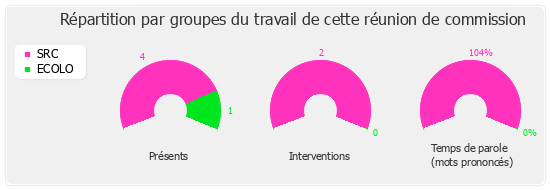Mission d'information commune sur l'application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Réunion du 10 mai 2016 à 14h00
La réunion
Mission d'information commune sur l'application de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
La Mission d'information commune a organisé une table ronde sur les déchets et l'économie circulaire, avec la participation de M. Vincent Le Blan, délégué général, Mme Muriel Olivier, vice-présidente, et M. Didier Imbert, vice-président de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) ; M. Fabien Veyret, Mme Agnès Banaszuk, coordinatrice du réseau prévention et gestion des déchets, et Mme Morgane Piederriere, chargée des relations institutionnelles, de France Nature Environnement (FNE) ; M. Manuel Burnand, secrétaire général de FEDEREC ; M. Géraud Guibert, président, et M. Arnaud Gossement, avocat associé, de la fabrique écologique ; M. Nicolas Garnier, délégué général et M. Julien Baritaux, chargé de relations publiques, de l'Association des maîtres d'ouvrage en réseaux de chaleur et d'environnement (AMORCE) ; M. Baptiste Legay, chef de la sous-direction déchets et économie circulaire, et M. Loïc Beroud, conseil auprès du directeur général de la prévention des risques, de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer.

Après une première table ronde sur la prise en compte de la transition énergétique dans la stratégie des investisseurs, des banques, des organismes financiers et des assurances, la mission d'information commune sur l'application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a décidé d'en organiser quatre autres, ouvertes à la presse et diffusées sur le site de l'Assemblée nationale, dont les comptes rendus écrits seront donc publiés. Celle d'aujourd'hui est consacrée à l'économie circulaire et à la gestion des déchets, qui constituent un des volets importants de la loi.
Je précise que M. Géraud Guibert et M. Arnaud Gossement nous ont adressé, au nom de la Fabrique écologique, une note que j'ai transmise, hier, aux membres de la mission d'information.

Les dispositions contenues dans les trente-trois articles du titre IV, qui est issu du débat parlementaire, ont un caractère très concret. Ainsi, l'une des principales mesures opérationnelles de la loi est l'interdiction des sacs de caisse en plastique, prévue à l'article 75 et dont il faut saluer le bien-fondé, même si le décret d'application a été publié avec un certain retard, le 30 mars 2016. Cependant, les interdictions ne constituent pas l'essentiel du titre, qui met en oeuvre une transition s'appuyant sur des mécanismes concrets de responsabilité élargie du producteur : qu'on songe à la reprise du tissu d'ameublement ou aux objectifs définis par l'article 70 du texte.
Cette table ronde doit permettre au Parlement d'identifier ce qui fonctionne et les blocages éventuels, non de mettre en cause la responsabilité de quiconque – administration, éco-organismes, filières, consommateurs ou industriels, voire législateur, parfois taxé d'irréalisme. C'est dans cet esprit constructif qu'il faut situer cette table ronde, comme les travaux de la mission. C'est dans cet esprit, en tout cas, que je vous poserai quelques questions.
La note de La Fabrique écologique, que le président Chanteguet a évoquée, souligne des retards dans la publication des décrets, le taux d'application, assez faible, étant de 33 %. Une partie de ces retards provient de la nécessaire prudence de la section des travaux publics du Conseil d'État, à laquelle on ne saurait reprocher de sécuriser au maximum les projets de décrets, dans des secteurs où les acteurs économiques défendent leurs intérêts. On doit également souligner la prudence de l'administration vis-à-vis du respect du droit de la concurrence et des règles européennes de libre circulation. C'est, je crois, ce qui explique l'application différée de l'interdiction des sacs plastiques.
On peut aussi souligner que certaines dispositions s'appliquent plutôt bien, comme l'article 85 sur le recyclage des navires, dont le décret d'application a été pris le 2 décembre 2015.
Mais – je pose cette question aux représentants de la DGPR – n'aurait-on pas pu aller plus vite en ce qui concerne l'application de certaines dispositions, en anticipant le cadre réglementaire, pour l'interdiction de la vaisselle en plastique à compter du 1er janvier 2020, par exemple, dont je rappelle qu'elle est prévue par une directive du 20 décembre 1994 ? Pourquoi de tels délais ?
Quels seront les délais de parution des prochains décrets ? Y aura-t-il systématiquement une consultation publique ? Conformément à l'engagement pris par le Premier ministre, les rapporteurs peuvent-ils avoir les textes au fur et à mesure, et non pas être mis devant le fait accompli ?
J'aimerais aussi poser quelques questions plus précises à l'ensemble des intervenants. Considèrent-ils que les objectifs de l'article 70 de la loi, s'agissant notamment de la réduction de 10 % de la production de déchets ménagers d'ici à 2020 ou du tri ou du retraitement de l'ensemble des emballages plastiques, également d'ici à 2020, sont tenables ? Au-delà de ce qui est prévu pour l'interdiction des emballages de presse et le tri à la source, ne faut-il pas prévoir d'autres mesures, quand on sait le faible taux de reprise du plastique ? La même question se pose pour la valorisation.
Le décret du 10 mars 2016 réserve aux agglomérations de plus de 2 000 habitants la collecte au moins hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles. Cette mesure ne contrarie-t-elle pas nos objectifs en milieu rural ? Pourquoi ce seuil de 2 000 habitants ? Dans le texte antérieur, il était de 500 habitants.
Où en est la filière de reprise des bouteilles de gaz, prévue par l'article 81 ? La question, que notre président a posée récemment aux représentants de la profession, est restée sans réponse. Faut-il un décret, alors que l'article 81 ne le prévoit pas explicitement ?
S'agissant des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), le décret du 10 mars 2016 prévoit la possibilité d'établir une chaîne de contrats et, le cas échéant, d'avoir recours à un opérateur qui contracte lui-même avec l'éco-organisme. Ce système est-il, selon vous, de nature à permettre une meilleure reprise ?
Concernant la vente de pièces détachées de véhicules issues de l'économie circulaire, le VIII de l'article 77 prévoit une application depuis le 1er janvier. Quelle est votre appréciation sur ce sujet ?
Je souhaite également vous entendre sur la responsabilité élargie du producteur (REP) papier, puisque la mission confiée à nos collègues Bardy et Miquel est terminée. Quid de la parution du décret ? Que prévoit-il pour la presse ? Selon Légifrance, il était prévu en mars.
En ce qui concerne l'article 93, qui traite de la reprise des déchets de matériaux par les distributeurs du BTP ? A-t-on une idée du nombre de sites commerciaux concernés ? Y a-t-il des réticences de la part de ces professionnels ? Que se passerait-il si ces dispositions n'étaient pas respectées ?
Enfin, je souhaite savoir où en sont les cahiers des charges des éco-organismes. Quelles sont les négociations en cours ou celles qui ont pu aboutir ? Cette question s'adresse principalement aux représentants de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) et de la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC).
Arnaud Gossement et moi-même avons piloté, depuis près d'un an, un groupe de travail sur la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Nous avons publié une première note au moment de l'examen du texte, et une deuxième, que vous avez eu l'amabilité de diffuser, sur l'application de cette loi. Il s'agit d'un point d'étape : nous y donnons un chiffre concernant les décrets publiés au moment où nous avons rédigé la note, mais d'autres l'ont été depuis.
Notre groupe a beaucoup travaillé sur la définition de l'économie circulaire, et nous nous félicitons que celle qui figure dans la loi soit très proche de la nôtre. Elle nous paraît particulièrement claire et adaptée à l'objectif assigné.
Nous avons par ailleurs constitué deux groupes de travail au sein de La Fabrique écologique. Le premier débouchera sans doute, en septembre, sur une note concernant l'obsolescence programmée. Le second, mis en place récemment, travaille sur la responsabilité élargie des producteurs et fera des propositions au dernier trimestre de l'année.
Nous nous devons d'alerter sur les conséquences que pourrait avoir l'évolution du prix du pétrole et des matières premières sur le développement de l'économie circulaire. S'il avait baissé de manière conjoncturelle, sur une courte durée, la difficulté aurait pu être surmontée. Mais, pour des raisons structurelles, cette baisse va se prolonger. Dans certaines filières, où les matériaux recyclés sont directement concurrencés par les matériaux de base, la question de la compétitivité ne manquera pas de se poser. Cette situation est une menace pour l'économie circulaire, comme l'ont montré les indicateurs des derniers mois. Il faut prendre sans tarder des dispositions – s'inspirant de celles qu'a prises l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour la filière plastique – afin de limiter les dégâts dans l'hypothèse où les prix directeurs ruineraient les perspectives de développement de l'économie circulaire.
La fiscalité sur l'énergie et les déchets est une question primordiale et La Fabrique écologique a travaillé à plusieurs reprises sur son évolution. Dans la suite logique des réflexions de ces derniers mois sur le prix du carbone, il nous paraît décisif, pour le développement de l'économie circulaire, d'accélérer le rythme de progression de la fiscalité sur les énergies fossiles et sur le carbone, pour compenser en partie les prix très bas des hydrocarbures. Il serait utile de se doter d'un dispositif qui fixe un prix plancher : la fiscalité ainsi récupérée pourrait être utilisée soit pour la transition énergétique, soit, si les prix devaient un jour remonter très fortement, pour rééquilibrer dans l'autre sens. Il est dommage que les réflexions sur une fiscalité contracyclique des produits fossiles n'interviennent que dans les périodes où le prix du pétrole est très élevé, alors qu'elles nous semblent s'imposer dans la situation actuelle. Cela aurait des conséquences directes sur les filières de recyclage.
Si l'on ne souhaite pas – ou pas suffisamment – s'engager dans cette voie, il nous paraît très important que des initiatives comme celle que l'ADEME a prise au niveau de la filière plastique se développent dans d'autres secteurs, qui restent à expertiser et à identifier. Cette logique nous paraît extrêmement importante pour que le mouvement puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, au contraire, nous inquiète fortement.
Vous avez défini dans la loi des objectifs généraux qui, parfois, n'en sont pas moins tellement précis qu'ils mettent les juges dans l'embarras. Je citerai l'exemple d'un contentieux en cours qui concerne les installations de tri mécano-biologique. Le législateur a défini, à l'article 87, un objectif que l'on pourrait traduire ainsi : les nouvelles installations ne sont pas pertinentes et doivent donc être évitées. Nombre d'opérateurs se tournent donc désormais vers les juristes pour savoir si l'on peut autoriser la création de nouvelles installations, bien que ce ne soit pas la priorité du Gouvernement ni de l'État, ou si elles sont interdites. Dans un jugement du 15 décembre 2015, qui fait l'objet d'un appel, le tribunal administratif de Pau a précisé que cet objectif était pour lui directement applicable et contraignant, et il a annulé une autorisation d'exploiter une nouvelle installation de tri mécano-biologique. Votre rapport sera donc lu attentivement par les différents opérateurs afin de savoir précisément ce que le Parlement a voulu dire à l'article 87.
Nous nous réjouissons de la définition qui a été retenue pour l'économie circulaire, dont il manque peut-être néanmoins un modèle plus opérationnel.
J'ai le sentiment que la discussion sur l'amendement sur la capitalisation des éco-organismes, défendu par le sénateur Miquel, ne porte pas seulement sur une question technique, mais sur une question politique, au sens le plus noble du terme. Elle n'a pas été tranchée, puisque la disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais elle rebondit aujourd'hui au niveau décrétal : seul le Parlement, me semble-t-il, peut clore le débat. Qu'est-ce qu'un éco-organisme ? Va-t-on vers la concentration ? Vers la concurrence ? Qui va créer des éco-organismes ? Avec quels moyens ?
Donnons un exemple concret de l'urgence que revêt la question. Deux juges ont estimé en début d'année que les contrats passés par les éco-organismes avec des collectivités territoriales étaient de droit public, ce qui est lourd de conséquences pour leur activité. Aujourd'hui, nombre d'entre eux s'interrogent sur la nature juridique de ces contrats, non seulement ceux qu'ils passent avec les collectivités territoriales dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets ménagers, mais tous ceux qu'ils signent, y compris avec des détenteurs publics pour des déchets professionnels. Là aussi, l'interprétation que donnera votre rapport est attendue. Qu'est-ce qu'un éco-organisme ? Est-ce le bras armé de l'administration, comme certains producteurs en ont parfois le sentiment ? On parle encore d'écotaxe à propos de la contribution aux éco-organismes. Est-ce, au contraire, la possibilité pour les producteurs d'organiser librement la collecte et le traitement de certains flux de déchets ?
Nous aurions besoin que le Parlement apporte des précisions sur leur statut, leur création et les conditions de leur activité, d'autant que nous sommes en pleine phase de renouvellement des agréments pour certaines filières, notamment celle des emballages.
En ce qui concerne la contractualisation, pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques, les éco-organismes sont appelés à passer des contrats avec les opérateurs de gestion au sens large, pour tous les déchets ménagers ou professionnels. Ainsi se pose la question des conditions de rédaction de ces contrats.
Vous avez aussi, madame la Rapporteure, posé la question des contrats en cascade. Peut-on contracter avec le contractant d'un éco-organisme ? A priori, la réponse est oui. En ce qui concerne les conditions et, surtout, les conséquences de cette contractualisation, les éco-organismes auront, avec ces contrats, un pouvoir d'information, sinon de contrôle, sur les flux de déchets, mais, en contrepartie, ils devront peut-être endosser une responsabilité nouvelle : tous n'en ont peut-être pas pris conscience. L'administration est appelée à apporter des précisions sur les points qui relèvent du domaine réglementaire, mais nous examinerons attentivement les développements qui, dans votre rapport, permettront éventuellement de clarifier les conditions dans lesquelles les opérateurs contractent avec les éco-organismes.
La note de La Fabrique écologique a souligné que la publication des décrets était en retard par rapport à ce qui était annoncé, soit par la ministre, soit par l'intermédiaire du site officiel Légifrance. Il ne s'agit pas de remettre en cause le travail de l'administration, mais de s'interroger sur les raisons qui font que les décrets concernant certaines mesures structurantes, comme la programmation pluriannuelle de l'énergie – qui, certes, ne relève pas du titre IV –, n'ont toujours pas été pris, alors que le ministère les promettait pour fin 2015.
Le travail a été plus important en matière de déchets et d'économie circulaire, grâce, notamment, au grand décret-balai du 10 mars 2016. Toutefois, ce décret peut faire l'objet de quelques observations. Ainsi, le règlement concernant la filière des déchets du BTP était très attendu : il a fait l'objet de nombreux débats et, donc, de compromis, mais il est juridiquement fort complexe et l'on peut se demander s'il pourra être appliqué. En effet, eu égard au nombre de dispositions législatives qu'il faudra respecter, et même si l'affichage de l'adresse est obligatoire, il sera difficile de trouver le lieu de reprise, situé dans un rayon maximal de dix kilomètres de l'unité de distribution. Il conviendrait d'apporter des clarifications sur la portée de l'article 93, afin de fluidifier la gestion des déchets du BTP par certains distributeurs.
Enfin, La Fabrique écologique tient beaucoup au fabuleux levier de développement que constituerait l'introduction de l'économie circulaire dans la commande publique. A priori, modifiant une précédente loi sur la consommation, le texte n'appelait pas nécessairement un décret d'application. Il semble toutefois, d'après l'échéancier d'application de l'article 76, que le schéma de promotion des achats publics responsables doive être complété, pour être opérationnel, par une disposition réglementaire, qui était envisagée pour le mois de janvier 2016. Faut-il vraiment passer par la voie réglementaire ?
France Nature Environnement (FNE) estime que le titre IV de la loi relative à la transition énergétique devrait permettre d'amorcer la transition vers une économie circulaire. Nous sommes sur la bonne voie, puisqu'un certain nombre de décrets ont déjà été publiés. Mais, pour que les mesures soient réellement appliquées et mises en oeuvre et que les objectifs et les ambitions soient atteints, il faut que des moyens humains, techniques, financiers et économiques soient consacrés à l'application de la loi.
Il faut également mettre en place un cadre fiscal. Depuis des années, FNE demande l'instauration d'une vraie politique fiscale, liée à la politique « déchets ». Ce point a été largement débattu lors des dernières Assises nationales des déchets, en septembre 2015. La Commission européenne nous avait interpellés sur la question, indiquant que nous avions adopté une loi ambitieuse, mais que, pour la mettre en oeuvre, il fallait un volet fiscal incitatif afin de mobiliser l'ensemble des acteurs. Nous espérons que le prochain projet de loi de finances sera l'occasion, pour le Gouvernement et les parlementaires, de mettre en oeuvre ce volet fiscal, avec une TVA réduite pour les collectivités qui auraient mis en place une collecte sélective de biodéchets ou une tarification incitative en matière de déchets. L'article 70 ne fait une obligation ni de l'une ni de l'autre, se contentant d'inciter les collectivités à se saisir de ces outils, qui devraient permettre d'atteindre les objectifs fixés par la loi.
M. Guibert l'a rappelé, il faut soutenir l'économie du recyclage, qui souffre de la baisse du cours des matières premières et du pétrole. Il serait également important de soutenir l'économie de la prévention des déchets, c'est-à-dire les activités de réemploi, de réparation, de refabrication ou de rénovation. Certes, au niveau européen comme au niveau français, la loi donne la priorité à la prévention des déchets, mais cela ne se vérifie toujours pas dans les faits. Les bâtiments, par exemple, ne sont pas éco-conçus pour être ensuite déconstruits, avec la possibilité de récupérer des matières ou des produits à réemployer ou à recycler. On utilise aujourd'hui assez peu de matières recyclées dans les bâtiments. Nos produits de consommation courante sont encore très peu durables et nos emballages ne sont pas réemployables.
Il est également nécessaire de compléter la planification. Les plans régionaux devraient être adoptés assez rapidement. Au niveau national, nous attendons encore le plan de réduction et de valorisation des déchets, qui était prévu pour 2014, ainsi que la stratégie nationale de transition vers une économie circulaire, qui devrait nous permettre d'identifier les différents paliers dans la mise en oeuvre de cette loi et de ses différentes mesures.
L'exemple du secteur du BTP illustre les idées que nous portons aujourd'hui : la nécessité d'un soutien économique et d'une incitation fiscale, le besoin de soutenir les activités de prévention des déchets et le besoin de planification. En France, le secteur du BTP est responsable de 247 des 345 millions de tonnes de déchets produites. On en parle trop peu au regard de l'importance des enjeux. Il faut absolument éco-concevoir nos bâtiments pour favoriser le recyclage et le réemploi des matières. Pour y parvenir, il faut mettre les acteurs en mouvement, les sensibiliser, les former, les informer et les inciter à mettre en place ces différentes mesures.
Il est possible de réduire de 10 % la production de déchets ménagers d'ici à 2020 : il suffit d'en avoir la volonté et de prévoir des débouchés supplémentaires pour consommer les matières premières de recyclage.
Le recyclage des bouteilles de gaz est très délicat, car leur manipulation est extrêmement dangereuse. Trop de bouteilles se retrouvent sur les chantiers de ferraille et sont la cause d'accidents mortels, passant dans les broyeurs qui provoquent des explosions plus ou moins graves. Ayant dirigé pendant des années la commission « broyeurs » de la FEDEREC, je peux vous dire qu'il s'agit d'un problème récurrent. Il existe des solutions, mais elles sont extrêmement coûteuses. La reprise des bouteilles de gaz n'est pas généralisée. Primagaz et Butagaz jouent le jeu et les reprennent gratuitement. On peut aussi faire venir des spécialistes qui demandent 50 euros pour faire exploser une bouteille. Mais, sur les chantiers, on hésite à franchir le pas, et on stocke d'importantes quantités, en espérant que la reprise sera organisée un jour.
Vous nous avez interrogés sur les DEEE et les contrats avec les éco-organismes. Un tel système peut en effet améliorer la reprise. Les éco-organismes ont la capacité financière et le mandat pour organiser les choses. Toutefois, le système a une limite : en matière de recyclage des pneumatiques, par exemple, le producteur met une certaine quantité de pneus sur le marché, fait une commande de reprise et arrête la collecte quand il a atteint son quota. Les détenteurs, quant à eux, se plaignent souvent que personne ne vienne chercher leurs pneus.
Ce sujet concerne aussi les DEEE. En dehors de Récylum pour les tubes et lampes, les principaux acteurs de la filière sont Eco-systèmes, l'éco-organisme européen ERP (European recycling platform) et Ecologic. L'agrément d'ERP n'ayant pas été renouvelé, il a interrompu son activité mais gardé l'argent des metteurs sur le marché, si bien que les deux autres éco-organismes ont récupéré son activité sans forcément disposer des financements. Aussi, des tensions apparaissent, notamment du côté d'Ecologic.
Le système peut tenir, mais la question de la capacité financière de l'éco-organisme se pose, ainsi que celle des difficultés inhérentes au marché. Dès lors qu'il y a plusieurs éco-organismes sur un même terrain de jeux, des surenchères sont à prévoir, tirant les prix vers le bas. Certes, on peut se dire que la concurrence est une bonne chose, mais elle peut avoir des effets pervers, tels que la dégradation de la prestation environnementale et celle des marges des opérateurs. L'objectif des éco-organismes étant souvent de faire leur marge sur le dos des opérateurs, on peut arriver à une situation de blocage. N'oublions pas, en outre, que les éco-organismes subissent eux-mêmes les effets de la baisse du coût des matières premières. Ils paient au même prix le service de recyclage mais récupèrent une matière dévalorisée, ce qui affecte leur budget. Ecologic se demande ainsi comment il pourra poursuivre sans recettes. Le principe est bon, mais la question de l'organisation globale des éco-organismes se pose. Quand les prix sont élevés, tout va bien, mais il faut rester vigilants et regarder ce qui se passe dans les autres pays.
En ce qui concerne les pièces de réemploi, l'application de la disposition est prévue à compter du 1er janvier 2017. Dans les faits, on note quelques difficultés, s'agissant notamment des pièces automobiles, qui font l'objet d'un gros marché à l'export. Or les opérateurs se sont retrouvés soumis à des contraintes importantes. Nous avons préconisé une sortie du statut de déchet implicite dès lors qu'il y a qualification de pièce de réemploi. Cela dit, on ne peut pas inonder les pays d'Afrique de vrais déchets. Comment bien arbitrer en la matière et faire en sorte qu'on exporte vraiment une pièce de réemploi et non un déchet ?
Par ailleurs, ouvrir le marché du réemploi, c'est aussi accepter la pièce de réemploi dans la réparation des voitures. Cela nécessite de passer des conventions avec les compagnies d'assurance. La France n'est pas très en avance en la matière, car ce n'est pas l'intérêt des constructeurs, dans la mesure où ce sont des marges en moins pour les réseaux et pour les marques. C'est un sujet délicat au plan commercial.
En ce qui concerne le BTP, y a-t-il suffisamment de sites commerciaux ? Concrètement, un centre commercial, qui vend différents matériaux, peut installer un petit box pour récupérer quelques déchets, mais cela ne sera pas réaliste sur le long terme, surtout si les clients déposent tout dans le même box. Il vaudrait mieux passer des accords avec des centres acceptant plusieurs types de déchets.
Pour ce qui est du cahier des charges des éco-organismes, je fais référence aux débats que nous avons sur Eco-Emballages, l'arrivée de Valorie et d'ERP. Nous avons quelques craintes concernant la fuite des déchets vers l'Allemagne. Par ailleurs, pour être plus compétitif, Ecologic veut envoyer ses déchets en Espagne, où la mise en décharge est moins onéreuse. Il paraît délicat de facturer le consommateur français pour envoyer des déchets en Espagne ou en Allemagne.
En Europe, la fiscalité n'est pas déclinée de la même manière dans tous les pays. Il faut faire preuve de vigilance. Cela étant, nous craignons de retrouver le même système que pour les DEEE, avec des effets pervers. Le principe de la concurrence entre éco-organismes est excellent, mais ses conséquences peuvent être dommageables pour la France. Si nous perdons des déchets qui partent vers l'Allemagne, nous perdons de la valeur, de la ressource et du pouvoir calorifique.
En ce qui concerne la nécessité de mettre en place des systèmes de contrôle, la loi est ambitieuse, mais il nous faudra tout de même réfléchir à la façon de mesurer et de contrôler, ce qui n'est pas simple.
S'agissant des pièces issues de l'économie circulaire qui pourraient remplacer les pièces neuves, on peut, à mon avis, en rester aux définitions existantes.
Concernant le principe de proximité, la FEDEREC estime que cela réduit les coûts logistiques, et donc l'empreinte CO2. Cependant, les capacités ne sont pas toujours en place. L'industrie papetière, par exemple, peut consommer 60 % des déchets de papier. Il faut donc exporter le reste, à moins de recréer de la capacité industrielle en France. Même chose pour les ferrailles : 40 à 50 % d'entre elles quittent la France, où la consommation industrielle est insuffisante. En tant que tel, le principe est sain, mais on ne peut l'imposer dans les faits. Il faut faire preuve d'un peu de réalisme industriel.
La gouvernance des filières REP est un sujet très important. En même temps que les éco-organismes montent en puissance au fil des ans, en termes de compétences, de moyens et de recherche-développement (R&D), les opérateurs s'appauvrissent et deviennent des exécutants, ce qui est préoccupant. Nous souhaitons que les fédérations soient actives au niveau de la gouvernance et représentatives au sens de la loi de mars 2014, c'est-à-dire qu'elles aient une ancienneté supérieure à deux ans, un vécu d'implantation territoriale, une certification des comptes, une audience significative et une convention collective. Il ne faut pas laisser n'importe qui s'exprimer sur ces sujets.
L'extension des consignes de tri est une mesure saine. Cela étant, dans la réalité, on va consommer beaucoup, en termes d'énergie électrique et de logistique, à vouloir séparer tous les déchets par catégorie. Est-ce réaliste dans tous les cas et dans tous les contextes économiques ? Dans certains cas, plutôt que de vouloir recycler à tout prix, il vaut mieux faire un bon combustible solide de récupération (CSR).
En ce qui concerne l'éco-conception, nous avons encore beaucoup à faire. Il faut que les opérateurs qui traitent les produits soient mis dans la boucle. Je suis surpris que les éco-organismes décident seuls de l'éco-modulation. Nous, qui faisons le travail, devons pouvoir dire ce qu'il en est.
Enfin, il faut renforcer la lutte contre les sites illégaux. Depuis quelques années, des bandes organisées internationales se livrent au vol de métaux. La France a pris l'initiative d'interdire les achats en espèces. La démarche était bonne, mais les ventes se font maintenant dans les pays frontaliers, et nous avons bien du mal à imposer ce principe au niveau européen. Tout reste à inventer et, même si FEDEREC est très impliquée dans les relations avec les douanes, le sujet est délicat.
Par ailleurs, il est nécessaire de produire des CSR. Or, par rapport à l'Allemagne, la France part de loin. La cimenterie a de gros avantages : elle prend peu d'argent, toutes les cendres vont dans le clinker et se retrouvent dans le béton, ses traitements à haute température entraînent peu d'émissions. Toutefois, si l'on veut faire un traitement correct, maîtriser les cendres et les rejets, cela a un coût et, de toute façon, la filière cimentière ne peut pas tout éliminer. La FNADE a mené des travaux sur ce sujet, mais, aujourd'hui, il faut trouver les solutions industrielles adéquates. Deux logiques s'affrontent : soit on fait du traitement de proximité avec des petites unités, soit on met en place, « à l'allemande », des structures de 600 000 tonnes et on va chercher les déchets plus loin – ainsi, les Allemands aimeraient bien venir chercher les déchets en France.
Nous nous sommes réjouis de l'adoption d'une loi aussi ambitieuse qu'accessible, et notamment de l'intérêt qu'elle accorde aux déchets, tant ménagers qu'industriels. Si j'insiste sur ce point, c'est que, au niveau européen, le paquet « économie circulaire », qui est en discussion, ne s'intéresse qu'aux déchets ménagers. La France a donc un temps d'avance.
Cette loi comporte une série de mesures concernant le tri à la source des cinq flux pour les déchets des activités des entreprises, l'extension des consignes de tri des plastiques, le tri à la source de tous les biodéchets, l'extension de la tarification incitative, les objectifs de valorisation pour les déchets du BTP, la reprise par les distributeurs de matériaux des déchets professionnels du BTP, le cadre réglementaire adapté pour développer la production d'énergie à partir de CSR, l'augmentation de la part des énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux de chauffage urbain à l'horizon 2030. Cette batterie de mesures a pour effet de favoriser la production de plus de matières et de plus d'énergie, ces deux volets étant importants.
Cependant, la loi ne prévoit pas de mesures d'accompagnement pour favoriser son application. Ces mesures pourraient être des soutiens, des incitations, des aides, des dispositifs fiscaux, une baisse de la TVA, une meilleure visibilité en termes de fiscalité.
Je souligne également le manque de mesures de contrôle et de sanctions, ce qui freine l'application de certains dispositifs. Je pense notamment à la mise en place du décret « 5 flux ». Que se passe-t-il si les industriels ne respectent pas les indications, concernant les déchets des activités des entreprises ? Le fait qu'il n'y ait ni contrôle ni sanction sera un frein à la mise en application.
Je pense également au développement du tri à la source et des biodéchets. C'est un volet structurant de la loi, mais il ne prévoit ni contrôle ni sanction. Quelles mesures d'accompagnement aurait-on pu prévoir, au moins pour inciter à faire ce tri ?
De même, en ce qui concerne le développement de la tarification incitative, des objectifs ont été fixés pour 2025, mais que se passe-t-il si personne ne s'y met et si le calendrier n'est pas respecté ?
Pour mettre en place toutes ces mesures et pour investir, les opérateurs et les industriels ont besoin de visibilité. Il y a, aujourd'hui, une certaine visibilité législative, qui n'est que partielle au niveau réglementaire. Mais, en l'absence de mesures d'accompagnement, cette visibilité n'est pas totale. En matière fiscale, nous n'en avons aucune pour le moment. Le projet de loi de finances rectificative ne nous a pas apporté les réponses que nous attendions en la matière. S'agissant notamment de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la FNADE soutient globalement le principe, évoqué par le Comité pour la fiscalité écologique, d'une hausse continue et progressive de la TGAP et d'une visibilité sur dix ans : cela correspondra au « plan déchets » qu'est en train de finaliser la DGPR.
Nous soutenons également le principe général des modulations, qui favorise la protection de l'environnement, ainsi que celui de l'égalité de traitement entre les installations publiques et les installations privées. Mais nous voulons également pouvoir entériner la trajectoire contribution climat-énergie et faire évoluer le marché du carbone pour les installations soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émission (ETS, Emission Trading Scheme), en cohérence avec la trajectoire de la contribution climat-énergie.
On dénombre une quinzaine de filières REP dans notre pays, ce qui ouvre une possibilité en termes de dépollution des déchets et de volume de matières à recycler pour favoriser l'économie circulaire. Les filières REP sont sans doute plus importantes en France que dans d'autres pays européens.
Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il est nécessaire d'arriver à un vrai partage des risques et de la valeur entre ceux qui mettent en marché, d'une part, et les opérateurs des filières REP, d'autre part. Nous avons atteint les limites du système, s'agissant notamment des filières organisationnelles.
Nous proposons de dresser un panorama de l'état financier des unités industrielles travaillant sur les filières, en particulier sur la filière DEEE où il y a d'énormes difficultés, et de développer ensuite un renforcement notoire des cahiers des charges pour les éco-organismes.
Il faut éviter les abus en termes de prix, qui mettent en danger les installations industrielles créées en France. Celles-ci ont parfois bénéficié, pour se développer, du soutien de l'ADEME, mais elles perdent aujourd'hui des tonnages et sont déséquilibrées au profit de nouveaux acteurs qui n'ont pas, pour l'instant, l'autorisation d'exploiter et vont devoir construire leurs installations.
Cela vaut pour les acteurs établis en France, mais il arrive aussi que l'exportation de déchets soit financée par le citoyen français, alors que nous disposons d'installations industrielles respectant tous les standards. Notre proposons donc, dans un deuxième temps, de bâtir, avec l'ensemble des opérateurs, y compris les éco-organismes, un véritable plan industriel national qui garantisse l'atteinte des objectifs fixés dans les filières REP, ces objectifs étant nécessaires pour atteindre ceux de la loi, tant sur la partie recyclage que sur la partie stockage.
La loi a pour ambition de développer le tri à la source, la collecte et le traitement des biodéchets des ménages et des gros producteurs de biodéchets, ces derniers étant déjà concernés depuis la loi de 2012, mais c'est une filière qui se développe assez lentement. En France, les biodéchets représentent 4 millions de tonnes, soit un volume très important. Ils sont soumis à la fois à la réglementation « installations classées pour la protection de l'environnement » (ICPE) et à la réglementation sanitaire, les déchets de cuisine et de table pouvant entraîner un risque sanitaire dans leur collecte et leur traitement. Les ICPE sont du ressort du ministère de l'environnement, tandis que l'agrément sanitaire est délivré par le ministère de l'agriculture. Or, aujourd'hui, la tentation existe de déroger à cet agrément sanitaire. Le ministère de l'agriculture prépare un projet d'arrêté visant à développer le compostage in situ, avec une utilisation jusqu'à une tonne par semaine. Or on considère qu'un producteur de biodéchets est important à partir de 10 tonnes par an. Ce projet d'arrêté contredit donc la loi. Des quantités très importantes seraient compostées in situ, sans autorisation d'exploiter ni agrément sanitaire, puisqu'on resterait en dessous des seuils, ce qui induit un risque sanitaire. Nous souhaiterions une application harmonisée des mesures et que, au-delà de 10 tonnes par an, il n'y ait pas de possibilité de dérogation.
On a beaucoup parlé du nécessaire soutien aux matières issues du recyclage. J'évoquerai, en complément, le développement de l'utilisation de l'énergie produite à partir de déchets. Comme l'a dit Vincent Le Blan, les industriels potentiellement utilisateurs d'énergie produite à partir de CSR ont aujourd'hui besoin de visibilité sur la contribution climat-énergie. La loi a fixé une trajectoire, qui a été en partie reprise dans la loi de finances rectificative pour 2015. Mais la contribution climat-énergie concernant les chaudières en dessous de 20 mégawatts, celles au-dessus de 20 mégawatts étant soumises à la réglementation européenne, la loi des quotas ETS devant être révisée pour l'après-2020, le marché des quotas étant aujourd'hui peu attractif – 6 à 8 euros la tonne –, les utilisateurs potentiels se demandent si la trajectoire s'appliquera vraiment en France et comment elle s'articulera avec le marché des quotas.
Il faut saluer le travail mené pour développer la filière CSR. Un décret va paraître, ainsi que des arrêtés sur la préparation de CSR et sur la production d'énergie à partir de CSR, et l'ADEME a lancé un appel à projets pour favoriser le développement d'unités de production d'énergie à partir de CSR. Nous nous réjouissons de tout ce qui a été mis en place depuis un an.
La loi affiche l'ambition de multiplier par cinq l'énergie renouvelable ou de récupération dans les réseaux de chaleur. Le CSR peut contribuer à alimenter ces réseaux ou des industries intermittentes. Pour développer cette utilisation, il serait nécessaire d'avoir un complément de rémunération pour produire de l'électricité à partir de CSR même dans les périodes où l'on utilise moins de chaleur. Cela n'est pas prévu dans les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En ce qui concerne la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), on cite l'énergie de récupération, sans véritablement fixer d'objectif. Elle devrait être intégrée dans la PPE et il faudrait, comme pour les autres énergies, définir des volumes. L'énergie produite à partir de CSR provient de refus de tri : il ne s'agit pas d'entrer en concurrence avec le recyclage, mais d'éviter le stockage. La loi prévoit de diminuer de 50 %, par rapport à 2010, les quantités stockées à l'horizon 2025. Cet objectif ne sera atteint que si le nécessaire a été fait au préalable en matière de prévention, de recyclage et de production d'énergie à partir de CSR.
Je voudrais souligner le mérite que nous avons eu à élaborer ensemble, dans des délais très courts, un titre IV qui est en quelque sorte le passager clandestin d'une loi traitant d'abord de la transition énergétique. Il a fallu deux ans pour rédiger la partie énergétique, et quatre à cinq mois pour le titre IV, qui offre un cadre structurant, avec des objectifs que nous partageons tous.
Ces objectifs mériteraient de figurer dans la future directive, dont débat la Commission européenne. Cessons de nous flageller : en matière de gestion des déchets et d'économie circulaire, la France figure probablement dans le Top 10. Tout dépend en fait de la manière dont on calcule les taux de recyclage : nos amis allemands sont bien meilleurs que nous en matière de lobbying…
Si, à quelques jours de Roland-Garros, vous me permettez une métaphore tennistique, je dirai que le cadre de la loi est bon, mais qu'il faut vérifier la solidité du cordage et la taille des trous dans la raquette. Elle contient par exemple beaucoup de mesures concernant la prévention. On peut toutefois se demander si le dispositif sera mis en oeuvre et efficace. La question des sacs plastiques et de la vaisselle jetable est symbolique, visant à faire prendre conscience du problème et à éduquer. Mais les gisements en jeu sont assez faibles et ne permettront pas d'atteindre une baisse de 10 % de la production des déchets ménagers. Le gaspillage alimentaire représente des gisements extrêmement importants, d'un tout autre ordre de grandeur. Entre les interdictions des sacs de caisse et la généralisation de la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'écart est de 10 à 50.
S'il est une mesure de prévention qui paraît excellente mais n'a pas totalement atteint sa cible, c'est bien la suppression de la date limite d'utilisation optimale (DLUO), qui ne s'applique qu'à très peu de produits. Ainsi, une DLUO figure toujours sur les paquets de riz ou de pâtes, alors qu'on peut continuer de manger sans risque leur contenu trois, voire quatre ans après la DLUO. Quoi qu'il en soit, vous avez ouvert une brèche, mais il faudra probablement réexaminer cette question.
Je serai plus nuancé en ce qui concerne le recyclage, même si nous avons tous travaillé sur le dispositif : l'extension d'un certain nombre de REP, en particulier les REP graphiques, est une immense déception. Le texte adopté était presque parfait, mais les décrets d'application le dénaturent – comme souvent, le diable est dans les détails. Les collectivités locales collectent et traitent un gisement de graphiques représentant à peu près 700 000 tonnes et coûtant 700 à 800 millions d'euros aux contribuables. Il s'agissait donc d'envoyer un signal pour dire que tous les graphiques qui se retrouvent dans la poubelle de recyclage, de Elle à France Football et à L'Obs, doivent contribuer à financer la collecte sélective, dans les mêmes conditions que les emballages. Or il nous est aujourd'hui proposé d'exonérer quasiment toute la presse ! Alors que la première partie du gisement, qui en représente une grosse moitié, paie aujourd'hui 65 millions d'euros pour un coût de 400 millions, soit une prise en charge de la REP à hauteur de 10 ou 12 %, et alors que le législateur est parvenu à élargir ce gisement, l'enjeu ne dépasserait pas 5 millions d'euros. Tout ça pour ça ! Au bout du compte, cela va se traduire par des aides en nature et des exonérations. Ce qui veut dire que Elle, France Football, Libération et les autres ne paieront quasiment rien.
Peut-être faudra-t-il un jour faire une loi REP, pour ne plus aborder, comme chaque fois, la question de manière erratique. Qu'est-ce que la base de la REP ? Quels sont les gisements sous REP ? En l'occurrence, je veux rassurer nos amis de la FNADE : je ne pense pas qu'il y ait des produits devant faire l'objet d'une responsabilité du producteur initial, tandis que d'autres n'y seraient pas soumis. Nous avons beau être les champions d'Europe de la REP, environ la moitié du gisement que l'on pourrait mettre sous REP ne l'est pas. Ainsi, la raquette de tennis dont je parlais tout à l'heure n'est pas sous REP. La plupart des outils de bricolage ou des jouets n'y sont pas non plus. Le système de responsabilité du producteur ne s'applique pas à un tiers de notre poubelle.
On se focalise sur la question de l'éco-organisme, qui est une forme de REP. Mais vous en avez créé une autre, qui n'est pas un éco-organisme, pour le BTP. Cela veut simplement dire que le fait de vendre impose une responsabilité au producteur. Il est temps de la définir, d'en décrire les formes, si l'on ne veut pas d'une économie circulaire à deux vitesses. Dès lors que l'on met sur le marché un produit qui se recycle, on paie une éco-contribution : il faut monter un éco-organisme, dont on ne sait pas trop ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, qui se présente comme une société anonyme sans but lucratif, mais avec l'argent du consommateur, qui est doté d'une mission d'intérêt général, qui doit demander une prolongation de son agrément, etc. Je ne condamne pas cette formule, mais on est en droit de s'interroger sur sa singularité.
J'en viens à la question de ce que j'appellerai une « para-REP BTP ». Si je parle de REP, c'est parce qu'il s'agit d'un metteur sur le marché, d'un distributeur, qui a une obligation, non d'un éco-organisme. Nous tenons là une nouvelle forme de REP assez intéressante. Nous croyons beaucoup à ce dispositif, dès lors que les points de collecte dont vous parliez tout à l'heure seront à la hauteur. Il ne s'agit pas d'un simple point de dépose.
Pour traiter 30 millions de tonnes de déchets ménagers, la France dispose de 4 000 déchetteries municipales. Pour plus de 100 millions de tonnes de déchets non municipaux, elle ne compterait que 300 déchetteries professionnelles. Il nous manque donc de nombreux points de collecte de déchets non ménagers : l'instauration de cette « para-REP » aidera probablement à combler cette lacune.
Toujours en ce qui concerne les REP, on a évoqué la concurrence, que nous regardons avec une certaine bienveillance, sous réserve de l'arrivée d'une vraie régulation. Dans le domaine de l'énergie, on a créé la CRE, dans le domaine de la télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Nous sommes, dans le domaine des REP, à la lisière du service public et du marché : il est temps de créer une instance. Avec ses modestes moyens, la DGPR essaie de jouer ce rôle de régulateur. Mais elle n'a qu'une indépendance relative, puisqu'elle est une direction de l'État, et ne peut donc être considérée comme une haute autorité indépendante. En outre, ses moyens sont limités : Eco-Emballages compte déjà 300 salariés. Or il n'y a que sept ou huit personnes à la DGPR pour gérer toutes les filières REP. Il va falloir se mettre à la hauteur de ce que nous avons construit.
J'en viens aux biodéchets. En la matière, nous avons eu quelques points de désaccord avec certaines personnes ici présentes. Il faut savoir qu'AMORCE représente aussi bien les collectivités qui ont fait le choix des biodéchets que celles qui ont fait d'autres choix, en particulier le compostage individuel et collectif, qui a été intégré à la mesure. La notion de tri à la source nous convient mieux que celle de collecte sélective obligatoire, car il existe de nombreuses façons de mettre les biodéchets de côté.
Certaines collectivités ont choisi de passer par des traitements mécano-biologiques (TMB). Or l'alinéa indiquant qu'il faut éviter les TMB me rend perplexe. Il s'agit d'abord d'un service public local, ce qui veut dire que la compétence organisationnelle de la gestion des déchets est communale. Avec cet alinéa qui l'interdit, on n'est pas loin de la recentralisation. La loi n'impose rien de tel pour les centrales nucléaires : pourquoi le faire pour les TMB ? Comment traiter cet alinéa ? Le tribunal de Pau a pris une décision, alors que l'arrêté d'exploitation a été publié un an plus tôt. Je suis serein, car je pense que l'appel va passer. Mais cela pose la question sur le long terme. Aussi avions-nous insisté pour que vous fixiez des objectifs de valorisation organique, en nous laissant choisir les modalités, jusqu'aux TMB.
AMORCE soutient la gageure de travailler sur la façon de mettre en place la collecte sélective en milieu très dense et très urbain, dans l'hypercentre de Lyon ou de Rouen. En ce qui concerne les taux de captage, il faudra assumer des surcoûts, mais l'ADEME pourrait les accompagner. Toujours est-il qu'il ne faut pas abandonner les TMB, qui ont au moins le mérite d'exister. Vous remettez en question des initiatives, bonnes et moins bonnes, prises ces vingt dernières années, et, aujourd'hui, les TMB. Or 50 % produisent un compost qui est aux normes. Il faut nous laisser la possibilité de développer cette solution, tant que les débouchés respectent la réglementation.
Nous sommes tous d'accord, ici, pour dire que la composante carbone des CSR augmente. Pour avoir introduit le Fonds chaleur dans une loi précédente, je tire la sonnette d'alarme pour toutes les énergies renouvelables thermiques. Nous en sommes tous conscients, nous allons dans le mur. Nous avons complètement décroché de la trajectoire sur les énergies renouvelables thermiques qu'avait prévue la loi. Plus aucun réseau de chaleur de grande quantité ne se crée aujourd'hui – et je ne parle pas seulement d'énergie fatale, mais de bois ou de géothermie –, car les élus locaux se demandent comment ils vont pouvoir défendre un réseau de chaleur si le prix du gaz continue de baisser. Il faut donc réviser à la hausse la trajectoire de montée en puissance de la contribution climat-énergie.
Le débat autour de son affectation est essentiel. Son augmentation devrait rapporter 1,5 milliard d'euros l'an prochain, mais il paraît que le montant a déjà été affecté. La loi relative à la transition énergétique – véritable loi de décentralisation énergétique – a redonné la parole aux territoires. Il serait temps qu'une partie de la fiscalité énergétique leur revienne également, tant au niveau des intercommunalités, consacrées comme lieu de l'organisation de la transition énergétique, qu'à celui des régions, qui en assurent la coordination.
Si la loi prévoit qu'il faut établir des plans climat air énergie territoriaux (PCAET) et des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), elle ne précise pas qu'il faut les mettre en oeuvre. Ainsi, on peut prétendre qu'on l'a respectée dès lors qu'on les a publiés. Nous proposons, pour les mettre en oeuvre, une affectation partielle de la moitié du 1,5 milliard dont je viens de parler, soit 700 millions d'euros, le reste étant prélevé sur la contribution au service public de l'électricité (CSPE). Cela représente 10 euros par habitant au niveau intercommunal, et 5 euros au niveau régional. Il s'agit de mettre en oeuvre la transition énergétique, de monter des structures d'approvisionnement bois, des plateformes de la rénovation énergétique. Nous en avons quatre-vingt depuis neuf mois, alors que nous en voulions 400 ou 500. Il s'agit également de monter des financements participatifs pour les éoliennes, de lutter contre la précarité énergétique, etc.
J'en viens à la question des déchets. Il y a trois ans, le Comité pour la fiscalité écologique, placé sous la présidence de Christian de Perthuis, a voté à la quasi-unanimité une réforme de la TGAP à deux volets. Alors même qu'était adoptée la loi sur l'économie circulaire, la TVA sur l'économie circulaire – c'est-à-dire sur la collecte sélective et sur le tri – augmentait de trois points. Le signal fiscal contredisait ce qui était inscrit dans la loi.
Nous proposons donc de revoir la TGAP, pour plusieurs raisons. Elle intervient en bout de chaîne, puisqu'elle est payée par les collectivités et, en définitive, par le contribuable, ou, pour ce qui est des déchets non ménagers, par les industriels. Or un centre de stockage contient plus de 50 % de déchets pour lesquels il n'existe aucune filière de recyclage. Est-il normal de sanctionner une collectivité territoriale parce qu'il reste 50 % de déchets non recyclables dans son centre de stockage ? Ne faut-il pas plutôt remonter à la source jusqu'aux metteurs sur le marché, jusqu'à ceux qui introduisent des objets qui ne se recyclent pas et qui, de surcroît, ne paient pas de REP ? Il y a là une double injustice : si vous mettez sur le marché un produit qui se recycle, vous payez ; si vous mettez sur le marché un produit qui ne se recycle pas, vous ne payez pas. À l'autre bout de la chaîne, on taxe une collectivité pour la simple raison qu'un jouet qui ne se recycle pas se retrouve dans sa décharge. Il manque tout un pan de politique fiscale pour que chacun participe à l'économie circulaire.
Nous revenons là à la question de l'optimisation. Est-il plus facile d'augmenter une REP déjà existante ou de s'intéresser à de nouveaux gisements ? Les mesures concernant le BTP apportent une première réponse à la question.
J'en tire la conclusion que le cadre est bon, le cordage assez solide, mais qu'il va falloir regarder de plus près ce qui se passe au niveau des décrets d'application. Je vous invite à vous pencher à nouveau sur les graphiques. Vous vous êtes tous battus pour ce texte, mais le résultat est loin de ce que nous étions en droit d'en attendre. Enfin, la loi de finances est probablement l'acte fondateur de l'économie circulaire.
Pour conclure, je dirai qu'il y a là un défaut de dimension politique. La ministre elle-même ne parle guère de l'économie circulaire, et il est toujours beaucoup plus question de la transition énergétique. Il faudrait placer les deux au même niveau.
Nous nous félicitons également du contenu de cette loi. Le titre IV est né d'une intuition de Ségolène Royal, qui, à quelques mois de la COP 21, a voulu intégrer la question de l'économie circulaire dans la loi relative à la transition énergétique. Le pari n'était pas évident, mais cette idée a soulevé beaucoup d'enthousiasme chez les parlementaires. C'est, pour les années à venir, une loi très structurante pour l'économie circulaire.
Les objectifs sont très clairs, quantifiés, et les mesures sont opérationnelles. Certaines sont d'application immédiate et d'autres nécessitent des décrets. Loïc Beroud vous dira tout à l'heure où en est la mise en place des textes réglementaires. Nous y avons beaucoup travaillé ces derniers mois, en lien avec toutes les parties prenantes.
Cette loi est équilibrée, concernant l'ensemble des cycles de vie des produits et des déchets. Il y a, en amont, beaucoup de productions et de consommations responsables. Certes, la loi comporte un certain nombre de mesures sur la gestion des déchets, mais ce n'est pas une pure loi « déchets », comme certains l'ont dit, puisqu'elle contient aussi des mesures concernant la production ou l'obsolescence programmée, qui sont pionnières au niveau mondial.
Suite à la censure du Conseil constitutionnel, des dispositions concernant le gaspillage alimentaire ont été reprises dans une autre loi, mais, in fine, l'intention des parlementaires a été respectée.
La loi contient également des intentions programmatiques pour 2020-2025. Je pense notamment à la diminution de moitié de la mise en décharge, au tri à la source des biodéchets, à la généralisation du tri des emballages et de tous les plastiques, ou encore à la tarification incitative. Tout cela va dans le bon sens.
Nous nous réjouissons de voir que nombre de territoires et d'acteurs agissent pour que cette loi soit réellement appliquée. Je pense en particulier aux plus de 30 millions d'habitants qui sont déjà dans des territoires zéro déchet et zéro gaspillage, suite aux appels à projets lancés en 2014 et 2015 par Ségolène Royal. Cela signifie qu'un Français sur deux vit sur un territoire souhaitant être pionnier par rapport aux objectifs fixés pour 2020-2025.
Autre motif de satisfaction, la France prend de l'avance par rapport au débat européen. Un paquet « économie circulaire » a été proposé fin 2015 par la Commission européenne. Avec cette loi, nous sommes armés pour être une force de proposition.
Pour ce qui est des décrets, nous avons dépensé beaucoup d'énergie, mais il n'en reste plus que quelques-uns à paraître. Une phase d'information sur ce qui a été retenu en termes réglementaires, de communication et d'échanges avec les acteurs, doit s'ouvrir. Elle est un préalable à l'instauration de mesures de contrôle, qui sont nécessaires pour assurer la crédibilité des mesures. Nous avons déjà commencé à y réfléchir au niveau du ministère. L'objectif étant que les contrôles soient proportionnés, le prérequis est qu'il y ait une bonne information préalable.
Nous voulons vous communiquer les dernières informations sur les textes d'application. Nous sommes loin des chiffres qui ont été cités au début de la table ronde et qui sont issus d'une note de la Fabrique écologique : ils se réfèrent sans doute à l'ensemble de la loi, non au seul titre IV, et, de surcroît, devaient être un peu anciens, car, en ce qui concerne l'ensemble de la loi, les choses ont bien progressé.
Ne l'oublions pas, le titre IV comporte vingt-deux mesures d'application immédiate. Plusieurs d'entre elles seront appliquées à compter du 1er janvier 2017, sans nécessiter un décret. Je pense, par exemple, à la commande publique en matière de papier recyclable et de travaux publics, qu'il s'agisse de bâtiments ou de routes, avec des obligations progressives, en termes de matières recyclées à intégrer et de recyclage des déchets issus des chantiers. Lorsqu'on parle de taux d'application, on oublie parfois les mesures d'application immédiate, qui ont un effet important sur les tonnages concernés.
Dix-sept mesures du titre IV nécessitent la prise d'un décret, onze d'entre elles renvoient à un décret en Conseil d'État. Or, on note un engorgement au niveau de la section des travaux publics du Conseil d'État. À ce jour, dix mesures ont été publiées au Journal officiel. Nous attendons la publication imminente du décret sur les CSR : c'est une question de jour, le texte est au Journal officiel depuis plus d'une semaine. Si l'on prend donc ce décret en compte, ce sont tout de même près de 60 % des mesures du titre IV qui sont publiées.
Elles l'ont été dans trois décrets, dont un décret simple, en décembre 2015, et un autre décret simple, le 30 décembre 2015. Parmi les décrets les plus importants et les plus difficiles à élaborer, je citerai notamment celui sur les sacs plastiques : le retard n'est pas dû seulement au passage en Conseil d'État, puisqu'il en est sorti fin décembre, mais à la notification européenne et à l'avis circonstancié que nous avons reçus et qui ont obligé à reporter la publication au lendemain de la fin du statu quo européen, le 30 mars.
Un autre décret regroupant cinq mesures a été publié le 10 mars, également en Conseil d'État. L'administration et les parties prenantes qui avaient participé à la concertation après la publication de la loi n'avaient pas perdu leur temps, et le texte est arrivé le 1er octobre 2015 devant le Conseil d'État. Mais celui-ci avait un nombre important de décrets à examiner ; la section des travaux publics doit encore statuer sur plusieurs décrets de la loi relative à la transition énergétique, sans compter ceux de la loi pour la reconquête de la biodiversité qui vont lui être transmis prochainement. À cela s'ajoutent deux décrets, qui sont encore au Conseil d'État. Nous avons bon espoir qu'ils soient publiés fin mai. Le taux d'application, qui devrait alors atteindre les 70 %, aurait pu être atteint à six mois pour le titre IV, s'il n'y avait pas eu ce retard dû à l'engorgement du Conseil d'État.
À ce jour, il reste cinq mesures à prendre. L'interdiction des gobelets et verres jetables est notifiée à Bruxelles : nous risquons de recevoir également un avis circonstancié, ce qui retarderait la publication de fin juin à fin septembre.
Nos collègues du Commissariat général au développement durable travaillent au décret sur les achats publics responsables. Il s'agit d'un décret simple, qui est en phase finale d'arbitrage interministériel. Nous pensons qu'il pourra passer au Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) début juin ou début juillet, pour être publié dans la foulée.
Le décret sur les allégations environnementales, concernant l'obligation de l'affichage des caractéristiques du produit, devrait être transmis au Conseil d'État fin mai ou en juin. Une notification sera également faite au niveau européen.
Le décret qui a été mentionné concernant la contribution de la presse en nature ou, en l'espèce, à la filière REP papier, fait encore l'objet d'un arbitrage interministériel. S'agissant d'un décret simple, il devrait pouvoir être publié dès que l'arbitrage sera rendu.
Quant au décret sur la mise en place de la filière REP des navires de plaisance recyclables, il nécessite un travail important d'étude du gisement du marché avant de pouvoir mettre en place concrètement cette filière. Par ailleurs, vous savez peut-être que la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour l'économie bleue a repoussé la mise en oeuvre de cette filière au 1er janvier 2018, ce qui, à notre niveau, ne change pas grand-chose. Nous sommes toujours décidés à publier ce décret le plus vite possible, dès que l'ADEME aura rendu ses conclusions. Nous envisageons une transmission au Conseil d'État à la fin du mois de juin ou en juillet.
En ce qui concerne les gobelets, la démarche est sensiblement la même que pour les sacs plastiques. Une directive européenne imposait aux États membres de limiter l'utilisation des sacs plastiques. Malgré cette injonction, il a fallu six mois d'échanges avec la Commission pour que notre décret soit approuvé par les autorités européennes. Pour les gobelets, nous avons quelques mois de décalage. Le statu quo se terminera fin mai. Nous attendons de connaître la réponse de la Commission à propos de cette mesure qui semble de bon sens, mais qui n'est pas explicitement prévue par le droit européen.
Pour élargir le débat, on peut aussi mentionner que le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité prévoit des mesures sur les microbilles en plastique et sur les cotons-tiges, dont on sait qu'ils sont générateurs de déchets marins qu'on retrouve sur les plages et dans les continents de plastique.
Sur tous ces sujets, le législateur demande des interdictions. Comme, pour ce type de démarche, la France est pionnière et a un temps d'avance sur le droit de la mise sur le marché des produits au niveau européen, ces procédures prennent du temps.
Madame la Rapporteure, vous avez posé une question sur le décret collecte. Il n'est pas spécifiquement prévu par la loi relative à la transition énergétique, mais nous l'avons rénové à l'occasion des décrets parus fin 2015 et début 2016. Il induit un assouplissement des fréquences de collecte puisqu'il demande aux collectivités de ne prévoir une collecte hebdomadaire que si elles ont plus de 2 000 habitants et non plus 500, comme c'était le cas auparavant. À notre sens, cette disposition accompagne bien les mesures prévues dans la loi relative à la transition énergétique, en particulier la mesure du tri à la source des biodéchets, car, plus les collectivités vont dans le sens d'un tri à la source des biodéchets, plus les ordures ménagères résiduelles restantes sont saines et peu fermentescibles, et moindre est la nécessité d'une collecte régulière. Cette idée, sur laquelle nous avons travaillé avec les représentants des collectivités territoriales, accompagne le mouvement en donnant un signal, en particulier aux collectivités qui pratiquent le tri à la source des biodéchets, sur la fréquence de leur collecte. Cela étant, quelles que soient les préconisations de la loi, et compte tenu de la responsabilité des collectivités en la matière, les élus locaux sont très sensibles aux questions de salubrité et de santé publique.
En ce qui concerne les bouteilles de gaz, dans la mesure où la loi relative à la transition énergétique a simplifié le dispositif législatif, un décret est nécessaire pour simplifier aussi le dispositif réglementaire. C'est l'un des deux décrets qui sont en ce moment au Conseil d'État. La séance étant prévue cette semaine, il ne tardera pas à paraître. Il va dans le sens d'une simplification, mais aussi d'une responsabilisation des metteurs sur le marché, dans le cadre du principe de REP, pour qu'aucune bouteille de gaz ne soit orpheline ou perdue dans la nature, pour que toutes puissent être réinjectées dans le circuit normal de consigne et de remplissage, ou mises proprement au rebut, afin d'éviter les accidents.
En ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques et la contractualisation, la mesure qui figure dans la loi relative à la transition énergétique est, à nos yeux, très positive et très utile. Les trafics sont nombreux dans la filière des DEEE, car les déchets métalliques ont une grande valeur. Il y a des filières grises, avec, parfois, des exportations illégales, y compris vers les pays en développement. Il est nécessaire d'avoir une traçabilité et une intégration des opérateurs – qui, parfois, font partie d'une économie grise – dans une filière, par le biais d'une professionnalisation, afin qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et qu'on puisse ainsi éviter les trafics.
Dans ce cadre, la contractualisation oblige toute personne qui collecte ou traite des DEEE à présenter un contrat qui la lie à un éco-organisme de la filière officielle. Ce dispositif contraint les personnes à rentrer dans une filière officielle, faute de quoi cela donne une indication à l'administration pour procéder à un contrôle. S'il n'y a pas de contrat, c'est qu'il y a un problème de légalité. La mesure est contraignante pour les opérateurs, mais est à la hauteur de l'enjeu. Les éco-organismes ont une vision complète de la filière, ce qui est positif. Le décret, qui est prévu en concertation avec les représentants des opérateurs, s'assure que cette contractualisation reste légère, essentiellement fondée sur la traçabilité, et qu'il n'y a pas de caractère invasif de l'éco-organisme dans les activités des opérateurs. Ce type de mesure participe à nos efforts pour lutter contre les sites illégaux.
Vous avez également évoqué, madame la Rapporteure, le décret sur les pièces détachées des véhicules hors d'usage, en rappelant que la loi prévoyait une application de cette mesure au 1er janvier 2016 et que nous étions en retard. C'est vrai, mais le sujet est complexe et a donné lieu à des discussions avec les représentants des professionnels. Le décret est au Conseil d'État et devrait paraître avant la fin mai.
En ce qui concerne le décret sur la presse, les débats ont été complexes et ont mobilisé les parlementaires. Suite à la parution de la loi, Mme Royal a confié une mission au député Serge Bardy et au sénateur Gérard Miquel, qui ont rendu leur rapport en février. Il comporte un certain nombre de propositions et de critères pour amener les publications de presse à s'améliorer en termes d'éco-conception de leurs produits, sachant que le respect de certains critères leur ouvre la possibilité de faire une contribution en nature plutôt qu'une contribution financière. Ce sujet est sensible. Il y a un enjeu d'équité pour les producteurs qui font une contribution financière quand ils mettent sur le marché des ramettes de papier ou des publications en papier hors presse. Dans le même temps, le rôle spécifique de la presse dans la démocratie a été mis en avant, dans le cadre de la loi. Le décret, qui se fonde sur les propositions du rapport de MM. Bardy et Miquel et dont nous souhaitons qu'il paraisse très prochainement, est en cours d'arbitrage interministériel.
Enfin, en ce qui concerne le décret sur le BTP et la reprise des déchets de matériaux par les distributeurs du BTP, vous souhaitez, madame la Rapporteure, connaître le nombre de sites concernés. Notre réflexion, en lien avec les professionnels, nous a amenés à sélectionner un périmètre et à le préciser par décret : 4 000 sites seraient concernés par l'obligation d'organiser une reprise, mais nous ne sommes pas certains que ce seront 4 000 points de reprise, car les professionnels ont beaucoup insisté sur la nécessité de pouvoir mutualiser ces points de reprise. Plusieurs magasins proches les uns des autres pourraient avoir un unique point de reprise offrant le même service, à moindre coût, à l'ensemble de leurs clients. Le nombre de mutualisations devrait être, au final, très inférieur à 4 000.
J'en viens aux éventuelles réticences des professionnels. Ceux-ci ont ressenti cette mesure comme une nouvelle réglementation qui s'imposait à eux. Dans toutes les filières REP ou « para-REP », ce type de dispositif induit une résistance de la part des professionnels, qui ne sont pas forcément convaincus. Nous avons entendu leurs besoins en termes de mutualisation et nous avons travaillé sur la question de la rentabilité de cette activité de reprise. Je rappelle que certains professionnels du secteur avaient spontanément mis en place, avant la loi, ce type de point de reprise parce qu'ils y voyaient un intérêt financier. Nous avons identifié une taille critique du site, à partir de laquelle l'activité de reprise peut être rentable. Nous avons réussi à convaincre le Conseil d'État qu'il convenait de prévoir à la fois un critère de surface minimale, comme le disait la loi, et un critère de chiffre d'affaires minimal. Le décret est paru. Seuls les distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et le chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros devront mettre en place cette reprise.
En ce qui concerne les sanctions, les professionnels sont en train de travailler plus finement sur l'identification des sites « obligés » et sur les possibilités de mutualisation. Nous travaillons avec eux pour vérifier que les choses se passent aussi bien que possible. Les sanctions qui existent pour les filières REP lorsque des producteurs n'appliquent pas leurs obligations d'adhésion à un éco-organisme peuvent également s'appliquer aux distributeurs qui ne respecteraient pas cette obligation.
J'en arrive à votre question sur les filières REP et les cahiers des charges. La filière REP est une filière de responsabilisation des producteurs. Il est donc important de laisser aux metteurs sur le marché la liberté de s'organiser comme ils l'entendent et d'encourager leur créativité pour qu'ils recherchent une gestion des déchets à moindre coût. Dans le même temps, cette liberté entre en conflit avec la question de l'encadrement. Il y a une forte demande pour que « liberté » ne soit pas synonyme de « jungle » et qu'il puisse y avoir des règles et un encadrement des filières, notamment en termes de concurrence et de projets économiques et industriels. Ce sont des choses que nous avons à coeur, que le législateur avait à coeur lorsqu'il les a transcrites dans des articles de la loi relative à la transition énergétique, dont un sur la gouvernance des éco-organismes, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Ce débat reste d'actualité.
J'évoquerai pour finir la fiscalité qui, selon moi, est le gros trou dans la raquette. Bien entendu, cette question ne pouvait pas être traitée dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, mais, pour que cela marche, il faut résoudre le problème de la TGAP. Des propositions ont été faites dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015, mais elles n'ont pas pu aboutir. Le sujet reste donc sur la table pour la prochaine loi de finances.

En effet, la fiscalité ne pouvait pas figurer dans la loi relative à la transition énergétique. Cela étant, on peut se demander si cette question sera abordée dans le cadre d'une loi de finances. Nous avons déjà eu quelques expériences et quelques déceptions…
Vous avez bien réussi à faire passer la contribution climat-énergie dans la loi relative à la transition énergétique !

Je suis moi-même encore surpris de ce succès !
En ce qui concerne la contribution climat-énergie, il faut compter avec le dispositif européen ETS. Sur un marché qui dysfonctionne, le prix de la tonne de carbone est de 5, 6 ou 7 euros. Pour 2016, le prix de la tonne de carbone contribution climat-énergie est de 22 euros, avec un objectif de 56 euros pour 2020 et de 100 euros en 2030. Aujourd'hui, certaines installations sont soumises au prix de la tonne de carbone de 2016, c'est-à-dire 22 euros, tandis que d'autres, compte tenu de leur taille, dépendent du marché européen ETS et sont soumises au prix de 5 ou 6 euros. Cet écart, qui est déjà important, va-t-il continuer à augmenter ? Ne faudrait-il pas trouver un dispositif qui permette de le réduire ?
J'en viens à la proposition du Président de la République, qui vise à fixer un prix plancher pour la tonne de carbone. L'idée ne serait-elle pas de mettre en place une forme de taxation complémentaire entre le prix de la tonne de carbone contribution climat-énergie et le celui de la tonne de carbone sur le marché ETS ? Comment les choses s'organisent-elles par rapport à la proposition du Président de la République ?
Si j'ai bien compris, cela s'applique au système électrique, de manière réduite pour le moment, même si l'on n'exclut pas…
Je parlais d'installations produisant de l'énergie à partir de CSR. Les industriels qui envisagent d'utiliser cette énergie comparent forcément son prix avec le futur prix de l'énergie produite à partir de combustibles fossiles.
Si cette trajectoire est maintenue, l'énergie produite à partir de CSR devient compétitive. Mais, si l'on tient compte du prix du marché du carbone et du fait que, au-delà d'une certaine puissance, c'est la réglementation ETS qui s'applique, on peut se demander si cette trajectoire pourra être maintenue. Aussi, les entreprises qui pourraient investir dans des unités produisant de l'énergie à partir de CSR sont dans l'incertitude et manquent de visibilité.
À mon avis, le problème de l'articulation entre le dispositif taxe carbone et les marchés des quotas ETS se pose. En tout cas, il y a un segment de proximité entre les deux qui peut permettre des distorsions de concurrence. Ce que j'ignore, c'est l'ampleur que cela représente. Quel est l'impact réel ? Il faudrait qu'une expertise nous dise si un mécanisme qui pourrait lisser cet effet de seuil serait utile.
En ce qui concerne les CSR, ce qui pose problème à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), c'est que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ne consacre pas une ligne aux énergies fatales et de récupération, qui ne constituent ni une énergie renouvelable, au sens strict, ni du charbon, ni du gaz. Aussi la DGEC ne peut-elle pas s'approprier complètement le sujet des CSR, qui est un peu hybride, entre une énergie partiellement renouvelable – on imagine 40 à 50 % de carbone organique – et une autre partie qui ne l'est pas, mais qui est fatale.
Nous avons, nous aussi, essayé de comprendre l'annonce présidentielle. Il me semble qu'on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé pour les certificats d'économies d'énergie (CEE). Dans les premiers temps, leur prix s'est effondré, et il a fallu augmenter le prix de la sanction pour retendre le marché. Mais, pour ce qui nous occupe, la seule question est celle de la compatibilité européenne. La France a-t-elle le droit d'établir, en cas de non-respect d'une obligation, un niveau de sanction supérieur au niveau du marché ?
Enfin, cette proposition ne répond pas, selon moi, à l'inquiétude des élus concernant les réseaux de chaleur au bois, la géothermie, etc. L'enjeu, pour nous, consiste à envoyer un signal fiscal sur le gaz ou le propane. Si vous voulez, par exemple, monter une chaufferie bois en Ardèche, la référence, c'est le gaz. Le prix du gaz s'étant écroulé, la proposition présidentielle ne règle pas le problème puisqu'on ne peut plus, par rapport au gaz, être compétitif avec une chaufferie bois.
D'autre part, la ministre a répété plus de dix fois devant la presse qu'elle doublerait le Fonds chaleur. La première fois qu'elle l'a dit, il y a trois ans, il s'élevait à 220 millions d'euros : il est aujourd'hui au même niveau. Faut-il oser faire un « Fonds chaleur flottant » ? Le Fonds chaleur fonctionne en référence à un niveau du prix de l'énergie. Or le prix du gaz s'effondre. Les réseaux de chaleur ayant été construits financièrement sur la base d'un autre équilibre économique, ils ne sont plus du tout compétitifs et il faudrait prévoir une clause de rendez-vous pour envisager un effort supplémentaire…
Que signifie un doublement du Fonds chaleur ? Si cela revient à inviter deux fois plus de projets à venir au Fonds, ce n'est pas doubler le Fonds chaleur, surtout dans une période où il n'y a pas de projets à cause du prix du gaz. Ce qu'il faut, c'est doubler l'aide apportée par le Fonds chaleur. Mais cela pose aussi des questions concernant l'encadrement des aides d'État.
Je le répète, je pense que l'annonce qui a été faite s'appliquait au système électrique. Il s'agit simplement d'une substitution des appels de puissance des installations pour la pointe et la semi-base, entre charbon, gaz, etc. Cela ne pose pas de problème dès lors que l'annonce se réduit à cela. Si, en revanche, on en élargit le champ, le problème de l'harmonisation du marché ETS et de la fiscalité se pose. La réflexion sur un mécanisme de lissage s'imposera un jour ou l'autre s'il n'y a pas d'évolution du marché. On peut imaginer que le marché ETS remonte, mais c'est loin d'être une certitude.
La proposition doit-elle s'appliquer en France ou dans le marché ETS européen ? L'annonce n'était pas très claire sur ce point.

Cela fait partie des réflexions que vont devoir développer Alain Grandjean, Gérard Mestrallet et Pascal Canfin dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Parallèlement à une réflexion au plan national, il est très important d'en mener une au plan international. Nous subissons aujourd'hui le dumping de l'acier chinois, qui ne supporte pas toutes les externalités environnementales. La Chine pollue allègrement le reste du monde, participe grandement au dérèglement climatique et inonde l'Europe de son acier. Que se passera-t-il si l'on renchérit, par exemple, l'acier de la filière électrique ? Si l'on taxe la partie charbon, la filière électrique de recyclage de l'acier sera affectée, comme la filière fonte. On renchérira ainsi le prix de l'acier français, et l'on élargira le fossé entre le prix de revient de l'acier chinois et celui de l'acier français. C'est pourquoi il me semble très important de mener une réflexion au plan mondial : nous sommes tous cosolidaires de la gestion de la planète, tous les États devraient avoir un intérêt à activer la transition énergétique, que ce soit la Russie, la Chine ou les États-Unis. Il faut aller, si possible, vers des systèmes relativement simples, comme l'instauration de taxes à l'extraction, dont le montant serait fixé, pour le charbon, le gaz ou le pétrole, en fonction du potentiel de dérèglement climatique. Puis on pondérerait en fonction des dégâts.
Je reviens sur la proposition de Nicolas Garnier concernant le doublement du Fonds chaleur. Le problème, c'est que la DGEC sera d'accord pour des énergies renouvelables, mais pas pour des énergies de récupération.
En ce qui concerne le paquet européen « économie circulaire », le législateur a introduit, en tête du code de l'environnement, une définition extrêmement importante, mais l'étape à venir doit préciser les conditions d'organisation sans créer trop de normes. Nicolas Garnier a raison de dire qu'il peut y avoir différents types de REP, et qu'il ne s'agit pas forcément de former un éco-organisme.
Aujourd'hui, l'un des points de vigilance du Parlement porte sur ce qui se passe au niveau européen, concernant le paquet « économie circulaire ». Le Parlement français n'ayant pas tranché sur certains points, ce sera peut-être fait au niveau européen. Mieux vaut, donc, anticiper les discussions européennes avant de transposer.
On parle beaucoup, pour ce qui est des déchets de construction, de la responsabilité du producteur et de celle de certains distributeurs, mais il faut réfléchir à la responsabilité du détenteur des déchets. En droit, il est déjà très compliqué de savoir ce qu'est un détenteur de déchets. En fin de compte, quelles sont ses obligations ? Que doit-il faire des déchets qu'il détient ? C'est une question qui, grosso modo, n'est traitée que sous l'angle de la sanction et de la responsabilité. Dans le cadre de la modification de l'article 8 de la directive de 2008, la Commission européenne a ouvert un débat très sensible sur l'incitation du détenteur, par exemple, à remettre ses déchets à certains opérateurs, dans une certaine filière. C'est, à mon avis, un point extrêmement important, sur lequel le Parlement doit agir.
Dans le cadre de cette directive, nous allons revisiter un certain nombre de définitions. Des opérateurs et des éco-organismes avaient soulevé le problème de la distinction précise à établir entre les catégories de déchets. Il est une catégorie qui, en droit, ne veut pas dire grand-chose, celle des « assimilés ». D'autre part, la proposition de la Commission parle des déchets municipaux, mais reste muette sur la distinction entre déchets professionnels et déchets ménagers. Il s'agit pourtant d'un enjeu extrêmement important et d'une question fondamentale pour les juristes.
Dans les filières REP, nous avons aussi, dans certains cas, des problèmes d'équilibrage. Une mission sur ces problèmes a été confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il n'est pas facile d'équilibrer des flux ménagers et professionnels, dès lors qu'on ne sait pas toujours où est la frontière entre les deux flux à l'intérieur d'une même filière.
Enfin, en ce qui concerne le TMB, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur Garnier, quand vous dites qu'il est du ressort des collectivités territoriales. Le TMB est aussi un enjeu de politique nationale, et le Parlement était tout à fait fondé à trancher sur cette question. Le problème, c'est que je ne sais pas très bien comment il doit le faire. D'ailleurs, les juges hésitent aussi sur ce point. Lorsqu'on est juriste, on accorde de l'importance aux travaux parlementaires. Pour cette raison, je le répète, votre rapport sera lu très attentivement, s'agissant notamment de certaines imprécisions de la loi, que j'ai essayé d'énumérer et qui n'appellent pas forcément un décret, mais plutôt une explication.
Je voudrais revenir sur la distinction entre déchets professionnels et déchets ménagers. Je ne comprends pas pourquoi on voit, au niveau européen, se généraliser l'envie que le service public s'approprie une partie des déchets privés, alors que ce sont des charges supplémentaires et qu'il devrait s'en défaire au maximum. En Allemagne, comme en France, il essaie de grignoter. Il est fondamental de savoir où se situe la limite et pourquoi certaines collectivités veulent prendre en charge des services d'assimilés. C'est également la tendance au niveau européen. Voilà pourquoi j'estime qu'il est important de définir les choses et de recadrer les limites du service public et du service privé.

L'article 69 prévoit une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire. Monsieur Legay, que savez-vous du calendrier ?
Comme nous arrivons à la fin de cette table ronde, je tiens d'ores et déjà à vous remercier tous pour votre participation à nos travaux. Je souhaite que nos échanges soient le plus productifs possible.
Certains d'entre vous ont parlé de l'ADEME : ses représentants ont été invités à cette table ronde, mais ils ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Cela étant, nous avons eu l'occasion d'échanger la semaine dernière, dans le cadre d'une autre audition.
En ce qui concerne la stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, certaines des briques qui la composeront sont déjà en préparation. Je pense notamment au plan déchets, qui était en cours d'élaboration avant la loi relative à la transition énergétique. Les travaux ont été suspendus dans l'attente de la loi, mais nous sommes aujourd'hui déterminés à les mener à bien.
Un élément particulièrement important et structurant dans le cadre de la stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire a été explicitement inscrit dans la loi : il s'agit du plan de programmation des ressources. À la suite de la Conférence de mise en oeuvre sur l'économie circulaire, à Gardanne, et de la Conférence environnementale de 2013, le Commissariat général au développement durable avait, en 2014-2015, commencé ses travaux sur le sujet avec les parties prenantes. Sans doute était-il trop tôt pour définir une stratégie pluriannuelle qui puisse s'inscrire dans la stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire. Mais ces travaux ont été relancés par le Commissariat général au développement durable et devraient aboutir au début de l'année 2017.
Il y a un débat autour de ce qu'on pourrait appeler la « fiscalité circulaire ». Aujourd'hui, la TGAP déchets – qui n'est qu'une TGAP en aval, c'est-à-dire une taxe boiteuse qui laisse passer bien des choses entre les mailles du filet – rapporte à peu près 450 millions d'euros à l'État. Le budget de l'ADEME en crédits de paiement tourne autour de 150 ou 160 millions d'euros. L'heure n'est plus aux taxes affectées, mais un débat démocratique, pour savoir quelle part de la fiscalité du déchet doit être affectée à la mise en place d'une politique d'économie circulaire, me semble relever d'un projet de loi de finances.
Enfin, vous savez sans doute que l'économie circulaire dispose désormais d'un logo, le Triman. Le consommateur sait que les vêtements, les téléviseurs ou les emballages sur lesquels il figure auront une deuxième vie. On ne parle pas assez de ce logo, qui est en train de se déployer partout – on peut même le voir, depuis la semaine dernière, chez McDonald's – et la DGPR a joué un rôle important pour sa survie, car il n'était pas souhaité par tous. Aujourd'hui, les masques tombent : si le Triman est absent d'un produit, cela signifie qu'il n'a pas de deuxième vie.

Il ressort de cette rencontre qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures de soutien et d'accompagnement, et de développer la fiscalité.
Des travaux ont été menés, dans le cadre du Comité pour la fiscalité écologique, sous la présidence de Christian de Perthuis. Des propositions ont été faites, mais, à ce jour, elles n'ont pas abouti. Le Comité pour l'économie verte, présidé par Dominique Bureau, a pris sa suite et nous attendons ses propositions.
Par ailleurs, vous attendez tous avec impatience, comme nous, la loi de finances pour 2017, dans laquelle pourraient figurer certains dispositifs fiscaux. Nous devons franchir les étapes les unes après les autres. Nous avons déjà imposé la contribution climat-énergie, mais nous devons aller plus loin.
J'appelle de mes voeux la mise en place et le financement d'un véritable « fonds transition énergétique » qui n'existe pas aujourd'hui, dans la mesure où il est peu ou pas financé, et de manière très nébuleuse. Nous aurions besoin de clarté et de transparence en la matière. S'il existait un fonds transition énergétique doté de 1,5 milliard ou 2 milliards par an, tous les professionnels seraient satisfaits, mais aussi les ONG et les différents acteurs, ainsi que les élus.
Je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette table ronde.
Membres présents ou excusés
Mission d'information commune sur l'application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Réunion du mardi 10 mai 2016 à 14 heures
Présents. - Mme Sabine Buis, M. Jean-Paul Chanteguet, Mme Geneviève Gaillard, Mme Martine Lignières-Cassou
Excusé. - M. Patrice Carvalho
Assistait également à la réunion. - M. François-Michel Lambert