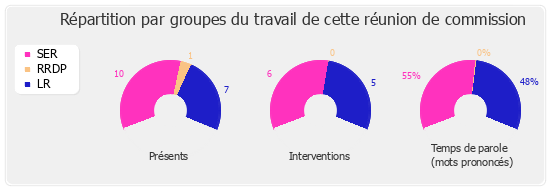Commission des affaires étrangères
Réunion du 4 octobre 2016 à 16h45
La réunion
La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq.

Nous accueillons M. le secrétaire d'État aux affaires européennes pour une audition fermée à la presse sur les suites du référendum britannique. Je rappelle que le Président de l'Assemblée nationale préside une mission d'information sur le Brexit afin d'assurer le suivi de la préparation des négociations qui vont s'ouvrir lorsque les Britanniques auront décidé d'invoquer l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ce que Mme Theresa May a déclaré à l'occasion du congrès du parti conservateur vouloir faire en mars 2017 – voilà donc une incertitude levée parmi de nombreuses autres.
Notre mission d'information, qui s'est réunie trois fois depuis sa constitution, vous a déjà auditionné, monsieur le secrétaire d'État. J'ai néanmoins jugé utile que vous vous exprimiez aussi devant la commission des affaires étrangères, afin que ceux de ses membres qui ne participent pas à ladite mission d'information puissent vous entendre.
Je vous propose de commencer par revenir sur les conditions dans lesquelles se préparent de part et d'autre ces négociations, sur nos positions, nos exigences et les lignes rouges à ne pas franchir selon nous. S'agissant du calendrier, l'article 50 sera heureusement activé avant la fin mars 2017, ce qui permettra aux négociations d'être achevées avant les élections européennes de juin 2019. Il aurait été paradoxal, en effet, d'aborder les élections européennes avec la perspective que des députés et des commissaires européens britanniques soient désignés.
Mme May a également annoncé une grande loi d'abrogation de la loi de 1972, qui interrompra l'application en droit interne de la réglementation européenne. Concrètement, cette loi codifiera les dispositions européennes dans la loi britannique en ouvrant la voie à des amendements. Elle sera examinée dès le printemps, mais n'entrera en vigueur qu'après la sortie formelle du Royaume-Uni de l'Union. C'est un moyen pour Mme May, qui en a besoin, d'associer le Parlement britannique au processus, comme il le réclame – en particulier l'opposition.
En somme, une méthode se dessine. La ligne politique, toutefois, me semble encore très floue : il va de soi que les Britanniques tenteront de négocier le meilleur accord possible pour eux en s'efforçant d'obtenir – ce à quoi nous devons vigoureusement nous opposer – la limitation de la liberté de circulation des personnes et les avantages du marché unique, notamment le passeport financier. Comment allons-nous y réagir ?
Le Gouvernement britannique est très divisé : aux tenants d'un soft Brexit font face les partisans d'un hard Brexit, notamment le porte-parole et le ministre des affaires étrangères, qui sont prêts à mettre en cause la liberté de circulation quitte à sacrifier l'accès au marché unique – ce qui me semble être pour partie de la fanfaronnade. Comment voyez-vous les choses chez vos interlocuteurs britanniques, étant entendu que nous nous interdisons de discuter avec eux avant qu'ils n'aient invoqué l'article 50 ?
Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas intérêt à entrer dans le débat intérieur, ni à faciliter le travail des négociateurs britanniques. Comme les autres membres de la mission présidée par M. Bartolone, je suis convaincue que nous ne pouvons pas dissocier la quatrième liberté, celle de la circulation des personnes, des autres règles de circulation dans le marché unique. Je ne partage absolument pas l'opinion exprimée par Jean Pisani-Ferry et l'institut Bruegel, et j'ai eu l'occasion de dire à mon homologue allemand, signataire de l'article en question, que je ne l'aurais pour ma part jamais signé. De même, j'ai directement fait part de mon désaccord à M. Pisani-Ferry. La semaine dernière, d'ailleurs, j'ai constaté lors d'une réunion au Bundestag avec nos collègues du Triangle de Weimar qu'une majorité de députés allemands approuve ma position, et non celle de M. Pisani-Ferry.
Vous nous direz, monsieur le secrétaire d'État, quelle forme pourra prendre l'accord de sortie du Royaume-Uni, mais aussi les accords futurs que nous conclurons avec ce pays. En effet, l'article 50 prévoit que l'accord de sortie sera négocié « en tenant compte » du statut futur du pays : tout est dans l'interprétation que l'on fait de la formule « en tenant compte ». Tout dépendra de l'unité et de la fermeté dont font preuve les Vingt-Sept : parviendrons-nous à les préserver ? À ce stade, nous sommes fermes ; le serons-nous dans la durée ?
Le sommet de Bratislava s'est traduit par l'adoption d'une feuille de route. Il faut relancer l'Union européenne, car l'expérience montre qu'il est plus difficile aux Britanniques de vouloir sortir de l'Union lorsque celle-ci avance. Brexit ou pas, il faut de toutes façons relancer le projet européen, qui était mal en point. Quelles sont donc nos perspectives, notamment économiques et sociales ? Le consensus nécessaire obtenu à Bratislava en matière de sécurité ne doit pas nous faire oublier de parler de l'union économique qui doit compléter l'union monétaire.
Enfin, quel est votre point de vue sur le renforcement de la politique de sécurité intérieure et sur la politique étrangère et de défense européenne ? Un conseil européen doit heureusement se tenir sur ces sujets avant la fin de l'année ; parviendrons-nous – car beaucoup dépend de la France en la matière – à enclencher de nouveau une dynamique positive ?
Je vous remercie de m'avoir invité à cette audition sur la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne et sur la relance du projet européen.
Je reprendrai dans ses grandes lignes mon intervention devant la mission d'information, même si les choses ont quelque peu évolué depuis avec les annonces faites par Mme May ; les fondements de notre position, cependant, demeurent. Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne est un événement considérable dont toutes les répercussions ne peuvent pas encore être mesurées – les Britanniques eux-mêmes ne les mesurent qu'au fur et à mesure. En effet, c'est la première fois qu'un État décide de quitter l'Union. De plus, le Royaume-Uni est une grande économie et un partenaire stratégique important. Enfin, les fractures sociales et géographiques et la peur de l'immigration et de la mondialisation qui se sont exprimées dans ce vote pourraient être observées dans les autres États membres ; de ce point de vue, au-delà des spécificités britanniques, ce référendum a eu l'effet d'un révélateur.
C'est donc l'avenir du projet européen lui-même qui est en jeu, dans un contexte où l'Europe est déjà confrontée à une multitude de crises – crise des réfugiés, menace terroriste, crise économique, montée et populismes. Même sans ce référendum, l'Europe devrait impérativement prendre des décisions en faveur de sa relance.
Elle doit d'autant plus aborder de façon ordonnée, cohérente et claire le défi de la sortie de l'un de ses États membres qu'elle doit dans le même temps apporter des réponses collectives déterminées à la crise européenne, en particulier à la forte attente de protection – des frontières, de l'économie, de notre modèle de société. Tout cela était à l'ordre du jour à Bratislava, et c'est le sens de la feuille de route qui y a été adoptée et des travaux engagés concernant l'avenir de l'Union.
La question du retrait britannique doit donc être réglée dans la clarté. Je tiens d'emblée à répéter que nous regrettons le choix des Britanniques de quitter l'Union européenne, mais que nous le respectons : c'est un choix souverain. Face à ce choix, il était important que les Vingt-Sept s'accordent sur quelques principes et sur quelques lignes rouges ; c'est ce qu'ils ont fait dès le 29 juin dernier, notamment à l'initiative du Président de la République.
Premier principe : il n'existe pas d'autres procédure pour quitter l'Union européenne que celle qui est prévue à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui n'a encore jamais été utilisé. Une fois activé, cet article prévoit un délai de deux ans au plus au terme duquel l'État concerné n'est plus membre de l'Union européenne sauf accord unanime des autres États membres afin de proroger le délai de négociation. Autrement dit, dès lors que l'article 50 est activé, le calendrier est balisé et l'Union maîtrise de fait le déroulement de la procédure de négociation.
Ensuite, il ne peut y avoir aucune pré-négociation ni négociation séparée visant pour le Royaume-Uni à obtenir de tel État membre ou des Vingt-Sept des garanties préalables avant l'ouverture des négociations. C'est pourquoi nous avons insisté pour que l'article 50 soit activé rapidement.
S'agissant des relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les quatre libertés de circulation sur le marché unique – biens, capitaux, services et personnes – seront liées, comme le préconise votre mission d'information. En clair, l'accès du Royaume-Uni au marché intérieur européen sera conditionné à la libre circulation des citoyens européens au Royaume-Uni.
Enfin, l'accès au marché intérieur et la participation à certaines politiques communes dépendront du respect et de la transposition d'un certain nombre de règles découlant du droit communautaire, ainsi que d'une contribution financière.
En étant fermes sur ces points, il ne s'agit pas de punir, mais de préserver les intérêts de l'Union, son intégrité et sa cohésion.
Mme May a annoncé le 2 octobre que le Gouvernement britannique activerait l'article 50 avant la fin mars 2017. Cela montre que la fermeté, la clarté et la cohérence du message de l'Union ont payé : on entendait dire que les Britanniques attendraient plusieurs années, mais il n'en sera rien. Ce calendrier permettra comme nous le souhaitions que la sortie du Royaume-Uni soit effective avant le renouvellement du Parlement et de la Commission en 2019. Mme May a également annoncé qu'elle soumettrait au Parlement britannique un projet de loi d'abrogation de la loi sur les communautés européennes – European Communities Act – de 1972, projet qui déterminera les éléments du droit européen qui seront repris en droit britannique.
Le Royaume-Uni va désormais se préparer à la négociation de la sortie de l'Union européenne, et à celle des autres accords concernant sa relation future avec l'Union ainsi qu'avec le reste du monde. Il demeure membre de l'Union jusqu'au terme des négociations de sortie, avec la plénitude de ses droits et de ses obligations. Il contribue au budget, doit transposer les directives, appliquer les règlements et respecter les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Il lui appartient néanmoins de faire de ses droits un usage qui respecte un esprit de coopération loyale. De ce point de vue, le renoncement à sa présidence de l'Union au premier semestre 2017 était une décision importante.
J'en viens aux étapes de la procédure de sortie prévue par l'article 50 du traité sur l'Union européenne et par le paragraphe 3 de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Le Royaume-Uni doit tout d'abord notifier au Conseil européen, par exemple par une lettre du Premier ministre au président du Conseil, son intention de se retirer de l'Union – Mme May ayant annoncé qu'elle le ferait en mars. Cette notification évoquera peut-être des objectifs particuliers du Royaume-Uni concernant ses relations futures avec l'Union qui, bien que faisant l'objet d'une négociation distincte, sont liées au retrait. C'est alors que nous saurons dans quel type de négociation le Royaume-Uni entend s'engager concernant ses relations futures avec l'Union.
Ensuite, le Conseil européen – à 27 États – devra fixer des orientations de négociation. C'est à cette tâche que devra s'atteler M. Didier Seeuws, désigné responsable de l'équipe spéciale (task force) du Conseil chargée du Brexit.
Troisième étape : à la lumière des orientations du Conseil européen, la Commission présentera au Conseil une recommandation sur l'ouverture de négociations avec le Royaume-Uni concernant les modalités de son retrait de l'Union européenne « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union », comme le prévoit l'article 50 du traité sur l'Union.
Le Conseil adoptera alors une décision d'autorisation d'ouverture des négociations et désignera le chef de l'équipe de négociation. L'accord sera ensuite négocié dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification.
Au terme de la négociation, une procédure est prévue pour entériner l'accord de retrait : le Parlement européen devra l'approuver à la majorité simple, puis le Conseil devra l'adopter au nom de l'Union à la majorité qualifiée.
Un dispositif a été mis en place pour mener ces négociations. Il a été convenu que le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union européenne émane de la Commission, que l'équipe de négociation pourrait comprendre des représentants du Conseil européen, du Conseil et, éventuellement, du Parlement européen, et que le Conseil européen pourrait demander dans ses orientations à être consulté tout au long de la négociation. En clair, le Conseil et les États membres pourront assurer un contrôle et un suivi permanents de la négociation.
Le 27 juillet dernier, le président de la Commission européenne a décidé de nommer Michel Barnier à la fonction de négociateur en chef responsable du groupe de travail de la Commission chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni au titre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, à compter du 1er octobre. Nous nous félicitons de ce choix : Michel Barnier sera donc chargé de la négociation relative à la sortie du Royaume-Uni.
L'article 50 établit expressément une distinction entre la conclusion de l'accord de retrait d'une part et celle d'un accord régissant les relations futures, ce qui suppose deux négociations distinctes, même si l'article dispose que le premier accord est négocié « en tenant compte » de l'autre. Rien n'interdit naturellement de désigner la même personne pour conduire l'une et l'autre négociations.
La deuxième question est celle des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui, une fois sorti, deviendra un pays tiers avec lequel de nouvelles relations de partenariat devront être établies. L'Europe doit penser cette relation future en fonction de ses intérêts, notamment dans le domaine économique et commercial, en matière de régulation financière mais aussi de coopération policière et judiciaire, de lutte contre le terrorisme, de migrations et de politique étrangère et de défense.
Ces relations futures pourraient s'appuyer sur plusieurs modèles existants, même s'il faudra in fine en bâtir un nouveau. Le modèle norvégien est le plus intégré : il implique l'adhésion à l'espace économique européen entré en vigueur en 1994, qui lie l'Union européenne, ses 28 États membres et trois des quatre membres de l'Association européenne de libre échange (AELE), à savoir la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, mais non la Suisse, qui a refusé d'y participer. Cette formule satisferait certains objectifs du Royaume-Uni, en particulier ceux des partisans d'un soft Brexit : conserver l'accès le plus large au marché intérieur et le passeport financier. Cela étant, elle serait en contradiction avec les demandes des tenants du « Leave », et avec plusieurs des demandes exprimées par Mme May lors du discours qu'elle a prononcé en fin de semaine. En effet, selon le modèle norvégien, le Royaume-Uni devrait continuer d'accepter la liberté de circulation pour les ressortissants des pays de l'Union, d'appliquer les mêmes règles qu'auparavant et de transposer tous les textes législatifs à venir de l'Union sans pour autant participer au processus de décision. En outre, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne primeraient sur le droit britannique. Enfin, la participation à l'espace économique européen se traduirait pour le Royaume-Uni par une obligation de contribuer de façon importante au financement de l'Union. Autrement dit, cette option est exclue.
Le deuxième modèle est celui de la Suisse. En 1992, la Suisse a refusé par référendum d'adhérer à l'espace économique européen, suite à quoi elle a développé ses relations avec l'Union européenne dans un cadre bilatéral et signé environ 120 accords lui permettant de participer aux politiques de l'Union au cas par cas. Cependant, la participation de la Suisse à certaines de ces politiques, notamment le marché intérieur, implique là aussi la transposition du droit communautaire en matière économique dans son droit interne. De plus, la Suisse est tenue de respecter la liberté de circulation sans restriction, en dépit des votations, et elle contribue au financement des politiques européennes auxquelles elle participe.
Le troisième modèle est celui d'un accord de libre-échange doublé d'un partenariat stratégique – c'est en quelque sorte le modèle canadien – à supposer que l'accord de libre-échange avec ce pays, le CETA, soit ratifié, ce que j'espère – qui est fondé sur une double association, à la fois politique et commerciale. Ce cadre correspond à des pays qui entendent entretenir des échanges commerciaux importants et un partenariat étroit avec l'Union européenne tout en étant plus éloignés et moins intégrés à l'Union que ne le sont les pays de l'AELE. L'accord de libre-échange approfondi qui en découle est nécessairement long et complexe à négocier. Dès lors, la période transitoire pendant laquelle le Royaume-Uni aurait le statut d'État tiers sans que les nouveaux accords ne soient finalisés pourrait durer plusieurs années. Si rien n'est encore certain, c'est vers cette option que l'on s'oriente. Dans cette période transitoire, le Royaume-Uni se retrouverait donc dans une situation où tous les accords de libre-échange avec l'Union cesseront de s'appliquer à lui. Il ne bénéficierait plus alors que de la clause de la nation la plus favorisée, et devrait renégocier en son nom tous les accords existants entre l'Union et les autres membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Sans en dire davantage sur cette relation future, Mme May a pour l'instant promis une grande loi d'abrogation (great repeal bill) de la loi sur les communautés européennes de 1972, qui entrera en vigueur lors de la sortie de l'Union. Elle satisfait ainsi l'un des objectifs des partisans du Brexit qui consiste à retrouver l'autonomie et le contrôle sur les lois, et à exclure la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne et l'applicabilité du droit européen dès le jour où le Royaume-Uni quittera l'Union. En réalité, cette loi transformera une grande partie de l'acquis communautaire en droit national. C'est aussi une manière d'associer le Parlement au processus, dans la mesure où le Premier ministre a indiqué qu'il ne lui serait pas demandé de se prononcer sur l'activation de l'article 50.
Concernant les relations futures, il est vraisemblable que le Royaume-Uni cherche à échapper aux modèles préexistants et à négocier un statut ad hoc reposant sur un accord de libre-échange particulier – comme le sont tous les accords de libre-échange – et sur une série d'accords politiques. Concrètement, le Royaume-Uni devra sans doute s'engager dans la négociation d'au moins six accords distincts : l'accord de retrait de l'Union, l'accord commercial futur avec l'Union, un accord intérimaire couvrant la période entre la sortie de l'Union et l'entrée en vigueur des arrangements définitifs, l'accord de réadhésion à l'OMC en tant que pays non membre de l'Union, les accords de commerce avec la cinquantaine de pays liés à l'Union par des accords commerciaux bilatéraux, auxquels s'ajouteront sans doute des accords nouveaux avec d'autres pays tels que les États-Unis et la Chine, et enfin un ou plusieurs accords de coopération policière, judiciaire et en matière de politique étrangère avec l'Union.
Dans cette négociation, l'Union européenne devra veiller à l'équilibre entre l'accès au marché et les obligations, et s'assurer qu'un État tiers n'obtienne pas davantage qu'un État membre, car ce serait entamer un détricotage dangereux. Il y va de la cohésion des Européens.
La négociation relève certes de l'Union, mais la France s'y prépare et s'est dotée d'un dispositif à cet effet dès que le résultat du référendum a été connu. Le secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) pilote un travail de cartographie de l'ensemble de nos intérêts en s'appuyant sur des correspondants dans tous les ministères concernés, afin d'éclairer le moment venu les arbitrages qui devront être faits au plus haut niveau. D'autre part, le ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI) a constitué une équipe spéciale dédiée qui regroupe les agents les plus directement concernés de la direction de l'Union européenne et de la direction des affaires juridiques, et qui est notamment chargée d'animer un réseau de points de contact au sein du ministère et d'assurer un lien quotidien avec les ambassades concernées, en particulier notre ambassade à Londres et notre représentation permanente auprès de l'Union à Bruxelles. Conduite par le directeur de l'Union européenne et placée sous l'autorité du secrétaire général du ministère, cette équipe spéciale assure le suivi quotidien de la négociation.
Pour structurer les travaux interministériels, plusieurs blocs de sujets ont été définis et font l'objet d'une expertise approfondie : les aspects juridiques et budgétaires, la liberté de circulation des personnes, la liberté de circulation des marchandises, les libertés d'établissement et de prestation de services hors services financiers, la liberté de circulation des capitaux et des services financiers, les politiques communes, la politique commerciale commune, la coopération policière et judiciaire, les sanctions prises au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et les aspects communautaires de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Ce dispositif doit permettre de garantir la meilleure information, l'analyse, la réactivité et l'élaboration des positions françaises à chaque étape de la négociation en tenant compte de l'intérêt général européen, mais aussi de nos intérêts nationaux ainsi que de nos accords bilatéraux avec le Royaume-Uni, en particulier en matière de sécurité et de défense.
Vous l'avez souligné, madame la présidente : l'agenda européen ne saurait se réduire au Brexit. L'essentiel est de définir le projet européen face aux crises auxquelles l'Europe est confrontée, et face aux grands défis du XXIe siècle, dont aucun ne trouvera de réponse dans le morcellement et la division du continent. Nous ne devons pas laisser les forces de dislocation et les populismes l'emporter. Certes, le fonctionnement et les priorités de l'Union européenne doivent changer pour qu'elle relève ces défis et qu'elle regagne la confiance des citoyens.
Cependant, l'Europe montre aussi qu'elle est capable d'agir avec efficacité et de peser sur des sujets décisifs lorsqu'elle s'unit et qu'elle se tourne avec ambition vers l'avenir. C'est ce qu'elle vient de faire concernant le changement climatique : après avoir défini dans le cadre énergie-climat les objectifs de la COP21, contribué à son succès et signé l'Accord de Paris, je me réjouis qu'elle se donne les moyens de le ratifier rapidement, en particulier avant la tenue de la COP22 à Marrakech. La France a montré quel rôle elle pouvait jouer et ce qu'elle peut apporter à une telle dynamique européenne.
Il nous faut pourtant relever de nombreux autres défis. L'Europe doit tout d'abord s'organiser pour assurer sa sécurité, contrôler ses frontières et se doter d'une politique de défense commune. Elle doit aussi renforcer sa protection économique, industrielle et commerciale dans la mondialisation, et protéger par ses règles internes son modèle social contre toute forme de dumping social et fiscal. La convergence économique et sociale doit être placée au coeur des priorités de la zone euro : la gouvernance et la coordination économiques ne sauraient se limiter à la surveillance budgétaire. Nous avons l'ambition de doter l'union économique et monétaire d'une véritable politique économique, s'appuyant sur des instruments, un budget de la zone euro et un contrôle parlementaire. Enfin, l'Europe doit investir davantage dans l'avenir de secteurs clés comme le numérique, la transition énergétique, la recherche – comme elle doit investir dans sa jeunesse.
De ce point de vue, la réunion des chefs d'État et de gouvernement de Bratislava a constitué une première étape – pas seulement symbolique – après le référendum britannique. Les 27 États participants ont souligné leur volonté collective de tracer dès aujourd'hui des perspectives pour l'Union, à la fois pour réaffirmer des engagements communs de long terme et pour définir un programme de travail immédiat. Dans un contexte difficile, l'enjeu était d'engager un processus de restauration de la confiance et de l'unité. À nos yeux, un tel objectif supposait l'affirmation d'un consensus autour d'un nombre limité de priorités fortes – la sécurité et l'exigence de protection, le soutien à l'économie et à l'emploi, la jeunesse – et leur traduction en mesures concrètes et précises, ainsi que l'adoption d'un calendrier resserré afin de prendre les décisions correspondantes et d'obtenir des résultats tangibles.
C'est cette vision qui inspire les trois chapitres de la feuille de route de Bratislava : les migrations et les frontières extérieures, la sécurité intérieure – par la création des gardes-frontières et des gardes-côtes – et le développement économique et social, notamment l'amplification du plan Juncker. Comme nous le préconisions, des rendez-vous sont pris afin de prendre des décisions : les deux prochains conseils européens d'octobre et de décembre, une réunion des Vingt-Sept qui se tiendra à Malte en février, et enfin le soixantième anniversaire du traité de Rome en mars 2017, qui sera l'occasion de clôturer ce processus et de fixer les objectifs que les Européens se donnent pour l'avenir.
Les chefs d'État et de gouvernement se sont largement retrouvés dans l'esprit du discours sur l'état de l'Union prononcé par M. Juncker le 14 septembre. Par leur travail de préparation conduit jusqu'à la veille même du sommet, lors du déplacement de la Chancelière Merkel à Paris, et lors de la conférence de presse commune à l'issue du sommet, le Président Hollande et Mme Merkel ont fait la preuve de l'unité des orientations et des points de vue de la France et de l'Allemagne, qui est particulièrement importante pour l'Europe dans le contexte actuel.
Tels sont les éléments que je souhaitais vous présenter, à la veille d'une négociation décisive pour l'Union et pour la France à laquelle l'Assemblée nationale prendra une part importante.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, pour cet exposé à la fois clair et précis. Nous en venons aux questions des députés.

Puis-je être iconoclaste ? Permettez-moi de commencer par faire observer que les procédures référendaires sont difficiles à manier, comme on l'a vu ces jours-ci en Colombie où, hélas, les Colombiens eux-mêmes ont refusé de ratifier l'accord de paix. Bien des promoteurs de référendums lors desquels les citoyens ne répondent pas vraiment à la question posée s'en mordent les doigts après coup.
Êtes-vous certains, monsieur le secrétaire d'État, que les trois scénarios que vous avez évoqués sont les seuls possibles ? Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont semble-t-il très complexes. M. Pascal Lamy, fin connaisseur de ces questions, me faisait remarquer qu'au-delà de la position de Mme May, l'une des difficultés majeures tient au fait que le Royaume-Uni est moins uni qu'on ne le dit : l'Écosse et l'Irlande du Nord n'ont pas sur cette question le même point de vue que l'Angleterre et le Pays de Galles. En trois ans, d'ici à 2019, il peut encore se passer bien des choses sur un plan politique, non seulement au Royaume-Uni mais aussi en Europe et aux États-Unis, qui pourraient modifier le contexte.
Comme le disait Mme la présidente, il faut au fond mener de pair le projet de recomposition de l'Europe qui, à l'évidence, devra fixer plusieurs niveaux d'intégration selon les pays, et la négociation avec le Royaume-Uni. Si nous sommes exigeants, nous ferons très vite apparaître aux Britanniques que ces négociations ne déboucheront pas sur un résultat qui leur sera très favorable. On peut alors penser que la population britannique réfléchira une seconde fois au vote qu'elle a émis lors du référendum sur le Brexit. Qu'en pensez-vous ?

On ne peut que soutenir la position de la France que vous défendez, monsieur le secrétaire d'État. Êtes-vous certain que c'est aussi la position de tous nos partenaires européens ? Que feront la Pologne, les États baltes et ceux de l'Europe centrale, dont de nombreux ressortissants vivent aujourd'hui au Royaume-Uni et risquent de servir de monnaie d'échange dans la négociation ? J'ai bien compris que les positions française et allemande étaient très proches, mais qu'en est-il des positions polonaise, lituanienne, estonienne, tchèque ? Ne courons-nous pas le risque qu'émergent deux discours au sein de l'Europe, ces pays étant tentés de défendre leur diaspora ?
Signe que la machine européenne est devenue complètement folle, nous avons appris cette semaine que l'Union avait donné son feu vert à l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine. La France a-t-elle donné son accord ? Avez-vous été consulté ? En ces temps d'incertitude, en effet, une telle nouvelle ne peut que détériorer l'opinion que suscite l'Europe.
Enfin, en février dernier, les Pays-Bas ont voté par référendum contre l'accord d'association avec l'Ukraine. Qu'en est-il aujourd'hui ? Cet accord est-il remis en cause ou renégocié ? Le Gouvernement des Pays-Bas passe-t-il outre le résultat du référendum ?

S'étant aperçu il y a quelques années que la France avait mal voté sur la Constitution européenne, on a fait en sorte de contourner ce choix du peuple. Ce qui se passe hélas en Colombie peut faire regretter le choix de recourir au référendum. Au Royaume-Uni, il semble que le petit peuple n'ait pas été à la hauteur de la noblesse des motivations de la City et de Londres. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la confiance qu'il est possible d'accorder au peuple par référendum. Peut-on même faire confiance au peuple lors des élections démocratiques ? Peut-être vaudrait-il mieux s'en remettre à la City, à certaines élites proches de nos amis américains et de nos amis européistes, comme dirait Hubert Védrine, qui sont prêts à pardonner leur erreur aux Anglais, à l'Europe du Nord, très anglophile, et à l'Europe de l'Est, atlantiste et très liée au Royaume-Uni ?
Plutôt que de profiter de cette occasion de bâtir sans les Britanniques une Europe cohérente et fondée sur une autre conception de la société européenne face à la mondialisation, ne pensez-vous pas que tout sera finalement fait – avec une exquise courtoisie et toute la bonne volonté de ceux qui tiennent beaucoup à la place du Royaume-Uni dans l'Europe, qui n'est pas une place ordinaire – pour que d'ici à quelques années, ce pays ne soit plus de jure dans l'Union, mais qu'il y soit de facto maintenu avec affection ?

J'approuve les propos de M. Vauzelle. Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'État, de vous poser une question précise à laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non : le Royaume-Uni pourra-t-il conserver le bénéfice du passeport financier ? C'est un élément majeur : dès lors que ce pays décide de quitter l'Union, il doit selon moi renoncer à ce passeport.
D'autre part, nous avons là l'occasion de renforcer la zone euro. On en parle beaucoup mais rien ne se passe. Quelles initiatives le Gouvernement français compte-t-il prendre pour renforcer le fonctionnement de la zone euro en la dotant d'un président, d'un secrétaire général et d'un trésor – en somme, en concrétisant enfin toutes les propositions qui sont régulièrement formulées sans jamais être appliquées ? L'harmonisation fiscale, en particulier, est essentielle et doit commencer tout de suite, car c'est un effort de longue haleine, comme le fut en son temps la création de l'euro.
Vous avez conclu votre intervention, monsieur le secrétaire d'État, en faisant référence à l'importance du rôle des parlements nationaux. Je m'étonne pourtant, madame la présidente, que la négociation implique la Commission européenne et le Parlement européen mais qu'aucun représentant des parlements nationaux n'y soit associé. Je tiens beaucoup à l'idée selon laquelle l'Europe ne peut plus se construire sans les parlements nationaux. Il me semblerait donc opportun que leurs représentants prennent part à la négociation – même s'il ne s'agit pas de notre commission.
Je partage tout à fait l'avis de M. Mariani sur la Bosnie-Herzégovine. Quelle fuite en avant ! Nous ne cessons d'expliquer que l'Europe ne fonctionne plus parce que nous l'avons élargie trop loin et trop vite, et nous continuons pourtant d'accepter des adhésions ! Il faut que cela cesse ! La France doit s'y opposer.
Enfin, le Royaume-Uni abrite le siège de deux agences européennes. J'espère qu'il ne les conservera pas ; qu'en sera-t-il ?

Quelles sont les conséquences financières du Brexit sur le budget de l'Union européenne, notamment sur le système de compensations au rabais dont la clarté n'en sortira pas renforcée ? Qu'en sera-t-il des hypothèses d'une réduction de 2 milliards que nous prévoyons dans le projet de loi de finances ?
D'autre part, est-il trop tôt pour évoquer la politique de sécurité et de défense, en particulier l'application des articles 42 et 43 du traité sur l'Union, sachant que les Britanniques étaient opposés à un certain nombre de dispositifs comme les groupements tactiques ? Quelle est la position de la France et des pays qui partagent son point de vue ?

Je note qu'a priori l'annonce de l'activation avant la fin mars 2017 de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, semble vous convenir. Les échanges entre Michel Barnier – notre « monsieur Brexit » – et les représentants du Royaume-Uni ont-ils commencé ou bien confirmez-vous qu'il n'y aura pas de discussions avant l'application dudit article 50, cela afin de ne pas mettre un terme prématurément au bras de fer engagé ? Ensuite, travaillez-vous avec le ministère de l'économie afin d'anticiper les conséquences économiques du Brexit, en particulier sur l'attractivité des entreprises ? Enfin, quels échos avez-vous des positions respectives de l'Écosse et de l'Irlande ? J'ai en effet eu l'occasion, au cours du week-end dernier, dans le cadre d'un jumelage, de discuter avec des élus écossais qui se posent de nombreuses questions sur la position de l'Écosse au sein du Royaume-Uni.

Je viens d'une région qui a beaucoup oeuvré, en 1972, pour que le Royaume-Uni adhère à la Communauté économique européenne (CEE) – c'était un grand défi.
Je constate aujourd'hui deux types de réactions : d'une part la crainte liée à la baisse de la livre dans la perspective de nos échanges futurs ; d'autre part l'impression, de la part des citoyens comme des milieux économiques, que tout va se négocier « ailleurs », sans souci de transparence. Aussi, comment associer le plus possible nos concitoyens qui vivent le Brexit comme un indice de désunion ?
L'Europe économique et sociale paraît à nos concitoyens totalement absente des préoccupations de la Commission européenne elle-même, en dépit du discours qu'elle tient ; on pense aux travailleurs détachés, aux grandes entreprises de transport, au fait que la concurrence n'est pas libre et qu'elle est malheureusement souvent faussée. C'est pourquoi, à la faveur du Brexit, il est possible que s'exprime une demande forte en la matière, de même que l'on se demande pourquoi on ne profite pas de la situation pour renforcer une Europe géopolitique.

Je reviens sur le sommet de Bratislava et en particulier sur la politique étrangère et de sécurité commune. On sait que, dans le contexte des drames survenant dans la région du Sahel ou en Libye, la coopération de l'Union européenne avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est essentielle. Or si la France est largement la tête de pont de cette défense européenne, le Royaume-Uni en est un membre important ; en outre, la coopération bilatérale en matière de défense a été renforcée avec les accords de Londres en 2010. Quel est votre avis, monsieur le secrétaire d'État, sur l'évolution du Royaume-Uni dans un environnement international si dramatique ?

Ma question ne vous étonnera pas, monsieur le secrétaire d'État : pensez-vous que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne renforcera enfin la position de Strasbourg en tant que capitale européenne ?

Que se passera-t-il si aucun accord n'est conclu en mars 2019, à deux mois des élections européennes ? Je sais bien que le Conseil européen peut décider, à l'unanimité, de décider de prolonger la discussion mais il y a tout de même ce butoir : y réfléchit-on déjà ?
Ensuite, certes, on voit bien que les Britanniques pro-européens auraient envie que l'on revienne en arrière – et ils sont nombreux en Écosse et en Irlande –, en même temps, je ne crois pas qu'on doive encourager cette attitude qui prolongerait l'incertitude. Ce qui ne signifie pas que l'on doive fermer définitivement la porte à un retour de leur part : autant, dans un premier temps, il faut se montrer très ferme pour éviter de se laisser ballotter, autant, après qu'ils auront fait l'expérience de la sortie, il ne faudra pas les empêcher de revenir.
Enfin, en ce qui concerne le renforcement de l'union économique, sociale et fiscale, qu'allons-nous faire ? On voit bien qu'il existe des attentes très concrètes sur la relance de la croissance donc de l'emploi, des investissements, notamment dans les secteurs d'avenir. Je n'ai pas de doute sur notre détermination mais quand j'observe les très nettes réticences allemandes, comment les surmonter, sur qui s'appuyer ? Pourquoi ne pas exprimer davantage notre point de vue ? Que nous ayons à coeur de ne pas nous dissocier de l'Allemagne puisque notre entente est la condition pour que tout se passe dans de bonnes conditions, soit, mais l'Allemagne ne doit pas, de son côté, négliger les préoccupations françaises.
La présidente de la commission vient de le rappeler, monsieur Destot : de nombreux Britanniques se disent qu'avec un peu de recul, chacun y réfléchira à deux fois au cours de la négociation. Je pense néanmoins, comme M. Vauzelle, qu'il y a eu un vote populaire au terme d'une campagne référendaire longue – même si beaucoup d'arguments fallacieux ont été utilisés, au point que plusieurs des responsables de la campagne en faveur du Brexit ont ensuite décliné toute charge gouvernementale, certains, certes, se ravisant sans avoir pour autant les idées très claires, plusieurs semaines plus tard, sur ce que le Brexit signifiait pour leur pays. Mais le Brexit, j'y insiste, est le résultat d'un choix démocratique dont je ne pense pas qu'il soit réversible – on en reparlera éventuellement dans une ou deux générations. Il serait de très mauvaise méthode et il ne serait tout simplement pas possible d'imaginer passer outre ce vote. C'est d'ailleurs la conclusion qu'a tirée le premier ministre britannique en déclarant devant le congrès de son parti, le week-end dernier, qu'il n'y avait pas deux façons de sortir de l'Union européenne mais une seule : l'application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Mme May a ainsi donné sens à la formule qu'elle répète depuis la proclamation des résultats du référendum – « Brexit means Brexit » –, considérant elle-même qu'elle avait un mandat du peuple britannique. Voilà une clarification que nous attendions.
Sans doute de nombreuses questions importantes se révéleront-elles difficiles à traiter, comme l'Écosse, l'Irlande plus encore – à la suite des accords du Vendredi Saint, un espace de libre circulation a été institué que personne ne veut remettre en question et ce sera l'un des thèmes de discussion entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, même si, bien sûr, je ne saurais préjuger de la solution qui sera retenue.
Il se passera beaucoup de choses d'ici à la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais je ne crois pas qu'on discute d'une option consistant en « l'annulation » des résultats du référendum par le biais d'un vote de la Chambre des communes. Ce n'est de toute façon pas l'état d'esprit des Britanniques. Tout le monde a compris qu'il fallait se préparer à un autre type de relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne que celui qui a prévalu jusqu'à présent.
Immédiatement après le référendum, le président Hollande, la chancelière Merkel et le président du conseil Renzi ont tenu à affirmer les principes que j'ai rappelés tout à l'heure afin que les autres pays de l'Union européenne les reprennent à leur compte. Il n'y aura pas de négociations séparées, pas de formule alternative à la sortie de l'UE. Nous devons nous préparer, dans l'intérêt des parties, à l'établissement de nouvelles relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, celui-ci devant devenir un État tiers, même si plusieurs pays membres auront des intérêts particuliers à faire valoir. Vous avez mentionné la Pologne et les pays Baltes, notamment, pays dont de nombreux ressortissants vivent au Royaume-Uni. J'incite ces pays, comme nous, à se montrer fermes sur la liberté de circulation et sur le fait que si le Royaume-Uni souhaite avoir un accès au marché intérieur, il devra, en contrepartie, veiller à respecter les droits des citoyens membres des pays de l'UE qui viendront s'y installer pour travailler, sans oublier, évidemment, ceux qui s'y trouvent déjà. L'attention que ces pays portent à leurs citoyens installés au Royaume-Uni ne joue pas contre la fermeté dès lors qu'il est acquis qu'il n'y a pas d'autre solution, je le répète, que la sortie.
Pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, aucune décision d'adhésion à l'Union européenne n'a été prise. En revanche, il a été décidé – et la France y a été totalement associée – de transmettre, à sa demande, via le Conseil des affaires générales, sa candidature pour examen par la Commission européenne. La Bosnie-Herzégovine est par conséquent dans la même situation que les autres pays des Balkans occidentaux, à savoir les six pays de cette région qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Je rappelle que deux pays issus de l'éclatement de la Yougoslavie, la Slovénie et la Croatie, sont pour leur part devenus membres de l'UE. Les autres pays candidats provenant de la Yougoslavie sont engagés dans un processus de rapprochement avec l'Union.
Je pense que cette dernière doit définir clairement ses frontières, indiquer où s'arrêtent les élargissements possibles. Il fallait ainsi clarifier notre position – et nous l'avons fait trop tardivement – vis-à-vis de l'Ukraine qui est un pays voisin avec lequel nous devons avoir des relations de partenariat, un pays que nous aidons beaucoup, mais dont je ne crois pas qu'il ait vocation à rejoindre l'Union européenne. Ni sa situation économique ni sa situation géopolitique ni, non plus, ses relations avec la Russie ne permettent d'envisager une telle évolution qui n'apporterait aucune stabilité pour lui comme pour la région.
Nous allons devoir procéder à une clarification vis-à-vis d'un autre grand pays qui s'est vu reconnaître le statut de candidat. De nombreux États membres, en effet, ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas que ce processus aille jusqu'à l'adhésion. Or le type de relations que nous entretenons et de négociations que nous menons avec ce pays procède, sur le plan formel, de la logique d'élargissement. Il s'agit de la Turquie. Si l'ouverture de chapitres de négociation ne préjuge pas de l'adhésion future – il s'agit de rapprocher les législations économiques, de coopérer en matière d'État de droit – il n'en subsiste pas moins une ambiguïté dès lors que, je le répète, de nombreux États membres ne souhaitent pas que la Turquie devienne membre de l'Union européenne. Cette question est posée depuis longtemps et beaucoup plus de chapitres de négociation ont été ouverts sous les quinquennats précédents, depuis l'ouverture des négociations, que pendant le présent quinquennat.
Or nous devons avoir le même débat au sujet des Balkans. Je ne crois pas que l'Europe sera complète et que la stabilité sera possible dans cette région si on ne lui donne pas une perspective européenne. Nous travaillons par conséquent avec ces pays pour qu'ils puissent mener à bien un certain nombre de réformes économiques, mais aussi la modernisation de leur État de droit – autant de conditions de stabilité. Le Président de la République a d'ailleurs réuni à Paris, le 4 juillet dernier, avec la chancelière Merkel et avec le président du conseil Renzi, les représentants de ces pays, dans le cadre d'un processus lancé il y a quelques années, destiné à favoriser leur intégration économique régionale, l'intégration des sociétés civiles, les échanges entre les jeunesses…
Aussi, j'y insiste, la Bosnie Herzégovine ne s'est-elle pas vu reconnaître le statut de candidat et nous n'avons pas ouvert de chapitre de négociation avec elle. Seulement, ce pays s'inscrit dans cette perspective, comme la Serbie, comme la Macédoine, comme l'Albanie…
Ce débat de nature géopolitique doit donc être exempt de toute démagogie.

Il me semble me souvenir qu'un conseil européen, il y a quelques années, avait reconnu formellement que les pays des Balkans qui se trouvent entre la Croatie et la Grèce avaient vocation à adhérer à l'Union européenne. L'Ukraine, bien sûr, n'en faisait pas partie et quant à la Turquie, c'est une autre histoire et qu'il faudra trancher un jour.
Vous avez raison, madame la présidente, il s'agissait du sommet de Zagreb, en 2000, sous présidence française – le Président de la République était alors Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin –, au cours duquel nous avons soutenu la perspective européenne des pays occidentaux des Balkans. Et nous avons eu raison : c'est parce que nous avons fixé cette perspective qu'aujourd'hui, malgré des tensions qui doivent nous pousser à la vigilance, nous nous trouvons dans un contexte de coopération. La Bosnie-Herzégovine a évidemment un long chemin à parcourir et de nombreuses étapes devront encore être franchies avant d'envisager l'ouverture de négociations sur son éventuelle adhésion à l'Union européenne.
J'en viens à l'Ukraine. Désormais, aux Pays-Bas, après avoir réuni un certain nombre de signatures, on peut obtenir l'organisation d'un référendum, y compris sur des sujets dont on peut se demander s'il est judicieux de les soumettre ainsi au vote populaire, ainsi de la signature de l'accord d'association avec l'Ukraine – accord que, par cette voie, les Néerlandais ont rejeté. Constitutionnellement, toutefois, le résultat du référendum ne lie pas les mains du gouvernement qui n'en doit pas moins, d'un point de vue politique, en tenir compte malgré une très faible participation.
Lors du conseil européen des 28 et 29 juin, le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a fait valoir que les Pays Bas souhaitaient trouver une solution à Vingt-Huit qui soit juridiquement contraignante et qui laisse le texte de l'accord avec l'Ukraine intact – lancer un nouveau processus de ratification poserait d'énormes problèmes à l'Ukraine – ; mais, pour une durée indéterminée, il a exclu l'hypothèse d'une application provisoire de l'accord en question. Afin d'éviter la tenue d'un second référendum, il doit être clair que l'accord d'association n'est pas une première étape vers l'élargissement, clair que l'ambiguïté doit être levée sur l'article relatif à la coopération en matière militaire qui ne doit pas équivaloir à une clause de sécurité collective, clair enfin que l'accord d'association ne doit pas engager l'Union européenne à un soutien financier sans fin. Voilà donc qui devrait permettre au gouvernement néerlandais d'arguer de ce qu'il a été tenu compte du résultat du référendum mais sans remettre en cause l'accord d'association. Et le premier ministre Rutte souhaite annoncer rapidement la solution afin d'éviter une notification de non-ratification. Les consultations se poursuivent entre Mark Rutte et Donald Tusk afin que le Conseil européen adopte une déclaration interprétative. Jean-Claude Junker, de son côté, s'est engagé à présenter des propositions au Conseil le plus rapidement possible, si bien que le sujet pourrait être abordé lors du Conseil européen des 20 et 21 octobre.
Michel Vauzelle a évoqué en particulier les suites qui seront données au référendum britannique. J'ai déjà tâché de répondre.
Pierre Lequiller s'est interrogé sur le fait de savoir si le Royaume-Uni allait garder ou non le passeport financier. La réponse est non. Si l'on s'en tient à la logique de la déclaration du Premier ministre britannique le week-end dernier, le Royaume-Uni ne pourra pas participer pleinement au marché intérieur – la configuration à envisager ne sera donc pas celle de la Norvège – et il n'y a donc aucune de raison de lui conserver le passeport financier. C'est mon interprétation et ce sera notre position. Reste, encore une fois, que c'est l'Union européenne qui va négocier.
N'est-ce pas l'occasion de renforcer la zone euro ? La réponse est, ici, affirmative et c'est bien l'idée sur laquelle Élisabeth Guigou a insisté. Le Brexit est l'occasion de renforcer l'union à Vingt-Sept autour des grandes priorités communes mais aussi de renforcer l'union économique et monétaire. Le débat que nous aurons à cette occasion ne sera pas celui de Bratislava mais un débat entre pays membres de la zone euro et qui devra nous mener au-delà des conclusions du rapport des cinq présidents. On constate que l'appréciation de la situation sépare les pays du Nord et ceux du Sud, les premiers voulant davantage de discipline dans le respect des règles et les seconds plus de solidarité, une meilleure convergence et posant la question d'une Union de transferts bancaires – sujet quasi tabou en Allemagne. Si l'on veut renforcer le respect des règles, il faut renforcer la convergence économique, fiscale et sociale, définir un projet commun. C'est dans l'intérêt des Vingt-Sept que d'avoir à coeur une zone euro qui fonctionne mieux. Avant que de nous préoccuper de gouvernance, avec, en particulier, une présidence stable, nous devons définir nos grands objectifs dès lors que nous considérons, comme vous l'avez souligné, madame la présidente, que la zone euro ne se réduit pas à une union monétaire. Une union monétaire ne saurait être viable, en effet, si elle n'est pas d'abord une union économique – nous avons toujours soutenu cette idée et les faits en confirment la validité. Nous avons tenté d'apporter des réponses partielles aux lacunes de l'Union économique et monétaire, notamment après la crise en instaurant des instruments de stabilité à l'efficacité d'ailleurs éprouvée : l'union bancaire, le mécanisme européen de stabilité… Eh bien, il faut aller beaucoup plus loin dans la définition d'outils de convergence économique et sociale.
En effet, mais avec nos partenaires : il ne suffit pas de se contenter du registre déclamatoire à l'échelon français.
En ce qui concerne les agences, trois ont leur siège au Royaume-Uni : l'Autorité bancaire européenne, l'Agence européenne du médicament et le Collège européen de police. Nous pensons, monsieur Schneider, que l'une de ces agences aurait toute sa place en France. Aussi la France pourrait-t-elle candidate pour accueillir l'Agence européenne du médicament. Le départ du Royaume-Uni va en effet entraîner une série de renégociations au sein de l'Union européenne liées au fait que ce pays ne contribuera plus de la même façon au budget européen – il ne bénéficiera plus du fameux rabais mais l'UE ne bénéficiera plus non plus de sa contribution nette.

Rien ne changera, en tout cas, jusqu'à ce que le Royaume-Uni sorte effectivement de l'Union européenne. Il continuera donc, en attendant, à contribuer au budget de l'Union européenne.
En effet, pendant les deux années à venir, le cadre financier pluriannuel reste le même et donc les règles de contribution du Royaume-Uni, comme son accès aux programmes européens, restent les mêmes. Une question se posera sur la fin du cadre financier. On peut en effet imaginer que les universités britanniques voudront continuer à bénéficier du programme « Horizon 2020 ». Le Royaume-Uni renationalisera un certain nombre de politiques comme la politique agricole. Mais pour d'autres politiques, j'imagine qu'il souhaitera demeurer dans un cadre européen – au moins partiellement. Il devra donc définir quelle sera sa contribution et quelle sera sa participation.
C'est pourquoi l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sera sans doute totalement nouveau : sur certains points, il se rapprochera de ceux contractés avec la Suisse et sur d'autres nous serons proches de la situation canadienne même si nous irons, dans de nombreux domaines de coopération, beaucoup plus loin.
Les accords bilatéraux, pour leur part, ne sont pas directement liés à l'Union européenne et par conséquent n'ont pas vocation à être modifiés, à l'exception, par exemple, de nos accords de défense, qui relèvent de l'accord de Lancaster House, mais aussi de nos accords sur les questions de migration – en particulier l'accord du Touquet, régulièrement remis en cause mais dont il faut rappeler qu'il doit son existence à celle d'un tunnel dont il faut contrôler l'accès –, ou encore de nos accords en matière sécuritaire ou de lutte contre le terrorisme – par exemple, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen mais utilise en partie les fichiers du système Schengen…
Lionel Tardy m'a demandé si les échanges entre Michel Barnier et les représentants du Royaume-Uni avaient commencé. Michel Barnier se rendra dans tous les États membres et peut-être ira-t-il également présenter sa mission au Royaume-Uni mais aucune négociation ne sera engagée avec ce dernier avant le déclenchement de la procédure prévue par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. En attendant, Michel Barnier se prépare, réunit des équipes.
Pour répondre à une autre question de M. Tardy, nous travaillons en effet, avec le ministère de l'économie, sur l'attractivité des entreprises. Le Premier ministre a annoncé tout une série de mesures pour les impatriés, pour renforcer l'attractivité de la place de Paris en matière fiscale, d'environnement. Une partie des activités, qui ne pourront pas rester à Londres, parce que la compensation en euros ne s'y fera plus, parce que le passeport financier ne sera plus accordé aux établissements au Royaume-Uni, se déplaceront vers les pays de la zone euro ; et, entre Paris, Francfort, Luxembourg… il y a une compétition et nous faisons en sorte que la place de Paris attire le plus grand nombre possible de ces acteurs du marché et de ces investisseurs.
J'en viens à la question de Mme Lebranchu. Il est vrai que c'est un choc pour les citoyens de l'Union européenne : pour la première fois un pays part, ce qui signifie que la construction européenne n'est pas irréversible. Il faut en effet sans doute y répondre par une vision géopolitique, par l'approfondissement de l'Europe économique et sociale et par la volonté, pour les Vingt-Sept, de continuer ensemble et d'indiquer pourquoi.
Mme Fourneyron m'a interrogé sur le sommet de Bratislava. Il y a été beaucoup question de la politique étrangère et de sécurité commune. La ministre allemande de la défense, Ursula von der Leyen, est aujourd'hui même à Paris pour y rencontrer son homologue Jean-Yves Le Drian afin de travailler sur les propositions franco-allemandes déjà débattues à Bratislava en matière d'Europe de la défense.
Pour répondre à Mme Guigou : si l'on n'aboutit pas à un accord en 2019, je ne pense pas que les États membres souhaiteront prolonger la période des négociations de sortie. Il y aura donc une période intermédiaire qui pourra être de plusieurs années – et c'est à cela que servira le fameux Repeal Bill qui annulera l'acte d'adhésion du Royaume-Uni – entre la sortie et la mise en oeuvre des nouveaux accords.
Les Britanniques pro-européens voudront peut-être revenir en arrière, nous l'avons évoqué, et il ne faudra pas aller dans ce sens, même si nous souhaitons qu'il y ait des Britanniques pro-européens qui contribuent, dans le futur, aux bonnes relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Enfin, sur qui s'appuyer pour l'approfondissement de la zone euro ? La réponse renvoie directement à la dynamique franco-allemande, au coeur de nos préoccupations actuelles.
Présidence de Mme Valérie Fourneyron, secrétaire de la commission

Les comparaisons que l'on fait avec la Suisse, la Norvège et, depuis peu, avec le Canada m'agacent. D'une part ce n'est pas gentil pour le Canada et, d'autre part, s'agissant de la Suisse et de la Norvège, l'exemple est mal choisi – vouloir le suivre reviendrait pour les Britanniques à vouloir le beurre, l'argent du beurre et le reste. La Suisse nous a montré, au fil des décennies, qu'elle avait su s'y prendre suffisamment bien pour tirer tous les avantages de la construction européenne sans avoir à en assumer les contraintes. Cela a participé à la mauvaise image que nos compatriotes peuvent avoir de la façon dont fonctionne l'Europe d'aujourd'hui.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, pour votre réponse sur les Pays-Bas et le traité d'association avec l'Ukraine. Je souhaite savoir quelle est la date butoir – car, visiblement, le gouvernement néerlandais va passer outre le résultat du référendum en s'abritant derrière une déclaration interprétative.
Je considère la décision prise par l'Union européenne sur la Bosnie-Herzégovine comme une erreur manifeste. En ce moment, la presse française et les sites internet français regorgent de reportages sur les élections locales dans ce pays où l'on voit être candidats, d'un côté, un ancien criminel de guerre condamné et, de l'autre, une femme en niqab. On sait très bien que cet État est majoritairement musulman. Or, pensez-vous sincèrement, alors qu'on constate une telle incertitude en Europe, que c'est le moment de rappeler que la Bosnie-Herzégovine a vocation à rejoindre l'Europe ? Cela me semble suicidaire même si j'ai bien compris que la décision ne date pas d'aujourd'hui. Et quand vous soulignez le fait que la France a été associée à cette décision, j'en conclus que nous y étions favorables. Cela donnera, pour l'Europe, une image catastrophique.
François Loncle a raison de rappeler que toute comparaison a ses limites. Les comparaisons évoquées ont été faites pendant la campagne référendaire. Et quand on faisait référence au modèle canadien, il s'agissait d'accords d'association, d'accords de libre-échange avec l'Union européenne, de partenariats dans différents domaines – politique judiciaire, politique policière… Encore une fois, si c'est un autre type d'accord que ceux mentionnés qui sera mis en place, il s'agira probablement d'un accord de libre-échange qui demandera des négociations très longues, très complexes et qui exigera de notre part une très grande vigilance et une harmonisation des positions européennes peut-être difficile à trouver.
Je n'ai pas connaissance de la date butoir, concernant les conséquences du référendum aux Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais va indiquer qu'il va tenir compte du résultat, qu'il va donc chercher à obtenir des réponses de la part du Conseil européen et, en cas d'échec, qu'il sera amené, dans un délai relativement raisonnable, à demander l'instauration d'une forme de suspension de la ratification de l'accord. Le premier ministre Mark Rutte est tout à fait conscient du fait que la remise en cause par un seul pays de l'accord d'association obtenu par les Vingt-Huit menacerait la stabilité de l'Ukraine. C'est pourquoi son gouvernement travaille à la rédaction d'une déclaration interprétative.
Pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, de nombreuses raisons peuvent justifier le fait qu'aujourd'hui on ne soit pas à la veille de l'ouverture de négociations d'adhésion ; mais je ne pense pas que l'on doive retenir l'argument selon lequel ce doit être parce que ce pays est musulman dans sa majorité. La Bosnie-Herzégovine est marquée par un fractionnement de confessions, de réalités nationales,…
En effet, de pouvoirs, depuis la signature des accords de Dayton. Une composante de la fédération bosniaque est certes musulmane mais, précisément, l'État ne se définit pas ainsi : on compte trois co-présidents dont l'un est serbe et un autre bosniaque musulman – on dit désormais simplement « bosniaque ». Les critères à retenir dans la perspective éventuelle, à long terme, d'une adhésion sont la capacité à respecter le droit communautaire, la capacité à prendre sa place au sein de l'Union européenne. En attendant, nous devons veiller à la paix dans cette région où les risques d'instabilité restent nombreux. Or la perspective européenne y est un puissant facteur de stabilité et un puissant levier de réforme.
La séance est levée à dix-huit heures huit.