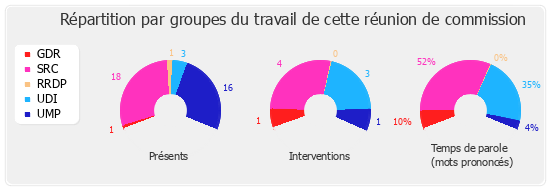Commission de la défense nationale et des forces armées
Réunion du 12 novembre 2014 à 11h00
La réunion
La séance est ouverte à onze heures.

Nous entamons aujourd'hui une réflexion sur les deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 2 octobre dernier, portant sur les restrictions au droit d'association des militaires. Je rappelle que M. Bernard Pêcheur, président de la section de l'administration du Conseil d'État et nouveau président du Haut comité d'évaluation de la condition militaire, s'est vu confier par le président de la République une mission de réflexion sur le même sujet. Nous sommes convenus de l'auditionner une fois qu'il aura achevé ses travaux.
Nous commençons ce matin par l'audition de trois juristes spécialistes de ces questions. Je vous remercie, madame et messieurs les professeurs, d'avoir répondu à notre invitation.
Je commencerai par une présentation de l'évolution du droit de la fonction militaire, du droit de la fonction publique civile et du droit du travail.
Le droit français, vous le savez, est scindé entre droit public et droit privé. Cette summa divisio garantit le principe de séparation des autorités et des juridictions administratives et judiciaires, lequel remonte à la loi des 16 et 24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III.
En conséquence, le droit applicable aux relations professionnelles se divise entre deux grandes branches : le droit de la fonction publique pour les fonctionnaires civils et pour les militaires, le droit du travail pour les salariés des entreprises. La prérogative de puissance publique, le service public et la défense de l'intérêt général justifient l'application du droit de la fonction publique aux fonctionnaires. Aux droits parfois exorbitants dont ces derniers bénéficient répondent en effet des obligations également exorbitantes.
Rappelons que le droit de la fonction militaire a été à certains égards la source du droit du travail et du droit de la fonction publique.
Ce sont d'abord les militaires qui ont bénéficié du droit à pension, par exemple, en contrepartie de quoi ils devaient rester au service de l'État. Puis, dans les années 1850, les fonctionnaires ont bénéficié de cet avantage. Les salariés devaient, eux, se constituer une rente, faute de quoi ils n'avaient d'autre perspective que de mourir à la tâche.
De même, le mode de recrutement par concours – rapporté par les missionnaires de Chine, où il servait au recrutement des mandarins –, s'est d'abord appliqué aux officiers avant que le dispositif ne soit étendu aux fonctionnaires. Mais ce dispositif était au départ mal considéré, dans la mesure où il était entaché de népotisme dans la fonction militaire et où, dans l'administration, il ne permettait pas de faire un choix discrétionnaire. Dans tous les cas, et comme on le voit chez Balzac, Zola ou Courteline, la lettre de recommandation permettait également d'entrer dans les ministères.
Un autre exemple de disposition provenant du statut des militaires est la séparation du grade et de l'emploi : l'officier est propriétaire de son garde, ce qui lui permet de le conserver malgré les changements de régime qui parsèment le XIXe siècle ; en revanche, le ministre a pouvoir de décision quant à l'emploi, ce qui lui permet d'affecter les militaires à sa discrétion. Il résulte de ce principe une obligation de mobilité pour les militaires.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette disposition est transposée à la fonction publique civile, constituant un gage de stabilité et de neutralité mais offrant aussi une liberté discrétionnaire aux ministres.
Dans cette période, les relations au sein des administrations reposent sur l'obéissance hiérarchique unilatérale. Aucune place n'est donnée aux relations bilatérales, à la négociation ou au dialogue.
C'est du reste la même hiérarchie qui règne dans les entreprises au début du siècle, puisque la loi Le Chapelier de 1791 dispose, en son article 1er : « L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit. »
C'est sous le Second Empire, régime qui n'est pourtant pas le plus ouvert en matière de libertés publiques, que l'on constate une évolution avec la suppression, en 1864, du délit de coalition. Puis, surtout après les événements de la Commune de Paris, le syndicalisme ouvrier commence à se développer. En 1884, enfin, la loi Waldeck-Rousseau autorise les syndicats : il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation du Gouvernement pour créer une section syndicale. Mais cette loi ne concerne ni les fonctionnaires ni, a fortiori, les militaires.
Et si la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne fait pas interdiction aux fonctionnaires de s'associer, l'interprétation politique qu'en feront les régimes successifs maintient cette interdiction. Les fonctionnaires ne peuvent prendre part aux banquets républicains, par exemple, ni se réunir sous quelque forme que ce soit.
Le juriste Henry Berthélémy proposait une distinction entre les fonctionnaires de gestion et les fonctionnaires d'autorité : pourquoi ne pas reconnaître aux premiers la liberté d'association ? Le problème est que les postiers et les instituteurs se trouvent dans cette catégorie, et qu'ils font grève en 1905, 1906 et 1907 !
Après la Première Guerre mondiale, les femmes, malgré la part qu'elles ont prise dans l'effort national, se voient interdire l'entrée dans la fonction publique via les concours au motif qu'elles n'ont pas fait leur service militaire. Il faut attendre 1936 pour que cette possibilité leur soit offerte.
Dans l'entre-deux-guerres, cependant, les syndicats pénètrent dans la fonction publique. Ils sont politiquement intéressants pour les gouvernements souvent marqués à gauche qui se succéderont dans la période. C'est ainsi que la puissance publique reconnaît officieusement ces formations qui constituent des forces électorales non négligeables.
Passons sur le premier statut général des fonctionnaires de 1941 et venons-en à 1946, où est voté, quelques jours avant la nouvelle Constitution, le premier statut général républicain des fonctionnaires. Le texte reconnaît la liberté syndicale pour l'ensemble des fonctionnaires. Pas un mot, en revanche, sur le droit de grève, proclamé néanmoins dans le préambule de la Constitution pour tous les travailleurs.
C'est donc à partir de 1946 que la liberté syndicale est reconnue à la fonction publique civile. Le statut général instaure dans le même temps toute une série d'institutions et d'instances paritaires où siégeront à parts égales les représentants de l'administration et les représentants des fonctionnaires via les organisations syndicales représentatives : le Conseil supérieur de la fonction publique, les comités techniques paritaires – aujourd'hui appelés comités techniques, etc. Les syndicats se voient reconnaître un rôle, sinon de négociation, du moins de concertation.
Pour ce qui est maintenant des militaires, le droit de vote leur est reconnu en 1945 par une ordonnance du général de Gaulle – un an après les femmes ! Les règles qui régissent l'armée renvoient toujours à une conception napoléonienne de la fonction militaire. Il faudra attendre la période d'après 1968 pour qu'une instance de concertation, le Conseil supérieur de la fonction militaire, soit mise en place. En 1972 est établi le premier statut général des militaires. Si des avancées ont lieu en matière de concertation, il n'en va pas de même s'agissant de la liberté d'association. Je rappelle que les militaires doivent encore demander l'autorisation du ministre pour se marier s'ils servent à titre étranger ou si le futur conjoint n'a pas la nationalité française.
En 2003, répondant à une demande de la ministre de la défense Michèle Alliot-Marie, la commission Denoix de Saint-Marc procède à un toilettage de ce statut. Déjà, la Cour européenne des droits de l'homme a alerté les États adhérents au sujet de l'interdiction générale et absolue de tout moyen de défense collective des intérêts professionnels. La commission est composée de militaires et de spécialistes comme l'amiral Béreau ou M. Bernard Boëne, alors directeur général de la recherche et des enseignements des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Elle travaille dans un cadre fixe, celui de la non-reconnaissance de la liberté syndicale ou d'association pour les militaires.
Depuis 1974, la France est partie à la Convention européenne des droits de l'homme, source du droit positif dont elle admet la supériorité sur la loi nationale – article 55 de la Constitution –, que cette convention soit postérieure ou même, en vertu de la jurisprudence, antérieure. On ajoutera, pour faire bonne mesure, que la Cour de Strasbourg, comme toute juridiction internationale, fait prévaloir le droit dont elle est l'interprète authentique sur le droit constitutionnel des États membres.
Cette situation vaut pour autant que la France n'a pas formulé de réserve particulière au titre de l'article 57 de ladite Convention en ce qui concerne l'article 10 sur la liberté d'expression et l'article 11 sur la liberté de réunion et d'association, alors qu'elle l'a fait en ce qui concerne l'article 15 de la Convention relatif à la dérogation en cas d'état d'urgence, afin de protéger l'article 16 de la Constitution.
Le statut militaire qui régit les forces armées est caractérisé par trois éléments convergents :
– la spécificité éventuelle de la mission opérationnelle, qui peut impliquer l'usage des armes, donc la possibilité de donner la mort hors l'état de légitime défense, dans des circonstances qui rendent l'emploi de la force absolument nécessaire au maintien de l'ordre public, comme la Convention le prévoit d'ailleurs en son article 2, ou dans l'hypothèse du combat contre un ennemi identifié ;
– la subordination permanente de la force armée au pouvoir civil, seul politiquement responsable de la mission assignée à la force armée, voire des conditions d'emploi de la force ;
– la cohésion manifeste de l'institution militarisée ou militaire reposant sur une stricte subordination de grade à grade telle que l'ordre du supérieur hiérarchique soit strictement et immédiatement obéi, à moins que cet ordre ne soit « manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public », comme l'énonce la jurisprudence « Langneur » du Conseil d'État du 10 novembre 1944 et comme le transpose en termes proches le code de la défense en son article L. 4122-1.
Tous ces éléments – spécificité éventuelle de la mission, subordination permanente de la force, cohésion manifeste de l'institution – se résument dans l'adage selon lequel la discipline fait la force des armées, formule qu'il faut comprendre comme applicable à l'ensemble des forces armées, gendarmerie nationale incluse. L'article D. 4137-1 du code de la défense traduit cet adage en droit positif :
« Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres.
Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. »
Doit-on considérer dès lors que la discipline conduit à respecter les droits de chaque militaire, y compris depuis la loi dite « Alliot-Marie » du 24 mars 2005, alors même que cette exigence de discipline conduit à écarter, sous les armes, mais aussi dans le service ou même hors service, un certain nombre de libertés fondamentales dont, précisément, la liberté d'association ? En 2005, le Conseil constitutionnel n'a rien eu à en dire car il n'a pas été saisi, par voie d'action, de la loi Alliot-Marie, pas plus qu'il ne l'a été, à ce jour, par voie d'exception, c'est-à-dire par voie de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Toutefois, un contentieux est pendant devant le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'État de la QPC n° 2014-432 du 24 septembre 2014 sur la constitutionnalité de l'incompatibilité, actuellement posée par la loi, d'un mandat électoral avec le statut militaire.
S'il n'y a pas encore de contrôle de constitutionnalité, il y a cependant un contrôle de conventionnalité : non pas de la part du juge français, puisque le Conseil d'État qui a donné raison à l'État dans les affaires Matelly et Adefdromil (Association de défense des droits des militaires), mais de la part du juge européen puisque, par une sorte de contrôle de conventionnalité « à l'envers », la Cour de Strasbourg a condamné l'État français, dans ces deux affaires, par ses deux arrêts du 2 octobre 2014.
Aux termes de l'article 11 de la Convention, « toute personne » – donc toute personne à statut militaire, notamment – « a droit à la liberté d'association ». De plus, le droit européen ne différencie pas cette liberté d'association et le droit syndical, contrairement au schéma français des lois de 1901 et de 1884. Le texte de la Convention précise bien que la liberté d'association emporte la liberté syndicale : « y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts », c'est-à-dire, entre autres, de ses intérêts professionnels.
Comme souvent, toutefois, la Convention ajoute avec réalisme à un premier paragraphe compréhensif un deuxième paragraphe restrictif. Ainsi, des « restrictions légitimes » et limitées peuvent être prévues pour certaines catégories, dont les membres des forces armées, sous des conditions reprises régulièrement par la Cour en référence notamment à son arrêt du 12 novembre 2008 « Demir et Baykara contre Turquie ».
Ces restrictions doivent répondre à trois grandes conditions : elles doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaires dans une société démocratique.
Dans les affaires qui nous occupent, la Cour considère que la première condition est remplie : les restrictions, en l'espèce, sont prévues à l'article L. 4121-1 du code de la défense et à l'article L. 4121-4, dont l'alinéa 2 est ainsi rédigé : « L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. »
La Cour estime également, au paragraphe 67 de l'arrêt Matelly et au paragraphe 51 de l'arrêt Adefdromil, que les restrictions poursuivent un but légitime, étant nécessaires à la préservation de l'ordre et de la discipline nécessaire aux forces armées.
La troisième condition, en revanche, celle de la nécessité dans une société démocratique, n'est pas remplie aux yeux de la Cour, en ce que la loi française interdit la liberté syndicale, composante de la liberté d'association pour la défense des intérêts professionnels des militaires – paragraphe 70 de l'arrêt Matelly et paragraphe 54 de l'arrêt Adefdromil.
Il existe déjà de nombreuses instances et procédures permettant de défendre les intérêts des militaires : par exemple, associations de soutien moral ou matériel, comme l'Essor de la gendarmerie nationale ou la Saint-Cyrienne, rapports sur le moral, conseils spécialisés tels que le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie et le Conseil supérieur de la fonction militaire, Haut comité de l'évaluation de la condition militaire, délégués locaux, mais aussi contentieux juridictionnel avec recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours. Ce que l'on peut inférer des arrêts de la CEDH, c'est une demande en faveur d'une association professionnelle des militaires d'active, régie par la loi de 1901, sur le modèle de l'Association générale des fonctionnaires d'avant la Seconde Guerre mondiale. Cela étant, la Cour mentionne, à ce sujet, un simple « droit de s'organiser » et ne demande nullement un syndicat militaire. Rien n'interdit, donc, de continuer à découpler la législation de 1884 et celle de 1901. Par ailleurs, il est entendu que des restrictions peuvent être apportées quant aux modes d'action et d'expression d'une telle association : exclusion de la grève, du droit de retrait ou de pétition, exclusion du droit syndical, suspension de l'exercice du droit d'association professionnelle en opérations de maintien de l'ordre ou lors des interventions à l'étranger, obligation de loyalisme envers la République ; enfin l'obligation de réserve et de neutralité applicable à toute la fonction publique pourrait être rappelée et, le cas échéant, renforcée s'agissant des militaires.
Pour conclure, la France doit assurément se mettre en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme. Cela suppose que le droit d'association professionnelle soit reconnu dans les forces armées ; mais ce droit ne doit pas être compris comme un droit syndical et être fortement encadré pour assurer le maintien de l'opérabilité des forces armées.
Un parallèle peut être dressé avec le corps préfectoral, qui n'a ni la liberté syndicale ni le droit de grève mais dispose de la liberté d'association. De fait, l'ACPHFMI (association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur) existe et son siège est au ministère de l'Intérieur.
L'obligation de loyalisme à laquelle sont tenus certains fonctionnaires, notamment les préfets, est plus exigeante que l'obligation de réserve. Mais, pour les militaires, il s'agira de loyalisme vis-à-vis de la Nation et des institutions et non pas, comme pour le corps préfectoral, vis-à-vis du gouvernement en place. Les termes me semblent ambivalents car on peut les appliquer à des situations assez différentes. Il revient au législateur d'être suffisamment précis pour éviter que le juge ne se faufile dans les interstices !
En tant qu'officier de réserve, je voudrais que mon intervention soit également une expression du lien armée-Nation.
Je m'efforcerai dans un premier temps de présenter la problématique mise en jeu par les deux arrêts de la Cour EDH, puis, dans un deuxième temps, d'en tirer les conséquences pour la France et de livrer mon analyse de cette jurisprudence et des questions de constitutionnalité qu'elle emporte.
Comme l'a rappelé mon collègue Olivier Gohin, l'article L. 4121-4 du code de la défense dispose que les groupements professionnels militaires à caractère syndical sont « incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». L'article 11 de la CEDH établit quant à lui le principe de la liberté de réunion et d'association, lequel comprend la liberté de fonder un syndicat ou de s'y affilier, mais il admet, en son alinéa 2, des restrictions à ce droit. Les dispositions du code de la défense sont-elles en contradiction avec cet article ?
N'oublions pas que le Conseil d'État les a déjà jugées légitimes au sens de l'article 11 dans un arrêt du 11 décembre 2008 – Association de défense des droits des militaires – et un arrêt de section du 26 février 2010 concernant M. Jean-Hugues Matelly, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, et énonçant que, « eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l'exercice de leur mission par les forces armées, les dispositions précitées de l'article L. 4121-4 du code de la défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d'autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l'article 11 ». Ce sont ces arguments que la Cour européenne des droits de l'homme vient de dénoncer dans les deux arrêts du 2 octobre 2014.
Leur contenu ayant été détaillé par mon collègue, je m'attarderai sur l'opinion séparée formulée par le juge De Gaetano, à laquelle se rallie la juge Power-Forde. Selon le juge De Gaetano, « l'article L. 4121.4 du code de la Défense et la jurisprudence du Conseil d'État (…) ont en pratique pour effet combiné de proscrire totalement tous les groupes professionnels ou associations de membres de la gendarmerie (…), car ils sont ipso facto regardés comme des groupements ou associations “à caractère syndical” ». Selon lui, « il y a là effectivement une interdiction large et générale qui vide de sa substance même le droit pour les membres de la gendarmerie de s'organiser de manière à promouvoir et défendre leurs intérêts », et il fait référence à la jurisprudence « Demir et Baykam contre Turquie » de 2008.
Pour autant, ajoute-t-il, on ne doit pas « interpréter les paragraphes 56 à 58 de l'arrêt, et surtout le paragraphe 70, comme signifiant que les membres des forces armées ou de la police (…) ont nécessairement le droit de former un syndicat ou d'y adhérer ».
Remarquant qu'« il est très difficile, sinon impossible, de concilier l'action revendicative et les rôles et fonctions des membres des forces armées et des forces de police », le juge souligne que « le droit de former un syndicat et d'y adhérer n'est pas un droit spécial et indépendant : il ne s'agit que d'un aspect du droit plus large à la liberté d'association garanti par l'article 11 § 1. L'expression “pour la défense de ses intérêts” tout à la fin de l'article 11 § 1 renvoie à la finalité particulière d'une association de ce type, à savoir protéger les intérêts professionnels ou sociaux de ses membres, et aide à distinguer celle-ci, généralement appelée “syndicat”, des autres associations de nature politique, religieuse, sociale, académique, philanthropique, etc. Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas la dénomination de telle ou telle association (…), mais sa fonction et sa capacité à gérer les intérêts professionnels ou sociaux de ses membres.
Dès lors qu'une association a pour but (ou parmi l'un de ses buts) de gérer ou promouvoir les intérêts professionnels ou sociaux des membres des forces armées ou de la police, elle n'a pas besoin d'être un syndicat pour satisfaire aux exigences de l'article 11 § 1. »
Certes, il s'agit là d'une opinion séparée, mais elle peut constituer un point d'ancrage pour une action future, ce qui conduit à ma partie consacrée aux conséquences à tirer pour la France.
Le Gouvernement peut évidemment prendre acte de ces arrêts et modifier sa législation en conséquence. Mais on peut aussi considérer que la décision n'est pas satisfaisante et porte atteinte à des intérêts majeurs de l'État, ce qui est ma position. Il doit demeurer une marge nationale d'appréciation pour ce qui est de l'exercice de la liberté syndicale, ce que la Cour a accepté par exemple dans un arrêt du 6 février 1976, « Schmidt et Dahlström c Suède ».
D'un point de vue procédural, le Gouvernement français devrait donc profiter du délai de trois mois prévu par la CEDH pour demander le renvoi des deux affaires devant la grande chambre et obtenir une décision différente.
Les deux arrêts soulèvent en effet des questions majeures portant à la fois sur le statut des associations de défense de leurs droits des personnels militaires dans notre pays et sur leurs possibilités d'action, en particulier du droit d'ester en justice. Le Gouvernement français peut très bien contester le point de vue de la Cour EDH, en s'appuyant en particulier sur l'opinion séparée que je viens de citer.
En l'état actuel du statut des militaires et de la législation, les organes qui permettent la défense des intérêts professionnels, sociaux – et j'ajoute moraux – des personnels militaires existent. Il faut pousser plus loin l'analyse de leur fonctionnement, de leurs compétences, de leur composition, de leur mode de désignation, de leur efficacité et, surtout, de leur finalité.
Si nous voulons parler au juge européen, nous devons nous inscrire dans sa logique en recherchant la proportionnalité de la règle législative inscrite dans le code de la défense au regard de l'exigence posée par l'article 11 de la CEDH et en évaluant l'effet utile d'une modification de l'interdiction syndicale – sachant qu'il s'agit d'une reprise de la recommandation du Comité des ministres de l'Europe de 2010 : permettre aux militaires de faire valoir leurs droits et revendications dans des conditions objectives de liberté.
Mais les militaires demandent-ils la création de syndicats ? Y a-t-il un besoin, une demande forte et générale ? Ne conviendrait-il pas de consulter le milieu militaire avant toute décision ?
Autrement dit, le syndicalisme est-il la réponse adéquate au regard de la finalité recherchée, à savoir l'exercice d'une liberté plus large que la liberté syndicale ?
Il nous faut tout de même constater que le « dialogue social » dans les armées, si l'on peut l'appeler ainsi, existe : il consiste à maintenir l'harmonie dans une organisation particulière qui ne peut pas voir se développer une contestation de type « purement » syndical sans toucher aux principes mêmes de la discipline militaire. La structure et le mode de fonctionnement de la communauté militaire requièrent que l'exercice de l'autorité y soit très spécifique.
Le statut du soldat peut en effet aller jusqu'au don ultime, comme il est rappelé dans le statut général, à l'article L. 4111-1, alinéa 2, du code de la défense : « L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. »
Parmi les propositions que l'on peut faire, je crois qu'il faut commencer par valoriser les instruments actuels : conseils de la fonction militaire (CFM) des armées et de la gendarmerie, Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) et Haut Conseil de la condition militaire (HCCM).
Le code de la défense, à l'alinéa 3 de l'article L. 4121-4, attribue également un rôle spécifique au commandement : « Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. »
Il convient toutefois de souligner une certaine spécificité de la gendarmerie dans le dispositif général, qui tient à sa composition en tant que corps militaire et à son affectation auprès du ministère de l'Intérieur. Un traitement particulier doit sans doute lui être réservé en matière de représentation.
J'insisterai enfin sur le rôle de chef des armées que l'article 15 de la Constitution confère au président de la République. D'une certaine façon, le président est le garant de la cohérence de l'institution militaire.
D'un point de vue pratique, nous devons apprécier les bons résultats du dispositif actuel. Ainsi, 90 % des demandes faites par le CSFM sont satisfaites. Et, si une part non négligeable du budget de la Défense est consacrée à la condition militaire, c'est aussi le fruit de la concertation telle qu'elle existe.
Parmi les solutions, on pourrait néanmoins préconiser une amélioration du fonctionnement et de la représentativité des organes actuels, en revoyant par exemple le processus de désignation aux CFM et au CSFM. Il convient de consulter les personnels sur ce qu'ils souhaitent vraiment, tout en prenant garde à ne pas déstabiliser l'institution militaire. Mais, en tout état de cause, la réponse syndicale n'est pas la bonne réponse.
Pour ce qui est enfin de l'aspect constitutionnel de la question, on peut se demander si l'article L. 4121-4 du code de la défense est compatible avec l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, inscrit dans notre bloc de constitutionnalité, qui énonce : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »
Dans sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel considère qu'il est de la compétence du législateur de rendre effective cette liberté syndicale. Il admet à cet égard des restrictions législatives, aux fins de garantir dans la loi les exigences tirées de la Constitution. Par ailleurs, sa célèbre décision du 16 juillet 1971 fait de la liberté d'association un principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est donc, à mon sens, dans un équilibre entre l'affirmation de la compétence du législateur et l'affirmation de la liberté d'association que la solution doit être trouvée.

Telle que nous l'avons votée, la loi de programmation militaire (LPM) de 2013 prévoit l'amélioration de l'expression et de la représentation des militaires au sein des armées. Des travaux en ce sens sont en cours. Mais M. Le Bris avait déjà étudié le sujet lors de la précédente législature.

Mon collègue de l'UMP Étienne Mourrut et moi-même avons en effet remis un rapport qui abordait l'ensemble des problèmes évoqués par les intervenants. Nous concluions par des propositions précises, notamment la proposition n° 15, qui vise à autoriser les militaires à adhérer à des associations de défense de leurs droits. Pendant plus d'un an, nous avons rencontré les militaires des différentes armes et les conseils de la fonction militaire. Jamais et nulle part nous n'avons entendu ou même ressenti que les militaires demandaient une syndicalisation. En revanche, le droit d'association est une revendication que l'on rencontre chez certains, dans le but notamment d'exprimer les intérêts professionnels lorsque ceux-ci sont mis à mal. S'agissant du logiciel LOUVOIS, par exemple, on peut imaginer que les anomalies auraient été prises en compte plus rapidement si la demande avait émané d'associations professionnelles et pas seulement de la hiérarchie, qui a sans doute fermé les yeux trop longtemps sur ce problème.
Il existe aujourd'hui des associations d'anciens militaires, d'anciens élèves des écoles militaires, etc., qui ont parfois un rôle d'expertise.

N'oublions pas les associations de femmes de militaires. Pour le logiciel LOUVOIS, elles ont été parmi les premières à donner l'alerte.

En effet. En tout état de cause, il serait bon que le ministre de la Défense tienne compte des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et ouvre des possibilités, moyennant les restrictions admises par la Cour elle-même : il ne saurait être question de droit de grève ni droit de retrait, il ne saurait non plus être question de cogestion à quelque degré que ce soit, la critique de l'institution ne peut dépasser une certaine limite, etc.
Je remarque que la jurisprudence française a sensiblement évolué au fil du temps. Déjà, un arrêt du Conseil d'État du 18 mai 1973 donnait la possibilité aux militaires de se réunir en dehors du service pour discuter de tous sujets, y compris de leur condition professionnelle. Il faut désormais que la législation s'adapte dans des limites convenables, toute forme de syndicalisme étant bien entendu exclue.

Vos interventions, madame et messieurs les professeurs, montrent une fois de plus l'importance des acquis du Conseil national de la Résistance et la nécessité de tout mettre en oeuvre pour les conserver.
Les militaires, auxquels la France sera un des derniers pays à reconnaître le droit d'association, sont une variable d'ajustement du budget. Entre 75 000 et 80 000 emplois auront été détruits en huit ou neuf ans. Les contrats d'engagement sont de très courte durée. Certaines soldes sont dramatiquement faibles. Le malaise est grand dans l'armée, alors pourquoi ne pas envisager, sous réserve des restrictions énoncées par M. Le Bris, la syndicalisation ?
À cet égard, qu'en est-il du droit syndical dans les armées des pays voisins ?

Pour avoir interrogé les militaires du rang dans le cadre d'un rapport sur le rôle social de l'armée de terre, je n'ai pas senti d'aspiration au droit de se syndiquer. Il existe en revanche des demandes concernant le dialogue social et l'amélioration de la prise en compte de la parole des militaires. Je pense donc qu'il faudra faire évoluer les instances en place vers plus de transparence, de lisibilité et même de possibilité de débat.
Faut-il, pour autant, aller vers une association professionnelle ? J'avoue être réticent : nous ne devons pas remettre en cause l'unicité du statut militaire, la cohésion des armées, mais aussi leur neutralité. Je ne voudrais pas que des associations fortes puissent contester le pouvoir civil. Les démocraties sont fragiles. Si nous devions évoluer vers un droit d'association, il faut le « border » soigneusement. Droit de grève et droit de retrait sont évidemment exclus, et la vigilance s'impose quant à la neutralité.
L'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont permis à leurs militaires de se syndiquer, avec sans doute des restrictions sur certains points. Le Royaume-Uni a également autorisé ses militaires à adhérer à des syndicats civils, mais en leur interdisant de formuler des revendications. En Espagne, en Italie et en France, la syndicalisation est interdite. Comment, dans ce contexte, faire évoluer le dialogue social au sein des armées ?
La France n'est pas en situation de « prendre acte » des arrêts de la CEDH : elle a obligation de les exécuter de bonne foi, en vertu de sa Constitution et des conventions auxquelles elle a librement décidé d'adhérer. Je vous renvoie au problème récurrent des magistrats du Parquet, qui, au sens de la Cour, ne sont pas des magistrats : après trois arrêts condamnant la France depuis l'arrêt Medvedyev, où sont les modifications de la Constitution ou de la législation organique à ce sujet ? Dans le cas qui nous occupe, si la France ne modifie rien, elle sera de nouveau condamnée !
Je veux bien que l'on interjette appel devant la grande chambre – nous en avons en effet la possibilité –, mais je pense que le résultat sera le même. La jurisprudence de la Cour est très construite, elle ne remonte pas aux deux arrêts du 2 octobre 2014 ! Comme dans bien d'autres cas, notre législation n'est pas en conformité avec la Convention mais personne ne s'en était soucié jusqu'à présent.
Maintenant que le problème est posé, il appartient au législateur de le résoudre. La difficulté tient à l'article 4121-4 alinéa 2 du code de la défense. Mais vous disposez de marges importantes : dans sa jurisprudence, la Cour accepte des restrictions fortes pourvu qu'elles soient légitimes.
À mon sens, l'opinion séparée exprimée par le juge maltais relève largement du sophisme. Ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est la distinction opérée en droit français entre le syndicat – loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 – et la liberté d'association telle que définie par la loi du 1er juillet 1901. Le régime d'association recouvre un vaste champ qui inclut d'ailleurs les partis politiques. Ce qu'admettait la circulaire Clémentel de 1924 peut exister à nouveau sans aucune difficulté, moyennant, bien entendu, les réserves déjà mentionnées : exclusion du droit de grève, du droit de retrait, exigence renforcée en matière de neutralité et de réserve, loyalisme envers les institutions. Cela n'empêche pas de revoir les structures actuelles de concertation, mais il faut aussi mettre le droit français en conformité avec la Convention.

La question de la différenciation des statuts selon que les militaires relèvent du ministère de la Défense ou – s'agissant des gendarmes – du ministère de l'Intérieur revient régulièrement devant notre commission. Je me dois de répéter notre attachement, toutes tendances confondues, au statut militaire. L'hypothèse que vous avez évoquée, monsieur le professeur Drago, nous laisse quelque peu perplexes…
Loin de moi l'idée de mettre fin à un statut militaire auquel les gendarmes sont très attachés ! En revanche, l'organisation des ressources humaines de la gendarmerie devrait faire l'objet d'une évaluation différente. Le maillage territorial assuré par la gendarmerie, sa répartition entre gendarmerie mobile et gendarmerie départementale, nécessitent sans doute un dialogue et un traitement différenciés.
Dans la mesure où ils relèvent du ministère de l'Intérieur, les gendarmes sont amenés à effectuer des comparaisons avec les forces de police, dont les grilles indiciaires et les conditions d'avancement, par exemple, font l'objet d'un traitement différent. La question n'emporte nullement l'abandon du statut militaire. Peut-être conviendrait-il de vérifier le fonctionnement du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie et, le cas échéant, de l'améliorer. Personne ne peut oublier que, dans l'histoire récente, la gendarmerie est la seule force militaire à avoir manifesté en tenue.
Notons tout de même qu'il n'y a pas tant de différences que cela entre les gendarmes maritimes, par exemple, et les militaires qui relèvent de la marine nationale. Notons aussi que d'autres militaires que les gendarmes ne relèvent pas du ministère de la Défense – ceux qui dépendent de la direction des affaires maritimes, par exemple. Est-il vraiment pertinent d'opérer des distinctions sur cette base ?
De même, il faut être réaliste au sujet d'instances de concertation qui sont marquées par la hiérarchie. Il faut que des militaires se portent volontaires pour y siéger, faute de quoi c'est le commandement qui désigne les membres. Il y a donc un problème de représentativité, d'autant que, derrière la représentation volontaire ou involontaire, se pose la question de la notation, de l'avancement, des promotions, des mutations, etc. S'il existait une structure collective – association loi de 1901 ou autre, sachant que la liberté syndicale, comme on le voit pour les magistrats et les policiers, n'implique pas le droit de grève –, je pense que le dialogue s'en trouverait facilité.
En matière de concertation, il faut rappeler l'existence d'instances de proximité.
Parfois, le droit régresse. Le décret du 30 décembre 2011 introduit par exemple dans le code de la défense un article D. 4121-3-1 disposant que « le personnel militaire est représenté auprès du commandement par des militaires désignés au sein des formations ». On ne peut attendre de personnes désignées par le commandement qu'elles aient de fortes revendications professionnelles !
La condition militaire ne se résume pas à un statut. Il ne suffit pas que les gendarmes aient un statut militaire pour qu'ils soient des militaires. La fonction militaire concerne environ 5 % de leurs effectifs, placés du reste sous l'autorité du ministre de la Défense, dans cette circonstance. Le reste exerce une fonction policière : police administrative ou judiciaire, et c'est ce qui fait la spécificité de la gendarmerie. Je n'estime donc pas anormal que celle-ci fasse l'objet d'un traitement différencié au sein d'un statut militaire auquel elle est attachée.
Quelle différence faire entre les missions de la gendarmerie mobile et celles des compagnies républicaines de sécurité (CRS), par exemple, sinon que les secondes disposent du droit syndical ? Les syndicats y sont même extrêmement puissants : on ne descend pas des fourgons avant que le délégué syndical ne soit allé vérifier que l'hôtel est acceptable pour les personnels !
Bref, je comprends l'attachement de gendarmes à leur statut militaire. Encore faut-il que leur comportement s'y conforme !

Vous faites référence, on l'aura compris, à des événements qui se sont déroulés il y a quelques années…
Des événements que l'armée de terre a très mal vécus.

Je suis un des rares députés de la majorité à n'avoir pas voté la loi du 3 août 2009. Dans toute démocratie, il y a une dualité des forces de police, qu'il s'agisse du modèle anglo-saxon de police nationale et de police locale ou du modèle latin de police à statut civil et de gendarmerie à statut militaire. En tant que juristes, êtes-vous attachés à cette dualité ?
Par ailleurs, le statut militaire de la gendarmerie n'est pas neutre sur le plan budgétaire. La potentialité de 100 000 gendarmes, en termes de charge de travail et de présence sur le terrain, équivaut à celle de 150 000 policiers. Faire passer la gendarmerie sous statut civil, comme en Belgique, aurait un coût non négligeable pour l'État.
Que les CRS et les gendarmes mobiles remplissent les mêmes tâches, certes, mais le coût n'est pas identique, ne serait-ce qu'en raison des conditions d'hébergement ! Et l'on sait très bien que la décision d'employer les CRS ou les gendarmes mobiles se fait aussi en fonction des coûts annexes – heures supplémentaires et autres –, moins élevés s'agissant des seconds.

La gendarmerie nationale, monsieur le professeur Drago, dispose d'un système de dialogue social différent des autres armes depuis un arrêté du 23 juillet 2010.
A-t-on évalué ce système ? Donne-t-il satisfaction ?

Les nouvelles instances de représentation rencontrent très régulièrement l'autorité politique.
Cet arrêté du 23 juillet 2010 montre bien que la situation de la gendarmerie est en train de diverger par rapport à celle des armées. Vous voulez défendre, monsieur le député Folliot, les intérêts professionnels des gendarmes. Mais, si le coût de la gendarmerie est moindre, c'est peut-être, précisément, en raison de la « rusticité » de ce corps, liée à l'absence ou à l'insuffisance de défense professionnelle par rapport à la police…

Ce n'est évidemment pas ce que j'ai voulu dire. Quand on choisit entre le concours d'entrée dans la police et le concours d'entrée dans la gendarmerie, on sait que les règles du jeu sont différentes. Qu'il existe ensuite des « passerelles » ne pose pas de problème. Les gendarmes observent bien entendu ce qui se passe ailleurs, sans que cela les empêche de rester très attachés à la spécificité de leur statut. Ce que je regrette, c'est que l'on ait trop distendu le lien entre le ministère de la Défense et la gendarmerie. Si le programme « Gendarmerie nationale » était resté interministériel, même en passant de 90 % de crédits imputables au ministère de la Défense et 10 % au ministère de l'Intérieur à la proportion inverse, le lien aurait été conservé. Il demeure, du reste, en matière disciplinaire. Je crois que nous n'avons pas intérêt à mélanger les genres. En ce domaine comme en bien d'autres, notre modèle latin n'est peut-être pas si mauvais que cela !
Dans mon souvenir, les élèves sortant de l'école spéciale militaire pouvaient choisir la gendarmerie. C'étaient souvent les premiers, d'ailleurs. Mais j'ignore si cela existe encore…

Étant entendu que ces élèves ne figurent plus dans le classement final. Les gendarmes, j'y insiste, sont très attachés à la spécificité de leur arme. À l'origine, la gendarmerie est une émanation de l'armée de terre.
Ce qui nous ramène à l'arrêt Matelly du Conseil d'État.
La professionnalisation des armées a évidemment des conséquences en matière de dialogue interne, on dit aussi social. Il appartient au législateur d'adapter le droit non seulement à des exigences conventionnelles, mais aussi à la logique des réformes qu'il a votées. Or, à l'évidence, les structures existantes ne sont pas en correspondance avec un modèle qui a beaucoup évolué.

C'est ce qui était constaté dans le rapport mentionné par M. Le Bris et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que la loi de programmation militaire permette d'engager une évolution.
Le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur a nécessairement des incidences. Il conduit à mettre ce corps, dont la fonction principale est de police et non pas militaire, dans une situation intermédiaire entre les armées et la police. La structure est beaucoup plus éclatée qu'autrefois. Le raisonnement vaut d'ailleurs pour la police elle-même : entre la direction générale de la police nationale avec la direction centrale de la sécurité publique, la direction centrale des CRS, ou la direction centrale de la police aux frontières, ou la direction générale de la sécurité intérieure, il existe sans doute plusieurs polices administratives et civiles au sein du même ministère.

À mes yeux, notre bloc de constitutionnalité garantit parfaitement les libertés fondamentales en France. Les juridictions judiciaires ou administratives ont démontré qu'elles étaient à même de les faire respecter. Qu'apporte, dès lors, la Convention européenne des droits de l'homme ? Est-il vraiment indispensable de reconnaître la juridiction de la Cour de Strasbourg ?
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'être partie à la Convention sans reconnaître la juridiction. Cette faculté d'option a disparu. Quant à se retirer de la CEDH, c'est certainement possible. Il existe un précédent, celui de la Grèce des colonels en 1967… (Sourires.)
La séance est levée à douze heures trente.