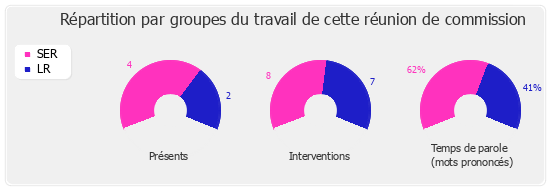Mission d'information sur les suites du référendum britannique et le suivi des négociations
Réunion du 29 septembre 2016 à 10h00
La réunion
La séance est ouverte à dix heures quinze.

J'ai le plaisir d'accueillir Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France au Royaume-Uni. Cette audition n'étant pas ouverte à la presse, vous allez pouvoir, madame Bermann, vous sentir très libre de vos propos.
Sans doute vos fonctions antérieures vous ont-elles habituée aux casse-tête chinois, mais ils vous paraîtront sans doute bien simples au regard de celui auquel vous êtes confrontée aujourd'hui.
Votre point de vue nous intéresse tout particulièrement étant donné que vous êtes une observatrice privilégiée de la situation britannique.
Ainsi aurons-nous le plaisir de vous entendre sur les suites du congrès du Parti travailliste, qui donne une certaine idée de ce que sera la position des travaillistes vis-à-vis du Premier ministre Theresa May.
Quelle est, ensuite, la situation au Royaume-Uni ? Car à écouter les déclarations de l'ancien maire de Londres ou celles des collaborateurs de Mme May, la date de l'application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne n'est pas la même.
Enfin, la situation britannique peut avoir des prolongements en France. Certains responsables politiques de haut niveau évoquent ouvertement l'idée qu'il pourrait y avoir à court terme – ce qui me paraît difficile – un changement de position de la part du Royaume-Uni.
Chacun perçoit la réalité britannique en fonction des informations qu'il peut recueillir mais vous êtes, j'y insiste, un témoin privilégié. Vous allez ainsi pouvoir nous en dire davantage sur la manière dont les Britanniques s'organisent ou encore sur l'état d'esprit des Écossais.
Je vous remercie pour votre invitation et je serai heureuse de recevoir votre mission au mois de novembre à Londres, en espérant que la situation aura quelque peu avancé.
Trois mois après le référendum, il n'y a plus de Bremainers, partisans du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, ni de Brexiters, partisans de sa sortie. Nous avons désormais, d'un côté, les hard Brexiters et, de l'autre, les soft Brexiters. Les premiers souhaitent une rupture immédiate et une renonciation à tout, y compris à l'union douanière, au marché unique européen, pour s'en tenir au cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les soft Brexiters, pour leur part, entendent que le Royaume-Uni reste au plus près de l'Union européenne, tout en tenant compte de la contrainte liée à l'immigration.
En effet, le référendum n'a pas réellement porté sur l'Union européenne mais bien sûr l'immigration – l'Union européenne, il y a quelques années, figurait ainsi au neuvième rang des préoccupations des Britanniques. Le lien établi par le parti nationaliste « pour l'indépendance du Royaume-Uni, United Kingdom Independence Party (UKIP), entre l'immigration incontrôlée et l'Union européenne, a conduit la majorité des votants à s'exprimer, en fait, contre l'immigration. Or il faut garder à l'esprit que le solde migratoire net est aujourd'hui de 327 000 personnes par an au Royaume-Uni, alors qu'il n'est que de 30 000 personnes en France. Il convient de prendre également en considération le fait qu'il y a des villes où les affiches sont en polonais, les instructions sur les chantiers données en polonais, et où les Polonais, dans certaines écoles, sont majoritaires ; je prends l'exemple des Polonais car ce sont eux qui ont été le plus victimes du racisme au lendemain du référendum – au point que l'un d'eux a été assassiné –, certains Britanniques exigeant le retour chez eux de « cette vermine ».
D'autres éléments ont également compté. Au sein du parti Tory, des députés étaient très hostiles à l'Union européenne et estimaient que le Parlement de Westminster devait avoir le dernier mot – alors que paradoxalement – il ne pourra pas se prononcer sur le déclenchement de l'article 50 du traité sur l'Union européenne.
Parmi les hard Brexiters, on trouve le ministre chargé du Brexit, David Davis, et le ministre chargé des négociations d'accords de libre-échange, Liam Fox. Quant à Boris Johnson, s'il est plus difficile à classer, il a rejoint un groupe de pression réclamant un Brexit rapide.
La situation est par conséquent très confuse. Le Gouvernement en est à établir une cartographie – mapping, pour reprendre leur terme. À ce stade, il en est encore à recruter du personnel jusqu'au mois de décembre et n'en est donc pas au stade de la définition d'options.
En ce qui concerne le déclenchement de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, Theresa May a indiqué, sans plus de précision, qu'il n'aurait pas lieu avant 2017. Au ministère du Brexit, on évoque le premier semestre 2017. Quand Boris Johnson a parlé des mois de janvier ou février, il s'est fait taper sur les doigts. La semaine prochaine aura lieu la conférence du parti Tory à Birmingham, et Theresa May sera sans doute obligée d'en dire un peu plus.
C'est sur l'immigration, je l'ai mentionné, que Theresa May a besoin d'obtenir des résultats. Les discussions en cours portent sur la possibilité d'établir un permis de travail afin d'avoir une immigration choisie, mais aussi sur la possibilité d'activer un « frein d'urgence » en cas d'arrivée massive de migrants pour, notamment, soulager les services sociaux. Theresa May a déclaré au président Hollande, à Angela Merkel et aux autres dirigeants européens qu'on ne pouvait pas, compte tenu du message populaire, ne pas aboutir à une limitation de l'immigration. Elle n'a certes pas indiqué qu'elle serait prête à passer l'accès au marché unique par pertes et profits, mais c'est bien autour de l'immigration que se fera sans doute le compromis.
Outre, d'un côté, le groupe de pression des Brexiters, existe, de l'autre, un groupe de pression nommé Open Britain regroupant les anciens Bremainers, la City et les organisations patronales qui ont besoin de l'accès au marché unique et du passeport européen mais aussi de l'immigration : quand des offres d'emploi, dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'agriculture, dans les services de santé – National Health Service (NHS) – sont publiées, les Britanniques ne se présentent pas et ce sont des immigrés qui travaillent comme médecins, comme infirmiers. La pression est forte non seulement de la part des grands patrons mais aussi des petites et moyennes entreprises (PME) et du monde des affaires.
J'en viens aux entités dévolues. J'étais la semaine dernière à Edimbourg pour rencontrer le premier ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, et la principale députée de l'opposition au Parlement écossais, Ruth Davidson, qui souhaitent que les intérêts de l'Écosse soient pris en considération pendant la négociation. Je n'ai pas connaissance de position arrêtée sur la tenue d'un référendum ou non.
La question est beaucoup plus sensible en Irlande du Nord : un contrôle de l'immigration suppose une forme de rétablissement d'une frontière. Si cette dernière est fixée entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, ce sera catastrophique pour le processus de paix – du reste très largement financé par l'Union européenne à travers le programme PEACE. Quand vous allez en Irlande du Nord, vous avez l'impression d'un climat qui n'est pas totalement apaisé après des années de guerre civile.
On peut ajouter la situation de Londres, dont le nouveau maire travailliste est l'une des personnalités politiques les plus fortes au Royaume-Uni – il s'est d'ailleurs opposé violemment à la politique de Jeremy Corbyn. Londres n'est pas une entité dévolue, certes, mais si l'on considère que c'est Londres qui fait la richesse du Royaume-Uni, on doit prendre la position de la ville en considération. Le maire est très actif, notamment quant à la protection des étrangers : vous avez pu lire dans la presse que de nombreux actes xénophobes avaient été commis, jusqu'à la commission, j'y ai fait allusion, d'un meurtre ; dans le métro, il arrive qu'on demande à des personnes parlant une langue étrangère « ce qu'ils font encore là dans la mesure où l'on a voté pour qu'ils partent ».
D'autres questions se posent, notamment sur les échanges universitaires, les échanges scientifiques. Non seulement ces derniers représentent 30 % des fonds alloués par l'Union européenne mais le Brexit risque de conduire à la destruction des réseaux constitués.
Dans le domaine de la défense, vous avez pu prendre connaissance des déclarations du ministre britannique compétent, qui s'opposera à la création d'une défense européenne visant à dupliquer l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), à savoir instituer un état-major à Bruxelles et fonder une armée européenne. Le Brexit va donc à l'encontre des intérêts britanniques, puisque le Royaume-Uni participe, à hauteur de soixante-dix personnes et d'un navire, à l'opération Sophia en mer Méditerranée, destinée précisément à contenir l'afflux de migrants. Ce sont en outre les Britanniques qui commandent l'opération Atalante contre la piraterie. C'est donc via l'Union européenne qu'ils exercent une influence dans le monde. Je mentionnerai, pour finir sur ce point, leur focalisation sur la Russie, selon eux la première menace dans le monde, et donc l'importance qu'ils accordaient aux sanctions de l'Union européenne.
Encore une fois, personne, au Royaume-Uni, ne sait quelles options seront proposées. Theresa May prend des décisions informées, comme on a pu le constater à propos du projet d'EPR sur le site de Hinkley Point, puisqu'elle a réfléchi pendant plusieurs semaines avant de signer – une signature qui doit avoir lieu cet après-midi même. Ainsi, la décision d'invoquer l'article 50 dépend non pas de la volonté de faire traîner les choses mais de son souhait de disposer d'une position claire.

J'avais cru déceler, début juillet, une nette différence entre le parti travailliste, qui venait de réélire triomphalement Jeremy Corbyn à sa tête, et le groupe parlementaire travailliste, plutôt critique à l'encontre de Jeremy Corbyn et majoritairement Bremainer. Une réconciliation vous paraît-elle aujourd'hui possible ?
D'autre part, comme vous l'avez montré, nous sommes dans une incertitude maximale quant à l'application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne : en réalité, les Britanniques ne savent pas quel équilibre ils veulent négocier.
À cet égard, quel est votre avis sur les perspectives économiques au Royaume-Uni ? À la suite du résultat du référendum, le cours de la livre a chuté, avant de remonter ; aujourd'hui, les inquiétudes concernent davantage les investissements, non seulement au Royaume-Uni mais aussi en Afrique où opèrent des fonds d'investissement britanniques. En outre, dans ce contexte, comment évoluent nos compatriotes ?
Ensuite, les élections européennes prévues pour juin 2019 sont-elles perçues comme une date-butoir ? Il semblerait en tout cas que cela commence à être le cas du point de vue des Vingt-Sept…
En ce qui concerne le statut, il est évident que les Britanniques vont vouloir le beurre et l'argent du beurre, à savoir la limitation de l'immigration et l'accès au marché unique. Ils vont vouloir le négocier mais sur qui, à votre avis, vont-ils pouvoir compter ? Probablement les pays scandinaves, certes… À titre d'information, j'ai conduit hier une délégation de la commission des affaires étrangères à Berlin pour rencontrer nos homologues allemands et polonais. D'ordinaire, nous nous entendons très bien ; or, cette fois, je me suis inquiétée des positions de mon homologue allemand : il campe sur l'idée développée dans l'article qu'il a cosigné l'été dernier avec, notamment, Jean Pisani-Ferry. Je note donc plus qu'un flottement de la part des chrétiens-démocrates. Les sociaux-démocrates, quant à eux, sont silencieux. Les seuls à rester sur nos positions d'amitié et de fermeté sont les Verts et Die Linke. Comment percevez-vous cette situation depuis Londres, madame l'ambassadeur ?
J'en viens, pour finir, à la situation à Calais où la pression va augmenter. Je sais que les associations britanniques y sont très actives : je l'ai constaté sur place au mois de juin dernier. Mais moi qui soutiens la position de Bernard Cazeneuve parce qu'elle me semble la seule raisonnable, je me demande si elle va pouvoir perdurer compte tenu, j'y insiste, de l'accentuation des pressions politiques. Le gouvernement britannique y réfléchit-il d'ores et déjà ou pas encore ?

Dans le débat que vous avez décrit, madame l'ambassadeur, entre les soft Brexiters et les hard Brexiters, est-il acquis que les Britanniques n'auront pas, pour reprendre l'expression d'Elisabeth Guigou, le beurre et l'argent du beurre, à savoir qu'ils n'obtiendront pas à la fois le Brexit et ce qu'avait négocié David Cameron en cas de maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne ?
Vous avez mis l'accent, madame l'ambassadeur, sur le fait que c'est l'immigration qui a orienté le vote des Britanniques, ce qu'on a peu évoqué en France. Où en est donc le gouvernement de Mme May concernant la frontière avec la France, à Calais ? Discute-t-il de la révision des accords du Touquet ? En somme, y a-t-il une ouverture du gouvernement britannique sur la situation à Calais ?

Pouvez-vous, madame l'ambassadeur, nous dresser un portrait de Theresa May, que nous connaissons peu ? Vous avez indiqué qu'elle était méthodique… fort bien, mais de toute façon un Britannique défendra toujours ses intérêts.

Surtout, maîtrise-t-elle son gouvernement, au sein duquel il semble y avoir de fortes têtes ?
Avez-vous perçu, par ailleurs, dans vos discussions avec les Britanniques, qu'ils avaient l'intention de jouer sur le fait que le solde commercial de la France vis-à-vis du Royaume-Uni est positif ?
Enfin, vous avez mentionné le fait que l'argent de l'Union européenne n'alimenterait plus la recherche britannique. C'est un faux problème : le Royaume-Uni est le troisième contributeur net au budget de l'Union européenne – à hauteur d'environ 6 milliards d'euros contre 8 milliards d'euros pour la France. Ils vont donc pouvoir récupérer cet argent, à moins que l'accord qui sera négocié ne prévoie, comme c'est le cas avec la Suisse et l'Association européenne de libre-échange (AELE), que le Royaume-Uni continue à contribuer au budget de l'Union européenne en contrepartie d'avantages comme le passeport européen.

Je reviens sur la première cause du Brexit, qui est selon vous, madame l'ambassadeur, l'immigration. À Calais, quelle est la réalité des chiffres et ceux, en particulier, des mineurs isolés qui se trouvent dans une bien difficile situation ?
Ensuite, vous avez bien montré que Theresa May n'était pas en mesure, aujourd'hui, de demander l'application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Quels sont, à votre avis, les outils, les acteurs qui vont la conduire à cette décision ? Qu'est-ce qui va peser dans les semaines et les mois à venir ?
Le parti travailliste n'est plus un parti mais un mouvement de masse : environ 300 000 personnes se sont inscrites essentiellement pour voter en faveur de Jeremy Corbyn, qui n'a aucune chance de jamais arriver au pouvoir. Ses idées remontent aux années 1970 et il est en confrontation avec le groupe parlementaire. Les membres de ce dernier ont même envisagé une scission et la constitution d'un nouveau parti avec les libéraux-démocrates, mais ils y ont renoncé à cause des échecs passés et parce qu'ils restent assez loyaux non pas à l'égard de Jeremy Corbyn, mais envers le parti lui-même. Il n'y en aura pas moins, à mon avis, de nouvelles tentatives de prendre la relève de Jeremy Corbyn.
Au passage, il n'est pas exclu, même si Theresa May a déclaré qu'il n'y en aurait pas avant 2020, que des élections générales anticipées soient néanmoins organisées, car la situation risque d'être difficile pour elle, compte tenu des divisions sur le Brexit. Élue par 199 députés, dans les conditions que l'on sait, et non par les membres du parti conservateur, elle pourrait donc – même si ce n'est pas le plus probable aujourd'hui – être tentée par la convocation des électeurs.
Les conservateurs, pour en revenir à eux, ont pu considérer qu'avoir Jeremy Corbyn avec eux serait un avantage dès lors que le parti Tory serait au pouvoir pour plusieurs générations. Or ils constatent aujourd'hui qu'il est pire d'avoir une opposition intérieure que d'avoir à affronter une opposition extérieure.
Pour ce qui concerne les perspectives économiques, les Brexiters font valoir qu'une catastrophe avait été annoncée au lendemain du Brexit, alors qu'en fait, en dehors de la chute de la livre – qui a tout de même été de plus de 10 % –, tout va bien. En effet, le taux de chômage est de 4,9 % de la population active, la plus faible proportion jamais atteinte et, plus globalement, sur le plan économique, la situation n'a guère évolué. Seulement, le Brexit n'est pas encore effectif. Et la situation va probablement se détériorer d'ici à la fin de l'année : de nombreux investissements – y compris lourds – ont été gelés et la confiance risque de s'en trouver entamée. La croissance devrait atteindre 1,7 % du PIB pour 2016 et, l'année prochaine, selon les dernières prévisions, 0,7 % ; or, quand je suis arrivée au Royaume-Uni, en 2014, elle était de 3 %.

On évoque beaucoup l'activisme du ministre du commerce extérieur, qui essaie de négocier des accords avec des pays tiers.
Il s'est en effet rendu dans différents pays pour essayer de négocier des accords, et ces pays ont répondu qu'il fallait attendre de savoir quelles seraient les relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne. L'Australie, membre du Commonwealth, pays ami, qui s'était prononcé pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, a ainsi été approchée, mais il faut savoir que les échanges commerciaux entre les deux États représentent moins de 1 % de la totalité des échanges britanniques. La déclaration qui a été faite à ce sujet relève par conséquent plus de l'affichage que de la réalité. Nombreux sont ceux qui affirment que le ministre en question risque même de ne pas rester au Gouvernement quand il se rendra compte qu'il ne peut rien négocier.
J'en viens à nos quelque 300 000 compatriotes vivant au Royaume-Uni. Ils ne sont pas les plus inquiets. Je pense qu'il y aura une négociation sur les droits acquis aussi bien pour les Britanniques en Europe que pour les étrangers au Royaume-Uni. Pour l'heure, le climat n'est, il est vrai, pas très sympathique et beaucoup qui se sentaient Londoniens avant le 24 juin se sentent aujourd'hui étrangers à Londres.
Les prochaines élections européennes ont également été évoquées. Theresa May les prend certes en considération mais le butoir des Britanniques est plutôt l'échéance électorale de 2020, étant entendu qu'on peut imaginer une formule transitoire en 2019. Les Britanniques sont en effet bien conscients de l'aberration que constituerait le fait d'élire des députés européens après avoir voté le Brexit ; reste que Mme May lancera les négociations quand elle s'estimera prête et que, comme elle l'a déclaré au Président de la République, elles s'engageront d'autant mieux que les deux parties seront prêtes.
Pour ce qui est du statut, bien sûr que les Britanniques veulent le beurre et l'argent du beurre. Il faut tenir compte de ce que 48 % des votants ont souhaité rester au sein de l'Union européenne et que les parlementaires sont plus largement pro-européens encore ; or David Cameron a précisé au Président de la République, à Thiepval, le jour des commémorations de la bataille de la Somme, que le Royaume-Uni souhaitait rester au plus près de l'Union européenne. Les Britanniques vont donc chercher des solutions en sachant que leur principal problème est l'immigration.
Sur qui vont-ils compter ? Eh bien, d'abord sur les divisions entre les Vingt-Sept. De ce point de vue, ils ont noté le fait que Matteo Renzi, à l'issue du sommet de Bratislava, a fait part de son désaccord. Les Britanniques compteront sur les Scandinaves et sur une Allemagne – celle, en tout cas, de Mme Merkel – qu'ils perçoivent plus compréhensive que ne l'est la France. Selon eux, les Français ont une attitude punitive, au point que, au début des vacances, les Britanniques nous ont attribué la responsabilité des files d'attente de plusieurs heures pour embarquer dans leur ferry, alors qu'elle incombait en partie à la police britannique. L'idée que nous chercherions à leur faire payer le Brexit est bien ancrée. Il convient donc pour nous de rester en phase avec les Allemands.
Pour ce qui est de la situation à Calais, quoi qu'il arrive, nous sommes considérés comme coupables, soit parce que nous serions incapables d'assurer la sécurité et le contrôle des frontières, soit parce que nous traiterions les réfugiés de manière inhumaine. C'est ce que j'ai perçu à chaque fois que j'ai été interrogée à la télévision sur le sujet : l'idée est que nous ne sommes pas capables de gérer la situation, et cela bien avant que nous n'ayons pris conscience du problème en France. Quand je suis arrivée en poste, on montrait déjà les camions pris d'assaut. Il existe néanmoins, sur le sujet, une grande différence entre la presse et l'opinion publique, d'un côté, et le gouvernement, de l'autre. Celui-ci est conscient du risque d'une demande de transfert de la frontière à Douvres. Aussi le Royaume-Uni nous aide-t-il en matière financière et de sécurité avec la construction de barrières, de murs. Sur la question particulière des mineurs isolés, Theresa May et la nouvelle ministre de l'intérieur, Amber Rudd, ont fait une réponse ouverte. Bernard Cazeneuve doit se rendre prochainement à Londres pour recueillir les propositions d'un groupe de travail franco-britannique. Dans le même temps, compte tenu de l'importance du problème migratoire, les Britanniques ne veulent pas créer d'appel d'air et ont accueilli ces mineurs non accompagnés au compte-gouttes. En outre, il n'est pas question pour nos voisins d'une révision des accords du Touquet, même s'ils sont bien conscients que, du côté français, le sujet va compter à l'occasion des prochaines élections.
Vous m'avez par ailleurs demandé si le Royaume-Uni avait entériné le fait qu'il ne pourrait bénéficier de ce qu'avait négocié David Cameron tout en procédant au Brexit. En fait rien n'est décidé. Les Britanniques sont d'excellents négociateurs et vont tâcher d'obtenir le maximum.
Jacques Myard est revenu sur les fonds dédiés à la recherche. Les Brexiters ont promis que l'agriculture, la recherche, la santé, de même que les entités dévolues récupéreraient les fonds aujourd'hui consacrés au budget européen. Or il y aura des priorités. En fait, ce que craignent le plus les Britanniques n'est pas un manque à gagner mais la perte de la coopération scientifique…
Elle sera maintenue parce qu'elle fera partie de la négociation.

Les scientifiques continueront de coopérer. Ce qui me frappe, chez les scientifiques, c'est que, quel que soit le type de gouvernement, ils continuent de coopérer. Au moment du nazisme, Otto Hahn et Frédéric Joliot-Curie discutaient de leurs travaux en toute liberté. Il existe toujours une communauté internationale des scientifiques.
Les Britanniques vont mettre l'accent sur la coopération bilatérale et la poursuivre, mais ce qu'ils veulent, c'est l'accès aux réseaux, qui leur sera beaucoup plus difficile après le Brexit. Pour ce qui est du financement, ils envisagent non pas de contribuer directement au budget de l'Union européenne, ou en tout cas pas de manière visible, mais de payer au cas par cas. Autrement dit, s'ils veulent garder des avantages dans le domaine de la coopération universitaire, de la coopération scientifique, mais aussi les avantages liés au dispositif Erasmus, ils paieront, mais ils ne voudront pas donner l'impression qu'il s'agit, je le répète, d'argent versé au budget européen.
De même, ils seraient prêts à payer en matière de défense, que ce soit en nature ou en argent.
On m'a demandé de dessiner un portrait de Theresa May. Je l'ai beaucoup vue parce qu'elle rencontrait Bernard Cazeneuve tous les deux ou trois mois et ils s'entendaient d'ailleurs très bien. Elle est quelqu'un de très sérieux et, comme on dit au Royaume-Uni, control freak : elle ne laisse rien sans réponse. J'ai mentionné le cas de la centrale de Hinkley Point. Elle a posé de très nombreuses questions aux experts avant de prendre sa décision. À chaque fois que les experts lui apportaient des dossiers – de très nombreuses réunions ont été organisées au 10 Downing Street –, elle posait de nouvelles questions. C'est pourquoi l'élaboration d'une position sur le Brexit risque de prendre un peu de temps.
Il est intéressant de noter qu'elle a nommé Boris Johnson ministre des affaires étrangères. Beaucoup ont vu cette décision comme une mise en oeuvre du principe selon lequel « you break it, you own it » : vous l'avez cassé, eh bien, maintenant cela vous appartient et vous devez le réparer.
On m'a par ailleurs demandé ce qui allait peser dans les semaines et les mois à venir. Ce sera évidemment l'intérêt du pays. La Confederation of British Industry (CBI), équivalent chez nous du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), les hommes d'affaires, les financiers mettent tous en garde contre les conséquences du Brexit et, surtout, contre la fin du passeport européen et de l'accès au marché unique, ce qui pèsera d'autant plus que la situation économique connaîtra une dégradation. Il n'est pas impossible qu'à l'avenir ceux qui, dans l'Angleterre profonde, ont voté pour le Brexit constatent une aggravation de leur situation parce que ce seront les premiers à perdre leur emploi. Et quand on évoque la City comme une élite de banquiers et de gens qui s'enrichissent, c'est oublier les centaines de milliers d'emplois, près de deux millions au total, qui en dépendent dans l'ensemble du pays et à tous les niveaux.
Le nouveau chancelier de l'échiquier, Philip Hammond, ancien ministre des affaires étrangères, est un ancien eurosceptique devenu, pendant la campagne, partisan du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne après en avoir constaté les avantages en matière de politique étrangère (par exemple à l'égard de la Russie ou de l'Iran). Nous disposerons de premiers éléments sur la situation économique au moment de l'Autumn Statement, au mois de novembre. Quoi qu'il en soit, Philip Hammond comptera beaucoup dans la décision.

Vous nous avez livré un panorama réaliste de la situation politique au Royaume-Uni. Pour certains milieux économiques, l'incertitude peut jouer. Vous avez évoqué la City ; certains établissements financiers commencent déjà à regarder ailleurs. Avez-vous entendu parler de démarches visant à mettre les places financières européennes en concurrence ?
L'excédent commercial de la France vis-à-vis du Royaume-Uni est le plus important de ses excédents, puisqu'il est de 12,5 milliards d'euros ; il est même en augmentation par rapport à l'année précédente. Les Britanniques nous feront dès lors valoir que nous aurons toujours besoin de leur exporter notre vin, nos produits alimentaires, et aux Allemands qu'ils auront toujours besoin de leur vendre leurs voitures.
J'ai rencontré la semaine dernière le directeur de la City, où l'on est très inquiet du fait de la prévisible perte d'emplois car, si le Brexit a lieu, des délocalisations seront nécessaires, non pas pour les sièges mais pour les chambres de compensation, pour les régulateurs… Toutes les entreprises, toutes les associations économiques se sont par conséquent pourvues d'une « cellule Brexit » afin de savoir si ce dernier, à cause des délocalisations qu'il provoquera, va leur faire perdre 50 000 emplois ou davantage. Pour ce qui concerne la chambre de compensation, tout dépendra de la position de la Banque centrale européenne (BCE), car si la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a pris une décision en faveur des Britanniques, c'était avant le référendum. Francfort, Amsterdam, Luxembourg, Dublin, Paris font des démarches en direction de la City pour récupérer certains établissements ; Paris Europlace s'y prépare. Les Britanniques espèrent malgré tout ne pas tout perdre dans la négociation : Londres offre tout de même de nombreux avantages et la délocalisation prend beaucoup de temps – il a fallu trois ans pour délocaliser la banque de détail de HSBC à Birmingham.
La principale interrogation concernant Paris est la variabilité de la fiscalité et, surtout, la rigidité du marché du travail.
Non, personne, pour le moment, ne tient la corde, et tout dépendra des banques ; mais ce que craignent les responsables de la City, c'est que la place de New York récupère la plupart des services et des personnes plutôt que le continent européen. Encore une fois, rien n'est encore décidé, mais telle est la réaction des banques en général.

Nous avons bien compris ce qui s'était passé chez les travaillistes après leur congrès, avec la fin de l'articulation entre le parti, devenu mouvement de masse, le groupe parlementaire et le shadow cabinet, conduisant les conservateurs à considérer qu'ils occuperaient le pouvoir pour longtemps. Y a-t-il un débat sur le fait de savoir si, malgré tout, passez-moi l'expression, on peut « s'asseoir » sur le résultat du référendum ? J'ai constaté en France que le président Sarkozy avait déclaré que les Britanniques devaient à nouveau voter afin de rester au sein de l'Union européenne.
Ce n'est pas un élément de discussion, mais cette idée traverse l'esprit des 48 % qui ont voté en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, ce qui est le cas en particulier du monde des affaires. Néanmoins, y compris parmi les parlementaires les plus pro-européens, les Britanniques savent qu'ils ne peuvent pas remettre en cause la décision du peuple, même si elle a été fondée très largement sur de nombreux mensonges. On n'insiste ainsi pas trop sur une éventuelle saisine du Parlement sur l'application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne – d'autant qu'il s'agit a priori d'une prérogative « royale », donc d'une prérogative du Premier ministre. En revanche, les parlementaires souhaitent absolument se prononcer au moment où l'accord sera conclu. Et là, ce que certains espèrent – j'emploierai l'expression wishful thinking, plus forte que celle de « voeu pieux » –, c'est que, comme l'accord pourrait être moins bon que la situation actuelle, le Parlement demande un nouveau référendum avec plusieurs options, dont celle du maintien au sein de l'Union européenne. Au reste, le référendum est consultatif et il est très étonnant que, dans un pays qui est un modèle de démocratie représentative et dans lequel Westminster doit avoir le dernier mot sur tous les sujets, celui du Brexit lui ait très largement échappé.
Aussi, pour l'heure, on s'en tient au mot de Theresa May : « Brexit means Brexit », ce qui donne lieu à de nombreuses plaisanteries. David Cameron avait parlé de saut dans l'inconnu, nous y sommes : une telle négociation n'a pas de précédent. Ce qui est arrivé était absolument inattendu. Rien n'est donc exclu et je ne pense pas qu'il faille parier sur l'hypothèse que j'ai évoquée : je suis frappée par le fait que nombre de mes collègues me font part de ce que dans leur capitale on considère – en général des intellectuels, des hommes politiques et des hommes d'affaires – que les Britanniques vont de toute façon trouver un moyen de rester au sein de l'Union européenne et qu'il n'y aura donc pas de vraies négociations. C'est là ne considérer que les 48 % qui souhaitaient le maintien de leur pays au sein de l'Union européenne.

Au cours du G7 parlementaire, j'ai discuté avec mon homologue britannique qui était favorable au maintien. Selon lui, la remise en cause des résultats du référendum provoquerait un mouvement de révolte, même de la part d'une partie de ceux qui ont voté contre le Brexit, attachés au respect de la décision du peuple.
On voit bien que les travaillistes veulent éviter ce débat, y compris au Parlement. Du coup, quel est le rapport de force au sein du groupe des députés conservateurs et quelle est la tonalité des échanges ?
Vous avez raison : il n'est absolument pas question, aujourd'hui, de revenir sur le référendum. Le peuple a voté et, donc, le gouvernement appliquera l'article 50 du traité sur l'Union européenne et lancera les négociations prévues. Néanmoins, dans deux ans, l'accord sera bien soumis au Parlement et nous ne savons pas, alors, ce qui se passera. Reste, je le répète, que, pour l'heure, même pour les plus pro-européens, il ne saurait être question de revenir sur le résultat de juin.

Il me semble que notre intérêt à nous est de solder au plus vite cette affaire et de tâcher de maintenir la cohésion des Vingt-Sept, notamment, vous l'avez très justement souligné, madame l'ambassadeur, en restant d'accord avec les Allemands, ce qui ne sera pas facile. Nous devons nous montrer fermes car nous ne pouvons pas nous laisser ballotter par l'indécision.
Et procéder de la sorte est peut-être le moyen de signifier aux pro-européens avec lesquels nous avons des affinités et qui aimeraient que nous tergiversions et laissions une porte ouverte, qu'ils ont sans doute intérêt eux aussi à montrer ce que représente la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni.
J'essaie de réfléchir à la manière d'affiner mais aussi de renforcer, avec nos partenaires, nos positions de négociations. Or, si nous nous montrons fermes dans la négociation, nous serons, avec les opposants britanniques au Brexit, donc pro-Européens, en position de force pour proposer éventuellement au Royaume-Uni de revenir. Il ne faut en effet pas exclure, à terme, qu'après avoir vécu l'expérience de notre fermeté, ils reviennent.
C'est également une question de temps. Les mois, les années vont passer et les Britanniques vont essayer, malgré tout, de négocier le mieux possible pour leur pays. Ils espèrent savoir quelles seront, au bout de deux ans, les relations avec l'Union européenne. Tout ne sera pas clair à ce moment-là et pour éviter un divorce brutal et ils vont sans doute essayer d'obtenir un accord intérimaire qu'ils peuvent « prendre sur étagère », qu'il s'agisse de l'AELE ou autre.

Nous entrons là dans un autre monde. Nous avons déjà pu constater le regard acéré qu'ils ont pu porter sur le groupe de Visegrád.

Le Parlement de Westminster a-t-il déjà rejeté un accord international présenté par un gouvernement ?
Je ne pense pas, cela reste à vérifier. Toutefois, l'idée n'est pas que le Parlement rejette l'accord, mais qu'il le soumette au peuple.
Encore une fois, nous sommes en terre inconnue et l'on spécule beaucoup.

Je suis persuadé, comme Elisabeth Guigou – qui va néanmoins bondir en entendant la suite de mes propos –, que nous pourrions garder les British, mais seulement si c'est l'Union européenne qui évolue. Je l'ai déjà dit maintes fois : je pense que l'Union européenne va s'affranchir d'un logiciel intégriste et fédéraliste pour aller vers beaucoup plus de coopération interétatique. Telle est à mes yeux la solution, même si je sais bien que vous n'êtes pas d'accord.
C'est en tout cas ce qu'espèrent les Britanniques pro-européens…
Beaucoup nous disent que nous allons évoluer sur la libre circulation. Je réponds souvent que le paradoxe est que nous aurons une Europe qui ressemblera bien plus à ce que souhaitait le Royaume-Uni avant de la quitter,…
…à savoir une Europe plus intergouvernementale,…
…plus flexible, oui, organisant des coopérations par cercles.

C'est une autre histoire. Nous vous remercions, madame l'ambassadeur, de cet éclairage. Nous aurons donc l'occasion de vous revoir à Londres, où nous rencontrerons un certain nombre de responsables britanniques.
L'audition se termine à onze heures quinze.
La commission procède à l'audition de M. Jean-Claude Piris, consultant en droit européen et en droit international public, ancien directeur général du service juridique du Conseil de l'Union européenne.

Monsieur Piris, vous avez été directeur général du service juridique du Conseil de l'Union européenne et jurisconsulte du Conseil européen de 1988 à 2010. La semaine dernière, nous avons auditionné le Gouvernement, avec qui nous avons évoqué le fameux article 50 du traité sur l'Union européenne. Nous souhaiterions approfondir ces aspects juridiques avec vous. Vous avez également été jurisconsulte des conférences intergouvernementales qui ont négocié les traités de Maastricht, d'Amsterdam, de Nice et de Lisbonne. Votre connaissance des traités, mais aussi des négociations européennes, nous apportera un éclairage précieux. Nous nous posons un certain nombre de questions sur l'articulation entre la négociation de l'accord de retrait et celle d'un nouveau statut, sur le contenu et le statut de l'accord de retrait, sur le déroulement des négociations et sur la révision des traités.
Vous avez écrit un certain nombre d'articles sur ce que pourrait être la suite de la construction européenne. Dans un de ces articles, vous avez d'ailleurs longuement décrit ce qu'elle ne pourra pas être, avant d'essayer de déterminer ce qu'elle pourrait être. Cet éclairage peut aussi nous aider à envisager ce que pourrait être la stratégie du Royaume-Uni non pas à court terme, mais à moyen ou long terme.
C'est un honneur de m'exprimer devant vous. Le Brexit est un dossier extrêmement complexe dont nous pourrions parler pendant des heures. En tant que juriste, je me concentrerai sur les questions juridiques et institutionnelles.
Le texte de l'article 50 du traité de l'Union européenne a été rédigé par la Convention européenne qui a négocié le traité constitutionnel – ont participé des hommes politiques tels que M. Valéry Giscard d'Estaing, M. Alain Lamassoure, M. Giuliano Amato ou M. Elmar Brok –, puis repris tel quel dans le traité de Lisbonne. Il a fait l'objet d'une discussion en profondeur. Il y avait alors des disputes entre juristes : certains prétendaient que, dans la mesure où la durée de validité des traités était illimitée, un pays ne pourrait pas sortir de l'Union ; pour ma part, j'estimais que, si un pays voulait sortir de l'Union, personne ne pourrait l'en empêcher. Mais un tel retrait serait source de nombreuses incertitudes et ne manquerait pas de provoquer un certain chaos juridique – on constate déjà un certain chaos politique au Royaume-Uni. D'où l'intérêt de cet article, qui trace les grandes lignes de ce que l'on doit faire et de ce qu'il est possible de faire, afin d'éviter une multitude de questions et de procès.
Les choses vont se passer de la façon suivante. D'abord, nous attendons que le Royaume-Uni « appuie sur le bouton » en déclenchant la procédure de l'article 50. Il s'agit d'une décision unilatérale. En l'absence de constitution écrite, une cour de justice britannique vient de préciser que cette prérogative appartient au gouvernement ; il n'est donc pas nécessaire de passer devant le Parlement.
L'accord prévu par l'article 50 vise à régler les conditions de la sortie, non les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'article 50 précise néanmoins que l'Union négocie et conclut cet accord avec l'État concerné « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union », membre de phrase dont la signification n'est pas claire. Quoi qu'il en soit, les deux parties semblent d'accord sur le fait qu'il y aura, d'une part, l'accord fondé sur l'article 50 traitant de la sortie ou, si l'on veut, du divorce et, d'autre part, un ou d'autres accords traitant des relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union. Le gouvernement britannique l'a admis avant même la tenue du référendum, ainsi que cela ressort de documents qu'il a publiés. À mon avis, le membre de phrase que j'ai cité pourrait permettre, si l'Union européenne le veut bien – elle n'y est pas contrainte –, que l'accord fondé sur l'article 50 prévoie des mesures transitoires, à condition que l'on sache exactement où l'on va, c'est-à-dire comment se dessine ledit cadre futur. Or, pour l'instant, le gouvernement britannique est, vous le savez, tout à fait divisé sur cette question : nous n'avons pas encore la moindre idée de la direction que l'on va prendre.
Une fois la procédure déclenchée par le Royaume-Uni s'ouvrira un délai de deux ans maximum – qui pourra être prolongé à l'unanimité par les Vingt-sept en accord avec le Royaume-Uni, si besoin est – pendant lesquels sera négocié l'accord de divorce. Si jamais on ne parvient pas à un accord au cours de ces deux ans, le Royaume-Uni quittera l'Union de manière automatique. Les deux parties ont néanmoins intérêt à trouver un accord pour éviter un chaos juridique.
Quel sera le contenu de cet accord de divorce ? À mon avis, il traitera, entre autres : de toutes les procédures en cours, par exemple en matière de concurrence ou d'aides d'État ; de questions budgétaires telles que les subventions agricoles et les fonds structurels ; des programmes et des projets de recherche, en substance et du point de vue budgétaire ; des divers traités, accords et contrats qui engagent les États ou les entreprises ; du sort des quelques millions de citoyens européens qui résident au Royaume-Uni et, inversement, des citoyens britanniques qui vivent dans l'Union à vingt-sept ; de celui des fonctionnaires de nationalité britannique qui travaillent au sein des institutions de l'Union.
En revanche, il ne devrait pas comporter de dispositions relatives aux relations commerciales. À cela, il y a une bonne raison non seulement politique, mais aussi juridique : l'Union européenne est soumise au principe d'attribution des compétences : l'Union ne dispose pas d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par les traités, et selon les procédures fixées par les articles de ces traités – ce qu'on appelle les « bases juridiques » dans le jargon de l'Union européenne.
L'accord de retrait sera négocié et conclu, selon les procédures fixées par l'article 50. Selon l'article 218, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, auquel fait référence l'article 50, ces procédures sont les suivantes : la Commission européenne négocie, le Conseil statue à la majorité qualifiée – 72 % des membres du Conseil, soit vingt États membres sur vingt-sept et 65 % de la population – et le Parlement européen a un droit de veto à la majorité simple. En tout cas, l'accord sera conclu par l'Union européenne seule : à la différence du ou des accords futurs, sur lesquels je vais revenir, il n'est pas prévu qu'il soit conclu par les États membres. Donc, en France, le Parlement sera saisi par le Gouvernement selon les voies consultatives normales.
Ainsi que je viens de l'indiquer, le négociateur sera la Commission, mais, en réalité, tout commencera par des « orientations » adoptées par le Conseil européen, par consensus, conformément à l'article 15, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. N'importe lequel des Vingt-sept pourra donc s'opposer à ces directives. D'après ce que j'entends à Bruxelles, le Conseil européen a bien l'intention de garder cette affaire en main, compte tenu de sa nature très politique. Il faut donc s'attendre à ce qu'il continue à jouer un rôle par la suite. Mais ce sont bien évidemment la Commission, son négociateur M. Michel Barnier et ses services techniques qui seront en première ligne. Les questions que j'ai citées tout à l'heure sont pour certaines très techniques, notamment les questions budgétaires.
Pour ce qui est du ou des accords futurs, des procédures différentes s'appliqueront : celles qui sont prévues par les articles 216 à 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Il sera possible de diviser le travail en plusieurs accords, notamment en concluant séparément un accord commercial et un accord d'association sur les autres aspects. Rappelons que certains accords de commerce sont adoptés à la majorité qualifiée et d'autres à l'unanimité. En l'espèce, je pense qu'il s'agira d'un accord adopté à l'unanimité. Quant à l'accord d'association, il s'agira probablement d'un accord mixte engageant à la fois l'Union européenne – dans la mesure où il concernera ses compétences telles qu'elles sont décrites dans les traités – et les États membres. Il faudra donc que les Vingt-sept le ratifient, soit par la voie référendaire, soit par la voie des parlements nationaux – sachant que, en Belgique, compte tenu du partage des compétences entre l'État fédéral, les trois communautés et les trois régions, sept parlements devront probablement se prononcer.
En tout cas, le commerce sera le sujet central du ou des traités, car c'est un domaine d'intérêt majeur pour le Royaume-Uni. Certains ministres britanniques chantent que le Royaume-Uni va conclure des accords avec l'Inde, le Canada ou la Chine, et que tout ira très bien, mais l'Union européenne occupe une place beaucoup plus importante que celle des autres pays en matière de relations commerciales du Royaume Uni. D'après les données de la Chambre des Communes, en 2014, l'Union européenne à vingt-sept représentait 44 % des exportations de biens et services du Royaume-Uni et 53 % de ses importations. Ces chiffres étaient respectivement : 3,7 et 6,9 % pour la Chine ; 1,7 et 1,9 % pour l'Inde ; 1,2 et 1,6 % pour le Canada ; 1,7 et 0,8 % pour l'Australie.
On mesure donc l'urgence et l'importance extrêmes de s'entendre avec l'Union européenne pour le Royaume-Uni, qui fait actuellement partie du marché intérieur, où il n'y a ni droits de douane, ni règles d'origine, ni paperasserie – il s'agit presque du marché intérieur d'un État, même s'il n'est pas entièrement réalisé dans le domaine des services. Il aura donc intérêt à se tourner vers l'Union européenne. Les Britanniques sont d'ailleurs en fâcheuse posture, car ils sont demandeurs : leur pays compte beaucoup moins pour l'Union européenne que celle-ci ne compte pour lui, l'Union exportant vers lui moins de 10 % de ses biens et services. Pour l'Union, ce n'est pas vital, même s'il faudrait nuancer selon les secteurs.
Prenons l'exemple du secteur automobile. Depuis une quinzaine d'années, le Royaume-Uni a réussi à rebâtir, en faisant appel à des capitaux étrangers, une industrie fabriquant des pièces détachées et des moteurs, qui exporte et fournit des emplois. Or les droits de douane pratiqués par l'Union européenne sont de 10 % sur les voitures et les parties de voiture – contre 3 à 4 % en moyenne. S'ils étaient appliqués au Royaume-Uni, cela changerait tout, le marché automobile étant extrêmement compétitif. Notons que cela affecterait aussi des fabricants tels que Mercedes et BMW, qui vendent beaucoup au Royaume-Uni.
S'il y a des années d'intervalle – gap years – entre l'accord de retrait et l'accord sur le commerce, le Royaume-Uni « tombera » dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui n'est pas bon du tout pour lui : il sera alors obligé de négocier avec les 164 membres de l'OMC, devra établir sa propre liste d'engagements et sera tenu par la clause de la nation la plus favorisée. Ainsi, s'il souhaite appliquer un tarif douanier nul aux pays de l'Union européenne, il sera obligé d'en faire bénéficier tous les autres pays. Les règles de l'OMC prévoient des exceptions à cette clause, notamment les zones de libre-échange et les unions douanières, mais le Royaume-Uni n'aura pas eu le temps d'en mettre en place. Les Britanniques ont donc tout intérêt à négocier avec les Vingt-sept quelque chose qui se tienne. Cependant, ils sont divisés et ne se sont pas encore fait leur religion : ils ne savent pas encore s'ils vont quitter l'union douanière, ni s'ils vont demander ou non à participer au marché intérieur.
En termes de choix politiques, les Britanniques font la distinction entre le hard et le soft Brexit. Ce dernier consisterait à garder le maximum de liens possible avec l'Union européenne en matière économique et commerciale, afin de limiter les conséquences du Brexit pour les entreprises exportatrices, en particulier pour celles qui vendent des services financiers. Les services, en particulier les services financiers, représentent désormais près des trois quarts de l'économie britannique. Il y a au Royaume-Uni environ 5 500 entreprises financières, qui ont besoin du passeport bancaire de l'Union européenne.
Pour ma part, je pense que l'on se dirige plutôt, en ce moment – cela peut changer –, vers un hard Brexit. Première raison à cela : on estime, dans les milieux politiques britanniques, que c'est principalement la question de l'immigration qui a déterminé le vote au référendum – lequel a été une surprise pour beaucoup, y compris pour ceux qui ont fait campagne en faveur du Brexit. Au Royaume-Uni, on fait depuis des années un mélange savant entre l'immigration issue de l'Union européenne et celle qui vient des pays tiers, en rendant l'Union européenne responsable des deux. Pourtant, l'Union n'a pas encore de politique commune concernant l'immigration en provenance des pays tiers, et le Royaume-Uni pourrait donc être beaucoup plus dur en la matière, en pratiquant davantage de contrôles ou en prévoyant des règles plus strictes pour la délivrance des cartes de séjour. Quoi qu'il en soit, l'opinion publique voit les choses ainsi que je les ai décrites, et c'est donc un problème politique de premier ordre pour les responsables britanniques.
Deuxième raison : ce que l'on ne veut plus admettre au Royaume-Uni, ce sont les jugements de la Cour de justice de l'Union européenne et les lois de l'Union sur le marché intérieur qui ont la primauté sur le droit national.
Si le Royaume-Uni s'engage dans la voie du hard Brexit, il va nécessairement y perdre. Lors des négociations, la position de départ des Britanniques sera probablement de dire qu'ils veulent le maximum du marché intérieur – en tout cas le passeport bancaire pour les services financiers – tout en demandant un certain nombre de dérogations à la libre circulation des personnes. Or, du point de vue des Vingt-sept, il ne fait guère de doute que les quatre libertés du marché intérieur – libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes – sont indivisibles et qu'il faut les appliquer toutes les quatre, même si la libre circulation des services n'est pas encore complète. Cette position des Vingt-sept est relayée de la même manière au sein de la Commission et du Parlement européen.
À mon avis, il est peu probable que l'on ait un accord commercial séparé qui serait conclu par l'Union européenne seule, sans ratification des Vingt-sept. Rappelons que la Commission comptait faire adopter l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada – qui a été négocié pendant neuf ans et finalement signé – à la majorité qualifiée, sans ratification par les États membres. Finalement, elle a décidé qu'il s'agissait d'un accord mixte et que les parlements nationaux devraient le ratifier. J'imagine que l'accord avec le Royaume-Uni sera lui aussi un accord mixte.
Oui, car c'est un tout qu'il n'est pas possible de diviser, même si certains y ont parfois pensé.
Il est probable que l'accord mixte avec le Royaume-Uni autorisera en outre ce pays à participer à un certain nombre de programmes, actions, politiques et agences de l'Union européenne. S'agissant des politiques, on peut penser notamment à la lutte contre le changement climatique et à la lutte contre le terrorisme, avec une participation à Europol. En ce qui concerne les actions, on peut penser aux sanctions politiques, tant contre des individus, notamment des terroristes, que contre des pays tiers tels que la Russie, ou encore aux opérations civiles ou militaires menées par l'Union dans différents pays. Pour ce qui est des programmes, on peut penser aux programmes de recherche scientifique ou d'échanges d'étudiants, notamment à Erasmus. Quant aux agences européennes, qui sont à peu près comparables aux agences fédérales américaines, il y en a désormais une trentaine, dont deux ont d'ailleurs leur siège à Londres et devront déménager – l'Agence européenne du médicament et l'Autorité bancaire européenne. Sur le fond, le Royaume-Uni pourrait être intéressé à participer à certaines de ces agences. L'Union européenne a, elle aussi, intérêt à ce que le Royaume-Uni participe à certaines de ces politiques, actions, programmes et agences, notamment à la lutte contre le terrorisme. En tout état de cause, cette participation, qui sera assortie le cas échéant d'une contribution au budget correspondant, se fera sans participation à la prise de décision, comme c'est le cas actuellement pour certains pays tiers, par exemple la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.
J'entends dire que le Royaume-Uni devrait continuer à participer aux politiques étrangère et de défense. Toutefois, cela soulèverait des difficultés, car ces politiques sont discutées d'abord au Comité politique et de sécurité (COPS) – qui comprend des représentants permanents des États membres et se réunit souvent trois fois par semaine –, puis au Conseil des affaires étrangères et lors des réunions des ministres de la défense et, enfin, très souvent, au Conseil européen. Or les Britanniques ne seront représentés dans aucune de ces institutions.
Le choix entre hard et soft Brexit relève, bien entendu, des Britanniques. Pour ce qui est de l'Union européenne, le chancelier de l'Échiquier, M. Philip Hammond, a déclaré qu'elle devait faire preuve de « morale » et être « gentille » avec le Royaume-Uni, mais telle n'est pas la question. D'abord, les relations entre États ne sont pas les relations entre individus : ce sont davantage les intérêts que les sentiments qui jouent. Surtout, il y a une logique du marché intérieur : un même acte est pris par les institutions européennes – proposé par la Commission, puis adopté par le Conseil et par le Parlement européen –, est appliqué par tous les États membres et fait l'objet d'une même interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne ; il y a un mécanisme de surveillance et des sanctions financières éventuelles. Or on voit mal comment les Britanniques, qui ne seront membres d'aucune des institutions que je viens de citer, pourraient adhérer à cette logique, à moins qu'ils n'acceptent le modèle de l'Espace économique européen (EEE) tel qu'il a été offert il y a vingt-quatre ans.
À cet égard, je fais une parenthèse : si l'on devait renégocier aujourd'hui l'accord sur l'EEE, je suis certain qu'il serait beaucoup moins généreux. En effet, dans le cadre des négociations en cours avec la Suisse, Monaco, Andorre et Saint-Marin, l'Union européenne est beaucoup plus exigeante qu'elle ne l'a été lors des discussions sur l'EEE. J'en veux pour preuve les directives de négociation avec la Suisse, adoptées par le Conseil en mai 2014 sur proposition de la Commission, qui sont théoriquement secrètes, mais qui ont fuité dans la presse helvétique. Dans le cadre de l'EEE, lorsque la Norvège, l'Islande ou le Liechtenstein tardent à appliquer les lois de l'Union sur le marché intérieur – il y a eu des retards sur des centaines de textes, y compris sur des textes importants, jusqu'à cinq ou six ans –, il n'y a pas véritablement de sanctions, les compétences en la matière étant exercées par une autorité de surveillance et une cour de justice propres à l'EEE, qui comprennent des membres norvégiens, islandais et liechtensteinois. En revanche, dans les directives de négociations avec la Suisse – certes, ces négociations ne sont pas finies –, l'Union européenne demande que les sanctions soient automatiques et que la Commission et la Cour de justice de l'Union, avec leurs vingt-sept ou vingt-huit membres, soient seules compétentes.

Vos propos montrent que, du point de vue juridique, les Vingt-sept ont toutes les raisons d'être fermes, du fait notamment de l'unicité du marché intérieur et de la dépendance commerciale du Royaume-Uni à l'égard de l'Union européenne. Du point de vue politique, c'est une autre histoire car, même si la France, je l'espère et je le pense, persistera dans cette attitude, encore faut-il que les Vingt-sept maintiennent leur cohésion.
Au Royaume-Uni, on fait en effet un amalgame en ce qui concerne l'immigration. De plus, l'opinion s'insurge non pas contre l'immigration venant du Commonwealth, mais principalement contre l'immigration interne à l'Union européenne. C'est d'ailleurs une raison supplémentaire pour nous de tenir bon sur l'unicité du marché intérieur. Pour l'instant, je ne vois pas les pays du groupe de Visegrád céder sur ce point. En la matière, la Pologne est franchement notre alliée, ainsi que j'ai pu le constater hier à Berlin lors d'une rencontre avec mes homologues allemand et polonais.
Je reviens sur la procédure prévue par l'article 50. Vous avez indiqué que le Conseil européen allait adopter des directives par consensus. Sur la base de quel article du traité ?
De l'article 15, paragraphe 4 : « Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. » Or l'article 50 ne prévoit pas de disposition particulière.

Mais qui a dit que le Conseil européen devait obligatoirement donner des directives de négociation ?
En vertu de l'article 50, paragraphe 2, l'Union négocie « à la lumière des orientations du Conseil européen ». Celles-ci sont d'ailleurs en cours de préparation.

Le Conseil doit adopter l'accord à la majorité qualifiée, qui est une double majorité, à la fois d'États membres et en termes de population. Pouvez-vous préciser de quelle majorité qualifiée il s'agit ?
À l'article 50, paragraphe 4, alinéa 2, il est écrit explicitement : « La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
Or celui-ci précise : « Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. »
D'après mes calculs, 72 % des membres, cela fait vingt États membres, et 65 % de la population, cela fait environ 330 millions d'habitants – sachant que l'on ne compte pas le Royaume-Uni.

Que se passera-t-il si les Britanniques déclenchent tardivement la procédure de l'article 50 et que l'échéance des deux ans arrive après la date des prochaines élections européennes ?
Ce serait très fâcheux. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de personnes essaient de pousser les Britanniques à déclencher la procédure. Mais nous n'avons aucun pouvoir : c'est une décision absolument unilatérale, qu'ils peuvent prendre à la date qu'ils souhaitent.
À ce stade, Mme Theresa May a indiqué en privé au président du Conseil européen, M. Donald Tusk, et aux dirigeants du pays de Galles, qu'elle le ferait en janvier ou février 2017. Si tel est le cas, l'échéance arrivera avant mai 2019, date des prochaines élections européennes. En revanche, si, ainsi que certains le prétendent à Londres, le Royaume-Uni attend la tenue des élections en France et en Allemagne, cela nous amènera à septembre 2017. À ce moment-là, les Britanniques participeront aux élections européennes, sachant que le président de la Commission est désormais choisi en tenant compte des résultats à ces élections.

Juridiquement, nous n'avons pas de moyens de pression pour que le Royaume-Uni déclenche la procédure de l'article 50. En revanche, politiquement, nous pourrions en avoir, à condition que les Vingt-sept en soient d'accord, car on ne peut pas dissocier complètement l'article 50 du futur statut.
Absolument.

En octobre 2015, vous avez écrit une note sur le Brexit, à certains égards, prémonitoire, pour la fondation Robert Schuman. Vous aviez une interprétation tout à fait intéressante : vous souteniez que l'article 50, paragraphe 2, décrivait une procédure facultative.
On m'a reproché plusieurs fois cette phrase, qui était une maladresse d'écriture. La procédure de l'article 50 est obligatoire tant en droit international qu'en droit européen. Ce que je voulais dire par là, c'est que le Royaume-Uni n'est pas tenu de conclure un accord de retrait : c'est une option. Si le Royaume-Uni ne veut pas négocier d'accord et qu'il laisse s'écouler le délai de deux ans, il sortira automatiquement de l'Union européenne à l'issue de ce délai.

Lorsque le Royaume-Uni a souhaité adhérer à la Communauté économique européenne, le président Pompidou a organisé un référendum en France – auquel j'ai voté non. A contrario, vous avez indiqué que, en tout état de cause, les parlements nationaux n'auraient pas à se prononcer sur l'accord de retrait. Or cet accord va modifier notamment les clés budgétaires de l'Union européenne et, partant, l'économie générale du traité de Lisbonne, lequel a bien été ratifié par les États membres – là encore, j'ai voté non. Je ne vois donc pas pourquoi le Parlement ne serait pas consulté sur l'accord de retrait. Rappelons que l'Union européenne est une organisation internationale et qu'elle n'a pas « la compétence de sa compétence ». Je suis intimement convaincu que la compétence du Parlement français doit être sauvegardée. Je ne vois pas pourquoi cela resterait une affaire uniquement bruxelloise et que seul le Parlement européen serait consulté.
Par ailleurs, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, mais pas de l'Europe. Malgré les chiffres que vous avez cités, notre intérêt est de ne pas couper complètement le cordon ombilical avec le Royaume-Uni en matière commerciale, sous réserve du respect d'un certain nombre de principes, dont les quatre libertés. Ainsi que cela a été souligné à plusieurs reprises, notamment par notre ambassadeur à Londres, la France a un excédent commercial de 12 milliards d'euros avec le Royaume-Uni. Quel est votre sentiment à cet égard ?
L'Union européenne est une communauté de droit : nous sommes tenus par les traités. L'accord prévu par l'article 50 ne va aucunement modifier les traités. Il est d'ailleurs impossible de modifier les traités sur la base de l'article 50. Quant aux clés budgétaires, elles ne figurent pas dans le traité : c'est de la législation secondaire, négociée et prise par les institutions.
Il est exact que le traité devra être modifié, mais d'une manière extrêmement légère. Tel est le cas de l'article 52 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que les traités s'appliquent au Royaume-Uni. Mais, si on ne le fait pas à temps, ce ne sera pas bien grave, car le Royaume-Uni aura entre-temps abrogé l'European Communities Act de 1972 et n'appliquera plus le droit européen. Il faudra aussi modifier l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui cite un certain nombre de territoires d'outre-mer, ainsi que quelques protocoles. On le fera sur la base de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, comme il convient. On ne convoquera probablement pas de convention, et le processus sera très rapide, car cela consistera seulement à supprimer les quelques dispositions que j'ai citées.
Quant aux autres textes fixant la composition et le siège des différentes institutions ou organes – par exemple le protocole sur le statut de la Cour de justice, les statuts de la Banque centrale européenne (BCE) ou ceux de la Banque européenne d'investissement (BEI) –, ils sont modifiables, le plus souvent par une décision du Conseil à l'unanimité, sans qu'il soit besoin de toucher aux traités. On avait pris cette précaution.
Enfin, d'après une étude que j'ai lue, le Brexit ne devrait guère prêter à conséquence en ce qui concerne le budget de l'Union.
Je suis tout à fait d'accord avec votre second point, monsieur Myard : à l'évidence, le Royaume-Uni ne va changer ni sa position géographique, ni l'histoire, ni les relations économiques très étroites qu'il entretient avec les autres pays européens.
Je suis d'accord avec Mme Guigou sur le fait que nous devons être très fermes sur certains principes. À mon avis, on ne bougera pas d'un millimètre sur la libre circulation des personnes, car c'est une question non seulement économique, avec la libre circulation de la main-d'oeuvre, mais aussi politique. Il en va de la dignité des pays de l'est de l'Europe. Rappelons que 800 000 à 1 million de Polonais vivent au Royaume-Uni. D'ailleurs, c'est le Royaume-Uni lui-même qui a décidé d'ouvrir immédiatement son marché du travail aux ressortissants des États qui ont adhéré à l'Union en 2004, alors que la France et l'Allemagne ont appliqué, comme cela était possible, des restrictions à leur circulation pendant quelques années – sept ans, s'agissant de l'Allemagne. De même, le Royaume-Uni était le principal partisan de l'adhésion de la Turquie à l'Union, et cela a été utilisé ensuite comme un argument en faveur du leave.
Nous ne pouvons pas bouger de la logique du marché intérieur. Des personnes sans doute très bien intentionnées, en France et en Allemagne, ont proposé de créer deux cercles, en permettant aux États du deuxième cercle, à savoir le Royaume-Uni et, plus tard, des pays tels que l'Ukraine ou la Turquie, de participer à l'élaboration des décisions pour le marché intérieur de l'Union. Ces idées sont inapplicables en pratique et juridiquement, et elles sont inacceptables politiquement, d'ailleurs pour les deux Parties. Elles mettraient l'Union européenne en danger. Il faut faire très attention à ces idées et être extrêmement ferme sur ce point.
Cela dit, nous sommes naturellement ouverts à l'égard du Royaume-Uni. S'il demande à adhérer à l'EEE, je ne vois pas comment nous pourrions nous y opposer, même si le processus serait très long. D'une part, il faudrait que l'accord soit ratifié par l'Union européenne et par trente et un États, à savoir les vingt-sept États membres de l'Union, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse (pour l'AELE). D'autre part, ainsi que je l'ai indiqué, l'Union n'est guère satisfaite des règles de fonctionnement de l'EEE et a tendance à être désormais plus sévère. Mais si le Royaume-Uni accepte le système du marché intérieur, c'est encore mieux ! Les Vingt-sept étaient favorables à ce qu'il reste dans l'Union. Il va donc de soi que nous voulons garder des relations commerciales étroites avec lui. D'ailleurs, l'Allemagne exporte beaucoup, elle aussi, vers le Royaume-Uni.

Dans les conclusions du Conseil européen de février dernier, un certain nombre d'avantages ont été accordés au Royaume-Uni – la décision correspondante mentionne d'ailleurs non pas « le Royaume-Uni », mais « les États membres ». À cette occasion, certaines règles ont été écornées, notamment celle que fixe la fameuse directive sur la sécurité sociale. Cela prouve bien que, contrairement à ce que vous venez de dire, il y a parfois des assouplissements.
Il est vrai que l'accord du 18 février 2016 avait été jusqu'à l'extrême limite de ce qui pouvait être accordé au Royaume-Uni. Certains États membres avaient d'ailleurs avalé la chose avec beaucoup de difficultés.
En effet. Il avait bien été entendu qu'il en serait ainsi en cas de Brexit.

La Cour de justice de l'Union européenne devra-t-elle être consultée sur l'accord de retrait ?
En vertu de l'article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice peut être consultée soit par un État membre, soit par l'une des trois institutions, mais ce n'est pas obligatoire.

Compte tenu du calendrier juridique, à quels moments et à quel rythme les différents éléments que vous avez cités, par exemple le déménagement des agences, deviendront-ils visibles pour les citoyens ? Selon moi, rien ne serait pire que de ne pas donner de visibilité aux conséquences du Brexit, à la fois pour les citoyens britanniques et pour ceux des vingt-sept États membres.
Les opinions publiques sont également très sensibles à tout ce qui concerne les fonctionnaires européens et leur statut particulier. De nombreux mythes circulent à ce propos, et il pourrait y avoir un certain buzz sur ces questions. Qu'en est-il, concrètement, pour les fonctionnaires européens de nationalité britannique ? Les concours continuent-ils à leur être ouverts ? Qu'adviendra-t-il des fonctionnaires déjà en place ? Seront-ils intégrés dans l'administration britannique ? Ces questions sont à la fois politiques et juridiques.
Je termine par une question qui peut paraître anecdotique, mais qui est éminemment symbolique : qu'en sera-t-il de la langue anglaise au sein des institutions européennes ? Il me semble que seuls les Britanniques avaient insisté pour qu'elle soit langue officielle de l'Union européenne, les Irlandais ayant pour leur part défendu le gaélique.
Un certain nombre d'étapes donneront de la visibilité : d'abord, les orientations du Conseil européen, qui seront, à l'évidence, rendues publiques ; ensuite, la position du Royaume-Uni, qui devra être rendue publique elle aussi, car il faudra bien que les responsables britanniques disent à leur population dans quelle direction ils souhaitent aller.
Les fonctionnaires de l'Union européenne sont dans une situation non pas contractuelle, mais statutaire, à l'instar des fonctionnaires français – le système européen a été calqué sur le système français. Du fait de la diminution des salaires intervenue à l'occasion de la réforme des institutions, il est très difficile, depuis plusieurs années, de recruter des ressortissants de certains États membres, notamment des Britanniques et des Danois, pour certaines fonctions. J'avais moi-même des difficultés à recruter des juristes britanniques, car ils sont beaucoup mieux payés dans le privé que dans les institutions européennes. Dès lors, on compte seulement un millier de fonctionnaires britanniques au sein des institutions, alors que le Royaume-Uni aurait droit à davantage au regard des quotas par nationalité.
La question des fonctionnaires va faire partie des négociations avec le Royaume-Uni. Je ne conçois pas que l'on mette à la porte les fonctionnaires déjà en place. En revanche, ils savent que leur carrière sera bouchée : on ne pourra pas les nommer à des postes très importants ou sensibles. Je note que deux directeurs généraux britanniques, MM. Jonathan Faull et Robert Madelin, ont annoncé leur démission.
Selon moi, il y a une question beaucoup plus importante, qui touche non pas un millier, mais 4 à 5 millions de personnes : que va-t-il se passer pour les quelque 2 millions de citoyens des Vingt-sept qui travaillent au Royaume-Uni et, inversement, pour le nombre à peu près équivalent de Britanniques qui travaillent ou passent leur retraite dans les pays de l'Union ? Je suppose qu'il n'y aura pas beaucoup de changements pour ceux qui se trouveront dans l'une ou l'autre situation à une date à fixer lors de la signature de l'accord de retrait. En revanche, d'autres règles s'appliqueront probablement à l'avenir, sans doute beaucoup plus restrictives du côté britannique et, par conséquent, beaucoup plus restrictives également du côté de l'Union. Car c'est alors la réciprocité propre au droit international qui prévaudra.
Au sein de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de l'EEE, la seule langue officielle est l'anglais. Pourtant, l'anglais n'est la langue officielle d'aucun des quatre pays principalement concernés – la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse.
D'après les statistiques du Conseil, en 1988, date à laquelle j'ai commencé à travailler pour les Communautés européennes, 85 % des textes législatifs originaux étaient rédigés en français, contre 12 à 13 % en anglais et 2 à 3 % en allemand. Aujourd'hui, c'est sans doute la proportion inverse : environ 85 % des textes originaux sont rédigés en anglais. Je serais étonné que la pratique des institutions change fondamentalement : l'anglais est devenu la principale langue de travail au sein de l'Union. D'autre part, deux États membres – l'Irlande et Malte – ont deux langues officielles dont l'anglais.

Vous avez rédigé une autre note très intéressante après le référendum. Selon vous, la sortie du Royaume-Uni peut-elle être, comme la langue selon Ésope, « la meilleure et la pire des choses » ? Cette sortie peut-elle amener une nouvelle prise de conscience chez les Européens ?
Je l'espère vivement. Malheureusement, cela paraît très difficile pour le moment, car les crises graves qui ont touché l'Europe ont suscité de nombreuses divisions : la crise de l'euro a provoqué des divisions entre États créditeurs et États débiteurs, entre le nord et le sud ; la question de l'immigration a créé des divisions entre anciens et nouveaux États membres, entre l'ouest et l'est.
Il y a toujours une solidarité et un attachement à l'Union européenne, mais l'euroscepticisme monte dans tous les États membres, y compris en France. C'est à ce populisme qu'il faut s'attaquer. Il faut essayer de démontrer que l'Union européenne est utile, en pratique et à court terme, à la résolution des problèmes les plus graves auxquels les citoyens ont à faire face, en particulier du chômage. Le taux de chômage des jeunes en Grèce et en Espagne est scandaleux. C'est une génération perdue, et il n'est pas possible de continuer de la sorte. L'Union européenne doit agir dans ce domaine dans la mesure où elle le peut. Rappelons que la majorité des pouvoirs en la matière appartient non pas à l'Union, mais aux États membres. L'euro a eu des conséquences très positives, notamment des taux d'intérêt très faibles pour tous les pays, mais a, dans le même temps, éliminé les possibilités de dévaluation. Il faut faire face à ces problèmes, établir des règles, créer une véritable union bancaire et un véritable marché unique des capitaux. D'autre part, l'Union européenne doit agir en matière d'immigration, d'autant qu'elle a, selon moi, davantage de capacités d'action dans ce domaine que dans d'autres. Mais, encore une fois, ce sera difficile. La note que vous avez mentionnée, monsieur le président, et que j'ai intitulée « Comment rendre l'Europe à nouveau populaire ? », peut paraître un peu pessimiste.
Ainsi que je l'ai écrit dans cette note, attendons les élections en France et en Allemagne, pour voir si nous pouvons rebondir. Pour ma part, je garde espoir. Je pense que l'Union européenne constitue un progrès et une aventure extraordinaires. Il faut continuer ; il ne faut pas lâcher dans les moments difficiles tels que celui que nous traversons actuellement.
La séance est levée à douze heures dix.