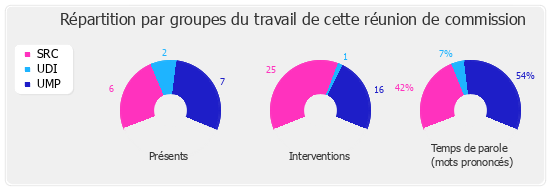Commission d'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État, entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, dans la gestion d'une affaire qui a conduit à la démission d'un membre du gouvernement
Réunion du 23 juillet 2013 à 17h00
La réunion

Mes chers collègues, notre Commission d'enquête a déjà reçu M. Jérôme Cahuzac le 26 juin dernier. Si nous avons immédiatement pu déplorer son refus de répondre à nombre de nos questions, nous avons constaté, en poursuivant nos travaux, que ce jour-là, bien qu'il ait prêté serment, M. Jérôme Cahuzac ne nous avait pas dit la vérité, comme il a déclaré ne pas l'avoir dite aux plus hautes autorités de l'État, au Parlement et à ses amis, à propos de ses avoirs non déclarés à l'étranger. Nous vous avons convoqué une deuxième fois, monsieur Cahuzac, pour que vous vous expliquiez et que vous nous apportiez quelques précisions complémentaires.
Avant d'aller plus loin, je précise que, si vous n'êtes pas juridiquement tenu de répondre aux questions empiétant sur l'information judiciaire en cours, rien ne vous interdit non plus de le faire, contrairement à ce que vous aviez laissé entendre le 26 juin. En particulier, comme notre collègue Philippe Houillon vous l'avait signalé, vous n'êtes aucunement tenu par le secret de l'instruction. En droit, si vous le souhaitez, vous pouvez parfaitement nous donner les éléments d'information que vous avez fournis aux juges d'instruction.
(M. Jérôme Cahuzac prête serment.)

Monsieur Cahuzac, je souhaiterais, au nom de la Commission d'enquête, vous demander des précisions sur vos déclarations lors de votre précédente audition, ainsi que sur des éléments nouveaux issus d'auditions ultérieures – ou d'autres sources.
Tout d'abord, vous nous avez déclaré avoir été informé de l'envoi d'une demande d'entraide administrative aux autorités suisses par vos avocats suisses. Le confirmez-vous ?
Je crois comprendre que je comparais à nouveau devant vous car il existerait deux versions divergentes.
La première est livrée par l'auteur d'un ouvrage récent, qui évoque, en citant une source anonyme, une réunion dans le bureau du Président de la République, sous la présidence de ce dernier, à laquelle auraient participé le Premier ministre, Pierre Moscovici et moi-même.
D'autre part, Pierre Moscovici vous a indiqué qu'à l'issue d'un Conseil des ministres, des mots ont été échangés – je crois que ce sont les termes qu'il a utilisés –, en sa présence et en la mienne, avec le Président de la République et le Premier ministre.
Je n'ai aucun souvenir d'une réunion dans le bureau du Président de la République – et ces réunions sont suffisamment rares pour que l'on s'en souvienne –, et je n'ai pas souvenir non plus de l'échange décrit par Pierre Moscovici à l'issue du Conseil des ministres.
Dès lors, y a-t-il divergence entre le ministre de l'économie et des finances et moi-même ? Peut-être pas, si l'on veut bien admettre qu'à l'issue d'un Conseil des ministres, les gens sortent par la même porte et se retrouvent dans le même lieu ; peut-être est-ce à ce moment et dans cet endroit que des instructions ont été données à Pierre Moscovici. Mais je n'en ai pas le souvenir.

L'auteure du livre précise que vous auriez demandé, à l'occasion de cette entrevue, que la demande d'entraide porte sur la période la plus large possible. Que répondez-vous ?
Dès lors que selon moi, cette réunion n'a pas eu lieu, je vois mal comment je pourrais donner crédit à tel ou tel propos tenu lors de cette supposée réunion !

La même journaliste indique que le Président de la République vous aurait demandé, le 5 décembre, à l'occasion d'une entrevue en présence du Premier ministre, de vous adresser directement à la banque UBS de Genève, afin que cette dernière confirme que vous n'y déteniez aucun compte. Est-ce exact ?
Il s'agit là d'un épisode antérieur de plus d'un mois à celui auquel vous venez de faire référence.
Lors de ma première audition, je vous ai indiqué qu'à l'issue du Conseil des ministres, et alors que nous étions toujours dans le salon Murat, le Président de la République et le Premier ministre étaient venus me demander ce qu'il en était des informations de Mediapart. Je ne crois pas que quiconque à cette occasion ait évoqué une éventuelle procédure pour faire litière des accusations lancées par Mediapart. S'il est vrai que, dans les jours qui ont suivi, j'ai, avec mes conseils, tenté d'obtenir de la banque citée ce que l'on appelle une « attestation négative », je ne me souviens pas que ce soient le Président de la République ou le Premier ministre qui me l'aient suggéré. Ils m'ont simplement posé une question, à laquelle j'ai répondu ; ils semblent m'avoir cru dans l'instant – ce dont je ne me réjouis pas, bien au contraire –, et l'entretien s'est arrêté là.

Est-il vrai que l'UBS ait indiqué, le 13 décembre 2012, qu'elle n'établissait pas de confirmation négative ?
Mes conseils ont posé successivement deux questions à la banque. La première consistait à lui demander, sans citer mon nom, si elle avait pour position de principe de ne jamais faire d'attestation négative – ce qu'elle lui a confirmé. En dépit de cette réponse, mon avocat suisse a demandé à la banque de produire une attestation négative sur la période correspondant à la durée légale de conservation des archives.
Une dizaine d'années, je crois. À demander plus, nous nous serions exposés à une réponse négative.

Pour approfondir ce point, je vous lis ce qu'écrit cette journaliste, qui a interviewé le Président de la République :
« À 10 heures du matin, mercredi 5 décembre 2012, le premier Conseil des ministres depuis l'article de Mediapart est l'occasion pour Cahuzac de s'assurer de la confiance du Gouvernement. À la sortie de la réunion, au rez-de-chaussée du palais de l'Élysée, François Hollande et Jean-Marc Ayrault convoquent quelques minutes le ministre délégué au budget. “Je vous assure que c'est faux” leur répète Cahuzac. Il est catégorique. “Il y a une seule méthode pour le prouver, c'est de faire la demande directement auprès de la banque pour qu'elle dise qu'aucun compte n'a jamais existé”, explique alors François Hollande. “Je vais le faire”, jure le ministre. »
Vous dites que cela ne s'est pas passé vraiment comme cela, mais que vous avez néanmoins saisi l'UBS, via vos avocats suisses, pour essayer d'obtenir une attestation négative ?
Un peu plus loin, la journaliste indique que, le 13 novembre, la banque UBS répond par la négative à vos avocats : elle ne délivre pas d'attestation. Est-ce ce que vous venez de confirmer ?
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question.
Je pense que vous vouliez dire « 13 décembre », et non « 13 novembre » ?

J'évoquais le premier Conseil des ministres après le déclenchement de l'affaire, le 5 décembre.
Vous souvenez-vous d'avoir passé quelques minutes en compagnie du Premier ministre et du Président de la République, à qui vous auriez juré que vous n'aviez pas de compte en Suisse ? D'après ce qui est rapporté dans ce livre – suite à une interview du Président de la République –, ce dernier vous aurait demandé d'engager une procédure auprès de votre banque. Ce que vous venez de dire tendrait à le confirmer. Ai-je raison ?
Je vais répéter ce que je viens de dire au rapporteur, puisque vous me posez la même question !
À l'issue du Conseil des ministres, alors que les collègues sont en train d'évacuer le salon Murat, le Président de la République et le Premier ministre viennent me voir – ils ne me « convoquent » pas. Je reste avec eux deux ou trois minutes, pas davantage. Ils me posent la question suivante – en substance : « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ». Je leur réponds que ce que prétend Mediapart est faux. Dans mon souvenir, cela s'arrête là ; je suis à peu près certain que ce n'est pas le Président de la République qui m'a demandé d'agir auprès de la banque UBS pour obtenir une attestation négative.
Ce sont mes avocats qui me l'ont conseillé, à moins que je ne le leur ai demandé, ou que nous ayons eu l'idée en même temps. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une initiative qui m'était propre, soit directement, soit indirectement. Dans mon souvenir, elle ne provenait pas des plus hautes autorités de l'État.
Je crois que c'était ainsi : « Pouvez-vous nous confirmer que M. Jérôme Cahuzac n'a pas détenu de compte dans votre établissement dans la période de conservation légale des archives ? ». Mais elle n'a pas eu de réponse.

Saviez-vous, à l'époque, qu'il fallait poser la question sous une forme positive – par exemple : « Pouvez-vous me confirmer que j'ai un compte chez vous ? » – pour obtenir une réponse ?
Il y a eu des débats juridiques tout au long de cette période ; pour ma part, ils ne m'ont pas convaincu que, même posée ainsi, la question pourrait obtenir une réponse ! En tout cas, ce débat est aujourd'hui un peu dépassé…

Vous nous avez indiqué, lors de la précédente audition, que vous n'aviez eu aucun rapport « institutionnel » avec Stéphane Fouks. Lors de son audition, celui-ci a reconnu avoir eu une conversation avec Mediapart au début de l'affaire, puis une autre avec une journaliste du Nouvel Observateur. Le confirmez-vous ?
J'ignorais l'existence de la conversation avec la journaliste du Nouvel Observateur, mais si Stéphane Fouks vous l'a dit, c'est sûrement vrai.
La conversation avec un journaliste de Mediapart date du lundi 3 décembre. Ce n'est donc pas « au début de l'affaire », puisque celle-ci n'avait pas encore éclaté : l'article ne sera publié que le lendemain.
Absolument.
Je dois dire que l'effet de surprise et la gravité des sujets évoqués m'ont amené à solliciter l'avis de personnes que je connaissais depuis longtemps, auxquelles j'étais lié d'amitié et en qui j'avais confiance. Stéphane Fouks en faisait partie ; je l'ai donc appelé pour lui demander quelle était la meilleure attitude à adopter.
J'étais à ce moment-là dans l'hémicycle, au banc du Gouvernement ; les conversations étaient forcément très brèves. Si j'ai bonne mémoire, Stéphane Fouks m'a proposé – à moins que je le lui aie demandé ? – d'appeler quelqu'un chez Mediapart pour savoir ce qu'il en était vraiment.
Tout cela se passait avant la publication de l'article. À compter de ce moment-là, je n'ai plus rien demandé à Stéphane Fouks – sauf si vous considérez qu'il était fautif de demander, à l'occasion, son avis à quelqu'un qui était mon ami depuis des dizaines d'années. Cet avis était toujours le même : « À partir du moment où ce n'est pas vrai, dis ta vérité et les choses se tasseront », me répétait-il. À lui, comme aux autres, je n'avais pas dit la vérité…

Vous avez été informé par vos conseils, non pas de la réponse précise de la Suisse, mais de son contenu. Nous assurez-vous que vos conseils n'ont pas eu de contact avec le Journal du Dimanche ?
Je suis incapable de vous répondre. En tout cas, je leur ai demandé de n'avoir aucun contact avec quiconque – mieux : une fois la réponse parvenue de Suisse, je leur ai clairement indiqué qu'il n'était pas de mon intérêt d'assurer la moindre publicité à celle-ci. J'ai du mal à imaginer que des avocats fassent le contraire de ce que leur client leur demande de faire !

Lors de son audition, M. Bruno Bézard nous a indiqué que vous aviez essayé, en vain, d'engager avec lui une discussion sur le contenu de la demande d'entraide à la Suisse ; vous avez vous-même reconnu lui avoir dit « quelques mots ». Vous souvenez-vous quoi ?
Restituer les mots précis serait solliciter mes souvenirs exagérément, mais si je me replace dans le contexte psychologique et politique de l'époque, j'ai dû lui demander s'il était envisageable que je lise le document qui serait envoyé aux autorités helvétiques. Il m'a répondu très nettement que cela ne lui paraissait pas possible ; je lui ai instantanément donné raison, et nous n'en avons plus parlé. L'échange a dû durer moins d'une minute.
Je pense que des contacts préalables avaient dû être pris, aux termes desquels mes conseils avaient dû être informés en Suisse qu'une procédure d'entraide serait menée.
Comme je vous l'ai dit lors de ma précédente audition – et je ne vous ai pas menti, monsieur le président ! –, c'est par mes conseils que j'ai su qu'une procédure de cette nature allait être engagée. Une fois celle-ci lancée, il est possible qu'à l'occasion de discussions, notamment avec Pierre Moscovici, cette question ait été évoquée ; cela ne me paraît pas absurde. Mais la procédure était lancée, et la demande partie.
Je ne me souviens pas de vous avoir donné la date de ma conversation avec M. Bézard. Mais peut être vous l'a-t-il précisée.

Cela sera facile à vérifier.
Est-il exact que vous ayez informé M. Fouks du contenu de la réponse des autorités fiscales helvétiques ?
Non, je ne lui ai pas parlé de cela.
Mes conseils m'ont informé de la nature de la réponse. En France, je crois que Pierre Moscovici a été informé de la réponse par Bruno Bézard lui-même. Quant à moi, je me suis efforcé d'être le plus discret possible, car je ne jugeais pas à l'époque de mon intérêt que cette nouvelle fût connue.
En même temps, il est possible qu'en apprenant le sens de cette réponse, j'aie manifesté une forme de soulagement, qui s'est peut-être vue.

Une dernière question – à laquelle, je crois, un grand nombre de membres de cette commission s'associeront.
Au terme de nos auditions, force est de reconnaître que le climat à Villeneuve-sur-Lot était « particulier ». Tout est parti d'un enregistrement accidentel que M. Gonelle a récupéré. Aujourd'hui, avec le recul, et après avoir suivi nos auditions, avez-vous une conviction sur l'identité de celui ou de celle qui aurait pu transmettre cet enregistrement à Mediapart ?
« Is fecit cui prodest » : à qui profite le crime ? Sur ce point, des réponses ont été apportées lors des auditions que vous avez conduites – notamment par Michel Gonelle.
Je ne crois pas que ce qui s'est passé profite en quoi que ce soit à Jean-Louis Bruguière ; en revanche, il me semble que cela réjouit profondément – c'est un euphémisme ! – Michel Gonelle, si j'en juge par l'attitude qui fut la sienne lors de l'élection législative partielle. J'ai également entendu dire qu'il consultait beaucoup en vue des prochaines élections municipales. Celui des deux qui avait le plus intérêt à ce que l'affaire éclate et fasse le plus de mal possible est Michel Gonelle – mais ce n'est naturellement pas une preuve.
L'audition de Michel Gonelle a fait apparaître des éléments troublants. Par exemple, il vous a déclaré sous serment n'avoir jamais rencontré Edwy Plenel, ni parlé avec lui, jusqu'à ce qu'Edwy Plenel vienne le voir avec Fabrice Arfi à son hôtel à Paris pour le convaincre d'authentifier l'enregistrement. Or, je crois avoir compris qu'alors que Michel Gonelle faisait son travail au Palais de justice d'Agen, Edwy Plenel a tenté de le joindre avec insistance. Michel Gonelle affirme que, ne pouvant utiliser son téléphone portable parce que celui-ci n'avait plus de batterie, il a emprunté le téléphone portable d'un officier de sécurité du Palais de justice pour rappeler M. Plenel. Je m'interroge : si son téléphone n'avait plus de batterie, comment pouvait-il savoir le numéro de téléphone d'une personne qu'il affirme ne pas connaître, et avec laquelle il n'avait jamais échangé auparavant ?

Je voudrais compléter la première question du rapporteur.
La réunion du 16 janvier 2013, nous l'avons découverte par des journalistes, mais elle a été attestée lors de l'audition de Pierre Moscovici. Voici ce que ce dernier nous en a dit : « À l'occasion de cet échange, le Président de la République, avec le Premier ministre, en ma présence et celle de M. Jérôme Cahuzac, a informé ce dernier du principe de cette procédure et du fait que nous allions probablement l'utiliser. Pourquoi l'avoir fait ? D'une part, parce que M. Jérôme Cahuzac était alors ministre du Gouvernement, d'autre part, parce que, aux termes de la convention, les avocats conseils de M. Cahuzac devaient être informés du lancement de la procédure.
M. Jérôme Cahuzac s'est dit serein ; il a souhaité que la demande couvre la période la plus large possible. Au-delà de cette information de principe, il n'a évidemment pas été associé à la décision, du fait de la muraille de Chine : il n'a pas su quand la procédure avait été lancée – autrement que par ses conseils –, il n'a pas été associé à la rédaction de la demande. »
Et un peu plus tard, en réponse à une de mes questions :
« M. le président Charles de Courson. Quelle fut l'attitude de M. Jérôme Cahuzac durant la réunion du 16 janvier ?
M. le ministre. Il s'est montré serein et, dans l'hypothèse où la demande se produirait, il a demandé qu'elle couvre la période la plus large ; nous y avons veillé, puisque, alors que la convention prévoyait une interrogation sur trois ans, nous avons fait en sorte de remonter jusqu'en 2006, date de la prescription fiscale sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et sur l'impôt sur le revenu. »
Vous prétendez ne plus vous souvenir de cette réunion ? Croyez-vous que cette perte de mémoire soit crédible ?
S'il s'était agi d'une réunion, monsieur le président, ma perte de mémoire serait peu crédible, mais il me semble que Pierre Moscovici vous a indiqué qu'il s'agissait, non pas d'une réunion, mais d'un échange de mots à l'issue du Conseil des ministres.
Je n'ai aucun souvenir d'une réunion dans le bureau du Président de la République, et il me semble que Pierre Moscovici non plus. Vous avez donc à choisir entre deux témoignages faits sous serment devant votre commission d'enquête, et des propos publiés dans un ouvrage qui, au demeurant, comporte un certain nombre d'erreurs factuelles grossières.

Vous ne pouvez pas dire que Pierre Moscovici ne se souvient pas bien ! Il est très précis dans sa déclaration ; il a même indiqué que vous vous étiez réunis dans le bureau à côté de la salle du Conseil des ministres. Comment se fait-il qu'entre le 16 janvier et maintenant, vous ayez complètement perdu la mémoire de cette réunion « informelle » – pour reprendre les termes de Pierre Moscovici ?
Je devine de l'ironie dans vos propos, mais je ne crois pas que Pierre Moscovici ait utilisé le terme de « réunion », fût-il minoré du qualificatif « informelle ». Il me semble qu'il a parlé d'un échange de mots à l'issue du Conseil des ministres, au cours d'un mouvement de sortie générale d'une quarantaine de membres du pouvoir exécutif. Vous pouvez ironiser autant qu'il vous plaira, je n'ai aucun souvenir de cet échange de mots.

M. Fouks a déclaré durant son audition que vous l'aviez informé du sens de la réponse des autorités suisses, laquelle vous avait été transmise, d'après vos dires, par vos avocats en Suisse. Si j'ai bien compris, vous ne vous en souvenez plus – mais lui l'affirme. Pourquoi avoir fait cela ?
Je crois que j'ai perdu le fil de votre question ; pourriez-vous la reformuler ?

Lorsque nous l'avons auditionné, M. Fouks a déclaré avoir joué un rôle au démarrage de l'affaire, le 3 décembre, lorsque vous l'avez appelé pour lui demander d'intervenir auprès de Mediapart, et il a dit que c'était lui qui avait organisé la réunion du 4 décembre au matin entre vous et M. Arfi.
M. Fouks n'a absolument pas organisé cette réunion ! Il m'a conseillé de recevoir M. Arfi – ce que j'ai fait. M. Arfi était d'ailleurs accompagné d'un de ses confrères de Mediapart.
Je tiens à être précis, car je ne souhaite pas que Stéphane Fouks fasse l'objet d'accusations infondées : il n'a absolument pas « organisé » de réunion sur cette affaire. Il m'a conseillé de recevoir les journalistes qui portaient des accusations très graves contre moi, et j'ai suivi son conseil : c'est différent.

Mais son intervention a bien eu lieu le 3 décembre, le jour où vous avez reçu les questions de Mediapart ?
Tout à fait.
Il est assez facile d'imaginer que le SMS ou le courriel que j'avais reçu de Fabrice Arfi m'avait plongé dans une vive inquiétude. J'ai donc appelé Stéphane Fouks, et je lui ai demandé ce qu'il en était vraiment, et quelle était la meilleure attitude à adopter – je rappelle qu'à l'époque, je n'avais aucune idée des éléments dont Mediapart pourrait faire état.
« Après avoir reçu ce courriel, Jérôme Cahuzac m'a appelé pour me demander mon avis sur ce qu'il convenait de faire. Je lui ai dit que je voulais d'abord mieux comprendre ce qui se passait. J'ai donc appelé un correspondant chez Mediapart, puis Fabrice Arfi, avec qui j'ai eu une conversation. Cela m'a permis d'organiser la réunion entre Jérôme Cahuzac et Fabrice Arfi, destinée à permettre l'échange d'informations nécessaire. »
Ce n'est pas lui qui a choisi le lieu, ni l'horaire ; cela s'est fait en liaison avec mon cabinet, et c'est moi qui ai décidé de recevoir les journalistes le lendemain matin. « Organiser » me paraît donc un terme excessif au regard de la responsabilité réelle de Stéphane Fouks dans ce rendez-vous.

Pourquoi l'avez-vous informé du contenu de la réponse de l'administration fiscale suisse ?
Je ne l'ai pas informé du contenu, pour la simple raison que je l'ignorais : je n'ai vu ni le document posant la question, ni celui apportant la réponse. Toutefois, je n'avais aucun doute quant à la nature de celle-ci, dès lors que la banque interrogée était l'UBS et que la demande portait sur la période non couverte par la prescription – et cela ne pouvait être autrement.
Monsieur le président, il faudra vous contenter de la réponse que je viens de faire.

Pour revenir sur les échanges qui auraient eu lieu à l'issue du Conseil des ministres, je rappelle ce que nous a déclaré Pierre Moscovici :
« C'est pourquoi il y a eu, non pas une réunion, mais quelques mots échangés à l'issue du Conseil des ministres, dans la salle attenante (…) À l'occasion de cet échange, le Président de la République, avec le Premier ministre, en ma présence et celle de M. Jérôme Cahuzac, a informé ce dernier du principe de cette procédure et du fait que nous allions probablement l'utiliser. »
Vous affirmez n'avoir fait aucun commentaire sur l'ampleur de la demande d'entraide ?
Je répète – en dépit de l'ironie de votre voisin, qui est facile – que je n'ai aucun souvenir de cet échange de mots. Mais quelle que soit la version retenue – réunion dans le bureau présidentiel, échange de mots ou toute autre chose que j'ignore –,la « muraille de Chine » n'a pas été prise en défaut, puisqu'à aucun moment je n'ai été associé aux questions posées à l'UBS via l'administration helvétique.

Mais s'il s'avérait que vous aviez bien participé à cette réunion, cela était-il été conforme à la note du 10 décembre 2012 par laquelle vous vous déportiez de votre dossier fiscal ?
La note du 10 décembre s'adressait à l'administration. Je ne crois pas, pendant les mois où j'étais ministre, avoir jamais envoyé de note au Président de la République lui indiquant ce qu'il fallait faire. La « muraille de Chine » concernait l'administration et elle a été scrupuleusement respectée.
En l'espèce, il s'agissait du Président de la République. Je vous confirme que le ministre du budget que j'étais ne donnait pas d'instruction au Président de la République.

Et le fait que vous ayez été associé à cette réunion vous semble-t-il conforme à l'instruction du 10 décembre – même si vous niez ce fait ou dites ne plus vous en souvenir ?
« Nier » est un terme que je juge impropre. Vous avez le droit d'ironiser, mais je maintiens que je ne me souviens pas de cette réunion.
Quoi qu'il en soit, je n'ai à aucun moment été associé à la procédure d'entraide administrative avec le Suisse.

Vous pensez vraiment que votre amnésie concernant une réunion qui a eu lieu en janvier de cette année est crédible – ou cela veut-il dire que vous contestez les propos de M. Pierre Moscovici ?

Monsieur Cahuzac, la question que je vais vous poser est importante pour notre commission d'enquête, puisque nous cherchons à savoir si l'administration fiscale a pu faire correctement son travail et si elle a correctement interrogé la Suisse. Même si nous avons noté votre souci de bien distinguer ce qui relève de notre travail et ce qui relève de la procédure judiciaire, il me semble que vous devriez pouvoir y répondre.
Lors de votre précédente audition, vous avez dit que l'hypothèse que la banque UBS aurait menti en répondant à l'administration française vous paraissait « peu plausible, vu les risques que cette banque encourrait ». On déduit de cette réponse que vous n'avez pas de compte à l'UBS.
À un autre moment, vous avez estimé que l'administration fiscale avait posé correctement la question. S'agissant de la réalité de votre compte et de son cheminement, vous avez déclaré que « quand elle sera connue, la procédure judiciaire fournira une explication qui n'est probablement pas celle à laquelle vous – c'est-à-dire le président de Courson – faites référence » – l'hypothèse étant que divers montages financiers auraient pu conduire à ce que votre nom n'apparaisse pas.
Monsieur Cahuzac, pouvez-vous nous confirmer que vous n'avez jamais été l'ayant droit économique d'un compte en Suisse chez l'UBS, directement ou indirectement – via Reyl ou tout autre gestionnaire de compte –, durant la période 2006-2009 ?
Je comprends votre demande et j'aimerais pouvoir vous répondre de manière simple, mais cela m'est impossible.
L'accusation dont j'ai été l'objet faisait état de la fermeture d'un compte à l'UBS en février 2010 – accusation qui a été reprise, je crois, par votre président lors des premières auditions. Il me semble qu'à partir du moment où tout le monde semble exclure la possibilité que l'UBS ait menti, le fait que, dans le cadre de la procédure d'entraide administrative, la réponse des autorités suisses ait été négative prouve que si le compte n'a pas été fermé en février 2010, c'est tout simplement parce qu'il n'existait pas de compte à l'UBS à cette époque-là.
C'est vraiment la seule chose que je peux vous répondre. J'espère que vous le comprendrez.

Vous nous confirmez donc la réponse que vous aviez faite lors de votre première audition ?

Avant de passer la parole à M. Fasquelle, je voudrais rappeler la réponse que M. Fouks avait faite à une question que je lui avais posée.
Question : « D'après lui [c'est-à-dire vous, monsieur Cahuzac], ce sont ses avocats en Suisse qui l'ont appelé pour lui indiquer, non pas qu'ils avaient lu la lettre, mais que les autorités helvétiques leur avaient indiqué que la réponse était négative. Ces mêmes avocats vous appellent-ils directement ? »
Réponse : « Non, c'est Jérôme Cahuzac qui le fait. » – M. Fouks affirme donc que vous l'avez appelé.
Question : « Vous dit-il que c'est une bonne nouvelle ? »
Réponse : « Oui. Je réponds : “Chouette, il n'y a plus qu'à laisser faire les choses !” »
Moi, je ne trouve pas cela « étrange ». Des coups de fil, j'en passais beaucoup, et je n'avais pas que Stéphane Fouks comme ami. Certaines personnes se préoccupaient de cette affaire d'une façon qui me semble assez légitime, dès lors que nous avions des relations amicales très anciennes et très fortes.
Averti par mes conseils suisses que la réponse donnée par la Suisse était bien celle qui me paraissait probable, il m'a semblé possible d'en informer ceux qui pouvaient considérer cela comme une bonne nouvelle ; Stéphane Fouks a dit que je l'avais appelé, je l'ai donc sûrement fait. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais je ne vois pas là de dysfonctionnement des services de l'État.

Ce n'était pas l'objet de ma question : nous cherchons à savoir qui a informé le Journal du dimanche.

Je pense que vous avez conscience, monsieur Cahuzac, que les faits évoqués ici sont d'une exceptionnelle gravité. Ministre du budget, chargé de la lutte contre la fraude fiscale, vous aviez un compte caché à l'étranger : cette révélation a profondément choqué les Français.
Nous vous avons entendu une première fois, et nous avons tous été déçus par cette audition, car vous vous êtes souvent réfugié derrière l'enquête judiciaire. Aujourd'hui, vous avez des trous de mémoire ! Il faudrait vraiment que vous soyez coopératif et nous aidiez à dissiper les zones d'ombre qui subsistent. La démocratie et notre République le méritent.
S'agissant de l'enquête administrative, vous dites que vous n'aviez aucun doute sur la nature de la réponse. Je me pose donc légitimement des questions : Pierre Moscovici pouvait-il, lui, avoir un doute sur la nature de la réponse ? Pourquoi la demande a-t-elle été faite de façon aussi tardive ? Pourquoi avoir retenu ce périmètre ?
Vous dites ne pas vous souvenir de l'échange du 16 janvier rapporté par Pierre Moscovici, mais il s'agit d'un point essentiel ! Au travers de cet échange, vous avez pu orienter l'enquête administrative, qui ne pouvait donner d'autres résultats que celui que nous connaissons. Un de vous deux ment – ou dit la vérité, c'est selon.
Je vous repose donc la question : quel souvenir avez-vous de cet échange ? Avez-vous eu, à un moment ou à un autre, un contact avec Pierre Moscovici, avec le Président de la République etou le Premier ministre sur le champ de l'enquête administrative ? Ces derniers pouvaient-ils avoir un doute sur le résultat de cette enquête ?
Le doute que les personnalités que vous avez citées auraient pu avoir ne regarde qu'elles : je ne peux pas répondre à leur place.
Ai-je orienté l'enquête administrative ? En aucune manière. Du reste, la déposition de M. Bruno Bézard démontre qu'au moment où la demande d'entraide administrative a été faite, l'administration fiscale ne pouvait pas mieux poser les questions.
Il faut juger ses actions à la lumière, non pas de ce que l'on sait aujourd'hui, mais de ce qui était prétendu à l'époque. Si l'on veut bien faire cet effort, on ne peut qu'arriver à la conclusion que la direction générale des finances publiques a parfaitement travaillé, en respectant scrupuleusement la « muraille de Chine » – pour utiliser le terme consacré – que son directeur avait jugé indispensable d'ériger dans les jours qui ont suivi la publication de l'article princeps de Mediapart.

Edwy Plenel nous a démontré que quiconque le voulait pouvait savoir dès le mois de décembre ; je m'interroge donc sur les raisons de l'inertie du Président de la République et du Premier ministre.
S'agissant de votre demande d'attestation négative, je n'ai pas trouvé vos explications très claires. Comment expliquez-vous que, face à de telles accusations, le Président de la République et le Premier ministre ne vous aient pas convoqué pour vous demander de vous procurer cette attestation négative ? L'affaire aurait pu être réglée en quelques jours, dès le mois de décembre !
Surtout, informés comme ils l'étaient, comment se fait-il qu'ils aient tant tardé à lancer l'enquête administrative et qu'ils n'aient pas saisi la justice française – qui aurait pu obtenir en quelques jours les informations en Suisse ?
Comment expliquez-vous cette inertie ? Confirmez-vous qu'à aucun moment, vous n'avez été convoqué par le Président de la République et par le Premier ministre pour faire toute la lumière sur cette affaire dès le mois de décembre ?
Vous posez des questions qui concernent d'autres personnes ; encore une fois, je ne peux pas répondre à leur place !
Vous jugez que la demande d'entraide administrative fut tardive. Je crois qu'il vous a été démontré que pour être recevable, l'État demandeur de cette aide devait avoir épuisé les moyens d'investigation qui lui sont propres. La demande d'entraide ne pouvait donc être envisagée qu'à partir du moment où je n'avais pas répondu dans le délai d'un mois à un formulaire me demandant de confirmer par écrit ce que j'avais affirmé oralement. Je n'ai plus en mémoire la durée qui s'est écoulée entre la purge de ce délai et le moment où la procédure d'entraide administrative a été déclenchée, mais je ne crois pas qu'elle ait été exagérément longue, bien au contraire.

Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez essayé d'obtenir une attestation négative de l'UBS et que, le 13 décembre, vous aviez reçu une réponse négative à cette demande. En avez-vous informé le Président de la République, le Premier ministre etou Pierre Moscovici ?
Comme je vous l'ai indiqué, mes avocats suisses ont fait la demande en deux temps : ils ont posé d'abord une question de principe, puis une question me concernant. Je ne crois pas avoir parlé explicitement, ni avec Pierre Moscovici, ni avec le Premier ministre, ni avec le Président de la République, des initiatives personnelles que je pouvais prendre – et qui doivent être distinguées bien entendu de la procédure d'entraide administrative. Les deux démarches n'ont rigoureusement rien à voir, même si elles pouvaient avoir un objet identique, sinon la même finalité.

Je me dois de préciser, monsieur Cahuzac, que le ministre Pierre Moscovici a déclaré, en réponse à l'une de mes questions : « En parallèle, Jérôme Cahuzac se faisait fort d'obtenir de l'UBS la confirmation qu'il n'avait pas détenu de compte chez eux. Cela tardait à venir… »
J'ai déjà fait référence à de tels épisodes, qui furent nombreux ; je suis incapable de les quantifier et de les dater. Il ne s'agit pas de trous de mémoire : je mets au défi quiconque de retrouver la date précise à laquelle tel échange a eu lieu six, sept ou huit mois auparavant ; même avec une bonne mémoire, la chose est difficile !
Ces échanges commençaient toujours de la même façon : « Est-ce que ça va ? », « N'est-ce pas trop dur ? ». Il faut que vous admettiez, même si cela vous choque, vous peine ou vous scandalise, que les personnes dont vous parlez me faisaient confiance, et qu'à partir du moment où j'avais déclaré ne pas avoir ce compte, elles m'avaient cru ; je le déplore amèrement aujourd'hui, mais c'est ainsi. On peut leur en faire reproche, mais elles ne furent pas les seules. Qu'elles prennent régulièrement des nouvelles me permettait de leur indiquer que j'avais pris des initiatives personnelles, via mes conseils, pour obtenir une attestation négative.
J'essayais bien sincèrement de le faire car, pour ce qui concerne la période de conservation légale des archives ou, du moins, la période non couverte par la prescription, cela aurait apporté les mêmes informations que celles obtenues par la demande d'entraide administrative. On peut comprendre que, dans le contexte de l'époque, je déployais, par l'intermédiaire de mes conseils, beaucoup d'efforts pour arriver à un résultat. Il est bien probable que, lorsque des collègues me demandaient des nouvelles, je leur indiquais ce qu'il en était.

Mais les avez-vous, oui ou non, informés de l'absence de réponse, c'est-à-dire que l'UBS refusait de vous donner cette attestation négative ? Est-ce qu'au moins l'une des trois personnalités citées a été avertie ?
L'échec de mes tentatives était patent : dès lors que je ne publiais pas ce courrier d'attestation négative, c'est que je ne parvenais pas à l'obtenir.

Mais avez-vous, oui ou non, dit à Pierre Moscovici, à compter du 13 décembre : « J'ai essayé et je n'ai pas réussi » ?
Je ne parlais pas de ces efforts au passé, mais au présent : « Je ne parviens pas ». En effet, je ne me suis pas arrêté là : la première réponse d'UBS n'était qu'une réponse générale, de principe. Ensuite, j'ai essayé d'obtenir une attestation négative me concernant ; cela a duré tout le mois de décembre.

Vous n'avez donc pas été convoqué par le Président de la République et le Premier ministre, et ils ne vous ont pas demandé de fournir une attestation négative. Vous dites qu'ils vous ont cru ; ils se sont contentés de votre parole alors qu'ils disposaient des informations de Mediapart et de Michel Gonelle : voilà ce qui nous trouble !

La journaliste affirme que, le 5 décembre, le Président de la République vous a demandé, en présence du Premier ministre, de fournir la preuve que ce qu'avançait Mediapart était faux, et donc de faire cette demande à l'UBS. Vous dites que cette assertion est erronée ?
Je ne me souviens pas que le Premier ministre et le Président de la République m'aient demandé cela le 5 décembre. J'ai le souvenir que les dénégations que j'ai produites ont – hélas ! – suffi à les convaincre. Je leur ai demandé, en vain à ce jour – peut-être cela sera-t-il possible dans le futur ? –, de me pardonner d'avoir trompé la confiance qu'ils m'avaient accordée.
Mais je n'ai pas répondu à M. Fasquelle. Je n'avais pas besoin d'être convaincu par quiconque de la nécessité d'obtenir une attestation négative. C'est bien sincèrement que j'ai souhaité l'avoir ! J'ai d'ailleurs beaucoup sollicité mes conseils à cette fin.

Ce qui me trouble, c'est que vous n'ayez pas été convoqué et que l'on n'ait pas exigé que vous produisiez une attestation négative. Dans pareille situation, la responsabilité du Président de la République et du Premier ministre eût été de le faire. Mais tel n'a pas été le cas, n'est-ce pas ?
Je le répète : je n'ai pas attendu qu'on me demande d'obtenir une attestation négative pour comprendre la nécessité d'une telle démarche. Quant à l'interrogation que vous manifestez, je comprends bien qu'elle ne s'adresse pas à moi.

Je veux maintenant vous poser de nouveau la question que je vous avais posée lors de votre précédente audition, monsieur Cahuzac, en précisant que l'enquête judiciaire en cours ne vous empêche pas d'y répondre.
Vous aviez affirmé qu'il n'y avait eu aucun mouvement sur le compte ; or des informations contraires ont circulé. Quelles sont les origines des fonds qui alimentent ce compte ? Comment expliquez-vous ces mouvements ? Existe-t-il d'autres comptes, en Suisse ou ailleurs ?
Monsieur le député, vous savez parfaitement que vous entrez de plain-pied dans la procédure judiciaire : je ne peux pas vous suivre sur ce terrain !

Monsieur Cahuzac, dans l'hémicycle, durant l'examen du projet de loi de finances, vous répondiez aux questions sans notes, en argumentant, sur des sujets aussi complexes que la TVA sur le bois – et, s'agissant de la réunion du 16 janvier, la mémoire vous ferait défaut ? Nous avons du mal à le croire !
« À qui profite le crime ? », demandiez-vous tout à l'heure : on peut poser la même question pour ce qui est de la divulgation au Journal du dimanche de la réponse des autorités suisses ! Au fil des auditions, nous avons appris que ni M. Fouks, ni vos collaborateurs – au sens large –, ni M. Moscovici, ni ses collaborateurs, ni M. Bézard n'ont fourni ce document au Journal du dimanche ; celui-ci a pourtant publié un grand article pour dire aux Français que vous étiez innocenté de ce dont on vous accusait.
Votre conseillère en communication a déclaré que vous aviez été déçu par la publication de cet article, M. Fouks, que vous vous en étiez réjoui. Savez-vous qui aurait pu transmettre ce document, ou une copie, ou encore la teneur de la réponse, aux journalistes du Journal du dimanche ?
Je l'ignore. J'avais clairement souhaité une très grande discrétion après qu'a été connu le résultat de l'entraide administrative. Avec le recul, je continue à penser que la publication de cet article ne fut pas une bonne chose pour moi.

Monsieur Cahuzac, nous avons aujourd'hui la démonstration flagrante que vous avez proféré un mensonge lors de votre première audition.
Vous dites avoir appris par vos avocats suisses l'existence de la demande d'entraide administrative. Or M. Pierre Moscovici a évoqué, avec une grande précision, des « propos échangés » – on interprétera cet énoncé comme l'on voudra – à l'issue du Conseil des ministres, dans une salle attenante : cela ne s'invente pas ! Il a dit que vous étiez serein et que vous aviez souhaité que la demande soit la plus large possible : cela non plus ne s'invente pas ! Nous comprenons qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus revenir sur vos premières déclarations, sans quoi le mensonge serait flagrant ; vous vous réfugiez donc derrière une perte de mémoire, mais cela ne peut pas nous satisfaire : nous avons besoin de lever cette contradiction.
Je rappelle que le président avait annoncé, au début de nos travaux, que s'il était établi qu'un mensonge avait été prononcé sous serment devant notre commission d'enquête, il n'hésiterait pas à saisir le procureur de la République. Nous sommes sur du sérieux !
Vous ne voulez pas vous souvenir de cet échange à l'issue du Conseil des ministres, sans doute pour protéger le Président de la République et le Premier ministre ; mais quatre personnes étaient présentes lors de cette réunion : Pierre Moscovici, qui dit, je le pense, la vérité ; Jérôme Cahuzac, qui ne dit pas la vérité ; le chef de l'État, que nous ne pouvons pas entendre ; et le Premier ministre. Je ne vois pas comment notre commission d'enquête pourrait conserver un quelconque crédit si nous n'entendions pas ce dernier sur ce point !
Le Premier ministre a déclaré : « Nous sommes dans un régime qui a un caractère parlementaire ; le rôle de contrôle qui est le vôtre doit être totalement respecté ». Pourquoi ne pas prendre ces propos à la lettre ? Je regrette que nos collègues de la majorité aient rejeté la demande d'audition du Premier ministre, car je crois que c'est l'intérêt même de ce dernier, et du Gouvernement tout entier, de venir s'expliquer devant la représentation nationale.
En effet, vos propos, monsieur Cahuzac, ne sont pas recevables. Vous ne pouvez pas prétendre ne plus vous souvenir de cet échange : cela n'est pas crédible. Je vous demande donc de bien peser vos déclarations, car on est là sous le coup de la loi pénale, qui punit le faux témoignage. Il est encore temps pour vous de renoncer au déni de réalité et de nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là, à l'issue du Conseil des ministres, dans la salle attenante.
Tout à l'heure, le président maniait l'ironie ; vous maniez maintenant la menace. C'est votre droit, mais ni l'ironie ni la menace ne me feront dire des choses dont je n'ai aucun souvenir.

Je ne brandis pas de menace, j'applique seulement la loi et j'assume les pouvoirs de notre commission d'enquête. J'appelle solennellement l'attention de M. Cahuzac sur un mensonge aujourd'hui flagrant.
M. Pierre Moscovici a livré trop de détails dans ses explications – le lieu où cela s'est passé, les propos tenus par M. Cahuzac – pour qu'il en soit autrement. Il est invraisemblable que M. Cahuzac ne se souvienne pas de cet épisode.
Il s'agit, non pas d'une menace, mais d'un rappel à vos obligations, monsieur Cahuzac.

J'aurai beaucoup appris en matière de sémantique au cours de cette commission d'enquête…
M. Pierre Moscovici a évoqué un « échange » lorsque le Président de la République, le Premier ministre, lui-même et Jérôme Cahuzac se sont rencontrés ; tout à l'heure, M. Cahuzac a parlé d'« échange de mots ». Pour moi, si quatre personnes « échangent » des « mots », c'est une « réunion » – qu'elle soit grande ou petite !
Voici ce que vous aviez dit lors de votre première audition, monsieur Cahuzac :
« M. le rapporteur. M. Bruno Bézard a indiqué, lors de son audition du 28 mai, que vous aviez « tenté d'entrer dans le débat sur la demande d'assistance administrative et de voir par exemple comment cette demande était rédigée » ; il vous avait répondu que cela était impossible et vous n'aviez pas insisté. Est-ce exact ?
Oui. Cet échange n'a duré que quelques secondes. J'ai su – car je crois que le texte de la convention le prévoit – par mes avocats suisses qu'une demande était soit en cours, soit faite. J'en ai dit quelques mots à M. Bruno Bézard, qui m'a répondu qu'il n'était pas envisageable que je puisse m'en mêler ; je lui ai donné raison et je ne lui en ai plus jamais reparlé. »
Juste après, vous avez ajouté : « Je n'ai pas souvenir de la date précise, mais ce sont mes avocats suisses qui m'en ont informé ».
Or M. Pierre Moscovici a été affirmatif : il a parlé, en votre présence, de la demande d'entraide administrative avec le Président de la République et le Premier ministre.
On a souvent mis en avant la « muraille de Chine » – qui relève selon moi plutôt de l'autoroute Paris-Pékin ! Comment expliquez-vous que, malgré votre déport, on vous ait informé qu'une demande d'entraide allait être rédigée et que vous ayez indiqué que la période d'interrogation devrait être la plus large possible ?
Je me souviens de l'échange avec Bruno Bézard, mais pas de celui décrit par Pierre Moscovici, et ni la menace ni l'ironie ne me feront dire des choses dont je ne me souviens pas – même si je comprends bien que cela simplifierait les travaux de la Commission d'enquête, voire que cela me simplifierait la vie.
Si j'avais le souvenir d'une telle réunion, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas.

Pour l'information de la Commission, cet épisode se situe entre le 24 janvier, date d'envoi de la demande d'entraide, et le 31 janvier, date de la réponse de la Suisse. M. Bézard ne se souvenait plus quel jour précis M. Cahuzac l'avait appelé pour connaître le contenu de cette demande.

Mais la réunion – pardon, « l'échange » ! – relaté par Pierre Moscovici a eu lieu le 16 janvier. Ma question portait sur l'incohérence entre la déclaration de Pierre Moscovici et les propos de M. Cahuzac.
« Incohérence » est un terme peut-être excessif. Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, la seule conclusion raisonnable à laquelle on peut arriver, c'est que Pierre Moscovici se souvient de ce que vous appelez une « réunion » et que d'autres ont qualifié d'« échange informel » ou d'« échange de mots », alors que moi, je ne m'en souviens pas. Cela ne me paraît pas si choquant que cela : quoi qu'il se soit passé et quel que soit l'endroit ou cela s'est passé, je ne suis intervenu ni dans la décision de principe de déclencher l'entraide administrative, ni dans les modalités de sa mise en oeuvre.

Il s'agit quand même du Président de la République, du Premier ministre et de votre ministre de tutelle – soit les trois personnages hiérarchiquement au-dessus de vous. Ils abordent un sujet qui vous concerne directement, qui modifiera nécessairement la suite de ce dossier, et vous n'en auriez pas souvenir ?
S'agissant de l'affirmation de la journaliste selon laquelle cette réunion se serait tenue dans le bureau présidentiel, pour le coup, mes souvenirs concordent avec ceux de Pierre Moscovici.

Pierre Moscovici n'a jamais dit que cela s'était passé dans le bureau du Président, mais à l'issue du Conseil des ministres, dans une salle attenante !
Précisément, dans l'ouvrage que vous avez cité, l'auteure indique que cette réunion se serait tenue dans le bureau du Président de la République. Je ne m'y suis pas rendu assez souvent pour l'avoir oublié si cette réunion s'était tenue à cet endroit. J'ai souvenir de la dernière réunion de travail que j'ai eue, avec le Président de la République, dans son bureau : c'était bien antérieur, sur un sujet qui n'avait rien à voir. Quelle que soit la source des informations de la journaliste, si des échanges de mots ont eu lieu, ce n'était certainement pas dans le bureau du Président de la République.
Sur ce point, nos souvenirs convergent donc.
En revanche, nos souvenirs divergent, s'agissant de la réunion informelle, ou de l'échange de mots, survenu à l'issue du Conseil des ministres. La seule explication que je trouve à ce que vous jugez être une incohérence majeure, ou un mensonge – ce que je déplore –, c'est que cet échange a eu lieu à la sortie du Conseil des ministres ; j'étais peut-être à deux ou trois mètres, mais, formellement, je n'ai pas participé à cet échange – en tout cas, je n'en ai aucun souvenir.
Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la version, à aucun moment je ne suis intervenu, ni dans la décision de principe de déclencher l'entraide administrative, ni dans ses modalités de mise en oeuvre.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, je suis surpris que vous acceptiez et que nous acceptions, aujourd'hui comme le 26 juin dernier, de nous faire « balader » par M. Cahuzac presque à chaque question que nous lui posons, avec plus ou moins de mépris en fonction du sujet et de l'interlocuteur ! A fortiori au moment même où plus de 900 parlementaires – députés et sénateurs – travaillent avec application sur des textes de loi qui sont la conséquence directe de l'affaire Cahuzac.
Vous avez invité M. Cahuzac aujourd'hui pour tenter d'en savoir plus sur la « réunion », « l'entretien » ou « l'échange » qui a suivi le Conseil des ministres du 16 janvier 2013. M. Cahuzac dit n'en avoir strictement aucun souvenir. Nous ne pouvons pas nous contenter de cette réponse. M. Fenech a estimé nécessaire d'entendre le Premier ministre. Certes, la majorité n'a pas souhaité que cette audition ait lieu, mais la manifestation de la vérité ne dépend pas d'un vote. À présent, je ne vois pas comment nous pourrions faire l'économie d'une telle audition – je le dis d'autant plus librement que je m'étais initialement prononcé contre.
Nous sommes dans une impasse : M. Cahuzac et M. Moscovici se contredisent. Il n'est d'ailleurs guère utile de poursuivre indéfiniment cette audition. Je demande donc que la Commission les auditionne conjointement.
D'autre part, vous ne devez pas vous contenter, monsieur le président, de réponses approximatives. De manière très pertinente, vous vous êtes étonné tout à l'heure que M. Cahuzac ait pu demander à M. Bézard d'être associé à la rédaction de la demande d'entraide administrative, alors même qu'il a prétendu ignorer l'existence de celle-ci. M. Cahuzac a alors bafouillé un peu – ce n'est pourtant guère dans ses habitudes – et vous a répondu qu'il en avait probablement appris l'existence par ses conseils. Vous lui avez fait observer que tel ne pouvait pas être le cas, puisque sa rencontre avec M. Bézard était antérieure à l'envoi de la demande. Nous n'avons donc pas de réponse sur ce point. À moins que M. Cahuzac n'ait été effectivement informé, comme l'a dit M. Moscovici, à l'occasion de la réunion qui fait l'objet de la présente audition. D'ailleurs, si M. Moscovici n'avait pas fait cette déclaration, nous n'aurions pas auditionné à nouveau M. Cahuzac. Il importe de faire la lumière sur cette question.

Au regard des déclarations des uns et des autres, la question soulevée par M. Houillon se pose en effet. Mais ce n'est pas le moment d'en parler.

J'entends bien, monsieur le président. Mais je le répète publiquement : la vérité ne se vote pas, elle se construit. Nous disposons aujourd'hui d'éléments qui plaident en faveur d'une poursuite de notre travail.
Au cours de ma première audition, j'ai été interrogé sur ma tentative – M. Bézard l'a qualifiée ainsi – de franchir la « muraille de Chine ». D'après le compte rendu de mon audition, ma réponse a été la suivante : « Oui. Cet échange n'a duré que quelques secondes. J'ai su – car je crois que le texte de la convention le prévoit – par mes avocats suisses qu'une demande était soit en cours, soit déjà faite. J'en ai dit quelques mots à M. Bruno Bézard, qui m'a répondu qu'il n'était pas envisageable que je puisse m'en mêler ; je lui ai donné raison et ne lui en ai plus jamais reparlé. » Vous constaterez, monsieur le député, que je n'ai parlé à aucun moment de la « rédaction » de la demande d'entraide administrative. Je tenais à lever toute ambiguïté, au moins sur ce point.

Pour l'information des membres de la Commission, le magazine Marianne a publié le 12 février le courrier adressé à UBS par les autorités fiscales suisses, lequel reprenait dans son intégralité le contenu de la lettre que leur avait envoyée l'administration fiscale française. Le courrier adressé à UBS n'était pas soumis aux mêmes règles de secret que la première lettre.

Comme beaucoup de collègues, j'ai du mal à concevoir qu'une telle différence existe entre l'intervention précise de M. Moscovici devant nous la semaine dernière et les souvenirs peu nombreux que vous avez.
Je cite quelques lignes, page 156, de l'ouvrage de Mme Charlotte Chaffanjon : « “Puisque tu n'arrives pas à avoir une réponse par la voie personnelle, on va passer par la voie conventionnelle !” expliquent François Hollande et Jean-Marc Ayrault à Jérôme Cahuzac, qui n'a d'autre choix que d'accepter. » L'auteur fait ici référence à la réunion, rencontre ou échange du 16 janvier 2013. Je poursuis : « “Dans un premier temps, il avait été demandé à Jérôme Cahuzac de faire la démarche lui-même, par ses avocats. Comme rien n'est venu de ce côté-là, il a été décidé d'engager la procédure prévue par la convention fiscale entre la France et la Suisse” confirme François Hollande après coup. » Suit un renvoi en bas de page : « Entretien avec l'auteur, 21 mai 2013. » Que vous inspirent ces propos du Président de la République ?
La décision de principe d'engager la procédure d'entraide administrative a manifestement été prise par le Président de la République ou par le Premier ministre, voire par les deux en même temps. Cette décision n'a été communiquée qu'à M. Moscovici, qui était le seul à pouvoir la mettre en oeuvre. À aucun moment je n'avais à intervenir dans cette procédure et encore moins dans la décision de principe de l'engager. Tels sont les commentaires que m'inspire le passage que vous avez lu, qui me paraît assez compatible avec ce que je me suis efforcé de vous dire en convoquant tous les souvenirs que je peux avoir en la matière – je suis désolé s'ils ne sont pas assez nombreux ou précis. J'étais probablement la dernière personne à « mobiliser » au sein de l'exécutif pour engager cette procédure. Il me paraît donc normal de ne pas l'avoir été.
J'insiste sur le passage que j'ai lu tout à l'heure à la suite de l'intervention de M. Houillon : au cours de ma première audition, à aucun moment je n'ai indiqué avoir voulu être associé à la rédaction de la demande d'entraide administrative. Lorsque j'en ai parlé à M. Bézard, j'ignorais si cette demande était déjà faite ou si elle était en cours. M. Bézard m'a alors dit qu'il n'estimait pas souhaitable que je me mêle de la procédure, à quelque stade qu'elle pût en être. Je ne crois pas qu'il y ait là les incohérences que les uns ou les autres veulent voir, pour des raisons qui vont bien au-delà de mon sort personnel, lequel ne présente plus aucun intérêt.
Ma curiosité en la matière ne paraît pas totalement incompréhensible, monsieur le président. Elle a d'ailleurs duré moins d'une minute. M. Bézard m'a répondu, de manière aussi catégorique que courtoise, que cela n'était pas possible. Je lui ai immédiatement donné raison.

Vous vous souveniez pourtant d'avoir signé, le 10 décembre, une note indiquant à votre administration que vous n'aviez pas à en connaître ?
Il est d'ailleurs bien probable que M. Bézard me l'ait rappelé à cette occasion, et il a bien fait.

Vous affirmez non pas que la réunion ou l'échange du 16 janvier n'a pas eu lieu, mais que vous ne vous en souvenez pas. Avez-vous néanmoins le souvenir, même imprécis ou fugace, d'avoir évoqué la demande d'entraide à un autre moment, même très rapidement, avec le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de l'économie et des finances, voire avec les trois ensemble ?
Je vous remercie, madame la députée, d'accepter la distinction que je m'étais permis de suggérer entre un mensonge assumé et le fait que ma mémoire ne retrouve pas, objectivement, les éléments sur lesquels je suis interrogé. Mon histoire personnelle récente me permet assez bien de faire la différence entre les deux.
Ai-je eu des discussions au sujet de la demande d'entraide avec les deux plus hauts personnages de l'État ? Avec le Premier ministre, oui. Il s'agissait d'échanges personnels et à caractère général, qui n'avaient pas trait à la procédure elle-même et relevaient davantage de l'amitié que d'autre chose. Cette affaire m'affectait – personne ne pourrait le contester ici. Le Premier ministre s'en apercevait, me croyait dans mes dénégations – je le déplore amèrement aujourd'hui – et s'inquiétait pour moi. Il m'interrogeait donc pour savoir si cela allait, si les choses s'éclaircissaient, si j'obtenais une réponse d'une manière ou d'une autre. Je m'efforçais de lui répondre en étant le plus précis possible sur les procédures, et le plus rassurant possible sur mon état. J'ignore si je parvenais à le convaincre.
Avec le Président de la République, non. Dès lors qu'il m'avait interrogé une fois et que je lui avais répondu par des dénégations, il estimait, je crois à juste titre, ne plus avoir à revenir sur ce sujet avec moi. Il ne m'a donc plus jamais interrogé. Cela peut paraître surprenant sur le plan humain, mais je pense qu'il a bien fait, au regard de la fonction qu'il exerce.

Est-il exact que votre accord était nécessaire pour que la demande d'entraide aux autorités helvétiques couvre une période plus étendue que celle prévue par la convention fiscale franco-suisse ? Dès lors, il serait normal que vous ayez été informé de la demande d'entraide sinon par vos collègues ministres, du moins par l'administration.
Cette remarque me semble très utile. La convention fiscale oblige les parties à répondre pour la période postérieure au 1er janvier 2010. Pour couvrir la période antérieure non prescrite en droit français, c'est-à-dire celle du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2010, il convenait en effet de recueillir l'accord de la personne intéressée, non pas parce qu'il s'agissait d'un membre du Gouvernement, mais parce que les textes qui régissent les relations entre la France et la Suisse en la matière le prévoient explicitement.
C'est d'ailleurs ce qui explique sans doute la chronologie des faits entre le 15 et le 31 janvier, qui a pu vous surprendre : dans la mesure où mon accord était nécessaire, il est normal que mes avocats suisses se soient retournés vers moi ; dès lors qu'ils m'ont demandé cet accord – je le leur ai donné –, cela signifie qu'ils avaient été informés de la procédure à un moment ou à un autre, peut-être antérieur à celui envisagé par certains membres de votre Commission, voire par vous-même, monsieur le président.
Dans la deuxième quinzaine de janvier, c'est certain. Mais il m'est impossible de vous répondre au jour près.

M. Moscovici a affirmé que vous aviez vous-même suggéré une extension à la période de 2006 à 2009 lors de la fameuse réunion du 16 janvier à laquelle vous ne vous souvenez plus avoir participé. Ce serait cohérent. Si vous n'avez pas participé à cette réunion, la question soulevée par Mme Untermaier se pose : à quel moment avez-vous donné votre accord et à qui ?
À qui : à mes avocats suisses. À quel moment : entre le 16 et le 24 janvier – date que vous avez indiquée être celle de l'envoi de la demande – probablement autour du 20. C'est non pas un souvenir, mais une déduction.

Vos avocats vous ont-ils appelé pour vous demander votre accord ? Ou bien l'avez-vous donné directement soit à M. Bézard, soit à M. Moscovici ?
Quel que soit l'intérêt que pouvait avoir alors cette question pour moi – il était grand –, quelle que soit la connaissance que je pouvais avoir de la convention fiscale franco-suisse, je vous assure que j'ignorais totalement ces subtilités juridiques avant d'être directement concerné. Qui, à l'époque, savait que la réponse des parties au traité était obligatoire pour la période postérieure au 1er janvier 2010, tandis qu'il était nécessaire, pour la période antérieure, de recueillir au préalable l'accord de la personne concernée ? Ces points relèvent d'une telle précision technique que chacun d'entre vous peut admettre que le ministre délégué chargé du budget les ignorait alors, quand bien même ils le concernaient directement.
Dès lors, ce n'est évidemment pas moi qui, d'emblée, serais allé trouver je ne sais qui, à je ne sais quelle occasion, pour demander d'étendre la période sur laquelle portait la demande. J'y insiste : je n'ai aucun souvenir d'une réunion au cours de laquelle j'aurais suggéré une telle extension, tout simplement parce que j'ignorais alors que mon accord était nécessaire pour ce faire. Ce sont mes avocats suisses qui m'ont informé de ces subtilités.

Vous avez affirmé que vos avocats et vous-même ignoriez que la lettre avait été envoyée le 24 janvier. Comment vos avocats ont-ils pu donner un accord alors qu'ils ne connaissaient pas le contenu de la saisine ? Vous avez dû donner un accord, dites-vous, entre le 16 – date de la fameuse réunion à l'Élysée – et le 24 janvier – date d'envoi de la lettre, qui comprenait un paragraphe relatif à la période de 2006 à 2009. Dans leur lettre – qui n'est pas d'une lecture aisée –, les autorités suisses rappellent que vos avocats ont donné un accord, ce qui leur a permis de répondre également pour cette période. D'où l'importance de la question soulevée par Mme Untermaier. Entre le 16 et le 24 janvier, vous saviez donc bien ce qui se préparait, alors même que la lettre n'avait pas encore été envoyée.
J'ignorais ce qui se préparait dans le détail que vous avez indiqué, monsieur le président. Je n'ai été au courant de quelque chose que parce que mes avocats suisses m'en ont informé. Je l'ai dit au cours de ma première audition et le maintiens. Vous êtes libres de me croire ou non, mais c'est ainsi.
En réalité, la demande d'entraide administrative a dû être précédée de contacts. Sinon, comment expliquer qu'une demande d'entraide administrative adressée le 24 janvier ait reçu une réponse dès le 31, c'est-à-dire dans un délai record, alors même que le taux de succès de ces démarches est particulièrement faible – 6,5 % de réponses, dont très peu sont exploitables ?
Je pense donc que des contacts préalables ont été pris. Il me semble d'ailleurs que M. Moscovici vous a lui-même indiqué avoir sensibilisé l'administration suisse. Il paraît plausible que l'administration suisse ait alors informé UBS qu'elle aiderait son homologue française et qu'UBS ait elle-même indiqué à mes avocats ce qu'il en était. Je ne dispose pas d'informations avérées à ce sujet : ce sont des déductions qu'il vous appartient de vérifier auprès des personnes concernées. Mais c'est la seule façon d'expliquer, d'une part, que j'aie pu être informé de cette demande par mes avocats et, d'autre part, que cette demande ait pu comporter une question à laquelle il ne pouvait être répondu sans mon accord préalable.
Bien entendu. Je me souviens effectivement de ce contact. Je puis même vous préciser que mes avocats suisses étaient d'avis de ne pas donner de réponse favorable à cette demande d'extension de la période pour ne pas créer de précédent. Je leur ai indiqué que je souhaitais, pour ma part, y répondre favorablement. Ils en ont pris acte et ont agi en conséquence.

Comme membres de cette Commission d'enquête, nous exerçons une fonction de contrôle du pouvoir exécutif et nous nous efforçons de faciliter la manifestation de la vérité. Or, nous nous heurtons aujourd'hui à un mur, celui des incohérences de M. Cahuzac, qui troublent jusque dans les rangs de la majorité. Incohérence d'abord entre la version de M. Cahuzac et celle de M. Moscovici : ce dernier a évoqué l'échange du 16 janvier à quatre reprises au cours de son audition, avec force précisions, notamment de date et de lieu. Incohérence ensuite entre les différentes versions de M. Cahuzac lui-même. Le 26 juin, évoquant la demande d'entraide administrative adressée aux autorités suisses, vous avez affirmé, monsieur Cahuzac : « M. Pierre Moscovici ne m'a jamais informé de cette procédure. » Aujourd'hui, vous vous réfugiez derrière cette amnésie d'autant plus troublante que nous nous souvenons de l'extrême précision de vos propos et des chiffres que vous citiez lorsque, ministre délégué chargé du budget, vous présentiez, sans notes, les projets de loi de finances.
Je formule deux suggestions pour la suite de nos travaux, monsieur le président. La première option est d'auditionner – je le souhaite ardemment – le Premier ministre. M. Moscovici a en effet affirmé que, outre le Président de la République, M. Cahuzac et lui-même, le Premier ministre avait participé à l'échange du 16 janvier. La deuxième option est d'auditionner M. Pierre-René Lemas, qui a pu assister à cet échange et pourrait contribuer utilement à la manifestation de la vérité. En effet, le secrétaire général de la Présidence de la République assiste aux débats du Conseil des ministres et il est d'usage qu'il suive le Président de la République dans le salon Murat, à la sortie du Conseil. En revanche, je ne propose pas que la Commission auditionne à nouveau M. Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président de la République, que nous avons entendu à propos des faits survenus le 15 décembre et qui nous a indiqué ne plus s'être occupé de l'affaire Cahuzac par la suite.
Je tenais à faire ce commentaire publiquement.

Votre question s'adresse en effet non pas à M. Cahuzac, mais au président, au rapporteur et aux membres de la Commission.

Je ne participerai pas à la curée, monsieur le ministre. Le tambour de la machine à laver doit tourner à fond depuis des mois. Mais les Français méritaient mieux. Au cours de votre première audition, vous vous êtes drapé dans le secret de l'instruction. Aujourd'hui, vous faites des réponses d'une dialectique redoutable : ni « oui », ni « non », mais « je ne me souviens pas ». Par respect non pas tant pour les parlementaires que pour les citoyens que vous avez servis pendant des années en tant que responsable politique, vous auriez dû faire preuve de transparence, au moins sur certains sujets. Nous ne vous demandons pas de vous livrer à un exercice de psychothérapie publique ! Vous êtes d'ailleurs conscient des dégâts considérables causés par cette affaire – comme par d'autres – à la démocratie française.
Je reviens sur un seul point. Vous avez indiqué avoir procédé en deux temps pour obtenir une attestation négative de la banque UBS : vos conseils ont posé d'abord une question d'ordre général, puis une question vous concernant. On voit bien la manoeuvre : vous avez pris la température afin d'être sûr de ne pas rencontrer de problème. Mais vos conseils ne vous ont-ils jamais proposé, pour régler cette affaire, de formuler la question de façon positive ? Si vous aviez posé à UBS non pas la question « Pouvez-vous confirmer que je n'ai pas de compte chez vous ? », mais « Pouvez-vous confirmer que nous avons une relation d'affaires ? », elle aurait été en devoir de répondre et sa réponse aurait été exploitable par les services de l'État. Tout le monde s'accorde sur ce point. Or, on a le sentiment que vous vous êtes organisé, pendant toute cette période, pour que la vérité ne soit jamais dévoilée – elle finit pourtant toujours par éclater – et pour que l'exécutif lui-même – j'ai encore la naïveté de penser que le Président de la République et le Premier ministre ont eu confiance dans vos propos, jusqu'à preuve du contraire – ne la découvre pas. Qu'en est-il exactement ?
J'ai été sensible, monsieur le ministre, à vos premiers mots, même si je ne réclame ni compassion ni pitié. Ce qui je vis est perceptible par chacune et chacun d'entre vous, mais cela ne regarde que moi et je m'efforce d'y faire face.
La question que vous posez appelle une réponse assez simple : j'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir cette attestation négative en décembre, par mes propres moyens. J'ignore ce qu'aurait été la suite si je l'avais effectivement obtenue, mais je formais à l'époque l'espoir que les choses s'arrêteraient là. Vous affirmez que la vérité aurait fini par éclater de toute façon et vous avez probablement raison. Le choix que j'ai fait de mentir au Président de la République, au Premier ministre, puis à la représentation nationale a été catastrophique, non seulement sur le plan personnel, mais de manière générale. J'en paie aujourd'hui le prix – il est très élevé – et j'essaie de le faire le plus dignement possible.
J'aurais aimé avoir cette attestation négative. À un moment, mes conseils m'ont assuré être près de l'obtenir, et je pense qu'ils disaient la vérité. En définitive, la banque a refusé, probablement pour se protéger, pour ne pas se compromettre dans une opération qui aurait abouti à exonérer un responsable public d'une faute très grave qu'il avait pu commettre. Elle a sans doute fait, à l'époque, le même raisonnement que vous : la vérité finirait par éclater.
Quant à savoir si la question était bien ou mal posée, j'ai déjà donné mon sentiment à ce sujet tout à l'heure. Certains concluent ce débat juridique, intéressant en soi, de manière trop rapide et peu satisfaisante. Je ne crois pas que la formulation que vous suggérez aurait permis d'obtenir de la banque des éléments permettant de sortir de cette crise. Je suis même convaincu du contraire. Vous avez bien sûr le droit d'avoir un avis différent.
Mais la question que vous posez est plutôt celle-là : ai-je tenté bien sincèrement, en décembre, d'obtenir par mes propres moyens une attestation négative de la banque UBS ? Oui, tel est bien le cas. De son côté, l'administration fiscale a reçu une réponse partiellement négative par la voie de l'entraide administrative. Le document que j'aurais pu obtenir à ce moment-là par mes propres moyens n'en aurait évidemment pas différé quant au fond.

Le ministre de l'économie et des finances a évoqué devant nous l'irritation, voire la colère qui a été la sienne après la parution de l'article du Journal du dimanche. Vous en a-t-il fait part à ce moment-là ? Avez-vous évoqué cet article avec lui ? Si oui, que vous a-t-il dit ?
Il a été en effet agacé par la parution de cet article, car il s'était, je crois, engagé auprès de son homologue suisse à ce que la réponse qu'apporterait la banque UBS ne fasse l'objet d'aucune publication. C'était peut-être une des conditions posées par l'administration suisse pour peser de tout son poids dans la procédure, afin d'obtenir une réponse d'UBS. C'était également une condition – M. Moscovici faisait un raisonnement judicieux sur ce point – pour que l'administration suisse coopère de manière tout aussi rapide et efficace à l'avenir, si d'autres questions de cette nature venaient à se poser. La parution de l'article violait donc en quelque sorte un engagement pris par M. Moscovici auprès de son homologue suisse et compromettait d'éventuelles démarches ultérieures. Sa colère était donc légitime pour ces deux motifs. Je lui ai donné raison et l'ai assuré que je n'étais pour rien dans cette publication. Et, ce jour-là, je ne lui ai pas menti.
En effet, il vous l'a dit lui-même. Je lui en ai probablement parlé par téléphone. Je lui ai également dit qu'il ne fallait pas en faire état, que tel n'était pas mon intérêt. Stéphane Fouks et moi avons des relations d'amitié très anciennes et très sincères. Je n'imagine pas qu'il ait pu faire quoi que ce soit qui se serait avéré préjudiciable pour moi. Je suis convaincu que ce n'est pas lui qui a communiqué l'information au Journal du dimanche. Je le répète : je n'ai été pour rien dans cette publication.

Si ce n'est pas vous, directement ou indirectement, ni M. Moscovici, ni M. Bézard, qui est-ce ?
Je ne peux parler que pour moi, monsieur le président. Quoi qu'il en soit, je n'y avais, objectivement, pas intérêt.

Lorsqu'il a évoqué les raisons de sa colère devant nous, M. Moscovici n'a pas évoqué les relations avec la Suisse : il a estimé que la parution de cet article risquait de paraître exercer une forme de pression sur la justice. Vous a-t-il également fait part de son irritation sous cet angle ?
Je me souviens que M. Moscovici a évoqué deux arguments, tous deux très judicieux : l'engagement qu'il avait pris n'était pas respecté ; cela pouvait compromettre des procédures ultérieures. Quant à l'argument que vous évoquez, il me semble que les temps où la parution d'un article de presse pouvait exercer une pression sur un procureur ou sur un juge sont désormais révolus.

Au cours de votre première audition, vous avez fait état d'une conversation avec M. Woerth, qui serait intervenue après la séance des questions au Gouvernement au cours de laquelle vous avez été interrogé par M. Fasquelle, c'est-à-dire le mercredi 5 décembre. Pour sa part, Mme Chaffanjon parle d'un contact entre M. Woerth et vous-même le lundi 3 décembre. Ce n'est pas tout à fait la même chose : le lundi 3 décembre, c'est le jour où votre conseillère chargée de la communication vous a remis, au banc des ministres, les questions que Mediapart souhaitait vous poser – elle nous l'a indiqué ce matin. Il semble que vous avez déchiré ce document. Dans son ouvrage, Mme Chaffanjon écrit que vous avez alors cherché M. Woerth du regard et que vous êtes allé le voir tout de suite après. Pourriez-vous préciser la chronologie des faits et nous indiquer pourquoi vous êtes allé trouver M. Woerth immédiatement après avoir pris connaissance de ces questions ?
C'est là une des très nombreuses inexactitudes ou erreurs patentes que contient le livre de Mme Chaffanjon. Pour quelle raison souhaitais-je parler à M. Woerth ? Parce que les journalistes de Mediapart m'avaient indiqué que M. Woerth avait reçu, en 2008 ou en 2009, un courrier l'informant que je détenais un compte non déclaré à l'étranger.
La théorie selon laquelle j'aurais commandé une étude juridique de complaisance pour aider M. Woerth à sortir indemne de l'affaire de l'hippodrome de Compiègne afin de le remercier d'avoir étouffé je ne sais quelle enquête me concernant lorsqu'il était lui-même ministre du budget, est une construction de Mediapart. Le mardi 4 décembre au matin, les journalistes de Mediapart me l'ont exposée dans ses grandes lignes – ils le feront de manière plus précise ultérieurement – et ont évoqué, à l'appui, le courrier qu'aurait reçu M. Woerth. Ce sont les journalistes qui m'ont informé oralement, à ce moment-là, de la possible existence d'un tel courrier. J'ignorais donc totalement cet élément le lundi 3 décembre. Mme Chaffanjon fait une erreur d'au moins vingt-quatre heures.

Vous affirmez donc trois choses. Premièrement, que le courriel que vous a adressé Mediapart le 3 décembre ne comportait pas la question suivante : « Avez-vous été informé du fait que l'existence de ce compte ait été portée à la connaissance de votre prédécesseur, Éric Woerth, en juin 2008 ? » Deuxièmement, que les journalistes de Mediapart vous ont appris la possible existence de ce courrier le 4 décembre. Troisièmement, que vous avez eu une conversation avec M. Woerth après la séance des questions au Gouvernement le 5 décembre.
Je suis certain d'une chose : je suis allé voir M. Woerth le mardi 4 ou le mercredi 5 décembre pour lui demander s'il avait été informé par un courrier que j'aurais détenu un compte non déclaré à l'étranger. Il m'a répondu qu'il n'avait pas reçu de courrier de cette nature ; ce fait n'est contesté par personne.
La possible existence dudit courrier a-t-elle été mentionnée dans le courriel que m'a envoyé Mediapart le lundi 3 décembre ou les journalistes m'en ont-ils informé oralement le 4 ? Dans mon souvenir, ils m'en ont informé oralement le 4. J'ai reçu le courriel du 3 décembre sur mon téléphone portable personnel avant même qu'il ne me soit remis sous forme imprimée par Mme Marion Bougeard. Je ne me souviens pas si les journalistes de Mediapart m'y interrogeaient déjà à ce sujet. Je n'ai pas gardé ce courriel. Je ne suis pas sûr que cela change grand-chose à l'affaire.

J'ignore si cela change quelque chose à l'affaire, mais il s'agit de savoir si M. Woerth a été la première personnalité politique avec laquelle vous avez discuté de l'éventuelle existence de votre compte à l'étranger. Cet élément est susceptible d'éclairer la Commission d'enquête.
Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Je conçois en effet que cela puisse intéresser votre Commission.
Je comprends bien. Dans mon souvenir, c'est le mardi 4 décembre que M. Arfi m'a indiqué que M. Woerth avait reçu le courrier en question. Je ne doute pas que les journalistes de Mediapart aient conservé un double du courriel qu'ils m'ont adressé. Nous pouvons donc connaître la réponse assez vite.

Sur ce point, les faits sont très précis. Le courriel du 3 décembre comportait la question suivante : « Avez-vous été informé du fait que l'existence de ce compte ait été portée à la connaissance de votre prédécesseur, Éric Woerth, en juin 2008 ? » La question visait peut-être le rapport de l'inspecteur Garnier daté du 11 juin 2008, qui mentionnait en effet l'existence d'un compte. Nous savons désormais que le rapport est remonté à la DGFIP, mais pas jusqu'au niveau du directeur général : l'actuel et le précédent nous ont affirmé n'en avoir jamais eu connaissance. La directrice de cabinet nous a indiqué avoir découvert son existence par l'article de Mediapart et l'avoir fait remonter à son bureau le lendemain. M. Woerth n'a donc jamais eu ce document en sa possession, et la réponse qu'il a faite à M. Cahuzac me paraît crédible au regard de ce que nous savons aujourd'hui concernant M. Garnier.
Si M. Arfi m'a posé, dans le courriel du 3 décembre, la question que vous avez lue, il est possible que je sois entré en contact avec M. Woerth dès cette date. Dans mon souvenir toutefois, c'est après une séance de questions au Gouvernement. Néanmoins, je retire l'appréciation que j'ai portée sur cette affirmation de Mme Chaffanjon. Dont acte. Cependant, il y a d'autres inexactitudes.

Il est donc possible que M. Woerth soit la première personnalité politique avec laquelle vous ayez échangé quelques mots sur cette affaire.

Je rappelle que la Commission a décidé, à la majorité, de ne pas auditionner M. Woerth. Elle peut néanmoins changer d'avis.

Vous avez dit avoir tout fait pour obtenir une attestation négative de la banque UBS. Dans le même temps, vous avez souhaité que la demande d'entraide administrative porte sur la période la plus large possible. Quels étaient l'objectif et l'intérêt pour vous d'une telle extension ?
J'étais accusé d'avoir détenu un compte à UBS et de l'avoir fermé en février 2010. Cette affirmation a d'ailleurs été reprise comme un fait acquis par certains d'entre vous, notamment par le président de la Commission, lors des premières auditions. La preuve a pourtant été apportée que je n'ai pas détenu de compte à UBS entre le 1er janvier 2006 et janvier 2013. Je n'ai donc pas pu fermer de compte à UBS en février 2010. Au moins une des accusations de Mediapart a donc volé en éclats. En tentant d'obtenir une attestation négative, je pouvais donc avoir cet objectif-là : prouver qu'une des affirmations catégoriques de Mediapart était erronée. C'est d'ailleurs ce que la réponse à la demande d'entraide administrative a fini par montrer.

Je fais écho aux propos de MM. Fenech et Houillon. Au cours d'une interview sur BFMTV, vous avez employé une formule désormais célèbre : la « part d'ombre » qu'il y aurait en tout homme. Au terme de cette deuxième audition, qui a duré deux heures, estimez-vous avoir levé votre part d'ombre devant la Commission d'enquête ?

Vous venez de confirmer à l'instant que vous n'avez pas détenu de compte à UBS entre 2006 et 2009. La réponse à la question de l'administration fiscale – que vous avez estimée bien posée – indique également que vous n'avez pas été ayant droit d'un compte à UBS au cours de la même période. La banque Reyl n'étant pas constituée sous forme de banque en Suisse avant le 1er janvier 2010, vous n'y avez pas détenu de compte non plus. Donc, si l'administration fiscale avait posé la question « M. Cahuzac a-t-il détenu ou été l'ayant droit économique d'un compte à UBS ou à la banque Reyl », elle aurait obtenu la même réponse que celle qu'elle a effectivement reçue. Est-ce bien exact ?
Je corrige une erreur de date : je n'ai pas détenu de compte à UBS entre 2006 et janvier 2013, et non seulement 2009. Le résultat de la procédure d'entraide administrative a été très clair sur ce point. Cette information étant publique, je peux d'ailleurs la confirmer. Me « réfugier » derrière la procédure judiciaire – pour reprendre l'expression de certains d'entre vous – serait absurde, et même déloyal à votre égard. Je ne le ferai donc pas.
Pour le reste, monsieur le député, au risque d'encourir la colère ou de causer la déception de certains de vos collègues – ce que je déplore –, je m'en tiendrai là : la chronologie et les éléments importants ou décisifs relèvent du champ de la procédure judiciaire. Par avance, je vous demande d'être compréhensif.

Il vous serait pourtant tellement simple, monsieur Cahuzac, de nous indiquer la date à laquelle vous avez ouvert un compte à UBS – sans doute au début des années 1990 – et celle à laquelle vous l'avez fermé pour le transférer à la banque Reyl, puis, semble-t-il, à Singapour ! Nous comprendrions alors pourquoi les mécanismes prévus par la convention fiscale franco-suisse n'ont pas fonctionné. Tel était l'esprit de la question de M. Germain. Je répète ce que j'ai dit en introduction : rien ne vous empêche de communiquer ces informations à la Commission. Je vous pose donc pour la dernière fois la même question : pouvez-vous nous indiquer ces deux dates ?
Je comprends bien l'intérêt qu'aurait la connaissance de ces dates pour apprécier la pertinence des termes de la convention fiscale. Cependant, tel n'est pas, me semble-t-il, l'objet de votre Commission d'enquête, qui consiste à établir l'existence d'éventuels dysfonctionnements dans l'action des services de l'État. La procédure judiciaire suit son cours et elle finira par être publique : un procès aura lieu au cours duquel tout sera dit. Les éléments qui seront portés à la connaissance des parlementaires à ce moment-là pourraient en effet permettre d'améliorer très utilement non seulement la convention fiscale franco-suisse, mais encore celles qui lient la France à de nombreux autres États.

Je m'adresse non pas à M. Cahuzac, mais aux membres de la Commission. M. Houillon nous a fait part de son sentiment ; il y a en effet matière à débat pour notre Commission. Pour ma part, j'ai l'intime conviction que l'entrevue mentionnée par M. Moscovici a bien eu lieu dans les conditions qu'il nous a décrites hier, même si j'entends que M. Cahuzac ne s'en souvient pas. Selon moi, au cours de cette entrevue, M. Moscovici a en quelque sorte demandé le feu vert pour engager la procédure d'entraide fiscale.
Je l'ai toujours dit très clairement depuis le début des auditions : jamais je n'ai eu le sentiment que l'État a cherché à égarer la justice ou à l'empêcher de fonctionner. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point : à partir du moment où la justice a été saisie, elle a travaillé sans entrave. C'est un acquis important.
Cependant, nous devons encore répondre à deux questions : qui est à l'origine de l'article du Journal du dimanche ? La participation de M. Cahuzac à l'entrevue du 16 janvier pose-t-elle un problème au regard de la « muraille de Chine » ? Ces deux points méritent réflexion. Nous pourrions en discuter demain au cours d'une réunion de travail.
Je me permets de réagir aux propos du rapporteur. S'agissant de la discordance entre les souvenirs de M. Moscovici et les miens sur l'échange qui aurait eu lieu entre le Président de la République, le Premier ministre, lui et moi, j'aimerais tenter de vous convaincre, si c'est encore possible. L'un d'entre vous a dit que je refusais de reconnaître l'existence de cet entretien au motif que je souhaiterais protéger le Président de la République, le Premier ministre ou je ne sais qui encore. Mais, dès lors que M. Moscovici a lui-même reconnu l'existence de cet entretien, qui aurais-je à protéger ? Personne, absolument personne.
Au nom de quoi devrais-je me protéger ? Si j'ai participé à cette réunion ou à cet entretien dont je n'ai aucun souvenir, la faute n'est pas la mienne, mais celle des personnes qui m'ont associé à un processus décisionnel auquel je n'avais pas à l'être. En l'espèce, ce n'est donc pas moi qui serais à protéger. J'espère que certains d'entre vous au moins auront un doute, voire me croiront : je n'ai aucun, absolument aucun souvenir d'un échange qui aurait réuni le Président de la République, le Premier ministre, M. Moscovici et moi-même à la sortie du Conseil des ministres.
Comme plusieurs d'entre vous, j'ai été interpellé par la précision de la description faite par M. Moscovici. Je crois infiniment probable, pour ne pas dire certain, qu'il a eu un échange à ce sujet avec le Président de la République et le Premier ministre. Je crois également très probable que la décision d'engager la procédure d'entraide administrative a été prise à l'Élysée ou à Matignon, davantage qu'au ministère de l'économie et des finances. D'autres que moi sont plus qualifiés pour le dire, puisque je n'ai pas été associé, par définition, à ce processus décisionnel.
Si j'avais le souvenir de cet entretien, je ne vois pas ce qui m'empêcherait de le dire. Il est même probable que cette audition aurait duré moins longtemps et que certains seraient moins irrités contre moi. Si je dis ne pas en avoir le souvenir, c'est que je n'en ai pas le souvenir. C'est ainsi. Évidemment, comme j'ai nié avec tant de force ce que j'ai fini par reconnaître, chacun peut nourrir des doutes lorsque je nie à nouveau avec toute la force que je peux, mais cette fois-ci en conscience, avoir le souvenir de cet entretien. Il revient à chacun d'entre vous, mesdames, messieurs les députés, de se faire son opinion.

Au cours de votre première audition, vous avez affirmé : « M. Pierre Moscovici ne m'a jamais informé de cette procédure. » Quant à vos pertes de mémoire, elles sont peu crédibles : pendant plusieurs années, vous avez donné des preuves de votre très bonne mémoire en commission des finances. Que chacun se fasse, en conscience, son opinion. Comme l'ont évoqué deux de nos collègues, seule une audition du Premier ministre permettrait de vous départager, M. Moscovici et vous.
Monsieur le président, je ne conteste pas les affirmations de M. Moscovici : je dis que je n'ai pas le souvenir de cet échange.
Vous faites référence aux qualités de mémoire que j'ai pu avoir. Cependant, la période que je viens de vivre n'a pas été totalement anodine. Si les facultés auxquelles vous rendez hommage se sont émoussées, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur.

Je me suis engagé devant la Commission, vous le savez, à utiliser l'un des rares pouvoirs dont je dispose et dont aucun président de commission d'enquête ne s'est servi jusqu'à présent : celui de saisir la justice si je prenais l'une des personnes auditionnées en flagrant délit de mensonge. Or, effectivement, vous n'avez pas menti – et M. Moscovici non plus – : vous avez dit que vous ne vous souveniez pas. La règle ne peut donc pas s'appliquer.

J'interviens d'autant plus volontiers que je ne fais pas partie de ceux qui ont dit que M. Cahuzac souhaitait protéger M. Moscovici. Dès lors que M. Moscovici a indiqué que la réunion du 16 janvier avait eu lieu, il n'y a évidemment plus aucune raison de nier son existence. Cependant, je rappelle un simple élément de chronologie : la première audition de M. Cahuzac s'est tenue avant celle de M. Moscovici. Je ne suis donc pas totalement convaincu par l'argumentation de M. Cahuzac, même si je ne conteste pas a priori sa bonne foi.
Monsieur le député, si les propos de M. Moscovici – dont j'ai évidemment eu connaissance avant la présente audition – avaient revitalisé la mémoire qui me fait défaut, je vous l'aurais dit et me serais excusé de ne pas avoir eu ce souvenir lors de la première audition. La chose aurait été réglée très simplement et je ne pense pas, d'ailleurs, que le président de la Commission ni quiconque m'en aurait tenu rigueur. Je le répète : les événements n'ont pas tous marqué ma mémoire, la période ayant été assez éprouvante pour moi. Chacun, je crois, peut l'admettre, même si je ne sollicite ni compassion ni pitié. Si je vous répète que je n'ai pas le souvenir de cette réunion, c'est que je n'en ai pas le souvenir. C'est ainsi.