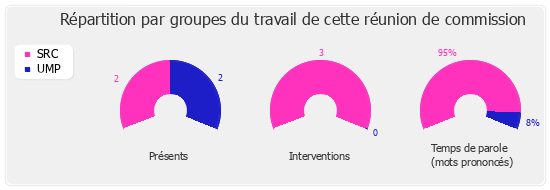Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
Réunion du 15 novembre 2012 à 9h30
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
MISSION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Jeudi 15 novembre 2012
La séance est ouverte à neuf heures trente.
(Présidence de MM. Jean-Marc Germain et Pierre Morange, coprésidents de la mission)
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a procédé à la nomination de M. Jérôme Guedj rapporteur sur le financement de la branche famille et à celle de M. Jean-Pierre Door rapporteur sur la mutualité et la gestion de l'assurance maladie.
Elle a ensuite procédé à l'audition, ouverte à la presse, de M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille, et Mme Élizabeth Le Hot, secrétaire générale.

Nous avons le plaisir d'accueillir M. Bertrand Fragonard, président délégué du Haut Conseil de la famille (HCF), et Mme Élisabeth Le Hot, secrétaire générale, dans le cadre de nos travaux sur le financement de la branche famille.
La Cour des comptes nous a transmis un premier rapport sur le sujet, faisant le constat d'un déficit structurel de la branche et d'une fiscalisation croissante de son financement. Elle nous communiquera un rapport définitif au vu des commandes complémentaires que nous lui passerons.
Quelle est votre analyse du déficit actuel ? Estimez-vous, comme la Cour, qu'il est structurel ? Quelles en sont les causes ? Comment pourrait évoluer la branche, tant en termes de dépenses que de recettes ? Quelle est votre position au sujet du grand débat sur le financement de la sécurité sociale ?
Je rappelle que deux séries de réflexions sont en cours. La première concerne la compétitivité du pays – qui a donné lieu à l'annonce d'un crédit d'impôt compétitivité emploi de 20 milliards d'euros assis sur la masse salariale inférieure à 2,5 SMIC et dont le Président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'elle n'interfère pas dans les discussions avec les partenaires sociaux sur la sécurité sociale, même si les deux peuvent converger. D'où la question de savoir comment rendre le prélèvement social le plus neutre possible à cet égard. La seconde série de réflexions engagées porte sur les financements les plus adaptés à la nature des prestations, sachant que le caractère universel de celles-ci a justifié leur fiscalisation croissante – ce qui suscite la crainte récurrente des partenaires sociaux de voir ainsi réduire leur légitimité à intervenir dans le débat, voire dans la gestion des organismes.
Plusieurs démarches s'imbriquent, qui compliquent le calendrier : les premières mesures prises à la suite du rapport remis par M. Louis Gallois, la commande du Premier ministre au Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui doit rendre ses conclusions début mars, les travaux de la MECSS et le rapport que la Cour des comptes doit également nous remettre en mars.

Quelles sont vos réflexions pour améliorer le rapport coût-efficacité de la branche ? Je rappelle que le Président de la République, lors de sa dernière conférence de presse, a évoqué la nécessité d'un effort budgétaire à hauteur de 12 milliards d'euros par an pour l'État, le système de protection sociale et les collectivités territoriales, et que de nombreux rapports ont été réalisés sur ce sujet, notamment celui de notre ancien collègue Yves Bur, qui a plaidé pour une assiette de prélèvement plus large et une rationalisation des dépenses, dans le respect des principes d'universalité et de solidarité des prestations.
Je m'exprimerai à titre personnel, le HCF n'ayant jamais traité des recettes. D'abord, ses réflexions ont été bloquées par le « rapport Bur », qui, à ma connaissance, n'a jamais été publié. Puis le décret régissant le HCF a été modifié et l'analyse de cet aspect a été supprimée de ses attributions, qui portent essentiellement sur l'équilibre financier de la branche.
De plus, sur beaucoup de points, je ne suis pas en phase avec les préoccupations d'une partie de ses membres, notamment sur le caractère pérenne et la nature des recettes.
En effet, le problème principal est moins la nature de celles-ci que leur niveau. La question essentielle est de savoir combien l'État veut affecter à la branche.
En ce qui concerne l'équilibre financier, nous avons réalisé en septembre 2010 un rapport sur son évolution jusqu'en 2025. Mais nous allons devoir le revoir pour tenir compte des travaux en cours, notamment les vôtres : nous pourrons vous transmettre la version définitive probablement en février prochain.
Cet exercice est en effet assez simple : la branche n'est pas compliquée et repose sur une évolution lente, dépendant du taux de natalité – dont l'effet se diffuse sur vingt ans –, de l'écart entre les salaires et les prix et du dynamisme général de l'économie.
Nous garderons l'échéance de 2025 : nous avons en effet retenu cette date parce que nous souhaitons qu'au-delà de la période de déficit dans laquelle nous sommes engagés, nous puissions prendre en compte celle du retour à l'équilibre – vers 2017-2018 – puis à l'excédent de la branche. Selon nos estimations, celui-ci devait s'élever à 7 milliards d'euros à cette échéance. Or je suis convaincu que si nous sortons de la crise, nous aurons toujours un excédent en 2025.
A contrario, une approche limitée à l'échéance de 2017 ou 2018 ferait seulement apparaître un déficit, incitant ainsi à s'interroger sur une réduction de dépenses – alors que si l'on montre que la branche connaîtra un excédent, la question principale devient : que fait-on de celui-ci ? Le laisse-t-on à la branche ou non ?
Celle-ci est en effet structurellement faite pour créer de l'excédent : à cet égard, la communication de la Cour n'est peut-être pas aussi pertinente qu'on pourrait le penser. Sans doute cela est-il lié à ce qu'elle a retenu un horizon de temps trop court.
De fait, les prestations évoluent globalement comme les prix alors que les recettes progressent plutôt comme le produit intérieur brut (PIB), dont le taux est tendanciellement supérieur à celui des prix de 1,5 à 2 points par an. De plus, le nombre de familles nombreuses diminue, ce qui, dans le système progressif que nous avons, favorise les excédents : si nous n'avions que des familles d'un enfant, nous n'aurions d'ailleurs plus d'allocations familiales ! En outre, quand le revenu global des ménages augmente d'un point plus vite que les prix, on perd des allocataires – que ce soit pour l'allocation de rentrée scolaire (ARS), le complément familial (CF) ou les aides au logement – dans la mesure où les plafonds sous lesquels on sert les prestations sous conditions de ressources évoluent comme l'inflation.
Seul un rebond de la natalité pourrait nous écarter de cette trajectoire excédentaire : si le nombre annuel de naissances passait de 830 000 à 850 000 ou 900 000, on assisterait à une nette augmentation des dépenses les trois premières années – du fait de l'importance de nos prestations liées à l'accueil du jeune enfant –, qui se diffuserait ensuite au cours des quinze années suivantes. C'est la raison pour laquelle nous établissons nos prévisions à partir du scénario central de l'INSEE en prévoyant un certain nombre de variantes, selon qu'on aurait 10 000 naissances de plus ou de moins. On ne peut guère anticiper des ruptures brutales sur ce point.
Cela dit, des erreurs sont possibles. En 1993-1994, nous avions aussi établi notre cadrage en fonction des prévisions de l'INSEE, qui anticipait 710 000 naissances : or, à peine avons-nous voté la loi relative à la famille du 25 juillet 1994 que celles-ci se sont accrues, passant de 720 000 en 1993 à 830 000 aujourd'hui.
J'aurais aimé demander aux membres du HCF ce qu'ils souhaiteraient faire de l'excédent prévu : leur position est a priori de le garder, ce qui, comme je leur ai dit, est un pari aléatoire. Si la situation financière de la protection sociale n'est pas bonne, qu'on n'arrive pas à mieux maîtriser les dépenses d'assurance maladie et qu'on décide d'aider davantage les personnes dépendantes ou pauvres, il est possible que ce surplus soit redéployé. Cela pourrait se traduire notamment par le fait de transférer à la branche le financement du congé de maternité, comme c'est déjà le cas pour le congé de paternité.
On a ainsi transféré en 2000, sous le gouvernement de Lionel Jospin, les charges de retraite du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sur la branche famille à hauteur de 4,5 milliards d'euros. Cela a scandalisé les associations familiales, qui y ont vu un moyen de neutraliser l'excédent potentiel de la branche. Aucun gouvernement n'est revenu sur ce transfert.
La question, dès lors, est de savoir si, compte tenu de ce potentiel financier, nous faisons le meilleur emploi de nos fonds – en situation de crise, mais aussi en période d'excédent.
Je rappelle que lorsqu'on est en excédent, on appauvrit en termes relatifs les familles par rapport au seuil de pauvreté ou au revenu médian, les prestations et les plafonds étant indexés sur les prix. Cette règle d'indexation ne me paraît pas optimale, dans la mesure où elle traite tout le monde de la même façon : pour une famille de deux enfants, la non-indexation des allocations familiales sur les salaires fait perdre globalement 1,5 point par an en termes de richesse relative, soit quelques euros chaque année ou 15 à 20 euros au bout de quatre à cinq ans ; alors que, pour une famille de trois ou quatre enfants, disposant d'un revenu primaire plus bas que la moyenne, plus exposée au chômage, avec un taux d'activité féminine plus faible, les prestations familiales et de logement représentant 40 % du revenu global, la perte est de quelques dizaines d'euros par an. Ce faisant, on tend à désarmer les familles nombreuses à revenu moyen ou modeste que l'on veut précisément protéger.
Cette indexation sur les prix, qui a été imposée à la branche depuis l'origine, a été pratiquée par tous les gouvernements, ce qui a pour conséquence de réduire au fil du temps l'efficacité de la politique familiale. J'ai donc proposé que l'on réfléchisse à une modification de la structure de cette politique : cela serait d'autant plus justifié si la contrainte financière était plus durable que prévu.
Je ne pense pas à cet égard qu'on augmentera les recettes de la branche à long terme : je crois même qu'on la diminuera – sous la forme du prélèvement de l'excédent que j'ai évoqué.
Nous n'avons pas réussi à avoir une réponse unanime au sein du HCF à ce sujet, car les syndicats et l'Union nationale des associations familiales (UNAF) n'ont pas voulu réfléchir à des hypothèses qu'ils rejettent par principe, souhaitant au contraire la sécurisation, voire l'accroissement des recettes.
Il nous faudrait travailler sous contrainte et que le Gouvernement dise au HCF de lui préciser comment il souhaite rétablir l'équilibre à l'horizon 2017 et ce qu'il ferait si les recettes n'augmentaient pas, sans allégement des charges indues, notamment le FSV. Or le président de l'UNAF voudrait au contraire que l'on sorte les charges de ce dernier de la branche famille pour avoir une politique familiale dynamique et revenir ainsi sur le péché capital que constitue l'indexation durable des prestations sur les prix.
En 2010, nous avons fait nos projections à recettes constantes : nous ferons a priori de même pour notre prochain exercice prospectif.

Avez-vous fait des simulations dans l'hypothèse où les prestations seraient indexées sur les salaires ?
Oui, ce serait très coûteux : cela reviendrait globalement à accroître de manière cumulée le montant global des prestations de 1,5 point par an, soit une augmentation de l'ordre de 8 % au bout de cinq ans. D'autant que cela conduirait aussi à indexer les plafonds : or, chaque fois qu'on augmente d'un point le revenu moyen par rapport aux prix, nous économisons entre 0,5 et 1,1 point des prestations sous condition de ressources – l'ARS, le CF et la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) –, dans la mesure où davantage de personnes dépassent les plafonds du fait de la progression des salaires.
Une telle mesure, révolutionnaire, condamnerait la branche à un déficit structurel.
Les mouvements familiaux souhaiteraient naturellement une indexation plus favorable, mais elle n'a jamais eu lieu. Ainsi, la loi du 12 juillet 1977 instituant le complément familial comportait un article – auquel j'ai travaillé –, prévoyant une indexation sur le PIB, le SMIC ou tout autre variable, pour ne pas parler ostensiblement des prix, mais on s'est quand même aligné sur ceux-ci !
Par ailleurs, les responsables budgétaires de la protection sociale doivent pallier les déficits croissants touchant les autres branches – qu'il s'agisse des retraites ou de l'assurance maladie – et faire face au besoin de financement de la dépendance ou de la lutte contre la pauvreté.
Il y a donc lieu de définir le type de politique familiale que l'on veut par rapport aux autres politiques sociales, ce qui permettrait de fixer une enveloppe financière, au sein de laquelle des choix pourraient être faits.

Cette réflexion doit aller de pair avec celle portant sur l'assiette des prélèvements, qui ne doit pas conduire à tuer la poule aux oeufs d'or !…
Il nous faudra définir des priorités pour les dépenses : défendre les classes moyennes ou populaires ne revient pas au même que cibler les jeunes familles ou les familles monoparentales.
S'agissant des recettes, j'entends la position des partenaires sociaux et des associations au sujet de l'opportunité d'affecter tel ou tel prélèvement à telle ou telle dépense.
Ils craignent d'abord une budgétisation de la branche, voire une étatisation de la gestion de la sécurité sociale. Il faut bien toutefois considérer la situation actuelle : le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) n'a pas son mot à dire sur les prestations, qui sont décidées au préalable, et le seul domaine où la branche a une autonomie concerne l'action sociale. En outre, je vois mal un gouvernement expliquer qu'il va supprimer les caisses d'allocations familiales (CAF) et faire gérer les prestations par les services fiscaux. Les partenaires sociaux disposent d'un véritable pouvoir de décision surtout pour l'assurance chômage et les retraites complémentaires.
Cette crainte traduit peut-être le fait que les gouvernements n'ont pas avec eux un dialogue aussi constant sur la politique familiale que sur la retraite par exemple. Elle fait plus écho à un changement symbolique qu'à une modification de fond.
Les partenaires sociaux redoutent aussi d'être trompés : la « tuyauterie » du financement de la sécurité sociale est tellement compliquée qu'elle fait perdre toute visibilité et sécurité juridique.
Selon moi, il n'existe aucune sécurité juridique pour quiconque, même si d'aucuns peuvent la souhaiter : le Parlement peut changer comme il veut l'ensemble des paramètres de ce qu'il veut. Certes, il peut sanctuariser certaines dispositions par la loi organique, comme ce fut le cas pour la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), mais on voit bien que cela ne peut constituer une garantie absolue. De toute façon, il est toujours possible de changer le point de cotisation ou l'assiette des prélèvements – les gouvernements le font régulièrement.
Il n'y a guère plus de visibilité, sauf pour quelques spécialistes. Mais si l'on modifie tel canal de financement, on peut rarement le cacher longtemps au Parlement et à l'opinion publique. Après l'opération de transfert de 0,28 point de contribution sociale généralisée (CSG) vers la CADES, le Parlement a ainsi exigé qu'on lui précise l'évolution des recettes de substitution de la branche famille jusqu'en 2017 : le rapport de la Cour des comptes a montré qu'elles baissaient, un débat parlementaire a eu lieu, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, à la suite de quoi la direction de la sécurité sociale a indiqué qu'elle apporterait chaque année une compensation. Cela dit, cette prévision, qui est à mon avis sincère et la meilleure qui soit aujourd'hui, n'a pas plus de validité qu'une ligne de cotisation de sécurité sociale.
Il n'en reste pas moins que les gestionnaires ont ce sentiment de défiance, ce qui n'est pas sain. Il faut donc que soient produites des prévisions de long terme – les schémas de programmation budgétaires servent à cela. De manière générale, les documents publiés par les administrations sont sincères et réalistes.
Sur la nature des recettes, on a commencé par dire que certaines branches étaient foncièrement contributives – les retraites ou l'assurance chômage – et devaient donc logiquement être financées par des cotisations, contrairement à d'autres, universalistes, dites de solidarité, pour lesquelles d'autres sources de financement ont leur place.
Vous remarquerez que ce débat est né lorsqu'on a voulu stabiliser les cotisations patronales. Quand, en 1976, on a sorti les prestations familiales de la logique contributive, personne ne s'est demandé s'il fallait changer la nature des recettes : ce n'est qu'après, sous le gouvernement de Raymond Barre, lorsqu'on a souhaité opérer cette stabilisation, qu'on a décidé de réserver ces cotisations prioritairement aux régimes contributifs et nourri une réflexion sur le fait que les autres branches pourraient avoir plus de recettes fiscales. D'où l'idée récente selon laquelle, si l'on devait alléger les cotisations, elles devraient porter sur les allocations familiales – ce qui crée à juste titre beaucoup de nervosité chez les partenaires sociaux.
Mais il s'agit d'une construction intellectuelle : si vous me demandiez de justifier l'inverse, je pourrais sans doute y arriver ! L'allégement pourrait tout aussi bien porter sur les cotisations de l'assurance maladie, qui est tout autant universelle, depuis la création de la couverture maladie universelle (CMU), que la branche famille.
Reste à savoir, si on allégeait les cotisations, quelles seraient les recettes de substitution, ce qui pose la question du changement d'assiette – qui peut porter sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la fiscalité écologique ou tout autre prélèvement. Il ne m'appartient pas de l'apprécier.
Toujours est-il que le Gouvernement a préféré créer un crédit d'impôt pour réduire le coût du travail plutôt que baisser les cotisations patronales. Du coup, plus personne ne considère la nature du financement de la branche comme un problème.
Il faut en fait distinguer trois types de débats : le débat intellectuel sur la nature des recettes, qui est intéressant au regard de la philosophie du droit ; celui sur les moyens que l'on souhaite donner à chaque branche de sécurité sociale ; celui, enfin, sur les assiettes de substitution en cas d'allégement des cotisations.

Avez-vous eu une réflexion particulière sur le choix entre le crédit d'impôt et l'allégement des cotisations ?
Il n'appartient pas au HCF d'en débattre. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale, auquel je participe, n'en délibère pas non plus, puisque ce n'est plus sa fonction. D'ailleurs, à peine a-t-il été créé par le gouvernement précédent qu'on avait déjà décidé de mettre en place la TVA sociale et, à peine l'a-t-on récemment relancé, qu'on a déjà décidé qu'on recourrait à un crédit d'impôt !

Avez-vous des informations sur les modèles macroéconomiques tels que le modèle Mesange, étudiant les différents scénarios de financement ?
Non. Ma réflexion porte sur ce que nous ferons pour la branche dans les années à venir : il suffit que le Gouvernement m'indique sur quelle hypothèse d'évolution des recettes il souhaite que nous travaillions. À défaut, je partirai de celle selon laquelle elles évolueront comme le PIB.

Le débat est moins fermé que vous ne le dites. Le choix du crédit d'impôt repose sur deux raisons principales : d'une part, ne pas préjuger du débat sur le financement de la protection sociale et, d'autre part, envoyer aux entreprises un signal d'amélioration de la compétitivité dès le 1er janvier 2013 en en reportant le financement à 2014 pour tenir compte des contraintes budgétaires. Dès lors, la question de savoir comment pérenniser le système de protection sociale en 2014-2015 et au-delà reste entière, sachant que beaucoup d'organisations syndicales sont attachées à la structure du financement actuel.
Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'écart de coût du travail avec la Chine ou les pays en développement – ni avec l'Allemagne, l'écart dans ce cas n'ayant pas d'impact sur les coûts de production –, mais plutôt de capacité d'investissement des entreprises, de recherche et de formation des salariés.
En revanche, se pose la question du rapport entre le coût du capital et celui du travail en France, qui détermine le choix de recourir à une machine plutôt qu'à un service – à des caméras de surveillance, par exemple, plutôt qu'à des agents dans les transports en commun. Je suis partisan d'une neutralité fiscale en la matière, qui permettrait d'éviter certains effets pervers.
La CFDT partage cette approche. Quant à la CGT, elle est favorable à une modulation des taux de cotisation en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée, mais cela revient mathématiquement quasiment au même.
En tout cas, il faut que nous ayons cette réflexion.
Je rappelle que les attributions du HCF ont été réduites à cet égard, même si ces questions sont fondamentales.
Je continue à penser que le débat sur la nature des recettes aura moins d'actualité depuis que le Gouvernement a fait le choix du crédit d'impôt. Se poseront en revanche la question de savoir ce que l'on met autour de celui-ci – qu'il s'agisse de le subordonner à des obligations ou de conditionner certaines exonérations – ainsi que celle de son financement.
J'attends les signaux du Gouvernement sur la politique familiale. L'augmentation de l'ARS, qui porte sur 400 millions d'euros, en est un. Si elle ne se traduit pas par une modification structurelle, elle constitue une bonne opération, car elle a permis, pour un montant limité, de cibler les classes moyennes avec un impact significatif – soit 700 ou 1 000 euros de plus au mois de septembre pour des familles de deux ou trois enfants. Un deuxième signal implicite a porté sur le quotient familial, que l'on veut légèrement réduire, sans le réformer en profondeur. Lorsqu'il avait évoqué le sujet lors de sa campagne électorale, le Président de la République avait d'ailleurs précisé qu'il le conserverait tout en le plafonnant à 2 000 euros.
Je rappelle à cet égard que ce plafonnement existe depuis 1981, que le Conseil constitutionnel a reconnu sa validité et que son niveau a plus ou moins été élevé ou réduit selon que le gouvernement était de droite ou de gauche. Or, le quotient familial correspond aujourd'hui à celui prévalant sous le gouvernement de Lionel Jospin actualisé en fonction de l'inflation. On observe donc une grande continuité dans ce domaine : la mesure prise ne modifie pas véritablement la politique familiale.
Il en va différemment de la question de savoir ce que l'on fait du statut fiscal − s'agissant non seulement du quotient familial, mais aussi du quotient conjugal, grand oublié du débat politique. De même que de celle touchant à la variation des prestations familiales en fonction de la taille de la famille, de l'âge des enfants ou du revenu.
Sur la taille de la famille, nous poursuivons depuis 1945 une politique constante tendant à accroître l'aide totale en fonction du nombre d'enfants, ce qui me paraît bien. En 1981, alors que la gauche était porteuse de l'idée de l'égalité des allocations familiales quel que soit le rang, le Gouvernement s'y est assez vite refusé et le débat n'a quasiment plus jamais reparu. De même, si M. Sarkozy avait évoqué l'idée d'une allocation au premier enfant lors de sa campagne de 2007, après son élection, le débat a été clos. Quel gouvernement serait prêt en effet à consacrer un budget de 2,5 milliards pour donner 60 euros à toutes les familles d'un enfant alors qu'un enfant sur cinq vit dans une famille pauvre ?
D'ailleurs, l'un des rares votes du HCF a été que, dans la conjoncture actuelle, il n'était pas prioritaire de retenir cette mesure. Cela veut bien dire qu'elle ne verra pas le jour.
En ce qui concerne l'âge, la politique conduite s'inscrit également dans la continuité, en faveur des familles jeunes. À la fois parce que cela incite celles-ci à avoir d'autres enfants et pour favoriser la compatibilité entre la vie professionnelle des femmes et leur vie privée. Or, les signaux adressés par le Président de la République dans sa campagne électorale vont dans le même sens, qu'il s'agisse de la volonté de renforcer l'école maternelle pour les tout-petits – où l'on a perdu 150 000 places en onze ans – ou d'amplifier l'effort en faveur des équipements d'accueil du jeune enfant (EAJE). Mais là encore, il faudra trouver les financements.
Pour ce qui est des revenus, il n'y a eu, en dehors de la mesure sur le quotient familial, aucune mesure de structure annoncée par le Gouvernement. Ce chantier n'a donc pas été ouvert. Je rappelle que lorsque certains responsables de l'ancienne majorité ont évoqué l'idée de placer les allocations familiales sous conditions de ressources, ils ont été très vite rappelés à l'ordre.
Et même réussi… pour un an ! Cette opération est d'ailleurs révélatrice tant en termes de méthode que de fond.
En effet, Lionel Jospin l'avait annoncée dans son discours d'investiture alors que le dossier n'était pas instruit et qu'on lui avait livré une information tronquée – en minimisant le coût sur la base d'un calcul portant sur une famille de deux enfants. Si on lui avait fourni une évaluation pour une famille de quatre enfants, il aurait peut-être davantage hésité. Or huit jours après l'annonce, il avait déjà modifié la mesure, le plafond de 25 000 francs devant augmenter avec la taille de la famille et le nombre de revenus.
Puis, après avoir été critiqué par les mouvements familiaux, il est revenu en arrière et, au passage, a modifié le quotient familial, récupérant ainsi à peu près ce qu'il avait perdu en rétablissant le régime des allocations familiales. Au bout du compte, il a obtenu une meilleure structure du système de prestations.
Je rappelle à cet égard que le Conseil constitutionnel n'approuverait probablement pas une offensive radicale sur le quotient familial.
Dans la note publique que nous avons rédigée sur ce sujet, nous avons décrit toutes les possibilités de réforme et exposé toutes les données permettant à chacun de faire ses choix. Le Gouvernement ne s'est pas encore prononcé à cet égard.
À mon avis, certains chantiers de la protection sociale sont plus prioritaires que d'autres, tels la dépendance, la lutte contre la pauvreté, le veuvage précoce ou les invalides. Il faut partenir à réduire considérablement les dépenses d'assurance maladie.
En ce qui concerne la branche famille, nous avons écrit que le statu quo est sans doute la politique la moins courageuse et la moins positive, car elle aboutit à désindexer tout le monde. En même temps, je comprends que l'on ne veuille pas procéder à une réforme structurelle tant qu'on n'a pas précisé les perspectives financières. Cette question est cruciale.
La prévision de déficit la plus récente pour 2017 est de 1,2 milliard d'euros. Plusieurs moyens permettraient de récupérer cette somme immédiatement, à commencer par le gel des prestations, qui revient à toucher tout le monde. Le gouvernement précédent a d'ailleurs fixé l'évolution de celles-ci à un point de moins que celle des prix et décalé de trois mois la date de paiement.
A contrario, une réforme structurelle consisterait à voir par exemple dans quelle mesure on pourrait renforcer les EAJE, mieux aider les adolescents, ou davantage soutenir les familles modestes ou pauvres.
Il faut donc faire des choix : il est paradoxal de dire en même temps que nous avons une bonne politique familiale et qu'un enfant sur cinq vit dans une famille pauvre !
Le Gouvernement m'a demandé d'animer un atelier sur les familles modestes : vous verrez mes positions à titre personnel sur la politique familiale à cet égard. En tout cas, si l'on veut faire un effort pour ces familles, il faut savoir quel décile on cible. Je penche pour les trois premiers plutôt que le premier. Une politique sociale limitée aux plus pauvres serait en effet rejetée par l'opinion…
Quant au HCF, je rappelle qu'il n'est saisi d'aucune demande, le décret le recomposant n'ayant pas encore été publié – ce qui ne nous empêche pas de travailler.

S'est-il penché sur la question des disparités territoriales, qui sont choquantes, même si l'on comprend que les collectivités territoriales cherchent à lutter contre la pauvreté de certaines régions ?
Par ailleurs, qu'en est-il de la fragilité et de l'hétérogénéité des systèmes d'information ?
La ministre déléguée chargée de la famille nous a demandé de réfléchir sur ce thème des disparités territoriales, qui concerne toute une série d'équipements et de services centrés sur l'enfance et l'adolescence, où elles sont très fortes. Il s'agit d'un sujet difficile, sur lequel va influencer la réforme des rythmes scolaires, qui rebat les cartes en ce qui concerne les charges des communes.
Nous avons rappelé qu'il ne suffisait pas d'avoir un plan de 200 000 places de garde − même s'il a été honorablement géré –, si l'on supprimait dans le même temps 150 000 places à l'école maternelle…
Nous sommes en faveur du développement des équipements collectifs, c'est-à-dire les écoles maternelles et les EAJE. Le Gouvernement peut utiliser la convention d'objectifs et de gestion (COG) pour donner au Fonds national d'action sociale (FNAS) de la CNAF les moyens d'assumer une extension de ses missions, mais il faut également avoir l'appui des autres financeurs que sont les communes, à qui on demande aussi d'améliorer l'aide aux adolescents et de s'ajuster à la modification des rythmes scolaires.
Cela pose la question de ce que l'on peut demander à celles-ci compte tenu du principe de leur autonomie de gestion.

Il faut aussi tenir compte d'un autre partenaire, que sont les parents d'élèves, certains d'entre eux préférant pour des raisons de coût mettre leur enfant à deux ans et demi à l'école maternelle plutôt qu'à la crèche ou au jardin d'enfant.
Nous avons estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accroître la gratuité dans les établissements de garde et avons d'ailleurs voté en ce sens. Nous accordons la priorité à l'offre : or pour qu'il y ait plus de crèches, il faut que les familles payent. Le taux d'effort des familles pour les établissements d'accueil nous paraît à cet égard très cohérent.
En outre, nous avons dit au gouvernement précédent qu'il fallait arrêter la suppression de places à l'école maternelle.
Enfin, nous avons considéré que les déclarations du Président Hollande pendant sa campagne électorale tendaient à remonter l'âge de la scolarité à deux ans et à poursuivre le plan de développement des modes de garde.
Sur ce point, les syndicats et mouvements associatifs qui soutiennent le gouvernement préfèrent, comme les familles, que l'on fasse un peu plus de crèches, plutôt que de renforcer l'assistance maternelle.
Cela n'est pas évident. On peut d'ailleurs se demander si, en accroissant le nombre de places à l'école, on soulagerait la grande section des EAJE. De manière générale, les Français choisissent de mettre leurs enfants à la crèche, puis à l'école maternelle, ce qui pose un problème de financement.
La branche famille peut assumer celui-ci : il revient au Gouvernement d'en décider. Il sera d'ailleurs obligé de définir au printemps, dans le cadre de la COG, le montant du FNAS, ce qui nous donnera une indication sur l'ambition du programme des EAJE – laquelle ne sera sans doute pas inférieure à celle du gouvernement précédent.
Quant aux communes, elles vont devoir prendre en compte, au-delà de leurs problèmes financiers généraux, non seulement la modification des rythmes scolaires, mais aussi l'avancée de l'âge d'entrée à l'école maternelle et la poursuite des efforts sur les EAJE.
À cet égard, je ne crois pas que le souhait spontané du HCF d'obliger les intercommunalités à faire des crèches sera réalisé. Ce serait d'ailleurs très difficile à organiser : les premiers contacts que nous avons eus avec la direction générale des collectivités locales (DGCL) à ce sujet attestent de sa part une certaine prudence, compte tenu du débat politique actuel sur la nouvelle vague de décentralisation.
Sur les systèmes d'information, je ne me prononcerai pas, en raison de l'accord politique entre le Premier ministre et le président de la CNAF sur le partage des compétences entre celle-ci et le HCF.
Cela étant, les CAF ont des capacités tout juste suffisantes : outre qu'on les charge de multiples tâches de gestion, elles subissent les effets de la crise.
Beaucoup veulent leur confier d'autres missions afin de mieux accompagner les familles vulnérables, améliorer la gestion des dispositifs d'accès au droit ou le taux de recours… : je suis d'accord à condition qu'elles en aient les moyens. La première recommandation que je ferai dans l'atelier que j'aurai à animer sur les familles modestes sera d'ailleurs de créer des emplois publics dans les CAF.
Nous ne gagnerions rien à ce que celles-ci se mettent à fermer un peu plus qu'elles ne le font déjà !

Cela renvoie à la question des coûts de gestion, que la MECSS a déjà abordée ainsi qu'à la problématique du guichet unique.
Les coûts de gestion des organismes de la sécurité sociale ne sont pas chers. Je rappelle que ceux-ci disposent de masses financières et de prérogatives de puissance publique importantes, et qu'ils font établir l'essentiel des opérations de recettes par les entreprises : il est normal que l'Urssaf ait 1 % de frais de gestion. Pourrait-elle travailler à 10 % moins cher ? Peut-être, mais cela ne réglerait pas le déficit de la sécurité sociale. De plus, les économies sur les frais de gestion sont parfois difficiles à réaliser.
Tant qu'on ne change pas le type de dépenses que les branches ont à gérer, on ne peut substantiellement réduire les coûts. Or, on fait l'inverse : comme nos moyens financiers sont limités, on cible toutes les politiques, en changeant de curseur tous les six mois. On a ainsi institué un tarif d'électricité : celui-ci a été considérablement amélioré grâce au décret de mars 2012, qui permet de le gérer de façon quasi automatique, mais voilà qu'on me demande maintenant si on ne pourrait pas changer le dispositif – ce qui interfère d'ailleurs avec la proposition de loi actuellement en discussion !
Il ne faut pas non plus négliger le fait que chaque ministre veuille avoir sa loi, son dispositif. À cet égard, si j'estime pertinente la mesure prise par le Gouvernement sur l'ARS, son souhait de tenir davantage compte de la situation de l'enfant dans le cycle scolaire et de différencier une somme de 400 euros par an en fonction, non seulement de l'âge, mais du niveau d'étude, sollicitera davantage les caisses.
Beaucoup de simplifications seraient possibles : pourquoi avons-nous par exemple, pour aider la scolarité des enfants, à la fois des bourses, une ARS et un crédit d'impôt ?
Par ailleurs, nombre d'actions gagneraient à être amplifiées : on ne fait par exemple pas assez pour lutter contre la fraude et favoriser l'accès au droit. Or, dans les deux cas, cela demande de la main-d'oeuvre. Mais si le responsable budgétaire accepte éventuellement quelques créations d'emploi pour lutter contre la fraude parce qu'il pense que c'est rentable, il rechignera beaucoup plus à le faire pour favoriser l'accès au droit – même s'il admet que c'est légitime – pour ne pas créer de dépenses supplémentaires.
Cela étant, on ne peut continuer éternellement à avoir un non-recours au revenu de solidarité active (RSA) de 50 %.

Ces charges administratives montrent bien combien la question des systèmes d'information et le croisement des données automatisées sont essentiels, tant au regard de la lutte contre la fraude que pour l'accès au droit.
Les pistes de simplification que vous avez évoquées pourraient être étudiées par la MECSS.
Je vous communiquerai un dossier sur ce point.
Je rappelle à ce sujet que nous aidons les familles à avoir des enfants en faisant un gros effort financier, tout en leur donnant ensuite un crédit d'impôt : pourquoi ne pas supprimer ce dernier et améliorer le paiement des prestations, d'autant que la somme en jeu − 100 millions d'euros – est relativement faible ?
Cela étant, les simplifications sont souvent difficiles à mener à bien, comme en témoigne par exemple la fusion des bourses des écoles et de l'ARS, qui a permis d'économiser 300 équivalents temps plein (ETP) à l'éducation nationale : elle a duré deux ans, puis les syndicats d'enseignants ont fait part de leur mécontentement et les parents d'élèves de leur souhait de garder les bourses, moyennant quoi la mesure a été supprimée.
Les grandes simplifications ne portent pas sur la gestion quotidienne, mais sur l'architecture des branches. Pourquoi avons-nous autant de régimes sociaux, alors que cela crée par exemple, en matière de retraites, le problème lancinant des polypensionnés, que les gouvernements essaient tour à tour de résoudre ?
Nous payons le péché originel de la pluralité des régimes que nous avons acceptée à la fin des années 1940. Seule la branche famille est à peu près homogène à cet égard, à l'exception du cas de la Mutualité sociale agricole (MSA) – même si les relations avec elle sont très bonnes.
Pour le reste, on peut toujours souhaiter que la productivité dans la chaîne de gestion des caisses s'améliore, ce qui est d'ailleurs le cas. Peut-on aller plus vite dans ce domaine ? Vraisemblablement… jusqu'à ce qu'on arrive à la limite des capacités des caisses – sachant qu'une grande grève à la sécurité sociale coûterait très cher !

Je me souviens d'avoir obtenu le non-renouvellement d'un départ à la retraite sur deux au sein de l'assurance maladie, lequel, après avoir été mal accueilli au départ, a fini par être bien accepté par les syndicats – ce qui a permis de diminuer de 12 000 salariés les effectifs de la branche. Cette mesure était liée à l'époque à la dématérialisation des feuilles de maladie.
Les caisses ont dans l'ensemble plutôt progressé en termes de gestion. Mais je ne crois pas au fantasme selon lequel on pourrait radicalement baisser les coûts en la matière sans changement d'architecture.

Lorsque j'ai rédigé le rapport d'évaluation de la précédente COG pour le compte de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), on nous avait fortement suggéré de rester à moyens constants alors qu'il fallait mettre en oeuvre le RSA. Un tel scénario serait difficilement tenable aujourd'hui ; je suis même étonné que le climat social demeure aussi apaisé au sein de la branche famille.
Cela est sans doute lié au fait qu'à force de fréquenter des familles pauvres, les personnels ont du mal à se mettre en grève… Mais il ne faut pas trop tirer sur la corde ! À cet égard, l'implosion qualitative des caisses, qu'elle se traduise par des fermetures ponctuelles ou une augmentation de l'absentéisme, ne serait pas préférable à la grève. La prochaine conférence de lutte contre la pauvreté aura à traiter de ces questions.
La Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale procède ensuite à l'audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Didier-Courbin, chef du service des politiques sociales et médico-sociales, adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales et de la santé, et Mme Florence Lianos, sous-directrice de l'enfance et de la famille.

Nous accueillons maintenant M. Philippe Didier-Courbin, chef du service des politiques sociales et médico-sociales, adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale, et Mme Florence Lianos, sous-directrice de l'enfance et de la famille à la direction générale de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales et de la santé.
Mme Sabine Fourcade, directrice générale de la cohésion sociale, dont l'audition était initialement prévue, se trouve en effet empêchée par un problème de santé. Nous lui adressons nos voeux de prompt rétablissement.
La MECSS a commandé à la Cour des comptes une étude sur le financement de la branche famille. Un rapport d'étape lui a été remis la semaine dernière. Il analyse l'évolution des dépenses et des recettes sans se prononcer, à ce stade, sur ce qu'elles pourraient être à l'avenir, ni sur les perspectives de réforme.
Or les questions que nous nous posons sont à la fois rétrospectives et prospectives. Nous cherchons d'abord à identifier les causes du déficit de la branche famille. La Cour des comptes considère que ce déficit est structurel. Le président délégué du Haut Conseil de la famille, que nous avons entendu ce matin, estime au contraire qu'un excédent et un remboursement de la dette peuvent être envisagés d'ici à 2025. Nous aimerions avoir votre analyse sur ce point.
J'en viens à la prospective. Comment financer la branche famille en fonction de l'évolution prévisible des dépenses ? La décision d'alléger de 20 milliards d'euros les charges sociales des entreprises sous forme de crédit d'impôt déconnecte le problème de la compétitivité de celui du financement de la sécurité sociale. Cependant, le Président de la République et le Premier ministre ont précisé que cette décision permettait de ne pas préjuger les conclusions du débat qui s'ouvre au sein du Gouvernement, du Haut Conseil du financement de la protection sociale et du Parlement. La question des ressources de la branche famille est d'ailleurs depuis longtemps liée à celle de la compétitivité puisque les premiers allégements de cotisations employeurs, décidées par M. Édouard Balladur, étaient à la charge de cette branche, la perte de recettes étant compensée par le budget de l'État. Cette fiscalisation n'a fait ensuite que s'accentuer, comme la Cour des comptes l'a mis en lumière. Ce mouvement doit-il se poursuivre ? Faut-il au contraire rechercher, pour ce financement de la protection sociale, d'autres assiettes, du côté de la valeur ajoutée par exemple, puisqu'il semble désormais exclu de s'en tenir à des cotisations patronales exclusivement assises sur les salaires ? En bref, quel est selon vous le financement optimal de la protection sociale ?
D'autre part, question qui est aujourd'hui sujet de débat entre les partenaires sociaux, comment évoluerait le lien entre des recettes dont la nature aurait été modifiée et des prestations familiales qui conserveraient leur caractère universel ?
L'objectif de la MECSS est de parvenir sur tous ces points d'ici l'été 2013 à un diagnostic qui soit consensuel et à des propositions qui pourraient l'être moins, en fonction des sensibilités politiques. Ce travail s'appuiera sur nos auditions, sur le rapport final de la Cour des comptes, prévu pour le printemps, et sur celui du Haut Conseil du financement de la protection sociale, attendu pour le début du mois de mars 2013.
Cela étant, ces grandes questions ne sont pas exclusives d'une curiosité quant au fonctionnement de la branche famille : la gestion de ses prestations permet-elle d'atteindre les objectifs recherchés ? Des économies sont-elles possibles sur certains postes, au profit d'autres ?

Nous souhaitons en effet disposer d'une évaluation exhaustive de l'efficience des prestations fournies. Les nombreux rapports récents sur la politique de la famille montrent que la question des recettes ne peut être dissociée de celle des dépenses mais, s'il faut certes rationaliser et optimiser ces dernières, cela ne peut être au détriment des objectifs fixés à la politique familiale, notamment de la correction des inégalités existant au sein de la communauté nationale.

La préparation de la quatrième convention d'objectifs et de gestion (COG) entre l'État et la CNAF sera l'occasion de vérifier si cette démarche de contractualisation est un outil efficace de pilotage de la branche famille par l'État et de la centaine de caisses d'allocations familiales, les CAF, par la CNAF. On a en effet pu nourrir quelques doutes à cet égard…
La direction générale de la cohésion sociale, la DGCS, n'a pas pour mission de suivre la politique familiale dans sa globalité, mais de travailler à la bonne articulation entre l'action des caisses comme prestataires d'allocations aux familles et la politique plus générale d'action sociale et de cohésion sociale – qui comprend l'appui aux familles et personnes vulnérables, l'action en faveur de l'égalité entre hommes et femmes et la politique du handicap.
La branche famille contribue à cette politique d'action et de cohésion sociales, en finançant des opérations qui relèvent de son offre globale de services mais également en agissant comme prestataire de services pour l'État, comme gestionnaire de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, et pour les départements, comme gestionnaire du revenu de solidarité active, le RSA. Enfin, les CAF versent les prestations familiales. Ces fonctions sont distinctes et le positionnement et les attentes de l'État envers la CNAF diffèrent selon qu'on considère l'une ou l'autre.
Dans leur rôle de prestataires de services, les caisses ne sont d'ailleurs pas que des opérateurs rémunérés ; elles observent aussi les publics qui bénéficient de ces prestations et cette autre fonction est également précieuse pour la DGCS.
Notre direction générale ne possède pas d'expertise particulière sur le financement de la branche famille. J'observe simplement que, quelle que soit leur nature, ces recettes dépendront toujours de l'activité économique. Mais l'intérêt d'une remarque aussi générale est sans doute limité et je vous renvoie donc pour cette matière à l'exposé de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale.
Cependant, il est un point sur lequel le sujet nous intéresse : la branche famille doit pouvoir non seulement piloter et financer des prestations, mais également être en capacité de conduire une politique d'action sociale pour laquelle la DGCS propose des orientations, à l'occasion de l'évaluation et de la négociation des COG. C'est dans ce cadre que se confronte la politique familiale, qui a un caractère quasi universel, avec l'action sociale qui, elle, vise des publics précis ou s'applique à des situations spécifiques ou dans des territoires particuliers.
Il n'est pas du ressort de la DGCS de décider si l'universalité de la politique familiale doit être ou non remise en cause. En revanche, nous avons notre mot à dire sur la définition de l'offre de services de la CNAF et des CAF, à travers la négociation de la convention d'objectifs et de gestion.
L'élaboration de la future COG n'en est actuellement qu'au stade des échanges techniques entre la DGCS, la CNAF et la direction de la sécurité sociale. Ces discussions interviennent au moment où se tiennent les ateliers thématiques chargés de préparer la conférence de lutte contre la pauvreté et les exclusions et où Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille, vient de lancer une consultation sur les services offerts aux familles. La conférence aura lieu les 10 et 11 décembre prochains et la consultation « autour des familles », selon l'appellation retenue par la ministre déléguée, devrait également déboucher sur des propositions avant la fin de l'année. Les conclusions de l'une et de l'autre influeront indéniablement sur les choix stratégiques qui seront retenus dans la COG. Cependant, sans attendre, nous pouvons nous appuyer sur d'autres éléments pour préparer cette convention.
En premier lieu, s'agissant du bilan de la COG 2009-2012 dressé par l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, des trois grandes priorités de cette convention relevant de la compétence de la DGCS – l'accueil du jeune enfant, l'accompagnement de la mise en oeuvre du RSA et celui de la réforme de l'AAH –, une seule, la première, était très directement liée à la politique familiale, les autres ressortissant de la politique d'action et de cohésion sociales. Il ressort de l'analyse de l'IGAS que les objectifs chiffrés, en matière d'accueil collectif des jeunes enfants, sont en passe d'être atteints et que les résultats sont excellents en ce qui concerne les assistantes maternelles ; en revanche, l'accueil en école maternelle n'a cessé de se restreindre depuis plusieurs années. Il y a là un déséquilibre qui ne pourra être corrigé que par une action combinée des caisses et de l'État, puisque c'est ce dernier qui a la charge des écoles maternelles. D'autre part, si, comme je l'ai dit, les objectifs chiffrés semblent atteints pour la création de places en structures d'accueil collectif, la couverture du territoire demeure très inégale et, malgré des efforts, les réponses apportées ne sont pas assez diversifiées, ni adaptées aux situations particulières. C'est d'ailleurs un constat qui vaut pour bon nombre d'autres actions : les résultats globaux peuvent paraître satisfaisants mais le traitement des cas spécifiques est souvent insuffisant.
Nous disposons également d'un bilan des actions d'appui à la parentalité. Là, le problème tient avant tout à la multiplicité des dispositifs : appui à la scolarité, réseaux d'appui à la parentalité, médiation familiale… Tous ont leur raison d'être, mais un effort de coordination serait souhaitable. À qui s'en remettre pour cela ? Comme l'État définit de grandes orientations dans ce domaine et participe au financement à travers ses services déconcentrés ou à travers les préfets, il reste présent dans le pilotage de ces actions, mais celles-ci bénéficient aussi de financements importants des caisses et, pour certaines, de la contribution de collectivités locales volontaires.
Au niveau national, une première réponse à ce besoin de coordination a consisté en la création d'un comité national d'appui à la parentalité, réunissant des représentants de tous les acteurs concernés, mais le pilotage local reste à constituer et des interrogations demeurent à cet égard. Le rôle de l'État financeur étant modeste, cela justifie-t-il la présence des préfets et des services de la cohésion sociale ? Ne peut-on se reposer uniquement sur les présidents des caisses et sur les présidents des conseils généraux ? Toutefois, s'agissant de l'appui à la scolarité ou de dispositifs centrés sur les territoires relevant de la politique de la ville, un tel désengagement ne serait probablement pas très prudent. Il faut donc que nous réussissions ce niveau ce à quoi nous sommes parvenus au niveau national avec la CNAF et avec l'Association des départements de France.
Cette coordination ne doit d'ailleurs pas se résumer à une réunion annuelle en vue de s'accorder sur les actions à financer : elle doit aussi porter sur le lancement de nouvelles actions dont la nécessité serait apparue, sur l'information des publics pour les aider à s'orienter entre tous les dispositifs existants – ce qui suppose de définir les moyens de toucher l'usager : le choix de la localisation des services, par exemple, n'est pas anodin. Les problèmes de relations entre parents et enfants ne se posent pas qu'aux familles en difficultés sociales ou financières, certes, et il est exclu de ne viser que celles-là, mais il faut néanmoins analyser finement les situations locales pour déterminer dans quelle mesure il convient de cibler des publics particuliers… L'État peut faire valoir des considérations générales, mais ces choix-là ne peuvent être arrêtés qu'au niveau local.

Pour en revenir à la question posée par le rapporteur, pouvez-vous évaluer l'efficacité des COG ? L'État utilise-t-il correctement cet outil pour s'assurer que ce qui a été convenu entre les parties est effectivement appliqué ? Si tel n'est pas le cas, quelles mesures correctrices sont prises ?

Dans la convention qui s'achève, par exemple, il était demandé à la branche de réunir les conditions lui permettant d'obtenir une certification de la Cour des comptes. Celle-ci avait en effet relevé une insuffisance du pilotage et du contrôle interne. Comment l'État est-il intervenu pour faire appliquer ce point ?

Comme rapporteur d'une mission d'information sur la gouvernance et le financement des structures associatives, j'avais constaté que ces dernières contribuaient fortement à la politique de la famille mais, dans votre rôle de contrôle et d'audit, veillez-vous à leur transparence financière ? Je rappelle en effet qu'au-delà de 153 000 euros de subvention annuelle, leurs comptes doivent être certifiés et publiés au Journal officiel, et qu'elles doivent rembourser à l'État le traitement des fonctionnaires mis à leur disposition.
À la différence de la direction de la sécurité sociale, nous ne suivons pas de près le fonctionnement des caisses, à une exception près : leur activité comme prestataires de services. Cela concerne la gestion de l'allocation aux adultes handicapés, pour laquelle nous entretenons un dialogue étroit avec la CNAF. En ce qui concerne les actions entrant dans le cadre de la COG, notre contrôle porte surtout sur la réalisation des objectifs fixés : ainsi, pour l'accueil du jeune enfant, grâce aux informations qui nous remontent régulièrement, nous avons pu constater que les objectifs quantifiés étaient atteints, mais qu'il convenait de fixer des orientations d'ordre qualitatif dans la COG qui vient, par exemple pour privilégier certaines modalités d'accueil. Je crois donc pouvoir affirmer que nous suivons l'application de la COG et en tirons les conséquences, en liaison avec l'IGAS notamment.
Nous opérons de la même manière pour ce qui est de l'aide à la parentalité. Les actions prévues sont menées, les différents dispositifs sont financés. Nous nous attachons à identifier les points à améliorer et cette évaluation a, comme je l'ai dit, montré la nécessité d'une plus grande coordination au niveau local, en particulier pour déterminer s'il convient ou non de « cibler » certains territoires ou publics particuliers.
À la demande conjointe de la direction de la sécurité sociale et de la DGCS, la CNAF a notablement amélioré ses systèmes de remontée d'information, ce qui nous permet maintenant de connaître en temps réel l'état d'avancement de tous les projets. Comme vous le savez, les différents programmes d'investissement de la CNAF, d'une grande technicité, s'étalent dans le temps. S'agissant des établissements d'accueil du jeune enfant par exemple, nous disposons désormais d'informations actualisées sur leur état d'avancement et sur le nombre de places occupées.
Nous tenons des réunions trimestrielles avec la direction de la sécurité sociale et avec la direction du Budget. Ce suivi a été renforcé après le rapport de 2009 de l'IGAS et de l'IGF, qui montrait un dépassement du budget du Fonds national d'action sanitaire et sociale (FNASS).
J'ajoute que le système d'information de la CNAF sera encore amélioré grâce au programme OMEGA, qui nous permettra de disposer en temps réel de toutes les données physiques et financières en matière d'action sociale.

À ce propos, avez-vous un agenda précis des travaux relatifs au partage des données ? En effet, les interconnexions de fichiers permettent actuellement de contrôler l'éligibilité aux droits, mais non la juste attribution des allocations.
S'agissant des rapprochements de fichiers, nous n'avons pas vraiment d'expertise – en tout cas pour ce qui concerne l'action sociale.
Au cours des années précédentes, la CNAF a fait preuve d'une grande réactivité en adaptant son système d'information pour accompagner la mise en place du RSA, ainsi que la réforme de l'AAH avec le dispositif Cristal. La manière dont elle a géré tout cela a permis d'éviter des dysfonctionnements alors même que beaucoup d'interrogations subsistaient à propos de ces réformes – y compris sur le résultat précis à atteindre. Elle a su s'adapter à des choix politiques qui ont évolué au fil du temps : cela lui a demandé un travail très important et je dois dire que les relations entre elle et nous ont parfois été tendues, car nous avions à coeur les uns et les autres de respecter les délais.

Nous souhaiterions disposer du bilan de la dernière COG, afin d'avoir une idée précise des inflexions, quantitatives et qualitatives, qu'il faudra apporter dans la prochaine – et d'être en mesure de vérifier, le moment venu, qu'elles l'auront bien été.
En matière d'accueil de la petite enfance, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de souci majeur, le suivi ayant été satisfaisant.
Pour d'autres dispositifs, qui engagent d'ailleurs des financements moindres, je pense que le suivi s'attachera à vérifier que les nouvelles cibles – en termes de zones comme de publics – sont bien atteintes. Mais, pour l'instant, ces nouvelles cibles n'ont pas encore été arrêtées.

Vous avez surtout parlé de la politique familiale et de la prise en charge du jeune enfant, mais peu du RSA et d'autres prestations…
Nous menons bien évidemment une réflexion sur le suivi du RSA et de l'AAH.
Pour l'AAH, nos interlocuteurs principaux ne sont pas les caisses : elles versent l'argent et nous n'avons pas d'exemples de difficulté particulière les concernant. L'essentiel du travail conduit depuis des mois est réalisé en amont, pour tenir compte de la modification des règles d'attribution et de l'évolution du montant de l'allocation qui a mécaniquement entraîné l'augmentation des publics touchés et, enfin, pour réfléchir aux conditions dans lesquelles les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les équipes techniques évaluent l'éligibilité à cette allocation.
Les travaux conduits dans le prolongement de la loi Blanc ont constitué une première étape. Il nous appartient à présent, à suite du changement de Gouvernement, de réfléchir à la nouvelle étape de la décentralisation, qui pourrait se traduire par une modification du statut des MDPH et donc des conditions dans lesquelles les droits sont attribués.
La réforme de l'AAH a conduit à une appréciation beaucoup plus fine qu'auparavant de la capacité de travail des personnes, ce qui a débouché sur une réglementation nouvelle. Nous venons, en lien avec la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique, de fournir aux services déconcentrés de la cohésion sociale les outils nécessaires pour qu'ils puissent, d'une part, mesurer exactement les modifications que cette nouvelle réglementation va entraîner dans les conditions d'attribution de l'AAH, et, d'autre part, fournir eux-mêmes des éléments à leurs collègues des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ce qui est une nouveauté. En effet, les services en charge de l'action sociale n'intervenaient guère jusqu'ici pour éclairer les équipes techniques et les membres des commissions des droits sur les conditions dans lesquelles est attribuée l'AAH, notamment au titre de l'article 35-2 de la loi du 30 juin 1975 – c'est-à-dire pour les personnes dont le handicap est compris entre 50 % et 80 % et pour lesquelles il est difficile de faire la part entre ce qui est lié aux effets du handicap et ce qui tient à leur environnement économique.
Bref, des travaux sont lancés, des outils existent, des référentiels sont diffusés, mais tout cela concerne moins les caisses que les maisons départementales, les équipes techniques et les membres des commissions des droits.

Il nous reste à vous remercier, madame, monsieur. Nous aurons certainement l'occasion de vous revoir une fois que la prochaine convention d'objectifs et de gestion aura été adoptée.
La séance est levée à douze heures quinze.