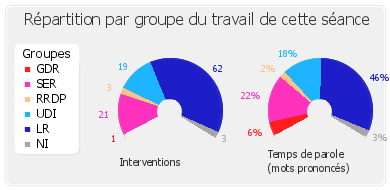Séance en hémicycle du 22 mai 2013 à 21h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche (nos 835, 1042, 969, 983). Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de huit heures trois minutes pour le groupe SRC dont 181 amendements restent en discussion, onze heures quarante-six minutes pour le groupe UMP dont 176 amendements restent en discussion, trois heures vingt-neuf minutes pour le groupe UDI dont cinquante-cinq amendements restent en discussion, une heure cinquante-cinq minutes pour le groupe écologiste dont quatre-vingts amendements restent en discussion, une heure quarante minutes pour le groupe RRDP dont trente-deux amendements restent en discussion, une heure trente-six minutes pour le groupe GDR dont treize amendements restent en discussion, et quarante minutes pour les députés non inscrits. Cet après-midi, l’Assemblée a commencé d’entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Patrick Hetzel.

Monsieur le président, madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, monsieur le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, mes chers collègues, en premier lieu, je voudrais revenir sur la méthode. Ce texte nous a été présenté dans la plus grande précipitation, le Gouvernement ayant demandé l’urgence et, de surcroît, il est discuté ici même, en séance publique, dans le cadre du temps programmé. Cela montre, si besoin était, que vous n’êtes pas très à l’aise avec ce texte, que vous voulez aller vite, car, de toute évidence, il vous gêne. Sans doute parce que de plus en plus d’oppositions se font jour et que vous voulez l’imposer à une communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche qui n’en veut pas. Des voix s’élèvent de toutes parts, et sur l’ensemble de l’échiquier politique, pour le critiquer. François Patriat, président socialiste de la région Bourgogne, vous accuse même de livrer les universités aux organisations syndicales et d’affaiblir leur gouvernance. Les raisons de ces nombreuses critiques ne sont certes pas toutes homogènes, mais force est de constater que vous n’avez pas réussi à générer de consensus autour de votre projet, c’est le moins que l’on puisse dire. Finalement, son adoption relèvera plus de la discipline du groupe SRC que d’une véritable adhésion. Cela en dit déjà beaucoup sur la pertinence d’ensemble de ce texte. En deuxième lieu, je voudrais relever que, manifestement, le Gouvernement ne considère pas le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche comme prioritaire. En effet, contrairement à d’autres textes de loi - je pense, par exemple, à l’école -, vous nous présentez une loi d’orientation, mais vous ne dites strictement rien en matière de programmation. D’ailleurs, le rapporteur lui-même, à la fin de son intervention, avait fait la même remarque. Nous n’avons aucune idée de la manière dont vous souhaitez, en termes de moyens, accompagner votre politique publique. Plus que jamais, le qualificatif de loi bavarde me semble approprié. En somme, ce projet de loi est d’inspiration plus velléitaire que volontaire. À n’en pas douter, les étudiants, leurs familles, les enseignants-chercheurs, les recruteurs apprécieront. Pour tout dire, à la première lecture de votre texte, je me suis dit : « Mais il n’y a strictement rien dans ce texte ! Tout ça pour ça ? La montagne Sainte-Geneviève a accouché d’une souris. » Mais, en relisant une deuxième fois votre texte, j’ai pu mesurer qu’il comportait en son sein quelques belles pilules empoisonnées, dangereuses à souhait. La plus toxique d’entre elles est sans doute l’organisation bicéphale que vous envisagez en créant un potentiel conflit de pouvoir entre le conseil d’administration et le conseil académique des universités et, pis encore, entre les présidents de ces deux instances. Très vite, nos universités seront ingouvernables, prises dans des conflits internes sans fin. Deux présidents et deux conseils décisionnaires, cela est étrange pour un établissement public. C’est même probablement un cas unique dans notre droit administratif. Mais cela ne s’arrête, hélas, pas là. Les communautés d’universités et d’établissements telles qu’elles sont proposées seront également sources de problèmes de gouvernance insolubles. Vous allez créer des EPSCP - des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel - de niveau supérieur à d’autres EPSCP. À titre d’illustration, un problème va devenir classique : lorsque les établissements délégueront, par exemple, le doctorat à la communauté, les universités n’auront plus de doctorants, et donc, plus d’électeurs ni de candidats éligibles dans ce collège. Il faudra inévitablement modifier le décret no 85-59 si l’on souhaite prévoir une double participation, tout en conservant l’appartenance à un conseil uniquement. L’élection aux différents conseils ne va pas être simple non plus, car les listes qui seront constituées ne seront pas représentatives des électeurs des différents établissements qui constituent la communauté. Une université majoritaire peut prendre le pouvoir dans le cas d’élection au suffrage direct, mais peut le perdre dans le cas d’une élection au suffrage indirect. Tout cela relève du bricolage : sans doute avez-vous été inspirée par la désormais célèbre « boîte à outils » de M. Hollande. Une chose est sûre, madame la ministre, avec ce texte, les tribunaux administratifs ne manqueront certes pas de travail !

Franchement, tout ceci n’est pas très sérieux ! En plus, ces communautés, contrairement aux PRES - les pôles de recherche et d’enseignement supérieur -, ne vont pas travailler ensemble sur une base volontaire, mais vous allez leur imposer les choses. C’est une vision très dirigiste, pour ne pas dire soviétique, de notre enseignement supérieur et de notre recherche.

Oui, pourquoi pas, n’hésitons pas à le dire ! Là où nous avions procédé par incitations, afin de permettre le développement de stratégies originales, capables de développer des projets innovants, avec une telle vision, vous allez scléroser le milieu, en augmentant les lourdeurs et en inhibant la prise d’initiative des acteurs. Votre loi est finalement une régression en termes de gouvernance et d’organisation. C’est un autre danger majeur de ce texte. Mais ce n’est pas tout. Sous couvert d’État stratège, vous avez, en réalité, une vision extrêmement étriquée. Vous pensez que ce sont les conseils régionaux qui doivent devenir les décideurs en matière d’enseignement supérieur et de recherche. À cela, on peut au moins opposer deux critiques. D’une part, il est réducteur de considérer que l’enseignement supérieur et la recherche se situent à un niveau régional. N’oubliez pas que leur vocation est a minima nationale et qu’aujourd’hui, la compétition des savoirs se joue à une échelle internationale. D’autre part, je me demande si vous procéderiez de même si les conseils régionaux étaient présidés par des représentants de l’opposition. À cet égard, permettez-moi de vous le dire, votre vision est partisane et relève de la tambouille électoraliste. Votre gouvernement fait de même sur tous les sujets depuis son arrivée au pouvoir. Vous voulez ériger une France socialiste et perdez de vue l’intérêt général et l’intérêt supérieur. On ne peut que le déplorer. Là encore, les Français apprécieront. L’orientation de ce texte reste très hexagonale. Il est en décalage avec ce qui se passe dans l’enseignement supérieur partout en Europe et dans le monde. Vous voulez que toutes les universités et tous les établissements d’enseignement supérieur français se ressemblent, soient des clones, là où, au contraire, il faut stimuler l’originalité, faire respirer le système. Là où nous avions développé des statuts, par exemple ceux de l’université de Lorraine ou de l’université de Strasbourg, dont l’objectif était de s’adapter au projet des établissements, vous inversez les choses en imposant un statut unique et en limitant de fait les évolutions stratégiques et les prises d’initiatives originales. Vous parlez de réussite étudiante dans l’exposé des motifs, mais où sont les outils que vous proposez ? Que faites-vous pour l’insertion professionnelle de nos jeunes ? Que prévoyez-vous pour que l’enseignement supérieur et la recherche prennent pleinement leur part pour améliorer la compétitivité de notre pays ? À ces questions, point de réponses dans l’exposé des motifs, et encore moins dans le texte de loi. Pour finir, vous n’abordez pas des sujets pourtant essentiels, comme l’avancée de la sélection à l’entrée du master. Aujourd’hui elle se fait au milieu du master entre la première et la deuxième année. Le moment est venu de créer une cohérence d’ensemble au niveau du Licence-Master-Doctorat en avançant d’un an la sélection. De même, le moment semble venu pour se demander si le contribuable français doit payer les études des étudiants étrangers hors Union européenne. À l’heure où nos finances publiques connaissent des difficultés sans précédent, ne devrait-on pas, comme le font la plupart des autres pays, faire payer les étudiants étrangers ? Quitte à instaurer un système de bourse lorsque l’on considérera que l’on veut attirer de manière privilégiée des ressortissants de tel ou tel pays avec lequel on a développé des coopérations. De la même manière, si l’on veut continuer à développer l’attractivité de nos établissements d’enseignement supérieur et de recherche, il serait pertinent de développer des filières d’excellence. Là aussi, les amendements que nous avons portés jusqu’à présent n’ont pas été retenus. Cela montre clairement que vous passez à côté des vrais sujets. En conclusion, votre texte est avant tout inspiré par le souci de défaire ce qui a été fait au cours des cinq dernières années.

Pourtant, la politique menée de 2007 à 2012 en matière d’enseignement supérieur et de recherche a été un élan considérable, largement salué par tous les observateurs, nationaux comme internationaux, qui ont pu noter que la France avait modifié un certain nombre de conditions favorisant l’innovation et la prise d’initiative au-delà même du texte, parce que l’on faisait confiance aux acteurs, parce que nos établissements d’enseignement supérieur étaient en train de reprendre confiance en eux-mêmes. En refusant de poursuivre cette dynamique, non seulement vous portez un coup d’arrêt à notre enseignement supérieur et à notre recherche, mais vous retournez plusieurs décennies en arrière.

Vous l’aurez compris, pour nous, ce texte devrait être purement et simplement retiré parce qu’il n’est, hélas, pas à la hauteur des enjeux.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la jeunesse était présentée par le futur Président de la République pendant sa campagne électorale comme l’une des grandes ambitions du quinquennat. Cela appelait logiquement un projet consacré à l’école et un autre destiné à repenser, à certains égards au moins, l’université. Et il semble qu’une nouvelle initiative gouvernementale concernerait prochainement la formation professionnelle.

De fait, après le projet de loi de refondation de l’école, toujours en cours d’examen au Sénat, celui relatif à l’enseignement supérieur et la recherche nous est soumis à partir d’aujourd’hui. On pourrait y voir la réalisation cohérente et progressive d’un processus continu, d’un projet global tout au long des divers degrés d’enseignement, mais aussi d’un objectif de résultat visant une meilleure intégration de notre jeunesse et la construction de têtes bien faites à la façon de Montaigne.

Jusque-là, tout se présentait donc sous de bons auspices et nous pouvions, paraphrasant Héraclite, espérer l’inespéré. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’en aurons pas l’occasion, même s’il faut s’abstenir de tout jugement simpliste. À propos de méthode, le ministre de l’éducation nationale reprochait à certains parlementaires de raisonner davantage en termes de structures qu’en termes d’objectifs pédagogiques. Mais le présent projet de loi ne parle que d’instances, juxtapose des formations diverses comme on construit des châteaux de cartes, initie à grande échelle des fusions au risque de confusions et institutionnalise le méli-mélo au risque de l’imbroglio !

De la même façon, votre collègue avait décidé, madame la ministre, de laisser les parlementaires débattre seuls en commission de la loi relative à l’école alors que vous avez choisi de participer à tous nos travaux. M. Peillon avait choisi l’absence sous prétexte de liberté des débats parlementaires. En vous essayant à un galop d’essai avec les parlementaires, vous avez été plus coopérative. Et de cela, nous vous savons gré. Voilà donc une continuité gouvernementale de pensée qui se traduit d’emblée par une discontinuité de méthode. Cela dit, je tiens à rendre hommage au travail réalisé en commission sous la présidence courtoise et efficace de M. Bloche, avec, à la manoeuvre, un rapporteur, Vincent Feltesse, certes tenu par les objectifs du Gouvernement mais capable d’une véritable liberté de pensée, nourrie d’une maîtrise précise du sujet et de sa bonne humeur. Qu’ils en soient tous les deux remerciés. Et si l’économie générale du projet de loi n’a pas été substantiellement abonnie, comme on pourrait dire d’ un bon vin de Bordeaux, monsieur le rapporteur, par la qualité de ce travail préalable, certains aspects ont néanmoins fait l’objet de quelques évolutions positives.

Mais au fond, de quoi s’agit-il dans ce texte ? Il s’agit de savoir si le plus bel outil de l’excellence républicaine - avec l’école - répond ou non à sa vocation originelle en portant les feux plus loin. La loi en préparation a en effet pour objet la stratégie, l’organisation et les structures de l’enseignement supérieur et de la recherche publique, puisqu’il s’agit bien d’une loi d’orientation et non de programmation, ce qui dispense opportunément le Gouvernement de traiter de la question des financements. Il est vrai que les moyens du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ont progressé de 514 millions d’euros en 2013 dans la précédente loi de finances, soit une augmentation de 2,2 % qui le porte à 22,95 milliards d’euros. Pour autant, nous aurions souhaité savoir comment la plupart de nos universités parviendront à faire face à des difficultés financières tendancielles, et parfois à des situations critiques. Cette question n’est pas seulement budgétaire. Elle renvoie aussi au mode de sélection des étudiants, aux moyens effectifs de lutter contre les inégalités d’accès aux études supérieures, à la situation matérielle des étudiants, aux relations structurelles avec le monde économique, au-delà de dispositions symboliques ou insuffisamment opérantes, et avec les collectivités locales, plus spécialement les régions. Autrement dit, même dans une loi de programmation, ces questions auraient pu trouver à tout le moins des débuts de réponse. L’introduction en commission d’un article 1er bis disposant que l’État est le garant de l’égalité, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’enseignement supérieur n’y change pas grand-chose. Il nous semble plus proche de la déclaration d’intention, de l’enfilage de perles et de l’espérance diaphane sortie des tiroirs à slogan que d’une réalité tangible à laquelle viendrait véritablement contribuer le nouveau texte !

Mais revenons au fond et d’abord à la culture, c’est-à-dire notre langue, le français, et sa place dans notre enseignement supérieur. L’article 2 du projet de loi prévoit d’autoriser les enseignements en langue étrangère lorsqu’ils sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère, afin d’attirer les étudiants étrangers, notamment des pays émergents. On comprend bien la préoccupation : c’est celle de l’ouverture la plus large possible de nos universités au monde, celle de la mise en cohérence de l’enseignement avec l’internationalisation de la connaissance, de la transmission et de la recherche, celle du savoir universel formulé dans une langue universelle. Certains ont poussé des cris d’orfraie, espérant trouver leur voie dans le combat pour la langue. C’est un peu facile. Il n’en est pas moins vrai que nous ne devons pas faire d’un outil de rayonnement celui d’une nouvelle colonisation dont notre culture serait la victime. Car au fond, nous avons tendance, à bien des égards, à nous positionner comme un pays culturellement colonisé, alors même que, il y a seulement quelques semaines, nous adoptions en commission des affaires culturelles et de l’éducation une résolution relative à l’exception culturelle. C’est la raison pour laquelle le groupe UDI a proposé plusieurs amendements, dont l’un a été adopté par notre commission. Il vise à éviter que, de la nécessité de répondre à un besoin, l’on passe à un défaitisme tous azimuts, en conservant en effet à l’enseignement en français sa place prépondérante. Il précise que les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère.

C’est là, simplement, l’illustration de notre idée générale sur le sujet, qui distingue les impératifs de la civilisation des enjeux fondamentaux de la culture. Et ne vous y trompez pas : au-delà de l’amour que nous portons à notre langue, nous ne succombons pas à un quelconque angélisme. Bien au contraire, nous créons ainsi le terreau favorable qui fera des étudiants étrangers venus en France, au sortir de leurs études, des ambassadeurs de la culture française et de la francophonie. Nous saluons, à cet égard, l’adoption de l’article 2 bis , qui prévoit la publication d’un rapport d’évaluation…

Oui, un rapport, peut-être le seul, d’ ailleurs, sur l’emploi du français dans les établissements d’enseignement et sur l’évolution de l’offre d’enseignement du français comme langue étrangère à destination des étudiants étrangers. Mais il faut aller plus loin encore, en s’assurant que les étudiants étrangers bénéficient effectivement d’un accompagnement linguistique et culturel, tout comme les étudiants français pour des enseignements en langue étrangère. C’est ainsi que nous ferons de nos jeunes ressortissants les fers de lance de notre culture à l’étranger !

Au-delà, quel est le chemin à suivre pour l’université ? À notre avis, il est double. Il lui faut s’adapter à la modernité, répondre aux besoins fondamentaux de formation et fournir des enseignements pour les nouvelles économies, d’une part, et constituer un socle culturel, comme cela vient d’être illustré à l’instant à propos de la langue française, d’autre part. « Les Lumières dépendent de l’éducation et l’éducation dépend des Lumières », disait Kant. Cela suppose la cohérence, et un acteur de cohérence. De ce double point de vue, le projet de loi qui nous est soumis réaffirme le rôle de stratège qui est celui de l’État, et nous nous en félicitons. Les importants défis que doit relever l’enseignement supérieur imposent en effet une telle intervention pour atteindre un niveau de qualité soutenant la comparaison internationale, pour améliorer la gouvernance et la responsabilisation, mais aussi pour accroître et diversifier son financement. Ces objectifs majeurs concernent d’ailleurs tous les pays d’Europe et doivent être au coeur de l’agenda politique et des stratégies nationales des pays européens. Encore faut-il, en ce qui concerne la France, qu’on se donne les moyens de ce rôle de stratège. Cela suppose par exemple d’identifier des objectifs et des outils d’analyse prospective des évolutions économiques, démographiques et sociales, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Or rien de tel n’est précisé dans le texte. Cela induit également une relation claire avec les régions qui se voient placées à nouveau en haut de l’affiche, avec les risques que cela comporte et que notre rapporteur a lui-même identifiés. J’en ai moi-même évoqué d’autres. Et à la veille de l’ examen de textes sur la décentralisation, on aurait pu aussi évoquer le rôle futur des métropoles. Ce qui est certain, c’est que le projet universitaire national ne peut être piloté par une hydre dotée de plusieurs têtes qui auront toujours tendance à n’en faire qu’à leur tête !

Certes, le texte prévoit des efforts pour donner plus de densité à la mission de service public de l’enseignement supérieur. Mais cela ressemble étrangement à un habillage, comme on décore un cadeau avec du bolduc. Je pense en particulier à l’article 4 du texte, qui évoque la mission de l’enseignement supérieur en une sorte de patchwork de mots accumulés les uns aux autres, des mots qui sonnent bien, qui font plaisir, qui flattent, même, mais qui bavardent : la « diffusion des connaissances dans leur diversité », la « lutte contre les discriminations », la « réussite des étudiants », « l’attractivité des territoires à l’échelon local, régional et national », j’en passe et des meilleures. Mais au fond, madame la ministre, c’est une sorte de collage destiné à masquer l’idée sous-jacente que la société doit s’adapter à l’université plutôt que l’université à la société. Pourquoi ? Parce que la seule condition de l’évolution, c’est, dans le langage de la République, la liberté, ou, dans le langage universitaire, l’autonomie. Et cette liberté, cette autonomie, le texte qui nous est présenté la renie. Il ressuscite des structures fermées aux périmètres de plus en plus étendus et nivelle une organisation plurielle. En bref, il fait le choix de réduire l’autonomie des universités comme peau de chagrin, notamment en accumulant les contraintes institutionnelles et administratives et en conduisant à la disparition de spécialités qui contribuent pourtant à l’attractivité de notre enseignement supérieur. La gouvernance des universités est en effet le gros morceau du projet de loi. On l’attendait. Eh bien, c’est une vraie déception. La principale nouveauté réside dans la création d’un conseil académique. Notre collègue Patrick Hetzel a bien montré que cette idée ne manquait pas, a priori , de pertinence, si toutefois on l’orientait vers le rôle d’un Sénat académique, avec ses divers comités, comme dans les universités américaines. Ce n’est malheureusement pas le cas ici. Certes, cette nouvelle instance se voit attribuer des prérogatives délibératives, mais ses missions, sa composition et son fonctionnement semblent introduire des risques sérieux de distorsion dans l’organisation stratégique des universités. Et faute d’une définition rigoureuse de ses missions, elle introduit assurément des risques de concurrence avec le conseil d’administration. L’autre pièce du gros morceau, ce sont les dispositions relatives aux regroupements des établissements. Simplifier et assouplir les dispositifs, telle est l’ambition affichée. À cet effet, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée sont supprimés au bénéfice d’une structure de communauté scientifique qui s’applique à tout regroupement qui n’est pas une fusion.

On ne voit pas bien à quel objectif répond la création de ces grands « machins » standards, qui signent une approche administrative et étatique, non pas d’un État stratège mais d’un État sénescent, sans substance inventive et créative. C’est une sorte de retour en arrière, tant du point de vue des politiques publiques en général que des grandes réformes universitaires.

L’article 30 amendé du projet de loi a permis un certain assouplissement des conditions de création et de gestion des regroupements des universités. Mais c’est une avancée insuffisante, d’autant que nous en sommes restés par ailleurs à une sorte de centralisme très peu démocratique. Le texte du projet de loi précise en effet que « la politique territoriale de coordination est organisée par un seul établissement pour un territoire donné » et ajoute que « sur la base du projet commun, un seul contrat est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements regroupés ». Que se passera-t-il si la communauté a un projet commun dont les stipulations spécifiques propres à chacun des établissements regroupés sont refusées par les intéressés ? On parle aussi de coordination tout en spécifiant que la communauté scientifique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, tout comme une université. On crée donc en réalité des super-universités dotées d’organes décisionnels qui se superposent à ceux des universités membres. Tout comme une université, une communauté est dotée d’un conseil d’administration et d’un conseil académique, auxquels s’ajoute un conseil des membres. Il existe cependant une différence capitale dans la composition du conseil d’administration : outre des représentants des établissements et organismes de recherche, celui-ci comprend 30 % de personnalités qualifiées et 40 % de représentants élus, au suffrage direct ou indirect, des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, des autres personnels, et des étudiants. Ainsi, les élus ne sont pas majoritaires au conseil d’administration de la communauté, alors qu’ils le sont nettement dans les conseils d’administration des universités membres. Comment faire coexister ces deux niveaux de conseil d’administration construits sur des principes aussi différents ? C’est en tout cas un pari d’arriver à faire fonctionner ces deux étages sans blocage. Si ce dispositif était adopté, la France disposerait d’un système unique au monde où les universités traditionnelles s’effaceraient - au moins pour tout ce qui concerne la stratégie - au profit de ces super-universités régionales qui seraient le plus souvent des mastodontes gouvernés par des conseils empilés. Nous risquerions d’y perdre ce qui fait la qualité des formations et des laboratoires : la liberté d’initiative des acteurs, la collégialité et la diversité qui, partout dans le monde, se déploient dans des universités de taille raisonnable où la subsidiarité est la règle. La disparition des spécialités de masters procède de la même logique. Elle aboutit à des conséquences tout aussi inquiétantes, par la standardisation et l’anonymat des diplômes, et par le nivellement par le bas. À terme, on risque de voir se développer, pour les professions techniques comme celles du droit, un enseignement supérieur privé à vocation étroitement professionnelle. Ce choix pose une question fondamentale à terme : celle de la non-sélection des bacheliers à l’entrée des universités. Ce choix est éminemment respectable mais, pour pratiquer une quasi-gratuité, pour garder ses bons étudiants, pour assurer le renouvellement académique et de la recherche, pour maintenir et développer des formations internationalement reconnues, il faut laisser aux universités le choix de spécialités attractives. Il faut préserver leur liberté d’entreprendre et d’innover. C’est le choix inverse qui a été retenu dans ce projet de loi. L’enseignement numérique relève de la même logique d’uniformisation. Sur ce sujet, il faut de la cohérence, mais elle doit être placée au service de la diversité et de l’esprit de création et d’innovation. C’est dans cet esprit que le groupe UDI suggère que l’agence de mutualisation des universités soit chargée de la mutualisation en logiciels libres des ressources logicielles entre les universités, pour leur gestion, pour les dispositifs d’enseignement et pour les outils destinés à la recherche, et de la mutualisation dans des formats ouverts des contenus numériques. En conclusion, nous déplorons que le mouvement vers une autonomie de l’enseignement supérieur raisonnée et adaptée aux enjeux de notre temps ne trouve pas à se poursuivre dans ce projet de loi. La France, ce pays où les professeurs des universités sont encore nommés par décret du Président de la République, s’engage à contre-courant de toutes les grandes organisations universitaires du monde. Au lieu de faire le choix de la souplesse des organisations, de l’excellence et de la diversité des enseignements, elle opte pour des rigidités empilées au prétexte d’une idée de l’égalité qui produira, au final, exactement l’inverse. Nous espérons que les discussions qui vont s’engager permettront au moins de limiter les effets les plus inquiétants de ce texte, qu’il nous semble très difficile de soutenir en l’état.
Applaudissements sur les bancs des groupes UDI et UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, j’ai eu l’occasion d’intervenir lors des débats sur la refondation de l’école pour dire combien l’éducation doit être une priorité. Notre République a le devoir d’offrir à notre jeunesse les outils lui permettant de relever les défis de demain. Cet engagement concerne en tout premier lieu l’école. De la crèche au lycée en passant par la primaire, la maternelle et le collège, la même qualité d’accueil doit être proposée, quels que soient le territoire concerné ou les conditions de vie de l’enfant ou du jeune. Mais nous ne devons pas nous arrêter là et prétendre que le bac suffit aujourd’hui pour trouver un travail et s’accomplir dans notre société. Non, évidemment, dans la plupart des cas, le bac est une porte d’entrée vers un autre univers, celui de l’enseignement supérieur et de la recherche. Offrir à notre jeunesse les outils lui permettant de relever les défis du XXIe siècle, c’est donc aussi s’intéresser de près à l’enseignement supérieur et à la recherche. Investir dans ces secteurs, c’est préparer l’avenir et façonner la société de demain. Dans le contexte de crise structurelle que nous connaissons, c’est dès aujourd’hui qu’il convient de penser les enjeux et d’anticiper les transformations nécessaires. L’enseignement supérieur doit donner à notre jeunesse la formation nécessaire lui permettant de s’épanouir professionnellement et personnellement dans notre société. Quant à la recherche, il s’agit du lieu par excellence de la production des savoirs. La recherche, c’est créer de nouvelles connaissances et comprendre le monde ; c’est aussi le moteur de l’attractivité de notre pays, de son développement économique et de sa capacité d’innovation technologique, bien sûr, mais aussi de sa transformation écologique, urbaine, sociale et citoyenne. Les enjeux sont grands et nous attendons donc beaucoup de cette réforme. La LRU et le plan campus ont rapidement montré leurs failles et limites alors même que les conditions de vie des étudiants ont empiré. C’est pourquoi il convient d’agir, pour donner aux générations en train de se former des conditions de vie et de travail meilleures dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, pour permettre aux chercheurs d’investir les champs essentiels pour le XXIe siècle, et pour stimuler une création responsable - pour ne pas dire écoresponsable. La réforme qui nous est proposée ici comporte, certes, quelques avancées. Je laisse à ma collègue Isabelle Attard le soin de les exposer tout à l’heure et d’évoquer plus précisément les différents aspects du texte. Mais nous attendons encore beaucoup plus. Nos attentes concernent tout d’abord la réussite des étudiants. Je pense par exemple à la nécessité de renforcer les liens entre le secondaire et l’enseignement supérieur, car il semble aujourd’hui plus facile d’accabler une prétendue impréparation des lycéens que de repenser notre système pour atténuer les différences qui existent entre lycées et universités et mieux accompagner les étudiants. Renforcer la pluridisciplinarité, accompagner les élèves face aux évolutions méthodologiques ou encore développer les passerelles sont autant de pistes à renforcer. Bien sûr, je ne peux évoquer la question de la réussite des étudiants sans revenir sur le combat à mener contre les inégalités sociales. Notre système éducatif est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus inégalitaires parmi les pays membres de l’OCDE. Nous l’avons dit et redit lors des débats sur la refondation de l’école. Il ne serait pas raisonnable de croire qu’il en va autrement en ce qui concerne l’enseignement supérieur et la recherche. Nous sommes, en effet, encore très loin de la démocratisation tant proclamée. De nombreuses pistes existent pour passer d’une massification à une réelle démocratisation, parmi lesquelles le renforcement du taux d’encadrement en premier cycle, la révision du système de sélection mis en place à l’entrée des grandes écoles, ou encore le rapprochement entre les universités et les classes préparatoires aux grandes écoles. D’ailleurs, outre le fait qu’un étudiant en classe préparatoire devrait obligatoirement être inscrit à l’université - nous avons fait un pas en ce sens lors des débats en commission -, nous considérons que les classes préparatoires ne devraient plus dépendre du budget de l’éducation nationale mais de celui de l’enseignement supérieur. Autre point sur lequel nos attentes sont grandes : la mise en place d’une allocation d’autonomie, promesse de campagne de notre Président de la République, réitérée récemment. On sait que 23 % des jeunes entre dix-huit et vingt-quatre ans vivent sous le seuil de pauvreté. Les conséquences de cette précarité sont graves : renoncement aux soins faute de moyens financiers, problèmes de logement, mais aussi taux d’échec important des étudiants salariés. À quand la mise en place de l’allocation d’autonomie que nous appelons de nos voeux depuis trop longtemps maintenant ? Cette situation ne doit pas faire oublier celle des 50 000 précaires dans l’enseignement supérieur et la recherche. La précarité des jeunes chercheurs et des personnels mérite elle aussi un volontarisme politique fort. Je salue, à cet égard, le premier pas que constitue la titularisation que vous avez annoncée, madame la ministre, même si le manque de moyens reste criant. Au-delà, nous demandons aussi la mise en place d’un véritable statut du doctorant. Permettez-moi également quelques mots sur l’égalité territoriale. À l’université de Picardie Jules-Verne, 56 % des étudiants inscrits en première année de licence sont des élèves boursiers. Cette situation engendre un coût important pour l’université, qui n’est, hélas, que partiellement compensé par l’État. Cet exemple n’est pas rare : en conséquence, j’en appelle à votre vigilance, madame la ministre, afin qu’une péréquation territoriale digne de ce nom soit mise en place. Autre inégalité qui mérite toute notre attention : la place des femmes. Des amendements ont été adoptés en commission : c’est un grand pas, mais il faut continuer. On ne peut, en effet, que regretter qu’à invoquer constamment les évolutions lentes mais positives en matière d’égalité, les générations passent et l’injustice demeure. Seul le volontarisme peut véritablement contrecarrer la multiplicité des résistances à l’égalité hommes-femmes. J’insiste donc sur la nécessité de se doter de comités paritaires de recrutement des enseignants-chercheurs : cela serait un pas de plus en faveur de l’égalité femmes-hommes. Par-delà la gouvernance, il conviendrait également de rattraper notre retard en termes de formation et recherche sur le genre, et d’aller plus loin encore dans le travail entrepris pour dépasser les stéréotypes qui féminisent ou masculinisent certaines formations ou spécialités. Enfin, vous connaissez mon engagement en faveur d’une société inclusive, où toute personne, quel que soit son handicap, aura sa place. Aussi, je ne peux que regretter l’insuffisance de ce projet de loi à cet égard, car l’objectif de créer une société et une université inclusives mérite d’être clairement affirmé. Ce sont des enjeux essentiels, dont nous aurons l’occasion de reparler au cours de nos débats.
Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour entamer les discussions autour du projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, avec l’ambition affichée de la réussite étudiante dans un système collégial. C’est l’ambition de la construction d’un nouveau modèle français, celui d’une nouvelle gouvernance. En premier lieu, je tiens à souligner la démarche initiée, qui a permis la rédaction de ce projet de loi. Véritable lieu de concertation et d’échanges, les assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui ont réuni pendant plusieurs mois l’ensemble des forces vives du pays, ont permis de faire émerger des propositions qui ont été traduites dans le texte qui nous est présenté. Je tiens aussi à souligner l’excellente relation que nous avons eue avec votre cabinet, madame la ministre. Je ne reviendrai pas sur l’article 2 du projet de loi, ni même sur l’orientation et la réorientation des étudiants. Je ne reviendrai pas non plus sur l’organisation des stages, ni même sur le statut des enseignants-chercheurs et doctorants : mon collègue Thierry Braillard l’a fait brillamment tout à l’heure.

En revanche, je veux revenir sur la série d’articles qui instituent la nouvelle gouvernance des universités. Alors que la loi LRU a clairement institué un pouvoir présidentiel fort qui découle essentiellement du mode de désignation et de la réduction du nombre de membres du conseil d’administration, privant une grande partie de la communauté universitaire de représentation, le projet de loi ESR propose, à l’inverse, d’augmenter la taille du conseil d’administration, qui sera élargi à des personnalités extérieures. Ces dernières seront au nombre de huit et participeront à l’élection du président : il s’agit d’un changement majeur et hautement symbolique. L’augmentation des effectifs du conseil d’administration devrait permettre une représentation plus équilibrée des différentes catégories qui le composent. La réduction de l’avantage apporté par une prime majoritaire, qui écrasait les minorités au sein de chaque corps, devrait faciliter la construction de communautés universitaires soudées au service d’intérêts communs et devrait enfin assurer la continuité de la vie démocratique dans les établissements. Toutefois, le groupe RRDP, toujours partisan d’une collégialité accrue, aurait préféré une présence plus forte des représentants des étudiants et du personnel administratif, qui demeurent encore minoritaires. L’article 27 propose d’instaurer, parallèlement au conseil d’administration, un conseil académique regroupant les commissions formation et recherche, doté d’attributions en matière de recrutement et de suivi de carrière des enseignants-chercheurs. Je crois que votre objectif affiché, « rendre la gouvernance des universités plus démocratique », est atteint. Le groupe RRDP souhaite, par ailleurs, que le Gouvernement se penche sur la question des IUT.

À ce titre, nous avons déposé trois amendements, aux articles 18 et 28. Les IUT sont, véritablement, des acteurs du développement économique des territoires et de l’ascension sociale. Pour éviter une trop grande intégration des bacheliers technologiques en IUT et anticiper une logique de quotas, nous souhaitons que l’accès aux IUT des titulaires d’un baccalauréat technologique fasse l’objet d’une proposition élaborée par le conseil de l’institut, concertée avec le recteur et inscrite dans le contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’IUT et l’université. Enfin, je voudrais terminer mon propos en évoquant la mise en place des communautés d’universités. Même si l’objectif avoué est clair, affronter la concurrence des universités européennes dans un contexte de décentralisation, nous avons un doute sur le caractère obligatoire d’une telle mesure alors même que des exemples récents, à Strasbourg, à Aix-Marseille et en Lorraine, prouvent que de tels regroupements se sont opérés spontanément. Les universités ne sont-elles pas capables de dessiner seules leur territoire ou alors souhaitez-vous veiller au risque d’un accroissement des inégalités territoriales ? C’est la question que nous posons. L’ensemble des amendements du groupe RRDP qui sont aujourd’hui soumis à votre approbation, madame la ministre, monsieur le rapporteur, sont fidèles à l’esprit du projet de loi qui nous est proposé aujourd’hui. Je me félicite du dialogue constant et particulièrement constructif que nous avons pu avoir avec votre cabinet, madame la ministre, et j’espère que les débats que nous aurons dans cet hémicycle permettront d’avancer un peu plus sur nombre de nos propositions. Ce projet de loi représente une avancée démocratique indéniable ainsi qu’une ouverture des universités sur leur environnement au bénéfice du plus grand nombre. Pour toutes ces raisons, madame la ministre, vous pourrez compter sur notre soutien pour cette belle ambition : faire réussir notre jeunesse et faire réussir notre pays !
Applaudissements sur les bancs des groupes RRDP, SRC et GDR.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, parce qu’il leur incombe de préparer l’avenir et d’ouvrir les horizons, de répondre aux aspirations des jeunes et aux demandes de la société, l’enseignement supérieur et la recherche se trouvent au carrefour de multiples enjeux. Les mutations du monde moderne renforcent encore, s’il en était besoin, les attentes à leur égard. C’est ce qui explique sans doute la succession de réformes que l’un et l’autre ont connue durant cette dernière décennie. Ce nouveau projet de loi est issu, même s’il n’en reprend pas toutes les propositions, des assises qui se sont tenues durant plusieurs mois sur l’ensemble du territoire national. Il a donc pour vocation d’apporter des réponses aux difficultés réelles que les précédentes lois n’ont pas su résoudre, quand elles ne les ont pas tout simplement créées. Ce texte qui, de manière inédite, réunit l’enseignement et la recherche, s’articule autour de trois grandes ambitions. D’abord, promouvoir la réussite des étudiants aux examens et atteindre enfin l’objectif déjà ancien de voir diplômés du supérieur 50 % des jeunes d’une classe d’âge. Ensuite, donner une nouvelle ambition à la recherche. Enfin, définir une nouvelle architecture de l’enseignement supérieur et de la recherche. La démocratisation de l’enseignement supérieur n’a pas tenu sa promesse d’égalité des chances. Au lieu de se résorber, les inégalités se sont entassées, un système de sélection qui ne dit pas toujours son nom s’est mis en place, les stratégies de contournement se sont perfectionnées et bien des parcours ont été choisis par défaut. Une véritable hiérarchisation s’est établie entre les différentes voies que propose l’enseignement supérieur, où l’université n’occupe pas toujours la place la plus enviable. On constate d’ailleurs une certaine désaffection à son égard puisqu’elle accueille un pourcentage de bacheliers toujours moins important, notamment lorsqu’ils sont issus des filières générales. De fait, l’université est le réceptacle des inégalités dans l’enseignement supérieur. L’échec dans le premier cycle, que nous déplorons tous, est surtout celui des étudiants inscrits à l’université. C’est là où les taux de réussite aux examens se sont le plus dégradés. Là aussi où les interruptions d’études sont les plus fréquentes. La situation est connue. Les chiffres viennent d’être actualisés. Seulement 27 % des étudiants de la promotion 2008 ont obtenu leur licence trois ans plus tard. Le plan Réussite en licence n’a rien changé. Pire, les résultats sont même en recul de deux points. Cette présentation globale se double, pour la première fois, de données chiffrées par établissement. Ainsi, il est non seulement possible de repérer de manière précise les initiatives porteuses d’améliorations et d’appréhender comment l’autonomie des universités s’est traduite dans le premier cycle, mais également d’évaluer l’ampleur des moyens que chaque établissement devra déployer. Pour l’université de la Réunion, l’effort devra être important. En effet, l’indicateur qui mesure le taux de passage L1L2 montre qu’à peine 20 % des étudiants ont accédé en un an à la deuxième année. Pour huit étudiants sur dix, la première inscription à l’université débute donc par un échec. Ce pourcentage est vertigineux. Il révèle aussi une dégradation préoccupante de la situation puisqu’en une décennie il a augmenté de dix points. De plus, au lieu de se résorber, l’écart avec la moyenne nationale – 43 % – a encore augmenté. Une part de l’explication de ce chiffre est sans doute à rechercher dans les caractéristiques et le contexte de cette jeune université, créée il y a tout juste trente ans, et qui accueille un nombre important d’étudiants boursiers. Ces particularités sociales sont d’ailleurs prises en compte dans les évaluations officielles et elles aboutissent au calcul d’un taux simulé. Pour la Réunion, ce taux simulé est de 31,3 %. En le rapprochant du taux de réussite réel ou brut – 19,8 % –, l’écart est encore de 11,5 points. Il est urgent d’interroger de manière précise cet écart si l’on veut mettre un terme à la dégradation continue des résultats. L’autre indicateur, celui qui mesure le taux de réussite en licence en trois ans, confirme cette inquiétante évolution. Le retard avec la moyenne nationale est de 10 points et l’écart entre le taux réel ou brut et le taux simulé est de moins 6. Plus qu’ailleurs sans doute, il est indispensable de briser, avant qu’il ne soit trop tard, le cercle vicieux qui menace notre université. Avec des résultats toujours plus défavorables, elle devient de moins en moins attractive aux yeux des étudiants et de leurs familles qui la désertent dès qu’une autre filière leur est accessible. L’université de la Réunion n’accueillerait plus, chaque année, que 2 500 des 7 000 bacheliers de l’académie. Parmi eux, on trouve une bonne partie des bacheliers issus des baccalauréats technologiques et professionnels, contraints de suivre les filières généralistes. L’article 18 prévoit de leur donner – il faudrait dire de leur redonner – un accès prioritaire aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, à ces STS et IUT créés à l’origine à leur intention. Cette disposition, que nous saluons, risque toutefois de se heurter très vite au grand décalage entre le nombre de bacheliers concernés et les capacités d’accueil de ces filières. Il serait utile que cette disposition phare s’accompagne, en liaison avec le rectorat pour les STS, d’une réévaluation de ces formations. Au-delà des statistiques, nous ne devons pas perdre de vue le découragement, l’incompréhension et parfois la colère générés par des échecs qui se paient au prix fort, et peuvent aller jusqu’à déterminer un destin, comme vous le savez. Ce projet de loi prévoit un certain nombre de mesures pour lutter contre l’échec à l’université. Qu’il s’agisse d’une orientation mieux adaptée des étudiants, d’une plus grande harmonisation entre le secondaire et le supérieur – le « -3 +3 » –, ou d’une spécialisation moins précoce, elles ne peuvent qu’agir dans la bonne direction. Mais, par-dessus tout, il est crucial de rétablir la confiance des étudiants, et plus généralement de la société, dans l’université. Cela passe bien sûr par la qualité des formations dispensées, et par leur invitation constante à comprendre et donc à interroger le monde. Cela passe aussi par une meilleure compréhension d’un système qui s’est beaucoup complexifié au fil du temps. Le choc de simplification proposé dans le maquis des licences et masters est bienvenu. Rendre l’université plus attractive, c’est aussi s’intéresser aux perspectives qu’elle offre. La reconnaissance du doctorat, que la France est le seul pays à négliger à ce point, ne peut que rejaillir sur l’ensemble des diplômes délivrés par l’université. Programmer la résorption de la précarité qui est le lot d’un trop grand nombre de personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche serait aussi un signal fort à la fois en direction des jeunes, de la recherche, et de l’université. La question de l’insertion professionnelle est forcément présente dans tous les esprits et conditionne souvent les choix. Cette préoccupation légitime ne doit toutefois pas conduire à proposer des formations régies par le court terme des marchés ou la conjoncture d’un moment. Créer ou, au contraire, supprimer une filière ou un cycle de formation est une décision encore plus lourde de conséquences quand il s’agit d’une des rares universités francophones de l’océan Indien. Au début de cette semaine encore, des étudiants m’ont fait part de leur vive inquiétude. Ces jeunes terminent leur licence de chimie ou de physique en juin prochain et craignent beaucoup de ne pas pouvoir mener leur cursus à son terme. Non pas du fait de leurs résultats, non pas parce qu’ils n’auraient pas réussi, mais tout simplement parce que l’université de la Réunion où ils sont inscrits vient de décider de supprimer le master Métiers de l’enseignement mention Physique-Chimie, qu’ils avaient l’intention de suivre. Pour ceux qui en ont les moyens – notamment financiers –, la fermeture de ce master signifie quitter l’île et s’inscrire dans une université située en France continentale. Pour les autres, la fin de ce master veut dire réorientation par défaut ou alors abandon de leurs études et de leur projet professionnel. L’ultrapériphéricité de notre université oblige à veiller encore davantage à ce que l’offre de formations supérieures proposée aux étudiants soit aussi diversifiée que possible. Tout comme elle nous rend particulièrement réceptifs à l’ambitieux plan numérique des articles 6 et 16 dont la réussite passera nécessairement par une égalité numérique réelle entre les territoires. Précisons dès à présent qu’en raison des surcoûts dus à l’éloignement, le débit dont dispose actuellement l’université de la Réunion est dix fois inférieur à celui de la plus petite université de France continentale. Agir pour la réussite des étudiants suppose forcément une action soutenue pour améliorer leurs conditions de vie. Nous regrettons que ce texte n’aborde pas dès à présent cet aspect si déterminant. La précarité est le lot d’un nombre croissant d’étudiants, et le niveau de prise en compte de cette réalité conditionnera les objectifs de cette loi. Dans l’attente des résultats de la mission interministérielle, je veux simplement mettre l’accent sur l’épineuse question du logement étudiant. Dans l’académie de la Réunion, alors que la moitié des étudiants sont boursiers, et le plus souvent à l’échelon maximum – rappelons que 50 % de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté – , à peine 6 % d’entre eux sont logés par le CROUS. Le retard accumulé depuis la parution du plan Anciaux est considérable. En ce qui concerne la recherche, qui constitue la deuxième ambition de ce texte, il me revient de souligner que l’agenda stratégique, qui sera inscrit dans la loi, doit aussi prévoir des thématiques en phase avec les priorités des établissements d’outre-mer, comme par exemple les recherches dans le domaine maritime. J’insiste d’autant plus sur ce point que le programme-cadre européen intitulé « Horizon 2020 », dans lequel s’inscrira la stratégie nationale de la recherche, a, de manière surprenante, totalement fait l’impasse sur les océans. L’université de la Réunion est le plus important établissement européen d’enseignement supérieur et de la recherche de l’océan Indien. Elle se trouve donc dans une zone qui se caractérise par des investissements massifs dans la formation, la recherche et l’innovation.Des accords de coopération ont déjà été signés, par exemple avec des universités indiennes, mais il est évident que les perspectives peuvent être bien plus larges. De manière certes moins exclusive qu’en 2007, ce texte s’intéresse à nouveau aux questions de gouvernance avec une architecture renouvelée à bien des égards. Il s’attache aussi à combler les lacunes juridiques que l’application de la loi LRU a fait apparaître, notamment – vous vous en souvenez, madame la ministre – lors des élections à l’université de la Réunion. Une procédure est proposée qui lie la destitution du président à la dissolution du conseil d’administration et, indirectement, à celle du conseil académique. Mais il est à craindre qu’appliquée au cas précis d’annulation des élections, cette procédure générale n’amène à substituer au vide juridique un trop-plein d’élections. Plus généralement constaté, l’autre vide juridique concerne la parité. La diminution brutale, lors du dernier scrutin, du nombre de femmes élues à la présidence d’une université impose une réponse forte. L’obligation de présenter des listes paritaires strictes aux élections des conseils centraux est donc saluée, surtout si elle joue le rôle d’accélérateur de parité. Ce projet de loi est le rendez-vous par excellence avec la jeunesse. Il est donc attendu par tous et sera apprécié tant sur ses effets immédiats que sur l’élan qu’il aura su impulser.
Applaudissements surles bancs du groupe GDR et sur quelques bancs du groupe SRC.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, notre collègue Hetzel parlait tout à l’heure de précipitation et de manques de moyens. Dois-je rappeler qu’en 2007, la loi LRU a été soumise au conseil des ministres en juin puis examinée en toute hâte par le Parlement pendant la session extraordinaire de juillet ?

Quelle différence avec le choix retenu par Mme la ministre pour préparer ce projet de loi : des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, un rapport demandé au président de l’OPECST, Jean-Yves Le Déaut, un travail en commission dont tout le monde reconnaît la qualité, y compris M. Salles, et aujourd’hui notre discussion. Je crois que la précipitation a plutôt été le fait de votre camp, mon cher collègue Hetzel. Vous avez évoqué timidement les moyens. Dois-je vous rappeler la situation qu’a trouvée Mme la ministre à son arrivée au ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur ? Les bourses étudiantes n’étaient pas financées.

La masse salariale de certaines universités n’était pas non plus financée car le GVT, le glissement vieillesse technicité, n’avait pas été pris en compte. J’en resterai là s’agissant des moyens mais, mon cher collègue, il faut se souvenir de cette période encore récente. Une seule question se pose : pourquoi ce projet de loi ? Pour quatre raisons, à mon sens. La première – et M. Salles l’a soulignée honnêtement – tient à la volonté de remettre l’État au coeur de la politique universitaire et de recherche de notre pays. Car vous avez fait un contresens, mesdames, messieurs de l’opposition. Vous avez pensé que l’autonomie des universités – qui est utile, que nous défendons – passait par l’effacement de l’État. Or une autonomie des universités bien comprise passe par le lien avec un État qui définit, aux niveaux national et international, les priorités de la recherche et de l’enseignement supérieur, lien qui se noue par le contrat. Ce que rétablit aujourd’hui ce projet de loi est quelque chose d’essentiel, souhaité, au-delà de nos différences, par un grand nombre d’universitaires, de chercheurs et d’observateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. La deuxième raison tient à la gouvernance, qui n’est pas un gros mot. Il s’agit tout simplement de répondre à la question de savoir comment concilier le pouvoir présidentiel, utile au sein de l’université, et un travail collectif et démocratique. Je pense que les propositions de Mme la ministre et le travail accompli en commission parviennent à un juste équilibre. La troisième raison tient au rapport avec les territoires. Vous savez mon opinion sur ce sujet : depuis très longtemps, je suis hostile à la régionalisation des universités. Elles ne doivent pas passer d’une centralité totale à une régionalisation, ce serait un complet contresens. L’État doit avoir l’intelligence de travailler avec des universités autonomes, en rapport étroit avec les collectivités locales, en particulier les régions. C’est ce à quoi tendent les communautés universitaires. Une des limites du précédent projet de loi – nous l’avons bien vu avec les investissements d’avenir – était qu’il reposait sur une carte de France qui n’était pas satisfaisante pour nous avec des pôles d’excellence d’un côté et de l’autre des colleges au sens américain du terme, c’est-à-dire des premiers cycles dans beaucoup d’universités.

C’était un contresens. Et je crois que la ligne qui est tracée aujourd’hui rétablit les choses dans le bon sens. La quatrième raison renvoie à une question essentielle qui se posait à nous comme au Gouvernement : celle de l’avenir des étudiants, de la lutte contre l’échec et d’une meilleure orientation. Je crois que toutes les propositions qui sont faites aujourd’hui participent de cette volonté de lutter contre l’échec universitaire, qu’il s’agisse des quotas – qu’on aime ou pas cette expression, c’est une solution réclamée par le Conseil d’État – au niveau des IUT et des BTS, ou qu’il s’agisse de l’orientation envisagée, ou encore des licences pluridisciplinaires. Enfin, l’essentiel est peut-être que le Gouvernement, avant même la discussion ce projet de loi, a rouvert notre université sur le monde en supprimant cette circulaire, impossible, ignoble, qu’était la circulaire Guéant. Et je ne comprends pas que les ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’époque aient pu accepter une telle mesure, qui fermait notre pays aux étudiants étrangers et donnait une image épouvantable de notre pays.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Je ne m’étendrai pas sur l’article 2. Pour en avoir discuté avec Mme la ministre, j’indiquerai simplement que l’idée que veut faire passer le Gouvernement est essentielle.
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Il s’agit d’élargir le recrutement d’étudiants étrangers au-delà des zones de la francophonie.

Si nous voulons élargir la francophonie, il faut faire venir des étudiants étrangers, en particulier du Sud-Est asiatique, qui ne parlent pas notre langue : après avoir vécu un certain nombre d’années dans notre pays, ils repartiront en connaissant le français. C’est un combat noble, un combat important pour notre université.

Je terminerai par l’initiative relative aux doctorants. C’est sans doute l’un des signes les plus forts : faire reconnaître enfin la place du docteur dans les conventions collectives et dans les administrations. Nous avons aujourd’hui un grand retard en ce domaine par rapport à d’autres pays européens et extra-européens. Cette mesure, dont la mise en place prendra du temps, est utile. Je ne jette pas à la poubelle tout ce qui a été fait précédemment, chers collègues de l’opposition.
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Simplement, acceptez comme nous d’évaluer, à un moment ou à un autre, une loi votée il y a cinq ans et autorisez-nous à répondre à certaines questions, forts de nos convictions. Les réponses apportées aujourd’hui sont dans l’intérêt des étudiants, de l’université et de la recherche française.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la ministre, vous l’avez dit hier, une des fonctions de l’enseignement supérieur est de permettre une bonne insertion des étudiants. Comme l’ont écrit dans un quotidien du soir deux universitaires, Philippe Aghion et Jean Tirole : « Une université qui ne produit ni recherche de niveau européen, ni innovations et brevets menant à des créations d’entreprises, ni bonne insertion professionnelle, ne contribue ni à l’emploi, ni à la croissance ». On voit donc bien le lien essentiel qui existe et qui doit être affirmé et renforcé entre l’enseignement supérieur et la recherche, d’une part, et l’économie et les entreprises d’autre part, donc l’emploi et la compétitivité. C’est aujourd’hui plus vrai encore parce que la concurrence internationale oblige plus que jamais à l’excellence et parce que la progression foudroyante du chômage, y compris chez les diplômés, oblige à cette corrélation entre formation et emploi. Le dire est une bonne chose, le faire en est une autre. Deux types d’obstacles, pourtant, me font douter de votre efficacité en la matière. Le premier est d’ordre idéologique. Cela m’est apparu lors de la discussion des amendements en commission. Avec Sophie Dion, nous avions déposé un amendement visant à ce que les enseignements universitaires puissent développer l’esprit d’entreprise. Vous avez eu une réaction embarrassée et peu favorable, préférant la notion de « formation à l’entreprenariat », moins compromettante sans doute à vos yeux. Cela révèle finalement votre malaise et votre ambiguïté. Accepter des amendements visant à ajouter les mots « sociaux, environnementaux et culturels » après le mot« économiques » ne semble vous poser aucun problème : ils sont politiquement corrects. En revanche, favoriser l’esprit d’entreprise, l’envie de créer son entreprise, c’est une tout autre affaire. Au fond, il y a toujours pour vous une prééminence de la fonction émancipatrice, donc individuelle, du savoir sur l’innovation au service de l’économie. C’est aussi la ligne du collectif Langevin. Je crois pourtant que les deux sont absolument compatibles. Dira-t-on jamais assez la valeur émancipatrice du travail ? Le deuxième type d’obstacle est d’ordre technique, voire tactique : il concerne le lien par transfert technologique entre l’université et l’entreprise. Il y a trente ans, on pensait que notre économie pouvait se satisfaire des innovations produites par notre recherche scientifique et qu’il importait peu que la production soit laissée à des pays étrangers à moindre coût de main-d’oeuvre. La désindustrialisation qui en a résulté continue à produire aujourd’hui encore ses effets dévastateurs. Funeste erreur ! La question du transfert, qui met en relation recherche et production, est insuffisamment développée dans votre loi. C’est même, à en croire Gilbert Bereziat, président honoraire de l’Université Pierre et Marie Curie, l’« une des causes de la désindustrialisation qui résulte du fait que, dans notre pays, les meilleures universités en recherche sont insuffisamment au contact des entreprises grandes et petites et que le concept de "parcs d’innovation" dans ou à proximité des universités a été pour le moins négligé ». « Il faut, ajoute cet universitaire, mettre la recherche au service de l’innovation et l’innovation au service de la création de la valeur ajoutée. » C’est aussi ce que confirme Louis Gallois, président du Commissariat général à l’investissement, récemment auditionné par le groupe d’études sur les PME, qui parle même de « vallée de la mort » où se perdent des projets privés de l’accès à l’industrialisation. C’est donc selon moi une question majeure. Le lien entre l’enseignement supérieur et les territoires n’est pas moins important à mes yeux et je vais pour cela vous donner l’exemple de ma région, le Haut-Doubs, terre où autrefois l’horlogerie était florissante, à deux pas de la Suisse qui a su porter cette filière au niveau d’excellence technique et esthétique qu’on lui connaît aujourd’hui. Dans cette petite région française, sont dispensées des formations supérieures en microtechnique, en horlogerie et en bijouterie. Elles produisent chaque année des promotions d’étudiants qui sont embauchés à 100 % en Suisse où se trouvent les usines et aussi de bons niveaux de rémunération. Bien sûr, on aimerait avoir en France un aussi beau tissu industriel. Cela reviendra peut-être si dans notre pays, on encourage un peu plus les chefs d’entreprise, si l’on éveille un peu plus chez nos jeunes l’esprit d’entreprise, si l’on soutient résolument le « fabriqué en France ». Mais en attendant, nous devons favoriser les expérimentations transfrontalières. Certains de nos collègues ont du reste évoqué, par amendement, la question transfrontalière. Ici, en France, la formation ; là, en Suisse, les emplois : impossible aujourd’hui d’organiser la formation en alternance entre nos deux pays, avec la formation assurée dans un pays et l’alternance dans les entreprises de l’autre pays. Pourquoi ne pas imaginer la création de chaires d’entreprises suisses dans des établissements d’enseignement supérieur français ? Pourquoi ne pas imaginer des plateformes transfrontalières de formation ? Il y a là des gisements intéressants d’innovations. Le lien avec le territoire est essentiel. Si nous négligeons ce lien entre l’enseignement supérieur et la recherche d’une part, et l’économie, les entreprises et le territoire d’autre part, nous serons condamnés à voir nos jeunes choisir l’exil, pour se former ou pour travailler ailleurs. La menace est réelle, si l’on en croit ce sondage Viavoice pour W et Cie : à la question « si vous le pouviez, aimeriez-vous quitter la France pour vivre dans un autre pays ? », 50 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans, ceux-là mêmes qui sont concernés par votre projet de loi, répondent « oui », tout comme 51 % des 25-34 ans. Voici ce que dit Maureen, 25 ans : « En France, on a du mal à se faire une place. ». Alexandre, 30 ans, se demande : « Pourquoi vouloir tuer l’entrepreneuriat ? ». « J’aimerais faire ma vie ailleurs », dit Clara, 20 ans, étudiante en histoire. Tout cela est triste, madame la ministre, car il est triste qu’une jeunesse ne soit pas attachée à son pays. Je ne crois pas que le visage que dessine votre loi pour l’enseignement supérieur soit véritablement de nature à redonner espoir à nos étudiants.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, monsieur le rapporteur, chers collègues, l’enseignement supérieur et la recherche ne sont pas des priorités ; ils ne sont pas même l’illustration d’une démarche, fût-elle tout entière consacrée à la jeunesse. L’enseignement supérieur et la recherche forment le coeur même du modèle de société que nous voulons construire ; ils sont l’expression de l’idéal républicain porté au plus haut niveau de l’exigence. L’idéal républicain, c’est la volonté d’émancipation de chacun ; c’est le pari de l’intelligence. Cette intelligence, cette émancipation se conçoivent à travers une idée, que j’aimerais développer : le lien. Ce lien sera mon fil d’Ariane pour parcourir ce texte. L’idée première de ce texte est sans aucun doute inspirée par de nobles motivations, dont celle de relier plus efficacement enseignement et recherche. Relier, c’est d’abord le principe même du savoir, parce que le savoir est un domaine dont la performance obéit peut-être moins que tout autre à l’individualisme et à la concurrence systématique. L’émulation est bien plus productive, quand elle prend source dans la collaboration et non dans la seule compétition. Cette compétition est avant tout intellectuelle: il s’agit d’une compétition de coopération, de débat et de curiosité. Nous devons avoir une conception large de l’utilité du savoir, qui ne manque pas d’évoquer les débouchés professionnels, le lien avec le monde économique ainsi que le plaisir de la connaissance. Telle est l’université moderne, qui doit éviter de faire sienne cette phrase de René Daumal : « Je sais tout, mais je n’y comprends rien. » Mais si les mots ont un sens, ils n’ont pas nécessairement de traduction, surtout quand, une nouvelle fois, une vraie fausse concertation préalable aboutit à faire saillir des pierres d’achoppement là où régnait une certaine forme de consensus, plutôt dirigée contre la LRU, dans un texte qui accumule, hélas, voeux pieux et lieux communs. Ce qui relie d’abord, c’est la langue. Dans le Pacifique, l’abandon du français comme langue d’enseignement constituerait un abandon de souveraineté,…

… une faute géopolitique, mais aussi une sorte de rupture du lien que nous créons avec les autres peuples qui nous environnent, qui sont curieux de la culture française, et y sont parfois attachés. À proximité immédiate de la Nouvelle-Calédonie se situe le Vanuatu, ex-condominium des Nouvelles-Hébrides, dont la Constitution retient deux langues officielles : le français et l’anglais.

Non, pas le bichlamar, monsieur Durand : le bichlamar est la langue pratiquée, mais elle ne figure pas dans la Constitution de la République. Les deux seules langues reconnues par la Constitution du Vanuatu sont le français et l’anglais. Nous possédons aujourd’hui, au coeur du Pacifique, dans cet environnement exclusivement anglo-saxon, trois territoires français. Rappelons qu’en Nouvelle-Calédonie, la langue véhiculaire au sein de l’ensemble de l’archipel, parmi les trente langues vernaculaires, reste le français. Oui, défendre la langue française dans le Pacifique aujourd’hui, dans ces territoires et dans l’ensemble régional, c’est aussi permettre de faire en sorte qu’elle ne disparaisse pas de nos universités. Relier, c’est la concertation. Un mot simplement à ce sujet : comment expliquer cette contradiction entre la multiplicité des points abordés dans les deux rapports préalables et le maigre contenu du projet de loi ? Pour ne prendre qu’un exemple, la communication a porté pendant un temps sur l’orientation des étudiants de premier cycle, en licence. Qu’est-il advenu des centaines de propositions pour la réussite des étudiants en licence ? Comment expliquer également, après ces discussions, que l’article 2 de la loi ait suscité une véritable bronca ? Relier, c’est aussi aménager la diversité : diversité des diplômes, des structures d’enseignement, des formations, des organisations territoriales. De ce point de vue, vous avez choisi non pas de relier mais d’empiler, de contraindre même et finalement de prendre le risque d’un blocage, ce que je ne souhaite pas. Relier, c’est simplifier. Mais manifestement, nous ne nous lions pas de la même façon ! Les restructurations engagées correspondent, du point de vue du Gouvernement, à une simplification de sa gestion des universités, réunies à l’échelle de sites au périmètre très variable et placées sous la direction de quelques établissements coordinateurs, qui contracteront des accréditations de l’État. En somme, ce changement d’échelle revient en tout ou partie à placer les prises de décision hors de portée des acteurs universitaires. Il rendra inéluctablement difficile l’élaboration d’une stratégie de recherche et d’innovation extrêmement ciblée sur quelques domaines prioritaires, dans l’espoir d’en tirer des applications socio-économiques utiles. Quant au transfert de ces innovations par l’université, le sujet est à peine esquissé dans le projet de loi. Il n’est pas sérieusement traité ; et pourtant, il est absolument fondamental. Ces restructurations, qui semblent de prime abord relier, vont au contraire éloigner les acteurs de l’enseignement supérieur des décisions stratégiques utiles. De la même façon, le lien impliquant la simplification, l’on pourrait saluer votre souhait d’une certaine clarté des intitulés de formation. Mais en jouant sur le nombre de diplômes proposés dans l’ensemble des universités françaises, sans jamais prendre en considération les contenus justifiant éventuellement ces intitulés, vous allez procéder de façon drastique à la réduction de ce nombre. En outre, sont supprimées les déclinaisons spécifiques de chacun de ces diplômes qui permettaient aux étudiants d’identifier des formations et des débouchés plus précis. De la sorte, au nom de ces deux seuls arguments répétés à l’envi - la lisibilité pour les étudiants et leurs familles, ainsi qu’un supposé «bon sens» -, un bouleversement radical de l’offre de formation a été mis en oeuvre, sans le dire explicitement. De cette façon, vous n’avez pas simplifié, mais appauvri notre paysage universitaire, ce qui emportera inéluctablement des effets négatifs. La survie de certains enseignements est en jeu, tandis que la remise en cause d’enseignements professionnalisants, nécessairement spécialisés, aura des conséquences sur l’emploi. De même, la possibilité de créer de nouveaux enseignements est compromise ; si une telle nomenclature avait été en vigueur depuis 1968, il n’y aurait jamais eu de formations en genre, en géopolitique, en psychanalyse ou en études européennes par exemple, ni même en informatique ou en cinéma. Enfin, la capacité des universitaires à penser librement les formations qu’ils dispensent et à en inventer de nouvelles est également remise en question. Cette simplification aura mécaniquement pour effet de mettre en concurrence des diplômes qui seront tous normalisés dans leur affichage, au détriment de la complémentarité et de la coopération possibles entre des formations inventant chacune leur spécificité. Du même coup, dans le cadre des communautés d’universités créées par le présent projet de loi, on peut craindre que s’ensuive une rationalisation brutale de la carte des formations, au bénéfice des établissements les plus puissants et les plus riches, ou de ceux qui imposeront, à l’image des grandes écoles, une sélection à l’entrée. L’autonomie budgétaire, parfois sans moyens adéquats, hélas, a déjà conduit un quart des universités à disposer de budgets en déséquilibre. Voilà que le ministère remet en cause l’autonomie qui est la plus chère aux universités : l’autonomie pédagogique. Bientôt il sera trop tard : l’université ne proposera plus que des masters formatés et des licences très génériques, prônant une interdisciplinarité illusoire sans socle disciplinaire et une professionnalisation abstraite sans analyse des débouchés possibles. Relier, enfin, ce n’est pas opposer des systèmes qui marchent - les écoles d’ingénieurs et les classes préparatoires - avec d’autres qui n’atteignent pas le même niveau de résultat, à savoir les universités. Relier signifie donner envie aux étudiants, motiver la jeunesse, lutter contre l’échec. Cela est beaucoup plus fort que les prêts-à-penser sur l’égal accès à l’enseignement, qui rétrécit l’enseignement plutôt que de faire grandir les enseignés, pour des résultats uniquement statistiques puisque, au bout du compte, ils n’aboutissent que difficilement à l’intégration sur le marché du travail. La France, pour demeurer, dans dix ans, parmi les vingt nations de tête, doit former et recruter 10 000 docteurs de plus par an, soit le double d’aujourd’hui. Nous n’aurons pas la moindre chance d’y parvenir sans une rénovation profonde des premiers cycles universitaires, dans le but de démocratiser l’enseignement supérieur, de mettre fin au taux très élevé d’échec et de répondre aux besoins de notre économie et du pays. Nous n’y parviendrons pas non plus sans l’ouverture de perspectives enthousiasmantes pour les jeunes qui s’engageront dans cette voie, faute de quoi ils renforceront encore les bataillons qui passent par les écoles de commerce. Voilà, madame la ministre, ma lecture de ce texte autour d’une idée, celle du lien, considéré comme une caractéristique ontologique de la recherche et de l’enseignement supérieur. Ce texte prétend défendre une langue et une culture, tout en réduisant les moyens pour y arriver. Ce texte ne construit pas de projet souple et véritablement moderne sur les outils numériques ou sur le contenu pédagogique des enseignements universitaires. Il n’impulse pas notre enseignement supérieur pour faire gagner les étudiants, et non les décourager ou les sélectionner par la déprime. Ce texte, je le crois sincèrement, ne servira pas notre université. Mais je crois encore plus en la formidable ressource de la communauté éducative, qui, malgré tout, continuera à servir et à sauver notre université.
Applaudissements sur les bancs des groupes UDI et UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je veux saluer tout d’abord la priorité affichée par le Gouvernement : la réussite des étudiants. De plus, l’inscription de la formation tout au long de la vie comme première mission du service public de l’enseignement supérieur est une avancée notable. Je me réjouis également de ce fameux article 2, ouvrant la possibilité de dispenser des cours en anglais dans nos universités. Contrairement aux idées reçues, nous sommes persuadés que la maîtrise des langues étrangères n’est pas un renoncement à notre culture.

Les langues étrangères et l’anglais, ce n’est pas la même chose ! Apprenez l’arabe ! Apprenez le chinois !
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Elle signifie bien au contraire l’ouverture de la boîte des connaissances, la liberté de travailler et de publier dans le monde entier, sans limite. Une telle mesure sera utile tant aux étudiants francophones qu’aux étudiants étrangers. Elle offre la possibilité à celles et ceux qui ne pratiquent pas parfaitement notre langue d’apprendre à leur rythme, tout en suivant leurs cours en anglais. Les doctorants étrangers venant terminer leur cursus en France devraient par ailleurs pouvoir rédiger leur thèse en anglais, sans avoir à en demander l’autorisation. Ces docteurs, qui auront été immergés dans la culture française pendant des années, seront nos meilleurs ambassadeurs.

Je reconnais également, madame la ministre, que l’accréditation des établissements peut contribuer à alléger les lourdeurs administratives et renforcer l’autonomie pédagogique des établissements. Il est toutefois essentiel que cette accréditation se fasse dans le cadre de diplômes qui restent nationaux, uniquement délivrés par des universités, et qu’elle soit réalisée de manière transparente grâce au travail du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cependant, je ne partage pas la philosophie d’ensemble de ce texte. Nous débattons aujourd’hui d’une loi d’orientation. Chaque mot compte ; or les mots "compétitivité", "transfert", "innovation" et tout le champ sémantique de l’entreprise sont mentionnés à maintes reprises. C’est un choix de politique ministérielle que de remplacer "science" par "innovation", et "portée scientifique" par "impact économique". C’est également votre choix d’omettre toute allusion à la liberté scientifique, la créativité, l’originalité et la curiosité. Le savoir n’est pas une marchandise : la connaissance donnée n’est pas perdue par celui qui la donne. La connaissance scientifique est faite pour être partagée sans limite. C’est ainsi qu’elle peut augmenter, au bénéfice de toute l’humanité. Des dérives, telles que le brevetage du génome humain, les brevets logiciels ou l’interdiction faite aux agriculteurs de cultiver leurs propres semences, sont légion. II faut faire cesser ces abus. Comme le dit Christophe Blondel, physicien au CNRS : « Nous sommes perdus si nous oublions que les fruits de la connaissance sont à tous et que la science n’est à personne. » Dans ce projet de loi, vous n’avez pas touché aux créations des précédents gouvernements, aux Idex, aux Labex, à l’ANR. Ils ont créé une compétition entre les établissements, entre les laboratoires, entre les équipes, au lieu de renforcer les coopérations transversales. Ils ont divisé et transformé les chercheurs en rédacteurs d’interminables dossiers de subventions, quasiment des mendiants. Les conclusions des assises faisaient pourtant état de demandes clairement formulées qui auraient permis d’ouvrir la voie à une véritable réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche. On y trouvait une remise en cause du fonctionnement de l’AERES et une réforme en profondeur de l’ANR, donnant enfin aux laboratoires la possibilité de travailler dans des conditions sereines. Je suis convaincue que le mode de gouvernance des communautés d’universités et d’établissements prévu dans ce projet de loi représente un grave recul de la démocratie universitaire. Nous pourrions en effet aboutir à des conseils d’administration composés de représentants élus, certes, mais au suffrage indirect. De plus, par la création de ces communautés, des établissements privés pourront être accrédités indirectement à délivrer des diplômes nationaux. Est-ce vraiment ce que nous souhaitons ? Par contre, le projet de loi innove en imposant à l’enseignement supérieur les missions de transfert vers le monde économique. Cette mission n’a jamais fait l’objet d’un débat national et n’est pas apparue comme un sujet prépondérant au cours des assises. Or ce transfert ne fait pas l’unanimité auprès de la communauté universitaire et je suis profondément opposée à la philosophie qui le sous-tend. Je suis, bien entendu, consciente que ce transfert technologique est important pour nos entreprises et qu’il peut éventuellement avoir sa place dans la partie "Recherche" de ce projet de loi consacrée à la recherche. Mais pourquoi en faire l’une des missions principales de l’enseignement supérieur ? Aujourd’hui, madame la ministre, à travers ce projet de loi, vous vous adressez également aux étudiants en sciences politiques, en sociologie, en histoire, en géographie. Vous leur dites en substance : « Nous soutiendrons vos recherches si elles intéressent le marché, si elles permettent de comprendre les demandes des clients. » Et pourtant, ces étudiants analysent et font avancer la société, en répondant aux interrogations de nos concitoyens. Ils forment même le gros du bataillon de nos collaborateurs. Alors, madame la ministre, je vous laisse aller leur dire que leurs études n’intéressent pas le Gouvernement. Mais vous irez le leur dire sans les écologistes. Disons-le clairement : si, depuis un an, certains projets gouvernementaux ont pu susciter insatisfactions ou doutes chez les écologistes, cette réforme universitaire nous inspire, en l’état, une opposition fondée et motivée. Il va sans dire que nous attendons beaucoup des travaux en séance pour dissiper les inquiétudes que je viens d’évoquer.
Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche est le fruit des nombreuses consultations menées dans le cadre des assises de l’enseignement supérieur et de la recherche matérialisées par le rapport de qualité de Jean-Yves Le Déaut. Il est marqué par une double volonté de simplification et de cohérence. Par son ambition, il répond aux défis que nous devons relever pour notre jeunesse, notre société et notre économie. Je mettrai en avant trois avancées principales. Tout d’abord, ce projet de loi fait de la réussite des étudiants un impératif. Ainsi, il crée un principe de continuité entre le second cycle de l’enseignement du second degré et l’enseignement supérieur. Par ailleurs, il fixe un objectif de 50 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur. La matérialisation de cette ambition passe naturellement par les moyens alloués. C’est pourquoi, dès cette année, 1 000 emplois dédiés à la réussite en licence ont été créés dans les universités, et il y en aura 5 000 à l’échelle du quinquennat. C’est pourquoi également les crédits en faveur de la vie étudiante ont été augmentés de 7,4 %. Dans la même logique d’accompagnement des étudiants vers la réussite, ce projet de loi remédie à l’orientation par défaut d’une importante part de bacheliers professionnels et technologiques vers l’université. Ce n’est pas sans conséquences, en effet. Actuellement, si plus du tiers des bacheliers généraux obtiennent leur diplôme trois ans après leur première inscription, ce pourcentage tombe à moins de 10 % pour les bacheliers technologiques et à 2,2 % pour les titulaires d’un bac professionnel. Mais, dorénavant, grâce à ce projet de loi, les IUT et les sections de techniciens supérieurs devront réserver une part minimale de leurs effectifs aux bacheliers professionnels et technologiques. Deuxième avancée notable : la reconnaissance et la valorisation des doctorants. Comme vous l’avez souligné dans votre rapport, monsieur le rapporteur, en dehors des secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, seuls environ 300 titulaires d’un doctorat accèdent chaque année à des emplois de la fonction publique, sur les 13 000 docteurs diplômés, et moins de 2 % des cadres de la fonction publique sont titulaires du doctorat contre 35 % aux États-Unis ou en Allemagne. Voilà une réalité dévalorisante pour nos doctorants face à leurs homologues européens et internationaux, mais aussi pour nos diplômes et notre système de formation. C’est pourquoi ce projet de loi prévoit la possibilité d’ouvrir des concours de la fonction publique aux titulaires d’un doctorat. Par ailleurs, je partage l’analyse de notre collègue Christophe Borgel sur le crédit impôt recherche et son fléchage en faveur de l’insertion des doctorants dans les entreprises. Enfin, et c’est la troisième avancée notable que j’aborderai, ce projet de loi marque le retour de l’État stratège, par la définition d’une stratégie nationale de la recherche. Il incarne une nouvelle ambition par la promotion des activités de transfert vers les secteurs socio-économiques, comme vous l’avez souligné à juste titre, madame la ministre. J’ajouterai que nos PME et TPE ont absolument besoin de ce lien avec la recherche publique. Pour nombre d’entre elles, esseulées, sans équipe de recherche et développement, comment pourraient-elles innover ou porter leurs innovations à maturité ? Dorénavant, grâce aux modalités de transferts prévues par ce projet de loi, elles pourront mieux innover, grandir, exporter et créer les emplois de demain. Je tiens à ce propos à saluer votre attitude ouverte et constructive, madame la ministre, en favorisant l’adoption de nombreux amendements destinés à approfondir cette dimension nouvelle apportée par le projet de loi. Ainsi, la possibilité pour les chercheurs de voir prise en compte dans leur évaluation l’expérience acquise dans les entreprises, lorsqu’ils sont amenés à revenir vers leur corps d’origine, ou encore leur action de médiation scientifique, technologique et industrielle, constituent un pas décisif dans la valorisation des acquis de la recherche publique et la reconnaissance professionnelle de ceux qui la font. C’est pourquoi je me joins à mes collègues pour soutenir ce projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche qui réaffirme l’ambition gouvernementale de préparer la France de demain.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, mes chers collègues, "longtemps la puissance d’une nation s’est mesurée à celle de son armée. Aujourd’hui, elle s’évalue à son potentiel scientifique". À l’instar de toutes les formules, celle du prix Nobel de médecine, le professeur François Jacob, n’échappe pas à une certaine forme de caricature. Elle a toutefois le mérite de poser clairement et sans détour les enjeux soulevés par l’évolution de nos sociétés et par le rôle grandissant qu’y joue le progrès scientifique. Il y a un classement qui a toujours fait beaucoup de bruit, celui des universités établi par l’université Tong de Shanghaï. L’on y constate que la qualité du système d’enseignement supérieur français n’est pas reconnue sur la scène internationale. J’en veux pour preuve que la première université française, Pierre et Marie Curie, n’apparaît que vers la quarantième position. Même si certains veulent le critiquer, ce classement ne peut être ignoré, car lorsqu’ils choisissent leur université, les Américains, les Australiens, les Chinois ou les Indiens le regardent. C’est la mondialisation. On ne peut s’en abstraire, et nous devons, nous, gagner des places, ce qui n’est pas contraire à l’exigence de l’excellence de l’université française. Et comme ce classement a des influences directes sur la politique de recherche en France, il était donc de l’intérêt de la création des pôles de recherche et d’enseignement supérieur. C’était l’un des points forts de la loi LRU de 2009 et je regrette que vous les rayiez d’un trait de plume. Et comme la loi LRU vous démange, vous n’hésitez pas, ici, à supprimer ou fusionner, par exemple le Conseil supérieur de la recherche et des technologies et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, et, ailleurs, à remplacer l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur par une autre agence. En un mot, vous déshabillez purement et simplement la loi LRU. S’agissant de l’article 22, qui concerne la première année commune des études de santé, vous souhaitez expérimenter de nouvelles modalités d’accès à ces études et vous fixez un délai d’expérimentation de six années. Il est entendu que le constat du véritable enfer que vivent des dizaines de milliers d’étudiants fait l’unanimité parmi les parlementaires. C’est d’ailleurs pour cela qu’en 2008 la loi Domergue avait institué la PACES, c’est-à-dire la première année commune des études de santé. Des passerelles étaient déjà prévues en cas d’échec ou de droit de remords à six mois, pour ceux qui ne peuvent pas suivre l’évolution des études. Aussi, l’article 22 a reçu l’aval de tous les membres de la commission des affaires sociales, y compris de ceux du groupe UMP. C’est peut-être le seul bon point que je vous accorde. Madame la ministre, si je suis favorable à ces expérimentations, je réitère une demande que je formule depuis un certain temps : construire d’autres programmes que ceux de la première année de médecine qui existent actuellement. Ces programmes ne sont plus actuels et sont totalement éloignés des sciences médicales. Voilà un sujet à revoir. Madame la ministre, votre projet de loi ne fait pas l’unanimité du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une intersyndicale connue appelle à une journée nationale de grève et au retrait de la loi. Même la conférence des présidents d’université a émis des réserves. Cet après-midi a eu lieu, devant l’Assemblée nationale, une manifestation hostile à ce projet de loi, à laquelle je ne m’attendais pas. Souvenons-nous du collectif « Sauvons la recherche » et de ses déclarations lucides, et des états généraux de la recherche à Grenoble. Le pays avait été alerté, car sans outils de recherche d’excellence nous serions "incapables de suivre l’accélération de l’évolution économique associée à la production des connaissances", et nous entrerions dans "une dépendance économique difficilement réversible". C’étaient là les termes de la déclaration des chercheurs dans leur ensemble. À partir de là, les gouvernements précédents se sont engagés dans la loi de programme pour la recherche de 2006 et la loi LRU de 2007, avec des avancées majeures, en particulier en ce qui concerne la gouvernance, ainsi que le rapprochement avec le monde économique, ou encore l’autonomie des universités. Ces dispositions avaient été plus acceptées que vous ne voulez le dire, le faire croire ou le dénoncer, comme vous le faites encore ici, dans le texte qui nous est soumis.

Certes, cela ne vous convient pas et, par idéologie, vous décidez de détricoter tout l’édifice scientifique et universitaire qu’il aurait fallu au contraire faire évoluer. C’est votre choix, madame la ministre ; ce n’est pas le nôtre. Je vous remercie.

Madame la ministre, comme beaucoup d’autres dans cet hémicycle, mais aussi dans le monde universitaire, je voudrais exprimer l’émotion et l’inquiétude que m’inspire l’article 2 de votre projet de loi : émotion et inquiétude dont l’opposition n’a pas l’exclusivité – et je parle sous le contrôle de mon collègue rapporteur de la mission sur la francophonie Pouria Amirshahi –, si l’on en juge par les travaux de la commission des affaires culturelles, qui ont consisté, en quelque sorte, à habiller de précautions inopérantes un renoncement effectif. Il s’agit bel et bien, en renonçant au principe posé par la loi Toubon de 1994, de remettre en cause la part nécessairement prépondérante de la langue française dans les enseignements dispensés dans les établissements français d’enseignement supérieur. Le texte de la commission indique que les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangères, grâce d’ailleurs à un amendement du groupe UDI. Mais où commence le « partiellement » ? Il aurait fallu aller beaucoup plus loin et écrire « minoritairement », ce qui, en droit, aurait été la seule garantie formellement significative. Votre refus est la preuve, madame la ministre, que vous n’avez pas la volonté politique de faire respecter même cette illusoire limitation. J’ai bien noté l’argument du rapporteur, qui revient plus ou moins à s’incliner devant le fait accompli.

C’est rarement une preuve de qualité de la décision politique. Le texte de la commission prévoit que les étudiants auxquels seraient dispensés les enseignements en langues étrangères « bénéficient d’un apprentissage de la langue française ». Curieuse formule en vérité : à nouveau une belle intention sans sanction, en d’autres termes un voeu pieux ! Enfin, le texte dit que le niveau de maîtrise de la langue française des étudiants suivant des cours en langue étrangère est pris en compte pour l’obtention du diplôme. Mais sauf erreur, les examinateurs sont déjà appelés à une telle compréhension lorsque des étudiants étrangers se présentent devant eux. Interprétée à la lettre, la disposition proposée par la commission est paradoxale : elle appelle en effet à la compréhension linguistique pour des étudiants qui, par hypothèse, choisissent un mode d’enseignement moins exigeant au regard de la maîtrise de la langue française. Autrement dit, la compréhension ira en priorité à ceux qui choisiraient la voie la moins lourde pour eux ! Plus largement, on invoque des raisons de prestige et de concurrence, en s’appuyant notamment sur l’exemple de Sciences Po. J’aurais pourtant cru, à la lecture d’informations récentes, que Sciences Po n’était pas réellement un modèle à imiter et que sa gestion était quelque peu sortie des clous.

Disons que cette école est exemplaire quand elle sert vos thèses : mais après tout, a-t-elle jamais cessé d’être une machine à produire la langue du pouvoir ? On dit aussi que l’apprentissage de la philosophie, par exemple, suppose l’organisation d’enseignements dans cette langue. Cela évite de parler du vrai problème, qui est la confrontation avec la langue anglaise. Mais, si on suivait la logique de cet exemple, il faudrait prévoir – ou restaurer, car Montaigne en a connus – des enseignements de philosophie en grec ancien, car personne ne peut contester, en suivant votre critère d’appréciation, que la connaissance de Platon et d’Aristote soit aussi importante pour la compréhension philosophique de notre temps que celle de Kant ou de Karl Marx. La connaissance correcte d’une langue, ce n’est pas la même chose que l’organisation délibérée, en France, de cours dans cette langue. Toutes ces apparentes justifications ne servent qu’à masquer une réalité : vous cédez devant une pression qui n’a rien de culturel et qui est proprement mercantile. Vous bradez cet élément essentiel du patrimoine culturel qu’est la langue nationale, sans prendre garde aux effets démobilisateurs et dissociateurs désastreux qu’une telle attitude peut provoquer dans le monde francophone. Votre libéralisme culturel vient ainsi en appui au libéralisme économique contre lequel votre majorité, et le Président de la République à sa tête, n’ont pas de mots assez durs.

Et il n’y a dans ce combat qu’un seul vainqueur : la langue anglaise – non pas celle de Shakespeare dont vous vous prévalez, mais le langage international appauvri qui en tient de plus en plus lieu, avec votre consentement, dans les enceintes internationales publiques et privées. Le véritable atout de nos universités, ce n’est pas le libéralisme linguistique, c’est un renouvellement de leurs capacités d’ouverture, d’adaptation et de modernisation pour lequel les mesures juridiques, si nécessaires fussent-elles, sont moins importantes que la conversion des comportements. Pour toutes ces raisons, le groupe UDI votera contre cet article 2…
Applaudissements sur les bancs des groupes UDI et UMP.

En commençant ce propos, je voudrais tout d’abord saluer la concertation qui a été menée, notamment dans le cadre des assises de l’enseignement supérieur, qui ont été un succès et ont permis de formuler de nombreuses propositions riches et intéressantes. Dans cette loi, et c’est une bonne chose, l’État reprend la main dans l’enseignement supérieur et la recherche, par le renforcement de son rôle de stratège et de régulateur. Ainsi, l’État assume sa mission incitative en donnant aux universités l’autonomie nécessaire pour atteindre les objectifs qu’il fixe, et rompre avec les effets pervers et les dérives de la concurrence excessive qui s’était instaurée entre universités. Ce projet de loi, qui englobe à la fois les questions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche, assure la cohérence de l’ensemble ; et sur les trois thématiques : formation, recherche et gouvernance, je voudrais m’attacher plus particulièrement aux dispositions qui constituent de véritables leviers pour la réussite de tous les étudiants. Certes, il s’agit d’une loi d’orientation et non de programmation. Bien sûr, la question des moyens est importante, elle devra être posée, mais d’ores et déjà la création de cinq mille postes est prévue sur cinq ans et les dotations de fonctionnement des universités sont maintenues. Dans cette loi, il n’y a pas d’arbre qui cache la forêt : on ne peut réduire l’ensemble des dispositions du projet à une ou deux mesures phares qui occulteraient les autres. Chacune des nombreuses dispositions apporte sa pierre à l’édifice pour que cette loi soit une loi d’égalité entre les étudiants, qui donne la priorité à la réussite étudiante avec l’objectif de parvenir à passer de moins de 40 % de diplômés de l’enseignement supérieur au niveau licence, à 50 % dans chaque classe d’âge d’ici 2020 et ainsi de réduire de façon significative le taux d’échec en premier cycle qui a augmenté ces dernières années, passant en première année de 52 % en 2006 à 57 % en 2011. Or ce sont les enfants des familles aux revenus modestes qui sont le plus souvent largement pénalisés.

Dans le projet de loi, nombreux sont les points qui représentent soit des progrès incontestables, soit des compromis intéressants, permettant dans bien des domaines des avancées conséquentes. Avancée, avec une première année pluridisciplinaire et par une plus grande lisibilité de l’offre de formation par une simplification des intitulés. Comme les débats des Assises l’ont souligné, tout le monde s’y perd aujourd’hui parmi les milliers de licences et de masters recensés qui génèrent des erreurs d’orientation, sauf pour les enfants de ceux qui connaissent le labyrinthe. Amélioration importante, par une meilleure orientation des bacheliers des sections professionnelles et technologiques. La loi redonne enfin aux sections de techniciens supérieurs et aux IUT leur vocation d’origine, en facilitant l’accès aux bacheliers professionnels qui y réussissent beaucoup mieux qu’à l’université. Avancée encore, par la mise en oeuvre d’une continuité du service d’orientation entre le secondaire et le supérieur. La continuité entre le lycée et l’université est un enjeu majeur pour la démocratisation de l’enseignement supérieur et la réussite des étudiants en premier cycle. Progrès encore, par le rapprochement entre toutes les filières post-bac, notamment les classes préparatoires et les premiers cycles, pour favoriser les parcours mixtes et les réorientations, afin de permettre aux étudiants de rebondir et leur éviter de se retrouver dans des impasses et donc dans l’échec. Avancée, par le développement de l’enseignement numérique pour que la France rattrape son retard dans sa capacité à utiliser de nouveaux supports numériques et à développer de nouvelles méthodes pédagogiques, avec la désignation d’un vice-président en charge des questions et ressources numériques, qui font partie intégrante de la politique des établissements comme l’a précisé un amendement de la commission intégré à la loi. Progrès aussi, avec les passerelles d’entrée en deuxième et troisième années de formation médicale pour les étudiants ayant une licence adaptée, afin de remédier aux effets de la PACES qui n’a pas donné les résultats espérés. Évolution positive, par le développement de la formation en alternance, avec l’objectif d’en doubler d’ici 2020 le nombre d’étudiants, pour faciliter l’insertion professionnelle. Il faut rompre avec l’image négative de l’apprentissage et, comme l’a dit le Président de la République, l’alternance est aussi une filière d’excellence.

C’est aussi une voie privilégiée pour permettre aux jeunes de tous les milieux sociaux de se former et de trouver un emploi durable. Cette voie permet de poursuivre des études à des jeunes qui ne l’auraient pas envisagé autrement. Enfin, progrès par la valorisation du doctorat, qui est une formation professionnelle exigeante et qui permettra l’accès à la haute fonction publique. Il faut se féliciter de cet objectif, qui est en harmonie avec les recommandations du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie pour l’accès à des corps de catégorie A de la fonction publique d’État. Mes chers collègues, le texte qui nous est présenté par le Gouvernement fait suite à une large concertation et contribue à la réussite de tous par la démocratisation des savoirs. Le temps du débat parlementaire a maintenant débuté. Le projet de loi a déjà été enrichi par la commission et je ne doute pas qu’il le sera encore dans les débats qui débutent aujourd’hui dans l’hémicycle.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la ministre, en douze mois, votre majorité a conduit la France dans la récession.
Protestations sur les bancs du groupe SRC.

Et ce n’est malheureusement pas votre texte sur l’enseignement supérieur et la recherche qui va inverser la tendance. Plutôt que de mener les réformes structurelles dont la France a besoin, votre seule ambition a été de détricoter ce que la précédente majorité avait mis en place. C’est vrai pour la politique familiale, c’est vrai pour la politique économique et fiscale, c’est aussi vrai dans le domaine de l’éducation. Après l’école, vous vous attaquez maintenant à l’université.

La dernière réforme d’ampleur date de 2007 : mais, il est vrai, c’était une réforme de la précédente majorité.

Vous considérez que votre projet est urgent. Vous avez donc engagé la procédure accélérée. C’est maintenant une méthode de travail habituelle, imposée par votre Gouvernement sur la plupart des textes. Sur seize lois publiées en 2013, hors conventions internationales et lois sur les finances publiques, le Gouvernement a eu recours huit fois à la procédure accélérée, autrement dit sur la moitié des textes publiés ! Cette semaine, pas moins de deux projets de loi seront examinés en séance publique selon la procédure accélérée, avec une seule lecture dans les deux chambres. C’est inacceptable.

Cela empêche tout débat approfondi et serein au sein du Parlement. Madame le ministre, qui dit urgence, dit importance et qui dit importance dit travail approfondi et non bâclé, fondé sur un véritable dialogue avec les acteurs concernés. Force est de constater que ce texte ne répond à aucune de ces exigences. C’est une loi bavarde qui finalement ne dit rien.
Interruptions sur les bancs du groupe SRC.

Une loi de façade, de précipitation, qui prive l’opposition de ses droits les plus élémentaires. Déjà, en commission, plusieurs de nos amendements sur l’article 2 ont été déclarés irrecevables, alors qu’un amendement similaire, issu de votre majorité, était quant à lui en discussion.

Les entraves au travail parlementaire ne s’arrêtent pas là. Le texte issu de la commission n’a été disponible que vingt-quatre heures avant le délai de forclusion. Disposer d’un délai aussi court pour exercer notre droit d’amendement, qui est un droit fondamental accordé à tout parlementaire, sur un texte qui ne fera l’objet que d’une seule lecture, est tout simplement intolérable. Enfin, vous présentez ce texte comme issu de la concertation. Or de nombreux organismes de recherche, des responsables d’université nous ont fait part de leur insatisfaction au sujet de ce projet de loi qui ne correspond pas à leurs attentes. Sans oublier, naturellement, les critiques de votre majorité qui a déploré le manque de concertation en amont. Que dire de plus ? Finalement, il ne reste qu’à supprimer le Parlement afin que le Gouvernement continue sur sa lancée : légiférer par ordonnance, méthode que vous dénonciez il y a peu et que vous utilisez aujourd’hui. J’en veux pour preuve le texte sur la construction inscrit à l’ordre du jour cette semaine !

Sur le fond, votre projet de loi n’est pas exempt de critiques. Il est étonnant de constater que la plupart de d’entre elles émanent, là encore, de votre propre majorité.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

La loi d’autonomie de 2007 a permis aux universités d’améliorer leurs performances et de peser davantage dans la compétition internationale. Or les mesures que vous proposez vont bloquer cette dynamique et, à nouveau, rigidifier le système de gouvernance. Elles vont mettre nos universités en position de fragilité dans la compétition mondiale et, madame la ministre, vous en serez tenue pour responsable.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

La principale innovation de votre texte est l’instauration de cursus d’enseignement en anglais dans nos universités pour les étudiants étrangers sans que ceux-ci suivent un enseignement en français. Nombreux sont ceux qui considèrent cette mesure comme attentatoire aux intérêts de la France et à l’avenir de notre langue. Vous me permettrez de citer M. Jacques…

… Jacques Attali : « Je considère que les étudiants étrangers suivant un cursus dans nos universités, y compris dans le domaine scientifique, doivent suivre un enseignement en français. » Vous écrivez dans l’exposé des motifs que votre projet de loi est d’abord conçu pour les étudiants.

Permettez-moi d’en douter. On ne trouve aucune disposition sur leurs conditions de vie. Vous renvoyez la question du logement, la création de centres de santé sur les campus, l’amélioration des aides sociales, à des évaluations et à des textes ultérieurs. Rappelons que la réforme de 2007 s’était accompagnée de mesures fortes en faveur des étudiants, notamment envers les plus modestes et les boursiers. En ce qui concerne la réussite des étudiants, vous l’affichez comme un objectif prioritaire. On cherchera vainement ce qui donne corps à cette affirmation. De même, on ne relève aucune mesure forte pour rapprocher l’université et l’entreprise.

Stages obligatoires, mise en place d’une formation à la création et à la gestion d’entreprise seraient pourtant des passerelles nécessaires et efficaces ; mais, là encore, nous attendons. Enfin, et je terminerai par là,…

… l’institution d’un quota de bacheliers technologiques dans les IUT n’a pas de sens. Les IUT sont attachés à la diversité des bacheliers recrutés.

C’est là toute la richesse du mélange de l’intelligence de la main et de l’intelligence de l’esprit. Nous passons aussi à côté de cet objectif essentiel dans la mission prioritaire qu’est l’éducation.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.
Protestations sur les bancs du groupe UMP.
Sourires.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, l’université française souffre d’un paradoxe historique : héritière d’une tradition ancienne et brillante, celle dont la Sorbonne porte encore haut et fort dans le monde entier la renommée, elle peut avoir, depuis quelques décennies au moins, le sentiment d’être en déclin. Six ans après la loi LRU, le malaise persiste. L’université garde le sentiment d’être la mal aimée d’un système d’enseignement supérieur qui l’oblige à accueillir massivement là où les grandes écoles, renforcées par la montée de la professionnalisation et le besoin de sécurité des débouchés, filtrent et sélectionnent leurs étudiants. Que faire pour que ce paradoxe cesse d’être une maladie chronique ? Faut-il en croire les regards portés sur notre université tels celui de l’OCDE – mais on peut aussi penser au désormais fameux, quoique boiteux, « classement de Shanghai ». Ils ont contribué à acclimater un diagnostic ambigu: c’est l’idée que les États doivent viser une qualité de niveau international pour leurs systèmes éducatifs afin d’assurer une croissance économique à long terme. Cette idée, juste en elle-même, s’est dévoyée dans un effet de mode qui décrète un peu rapidement que la formation pour la formation serait le gage, le nec plus ultra du retour à la prospérité. Nous devrions pourtant savoir aujourd’hui que cette idée néolibérale fait bon marché d’une contrainte essentielle, celle de la tension sur le marché de l’emploi : pas de formation utile sans débouché et pas de débouchés sans la condition nécessaire d’une formation adaptée. C’est dans cette perspective correctrice, celle du redressement productif nécessaire à notre pays, que vous avez situé, madame la ministre, le projet de loi dont nous allons débattre. Il est en cohérence avec le pacte voulu par le Gouvernement qui peut aider notre pays à se relever. C’est là son grand mérite, même si le mouvement dont je suis l’élue, le mouvement républicain et citoyen, pense qu’il faudrait aller plus loin sur certains points importants. Je me bornerai, dans le temps qui m’est imparti, à pointer les deux objectifs majeurs qui recueillent notre adhésion. Tout d’abord, la nécessité reconnue d’un effort particulier en faveur des jeunes qui sortent trop nombreux de leurs études universitaires sans qualification suffisante. Les modalités pour y remédier peuvent faire débat : je pense aux quotas à l’entrée dans les IUT. Mais cet objectif doit en tout cas prendre toute sa place dans la « stratégie nationale de l’enseignement supérieur » – concept heureux. Nous pensons que cette stratégie devrait intégrer le renforcement des filières professionnelles courtes au niveau de la licence. Ces filières sont aujourd’hui un élément fort ; elles demandent à être développées. Mais il faut tenir les deux bouts de la chaîne et favoriser aussi les formations longues. Former des chercheurs de haut niveau dans des filières d’avenir en n’oubliant pas que, comme enseignants-chercheurs, ils doivent aussi transmettre un savoir sans cesse enrichi. Le projet de loi apporte une innovation très utile, qui constitue même un tournant : la valorisation de la recherche par le transfert des résultats vers les secteurs socio-économiques, transfert sur lequel l’université doit garder la maîtrise grâce au mandataire unique que vous avez évoqué, madame la ministre. Quant à la stratégie nationale de la recherche, autre innovation importante, elle ne pourra ignorer la nécessité d’une solution mettant progressivement fin à la précarisation du statut des chercheurs qui atteint aujourd’hui, vous l’avez également souligné, une proportion préoccupante. Je voudrais souligner un point particulier qui me semble d’importance. Cette stratégie doit s’attacher à garantir un équilibre entre l’ensemble des disciplines en ce qui concerne les moyens de la recherche et leur valorisation, sans oublier la place utile qu’y tiennent la philosophie, les lettres, et l’ensemble des sciences humaines. Il en va de la respiration de la société tout entière. C’est aussi affaire du rayonnement de notre pays à l’étranger. Enfin, il convient de saluer la ferme affirmation du rôle de l’État sans lequel tous ces équilibres ne pourraient être garantis sur l’ensemble du territoire. Utile et même nécessaire dans la stratégie nationale de l’enseignement supérieur, ce rôle est indispensable au coeur de la stratégie nationale de la recherche qui ne peut se réduire à un simple face-à-face entre les universités et les régions. Nous serons très attentifs sur ce point qui est à nos yeux majeur. Madame la ministre, ce projet de loi se veut une réponse au défi du redressement économique, social et culturel, même, de notre pays. Pour répondre à cet objectif que nous approuvons, il peut encore être enrichi par des amendements qui n’en dénaturent pas le sens. Dans cette attente, si l’Assemblée est écoutée pour le renforcement de cet objectif, l’occasion n’aura pas été perdue de rendre espoir à tous ceux qui, difficilement, font vivre notre université.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe SRC.
Au début de son intervention, M. Fasquelle s’exprime en anglais, suscitant des exclamations continues sur les bancs du groupe SRC.

Mes chers collègues, je n’irai pas plus loin dans la langue de Shakespeare…

Tant mieux ! On voit bien qu’il n’a pas eu de cours d’anglais depuis longtemps !

Je ne veux pas plus longtemps vous faire vivre ce que vont vivre malheureusement très bientôt un certain nombre d’étudiants qui, bien que parlant le français, vont devoir suivre dans nos universités des cours en anglais.

Ne nous y trompons pas : on ne créera pas, dans la plupart des cas, deux groupes, un pour les francophones et un autre pour les autres. Au motif d’attirer des étudiants qui ne parlent pas français, et sans exiger d’eux qu’ils apprennent notre langue, on passera en réalité progressivement au tout-anglais. Et sans limite, puisque l’exception en faveur de la mise en oeuvre des conventions internationales et européennes prévue par le projet de loi est tellement large qu’elle permettra de faire basculer, en réalité, n’importe quel licence ou master dans une autre langue que le français. Les universitaires savent très bien que les universités françaises ont multiplié les conventions de par le monde et que, par ailleurs, le programme Erasmus permettra, je le répète, de faire basculer n’importe quelle licence ou n’importe quel master dans la langue anglaise. Le menace est triple : pour nos universités, pour le rayonnement de notre pays et pour notre langue. Il faut dénoncer, en premier lieu, l’abaissement, inévitable, du niveau de nos universités. Toutes les enquêtes le montrent : la qualité des enseignements sera inévitablement affectée par le passage à l’anglais. L’Allemagne, qu’on prend souvent en exemple, fait d’ailleurs aujourd’hui marche arrière et revient à l’allemand pour cette raison.

On peut nourrir aussi des craintes pour le rayonnement de notre langue, de notre culture et donc de notre pays. La politique est faite de symboles. A-t-on vraiment pris conscience, mes chers collègues, du signal que l’on va envoyer dans le monde en direction de tous ceux qui aiment et défendent le français ?

A-t-on vraiment compris que l’accès aux universités françaises ne peut que fortement motiver nombre de jeunes à apprendre le français ? Comment défendre, d’un côté, l’exception culturelle face aux Américains, comme vous le faites et, de l’autre, abandonner le français dans notre pays ? Ce sont deux messages totalement contradictoires. Ce n’est pas sérieux.
Sourires sur les bancs du groupe SRC.

Ce n’est tout de même pas compliqué : on ne peut pas défendre l’exception culturelle et décider d’enseigner en anglais dans nos universités.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Personne ne comprend rien à ces deux messages contradictoires. Réveillez-vous, ouvrez les yeux ! Ce qui est en cause, plus fondamentalement encore, et c’est le troisième enjeu, c’est l’avenir de notre langue.

Qu’ils soient aveugles, passent encore ; qu’ils ne soient pas intelligents, ça, c’est un problème !

Comme l’affirme Michel Serres, qui est « nul » d’après une députée que je viens d’entendre,…

Pouvons-nous nous écouter ? On a tout de même le droit d’émettre une opinion différente de la vôtre sans être couverts par des vociférations ! C’est franchement désagréable.

Comme l’affirme Michel Serres, disais-je, « une langue disparaît lorsqu’elle ne peut pas tout dire. Elle devient virtuellement morte ».

Or demain – mais nous découvrons, hélas, à l’occasion de ce débat, que c’est déjà le cas aujourd’hui – des équipes d’enseignants-chercheurs vont enseigner, mais aussi mener leurs recherches, exclusivement en anglais. Et peu à peu, il faut en prendre conscience, nous allons perdre notre capacité de penser et d’exprimer l’avenir en français dans certains domaines. Il n’y aura tout simplement plus de mots français pour embrasser ces nouveaux domaines : c’est extrêmement grave.

Mes chers collègues, à moins d’accepter que la France et le français n’aient plus qu’une vocation régionale et marginale, il faut renoncer à l’article 2 du projet de loi lourde d’orages et de défaites, comme l’a si bien dit Bernard Pivot ; mais peut-être est-il aussi de ceux que vous ne voulez pas écouter. Or c’est à l’université de montrer l’exemple. Car, au-delà de nos établissements d’enseignement supérieur, le même raisonnement est à l’oeuvre, qui conduira, pour reprendre les mots de Bernard Pivot, aux mêmes défaites. On chante de moins en moins en français, on tourne maintenant des films français en anglais pour les traduire ensuite en français ; demain, au motif d’attirer des cadres, puisqu’on parle sans cesse de l’attractivité de nos entreprises, on parlera également anglais à la tête de nos entreprises.

Il n’y a pas de limites : où cette folie va-t-elle s’arrêter ? Face à de telles menaces, existe-t-il une autre issue que celle que vous proposez ? La réponse est oui: elle consiste à essayer de concilier mondialisation et respect des langues et des cultures, et cela passe par une volonté politique forte. Cette ambition nouvelle doit s’exprimer, dans le domaine de l’enseignement, par une politique d’accueil des étudiants étrangers complètement repensée et renouvelée. La question n’est pas de savoir – et la confusion est malheureusement entretenue – s’il faut apprendre l’anglais à nos étudiants : bien sûr qu’il faut apprendre l’anglais, mais aussi d’autres langues, aux étudiants français. C’est évident, mais ce n’est pas la question. La vraie question, c’est celle de l’attractivité des universités françaises aux yeux des étudiants étrangers. Or en offrant des cours en anglais, nous ne ferons qu’attirer les étudiants qui auront été refusés par les universités anglophones : on préfère toujours l’original à la copie.

Tous ceux qui ont enseigné à l’université savent très bien que c’est ainsi que cela se passe. Pendant ce temps, est-on certain de tout mettre en oeuvre pour accueillir les meilleurs étudiants des pays francophones ? Aujourd’hui, hélas, de très bons étudiants ne viennent plus se former en France. Voilà un vrai sujet, et ce n’est pas en faisant basculer tous nos cours en anglais que nous rendrons nos universités plus attractives aux yeux de ces étudiants. Est-on suffisamment mobilisé pour inciter les étudiants des pays non-francophones à apprendre notre langue ? Voilà le sujet. S’est-on vraiment posé la question de savoir si les freins à l’accueil des étudiants étrangers n’étaient pas ailleurs que dans la barrière de la langue ? Vous raisonnez comme si la seule barrière s’opposant à l’accueil d’étudiants étrangers en France était celle de la langue, mais c’est tout à fait faux. Améliorer l’attractivité de nos universités suppose une réflexion préalable et approfondie sur le sujet, loin des procès en ringardise qu’on ne manque pas de faire aux Français qui défendent tout simplement la langue nationale, mais cette réflexion a malheureusement manqué. Cela implique aussi et surtout une volonté politique forte, française et européenne. À ce sujet, madame la ministre, on peut s’étonner de ce que l’Europe consacre aussi peu de moyens à l’apprentissage des langues étrangères…

… créant de ce fait un espace propice au développement exclusif de l’anglais : ainsi que l’affirme fort justement Umberto Eco, la langue de l’Europe, c’est la traduction.

On le voit, le débat qui s’est engagé est essentiel, n’en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre les arguments contraires aux leurs.

C’est dommage, car nous sommes ici pour débattre et pour nous écouter. Nous pouvons ne pas être d’accord avec vous ; vous pourriez au moins respecter notre point de vue et ne pas me traiter comme vous venez de le faire, en me demandant, par vos gestes, de mettre fin à mon intervention.

Vous vous exprimez dans cadre du temps programmé, monsieur Fasquelle, et vous pouvez effectivement parler autant que vous le souhaitez.

On le voit, le débat qui s’est ouvert est essentiel, car il en va, non seulement de la qualité de nos enseignements, mais aussi de l’avenir de notre langue, et finalement de bien plus que cela car, comme le disait Albert Camus : « Oui j’ai une patrie, c’est la langue française. » Ce débat peut être salutaire, s’il permet une urgente prise de conscience. Le premier acte fort passe par le renoncement à l’article 2 du projet de loi sur l’enseignement et la recherche. Mes chers collègues, je compte sur vous pour réagir et pour marquer, à l’occasion de ce projet de loi, le point de départ d’une politique ambitieuse pour notre université, pour notre langue et pour notre pays !
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Pour le bonne information de tous, je vous indique que seuls les propos de M. Fasquelle tenus en français figureront dans le compte rendu.
« Oh ! » sur les bancs du groupe UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les présidents de commission, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs, c’est avec une réelle inquiétude que j’ai pris connaissance de la loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et la recherche. Le texte que vous nous présentez aujourd’hui, madame la ministre, est un véritable retour en arrière. La loi du 10 août 2007 relative à la liberté et la responsabilité des universités, courageusement portée par Valérie Pécresse, a permis d’instaurer un juste équilibre dans l’application de l’autonomie des établissements. Cet équilibre, vous le remettez totalement en cause aujourd’hui, alors même qu’il est salué par la majorité des acteurs de l’enseignement supérieur. La loi Pécresse donnait au président des universités une véritable autonomie d’action et le ministre chargé de l’enseignement supérieur intervenait comme facilitateur. Vous, vous proposez l’inverse : votre vision est celle d’une gouvernance centralisée et administrative, où la tutelle du ministre est renforcée et où les pouvoirs du président des universités sont dilués. La création du conseil académique, que vous substituez au conseil des études et de la vie universitaire, et qui ne sera plus présidé par le président de l’université, en est une illustration. Il ne répond à aucune demande, ni de la part des enseignants, ni de la part de l’administration, ni même de la part des étudiants. Votre objectif est donc avant tout d’affaiblir le président de l’université, en retirant au conseil d’administration des prérogatives qui semblent pourtant relever normalement de sa compétence, à savoir le recrutement des enseignants, la gestion de leur carrière et la discipline de l’université. De même, l’augmentation du nombre de membres au sein de ces conseils, qui sont déjà pléthoriques, est une mesure démagogique, d’autant plus que vous n’augmentez pas pour autant la proportion de représentants du monde professionnel au sein de ces conseils. Bref, votre seul objectif est d’affaiblir le président et de défaire l’autonomie des universités. Mais le plus grave, madame la ministre, c’est que cette vision archaïque, vous ne l’appliquez pas aux seules universités. Vous voulez aussi l’appliquer aux grandes écoles, en plaçant systématiquement sous la coupe de l’enseignement supérieur tous les établissements qui dépendent d’autres ministères. Ce faisant, vous niez totalement la spécificité de ces établissements, qui n’ont ni la même culture, ni la même vision, ni la même histoire que les universités. Ils n’ont pas non pas la même vocation, et n’ont donc pas à être gérés comme des universités, ou comme les autres établissements de l’enseignement supérieur. Et s’ils sont rattachés à un autre ministère, c’est bien parce que ce dernier correspond au domaine d’activité dans lequel les étudiants vont ensuite se spécialiser. Vous semblez également oublier, madame la ministre, que ces établissements fondent une véritable exception française, qu’aucun de nos voisins n’a véritablement réussi à créer, mais que tout le monde nous envie. Au nom d’un égalitarisme que je ne comprends pas, et d’une logique d’uniformité, vous êtes prête à brader cet atout. C’est un véritable nivellement par le bas, et nous ne l’accepterons pas ! Oui, madame la ministre, votre projet est inquiétant. Il est inquiétant, parce qu’une fois de plus, vous cédez au dogmatisme, alors que l’enseignement supérieur a besoin de pragmatisme.

Il est inquiétant, parce qu’une nouvelle fois vous préférez défaire plutôt que faire. Il est inquiétant, parce qu’il remet en cause la notion d’excellence française, dont les grandes écoles sont l’incarnation. Alors, madame la ministre, je dirai non. Je dirai non au retour en arrière que vous nous proposez. Je dirai non à la cotutelle du ministre de l’enseignement supérieur, parce que vous allez créer une usine à gaz que vous ne contrôlerez pas. Et je dirai non à l’abaissement de notre méritocratie, qui fait de nous un modèle social envié.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons est un texte qui fait avancer l’ensemble de notre système d’enseignement supérieur et de recherche sur le chemin du XXIe siècle. On ne peut, comme on tenté de le faire certains orateurs, résumer son ambition à la polémique soulevée par son article 2 à la question de l’enseignement de l’anglais à l’université. C’est un texte qui propose des mesures fortes en faveur de la réussite de tous les étudiants, et qui agit en particulier sur les premiers cycles universitaires, pour faire en sorte que 50 % d’une classe d’âge soit enfin diplômée de l’enseignement supérieur.

C’est un texte qui promeut les valeurs de la coopération et de l’émulation, plutôt que celles de la concurrence et de la compétition, et qui renoue ainsi avec les valeurs qui sont au fondement de la communauté de la science et de l’enseignement. C’est un texte qui donne un nouvel élan à la recherche française, en la dotant d’une vision à long terme, sous l’égide d’un État redevenu stratège, et l’ouvrant avec courage vers l’international. Il est indispensable pour l’université de la Réunion, que je connais un peu mieux que les autres et qui est la seule université française de tout l’Océan indien, d’assumer pleinement son rôle dans le rayonnement de la France, à travers des coopérations universitaires avec les pays de sa zone géographique. C’est un texte qui réaffirme l’ancrage territorial, le rôle et la mission de nos universités dans leur environnement régional, notamment à travers la carte des formations professionnelles et universitaires, et qui redonne aux universités un rôle déterminant dans l’aménagement des territoires. C’est un texte qui réaffirme la détermination du Gouvernement à investir dans le savoir, dans l’éducation, dans la jeunesse, parce que c’est la clef pour préparer la France de demain, son redressement économique, social et moral. Mais c’est aussi un texte, madame la ministre – et je sais que vous y êtes particulièrement attachée – dans lequel la question des stages et des stagiaires devrait avoir toute sa place. Bien plus, je suis convaincu que c’est dans ce texte, plus que dans tout autre, que nous devons inscrire l’ambition du Gouvernement en matière d’encadrement, de développement et de sécurisation des stages. Cette ambition pour les stages doit avant tout rester une ambition pédagogique ; les stages n’ont de sens que s’ils font partie intégrante d’un cursus de formation. Car c’est précisément cette loi qui donne à l’université la mission de préparer l’insertion professionnelle de ses étudiants. Il y a, en France, plus d’un million de stagiaires, et presque deux millions selon certains. Leurs parents doivent subvenir à leurs besoins et il y a, en ce domaine, beaucoup d’abus que nous ne pouvons plus tolérer. J’aurai le loisir, au cours de nos débats, de vous présenter plusieurs amendements qui relèvent de cette question. Je les soumettrai à votre approbation avec le soutien du groupe socialiste, que je remercie de vouloir véritablement proposer une nouvelle donne en matière de politique des stages. Toutes ces mesures, vous le verrez, sont des mesures simples et de bon sens, sans contraintes excessives, ni pour les entreprises, ni pour les universités. Toutes ces mesures forment un ensemble cohérent qui, s’il venait à être adopté par cette assemblée, serait à l’origine d’un véritable « New Deal » pour les stagiaires.

Expression anglaise, certes, mais historique ! New Deal , parce que ces mesures reposent sur un équilibre subtil entre droits nouveaux pour les stagiaires, responsabilités renforcées pour les universités, mission complémentaire pour les inspecteurs du travail, et enfin respect d’un minimum de règles, notamment de transparence, par les entreprises et les organismes d’accueil. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas d’interdire les stages ou de les rendre impossibles par le jeu d’une réglementation excessive. Il s’agit au contraire de leur redonner un sens pour mieux les développer et les rendre accessibles à tous les étudiants. Il s’agit d’affirmer qu’en France, un autre stage est possible : un stage qui ne serait plus synonyme pour nos jeunes d’emploi déguisé, d’inscription fantôme à telle université, de mépris générationnel ou de précarité. Un stage qui ne serait plus le bizutage organisé sur le marché du travail qu’il est devenu, mais une formation tremplin vers l’emploi. Je connais, madame la ministre, la force de vos engagements sur cette question qui se trouve à la confluence d’un ensemble de défis auxquels nous devons faire face : celui de l’emploi des jeunes, celui du progrès social et de la lutte contre la précarité, et celui de la modernisation de notre système d’enseignement supérieur au service de la réussite de tous. J’ai la conviction que ce projet de loi nous offre une chance unique de passer à l’action sur les stages et de faire avancer ainsi beaucoup de nos combats collectifs pour la conquête des droits sociaux, pour l’université de demain, pour la jeunesse de France. Je ne peux que vous inviter collectivement à en saisir l’opportunité.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre pays ne va pas bien dans un monde qui, lui, va mieux. La France s’enfonce dans la croissance zéro, l’hyperendettement public et le chômage de masse, au moment même où des continents s’éveillent, où la pauvreté et l’ignorance reculent, où les libertés progressent dans le monde. Les jeunes Français s’interrogent : ont-ils encore un avenir en France ? Seulement 36 % d’entre eux ont confiance dans l’avenir de notre pays, alors qu’ils sont 75 % à croire en celui de l’Allemagne. Plus préoccupant encore : 51 % des jeunes de 25 à 34 ans aimeraient, s’ils le pouvaient, partir vivre ailleurs qu’en France. Nous sommes menacés par le déclin industriel, commercial, mais aussi culturel et même intellectuel si nous ne parvenons pas à rompre avec un certain nombre de tabous. C’est pourquoi notre système d’enseignement supérieur doit faire preuve d’audace. Pour commencer, nous ne devons pas craindre de renforcer ardemment le lien entre l’enseignement supérieur et le monde de l’entreprise. Chaque étudiant, dès le premier cycle, doit pouvoir recevoir une formation d’initiation à la vie de l’entreprise et bénéficier de stages. Dans le même temps, les instances de gouvernance des universités doivent s’ouvrir, plus qu’aujourd’hui, à des acteurs de l’industrie, du commerce et des services. Ma deuxième conviction est que nous devons assumer l’existence classes préparatoires et de grandes écoles qui restent indépendantes des structures universitaires. Prenons garde à ne pas freiner les initiatives de nos grandes écoles ou à les contraindre ; elles restent un formidable atout pour notre pays, un ascenseur social et un instrument de méritocratie républicaine. Nous n’avons pas à nous excuser de l’existence en France de ces filières d’excellence. Troisième impératif : nous devons favoriser une plus grande ouverture internationale de notre système d’enseignement supérieur. Notre attractivité auprès des étudiants talentueux des pays émergents est un enjeu majeur pour maintenir l’influence de notre pays dans les enceintes diplomatiques, mais aussi pour conquérir des marchés. La question de la langue de l’enseignement doit être abordée de manière apaisée. Bien sûr, il faut maintenir le principe d’un enseignement en langue française. De même, il est normal que des cours de langue et de culture françaises soient obligatoires pour les étudiants étrangers. Est-ce à dire que, dans nos écoles et nos universités, tous les cours doivent être assurés en français ? Je ne le crois pas. Il serait évidemment absurde qu’un enseignant français maîtrisant moyennement l’anglais, parlant ce globish que Jacques Myard dénonce à juste titre, soit obligé de donner une leçon dans un anglais médiocre. Mais il serait tout aussi absurde d’empêcher un professeur Américain, invité dans une grande école française, de donner un cours de commerce international ou de finance en anglais.

Faisons preuve d’ouverture et de bon sens, et ne cherchons pas à tout réglementer dans le détail par la loi. Faisons confiance aux acteurs de l’enseignement supérieur. J’en viens à ma quatrième conviction : il faut renforcer l’ancrage territorial de nos universités et de nos grandes écoles. Dans le système d’enseignement supérieur des années 2030, il ne doit pas y avoir Paris, quelques métropoles régionales et, partout ailleurs, le désert français ! Les villes moyennes ont besoin de formations supérieures ciblées, cohérentes avec les besoins des entreprises, et articulées avec l’offre d’enseignement des métropoles voisines. Je suis persuadé qu’une ville comme Auxerre devra former demain plus d’étudiants, en liaison avec l’université de Bourgogne, sans s’interdire des partenariats avec des filières de l’Ile-de-France.

Vous avez raison, cher collègue, de souligner combien une filière telle que la viticulture gagnerait à être encore plus valorisée dans ma belle région de Bourgogne ! Plus sérieusement, je conclurai en énonçant une cinquième conviction, sans doute la plus audacieuse : n’ayons pas peur de mettre en oeuvre une orientation sélective des bacheliers vers les différentes filières d’enseignement supérieur. Chacun a ces chiffres à l’esprit : un quart des jeunes sortent de l’université sans aucun diplôme, et seuls 47 % des étudiants inscrits en première année à l’université passent en deuxième année. Cet échec massif au cours des premières années d’université doit être combattu vigoureusement. Il faut mettre fin à la sélection par l’échec et oser organiser enfin une orientation sélective active des bacheliers vers les filières d’enseignement supérieur. C’est pourquoi je suis favorable à ce que chaque lycéen ouvre un dossier personnel d’orientation et de candidature qui serait examiné par les établissements d’enseignement supérieur. Ceux-ci auraient alors non seulement le pouvoir de refuser une inscription dans une filière, mais aussi l’obligation de proposer une inscription alternative dans une autre filière. Ainsi, tous les bacheliers auraient accès à une formation universitaire. La vraie démocratisation de l’enseignement supérieur sera, demain, de garantir aux bacheliers une orientation réussie et donc une formation supérieure qui leur permette véritablement de s’insérer sur le marché du travail. Je regrette que votre projet de loi, madame la ministre, soit à des années-lumière de cette nécessaire audace. Vous allez bureaucratiser l’organisation de l’enseignement supérieur tout en rognant les ailes de celles et ceux qui veulent avancer plus vite et plus loin. Vous allez, hélas, faire prendre du retard à la France.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les présidents de commission, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames et messieurs, vous me permettrez de commencer cette intervention par l’évocation des conditions dans lesquelles ce projet de loi est examiné. Son examen a été repoussé, notamment pour faire place au texte sur l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples du même sexe. L’examen des amendements en commission a été déstructuré, s’achevant lors d’une séance commencée le mercredi à vingt et une heures trente et achevée le jeudi à cinq heures trente.

Le texte de la commission n’a été disponible le vendredi qu’après quinze heures, alors que le dépôt des amendements, prévu avant dix-sept heures, a été reporté au samedi d’un week-end pas ordinaire. Enfin, l’examen du texte se fait sans délai.

C’était bien pire avant ! Vous n’étiez pas encore là, mais si vous aviez vu !

Ce n’est pas faire injure au président de la commission, qui s’est adapté au mieux aux circonstances, que de dire que les conditions n’ont pas été optimales pour débattre de ce projet de loi. Pourtant, enseignement supérieur et recherche sont les outils de formation de notre jeunesse, de notre développement économique et de notre attractivité internationale. Permettez-moi de soulever trois questions générales avant de choisir quatre points parmi tous ceux qui pourraient ou devraient être développés. Tout d’abord, quel est le sens de cette loi qui revient sur une réforme récente, considérée comme plutôt positive ? Vous-même, madame la ministre, vous en avez régulièrement souligné la continuité. S’il s’agit d’améliorer un dispositif, on peut être d’accord ; mais l’objectif semble plutôt de défaire d’un point de vue technique ce qui a été fait, car les orientations de réussite des étudiants en licence, de lien entre secondaire et supérieur, de place du numérique ou des langues vivantes étaient déjà dans la loi de 2007. Deuxième question : quels sont les moyens prévus pour accompagner ces engagements dits nouveaux ? Le rapporteur a regretté, dans sa présentation en commission ainsi que dans l’hémicycle, l’absence d’engagements financiers et appelé de ses voeux un livre blanc de l’enseignement supérieur et de la recherche, associant stratégie et moyens. La réalité est que les universités ont dû réduire leur budget de fonctionnement de 4 %. Quant aux 1 000 postes supplémentaires destinés à la réussite en licence, ne s’agit-il pas d’un effet d’annonce à l’heure des gels des postes et des difficultés financières ? Aucune précision n’est donnée sur la nature de ces postes et les qualités qui permettraient de s’adapter à un public hétérogène en première année et de faire évoluer les pratiques d’enseignement. Troisième question : quelles sont les orientations et les propositions pour la vie étudiante ? La réussite passe pourtant aussi par les conditions de vie des étudiants. J’en viens aux quatre points que je souhaitais développer plus précisément. Quatrième question, celle de la gouvernance. Le conseil d’administration s’élargit et ses compétences se réduisent, tandis qu’à ses côtés est créé un conseil académique, comptant de quarante à quatre-vingts membres, qui va décider de la répartition des moyens, du recrutement et de la gestion des carrières. En faisant coexister président de l’université et président du conseil académique, ne risque-t-on pas la confusion, la confrontation et au pire la paralysie ? Les sénats académiques existent dans des universités étrangères, mais le conseil d’administration y est très ramassé et plus ouvert à la société civile qu’aux composantes universitaires. S’agissant du regroupement d’établissements, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur, fondés sur l’association volontaire autour de noyaux durs, sont supprimés. Les communautés d’universités et établissements sont créées dans une logique territorialisée. Le risque est grand d’une modélisation mettant en cause l’autonomie et les spécificités. Peut-on n’avoir qu’une vision régionaliste ? Quid du rayonnement national et international ? En Allemagne, où l’enseignement supérieur est régionalisé, l’État a choisi d’intervenir pour qu’existent des pôles d’excellence nationaux en capacité de participer à la compétition internationale. S’agissant des STS et des IUT, le projet de loi instaure un pourcentage minimal de bacs professionnels et technologiques dans ces deux filières. L’objectif est partagé par tous les acteurs. Cette préoccupation est d’ailleurs affichée depuis longtemps, et dans de nombreux établissements les dossiers des candidats bacheliers techniques et professionnels sont étudiés à part de ceux des candidats bacheliers généraux, et avec une attention particulière. Mais la solution des quotas fixés d’en haut n’est pas nécessairement la bonne réponse, parce qu’elle ne tient pas compte de la situation territoriale et de la spécialité des diplômes, et parce qu’elle ne favorise pas le dialogue entre les IUT, les STS et les lycéens. Or ce dialogue permet de mieux informer et inciter les lycéens et d’assurer la continuité et l’accompagnement adapté. S’agissant enfin de l’évaluation de la recherche, l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est remplacée par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur avec un objet équivalent. Depuis six ans, l’AERES a construit un dispositif national d’évaluation, acquit une reconnaissance européenne et mondiale et est référencée sur le web. On ne voit donc guère l’intérêt de ce changement, par ailleurs coûteux. On peut aussi avoir un doute sur l’indépendance et l’impartialité des évaluations puisque le Haut conseil a pour mission de valider des procédures d’évaluations réalisées par d’autres instances. Enfin, je regrette de n’avoir pas ou peu lu les mots « entreprise », « industrie », « excellence », « compétitivité » ou « international ».
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pour la première fois, enseignement supérieur et recherche sont réunis dans un seul et même projet de loi. Cela montre bien l’importance que revêt à vos yeux la recherche, madame la ministre. Les chercheurs que je rencontre me disent tous combien ces deux sujets, enseignement supérieur et recherche, sont inséparables. Et je peux vous dire qu’ils sont nombreux, ces chercheurs, dans ma circonscription qui compte deux universités, 200 labos publics et privés dont 31 associés au CNRS, cinq écoles d’ingénieurs et de nombreux instituts renommés comme l’IEMN et l’INRIA. La recherche est un levier essentiel pour contribuer au redressement de notre pays, soutenir l’activité et l’emploi, et pour développer l’innovation de nos entreprises et de nos PME. C’est pourquoi il est heureux que ce projet de loi prévoie le principe d’un agenda stratégique pour la recherche, le transfert et l’innovation. Il est heureux aussi qu’on élabore enfin une vraie stratégie nationale de recherche, tant il est vrai que la SRI de 2009 est considérée par beaucoup comme peu concluante. Le nouvel agenda stratégique national devra être conçu en concertation avec tous les acteurs, mais également, je voudrais insister sur ce point, en lien avec les orientations stratégiques européennes. Ces orientations sont tracées dans le 8e programme-cadre pour la recherche et l’innovation, le programme européen Horizon 2020. Il se trouve que j’ai récemment eu l’occasion, au sein de la commission des affaires européennes, de présenter avec Jacques Myard…

… un rapport d’information sur Horizon 2020 – en français, je le précise pour éviter toute polémique.
Sourires.
Sourires.

Ayant travaillé et auditionné de manière approfondie de nombreux acteurs français concernés par Horizon 2020, je veux ici souligner combien la cohérence entre le futur agenda français de recherche et le programme-cadre européen est nécessaire. Cela doit se traduire d’abord dans les mécanismes d’obtention des financements : il ne faut plus que nos chercheurs aient, faute de temps ou de lisibilité, à arbitrer entre répondre à un appel à projet français - et ils sont devenus nombreux - et répondre à un appel à projet européen. La participation d’équipes françaises aux appels à projets européens évolue trop faiblement en comparaison celle de nos voisins. Pourtant, les chiffres montrent que le taux de succès, c’est-à-dire le nombre de dossiers acceptés par la Commission européenne par rapport au nombre de dossiers candidats, est de 25 % pour les chercheurs français, ce qui est un taux satisfaisant, et même largement supérieur à la moyenne européenne dans certaines disciplines. Quand nous répondons, donc, nous sommes souvent sélectionnés. Mais comme nous ne répondons pas souvent, le taux de retour pour la France, c’est-à-dire les crédits obtenus par les laboratoires français par rapport à la contribution financière française au programme européen, reste mitigé. Il est donc essentiel que la mise en place de l’agenda stratégique national s’articule bien par rapport au programme-cadre Horizon 2020 pour permettre à nos chercheurs de répondre davantage aux appels à projets européens. L’accompagnement de nos chercheurs est, à cet égard, un point important. Notre réseau de points de contacts nationaux pourrait être encore perfectionné pour mieux diffuser l’information sur nos territoires et accompagner partout les équipes dans l’ingénierie du montage de projet. Mieux accompagner suppose aussi de veiller à ce que les administrations françaises ne soient pas parfois plus exigeantes, plus tatillonnes, voire plus bureaucratiques que la Commission européenne elle-même, en matière par exemple de justification des dépenses par les chercheurs. L’articulation entre notre agenda national de la recherche avec Horizon 2020 doit donc se traduire sur le plan organisationnel. Mais cette articulation doit aussi – et peut-être surtout – être assurée aussi sur le fond et sur le plan scientifique. Les axes prioritaires d’Horizon 2020 sont connus : l’excellence scientifique, la primauté industrielle et l’innovation dans les PME, sans oublier les grands défis sociétaux comme la santé, la sécurité alimentaire ou encore la lutte contre le changement climatique. Ces priorités, la France les partage, les porte même comme État membre dans les discussions au niveau européen. Elle doit également faire en sorte qu’elles soient bien présentes dans le futur agenda stratégique national avec, dans les deux cas, un juste équilibre entre le soutien à la recherche appliquée et le soutien à la recherche fondamentale. Dans le même temps, la France doit continuer de veiller, comme vous le faites avec vos collègues, madame la ministre, à ce que les différentes lignes de crédits du programme Horizon 2020 soient bien fléchées vers les secteurs d’avenir, en particulier vers ceux dans lesquels la France est puissante, comme l’énergie, la santé, l’aéronautique ou le numérique. C’est dans un esprit de cohérence et de bonne articulation avec l’Europe pour et par la recherche que, madame la ministre, vous avez tracé hier les grandes lignes de notre futur agenda stratégique pour la recherche, de notre agenda France Europe 2020, comme l’avez fort opportunément appelé. Je m’en réjouis et je voterai donc, pour cette raison et bien d’autres évoquées par mes collègues du groupe SRC, le projet de loi que vous nous présentez, enrichi des améliorations que notre travail parlementaire y a apportées et va y apporter encore.

Madame la ministre, j’ai deux mots à vous dire au sujet de l’article 2… Cet article porte la marque des cervelles lavées qui excellent à s’exprimer en globish et pensent ainsi se faire comprendre de la terre entière. Certes, la commission a apporté quelques modifications au texte initial, mais ces modifications sont purement cosmétiques ! Il faut regarder les choses avec responsabilité et objectivité. Parler une langue étrangère est aujourd’hui une évidence ; deux, c’est encore mieux. De ce point de vue, je crois que nous devons encourager l’enseignement des langues étrangères pour tous les étudiants –- et peut-être même pour certains députés.
Sourires.

Comment faire ? Par les échanges d’étudiants, notamment par le programme Erasmus Et, croyez-moi, cela peut très bien fonctionner, même si certains ont estimés que les crédits étaient excessifs. Faut-il pour autant organiser un cursus dans une langue spécifique sur notre territoire, dans nos universités, une telle pratique étant, paraît-il, censée attirer les étudiants étrangers ? On nous donne en exemple les pays scandinaves, telle la Suède, ainsi que les Pays-Bas. Depuis quand l’analogie avec ces États, valeureux, certes, constitue-t-elle une politique publique pour notre pays ? Les bras m’en tombent ! Vous n’allez quand même pas comparer la France, avec sa stratégie d’influence et la francophonie, à la Suède ou aux Pays-Bas ! Cela ne tient pas la route ! Je relève d’ailleurs qu’à certains égards, après avoir servi de modèles à certains bobos salonnards, ces États ont opéré un changement à 180° de leur politique, par exemple en matière de drogue. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous inspirer de ces prétendus exemples de l’étranger : regardons plutôt où sont nos intérêts. Je relève d’ailleurs que la République fédérale d’Allemagne, qui avait justement privilégié le globish dans son enseignement et démultiplié les cours en anglais, vient de se rendre compte, au cours de la Hochschulerektorenkonferenz qui a eu lieu il y a quelques mois, des dégâts de l’enseignement de la recherche en globish général, qui a abouti à une véritable catastrophe. Au point que les chercheurs et les professeurs allemands commençaient même à se demander si la langue allemande, cette très grande langue européenne qui a permis des apports inestimables à la science européenne et mondiale, était encore capable à l’avenir de forger des concepts ! Il y a là un problème que vous refusez de voir, madame la ministre : ce n’est pas en publiant uniquement dans une langue ânonnée dans un certain nombre de publications que l’on va participer à ce qui se passe aujourd’hui dans le monde : le maelström de la science dépasse largement ce globish réducteur ! Il est clair qu’aujourd’hui, si vous êtes en pointe dans votre recherche et publiez en français, vous serez de toute façon lu dans le monde entier, car il existe partout des services ayant vocation à éplucher et traduire les revues scientifiques. Voir le monde scientifique uniquement à travers ce globish réducteur est donc une grave erreur. Si l’on continue à publier uniquement dans ce globish que certains de nos chercheurs ont déjà décidé, paraît-il, de voir comme le deus ex machina, la langue valable, à terme, la bibliothèque scientifique de la francophonie ne va aller qu’en s’appauvrissant, ce qui serait une catastrophe ! On nous dit qu’il faut attirer les étudiants étrangers avec des cursus entièrement en anglais. Mais de qui se moque-t-on ? Croyez-vous que les étudiants que nous allons accueillir ne vont pas d’abord tenter d’aller aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, avant de se rabattre éventuellement sur la France ? Je vous rappelle que notre pays est la troisième puissance au monde à accueillir des étrangers. Ce n’est pas en renonçant à ce que nous sommes que vous allez attirer les étudiants étrangers, bien au contraire ! Mais il y a plus grave. La fascination pour cette langue, que l’on nous présente comme la clé du monde d’aujourd’hui, me fait penser à celle qu’éprouvaient les stratèges de 1940 à l’égard de la ligne Maginot, censée nous protéger des chars de Guderian. Regardons les choses telles qu’elles sont : l’anglais est aujourd’hui une langue en déclin, madame la ministre ! Il suffit pour s’en convaincre de regarder les statistiques sur Internet : alors qu’il y a quelques années, celles-ci étaient exclusivement en anglais, elles sont désormais dans une multitude de langues.

Nous sommes entrés de plain-pied dans le monde des puissances relatives et, à ce titre, privilégier le globish revient à porter une vision dépassée sur le monde : ce n’est donc pas regarder la réalité. Les grandes langues de l’avenir seront le chinois, l’espagnol et l’arabe. L’anglais restera tout de même une grande langue – de même que le français, grâce aux Africains qui, eux, ont le courage de le parler et de ne pas refuser la réalité du monde. Que nos ingénieurs n’espèrent pas pénétrer le marché chinois sans parler le chinois ! Penser que l’anglais constitue un sésame pour la Chine est une grave erreur ! Je sais de quoi je parle, ayant moi-même négocié avec les Chinois : sortez de votre hôtel, pas un mot d’anglais ne pourra vous aider pour traverser le pays: il faut être sinisant. Tout cela est à replacer dans le contexte de l’Union européenne. On assiste, à Bruxelles, à un matraquage en anglais par la Commission, qui a pour conséquence de faire disparaître peu à peu le français en tant que langue de travail – avec du reste la complicité de nos diplomates, qui se vautrent avec délices dans l’adoration de l’anglais dans l’espoir d’avoir l’air intelligent. Et grâce à eux, le français recule tous les jours! Face à ce phénomène, que faites-vous, madame, pour protéger et renforcer la langue française ? Comment se fait-il que, comme Audrey Linkenheld et moi-même l’avons constaté, presque toutes les publications qui sortent de Bruxelles soient aujourd’hui en anglais ? Nous ne devons pas renoncer à exercer une stratégie d’influence, en refusant ce que veulent nous imposer un certain nombre de technocrates coupés de la réalité – une réalité qui va leur revenir en boomerang dans la figure ! Comme nous l’avons indiqué dans nos conclusions, il est clair que le français doit continuer à être une langue scientifique, que nous devons continuer à défendre bec et ongles. Pour cela, nous devons publier en français, même s’il faut accompagner les textes d’un résumé en chinois, en arabe et en espagnol – croyez-moi, si la publication est de qualité, elle ne manquera pas d’être traduite par les chercheurs du monde entiers, désireux d’en prendre connaissance. Une langue, c’est un monde de pensée. En enseignant notre langue, nous ne donnons pas simplement accès à une technique, à la nanotechnologie ou à la médecine, nous ouvrons la porte sur la maison France : C’est un atout économique, madame la ministre. On ne segmente pas les connaissances et les possibilités de la France, on les ouvre tout grand. Lorsque l’on défend notre langue et qu’on l’enseigne à des étrangers, on leur ouvre l’accès au cinéma français, à la littérature française, au droit français. Sinon, on va droit dans la segmentation de la connaissance, et on a tout faux ! M. Daniel Fasquelle vous l’a dit tout à l’heure et il avait raison:, à un moment où le Gouvernement, avec raison, essaie d’introduire dans l’accord qui va être noué entre l’Union européenne et les États-Unis une exception culturelle, que vous vous faites les fourriers des intérêts anglo-saxons : ce n’est pas acceptable ! L’article 2 est véritablement le « porteur de valises » d’un imperium qui nous a certes apporté beaucoup, mais qui ne saurait constituer une explication du monde suffisante. Dès lors, prenez garde : les querelles linguistiques, madame, ont toujours été les prémices de bouleversements fantastiques en Europe. Voyez ce qui se passe en Belgique, voyez ce qui s’est passé dans l’ex-Yougoslavie et en Union soviétique : ce sont véritablement des bombes à retardement.

Une langue, c’est un monde de pensée. En enseignant notre langue, nous ne donnons pas simplement accès à une technique, à la nanotechnologie ou à la médecine, nous ouvrons la porte sur la maison France : C’est un atout économique, madame la ministre. On ne segmente pas les connaissances et les possibilités de la France, on les ouvre tout grand. Lorsque l’on défend notre langue et qu’on l’enseigne à des étrangers, on leur ouvre l’accès au cinéma français, à la littérature française, au droit français. Sinon, on va droit dans la segmentation de la connaissance, et on a tout faux ! M. Daniel Fasquelle vous l’a dit tout à l’heure et il avait raison:, à un moment où le Gouvernement, avec raison, essaie d’introduire dans l’accord qui va être noué entre l’Union européenne et les États-Unis une exception culturelle, que vous vous faites les fourriers des intérêts anglo-saxons : ce n’est pas acceptable ! L’article 2 est véritablement le « porteur de valises » d’un imperium qui nous a certes apporté beaucoup, mais qui ne saurait constituer une explication du monde suffisante. Dès lors, prenez garde : les querelles linguistiques, madame, ont toujours été les prémices de bouleversements fantastiques en Europe. Voyez ce qui se passe en Belgique, voyez ce qui s’est passé dans l’ex-Yougoslavie et en Union soviétique : ce sont véritablement des bombes à retardement.

Faites attention : on ne se bat pas pour une boîte de petits pois, mais pour notre langue, fondement de notre identité
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.

Madame la ministre, beaucoup de choses ayant déjà été dites, je centrerai mon intervention non sur l’article 2, mais sur l’article 18 du projet de loi. Le dispositif institué à l’article 18 vise à conférer une priorité d’accès vers les sections de techniciens supérieurs aux titulaires d’un baccalauréat professionnel et vers les instituts universitaires de technologie aux titulaires d’un baccalauréat technologique. Si, de prime abord, cette mesure peut paraître séduisante – plusieurs collègues de la majorité l’ont reconnu tout à l’heure –, en ce qu’elle peut éviter d’orienter un trop grand nombre de ces bacheliers vers l’université et contribuer ainsi à diminuer le taux d’échec contre lequel vous voulez lutter, madame la ministre, elle peut aussi avoir très rapidement des effets destructeurs sur les IUT : c’est ce que je veux essayer de vous démontrer. Une constatation, au préalable : il n’existe pas toujours un nombre suffisant de bacheliers technologiques susceptibles d’être accueillis en IUT, à moins de vouloir niveler par le bas le niveau d’enseignement dispensé et donc de diminuer le taux de réussite des IUT. En effet, s’ils constituent globalement un tiers des élèves en IUT, les bacheliers technologiques ne forment que 20 % des effectifs, voire même 15 % dans certaines filières comme l’informatique ou l’information-communication. Je citerai un exemple concret : à Nantes, alors que 94 % des places étaient ouvertes cette année, au sein des IUT, aux bacheliers technologiques, seuls 20 % d’entre eux s’y sont inscrits. L’instauration d’un pourcentage minimal, assimilé aujourd’hui par les directeurs et les enseignants d’IUT à un quota, me paraît donc contre-productive. En effet, dans la situation actuelle, chaque conseil d’IUT détermine sa stratégie de recrutement à l’aide de cibles claires qui dépendent de la spécialité du diplôme dispensé et du marché local de l’emploi. Ces conseils cherchent à adapter leurs formations et leurs recrutements au contexte régional. Cela explique, sans nul doute, le taux de réussite et le taux d’accès au marché de l’emploi des étudiants ayant suivi une telle formation. Nous savons aujourd’hui que le taux de réussite des bacheliers technologiques titulaires d’un diplôme universitaire de technologie est de 68 %, alors qu’à titre de comparaison, il n’est que de 13,5 % en licence. C’est la raison pour laquelle, à des quotas imposés, je préfère des objectifs ciblés qui émanent du terrain et des spécificités de chaque IUT. Il revient à chaque jury d’admission de fixer des objectifs en fonction des candidatures à examiner. Il n’est bien entendu pas question de refuser d’accueillir plus d’un certain nombre de bacheliers technologiques ; c’est même tout le contraire qui doit être fait : les 115 IUT de France y sont tout à fait favorables, ainsi qu’à une co-construction avec les recteurs sur la base de conventions d’orientation entre lycées et établissements d’enseignement supérieur. C’est d’ailleurs une préoccupation qu’ils affichent depuis longtemps et qui se traduit concrètement dans leur sélection. Il est toutefois inutile que le recteur se substitue aux jurys d’admission en proposant des quotas. Le véritable problème tient au fait, je le répète, que les IUT n’ont pas assez de candidats issus des filières technologiques. Les obliger à renoncer à leurs critères de sélection pour permettre l’admission en leur sein de jeunes bacheliers technologiques qui ne sont pas motivés par les formations dispensées en IUT et qui désirent, pourquoi pas, se réorienter vers un cursus plus général en université, me paraît totalement contraire au principe de liberté de choix des étudiants et à la volonté de préserver une intégration dans l’emploi à l’issue d’une formation en IUT. Si la volonté du Gouvernement consiste, par cet article 18, à augmenter le nombre de bacheliers technologiques en IUT, il doit inscrire son action dans une perspective de long terme et faciliter les campagnes d’information dans les lycées pour inciter ces futurs bacheliers à s’intéresser davantage à ce type de formations. Comme vous le voyez, votre article 18, s’il peut sembler réorienter les IUT vers leur véritable destination, risque en réalité de réduire leur attractivité, leur niveau de recrutement et, partant, leur taux de réussite. Je crains malheureusement, s’il demeure en l’état, qu’il amorce la disparition programmée d’un système d’études qui a fait ses preuves, constitue un levier important de l’insertion professionnelle des jeunes et joue un rôle d’ascenseur social en faveur de ceux qui sont souvent le plus en difficulté
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Je veux tout d’abord féliciter le Gouvernement en raison de la priorité qu’il accorde à l’éducation et, partant, à la jeunesse de notre pays. Les projets de loi sur la refondation de l’école de la République et celui dont nous débattons, relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, constituent, chacun à son niveau, les deux volets d’une même démarche : celle du parti pris de l’éducation et du savoir, celle de l’émancipation de l’individu, celle de l’intelligence et du progrès. Votre projet de loi, fort de soixante-neuf articles, a pour objectif prioritaire la réussite des étudiants mais aussi, par la prise en compte de la recherche dans toute sa diversité, la réponse aux grands enjeux sociétaux à venir. Par ailleurs, puisque nous touchons à l’universel, votre projet de loi comporte nécessairement des dimensions européenne et internationale. Personne ne saurait contester de telles orientations, qui permettent d’anticiper les défis de demain, sans pour autant sacrifier les fondamentaux des cultures dont nous héritons. Cela me fait songer à ces mots du poète André Chénier : « Sur des pensers nouveaux, faisons des vers antiques ». Après avoir souligné l’importance et l’ambition de cette loi – que, vous l’aurez compris, je soutiens – permettez-moi néanmoins, madame la ministre, de m’étonner que le débat et la médiatisation qui l’entourent, loin de porter sur l’ensemble du texte, se focalisent sur l’article 2. Je vous ai écrit à ce sujet en ma qualité de président délégué de l’assemblée parlementaire de la francophonie. Vous m’avez apporté une réponse argumentée, en soulignant la possibilité « d’une dérogation encadrée au principe de l’usage du français comme langue d’enseignement » par une interprétation extensive de la loi Toubon. Trois arguments viennent à l’appui de votre point de vue : premièrement, ce droit résulte d’une demande des établissements d’enseignement supérieur ; deuxièmement, il ajouterait à l’attractivité de notre enseignement supérieur, ce que l’on peut admettre ; troisièmement, il précise et encadre un mouvement déjà existant. Tout en prenant acte de vos arguments, je m’interroge : s’il s’agissait, notamment, de régulariser une situation de fait, fallait-il recourir à des dispositions législatives ou pouvait-on se contenter de mesures réglementaires ? Était-il nécessaire de relancer un débat déjà tranché dans les grandes écoles et certaines universités ?

Vous comprenez que ma volonté n’a jamais été de provoquer ni d’attiser ce débat. Les amendements déposés par le rapporteur et plusieurs de nos collègues démontrent que la volonté d’encadrer ce dispositif est largement partagée. Chacun, de bonne foi, essaie d’apporter sa pierre à l’édifice et nombre de suggestions méritent d’être regardées et analysées sans a priori plutôt que d’être balayées d’un revers de main.

Par ailleurs, la prise en compte des amendements parlementaires n’est pas un aveu de faiblesse, mais participe de la coproduction législative.

En ce qui me concerne, je vous propose de considérer la possibilité de mettre entre parenthèses cet article 2, pour donner le temps à ceux qui le souhaitent de parvenir à une rédaction plus consensuelle d’ici son adoption définitive. Je crois savoir que bon nombre de députés ainsi que, pour leur avoir parlé, un certain nombre de sénateurs, partagent cette volonté. Il nous appartiendra aussi de veiller, comme vous le dites, à ce que les étudiants étrangers ayant fait leurs études en France soient véritablement les ambassadeurs de la francophonie et de notre culture universelle : c’est un objectif qu’il ne faut jamais perdre de vue. La francophonie n’est pas une cause ringarde, comme l’a souligné, en termes plus diplomatiques que les miens, M. Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie, dans un courrier adressé à M. le Premier ministre. La francophonie milite pour la diversité culturelle, contre l’uniformité. Nous le savons bien, nous qui, par ailleurs – n’est-ce pas, monsieur le président de la commission des affaires culturelles – nous battons aussi, parfois, pour défendre l’exception française. La langue n’est pas simplement vernaculaire ; elle est aussi l’expression d’une culture, d’une conception et d’une philosophie de société, chacun le sait bien ici. Pour autant, il faut savoir en sortir. Le débat qui va suivre permettra, si chacun le veut, de parfaire la coproduction législative que j’évoquais précédemment.

Il nous incombe à tous de dépasser des positions figées, par une écoute réciproque, et par là même de confirmer qu’impossible n’est pas français
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce projet de loi, issu d’une des nombreuses promesses de campagne de François Hollande, est très loin de répondre aux enjeux fondamentaux de l’enseignement supérieur et risque, en rigidifiant leur gouvernance, de briser la dynamique qui a été engagée depuis cinq ans dans les universités françaises. Après vous être attaqués à l’école de la République, dans notre assemblée, il y a quelques semaines et ces jours-ci au Sénat, vous détricotez une fois de plus le travail de la législature précédente. Avec mes collègues de l’opposition, nous reprochons tout d’abord à ce texte de réduire presque à néant l’autonomie des universités en accumulant notamment les contraintes institutionnelles et administratives, et en faisant disparaître des spécialités qui contribuent pourtant à l’attractivité de nos universités. J’en suis désolé pour notre collègue Valérie Pécresse, qui avait accompli un travail remarquable. Vous prétendez corriger ce que vous appelez les dysfonctionnements de la loi sur les libertés et responsabilités des universités. J’admets que cette loi a favorisé une concentration du pouvoir au bénéfice des présidents d’université, mais il s’agissait de permettre aux établissements d’enseignement supérieur de développer une véritable vision stratégique. Même sur vos bancs, et parmi vos amis, notamment M. François Patriat, président du conseil régional de Bourgogne, certains pointent le risque de dilution du pouvoir universitaire et soutiennent la réforme ambitieuse mise en oeuvre sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Cette réforme a notamment permis aux universités françaises de devenir autonomes : au plus près des réalités du terrain, les établissements disposent ainsi de tous les leviers pour conduire les stratégies les plus adaptées à leur contexte, afin d’améliorer leurs performances et de peser davantage dans la compétition internationale. Cette loi a été accompagnée par une augmentation sans précédent des moyens accordés aux universités, avec une progression de 50 % du budget consacré à l’enseignement supérieur entre 2007 et 2012, qui est passé de 10 à 15 milliards d’euros par an. Tout comme vous, nous souhaitons la réussite des étudiants. Mais nous sommes sceptiques, car ce texte, par exemple, ne comporte aucune mesure en faveur du logement étudiant ou du développement de filières d’excellence dans les premiers cycles universitaires, alors qu’une telle disposition contribuerait à rendre l’université plus attractive par rapport aux grandes écoles. La disparition des spécialités de masters que vous envisagez contribuera également à la perte d’autonomie des universités, à l’anonymat des diplômes et au nivellement par le bas. À terme, elle risque de favoriser le développement d’un enseignement supérieur privé à vocation étroitement professionnelle. Une fois de plus, ce seront les étudiants modestes et issus des classes moyennes qui seront mis sur le côté, ce qui n’est pas admissible. Alors qu’il aurait fallu poursuivre la démarche entamée par la loi LRU en allant vers une autonomie encore plus claire au bénéfice d’enseignements de qualité, la France engage son enseignement supérieur à contre-courant de toutes les grandes organisations universitaires du monde. J’ajouterai quelques mots enfin sur l’enseignement de la langue de Molière ; j’aurais l’occasion d’y revenir lorsque nous examinerons l’article 2. Renoncer à enseigner le français au sein de nos universités, comme vous le prévoyez à l’article 2, madame la ministre,…

… représente un très grave abandon de souveraineté intellectuelle et culturelle. Si cet article devait être adopté, nos étudiants dans les disciplines scientifiques et de la recherche ne travailleraient plus qu’en anglais. Or, si nos étudiants doivent en effet progresser en langues étrangères, car leur niveau est plus faible que chez nos voisins, on ne peut pas accepter que le français soit ainsi déconsidéré, et bientôt oublié. J’en veux pour preuve l’exemple de la Commission européenne, où de plus en plus de textes ne sont malheureusement plus traduits en français.

De manière plus générale, ce texte manque d’ambition pour un secteur qui touche pourtant à l’avenir de notre pays : les moyens consacrés à l’enseignement supérieur sont en baisse, l’initiative des acteurs va être bridée et rien n’est fait pour aider les étudiants. Alors que l’enseignement supérieur a besoin de souplesse et de marges e manoeuvre pour se moderniser, votre projet de loi, madame la ministre,ne fait que recentraliser le système et donner des gages aux corporatismes internes. Vous dénoncez, chers collègues de la majorité, la réforme que nous avions mise en oeuvre. Pourtant, je tiens à vous rappeler que l’autonomie que nous avons proposée a été plébiscitée par les universités : choisie librement par cinquante et une universités sur quatre-vingt quatre au 1er janvier 2010, elle l’a été par soixante-treize universités au 1er janvier 2011. Depuis le 1er janvier 2012, toutes les universités,à l’exception des universités de La Réunion, des Antilles-Guyane et de Polynésie française, bénéficient des responsabilités et compétences élargies. Pour toutes ces raisons, madame la ministre, vous comprendrez que je vote contre ce projet de loi
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la ministre, avec une vingtaine de moutures successives depuis le début de l’année, votre projet de loi va de compromis en compromis, sans satisfaire personne, et finalement sans apporter d’éléments réellement novateurs. Il est malheureusement sans vision et sans aucune véritable ambition pour l’enseignement supérieur et la recherche. Comment en est-on arrivé là ? Votre texte est un agrégat de mesures cosmétiques, idéologiques et, enfin, techniques, essentiellement inspirées par le souci de défaire ce qui avait été fait. Vous n’hésitez pas à remettre en cause les pôles de recherche et d’enseignement supérieur, les PRES, qui réunissent aujourd’hui l’ensemble des universités et la plupart des grandes écoles dans des structures communes, alors que cela avait été un travail gigantesque de les réunir. Vous décidez de fondre les quelque cent établissements français d’enseignement supérieur actuels en une trentaine de sites, les « communautés d’universités », qui n’auront comme compétences que celles que les établissements voudront bien leur déléguer. Puisque ces établissements seront minoritaires au sein de cette nouvelle entité, on ne peut malheureusement s’attendre qu’à des problèmes de gouvernance considérables qui risquent fort de faire de cette communauté une coquille vide. À l’heure où l’enseignement supérieur et la recherche français doivent s’inscrire plus que jamais dans une compétition internationale de plus en plus intense, vous faites le choix de la régionalisation. L’Allemagne a connu la régionalisation et elle en revient actuellement : le gouvernement allemand a repris la main pour faire émerger des pôles d’excellence nationaux capables d’entrer dans la compétition internationale. Mais, après tout, pourquoi tirer les enseignements des échecs des autres lorsque nous pouvons les éprouver nous-mêmes ? C’est la question que l’on se pose à la lecture de votre projet de loi… Votre ambition ne se résume qu’à prendre le contrepied de ce que le gouvernement précédent a construit en détricotant l’autonomie des universités et à avancer à contresens par rapport à ce qui est fait dans les autres pays. Vous choisissez de mettre un frein au développement d’établissements de premier plan et de sacrifier toute ambition de l’excellence sur l’autel d’un égalitarisme, au demeurant tout à fait théorique, totalement incompatible avec la compétitivité dont notre enseignement supérieur a besoin. L’enseignement supérieur et la recherche sont les meilleurs outils de notre développement économique et de l’attractivité de notre territoire ; encore faut-il leur donner les moyens financiers et structurels de conserver et d’amplifier leur niveau d’excellence. Or votre gouvernement manque cruellement d’ambition, au plan tant national qu’international. Pire encore, vous vous attaquez aux réseaux d’excellence. Ce peut être par exemple de grands établissements spécialisés autour de thèmes d’enseignement et de recherche; c’est aussi les établissements de l’enseignement supérieur associatif, dont vous menacez 1’avenir tant vous avez coupé leurs subventions, à hauteur de plusieurs millions d’euros. L’efficacité de ces établissements est pourtant reconnue sur la scène internationale en matière d’innovation pédagogique, d’accompagnement des étudiants, de formation à l’entreprenariat, de recherche partenariale avec les entreprises, d’ouverture sociale et internationale. Une fois encore, c’est un rendez-vous manqué, madame la ministre. Et puisque nous parlons de recherche, je voudrais dire un mot sur la recherche agricole, puisque votre texte s’en exonère totalement, alors que notre agriculture est aujourd’hui confrontée à des défis majeurs de production et de durabilité, et ce dans un contexte de crise économique et de croissance de la population mondiale, une population qu’il faudra nourrir. La France a sa place et son rang à tenir sur ce sujet. Je crois très fortement à la complémentarité entre recherche fondamentale, recherche finalisée et recherche appliquée pour garantir la compétitivité et l’adaptation de notre agriculture aux enjeux actuels. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur le fameux réseau ACTA qui regroupe les instituts techniques agricoles, et le réseau ACTIA qui fédère les activités des instituts techniques agro-industriels. Je regrette profondément que ces têtes de réseau ne soient pas plus impliquées dans le débat public et se retrouvent au final totalement absentes de ce projet de loi. Là encore, c’est un rendez-vous manqué. Globalement, madame la ministre, votre projet de loi est désolant, au sens premier du terme. Avec ce texte, c’est non pas d’un compromis que les assises ont accouché, mais du plus petit dénominateur commun. Ce dernier n’est donc absolument pas en phase avec les défis du XXIe siècle.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Á cette heure tardive, je voudrais rappeler que le projet de loi que nous étudions est le fruit d’une démarche fondée sur le dialogue et la confiance et qu’il s’inscrit dans la continuité de la loi de refondation de l’école. Il traduit la volonté de notre gouvernement de réformer l’enseignement en profondeur, ouvrant ainsi la porte vers toutes les transformations et tous les possibles, de la maternelle à l’université. Logique, cohérence, soulagement : le Président de la République et le Gouvernement, et vous-même, madame la ministre, avez parfaitement compris que l’enseignement occupait une place essentielle dans le redressement de noter pays. Grâce à la refondation de l’école, à l’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche, nous pouvons former l’espoir de préparer la France de demain ; soyez-en remerciée. Hier, nous avons étudié le texte de programmation qui posait la première pierre de la refondation de l’école ; aujourd’hui, madame la ministre, nous examinons un texte qui, à l’autre bout de la chaîne, s’attaque à un nouveau maillon : l’enseignement supérieur et la recherche. Pour la première fois de notre histoire, et beaucoup de nos collègues l’ont souligné, l’ensemble des questions relatives à ces sujets sont traitées par une seule et même loi d’orientation. Je souhaite insister tout particulièrement sur la cohérence historique que vous avez imprimée à ces travaux en examinant concomitamment ces deux textes dont le lien indéfectible passe par la formation des maîtres et des enseignants. Nous le savons aujourd’hui, la coopération entre les acteurs et les établissements est indispensable. La performance collective passe par un renforcement souple de tous les maillons de la chaîne de l’enseignement, des maillons forts et des passerelles bien huilées. Nous devons donc tous travailler en spécialistes, mais sans jamais oublier de nous retourner, et dans le même élan regarder vers l’avant. Je le disais à l’ancien ministre de l’éducation : comment pouvons-nous parler de la réussite à l’université si nous négligeons l’école maternelle et le primaire ? Mais je parle d’un autre temps, où trop souvent l’excellence avait droit de cité et où tous les moyens convergeaient vers cette idéologie complètement inégalitaire. Aujourd’hui, la priorité essentielle est la réussite étudiante – je m’en réjouis –, ce qui passe par l’objectif d’augmenter significativement le nombre de diplômés du supérieur dans chaque classe d’âge. La réussite de nos étudiants dépend de la qualité des enseignements, d’une bonne orientation, mais aussi des conditions de vie des étudiants à l’intérieur des universités. La pérennisation du dixième mois de bourse, la création de 40 000 logements sur cinq ans pour les étudiants et l’accès aux soins de ces derniers sont les premières mesures que nous avons prises dans ce sens. Pour faciliter l’accompagnement des étudiants vers la réussite, ce texte réforme le cycle de la licence et affirme la continuité entre le secondaire et le supérieur et le rapprochement entre toutes les filières post-baccalauréat. Il s’appuie sur le renforcement des passerelles, tout comme le projet de loi de refondation de l’école de la République visaient à renforcer les liens entre la maternelle et le primaire, le primaire et le collège, pour éviter le décrochage et faciliter l’accès à chaque nouvelle étape de la scolarité. Il réaffirme la nécessité d’un décloisonnement entre les disciplines, entre les cursus, entre les établissements, entre les sites. La simplification des procédures et des structures et leur interactivité permettront aux jeunes étudiants de corriger leur choix, de s’orienter en meilleure connaissance de cause et de jouir d’une plus grande latitude dans leur ambition. Je tiens également à louer le fait que ce projet de loi accorde une attention particulière à l’orientation, avec une spécialisation progressive dans le premier cycle de la licence, et à l’accompagnement personnalisé des étudiants par l’innovation pédagogique, avec le développement de l’enseignement numérique et la formation par alternance, véritable composante économique pour une intégration réussie dans les milieux professionnels. Le secteur économique attend beaucoup de cette insertion progressive dans le monde de l’emploi. Enfin, ce texte incite largement à la mobilité des étudiants et des chercheurs ainsi qu’à l’accueil d’étudiants étrangers – je ne m’y appesantirai point. Ce projet de loi marque véritablement un progrès car il réaffirme l’importance de toutes les composantes de l’université, le rapprochement des universités et des grandes écoles. L’interaction entre les différents acteurs garantira un développement plus harmonieux et plus égalitaire entre les territoires. De la réforme de la formation des enseignants envisagée dans la loi sur la refondation de l’école découlera la création des écoles supérieures du professorat et de l’éducation dès la rentrée 2013. Ces ESPE seront le noyau commun entre l’école, l’université et la recherche au travers de la transmission des savoirs et savoir-faire. Elles s’appuieront, si je puis me permettre cette comparaison, sur le modèle d’organisation des IUT, un modèle qui a fait ses preuves. Cette filière, qui est destinée à préparer à l’insertion professionnelle, doit prendre très clairement sa place dans le cycle licence. Vous l’avez compris, madame la ministre : le redressement de la France nécessite de considérer l’écolier et l’étudiant comme des messagers de l’avenir. Le temps de l’éducation, rappelons-le, est nécessairement long. La culture de l’école et de l’université n’est pas celle de l’émotion et de l’instantanéité. Elle est celle de la raison et du temps patient et persévérant. Ce nouveau texte que vous nous proposez, madame la ministre, conjugue objectifs et moyens. Investir dans le savoir, surtout dans les moments où les moyens financiers sont rares, c’est préparer la France de demain. J’invite donc mes collègues de l’opposition à regarder ce texte avec beaucoup plus d’objectivité: il donne un nouvel élan à la recherche, il nous engage vers la réussite d’un plus grand nombre d’étudiants et vers le rayonnement de nos universités dans le monde. Pour toutes ces raisons, et pour toutes celles que je n’ai pas pu évoquer durant les cinq minutes qui m’étaient imparties mais que mes collègues ont exposées, nous soutiendrons ce projet, que nous espérons enrichir tout au long de cette semaine.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi Précresse, est l’une des premières grandes lois du quinquennat précédent. Dès le mois de juillet 2007 la majorité s’était attelée à un sujet prioritaire pour elle, la question des universités, en leur permettant de devenir autonomes. Au plus près des réalités du terrain, les établissements disposaient ainsi de tous les leviers pour conduire les stratégies les plus adaptées à leur contexte, afin d’améliorer leurs performances et peser davantage dans la compétition internationale. Cette réforme majeure allait dans le sens des évolutions menées dans de nombreux pays européens. Elle était accompagnée d’une augmentation substantielle des moyens accordés aux universités, avec un budget consacré à l’enseignement supérieur en progression de 50 % entre 2007 et 2012, passant de 10 à 15 milliards d’euros par an. Cette loi renforçait le rôle des présidents d’université en leur donnant une réelle responsabilité sur leur masse salariale, leur recrutement et leur organisation, et incitait à l’émergence de pôles d’excellence de niveau international. La mutation a d’ailleurs été réelle, comme le reconnaît l’éditorialiste du Monde ce mercredi. Vous auriez pu abroger la LRU, madame la ministre. Vous ne l’avez pas fait, ce qui est déjà une certaine forme de reconnaissance, alors que le parti socialiste n’a eu de cesse de la dénoncer.

En fait, comme vous avez l’habitude de le faire depuis votre arrivée au pouvoir, vous procédez à un détricotage méticuleux. Ni évolution ni révolution dans votre texte ; il s’agit plutôt d’une loi de régression, avec des crédits en baisse. Les moyens restent en effet les grands absents de votre texte, madame la ministre. Pourtant, la jeunesse n’était-elle pas censée être une priorité de votre candidat ?

D’ailleurs, la conférence des présidents d’université – la CPU –, qui vous était favorable au moment de la présentation de votre projet de loi, critique désormais avec force ce qu’elle appelle « une tromperie sur les moyens 2013 affectés aux universités ». Elle parle même d’un projet LRU II non financé, et vous a demandé de retirer votre texte afin de réfléchir à une révolution de l’ensemble du premier cycle.On comprend alors, comme Patrick Hetzel l’a clairement explicité mardi, pourquoi vous avez demandé tout à la fois l’urgence sur ce texte et un temps programmé, avec des conditions d’examen en commission improbables. Du reste, cette fébrilité législative semble révélatrice d’une fragilité politique. Mais venons-en aux mesurettes qui ne sont, en définitive, que des mesures techniques, essentiellement inspirées par le souci de défaire ce qui a été fait. Permettez-moi d’évoquer les quotas de places dans les IUT, une mauvaise solution aux problèmes de débouchés des bacheliers des filières technologiques.

Même si vous avez évoqué la fixation de ces quotas dans la concertation, vous n’avez pas réussi à calmer la colère des directeurs et présidents d’IUT, en grève jeudi dernier. La préservation des IUT n’était-elle pas, pourtant, une promesse de campagne de votre candidat ? Concernant la nouvelle gouvernance des universités, elle semble provenir de l’organisation délibérée d’un face-à-face entre deux instances, un conseil académique pléthorique que vous créez, et le conseil d’administration. Cette université bicéphale semble vouée à paralyser et bloquer le système. Il ne peut y avoir qu’une autorité décisionnelle, le président et son conseil d’administration, sauf à vouloir la mort d’un système, au point que certains ont évoqué un projet mortifère pour l’enseignement supérieur, ou des universités transformées en navire ingouvernable, voire en bateau ivre. Continuons de détailler le détricotage : que deviendront les pôles de recherche et d’enseignement supérieur – PRES –, qui avaient pourtant été créés pour constituer des champions de la formation et de la recherche ? Vous les supprimez, madame la ministre, pour les remplacer par des communautés d’université et d’établissement, dans une logique territorialisée qui risque de se transformer en regroupements forcés, au mépris de l’autonomie des établissements et de leur rayonnement, lequel doit être national et international. Certains grands organismes de recherche, que vous connaissez, m’ont fait part de leurs inquiétudes à ce propos. Enfin, vous détricotez le dispositif d’évaluation : l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement – l’AERES – reconnaissait elle-même qu’elle devait améliorer ses procédures. Mais votre condamnation est sans appel, et répond à une commande politique. Comment oser dire que cela ne marchait pas, que l’évaluation n’était pas faite par les pairs, alors que l’AERES faisait appel à des scientifiques reconnus, français et étrangers, et même à des prix Nobel ? Elle était accréditée au niveau européen. Quelle régression, et quelle image désastreuse en Europe, où nous serons isolés ! Madame la ministre, malgré de longs débats préliminaires, votre projet de loi manque d’ambition, d’audace et de souffle. Il déçoit, alors que, comme l’écrit Valérie Pécresse, nous aurions dû avoir un acte II de la réforme des universités. Il fait ainsi plus de mécontents que d’heureux. Finalement, comme cela a déjà été le cas avec la loi pour la refondation de l’école, votre texte est un exercice raté, avec la même méthode – quantité versus qualité – d’où un nivellement vers le bas. L’enseignement supérieur et la recherche sont pourtant des outils stratégiques de notre développement économique. Leur développement et leur excellence sont les meilleurs vecteurs pour attirer les talents étrangers. Nier la compétitivité internationale qui nous entoure, mettre des freins à la marche vers l’excellence de nos universités et de nos écoles, que la précédente majorité avait voulu initier, c’est saborder l’avenir de notre pays et de nos enfants. A l’UMP, nous pensons que relancer la croissance et l’emploi passe par une université forte et attractive. Votre réforme la fragilise et la déstabilise, alors qu’elle aurait dû au contraire l’aider à franchir une nouvelle étape. (Applaudissements sur les bancs du groupe U MP.)

Prochaine séance, demain, à neuf heures trente : suite du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche. La séance est levée.
La séance est levée, le jeudi 23 mai 2013, à une heure cinq.
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l’Assemblée nationale Nicolas Véron