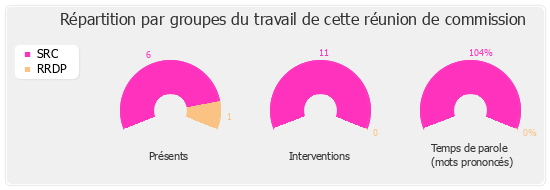Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 15 janvier 2013 à 16h15
La réunion
Présidence de Mme Catherine Coutelle, présidente.
La séance est ouverte à 16 heures 15
La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à l'audition de Mme Sophie Elizéon, ancienne déléguée régionale aux droits des femmes de La Réunion, Déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français des outre-mer.

Cette audition prend place dans un cycle de travail sur l'organisation et les moyens du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, et en particulier de son réseau déconcentré. La révision générale des politiques publiques (RGPP) a en effet eu pour conséquence la réorganisation des délégations régionales et départementales. Nous avons déjà mené de nombreuses auditions et réunions, mais nous tenions à entendre l'expérience d'une déléguée de l'outre-mer. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Mme Sophie Elizéon, qui a été nommée, le 3 octobre 2012, Déléguée interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, après avoir exercé les fonctions de déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes à La Réunion de 2007 à 2012.
Les échanges que nous avons eu avec un certain nombre de déléguées ont fait apparaître un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles : la raréfaction de la ressource humaine ; la mobilité et la progression de carrière peu encouragées ; de faibles crédits mobilisables pour les actions d'initiative locales et l'accentuation du fléchage des crédits ; une difficulté à mobiliser des crédits par effet de levier.
Madame la Déléguée, cette situation se retrouve-t-elle à la Réunion ?
Les travaux de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, que j'ai suivis de très près lorsque j'étais déléguée régionale aux droits des femmes de La Réunion, ont permis aux délégués en région de promouvoir des avancées sur le terrain. C'est donc un honneur pour moi d'être reçue parmi vous aujourd'hui.
La Réunion étant une région monodépartementale, elle comporte une délégation régionale aux droits des femmes mais pas de chargé de mission départemental. L'équipe de la délégation régionale est composée, en tout et pour tout, de deux personnes : une secrétaire, qui fait office de collaboratrice, et une déléguée régionale. La délégation a pour mission de décliner localement la politique nationale d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette politique s'articule autour de deux axes : égalité dans la vie politique, sociale, professionnelle et économique, pour le premier, promotion des droits et lutte contre les violences faites aux femmes, pour le second.
À la Réunion, 15 % de femmes sont victimes de violences conjugales, soit une femme sur 6 selon les évaluations réalisées en 2002. En 2011, six femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Entre 2009 et 2011, le nombre de dépôts de plainte a augmenté de 35 %. Certes, les femmes osent davantage qu'auparavant porter plainte, néanmoins les violences conjugales faites aux femmes à La Réunion sont un fléau.
Il est très difficile de parler d'égalité professionnelle à La Réunion, car le contexte économique, marqué par un fort chômage, engendre le discours selon lequel il faut d'abord se préoccuper des demandeurs d'emploi, avant de s'occuper spécifiquement des femmes.
Néanmoins, en tant que déléguée régionale de 2007 à 2012, j'ai toujours pu bénéficier du total soutien des préfets. Ainsi, les services de l'État à La Réunion, comme la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE), la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) et la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), se sont révélés être des partenaires proches et fidèles de la délégation régionale aux droits femmes.
Le changement de rattachement de la délégation de La Réunion, lié à la réforme générale des politiques publiques, a été réalisé avec un an de décalage par rapport à l'Hexagone, les outre-mer ayant bénéficié d'un temps d'adaptation du fait de leur spécificité. À La Réunion, nous avons tenu le plus longtemps possible pour que la délégation reste rattachée au cabinet du préfet, ce positionnement étant à nos yeux idéal dans un territoire petit, fermé et où l'État est très observé et attendu par nos concitoyens sur le thème de l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis la délégation a fini par être rattachée à la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion.
Oui, mais avec des prérogatives très éloignées de celles de la délégation régionale, notamment en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.
Le rattachement de la délégation à la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale a permis, d'une part, de commencer à diffuser au sein de la DJSCS elle-même l'approche intégrée des deux axes de la politique d'égalité, et, d'autre part, de mobiliser des « queues de crédits ». Par contre, il a rendu totalement invisible l'action de la délégation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes sur le territoire, et gêné l'activation des partenariats. C'est pourquoi, comme le disent également mes collègues des outre-mer, le rattachement au cabinet du préfet est beaucoup plus efficace.
J'ai parlé tout à l'heure des moyens humains de la délégation régionale. S'agissant des moyens financiers, ils se sont amenuisés jusqu'en 2012. Jusqu'à cette date, nous pouvions mobiliser, en milieu d'année, des queues de crédits non utilisés par d'autres collègues, possibilité qui était cependant difficile en raison de notre éloignement.
Le réseau des déléguées régionales est animé par le Service des droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Si les déplacements nécessaires à l'organisation de rencontres tout au long de l'année sont relativement simples pour les personnes installées dans l'Hexagone, ils sont peu aisés pour celles qui le sont en outre-mer, sachant que les crédits de fonctionnement se sont raréfiés. De ce fait, certaines déléguées régionales des outre-mer n'ont pu effectuer des déplacements, ce qui a été mon cas, alors même qu'ils leur permettent de se sentir appartenir à un réseau, de recueillir de bonnes idées ou de bonnes pratiques, et de négocier un financement complémentaire pour une action nécessaire sur le territoire.
Une deuxième difficulté tient aux relations entre l'échelon régional et l'échelon national. Les outre-mer peuvent amender certaines dispositions en fonction de leur situation, ce qui a été le cas pour la RGPP, mais l'échelon national n'appréhende alors que le mode de fonctionnement national. C'est pourquoi, lorsque le service central adresse un courrier aux SGAR pour interpeller les déléguées régionales, il oublie parfois d'écrire au DJSCS – ou au préfet pour celles des délégations qui y sont encore rattachées. Ainsi, les informations ne circulent pas toujours très bien, et les directives données peuvent être contraires aux dispositions prises sur le territoire.
Il est une troisième difficulté : jusqu'en 2012, les régions ultramarines étaient pratiquement toujours oubliées lorsque des actions expérimentales étaient décidées au niveau national. Cependant, la mise en place des référents d'outre-mer nommés dans chacun des cabinets ministériels devrait améliorer la situation.
Peu de temps avant mon départ, elle a été retenue comme région expérimentale pour la mise en place des territoires d'excellence en matière d'égalité professionnelle.
Les crédits d'intervention se sont également raréfiés, notamment en raison du fléchage d'un certain nombre d'entre eux. Ainsi, même si ce sont les délégations régionales qui versent les crédits aux structures associatives, la décision de financer telle ou telle structure associative est prise au niveau national. C'est le cas des lieux neutres – où se rencontrent, sur décision du juge, les enfants et les parents qui n'en ont pas la garde –, qui sont cofinancés par des crédits du BOP 137.
Ainsi, les crédits fléchés ont réduit notre marge de manoeuvre. D'où la difficulté à tenir un discours selon lequel l'État agit en matière d'égalité, alors même que les crédits se sont raréfiés entre 2007 et 2012.
Néanmoins, la nomination de La Réunion comme région expérimentale en 2013 lui garantira des crédits plus importants. Entre 2012 et 2013, les crédits pourraient en effet être fortement augmentés, alors qu'ils avaient diminué de près de 42 % entre 2007 et 2012. Cette bouffée d'oxygène permettra de mettre en place des actions pérennes sur le thème de l'égalité professionnelle. En outre, le fléchage – et j'y vois, cette fois-ci, un avantage – amènera un nouveau partenaire sur ce sujet, le conseil régional.

À La Réunion, on a eu mal à engager des actions contre les violences faites aux femmes, alors qu'en Seine-Saint-Denis, pour ne prendre qu'un exemple, un observatoire a été mis en place et les associations sont très dynamiques. J'ai l'impression que les actions menées dans l'île par certaines personnes sont inefficaces – elles consistent simplement en un coup de communication les 8 mars et 25 novembre – et qu'il y a un devoir de réserve sur ce problème, qui relève de la préfecture. Comment promouvoir une action commune permettant de progresser sur ce sujet ?
En outre, le chômage est si massif à La Réunion qu'on a eu du mal à rendre audible le problème de l'égalité hommes femmes. À combien s'élèvent les crédits dont disposera La Réunion en 2013 ? Parviendrons-nous à avancer sur cette problématique en travaillant avec la région, sachant qu'une convention va être signée avec cette dernière pour mettre en oeuvre l'expérimentation?
Le plan gouvernemental de lutte contre les violences faites aux femmes fixe un certain nombre d'orientations et d'objectifs et, à La Réunion, un conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est en place. La lutte contre les violences faites aux femmes ayant tenu à coeur de tous les préfets que j'ai connus, une formation spécialisée sur cette problématique a été instaurée au sein de ce conseil départemental. Réunie une fois par an, cette formation spécialisée a choisi de se doter d'un groupe de travail qui s'est réuni, lui, environ une fois par trimestre pour mettre en place des actions. Ce travail a été engagé par la collègue qui m'a précédée.
Ce fonctionnement a réellement permis de renforcer le travail de partenariat entre les services de gendarmerie et police et le tissu associatif. À ma prise de fonction en 2007, il ne se passait pas un mois sans que j'aie un retour du tissu associatif sur les difficultés liées aux dépôts de plainte, surtout avec les services de police. La délégation a recensé ces difficultés et les a transmises aux directions de la police et de la gendarmerie. Nous avons par ailleurs poursuivi des formations interdisciplinaires rassemblant policiers et gendarmes, bénévoles et professionnels des associations, et travailleurs sociaux.
Je pense donc qu'il y a eu de réelles améliorations grâce à ce travail partenarial. Nous avons en effet constaté une augmentation du nombre de dépôts de plainte, mais aussi un phénomène qui n'existait pas en 2007, à savoir des appels à l'aide provenant d'auteurs de violences conjugales et adressés aux travailleurs sociaux, aux professionnels de santé et aux policiers ou gendarmes. De véritables efforts ont été faits aussi bien par les fonctionnaires de police et de gendarmerie que par le tissu associatif pour travailler ensemble afin de lutter contre les violences faites aux femmes.
Néanmoins, les moyens alloués à la délégation n'étaient pas suffisants. Les formations interdisciplinaires, mises en place tous les ans, étaient des formations de premier niveau, destinées à de nouveaux arrivants ou à des personnes non formées les années précédentes. Il aurait été intéressant d'ouvrir davantage de places en diplôme d'université de victimologie pour en faire bénéficier policiers, gendarmes, travailleurs sociaux et bénévoles, ou encore de mettre en place des formations progressives permettant une meilleure connaissance du phénomène et donc une amélioration des pratiques.

La loi sur les violences faites aux femmes votée en 2010 est-elle appliquée en outre-mer, en particulier s'agissant de la délivrance d'une ordonnance de protection et de l'obligation pour les policiers et gendarmes d'enregistrer les plaintes et de les transmettre au procureur ?
Que pensez-vous de la tendance actuelle qui veut que, d'un côté, le ministère a tendance à flécher les crédits et que, de l'autre, les appels à projet se développent, ce dont se plaignent les associations qui y voient une menace pour la visibilité de leurs crédits ?
Les problèmes à La Réunion se posent-ils dans les mêmes termes en Guyane, à la Martinique ou encore à Mayotte ?
Enfin, partagez vous la demande en faveur d'une nouvelle circulaire du Premier ministre pour redéfinir les missions des déléguées ?
La loi relative aux violences faites aux femmes, qui s'applique également aux outre-mer, a connu des difficultés d'application au démarrage. Dans le cadre du travail que j'ai mené pour la création d'un outil d'information à destination des femmes victimes de violences, les discussions sur la façon de communiquer sur l'ordonnance de protection ont révélé des différences d'interprétation entre les magistrats, mais aussi entre les fonctionnaires de police et de gendarmerie.
Néanmoins, des juges aux affaires familiales se sont montrés très volontaires pour mettre en oeuvre l'ordonnance de protection. À l'occasion d'un forum qui s'est tenu fin 2011, une juge aux affaires familiales a réalisé une forte communication sur l'ordonnance. Malheureusement, les saisines du juge par les personnes en danger n'ont pas augmenté significativement. L'enjeu est de mettre en place une session de formation sur ce sujet à destination des policiers, gendarmes, magistrats et associations, ce qui renvoie au problème de la mobilisation de crédits.

Une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes est prévue par la loi de 2010. Elle doit être mise en oeuvre.
Grâce au fait que La Réunion a été retenue comme région expérimentale pour les territoires d'excellence, les crédits de la délégation régionale seront nettement augmentés : en 2012, la délégation avait fonctionné avec environ 142 000 euros.

Et les crédits sont fléchés dans leur grande majorité. Procédez-vous beaucoup par appel à projets dans vos relations avec les associations ?
Tous les crédits ne sont pas fléchés, mais une partie importante devrait l'être vers les actions pour l'égalité professionnelle. Le fléchage est intéressant car il permet à l'État de fixer un cadre, d'afficher des orientations claires pour les territoires. Néanmoins, il faudrait garder une marge de manoeuvre pour des expérimentations adaptées à chaque territoire. Lorsque les appels à projet peuvent être pilotés et gérés en région, je pense que ce n'est pas un mal. En revanche, lorsqu'ils sont gérés par l'échelon national, nous perdons totalement la main et les situations particulières des régions ne sont pas forcément prises en compte.

Ces appels à projet pourraient-ils être prévus sur trois ans, pour faciliter l'action des associations ?
En effet, un engagement sur trois ans serait idéal car cela permettrait d'inscrire l'action dans la durée, et avec un véritable copilotage puisque l'État est ordonnateur.
Le niveau des crédits n'a pas permis de mettre en place à La Réunion un observatoire. Néanmoins, grâce à des crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), nous avons obtenu la création d'un tableau de bord de suivi des violences faites aux femmes au sein du couple. Cet instrument nous a permis, en particulier, de relever l'augmentation des dépôts de plainte et l'évolution des offres d'hébergement. Un tel outil est indispensable au travail d'une délégation car il permet à la fois de connaître le territoire, d'orienter les actions menées dans le cadre du plan de lutte contre les violences et de les évaluer.
Pour avoir discuté avec mes collègues au moins jusqu'en 2012, je peux vous dire que la problématique des violences se pose également à la Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane, avec, en toile de fond, la question de l'éducation des jeunes garçons et celle de l'image des femmes véhiculée dans les médias.
Une autre problématique est celle de parentalité précoce. À La Réunion, le nombre de naissances chez des jeunes filles encore mineures a augmenté de l'ordre de 150 % entre 1999 et 2009. Le comité de pilotage mis en place à cet effet par le préfet pendant cette période a probablement permis de stabiliser ce nombre, qui reste malheureusement très important, tout comme celui des interruptions volontaires de grossesse (IVG) pratiquées chez les mineures, même très jeunes. Chaque année, à La Réunion, entre cinq et dix jeunes filles de moins de quinze ans deviennent mères. Une difficulté est qu'un certain nombre d'acteurs, qui refusent de se montrer moralisateurs, préconisent « d'accompagner ces jeunes filles à être de bonnes mamans si c'est leur choix ». Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'une société qui laisse des enfants éduquer des enfants est une société perdue. Ce sujet n'a rien à voir avec la morale, il s'agit de permettre à des femmes d'avoir des enfants à un moment où elles ont les moyens de les éduquer correctement, ce qui passe par une insertion professionnelle réussie. À La Réunion, un rapport rédigé par des anthropologues a conclu à la possibilité de s'interroger sur l'élasticité de la notion de majorité, considérant qu'on a intérêt à accompagner les mères mineures dans leur choix, plutôt que de faire de la prévention sur la parentalité précoce. Je trouve cela dangereux car, encore une fois, je ne vois pas comment on peut choisir d'être mère à quinze ans. Pourquoi ne pas voter, conduire une voiture, travailler et payer des impôts à quinze ans ? Nous sommes là face à un véritable sujet de société.
Le sujet des missions des délégués a été abordé à une époque antérieure à la RGPP – le réseau des délégués avait interpellé la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée à ce sujet. Il est clair qu'un positionnement tel que celui des DRRT (délégations régionales à la recherche et à la technologie) favoriserait l'efficacité des délégations régionales. Ce positionnement, soutenu en son temps par le réseau des délégués aux droits des femmes et l'association nationale des déléguées régionales, peine à faire son chemin. Il aurait l'avantage de permettre à des hommes de s'impliquer sur ces métiers.

Absolument, car les déléguées régionales sont toutes des femmes, et on ne compte qu'un seul homme parmi les délégués départementaux.
Merci beaucoup, madame, de nous avoir fait part de votre expérience. Les violences faites aux femmes sont un sujet récurrent, et celui des grossesses précoces est un vrai sujet de société.
Ensuite, la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a entendu la deuxième communication de Mme Cécile Untermaier sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Nous allons maintenant entendre la deuxième communication de Mme Cécile Untermaier sur l'égalité professionnelle et salariale. Je vous rappelle qu'à la suite de sa première communication sur le sujet, qui nous a été présentée le 14 novembre 2012, il a été convenu qu'elle informerait la Délégation à nouveau lors de la parution du décret relatif à la mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au sujet duquel nous avions adopté des recommandations, qui ont été adressées au Gouvernement. Ce décret a été publié le 19 décembre 2012.

Après la présentation de ma première communication, qui faisait le point sur le décret d'application de l'article 99 de la loi du 9 novembre 2010, j'ai poursuivi l'audition des représentants syndicaux et du patronat, pour recueillir leur avis sur le nouveau projet de décret du gouvernement. Mon intervention rappellera l'essentiel des remarques faites par les personnes entendues (syndicats et patronat) et indiquera la teneur du décret de décembre.
Les remarques et attentes des différents représentants s'articulent autour de trois points principaux: le délai de mise en conformité, l'institution d'une sanction financière et la procédure de contrôle.
Le premier point concerne donc le délai de mise en conformité des entreprises qui n'ont pas rempli leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale.
Ce délai est fixé à six mois dans le projet de décret. Les représentants de la CGPME l'ont jugé satisfaisant, le considérant comme un délai pédagogique, permettant aux entreprises de « se retourner ». Les représentants du Medef sont plus circonspects : ce délai leur paraît trop court et le Medef aurait souhaité que le gouvernement attende la fin des négociations en cours sur la qualité de vie au travail, qui couvrent la question de la réduction des inégalités professionnelles.
À l'inverse, parmi les représentants syndicaux entendus, une certaine unanimité est apparue pour trouver ce délai trop long. Les représentants de la CFTC et de FO, notamment, craignent que ce délai ne favorise l'attentisme des entreprises : un délai de deux mois leur semblerait suffisant. A vrai dire, nous aussi nous trouvons que deux mois seraient suffisants, rappelons nous que le RSC a été instauré en 1983, par « la loi Roudy » !
Le deuxième point concerne la sanction financière instituée à l'article 99 de la loi de 2010, et marque sans surprise une ligne de séparation entre les syndicats et le patronat.
Les représentants patronaux se sont montrés très réservés quant à l'institution d'une sanction frappant les entreprises qui n'ont pas rempli leurs obligations. Les représentants de la CGPME comme ceux du Medef ont exprimé leur préférence pour une démarche de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises, avec la mise au point et la généralisation de bonnes pratiques : le Medef, par exemple, a édité à l'intention de ses adhérents un guide pratique sur l'égalité professionnelle, pour les sensibiliser à cette problématique. Tous ont admis qu'il convenait de privilégier une logique d'incitation, à visée pédagogique. A cet égard, la création d'un site Internet dédié, annoncée par le gouvernement, leur a paru une bonne initiative, le lancement d'une campagne d'information prévue en janvier également.
Les représentants du Medef ont fait observer que les PME risquaient de manquer de moyens pour se doter d'un accord collectif ou d'un plan d'action dans le temps imparti, et ce sans aucune mauvaise volonté. La CGPME a craint que la mise en place d'une sanction financière pour les entreprises de plus de cinquante salariés n'accentue encore les effets de seuil.
Concernant le montant de la sanction, fixé au maximum à 1% de la masse salariale, il est apparu tout à fait excessif aux yeux des représentants patronaux, pouvant même mettre en péril l'existence de l'entreprise. De ce point de vue, le caractère modulable de la sanction est donc plutôt rassurant.
Au contraire, les représentants syndicaux ont considéré que l'application d'une sanction était nécessaire pour garantir le caractère dissuasif du dispositif: dès lors que les obligations légales ne sont pas respectées, la sanction doit pouvoir s'appliquer. Les représentants de la CFTC comme ceux de FO convergent dans leur analyse pour affirmer que la sanction doit être la norme, quitte à prévoir des éléments dérogatoires. Il s'agirait pour eux, en quelque sorte, « d'inverser la charge de la preuve », en conservant un cadre général pénalisant, avec une sanction rapide et automatique.
La CGT observe, dans sa déclaration au Conseil supérieur de l'égalité du 12 novembre 2012 en le regrettant, que les motifs de défaillance admis pour échapper à la pénalité financière ne sont pas supprimés dans le projet de décret.
Le troisième point sur lequel se concentrent les remarques est la procédure de contrôle.
Les représentants syndicaux se sont interrogés sur le suivi du dépôt des accords collectifs et plans d'action et sur le contrôle effectué : à quel moment, dans quel délai et à quel rythme s'effectueront les contrôles ? Certains ont fait remarquer que le contrôle effectué par les inspecteurs du travail était surtout formel alors que souvent, les accords, dans leur contenu, ne font que répéter ce qui est déjà dans la loi.
Ils ont observé que les procédures de contrôle n'étaient pas clairement définies dans le projet de décret : il a semblé nécessaire que la Direction générale du travail adresse des consignes précises en la matière. La CGT, dans sa déclaration, pointe le manque de moyens et se demande combien de contrôles sur site seront possibles, compte tenu des moyens alloués aux Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Enfin, les syndicats ont insisté sur la nécessité d'un contrôle à la fois quantitatif et qualitatif visant à évaluer les progrès réels sur le plan de l'égalité professionnelle.
En complément des auditions des syndicats et du patronat, j'ai entendu le point de vue d'un praticien confronté aux problèmes concrets de l'égalité professionnelle en entreprise et j'ai choisi d'entendre Mme Hélène Sabatier, juriste d'entreprise et animatrice d'un réseau de femmes dans le secteur de la banque et de l'assurance. Mme Sabatier a considéré que la sanction était nécessaire, la simple incitation n'étant pas suffisante pour faire évoluer la situation. Mais selon elle, la principale faiblesse du dispositif réside dans le fait que la sanction n'a pas d'objet qualitatif : il faudrait imaginer un mécanisme d'évaluation qui tienne compte des améliorations apportées d'une année sur l'autre par les plans d'action.
Le contrôle des plans d'action ou accords collectifs devrait avoir toujours en vue l'amélioration, avec une sorte d'obligation de résultat. Car la vraie question est : comment contrôle-t-on l'efficacité du dispositif ; Les accords aboutissent-ils à une plus grande égalité professionnelle entre hommes et femmes ?
On pourrait aussi imaginer des experts dédiés à l'égalité professionnelle dans les entreprises. Ainsi, l'égalité professionnelle pourrait être traitée en même temps que les conditions de travail, par un seul expert, au sein du CHSCT qui aurait aussi compétence sur l'égalité professionnelle. Les réseaux de femmes en entreprise pourraient être utilisés comme espace d'échange dans l'entreprise, en faisant le lien entre les différents acteurs.
J'en viens maintenant au contenu du nouveau décret du 18 décembre dernier.
Le décret augmente le nombre des domaines d'action sur lesquels devront porter les accords et les plans d'action. Ce nombre est porté de deux à trois pour les entreprises de moins de 300 salariés et de trois à quatre pour les entreprises de plus de 300 salariés.
Par ailleurs, la rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action.
Cette disposition satisfait ainsi la recommandation n°1 de la DDF.
Le nouveau décret met en place des indicateurs sur la place des femmes, déclinés par catégories professionnelles, et qui doivent figurer dans la synthèse du plan d'action.
Il impose aux entreprises de déposer leurs plans d'action auprès des Directions régionales du travail (DIRECCTE) dans les conditions de droit commun prévues par le code du travail pour les conventions et accords, permettant en conséquence de mettre en oeuvre un contrôle sur pièce.
S'agissant du délai laissé aux entreprises pour la mise en conformité, et contrairement au souhait de la Délégation de le voir ramené à deux mois -c'était la recommandation n°3-, le décret le maintient à six mois. On peut regretter que l'application de la sanction ne soit pas automatique mais reste soumise à l'appréciation de l'inspecteur du travail. Le montant maximum de la pénalité financière, toujours modulable, reste fixé à 1% de la masse salariale.
Les nouvelles dispositions n'entreront en application dans les entreprises, que lors du renouvellement de ces accords collectifs ou plans d'action et, au plus tard, en ce qui concerne les accords à durée indéterminée, à l'échéance triennale suivant la publication du décret.
J'observe que ce choix s'explique par les contraintes de la négociation collective, mais il conduit, de fait, à accorder un délai supplémentaire aux entreprises pour se mettre en conformité avec les exigences légales. Selon mes informations, les entreprises de plus de mille salariés devraient faire l'objet d'un contrôle systématique en 2013, les autres faisant l'objet de contrôles plus ponctuels.
Le décret devrait s'accompagner de deux circulaires, actuellement en cours d'élaboration.
Pour conclure, je dirais que la parution du décret est une chose, son application en est une autre. Il faudrait prévoir d'en mesurer les effets et les avancées s'agissant de l'égalité professionnelle et salariale, dans un an.
Ce décret s'inscrit dans une démarche globale de lutte contre la précarité professionnelle et les inégalités. Les RSC sont des indicateurs et acteurs de cette politique que nous poursuivons. Ils doivent faire l'objet d'une véritable analyse.

Il sera utile de faire une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif ainsi mis en place un an après son entrée en vigueur. Il faudra suivre la progression du nombre des accords et plans déposés dans les directions régionales du travail et de l'emploi. Il serait bon que les inspecteurs du travail puissent à cette occasion contrôler aussi l'existence et le contenu des RSC. Jusqu'à aujourd'hui, les inspecteurs du travail, lorsqu'ils se rendaient dans les entreprises, ne demandaient pas le RSC ; il faut souhaiter que dorénavant, toute visite en entreprise porte aussi sur l'existence et la teneur du RSC.
Il est difficile d'évaluer les progrès de l'égalité salariale ; cette évaluation ne sera probablement possible que dans plusieurs années. On entend actuellement s'exprimer une crainte que la progression de l'égalité salariale ne conduise à retirer aux hommes ce qui devra être donné aux femmes. Enfin, les organisations professionnelles devront mettre ce sujet de l'égalité au coeur de leur action et de leurs négociations.

Qu'en est-il des associations qui emploient du personnel, comme des associations gérant des établissements accueillant des personnes âgées, par exemple, et des administrations, en ce qui concerne les obligations d'égalité professionnelle et salariale ?

La loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels dans la fonction publique, dite loi Sauvadet, a prévu que les administrations aient à rendre des rapports de situation comparée et se voient infliger des pénalités en cas de non-application de la loi. Il est vrai que la question se pose pour les associations recourant à des métiers de service : nous devons être vigilants sur cette question, que nous pourrions poser au ministre du Travail et au ministre des Affaires sociales.

La disposition relative au procès-verbal de désaccord, qui a été introduite par la loi du 26 octobre 2012 sur les emplois d'avenir, peut jouer un rôle très important aussi. J'estime que les entreprises, surtout les petites et moyennes, devraient aussi être davantage guidées, pour l'élaboration de leur RSC, par des modèles qui seraient mis à leur disposition par l'administration ou par les syndicats représentatifs du patronat.

Je partage cette préoccupation de faciliter l'élaboration des RSC par les entreprises.
Je vous propose donc d'adopter le rapport de Mme Untermaier, qui comportera les deux communications qu'elle nous a successivement présentées ainsi que les recommandations adoptées par la Délégation le 14 novembre 2012.
La Délégation adopte le rapport d'information de Mme Cécile Untermaier.
Enfin, la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à l'audition de Mme Danièle Boyer, chargée de recherche à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), responsable de l'Observatoire national de la petite enfance, sur le thème de l'accueil de la petite enfance et du soutien à la parentalité.

La ministre déléguée chargée de la famille, Dominique Bertinotti, que nous avons auditionnée le 27 novembre dernier, a invité notre Délégation à apporter sa contribution à la consultation « Au tour des parents » qu'elle a engagée. Elle souhaite que nous lui proposions des expériences innovantes sur les sujets suivants : la garde des enfants, l'aide aux familles, la place des parents, l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Nous ne pourrons faire le tour de ces questions avant la fin du mois de janvier, date à laquelle nous devons lui adresser les résultats de notre réflexion, cependant nous avons souhaité entendre quelques personnes ayant autorité sur ces questions.
Nous avons ainsi interrogé Mme Hélène Périvier, chercheuse dans le domaine des politiques sociales et familiales et auteure d'une note intitulée « Un service public de la petite enfance » qu'elle a rédigée pour l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Elle y analyse le programme de François Hollande et présente des propositions intéressantes.
C'est dans le cadre de la réflexion sur les modes de garde de la petite enfance que nous avons invité Mme Danièle Boyer, afin qu'elle nous indique quelles sont les propositions de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en matière de garde des jeunes enfants. Dans ce domaine, la France, dont la politique est essentiellement axée sur la garde collective, souffre d'un retard évalué entre 300 000 et 500 000 places. Malgré les plans successifs de création de places de crèche, il semble que nous ayons régressé au cours des quinze dernières années d'environ 60 000 places par rapport aux besoins.
L'accueil de la petite enfance est capital au regard du développement de l'enfant et de l'égalité entre femmes et hommes – en ce qu'elle influe sur l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Selon l'INSEE, en quinze ans, le temps que les hommes consacrent aux tâches ménagères a augmenté de huit minutes seulement ! Nous connaissons tous des nouveaux pères, mais ils ne sont pas assez nombreux pour faire basculer les statistiques…
Nous souhaitons, Madame, vous poser un certain nombre de questions.
Tout d'abord, quel diagnostic portez-vous sur l'accueil de la petite enfance en France ? Au regard du développement de l'enfant et de l'égalité femmes-hommes, quelles en sont les forces et les faiblesses ? Quel est le budget consacré à la petite enfance et comment est-il réparti ?
Quelles sont les analyses de la CNAF et ses propositions face aux évolutions constatées dans les modes d'accueil au cours des dernières années, en particulier l'augmentation de la part de l'accueil individuel ? Faut-il, selon vous, encourager le recours aux assistants maternels ? Comment améliorer ce type d'accueil ?
Peut-on, et sous quelle forme, envisager un « service public de la petite enfance » ?
Je vous remercie de m'avoir invitée à participer à votre réflexion sur l'accueil de la petite enfance.
Avant de répondre à vos questions, je me dois de vous préciser quelle est ma position au sein la CNAF. Je travaille en qualité de sociologue au bureau de la Recherche et des statistiques. En tant que chercheuse, je suis amenée à effectuer des travaux de recherche dans le secteur de la petite enfance. Parallèlement, je dirige l'Observatoire national de la petite enfance, dont la mission est de coordonner l'ensemble des données dont nous disposons sur la petite enfance. Mais ne faisant pas partie d'un pôle politique au sein de la Caisse, je ne développerai pas la position de la CNAF. Je peux toutefois vous livrer le diagnostic de la Caisse quant à la politique menée en matière de petite enfance.
En ce qui concerne l'accueil de la petite enfance, le diagnostic est parfaitement connu : le taux de couverture de l'accueil dans notre pays est plutôt satisfaisant puisqu'un enfant sur deux est potentiellement accueilli – il faut distinguer l'offre d'accueil et le recours effectif à tel ou tel mode de garde – mais ce secteur est marqué par de fortes inégalités et souffre depuis plusieurs années d'une confusion due à la multiplication des acteurs et des dispositifs.
Au regard du développement de l'enfant, l'accueil de la petite enfance est le meilleur moyen d'assurer le suivi médical, social et cognitif des enfants, ainsi que l'accompagnement à la parentalité. Toutefois, si près de la moitié des enfants de moins de trois ans en bénéficie, l'autre moitié n'en bénéficie pas. Or concernant ces derniers, il s'agit essentiellement d'enfants issus de familles défavorisées. Ainsi 91 % des enfants dont les familles se situent dans le premier quintile de niveau de vie (bas revenus) sont gardés par leurs parents, le plus souvent leur mère, alors que ce taux n'est que de 31 % pour les enfants situés dans le cinquième quintile (hauts revenus). Cet écart constitue une première inégalité.
Une autre inégalité vient de la difficulté d'accès aux modes d'accueil, car tous les modes d'accueil – en établissement, en faisant appel à une assistante maternelle ou en étant gardé à domicile – n'assurent pas le même type de prise en charge. Or les familles les plus précaires, pour des raisons financières, n'ont accès qu'à un seul mode d'accueil : les établissements d'accueil collectif.
Parmi les enfants de moins de trois ans qui ont accès à un établissement d'accueil, on trouve 4 % des enfants du premier quintile et 16 % des enfants du cinquième quintile, sachant que 10 % des enfants ont accès à la crèche, 18 % sont gardés par une assistante maternelle et 2 % sont gardés à leur domicile. L'accueil à l'école maternelle est comptabilisé dans les autres modes de garde, qui concernent 3 % des enfants.

La chercheuse Hélène Périvier souligne que l'accueil des enfants de deux à trois ans qui a été mis en place dans les zones prioritaires est passé de 30 à 17 %. Voilà une autre inégalité. Actuellement un certain nombre d'enfants de trois ans et demi sont encore gardés par une assistante maternelle, tandis que d'autres sont déjà scolarisés à deux ans.

Ce n'est pas le cas des enfants nés au début de l'année, qui ne sont pas accueillis avant la rentrée suivante à l'école maternelle.

Cela dépend des collectivités et de la priorité que les maires accordent à la petite enfance.
Le taux de scolarisation des enfants de deux à trois ans est passé de 35 % en 2000 à 12 % en 2011, et cette baisse, faute de places et d'effectifs, commence à atteindre les enfants de trois ans.

Le coût du mode de garde pour les familles constitue une autre inégalité.
Notre force, en France, vient de notre école maternelle, dont les qualités sont reconnues, mais celle-ci manque de places. Il faudrait mettre en place des classes passerelles, que la CNAF pourrait peut-être financer, du moins en partie.

Rien n'empêche les communes de signer des contrats petite enfance avec la CNAF. J'ai moi-même signé dans la commune de Floirac dont je suis le maire, un « Contrat crèches » avait été mis en place dès 1983 ! Il suffit pour cela d'une volonté politique. Les investissements de l'État permettent d'assurer l'égalité entre les territoires, mais toute collectivité se doit d'offrir à ses administrés les moyens de s'épanouir dans leur travail et pour cela, elle doit leur proposer des modes de garde. Voilà ce qu'est une véritable politique citoyenne !

Nous constatons aujourd'hui d'importantes inégalités territoriales puisque selon les départements, le taux de l'accueil va de un pour neuf enfants à un pour 69 enfants. Je suis favorable à la décentralisation, mais une politique nationale permet de corriger les inégalités. À ce titre, je déplore le recul de l'accueil des enfants de moins de trois ans à l'école maternelle, qui dans mon département est passé de 30 à 12 %.

Quoi qu'il en soit, il appartient aux collectivités d'utiliser les impôts locaux pour améliorer l'accueil de la petite enfance.
Je reviens sur les inégalités d'accès aux différents modes d'accueil. Si 37 % des enfants du cinquième quintile ont accès à une assistante maternelle, ils ne sont plus que 2 % parmi les enfants du premier quintile.
Au regard de l'égalité entre hommes et femmes, l'accueil de la petite enfance contribue au maintien des mères sur le marché du travail à temps plein – même si 20 % des femmes quittent leur travail faute d'un accès à tel ou tel mode d'accueil. 97 % des bénéficiaires des congés parentaux sont des femmes, ce qui constitue une spécificité française et contribue à perpétuer les inégalités entre les hommes et les femmes. En outre, la très faible présence masculine parmi les professionnels de la petite enfance tend à reconduire les stéréotypes. La possibilité pour les femmes qui ont des enfants de travailler à temps complet fait actuellement débat. C'est un point sur lequel nous devons être très vigilants.
Le budget consacré à la petite enfance par l'ensemble des acteurs de la politique d'accueil de la petite enfance – communes, État, CNAF – s'élève à 28, 3 milliards d'euros, ce qui correspond à 1,5 % du PIB. Je vous invite, si vous souhaitez connaître en détail l'utilisation de ce budget, à consulter le livre publié par l'Observatoire de la petite enfance intitulé « Petite enfance : enjeux éducatifs de 0 à 6 ans ».
En termes de dépenses par enfant, la France se situe en tête des pays européens, mais après les pays scandinaves et l'Angleterre – depuis une dizaine d'années, ce dernier pays consacre une part importante de son budget à l'accueil des jeunes enfants, essentiellement ciblée sur les familles les plus démunies.

La France est en effet très bien notée pour la part du PIB qu'elle consacre à la petite enfance, mais notre politique familiale n'est pas suffisamment redistributive – ce sont les familles les plus aisées qui bénéficient le plus des services collectifs – et notre pays souffre d'importantes inégalités territoriales.
Deux sujets doivent en effet faire l'objet d'une réflexion approfondie : l'absence de redistribution et les congés parentaux.

Le budget que nous consacrons à la petite enfance réunit des dépenses diverses puisqu'il englobe la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), le complément de libre choix d'activité (CLCA), l'allocation logement, les aides aux crèches, mais également la scolarisation pour les moins de trois ans, l'accueil collectif, l'accueil familial, l'accueil parental, les micro-crèches, les relais assistantes maternelles (RAM), les lieux d'accueil et d'activité, les assistances maternelles, ou les contrats de passage à la prestation de service unique (PSU).
La branche famille consacre 12 milliards d'euros à l'accueil des enfants de moins de trois ans, étant entendu que l'Éducation nationale les prend en charge à partir de trois ans.

Quel est l'ordre de grandeur entre les sommes dépensées pour l'accueil et celles versées au titre des allocations individuelles par la branche famille ?
L'accueil de la petite enfance ne dépend pas uniquement de la branche famille et ne doit pas être associé au versement d'allocations familiales. Il faut concevoir l'accueil de la petite enfance de façon plus globale. Ainsi, une part très importante des allocations familiales est versée au titre de l'allocation logement.
Faut-il encourager l'accueil individuel par les assistantes maternelles ? Cette question, selon moi, doit être liée à celle de la création d'un service public de la petite enfance. En proposant 28 places pour 100 enfants et en accueillant 18 % des enfants de moins de trois ans, les assistantes maternelles assurent une grande part de l'offre d'accueil. Augmenter leur nombre nécessiterait d'augmenter parallèlement le nombre de places d'accueil collectif, afin de ne pas accentuer plus encore les inégalités d'accès aux différents modes d'accueil, et d'harmoniser leurs tarifs. Cette nouvelle donne nous amènerait à demander aux assistantes maternelles de répondre à une mission d'accueil, au même titre que les établissements d'accueil collectif, donc à revoir leurs statuts. Actuellement, c'est souvent la recherche de revenus qui conduit les assistantes maternelles à décider d'accueillir des enfants.
Leur demander de suivre la même formation serait très compliqué dans la mesure où elles exercent leur métier dans le cadre d'une relation de gré à gré avec les parents. Actuellement leur statut est ambigu : elles sont salariées indépendantes tout en ne l'étant pas. Une chose est certaine : dès lors qu'elles auront suivi une formation, une part des enfants dont elles s'occupent actuellement devront changer de mode de garde.

Les collectivités territoriales font de gros efforts en direction de la petite enfance, certaines communes en font même une priorité. Il faut privilégier l'accueil collectif tout en reconnaissant le statut des assistantes maternelles, car les parents sont de plus en plus exigeants à leur égard.
Leur métier a une dimension humaine incontestable mais il ne s'appuie pas sur la notion de mission. C'est pourquoi l'accueil des enfants les plus démunis et des handicapés n'est pas assuré par les assistantes maternelles mais par les établissements d'accueil collectif.

Le relais assistantes maternelles (RAM) est un dispositif très intéressant, auquel les assistantes maternelles adhèrent sur la base du volontariat. J'ajoute que leur situation financière est très différente selon qu'elles exercent dans un territoire rural, où les enfants sont moins nombreux, ou à Paris, où les tarifs sont plus élevés et la demande plus importante.

L'offre de garde des jeunes enfants est un élément de l'attractivité de nos villes. Le recours à une assistante maternelle n'est plus la bonne réponse pour nombre de jeunes parents qui souhaitent confier leurs enfants à des personnes qui ont reçu une formation spécifique.

D'où l'importance pour les communes d'investir dans les crèches municipales, qui connaissent un grand succès.
Mais dont le nombre, hélas, diminue d'année en année.

Les élus locaux ont à choisir entre bâtir des infrastructures ou accompagner les citoyens et ne peuvent tout attendre du Gouvernement. C'est un choix difficile car les investissements en direction des enfants ne porteront leurs fruits dans vingt ans…

Nous sommes favorables à l'instauration d'un service public de la petite enfance, qui ne serait pas une hiérarchie centralisée de fonctionnaires mais permettrait de définir une mission publique de la petite enfance qui concernerait l'ensemble des professionnels. Nous pourrions dans ce cadre réfléchir au taux d'encadrement dans les crèches, qui renchérit le coût de l'accueil – jusqu'à 30 000 euros pour l'ouverture d'un berceau !
Y a-t-il lieu pour la France de s'inspirer des exemples étrangers ?
La définition d'une mission vaut également pour les professionnels de l'accueil collectif.
Nous ne disposons actuellement d'aucune donnée sur les pratiques en vigueur dans les crèches et chez les assistantes maternelles. Augmenter le nombre des assistantes maternelles nous obligerait à définir et à contrôler les pratiques au niveau national.
Quant aux « projets de crèche », ils sont peu utilisés et la plupart des professionnels en ignorent l'existence. Le projet est signé par la CNAF et la commune, mais aucun cadre n'a été défini et nous constatons de fortes disparités entre les établissements. Les professionnels de l'accueil ne disposent que de leur propre expérience, qu'il s'agisse de l'accueil des enfants proprement dit ou de la gestion des conflits.
Instaurer un service public de la petite enfance nous obligerait à augmenter l'offre de garde collective, à améliorer la gouvernance, à harmoniser les tarifs de l'accueil individuel, à mieux coordonner l'offre, à clarifier la gestion des établissements – par le biais notamment de délégations de service public. Nous avons entrepris des recherches pour comprendre la manière dont sont gérés les établissements, mais il nous est très difficile d'accéder aux informations.
Dans le cadre d'un service public de la petite enfance, nous pourrions envisager de donner à chaque enfant de moins de trois ans le droit d'accéder à un mode d'accueil, quel qu'il soit, pendant une durée d'un an.
Je suis sceptique quant à l'intérêt pour la France de s'inspirer des exemples étrangers car peu de pays disposent comme le nôtre d'une politique familiale explicite et institutionnalisée. La France a dépassé un certain nombre de stéréotypes, notamment celui qui écarte du travail à temps plein les femmes ayant de jeunes enfants. Or les pays nordiques ont des systèmes d'accueil parfois performants mais ont redonné vie à ce stéréotype puisque les femmes de ces pays travaillent à temps partiel pour élever leurs enfants.

En Suède, les communes ont obligation de proposer à chaque enfant une place d'accueil collectif dès qu'il atteint l'âge de un an. Cet accueil, axé sur la socialisation, est gratuit et doit être proche du domicile de la famille. Mais durant sa première année, l'enfant est gardé par sa mère, ce qui empêche celle-ci de travailler. Certaines communes suédoises consacrent plus de 50 % de leur budget à ce dispositif.
Afin de préserver l'insertion professionnelle des mères, faut-il réformer le congé parental ? Convient-il de l'abréger ou de le répartir entre les parents ?
Les Suédois considèrent en effet qu'il est préférable pour l'enfant de rester près de sa mère pendant un an. Mais les femmes françaises ont bien compris l'intérêt de recourir à un mode d'accueil dès la fin du congé maternité. De ce point de vue, le modèle français me paraît beaucoup plus avancé, sur le plan de l'égalité entre femmes et hommes, que les modèles nordiques.
Le problème en France vient de ce que nos modes d'accueil s'adressent aux parents qui travaillent, et donc qui appartiennent aux catégories les plus aisées.
Faut-il abréger le congé parental ? Oui, pour éviter que les femmes soient trop longtemps éloignées du marché du travail. Faut-il le répartir différemment ? L'idée est intéressante, mais dans les deux cas cela suppose de trouver un autre mode de garde.
Je voudrais évoquer le congé parental à temps partiel. Le nombre de recours à cette nouvelle forme de congé parental ne cesse d'augmenter depuis 2004, au détriment de l'interruption d'activité. Ce phénomène est dû à la revalorisation des indemnités du congé parental à temps partiel et du complément de libre choix d'activité (CLCA), et il permet aux bénéficiaires de ne pas craindre de perdre leur emploi. Ce recours au temps partiel nous amène à reconsidérer la norme en matière de travail des femmes, qui pourrait être de plus en plus modulé pendant la petite enfance.
Le congé parental concerne très peu de pères – seulement 3,5 % des bénéficiaires sont des hommes – mais parmi eux 70 % ont opté pour un congé à temps partiel. J'ai souhaité interroger certains de ces hommes : ils m'ont dit vouloir profiter de leur enfant tout en conservant leur statut d'homme qui travaille. Mais ce dispositif, qui s'apparente plus à de la flexibilité qu'à une conciliation, n'est possible que dans les secteurs où le dialogue social est une réalité et où les personnes sont certaines de retrouver un emploi à temps complet, ce qui constitue une autre forme d'inégalité.
Quoi qu'il en soit, le congé parental est forcément inégalitaire, sauf à en raccourcir la durée.

À travers les contractualisations qu'elle engage avec les communes, la CNAF ne se désengage-t-elle pas de sa mission d'aide et d'accompagnement des adolescents au profit de la petite enfance ? Cette évolution a mis certaines communes en difficulté et oblige un certain nombre de femmes qui ne souhaitent pas laisser seuls leurs enfants de huit ou dix ans à opter pour un temps partiel.

En bref, pour mener une véritable politique familiale égalitaire, nous devons augmenter le nombre de places en crèches, améliorer la qualité de l'accueil et mieux former les professionnels qui y travaillent. Cela exige de consacrer plus de moyens à la politique familiale, or ceux-ci sont déjà très importants. Dans une période où les fonds publics sont limités et le seront encore demain, la politique familiale menée en France n'est-elle pas trop tournée vers l'aide individuelle, au détriment de l'aide collective ? L'argent public ne devrait-il pas être plutôt destiné à construire des structures collectives qu'à attribuer des aides individuelles, a fortiori lorsqu'elles sont accordées sans limite de revenus ?

En France, notre force, c'est notre école maternelle. L'Éducation nationale, la CNAF et les collectivités locales devraient réfléchir ensemble en vue de développer l'accueil des enfants de moins de trois ans au sein de l'école maternelle – ce que refusent encore les acteurs de l'Éducation nationale.
L'étude de l'OFCE démontre la rentabilité d'un tel investissement à moyen et long terme dans la mesure où la scolarisation dès deux ans améliore le niveau des élèves de l'enseignement primaire. Les 150 000 enfants qui sortent chaque année du système scolaire sans qualification ont peut-être décroché dès la classe de CP. Cependant il est difficile, dans une période de restriction budgétaire, de prendre une mesure qui ne produira ses effets que dans dix ans.
Vous avez raison, mais cela suppose de redéfinir la mission de l'école maternelle qui, nous devons peut-être nous en inquiéter, est de plus en plus axée sur la préparation à la scolarité élémentaire.

Chaque enfant a son propre rythme de progression sociale et intellectuelle. Nous devons respecter ce rythme et abandonner le principe qui consiste à réunir tous les enfants d'une tranche d'âge au sein d'une classe.
C'est pourquoi il est important de clarifier ce que l'on attend de l'accueil des enfants de zéro à trois ans et de choisir les structures de socialisation les plus adéquates.

Notre pays bénéficie comparativement d'une forte natalité, mais c'est aussi le pays d'Europe où les femmes qui quittent le monde du travail après le deuxième ou le troisième enfant sont les plus nombreuses.
Je vous remercie, madame.
La séance est levée à 18 heures 55.