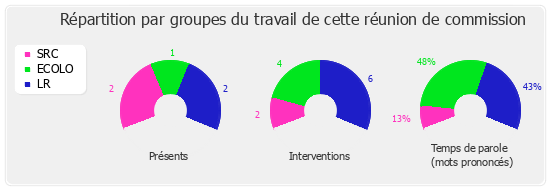Groupe de travail sur l'avenir des institutions
Réunion du 26 juin 2015 à 9h00
La réunion
La séance débute à neuf heures quinze.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à féliciter Michel Winock qui vient d'obtenir le prix du livre politique du Sénat pour son ouvrage sur François Mitterrand. Nous avons donc fait le bon choix, les mérites du coprésident de notre groupe de travail ayant été une fois de plus reconnus…
Je vous remercie, monsieur le président, d'autant que, je le suppose, vous n'y êtes pour rien !

Pour rien, en effet : vous imaginez le poids de ma parole au Sénat…
Après sept mois d'auditions, de tables rondes et de débats, nous voici entrés dans la phase de délibérations de notre groupe de travail sur l'avenir des institutions.
Dans cette perspective, nous avons adressé à chacun d'entre vous un questionnaire dit « préférentiel ». Ce document, dont vous trouverez un exemplaire devant vous, est le reflet de nos discussions et de nos échanges. Il tente de répertorier les positions et les pistes de réformes évoquées au cours des quatorze séances précédentes. Nous vous avons demandé d'indiquer sur ce document votre degré d'adhésion ou d'opposition à chaque proposition.
Si ce questionnaire se veut relativement exhaustif, il se peut néanmoins que vous ayez noté, ici ou là, un oubli. Si tel est le cas, une rubrique intitulée « remarques personnelles » se trouve en dernière page du questionnaire afin de vous permettre de sortir des chemins tracés par ce document et de le compléter ainsi utilement. Nous ne pourrons pas, en revanche, compte tenu de notre calendrier, modifier ou ajouter telle ou telle question et adresser un nouveau questionnaire au groupe de travail.
J'insiste d'ailleurs sur le fait que vos réponses doivent impérativement parvenir au secrétariat du groupe de travail, soit sous forme électronique, soit sous forme manuscrite, au plus tard lundi prochain à midi. Michel Winock et moi-même remercions ceux qui nous ont d'ores et déjà transmis leur réponse.
Nous vous informons également que nous vous remettrons, à la demande de plusieurs d'entre vous, un enregistrement de l'intégralité de nos auditions et de nos séances. Je vous rappelle toutefois que l'ensemble des comptes rendus est accessible en ligne sur le site de l'Assemblée sous un format PDF – nous pourrons aussi vous les transmettre.
J'ai eu l'occasion de l'indiquer il y a quinze jours, nous avons prévu avec Michel Winock deux séances de délibérations : celle d'aujourd'hui et celle du 10 juillet prochain.
Lors de la prochaine séance, nous vous présenterons l'analyse consolidée des questionnaires que vous nous aurez transmis et, par la suite, les positions qui semblent faire consensus au sein du groupe de travail et celles qui au contraire n'auront pas rassemblé de majorité. Puis nous laisserons les uns et les autres réagir.
La séance d'aujourd'hui est, en revanche, l'occasion pour chacun d'entre vous d'exposer ses propres positions afin, peut-être, de convaincre ceux qui n'ont pas encore rempli leur questionnaire ou qui seraient encore indécis sur tel ou tel point. C'est également l'occasion d'insister sur les constats qui semblent s'être dégagés à l'issue de ces sept mois de travail et que nous voudrions retrouver dans notre rapport.
Je l'ai dit la dernière fois : chacun ici a évolué intellectuellement au cours de ces séances. Nos convictions ont été parfois renforcées, parfois ébranlées, voire modifiées ! L'analyse des questionnaires peut nous réserver quelques surprises… Reste que, pour ma part, une chose est sûre : après cette expérience, je crois aujourd'hui encore plus qu'hier à l'importance de la délibération. Je vous remercie les uns et les autres pour votre assiduité et pour vos interventions. Je rappelle qu'il n'est en aucun cas question de vous piéger : toutes vos remarques, y compris celles qui ne s'accorderaient pas avec les conclusions du rapport, seront prises en considération et vous pourrez y adjoindre une contribution écrite une fois nos réunions terminées. Tout sera ainsi transparent.
La question de la modernisation de nos institutions s'invitera inéluctablement lors de la prochaine élection présidentielle. J'espère que notre groupe atypique – pour la première fois, ce ne sont pas uniquement des constitutionnalistes qui auront réfléchi à l'évolution de nos institutions – aura l'occasion de prendre sa part au débat.
Je m'interroge sur la méthode de travail du tour de table de ce matin : allons-nous traiter question par question ? Je pense en effet que nous devons séquencer nos interventions.

Si nous faisons un tour de table pour chaque question, nous serons encore là demain matin. Il me semble plus approprié, à ce stade de nos travaux, que nous livrions chacun une vision synthétique.

Mon prédécesseur a, me semble-t-il, raison et nous ne devons pas, de plus, anticiper sur les réponses au questionnaire. Je propose donc que chacun s'exprime sur l'ensemble des auditions auxquelles nous avons procédé, en se concentrant sur les points qui l'auront le plus fait « bouger ».
Je suis d'accord avec la méthode que vous proposez, monsieur le président, ainsi que M. Accoyer : il faudrait que chacun revienne sur deux ou trois points saillants. En outre, je note que le questionnaire recèle une question implicite et qui surplombe les autres : celle de savoir s'il faut, ou non, réformer en profondeur les institutions.
Ne peut-on, avant tout, se demander ce qui manque dans ce questionnaire – sans qu'il soit certes question de le transformer ? Par exemple, je n'y ai rien vu sur la procédure de désignation des candidats à la présidence de la République, alors que nous l'avions évoquée à propos des primaires.

Identifier ce qui manque est une démarche intéressante, mais qui ne doit pas occulter le travail accompli. L'intervention de Michel Winock me donne d'ailleurs l'occasion de remercier l'ensemble de ceux qui ont travaillé sur le sujet, services, administrateurs et vous-même, madame la secrétaire générale.
Si nous optons pour la fusion du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), des questions supplémentaires sont nécessaires sur les compétences de la nouvelle assemblée qui en résulterait : à quoi servirait-elle, ne serait-elle que consultative ; aurait-elle, dans certains domaines, des compétences législatives ?
De même, si l'on opte pour un ordre de juridiction sociale, fortement défendu par Pierre Joxe – proposition quelque peu révolutionnaire pour laquelle on peut être tenté, constatant le mauvais fonctionnement de nos juridictions sociales –, des questions complémentaires doivent être posées. Fusionnera-t-on les juridictions sociales administratives et judiciaires ? Doit-on mettre de l'ordre dans le maquis juridique actuel tout en tentant de sortir de la pauvreté immense de ces juridictions ?

Pour ce qui est de la fusion du Sénat et du CESE, plusieurs questions figurent page 12, notamment la question 39.1.3, qui rejoint la vôtre : « Quelles conséquences faudrait-il en tirer en termes de pouvoirs ? »
Nous n'avons pas procédé à l'évaluation des réformes constitutionnelles passées. Je pense à la remarque qu'avait faite le président Accoyer sur les conséquences de la session unique. Faut-il la maintenir, surtout si l'on veut accentuer le contrôle de l'exécutif par le Parlement ? Je pense à la semaine de contrôle.
Ensuite, en ce qui concerne la réforme constitutionnelle de 2008, je me suis interrogée à plusieurs reprises, d'une part, sur le partage du temps entre le Parlement et le Gouvernement et, d'autre part, sur le fait que le texte examiné en séance est désormais celui de la commission et non plus celui du Gouvernement. Or, sur ce dernier point, vous avez observé, monsieur le président, une explosion en séance des amendements gouvernementaux, les textes étant « mal ficelés ». Mais la vraie raison n'est-elle pas plutôt que le Gouvernement, s'il veut en revenir à son texte, est obligé de déposer des amendements ? Je me demande par conséquent si ces deux modifications n'ont pas eu des effets collatéraux que l'on n'avait pas prévus.

Lorsque nous avons reçu Régis Juanico et Laure de La Raudière, auteurs d'un rapport sur la « fabrique de la loi », ces difficultés ont bien été mises en évidence et nous avons pu constater qu'elles dépassaient la seule réforme de 2008. Vous auriez raison, madame, si les amendements du Gouvernement n'étaient déposés qu'après l'examen du texte par l'une des deux assemblées, mais je dois malheureusement souligner, pour l'avoir vécu très dernièrement, que cette multiplication des amendements gouvernementaux s'observe dès la première lecture. J'ajoute, à l'attention de ceux – dont font partie certains membres du Gouvernement – qui déplorent le rôle du Parlement dans l'inflation législative, que plus de 80 % des textes inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée sont d'origine gouvernementale. En outre, l'inflation en question ne doit pas seulement se mesurer au nombre des textes, mais aussi à leur épaisseur – et la frontière est souvent franchie allégrement entre le domaine de la loi et celui du règlement.

Je félicite à mon tour les services pour l'élaboration du questionnaire, et j'insiste pour qu'on ne voie pas dans mon intervention une critique.
Je relève que nous avons assez peu évoqué le Conseil d'État au cours de nos réunions. Il serait intéressant de savoir comment nous souhaiterions le voir évoluer ? Faut-il aller jusqu'à regrouper la juridiction administrative et la juridiction judiciaire au sein d'un même ensemble ? Cette question est importante dès lors que nous nous interrogeons sur la nature du pouvoir judiciaire, car qui dit pouvoir judiciaire dit, bien sûr, déontologie et indépendance. Or je ne suis pas sûre que le Conseil d'État, dans sa configuration actuelle – on y remarque en effet l'existence de potentiels conflits d'intérêts – réponde aux exigences d'un pouvoir judiciaire.
Je ne vois pas d'items sur la place du principe de précaution dans la hiérarchie des normes, alors que nous avons longuement débattu de ce point controversé, et qui touche à la démarcation entre opinion et connaissance. Veut-on, oui ou non, confier à nos institutions la responsabilité de la gestion de nos sociétés sur le temps long ?
Vous l'avez dit, et nous vous en sommes redevables, monsieur le président, ce groupe de travail est assez original et doit le rester. Il faut que le rapport mette en évidence la plus-value de notre travail : la diversité des positions exprimées sur les questions institutionnelles, la diversité des approches empiriques suggérées. Si nous n'étions qu'une énième commission de réflexion sur les institutions, ce serait en effet dommage. Aussi le grand intérêt de notre travail – et même si nous le ferons dans certains cas parce que c'est utile – ne réside-t-il pas nécessairement dans l'énumération de propositions de modification de la Constitution, d'autant que nous savons qu'il sera difficile de réunir une majorité des deux tiers au Congrès. Nous devons constituer une étape dans la réflexion sur les institutions de la Ve République.
Je souscris à ce que vient de dire M. Baranger. Évoquer le fait qu'il n'y a pas de question sur le point de savoir s'il faut conserver, amender ou changer la Constitution est une bonne manière de lancer le débat. Il faudrait que le groupe de travail, à travers son rapport notamment, montre qu'au-delà des mesures qu'il peut préconiser sur tel ou tel point, la question des institutions est urgente et impérieuse. Il faut en effet qu'elle redevienne une question démocratique et médiatique. Il convient de réintroduire le politique au sens noble dans notre façon d'aborder les questions institutionnelles. J'y insiste : la question de savoir s'il faut changer la Constitution ou changer de Constitution devrait tout de même être évoquée, ne serait-ce que formellement, pour délimiter l'ambition du groupe de travail.
Il y a peut-être consensus sur la nécessité que nos discussions deviennent de véritables enjeux de société dans les mois à venir, et, pour cela, il n'y pas d'autre moyen que de souligner que ce dont nous avons parlé ici, y compris dans ses dimensions les plus techniques, concerne les citoyens. La discussion devrait donc avant tout porter sur le désir d'institutions, éventuellement même – je parle ici pour moi – le désir de changer les institutions, et ce avant même de savoir si le Sénat doit devenir une chambre consultative ou une chambre dont les membres seraient tirés au sort.

Nous saisissons très souvent, même de plus en plus, le Conseil constitutionnel, et je regrette que nous n'ayons pas auditionné son président – mais peut-être a-t-il un devoir de réserve. Le questionnaire n'aborde que le fait de savoir si les anciens présidents de la République doivent ou non en être membres de droit, et si ses membres doivent avoir une compétence juridique… Or j'ai bien mesuré, depuis que je suis parlementaire, l'évolution de cette institution très importante à mes yeux, en particulier avec l'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le questionnaire devrait donc aborder la place, la fonction du Conseil constitutionnel dans la démocratie française.
Ensuite, qu'en est-il de l'environnement européen ? Quelle est l'influence de l'Europe sur nos institutions ? Nous n'avons peut-être pas suffisamment développé le sujet au cours de nos réunions alors que l'Europe prend une place de plus en plus importante. Notre système institutionnel est-il adapté à l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne les rapports entre les parlementaires nationaux et les parlementaires européens ?
Je suis de ceux qui ont déjà répondu au questionnaire. Même si l'on peut souhaiter que d'autres questions soient posées, il paraît difficile d'en augmenter le nombre indéfiniment. Néanmoins, on est souvent tenté de répondre par « oui, si » ou « oui, mais »… Je pense avant tout à la restitution et à la réception de nos travaux. Nous pouvons en effet aider à une prise de conscience afin que les sujets que nous avons abordés fassent plus encore qu'à présent partie du débat public. Dans cette perspective, nous devons avoir présent à l'esprit que tous les sujets ne se valent pas. Ainsi, la durée du mandat du Président de la République intéressera bien plus que le fait de savoir s'il faut porter de une à deux le nombre de semaines blanches au Parlement. Ainsi ce qui paraît relever de la mécanique – même si certains aspects en sont très importants – ne devrait pas être placé au même rang que d'autres enjeux qui, aux yeux des citoyens, apparaissent bien plus cruciaux.

Je précise que le tome II du rapport reprendra l'intégralité de nos auditions et chacun pourra, s'il le souhaite, envoyer une contribution. Nous devons tenir compte du pari intellectuel que nous avons fait : réunir régulièrement et pendant de nombreuses semaines, dans la même pièce, des individus aux profils totalement différents et essayer de mesurer leur sensibilité à la question de savoir s'il faut modifier ou non nos institutions. Reste que la juxtaposition des interventions des uns et des autres ne suffirait pas à dégager une approche conclusive, d'où ce questionnaire. Je ne veux en tout cas surtout pas qu'on ait l'impression que je voudrais tordre la position des uns et des autres : le document final montrera le « bougé » éventuel des positions de chacun.
En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, madame Zimmermann, nous avions décidé de ne pas recevoir les représentants des institutions – ainsi le président du CESE m'a-t-il demandé en vain, à plusieurs reprises, à être reçu – car cela aurait changé la nature de nos réunions. Quant à la QPC, nous sommes miraculeusement parvenus, il y a un an et demi, à réunir l'ensemble des représentants des différentes institutions pour participer à un colloque sur le sujet. Un document en est résulté, où l'on s'interroge notamment sur le fait de savoir si la QPC change ou non la nature du Conseil constitutionnel.

Le questionnaire – qui est une très bonne idée – permet de mesurer la sensibilité de tous ceux qui ont participé aux travaux de la commission. Pour ce qui me concerne, mes positions ont évolué sur certains points ; ainsi de la Sixième République : plutôt que d'en passer par un moment très violent, je plaiderais plutôt, désormais, pour une Cinquième bis. Il est très important que le résultat de nos travaux soit suffisamment clair et donne des perspectives. Bien sûr, nous n'aboutirons pas à une position commune – sinon elle serait des plus tièdes – et il faudra laisser apparaître un certain nombre de tendances.
Je reviendrai sur deux événements récents. Je m'astreins depuis un certain temps, notamment à cause de nos travaux, à ne plus commenter ce type d'événements afin d'avoir du recul.
Le premier est la manière dont le Premier ministre a décidé d'appliquer l'article 49, alinéa 3, de la Constitution : au cours d'une micro-intervention, coupant court à tout débat, il nous a expliqué qu'il fallait aller vite. On n'entend d'ailleurs que cela : j'ai lu que le Président de la République allait juger les ministres en fonction de la rapidité avec laquelle ils prenaient leurs décrets d'application. Or on se trompe : quel est le problème « majeur » de la France depuis deux jours ? Celui des taxis !
Pouvons-nous nous montrer francs sur le sujet ? Entre 1973 et 2012, le prix de la licence de taxi a été multiplié par quarante et, ces dernières années, il est passé de 200 000 à 250 000 euros. Or ce problème ne vient pas de surgir : identifié depuis plus de vingt ans, il est lié à la fois à l'économie de la rente et à la révolution numérique en cours, et non pas au temps parlementaire, à la sortie attendue de décrets d'application – ce serait mentir que de l'affirmer. C'est donc davantage une question de prise en compte des enjeux politiques que de fonctionnement des institutions qu'il s'agit.
Notre responsabilité me paraît être d'introduire de la raison et de la lenteur dans le processus législatif pour éviter non pas la rapidité mais bien l'agitation : élaborer la loi exige prudence et responsabilité. L'accélération évoquée implique que la seule réponse politique que l'on puisse trouver à certaines questions est d'ordre législatif.
Quand on brusque certaines décisions, le Conseil constitutionnel est aujourd'hui le dernier recours. Quel sens y a-t-il à ce que le chef de l'exécutif, dont nous avons dit à quel point il était déjà puissant, saisisse le Conseil constitutionnel de l'intégralité d'une loi qui vient d'être votée ? Tour le monde a l'air de considérer cette pratique comme logique, mais on nous empêche d'assumer des choix politiques de moyen, voire de long terme, ou même de réparer des erreurs. Je prendrai un autre exemple : celui de la taxe poids lourds, fruit d'un travail considérable, faisant l'objet de l'unanimité dans le cadre de la loi « Grenelle », et appliquée par deux majorités différentes – avant que tout s'arrête subitement.
Nous nous éloignons peut-être un peu du sujet, mais il faut prendre ce type d'exemples en considération car, à rester à un niveau stratosphérique, nous nous mentirions à nous-mêmes. Parmi les difficultés que nous avons identifiées figure la très grande responsabilité du Président de la République : dès lors qu'un seul individu est sommé d'apporter des réponses sur tous les sujets du jour au lendemain, le fonctionnement démocratique s'en trouve fragilisé.
J'espère que le questionnaire mettra en évidence, sur plusieurs points, des « bougés », pour reprendre votre expression, monsieur le président. Et j'espère que l'absence de plan caché de votre part ne signifie pas que nous n'aboutirons à aucun résultat. En effet, notre groupe de travail n'est pas si anodin. Dans les circonstances présentes, nous devons oser la franchise. Je ne prétends pas détenir la vérité sur tout : nos débats, je l'ai dit, m'ont amenée à changer d'avis sur certaines questions – ainsi des relations entre le Sénat et le CESE, sujet sur lequel j'ai été en effet très influencée par ce que j'ai entendu. Au contraire, plusieurs auditions ont renforcé mon point de vue initial, comme sur le scrutin proportionnel.
La composition du groupe de travail est si originale que nous devons oser affirmer un certain nombre de choses : nous en avons besoin. J'ignore si, comme me l'a suggéré une personne autour de la table, nous sommes en 1788 sans que, nous mis à part, les principaux concernés ne s'en soient pas rendu compte, mais je pense que nous devons faire des propositions – les acteurs institutionnels eux-mêmes étant du reste bien conscients de la nécessité de bouger. La situation des taxis et des VTC est douloureuse, alors que nous avions identifié leurs problèmes depuis très longtemps ; si nous agissons de même avec les institutions, ce ne serait plus seulement dangereux mais dramatique.
Je prolongerai ces réflexions auxquelles je souscris largement. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette affaire des taxis ? Pas seulement une question de procédure, mais également une question de principe – un principe de justice, ou de respect des contrats. Des gens sont titulaires d'une licence qu'ils ont payée très cher, en fonction de laquelle ils ont organisé leur avenir, et ils voient brusquement des modalités de fonctionnement de la société, parfaitement légitimées par le développement des techniques, par les progrès de la mondialisation, entrer malheureusement en totale contradiction avec le respect des engagements pris par la société à leur égard. Je faisais à ce propos remarquer à Bernard Thibault que le corporatisme pouvait être aussi violent que la lutte des classes…
J'ai appris ici comment les choses fonctionnaient sur le terrain – je n'ai jamais été député –, d'une façon qui m'a énormément éclairé. La France, parmi la plupart des pays européens, est celle qui a le plus subi le choc de la mondialisation, car elle a été construite par son État, contrairement à de nombreux autres pays, comme l'Allemagne qui a été une nation avant d'être un État. Par conséquent, dès lors que l'État se trouve déstabilisé par la mondialisation, nous nous demandons d'où vient la loi qui décide de l'orientation vers tel ou tel cap qui nous semble parfois en contradiction avec notre modèle – comme c'est le cas pour la laïcité, par exemple, très peu abordée par le questionnaire.
La Cinquième République a été jusqu'à présent une réponse à ce type de problème, dans la mesure où elle posait des équilibres, notamment entre l'aspiration monarchique des Français – et ce n'est pas un hasard si la place du Président de la République nous a tellement occupés – et la dimension populaire. Je pense qu'il faut préserver cette dimension monarchique sans pour autant affaiblir les contre-pouvoirs. La mise en jeu de la responsabilité du Président m'apparaît essentielle : il est irresponsable comme les anciens monarques, ce qui n'est plus pensable aujourd'hui.
En outre, la mondialisation nous confronte au temps réel. Si vous entamez un régime d'amaigrissement, je vous déconseille de vous peser toutes les dix minutes ! Or c'est un peu ce qui nous arrive : les lois sont essentiellement fonction de l'actualité qui impose son rythme. Sur ce plan aussi, la Cinquième République respectait un certain équilibre qui reposait sur la légitimité du vieux mythe de la loi – expression de la volonté générale – mythe qui s'est réduit comme peau de chagrin – hiérarchie des normes oblige.
La Cinquième n'a pas su répondre au problème du contre-pouvoir judiciaire. Il est évident qu'il faut un véritable pouvoir judiciaire. Le contrôle judiciaire est essentiel. Bernard Thibault me disait encore tout à l'heure que le code du travail, c'était, au fond, quelques règles et un nombre incroyable d'explications et de cas particuliers – en général définis par la jurisprudence.
Je ne crois pas qu'il faille changer la Cinquième République ; elle a été une réponse historiquement d'ailleurs liée à des hasards. De Gaulle s'imaginait-il, en 1962, que l'élection du Président de la République au suffrage universel, associée au scrutin majoritaire à deux tours, amènerait la France à s'aligner sur les modèles bipolaires et bipartisans de la plupart des pays ? L'avènement d'un système fondé sur une majorité et une opposition, d'alternance démocratique, ne faisait pas nécessairement partie des desseins du Général. Ainsi, paradoxalement, « par volonté et par hasard » comme dirait Pierre Boulez, la Cinquième République a créé quelque chose qui fonctionnait et qui est aujourd'hui remis en cause pour des raisons d'inadaptation technique aux exigences à la fois d'efficacité et de réflexion à long terme.
Créer une commission par ministère me paraît une très bonne idée, même si je ne suis pas sûr qu'il faille anticiper, par une pré-délibération, sur la délibération parlementaire : plus on banalise celle-ci, plus on risque d'affaiblir le prestige de l'Assemblée. Il faut resacraliser le mécanisme et le relégitimer, la relégitimation elle-même passant par une plus grande efficacité, une meilleure communication et une meilleure distribution des interventions et des pouvoirs.
Il fut un temps où il était très à la mode de donner dans la démocratie participative. Nous n'en avons pas trop parlé – un nom a quelque peu disparu de nos débats, celui de Pierre Rosanvallon qu'à une époque le Conseil économique et social consultait énormément.
En ce qui concerne les corporatismes, si je ne sais pas ce qu'il convient de faire du Sénat, je suis en tout cas sûr que l'associer au CESE serait contradictoire. En effet, on en viendrait à reféodaliser de la société française : dans un pays comme la France, qui a été unifié précisément par l'État, lorsqu'il n'y a plus l'État, il reste les corporations, les religions et la race. Ce qui nous rassemble et nous définit, c'est, en fin de compte, l'intériorisation de la loi ; or, quand la loi n'a plus de légitimité, quand l'État n'apparaît pas suffisant pour protéger les citoyens, chacun se protège derrière une corporation, une identité, qui peut être religieuse, ethnique ou régionale.
Il convient, pour refonder la Cinquième République, de renforcer, d'une part, une certaine sacralité du pouvoir et, de l'autre, la légitimité de ce pouvoir, les deux notions n'étant pas toujours identiques et devant s'équilibrer. C'est le défi auquel nous sommes confrontés et c'est le meilleur moyen, à mon sens, de lutter contre les dérives de notre société qui risque d'éclater faute de nation. Il ne s'agit pas de lancer un appel à la refondation de la nation, sursum corda, tous debout au coude-à-coude sur le parapet et sabre au clair pour reconstituer l'amour de la patrie – cela ne se décrète pas –, mais au moins tâchons de faire en sorte que les institutions retrouvent une certaine crédibilité, une certaine légitimité.
On nous a soumis une liste de questions pratiques, techniques. Il serait bon que chacun y aille non pas de sa profession de foi mais d'un exposé des motifs plus clair que les propos que je viens de tenir. C'est l'une des raisons d'être que je donnerais à notre groupe de travail qui ne réunit pas que des juristes mais des citoyens impliqués dans la réflexion sur l'histoire de France.
En vous écoutant les uns et les autres, il me semble que notre défi majeur consiste à savoir ce que l'opinion retiendra de nos travaux. Je suis d'accord avec Bernard Thibault : il est probable que les médias s'accrocheront à la suppression du Sénat, au mandat du Président de la République… Nous devrions par conséquent nous caler sur quelques idées fortes qui nous paraissent « transformantes » tant il est vrai que, dans ce pays, quand on se parle, on est capable d'identifier les maux dont on souffre.
Je prendrai l'exemple d'un sujet qui m'est cher, « Démocratie sociale et démocratie politique » : la question 60 sur la hiérarchie des normes me paraît très « transformante » mais je redoute que, sur la question, l'opinion et les médias ne retiennent que le chèque syndical ou l'obligation d'adhérer à un syndicat.
J'ai beaucoup d'admiration pour le travail des services qui sont parvenus à canaliser nos débats.
Je reviens donc sur notre défi : imposer quatre idées dans le débat. Ce que nous avons fait est trop précieux, trop intéressant pour que cela se résume à quelques points de friction et d'intérêt pour les médias.
Je remercie à mon tour les auteurs du questionnaire et je souhaite qu'ils ne voient pas dans nos remarques autre chose que de la reconnaissance.
Nous avons intérêt à distinguer, d'une part, les grands équilibres institutionnels et, de l'autre, ce qu'on doit changer. Les premiers sont difficiles à changer par décret, de façon volontariste. Ainsi, si nous faisons des propositions de modification constitutionnelle sur les grands équilibres, nous tomberons dans la même trappe que les précédentes commissions – ce qui ne nous empêche pas de nous exprimer avec force sur le sujet. Je prendrai l'exemple du Sénat et du CESE. Je retiens de nos nombreuses discussions que le Sénat comme le CESE doivent évoluer.
Dans l'intérêt même de l'institution sénatoriale, une évolution doit avoir lieu : il est dommage d'avoir une seconde chambre qui ne joue pas le rôle qu'elle pourrait jouer dans le débat public, et affirmer qu'elle souffre d'une crise de représentation n'est pas faire offense à ses membres – c'est tout le contraire dans mon esprit.
Le CESE doit évoluer, lui aussi : le fait qu'il ne soit pas entendu dans la discussion publique est vraiment dommage.
Doit-on réunir ces deux assemblées ? Ce serait peut-être souhaitable. Le Sénat l'acceptera-t-il ? C'est plus incertain. J'avais estimé nécessaire, pour ma part, de politiser la discussion au CESE – dans le sens où existe une politique non partisane : des écologistes peuvent ne pas provenir de l'écologie politique, d'autres membres peuvent être issus de la « société civile »… Nous avons ainsi reçu le représentant d'une grande association intervenant dans l'écologie et qui a tenu des propos plus choquants, brutaux que n'importe quel élu politique. Le CESE doit être le lieu de ce genre d'expression.
M. Mélin-Soucramanien a entièrement raison de considérer qu'il ne faut pas de troisième chambre. Il me paraît néanmoins urgent qu'il se passe quelque chose au sein du CESE. Nous devons l'affirmer même si nous n'avons pas de proposition à faire valoir qui soit recevable par tous les courants d'opinion.
Il convient par ailleurs de mettre en avant ce qui va mieux – je pense au point de vue de Marie-Anne Cohendet sur le Président de la République. Je renverserai, par goût de la provocation, certaines idées en vogue : j'affirme être satisfait de ce que le Président de la République soit aujourd'hui moins fort que ne l'étaient le général de Gaulle et Georges Pompidou. Depuis une dizaine d'années, en effet, le chef de l'État dispose d'une moindre marge de manoeuvre, influence moins la vie politique. Or ce n'est pas un amendement à la Constitution qui en est la cause mais une tendance lourde ; et les tendances lourdes, on ne peut que les constater ou les regretter quand on trouve qu'elles sont nuisibles – être un organe de constatation ne me paraît du reste pas négligeable. Certains mécanismes de réajustement ont fonctionné : ainsi de certaines dispositions positives de la réforme de 2008 – encore faut-il, j'y insiste, le souligner.
Malgré tout, il y a urgence à intervenir.
Ainsi, il faut absolument changer l'article 64, voire le supprimer ! Le Président de la République ne doit plus « veiller à l'indépendance de l'autorité judiciaire » : ce n'est simplement plus possible. Il faut un pouvoir judiciaire. J'ai été, sur ce point, très sensible aux propos de Pierre Joxe.
Il faut aussi faire évoluer le Conseil constitutionnel. À mes yeux, la Constitution n'est pas vivante dans notre pays comme elle peut l'être en Allemagne ou aux États-Unis. J'ai le plus grand respect pour le Conseil constitutionnel, qui a su porter l'idée d'État de droit dans notre pays ; mais je n'arrive pas à me réconcilier avec l'idée d'un juge qui motive aussi peu ses décisions. Une décision sur une loi organique peut-elle tenir en deux lignes ? Encore une fois, je le dis avec respect, mais je ne peux pas l'accepter. Il nous faut des opinions dissidentes, il nous faut un juge constitutionnel qui soit un organe de la longue durée – ce que n'est pas aujourd'hui notre Conseil constitutionnel. Celui-ci est très bien intégré à la mécanique institutionnelle de gestion du processus normatif ; on sait ce qu'il pense, et on le sait vite : un commentaire des Cahiers du Conseil constitutionnel indiquait que telle décision avait été rendue en une heure et demie ! Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il faut de la lenteur, et les QPC posent de ce point de vue, je crois, un énorme problème. La motivation des décisions, je le dis sans aucune volonté de provocation, est très insuffisante, et notre justice constitutionnelle doit évoluer sur ce point. Nous sommes peu à le dire mais cela ne doit pas nous empêcher d'être entendus.
J'aimerais qu'il soit question de la parité, qui n'a pas assez évolué.
La transformation des grands partis en séries de micro-partis me semble poser un problème sérieux : il faut interdire, ou encadrer, ces derniers. On m'a fait remarquer qu'être opposé aux micro-partis revenait en quelque sorte à s'opposer aux primaires, les premiers servant d'instruments de préparation des secondes. Il faut y réfléchir, mais un encadrement législatif des micro-partis me semble indispensable.
Il faut enfin verrouiller la question du contrôle du financement. Nous avons ainsi auditionné le fondateur d'une start-up dont le but est d'accompagner la transformation des partis politiques et des campagnes électorales. C'était très intéressant, mais tout cela va coûter cher… Soyons prudents : plus les élections seront onéreuses, plus le financement privé sera nécessaire. Or c'est – comme le montre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis – une pente dangereuse pour la démocratie. Il faut prendre garde à ne pas nous y engager.
S'agissant enfin de l'éthique publique, il faut, je crois, externaliser le contrôle : notre administration se contrôle assez bien, mais elle se contrôle elle-même, ce qui pose problème. Pourquoi le CESE ne pourrait-il pas devenir une instance de contrôle ? Je ne néglige pas le travail de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais il faut nous engager dans un mouvement de séparation organique du contrôleur et du contrôlé.
Je commence par souligner à quel point je suis heureux d'avoir pu participer à cette commission ; l'expérience a été très enrichissante.
Je m'abstiendrai naturellement de tout propos sur la justice, les autorités juridictionnelles et le Conseil constitutionnel.
Je m'interrogerai d'abord sur l'un des préalables de notre discussion, qui a été énoncé par Michaël Foessel : les institutions devraient redevenir le coeur du débat. Je n'en suis pas si sûr : les mobilisations sociales récentes – comme les « zones à défendre » (ZAD) ou les mouvements Occupy – montrent une volonté démocratique mais aussi une sortie des institutions. Ces mouvements n'ont guère de leaders ni de programmes articulés – sinon celui de laisser fructifier des modes d'existence ou de croyance librement, à l'abri des institutions. C'est d'ailleurs ce qui les rend si difficile à lire par les sciences politiques. Paradoxalement, notre mission est peut-être le dernier sursaut d'un monde appelé à vaciller… Cela m'invite à beaucoup de modestie, mais j'ai accepté de faire partie de cette mission et je sais pourquoi je suis là.
En remplissant le questionnaire – qui est en effet très bien conçu – je me suis senti partagé entre des aspirations abstraites, utopiques, révolutionnaires d'un côté, et de l'autre le concret, le faisable aujourd'hui, en 2015. Je me suis donc résolu à parler de ce qui me semble urgent.
Il est d'abord urgent d'avoir une élite politique plus en phase avec la population, plus réactive, plus attentive, plus en mesure d'incarner ce que souhaite le peuple. Pour relégitimer nos institutions – si nous proposons de les conserver –, il faut rassembler les personnes, et supprimer la distance entre les élites et la population.
Cela passe par un statut de l'élu, mais aussi par l'instauration de quotas. Ceux-ci, fait-on souvent observer, présentent un risque de subversion des fondements même de notre culture politique depuis la Révolution ; ils mettraient à mal notre idée d'un citoyen abstrait qui, par le suffrage universel, confie sa voix à un représentant détaché de ce qu'il est concrètement – religion, origine sociale, profession… C'est un risque, je n'en disconviens pas, mais c'est un risque à long terme. À ne rien faire, en revanche, à refuser de prendre la mesure de la déconnexion entre les élites et les citoyens, il y a aussi un risque, mais un risque à très court terme. Marie-George Buffet avait très bien montré cette difficulté, en prenant l'exemple de jeunes de cités qui se portaient candidats sur des listes électorales, quelles que soient la tendance politique et l'idéologie de celles-ci, dans le seul but d'être inclus dans la société. On pourrait citer ici un film célèbre : « jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien »… Alors, bien sûr, instaurer des quotas reviendrait à bouleverser notre culture de la représentation ; ce serait une forme de révolution culturelle, et je suis bien incapable ici de mesure les conséquences d'un tel changement.
Mais, même à dose homéopathique, cela vaudrait la peine d'essayer d'instaurer des quotas, mais aussi le vote électronique, la représentation proportionnelle, la réforme du référendum pour renforcer le rôle de la démocratie directe, les amendements citoyens, des processus – bien sûr très encadrés – de destitution sur initiative citoyenne à l'image du recall américain… Il faut en tout cas essayer de faire entendre la voix de ceux que nos institutions n'entendent plus, et qui se feront entendre un jour ou l'autre, mais d'une manière qui risque d'être délétère, ou à tout le moins très insatisfaisante pour beaucoup d'autres personnes.
Le questionnaire s'intéresse surtout à la mécanique institutionnelle, et laisse de côté les droits fondamentaux. Notre État prend aujourd'hui ses distances par rapport à l'État providence d'il y a encore dix ou vingt ans ; nous pourrions tenter de nous orienter vers un caring state, c'est-à-dire un État qui met en place les conditions qui permettront aux groupes, et aux individus, de développer les cultures, les solidarités, les comportements, qu'ils souhaitent. En ce sens, nous pourrions proposer – ce serait à nouveau une rupture culturelle majeure – de laisser Montesquieu de côté, d'oublier qu'il y a trois puissances dans chaque État, et d'instituer un pouvoir citoyen, comme certains pays le font déjà. Bien sûr, l'institutionnalisation risque de stériliser l'apport original de la volonté citoyenne brute, non filtrée par les mécanismes institutionnels qui sont aujourd'hui contestés. Mais pourquoi ne pas tenter de faire émerger ce pouvoir citoyen, peut-être par un titre autonome dans la Constitution, en rassemblant diverses procédures que j'ai déjà évoquées – référendum, amendements citoyens, possibilités de destitution… ?
Je rejoins enfin le dernier thème évoqué par Denis Baranger : certaines constitutions étrangères prévoient un pouvoir déontologique ou un pouvoir de contrôle. Nous pourrions nous en inspirer en inscrivant par exemple dans notre Constitution la nécessité d'un financement propre et transparent de la vie politique, d'une information, de relais plus forts pour la volonté du peuple…
Ce sont là, vous le voyez, des propositions, des hésitations aussi, voire des élucubrations, mais j'avoue ne pas les regretter : je vous suis donc très redevable d'avoir mis en place ce groupe de travail et je vous renouvelle mes remerciements.
Denis Baranger et Michael Foessel ont parlé de la nécessité d'une diversification de la parole sur les institutions ; en allant dans le même sens, j'aimerais, en laissant pour le moment de côté le questionnaire que vous avez eu l'amabilité de nous faire parvenir, revenir sur ce qui fait la raison d'être de ce groupe de travail, pour mettre en avant certaines explications de la crise de confiance que nous constatons, mais aussi pour faire en sorte que notre rapport touche le plus grand nombre possible de nos concitoyens.
Je ne suis pas persuadée que nous soyons tous d'accord sur le diagnostic que nous formulons sur la crise de nos institutions – je rejoins ici le constat d'Alain-Gérard Slama. L'écriture du rapport ne sera pas une mince affaire.
Mais la raison d'être de cette commission repose bien sur le constat d'une crise de notre système politique et de ses institutions. Nous avons vu que le mot « crise » pose problème : la crise de l'éducation, la crise territoriale et la crise des partis politiques n'ont pas la même signification et ne sont pas nécessairement comparables.
Je voudrais surtout souligner que, quand on parle de « crise », on parle du ressenti de nos concitoyens, de la remise en question de leur croyance en la capacité de nos institutions à résoudre les problèmes du quotidien. Je ne prétends pas qu'il n'existe pas de dysfonctionnement dans notre machine représentative, dans nos partis politiques ou dans notre justice. Je dis simplement que la relation de cause à effet entre la mécanique interne de nos institutions et la perception que peuvent en avoir les individus – l'opinion publique – n'est pas si évidente qu'il y paraît. Notre diagnostic de crise, il faut en être conscient, fait référence à la perception qu'ont les citoyens du fonctionnement de leurs institutions plutôt qu'à leur fonctionnement réel. C'est une nuance qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas, car elle doit nous conduire à modifier la hiérarchie des variables explicatives de la défiance politique.
Si l'objectif de cette commission est de trouver des solutions pour restaurer la confiance politique, il ne faut pas uniquement réfléchir à l'amélioration du fonctionnement interne de nos institutions. Il faut également nous demander quel est le retentissement de ce fonctionnement sur le quotidien des citoyens.
En l'état, le questionnaire concerne surtout la mécanique de nos institutions politiques. Mais il me semble qu'il y a d'autres variables explicatives de ce climat de défiance politique. Preuve en est que les décideurs publics locaux sont davantage appréciés des Français que le pouvoir politique national : ce que l'on appelle en sciences politiques la « confiance du bas » et la « défiance du haut » est une constante des sondages. La proximité avec les citoyens est un facteur essentiel de la confiance politique. Améliorer cette dimension de proximité implique de déplacer en partie notre analyse : nous ne devons pas nous intéresser seulement à nos institutions juridiques et politiques, mais aussi à ces courroies de transmission institutionnelles, ces médiations qui touchent directement le quotidien des citoyens et qui sont le relais du pouvoir politique jusqu'aux espaces publics. Je pense notamment, mais pas uniquement, aux médias. En effet, le rapport entre les institutions et les publics n'est pas informé seulement par les règlements et la loi ; il l'est aussi, et peut-être d'abord, par ces médiations. Afin de ne pas négliger la complexité sociologique du problème que nous devons traiter, il me semble utile de montrer dans nos réflexions l'importance de quatre de ces médiations.
La première médiation à laquelle nous avons tous été confrontés et continuons de l'être, c'est le guichet administratif – je veux parler du travail administratif des agents qui reçoivent les usagers, traitent leurs demandes et instruisent leur dossier. C'est ce que l'on appelle en langage savant la street level bureaucracy. Ces agents sont aujourd'hui confrontés à des mutations culturelles radicales : importation des techniques du nouveau management public, culture numérique qui envahit l'ensemble des administrations et de la vie sociale… Cela rejoint nos réflexions sur les différentes temporalités de l'administration et des administrés.
Notre réflexion sur les institutions doit également, me semble-t-il, englober le rapport de nos concitoyens avec ces services administratifs en pleine mutation, car c'est à travers cette terminaison de l'action publique que nos institutions politiques sont comptables de leurs activités aux yeux des Français, qu'elles rendent des comptes à nos concitoyens.
Dans une démocratie qui serait presque idéale, où cette accountability serait présente, c'est l'individu qui est le sujet de droit. Mais pour que l'individu soit sujet de droit, encore faut-il que cette culture soit également répandue. Or on constate un écart énorme entre le droit des juristes, ce droit que l'on trouve dans les livres, et le droit que chaque individu pense avoir ou peut être amené à revendiquer. Cet écart est sans doute plus flagrant encore dans les politiques sociales, qui s'adressent à des personnes en situations de précarité sociale, économique et culturelle. Sur ce point, j'ai été très sensible aux interventions de Cécile Duflot sur le fonctionnement de la justice et la longueur de ces procédures et de Cécile Untermaier sur le problème des moyens de l'aide juridictionnelle et l'hésitation de beaucoup de nos concitoyens à recourir à la justice. Nombre d'individus, pour des raisons diverses – sociales, morales, idéologiques, culturelles –, ne se pensent pas comme sujets de droit et ne bénéficient pas des offres publiques, des droits et des services, auxquelles ils pourraient théoriquement prétendre.
Le non-recours au droit, étudié notamment par Philippe Warin, est beaucoup plus important qu'on ne le pense souvent : certaines études estiment que le coût de non-recours est supérieur à celui de la fraude sociale. Il obéit de plus à une constante sociologique : comme Pierre Joxe l'a souligné, les requérants des juridictions sociales sont pauvres, et c'est aussi le cas des non-requérants, qui sont mal informés et parfois éloignés des services sociaux ; j'ai été très sensible à son regard sociologique, à sa lecture des institutions judiciaires du point de vue du quotidien des magistrats mais aussi des usagers, des administrés. Tout cela pose la question de la mise en oeuvre de nos politiques sociales.
Notre travail sur les institutions ne doit pas faire l'économie d'une réflexion sur les marges – les non-requérants, les élèves en difficulté scolaire, les chômeurs de longue durée, certaines personnes âgées… Il doit comporter, je crois, un volet de propositions, ou tout au moins de réflexions sur les manières d'améliorer le travail administratif des agents qui sont directement en contact avec les usagers.
La deuxième médiation, dont nous avons finalement peu parlé, concerne le champ associatif.
Dans nos différentes séances, nous avons considéré d'emblée, par nécessité de clarté dans nos propos, qu'il existait une séparation relativement nette entre nos institutions politiques et la société civile. Or il me semble que les associations constituent une bizarrerie institutionnelle qui mérite notre attention en raison des intrications extraordinaires, et particulières à la France, entre les associations et les pouvoirs publics. Le gouvernement de Pierre Mauroy avait voulu, au début des années 1980, clarifier leur rôle, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait eu depuis beaucoup d'avancées… Or, il est clair que les associations peuvent être amenées à jouer un rôle d'auxiliaire, de pilote ou d'agent des politiques publiques. Les termes – courants – de para-associatif et de parapublic traduisent une lourde ambiguïté institutionnelle : on peut considérer que l'État se démembre en recourant aux institutions pour effectuer des tâches qu'il n'assure pas – c'est l'idée que l'État instituerait le social par les associations ; on peut au contraire envisager la fonction des associations comme une prise en charge de la société par elle-même, comme une forme d'action collective.
Il me semble que cette ambiguïté traduit le fait que nous sommes dans une configuration beaucoup plus osmotique où le vrai clivage ne se situe pas entre l'administration classique et les citoyens, mais entre ceux qui participent au fonctionnement de l'État – via l'administration et les associations – et les autres. Et il est vrai que la vogue participationniste ne fait qu'institutionnaliser ce phénomène. Il faudrait, je crois, nous interroger sur le périmètre de nos institutions politiques, et nous demander ce qui constitue leur essence. C'est aussi notre conception de l'éthique publique qui est ici en jeu.
La troisième médiation qui me semble importante, c'est tout ce qui relève de nos institutions de mémoire.
Nous avons connu, à partir des années 1980, une sorte d'explosion de la demande patrimoniale : les individus, les groupes sociaux ont revendiqué le respect et la reconnaissance de leur mémoire. Dans ce contexte, les travaux de Pierre Nora ont eu un retentissement important : ils ont montré qu'il pouvait y avoir conflit, désajustement, entre les mémoires plurielles et la construction d'un récit national commun dont on voit bien aujourd'hui qu'il est difficile à constituer. Je pense que cela n'est pas sans liens avec les problèmes de défiance des Français vis-à-vis de leurs élus. Comme l'a signalé Lucien Jaume, la désaffection des citoyens vis-à-vis de leurs représentants pourrait s'expliquer en partie par le fait qu'ils n'adhèrent plus à l'idée de peuple souverain ou qu'ils ne partagent pas la même acception de ce que c'est que d'être Français. On rejoint les enjeux actuels de l'interculturalité.
Il est important, je crois, d'avoir conscience que penser l'avenir des institutions consiste également à se mettre d'accord sur la façon dont on écrit leur passé, sur la façon dont nous nous raccrochons, tous, aux symboles forts de la nation. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans un moment important pour nos politiques symboliques, au regard de notre histoire institutionnelle et sociale : les attentats du mois de janvier dernier ont montré l'émergence de nouvelles constructions symboliques. C'est en de tels moments que se renégocient et se re-hiérarchisent les éléments de notre mémoire nationale. Il faut aussi, à mon sens, mentionner dans notre rapport l'importance des questions mémorielles, nationales et locales, et de leur traduction sur notre territoire – je pense par exemple aux écomusées.
La quatrième médiation qui me semble fondamentale renvoie aux politiques culturelles – au sens large, c'est-à-dire en y incluant les savoirs scientifiques.
Une société qui croit en ses institutions politiques est aussi une société qui croit au progrès par la recherche, comme à la nécessité de transmettre les connaissances. Mais aujourd'hui, de la même façon qu'il y a des mémoires plurielles, il y a très fréquemment des revendications de connaissances plurielles qui se situeraient toutes sur un même plan de légitimité. C'est une illusion, nous le savons bien ; et cela ne gêne pas en soi le fonctionnement de la société. Mais cela commence à poser problème quand il y a volonté de remettre en cause le travail des scientifiques. Il me semble que cette confusion entre ce qui relève de l'opinion et ce qui relève d'un savoir scientifique, pour reprendre les termes de Dominique Schnapper, a d'importantes conséquences pour nos institutions politiques.
Tout d'abord, formellement, il est dans le rôle des institutions de réaffirmer la nécessité d'un débat public sur les choix de société et de sauvegarder la connaissance scientifique, compte tenu des enjeux que cela comporte en termes de développement social et économique.
De plus, cette confusion entre savoir et opinion pose un problème plus profond qui est le propre de la mouvance postmoderne. On ne sait plus rendre désirable l'idée de futur et l'on souhaiterait confier à nos institutions politiques la gestion de nos sociétés sur un horizon prédictif de plus en plus long – ce qui est scientifiquement impossible. Ce que nous devrions demander à nos institutions, ce n'est pas de se lancer dans la futurologie, mais d'être réactives quand il le faut et ne pas prétendre maîtriser les événements quand cela n'est pas possible. L'entrée des sciences dans la démocratie ne doit pas remettre en cause l'esprit des Lumières, mais il ne faut pas non plus que l'État soit le seul garant de l'orthodoxie culturelle : c'est là, j'en ai bien conscience, un équilibre difficile à atteindre, mais essentiel pour notre confiance dans nos institutions politiques.
En mettant en avant ces éléments de sociologie politique, de façon peut-être un peu décalée par rapport à vos attentes, j'ai voulu prévenir le travers d'une vision trop fonctionnaliste des institutions politiques, qui ferait de la mécanique interne des institutions le seul paramètre expliquant la défiance des citoyens vis-à-vis de nos hommes et de nos institutions politiques. Notre rapport final pourrait utilement, je crois, comporter un volet de réflexions sur ces médiations sociologiques que je viens de décrire ; il constituerait ainsi la préface de réflexions à venir sur les interactions diverses, multiples et variées entre les citoyens et leurs institutions politiques.

Je commence par vous remercier, monsieur le président, de votre travail d'organisation de cette commission. La réflexion menée a été quelque peu iconoclaste, et il faut s'en féliciter : associer parlementaires et experts, en allégeant la présence des constitutionnalistes, fait toute l'originalité de la démarche. Notre président historien fait l'unanimité par ses analyses toujours pertinentes.
S'agissant de nos institutions, je me demande pourquoi il fallait débattre des changements à leur apporter avant d'en avoir conduit une évaluation attentive, au besoin comparative. Une évaluation des réformes déjà menées à bien aurait également été utile.
Les institutions de la Cinquième ont été pensées par le général de Gaulle, dans le détail, à la lumière de sa vie au coeur de l'histoire de France en ce siècle terrible qu'a été le XXe siècle. En un sens, il les incarne encore. Ces institutions ont prouvé leur qualité, leur efficacité ; elles ont apporté à notre pays, pour la première fois de son histoire républicaine, la stabilité gouvernementale.
Ces institutions ont été bâties pour donner les moyens d'agir à une volonté politique incarnée par le pouvoir exécutif soutenu par le peuple ; à l'inverse, il faut se souvenir des institutions de la Troisième et de la Quatrième République, dessinées pour limiter, voire empêcher l'action du pouvoir exécutif, et de leurs résultats. Le chef de l'État, élu par le peuple, directement, incarne la volonté politique, fixe le cap et donne le rythme de la politique que le Premier ministre, chef du Gouvernement, décline en s'appuyant sur une majorité cohérente et homogène à l'Assemblée nationale, grâce au scrutin majoritaire à deux tours.
L'élection présidentielle réussit encore à rassembler près de 80 % des Français inscrits sur les listes électorales : cela nous montre l'attachement que nos concitoyens continuent, contre toute attente, de manifester à cette expression démocratique.
La Cinquième République est solide, et c'est ce que nous devons préserver. Mais, si elles sont solides, nos institutions sont aussi suffisamment souples pour s'adapter aux circonstances, aux hommes et aux femmes, sans que ne soient remis en cause les grands équilibres de notre régime. Ces institutions n'ont-elles pas permis à la France de surmonter la guerre d'Algérie et la crise de Mai 68 ? Ne se sont-elles pas adaptées sans heurt à l'alternance des majorités comme à la cohabitation ?
Nous ne devons donc envisager qu'avec prudence l'introduction dans la Constitution de dispositions qui la rendraient plus rigide, et qui créeraient des situations de blocage insurmontables, comme la France en a hélas jadis déjà connu. On peut toujours concevoir des mécanismes parfaits, au moins sur le papier ; on peut toujours, et il le faut, imaginer des améliorations. Mais on ne peut ignorer la part déterminante de la pratique et du caractère des acteurs qui font vivre les institutions, c'est-à-dire des élus.
Nous avons réformé de façon importante nos institutions à plusieurs reprises, et en particulier en 2008 – il y a sept ans déjà. Avons-nous pour autant utilisé toutes les possibilités offertes par cette réforme ? Je n'en suis pas sûr.
Beaucoup de parlementaires – dont l'actuel Premier ministre – voulaient, en 2008, supprimer l'alinéa 3 de l'article 49 de notre Constitution. Mais le Gouvernement doit disposer d'un moyen de répondre rapidement aux mutations du monde et à leurs conséquences pour notre pays.
Nos institutions reposent notamment sur le couple formé par le Président de la République et le Premier ministre. Au cours du quinquennat de François Hollande, nous avons tous vu que les rapports que le Président de la République entretenait avec Jean-Marc Ayrault n'étaient pas les mêmes que ceux qu'il entretient aujourd'hui avec Manuel Valls. C'est une souplesse remarquable de nos institutions ; mais c'est aussi la preuve que la personnalité, le caractère des acteurs comptent énormément dans la vie de nos institutions.
Guy Carcassonne décrivait la Cinquième République comme un « régime parlementaire à forte domination présidentielle » : c'est bien de ce régime que je reste un fervent partisan, car c'est sans doute la seule manière de faire fonctionner dans notre pays un régime parlementaire de façon à la fois efficace et équilibrée. « L'hyperprésidence », comme la « présidence normale », sont surtout des formules qui décrivent mal des réalités institutionnelles infiniment plus complexes, où les personnes jouent le rôle essentiel.
Il ne faut donc pas toucher, à mon sens, aux dispositions constitutionnelles qui concernent le Président de la République – je pense notamment à la présidence du Conseil des ministres et au droit de dissolution. Le quinquennat, imposé en l'an 2000 – quelques-uns d'entre nous en ont été les témoins – par Lionel Jospin et Valéry Giscard d'Estaing, a bouleversé certains équilibres institutionnels. Il me paraît difficile, mais souhaitable, de revenir sur ce point.
D'une façon plus générale, j'insiste sur la nécessaire évaluation des réformes institutionnelles. Je me range à l'avis de ceux qui considèrent que l'arrivée des primaires dans notre fonctionnement démocratique relève de la Constitution : mais son article 4 dispose déjà que « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, [qu'ils] se forment et exercent leur activité librement [et qu'ils] doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».
Certains proposent de combiner la réduction des prérogatives du Président de la République avec un recours accru à des mécanismes de rationalisation, afin de garantir la stabilité gouvernementale. Je ne suis pas certain que les résultats de telles réformes seraient différents de ce que l'on a constaté sous la Quatrième République, même si le système des partis a changé. Celui-ci doit être pris en considération, avec ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater une dérive de la vie politique vers une professionnalisation qui est sans doute la principale cause de l'abîme dramatique qui s'ouvre sous nos yeux entre le peuple et ses élus.
Chacun voit bien que le système politique français entre dans une ère de tripartisme, où son fonctionnement pourrait devenir erratique, où toutes les combinaisons deviennent possibles. La présence d'une troisième force a souvent, sous la IIIe comme sous la IVe Républiques, été à l'origine de grandes confusions, d'un immobilisme, d'une instabilité ministérielle, voire d'une confiscation du choix des électeurs par les appareils partisans. Le caractère démocratique des institutions gaulliennes, c'est-à-dire la désignation par le peuple des responsables chargés de l'essentiel, soutenus par une majorité cohérente et pérenne, mais aussi la légitimité incontestable que ces institutions confèrent à ceux qui veulent réformer le pays ainsi que leur capacité à affronter les crises constituent des atouts considérables pour notre pays. Elles contribueront à nous protéger des effets les plus néfastes de cette division tripolaire.
Au moment où notre système politique est en proie à des turbulences fortes, nous ne croyons pas qu'il faille remettre en cause l'équilibre de nos institutions – équilibre dans lequel le mode de scrutin majoritaire joue un rôle déterminant. Je suis donc opposé à toute introduction, partielle ou totale, du scrutin proportionnel pour élire les députés. Le scrutin majoritaire limite raisonnablement le rôle des partis charnières – on sait que la présence de ceux-ci conduit souvent à des compromis politiciens et électoraux.
C'est sur la modernisation du Parlement que nous pourrions utilement, à mon sens, dégager des propositions de réforme consensuelles, notamment sur la procédure législative. Il faut limiter la prolifération des normes, et leur instabilité ; en particulier, des dispositions de nature réglementaire sont trop souvent inscrites dans nos lois. Nous devrions réformer les études d'impact, aujourd'hui cruellement insuffisantes, mais aussi réfléchir à l'évaluation et au contrôle des politiques publiques – notamment en tirant les leçons de la réforme de 2008, et en utilisant vraiment les possibilités que celle-ci nous offre, ce qui n'est pas, tant s'en faut, le cas aujourd'hui.
En toutes choses, l'échec conduit bien souvent à remettre en cause les règles du jeu plutôt que les acteurs. C'est ainsi que j'analyse la situation difficile dans laquelle se trouve notre pays.

Monsieur Accoyer, vous ne faites ici que répéter ce que vous aviez déjà dit lors de notre deuxième réunion : selon vous, il ne faut rien changer. Nous avons pourtant mené des auditions nombreuses, intéressantes, sur la question des partis, du scrutin… et les débats ont été nourris. Votre conclusion est pourtant demeurée strictement identique : le problème, ce sont les acteurs, ce n'est pas la machine.
Je vous rejoins sur certains points, par exemple la professionnalisation, que vous regrettez ici tout en étant élu depuis 1989 ! Il est difficile d'affronter nos propres contradictions, mais c'est, je crois, l'exercice auquel nous devons nous livrer ici. J'ai pour ma part évolué, sur la question de la proportionnelle par exemple.
Sur le fait que seuls les acteurs comptent et que les institutions n'ont aucune part dans les crises, vous avez tort. J'ai été à la tête, vous le savez, d'un parti politique qui voulait opérer une synthèse plutôt intéressante entre des gens issus pour beaucoup de l'extrême gauche et des statuts d'essence presque libertaire, où en particulier la proportionnelle tenait une grande place. Mais ces statuts créaient un intérêt objectif à présenter une motion supplémentaire, puisque cela permettait mécaniquement de disposer de plus d'élus : il y avait une prime à la division, statutairement organisée, même si elle n'était pas pensée pour cela… L'idée des écologistes était de représenter toutes les sensibilités politiques du parti, mais le résultat était bien qu'avec 3 %, 4 %, 5 % des voix, on pouvait obtenir un poste dans les organes de direction ; certains militants plutôt issus de l'extrême gauche n'ont pas manqué de s'en apercevoir.
Nous avions aussi quatre porte-parole, qui représentaient les différentes sensibilités : certains – qui appartenaient à l'opposition interne – pouvaient ainsi tenir des conférences de presse au siège même du mouvement pour s'opposer à des prises de position du secrétariat national ! Ce n'est pas là un problème de personnalité ; c'est un problème d'organisation. Dès lors que nous nous sommes organisés pour donner une prime au regroupement – même si nous demeurons des adeptes et des pratiquants de la proportionnelle – et pour avoir une expression publique plus unitaire, nous avons résolu bien des problèmes. Je suis donc très profondément en désaccord avec l'idée que seuls les hommes comptent.
Vous l'avez dit, très poliment, je vous l'accorde, mais vous l'avez dit : la différence entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, c'est que l'un a suffisamment de caractère pour s'opposer au Président de la République quand l'autre était tout mou.

Je ne dis pas que vous l'ayez dit de cette manière, mais c'est en gros ce que vous avez dit – et d'ailleurs, vous n'avez pas tort ! Le caractère des individus les conduit, en effet, à occuper les responsabilités de façon différente. Considérons la façon dont l'article 49, alinéa 3, a été utilisé tout récemment. Certains, peut-être parce qu'ils ont été parlementaires pendant de longues années, n'auraient pas pu regarder les députés dans les yeux en expliquant qu'il n'y aurait pas de débat, que même ni le rapporteur ni le président de la commission spéciale ne pourraient s'exprimer, et hop, emballez c'est pesé ! Le caractère de certains, voire leurs convictions, les empêcheraient d'agir de la sorte ; d'autres pas. Vous avez donc raison sur ce point.
Mais c'est précisément pour cela que nous avons des institutions, qui prévoient des garde-fous, qui empêchent que certaines capacités politiques de certains individus ne soient mises en oeuvre. Le rôle des institutions est bien d'établir des contentions démocratiques.
Refuser de les faire évoluer en renvoyant tout au caractère et à la manière d'exercer les responsabilités me paraît une erreur profonde. Nous devons, je l'ai déjà dit, cesser de nous mentir sur l'usure de nos institutions : si nous croyons qu'il suffit de changer les hommes, nous allons au-devant de graves problèmes. Cela a été dit tout à l'heure : une explosion peut venir beaucoup plus vite que prévu. On pousse le système jusqu'à l'extrême, et on se dit que ça tient – vous parliez de la solidité de la Cinquième République, monsieur Accoyer. Eh bien, oui, mais un chêne est solide jusqu'à ce qu'il casse…
Nous avons atteint, je crois, les limites de nos institutions ; n'attendons pas que notre système politique se brise, car nous ne savons pas ce qui pourrait alors se passer. Il y a dix ans à peine, lors des émeutes de 2005, nous avons vu utiliser des dispositions certes constitutionnelles, mais qui se situent aux limites de la démocratie : il n'est en rien impossible qu'une telle situation se reproduise. On parlera alors de causes sociales et de toutes sortes de choses ; mais nul n'osera dire que nous avons poussé nos institutions, et l'absence de représentation d'une authentique diversité sociale qu'elles organisent, jusqu'à leur terme.
Sur les failles de notre représentation, sur la monarchie républicaine qui serait une sorte de manifestation de fidélité à une histoire de France, sur une forme d'aristocratie, ou de caste si l'on veut employer un mot plus violent… nos débats ont été vraiment intéressants. J'ai notamment été très sensible à la phrase de Mme Viviane Reding citée par Mme Antoni : « Je n'aime pas les quotas, mais j'aime ce qu'ils font. » Il faut au moins en retenir qu'il existe aujourd'hui une rupture profonde entre ceux qui ont le sentiment d'exercer légitimement les responsabilités et ceux qui ont le sentiment d'en être définitivement exclus.
J'espère que notre rapport ne sera pas un rendez-vous manqué : si nous ne posons pas ces questions ouvertement, elles risquent de l'être par d'autres, et autrement plus brutalement.

Sans vouloir jeter de l'huile sur le feu qu'a soigneusement entretenu Cécile Duflot, je voudrais préciser que j'entends par professionnalisation la domination progressive de la vie politique française par des élus qui n'ont jamais travaillé que dans des appareils politiques, qui sont entrés dans la vie politique sans avoir vécu préalablement, ou même simultanément, hors de la vie politique – c'est-à-dire dans la vraie vie.
Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls sont deux Premiers ministres de la France et méritent, à ce titre, notre respect. Vous avez donné une interprétation de mes propos qui vous appartient ; c'est une interprétation politique, expression de vos propres positions à l'égard des politiques différentes qu'ils ont conduites ou qu'ils conduisent.
Je maintiens ce que j'ai dit sur nos institutions : elles sont précieuses, et leur solidité fait la force de la France.

Avant de suspendre nos travaux pour quelques minutes, je rappelle que nous nous étions interrogés, au cours de nos premières réunions, sur l'état de nos institutions. Si nous avions retenu l'idée qu'il n'y avait rien à changer, nous aurions sans doute trouvé d'autres occupations pour nos vendredis…
Je me félicite d'avoir fait appel à Michel Winock : je partage en effet l'idée exprimée à plusieurs reprises que notre commission ne peut pas proposer seulement des réformes techniques. Notre réflexion relève de la philosophie politique.
Les institutions de la Cinquième République n'ont plus rien à voir avec celles de 1958, comme d'ailleurs notre pays n'a plus rien à voir avec celui de 1958. Je me réjouis que le général de Gaulle ait pu trouver un système qui a apporté de la stabilité à une France qui en avait bien besoin. Mais le contexte a changé, et nos institutions ont d'ailleurs été modifiées vingt-huit fois depuis le début de la Cinquième République : taillées sur mesure pour le général de Gaulle dans un pays terriblement centralisé, elles doivent aujourd'hui servir à un pays désormais décentralisé. Nous appartenons à l'Union européenne, notre monnaie est l'euro – ce qui n'est pas sans conséquences.
Quelle règle commune aujourd'hui pour lier ensemble nos compatriotes, pour faire société ? C'est la question qui nous est posée. Je me souviens d'échanges sur la meilleure façon d'arriver à une décision qui peut être acceptée par tous – je pense par exemple à l'aéroport de Notre-Dame des Landes, ou au débat public sur l'enfouissement des déchets. C'est sur ce point que j'aimerais que nos discussions se prolongent après la pause.
Mais j'apprends à l'instant qu'un attentat de DAECH aurait eu lieu à Saint-Quentin-Fallavier ; un homme aurait été décapité. Je vous propose de suspendre la séance.
Suspendue à onze heures dix, la séance est reprise à onze heures vingt-cinq.
Les propos de M. Accoyer, laissant entendre que la seule raison d'être de notre commission serait de rendre hommage aux institutions de la Cinquième République, m'ont quelque peu interpellée. Nous sommes tous conscients de la stabilité que la Constitution de 1958 a offerte à notre pays, mais nous avons en quelque sorte la chance de ne pas être réunis pour rédiger un nouveau texte. Que notre rapport dise comment il conviendrait d'aménager la Constitution ou qu'il appelle à entrer dans une Sixième République, nous pouvons faire preuve d'audace puisque c'est sous la plume d'une commission ultérieure que nos propositions fleuriront ou ne fleuriront pas.
J'appelle donc à l'audace : elle est indispensable pour trouver une réponse à la défiance à l'égard des politiques – dont le niveau a atteint un niveau extrêmement grave pour l'équilibre de notre pays – et des juges. À ce sujet, plusieurs d'entre nous pensent qu'il faut passer d'une autorité judiciaire à un pouvoir judiciaire auquel on donnerait les moyens nécessaires pour appliquer le droit dans des conditions normales – par ces mots, j'entends dire que faciliter l'accès au droit et aux droits fondamentaux est d'une importance capitale.
Il est tout aussi nécessaire, pour redonner confiance dans les institutions, que nous manifestions le respect que nous portons à la société civile et donc à ses relais, les associations et les organisations non gouvernementales (ONG), sans lesquelles aucune politique publique ne peut être appliquée. J'ai pris toute la mesure, en présidant la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), de ce que, sans les associations, petites et grandes, nationales et internationales, les politiques sont extrêmement dépourvus, qu'il s'agisse du droit des étrangers, du droit d'asile, de la situation des détenus, de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, de la lutte contre la traite des êtres humains ou d'une autre protection de l'environnement. Or les associations sont dans une pauvreté presque égale à celle des personnes dont elles doivent s'occuper. La réduction des subventions qui leur est versée est dramatique. Il nous faudra dire qu'aussi bien pensées, rédigées et soutenues politiquement soient les politiques publiques, s'il n'y a pas d'acteurs pour les décliner, c'est comme si elles n'existaient pas. Je le constate dans quantité de domaines, et singulièrement en matière de droit d'asile, la question la plus sensible ces jours-ci.
Vous appelez de vos voeux, monsieur Tusseau, une politique de quotas ; j'aimerais vous entendre préciser comment vous les détermineriez car je ne comprends pas comment fonder une meilleure représentativité par ce moyen. Les quotas seraient-ils établis sur une base fiscale, en distinguant les citoyens selon leur avis d'impôt ? Le seraient-ils sur une base religieuse, sur production d'un certificat de baptême ou de circoncision ? Serait-ce en fonction de la couleur de la peau, dont les nuances sont multiples et graduées ? Plus sérieusement, comment faudrait-il procéder ?
Comme vous, monsieur Accoyer, je considère comme un risque grave la professionnalisation de la vie politique, qui provoque pour partie la désaffection du public pour la chose politique. Mais n'y a-t-il pas alors quelque contradiction à appuyer le principe du scrutin majoritaire ? J'ai le sentiment que, les candidats étant désignés par les partis, ce mode de scrutin entretient et facilite la professionnalisation que vous réprouvez.
Je n'en disconviens pas, ma proposition était imprécise. Revenant sur une culture de la représentation longue de deux siècles, elle bouscule la pensée, mais elle a deux intérêts. Le premier, indispensable, est de faire figurer plus visiblement la diversité sociologique, économique, religieuse, culturelle, d'origine ethnique de notre pays dans l'institution qui prétend représenter les Français. Dans le contexte actuel de désaffectation à l'égard du politique, le « désenclavement » des élites élues, coupées de la population au nom de laquelle elles sont susceptibles de parler, est urgent. Et, outre qu'ils permettent une représentation descriptive qui assure la confiance et la restauration d'un lien, les quotas sont utiles à la qualité épistémique des décisions : plus variées sont les voix qui participent à une discussion, plus éclairée est la décision prise et plus facile son application. J'en vois une illustration dans la composition de la commission qui nous rassemble : parce que l'on a pris soin de faire s'exprimer des points de vue divers, le rapport sera beaucoup plus intéressant que si l'on s'était limité à faire siéger seuls vingt parlementaires, vingt constitutionnalistes ou vingt représentants de la société civile. Certains travaux portant sur la sociologie de la décision, en particulier l'ouvrage de Scott Page, The Difference, sont extrêmement convaincants à ce sujet. Si on laisse faire de manière neutre, rien ne bougera. Aussi, l'introduction de quotas, hypothèse qui peut sembler répulsive, mérite d'être expérimentée car, je le répète, il y a urgence puisque certaines voix ne sont pas entendues, soient qu'elles soient exclus du débat politique, soient qu'elles s'en auto-excluent.
Quels critères retenir pour assurer la représentativité ? Notre droit réprouve les statistiques ethniques, auxquelles je suis assez hostile. Mais est-il si difficile d'imaginer que des personnes représentant une religion soient membres ès qualités d'une assemblée parlementaire ? Peut-être pas membres de l'Assemblée nationale, dont on peut concevoir qu'elle doit rester élue par l'ensemble de la population. Mais pourquoi dix sénateurs représentant les catholiques, dix autres les protestants, dix les juifs, dix les musulmans, dix les bouddhistes, ne siégeraient-ils pas au Sénat réformé, si l'on décide de le conserver ? Même si la proposition paraît farfelue ou contestable, le sujet me paraît mériter d'être discuté.
Est-il si sorcier de concevoir un quota de personnes qui seraient sénateurs parce que leur âge est compris entre 18 et 25 ans ? On a objecté à cela qu'il n'était pas besoin d'instaurer un tel quota puisque nous avons tous été jeunes. Permettez-moi d'observer que je n'ai jamais été un jeune d'aujourd'hui, né à l'époque des Facebook, Twitter et iPad triomphants, que je n'ai jamais été le jeune homme qui, avec ses contemporains, se pose maintenant les questions de son temps. Ceux-là méritent de participer aux institutions politiques. S'ils s'en sentent exclus, si le processus politique ne les inclut pas naturellement alors que le temps long est aussi leur affaire, il me semble nécessaire, pour que leur voix soit entendue, de forcer les choses pour imposer dix, vingt ou trente sénateurs dont la seule originalité est la jeunesse ; cela mériterait d'être expérimenté.
La nomenclature de l'INSEE permettrait de pourvoir à la représentation des professions, et l'on pourrait ainsi garantir des quotas d'employés, d'ouvriers, de membres des professions libérales, d'entrepreneurs ou de fonctionnaires dans le Conseil économique, social et environnemental réformé. L'obstacle n'est pas technique mais de principe : maintient-on la conception, à laquelle je suis aussi très attaché, de l'adunation sieyèsienne issue de la Révolution française ou, étant donné la crise de l'intermédiation politique, expérimente-t-on le temps d'un quinquennat, pour resserrer le lien distendu entre la politique et la population, un système de quotas dont on évalue les effets ? Si l'on n'avait pas procédé de la sorte pour imposer la parité en politique…
Je n'en suis pas certain ; c'est en tout cas de l'ordre de la représentation politique de catégories de la population qui ne le sont pas à leur juste titre. Je ne pense pas vous avoir convaincus, mais je vous remercie de m'avoir permis de clarifier ma réflexion.

Mon expérience de dix années à l'Observatoire de la parité et à la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes me pousse à demander vigoureusement que l'on s'abstienne de faire référence à la parité, sujet en soi, pour défendre l'introduction d'une politique de quotas. Une femme peut être commerçante, kinésithérapeute, jeune… La parité ne doit pas, si je puis dire, se dissoudre dans d'éventuels quotas visant à améliorer la représentation de la diversité. J'ai défendu le principe d'une proportion obligatoire de femmes parce que les statistiques de l'Observatoire de la parité établissaient que les femmes, qui constituent 52 % de la population en France, n'étaient pas justement représentées dans les instances de pouvoir. La parité est un très long combat. Alors que, le 28 juin 1999, le Congrès réuni à Versailles allait adopter le projet de loi constitutionnelle relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, j'avais dit au Premier ministre de l'époque que je m'exprimerais sans réserves en faveur de l'abrogation du texte le jour où la représentation des femmes serait juste ; c'est manifestement à l'un de mes arrière-petits-enfants qu'il reviendra de prononcer ce discours ! Je suis lasse d'entendre les partisans d'une politique générale de quotas la justifier en permanence par l'argument de la parité et je souhaite que le rapport de notre commission établisse la nette distinction qui s'impose.
Je suis un grand lecteur et un grand admirateur des rapports de l'Observatoire de la parité, que j'ai consultés à l'occasion d'une recherche sur la discrimination positive en faveur des femmes en matière politique. Je suis beaucoup plus féministe que nombre de femmes. Mais outre que le mouvement féministe n'a rien d'unitaire, vous semblez faire primer le sexe sur le genre, ce qui n'est pas parfaitement justifié. Alors que l'Australie, l'Inde et Tahiti reconnaissent l'existence d'un troisième genre, accorder la primauté au sexe pour être représenté en cette qualité mérite une argumentation beaucoup plus poussée que celle qui consiste à dire que les femmes représentent 52 % de la population, puisque c'est faire l'impasse sur les transsexuels, les transgenres, les hermaphrodites et les personnes du troisième genre. On peut légitimement considérer que la population de France est composée de femmes et d'hommes en proportion équivalente, et de quelques pour cent de personnes d'autres catégories. La primauté, sur le plan éthique, de cette distinction purement biologique qui n'est pas aussi binaire qu'on le prétend, doit donc être étayée, ce qui ne me semble ni plus facile ni plus difficile que pour les catégories que l'on peut évoquer par ailleurs.

Avant que l'on en arrive, dans un avenir plus ou moins lointain, à définir des quotas en fonction des génomes, je souhaite apaiser les craintes de M. Tusseau en rappelant qu'aux termes de l'article 4 de la Constitution les partis politiques organisent la vie démocratique et la représentation du peuple dans sa diversité. N'inscrivons pas dans la Constitution des dispositions qui transformeraient la République en un système communautariste.
La professionnalisation de la vie politique pose un problème majeur, méconnu par ceux qui en sont l'incarnation. Parfois, au contraire, elle est revendiquée : « La politique est un métier » disent certains acteurs politiques, et non des moindres, qui creusent ainsi le fossé entre les élus nationaux et le peuple. Non, monsieur Winock, le scrutin majoritaire n'est pas l'un des moteurs de la professionnalisation de la vie politique ; c'est l'inverse. Certes, le scrutin majoritaire requiert l'intervention d'un parti politique quand il y a investiture, mais dans le cas du scrutin uninominal, on peut se présenter à l'élection sans avoir été investi et les candidatures spontanées de personnes sans étiquette sont nombreuses ; il faut cependant reconnaître qu'elles aboutissent rarement à l'élection des parlementaires – sauf au Sénat. Au contraire, dans le cas d'un scrutin proportionnel, c'est le parti politique qui décide qui sera nommé, puisqu'est certain d'être élu qui est placé en tête de liste. Ce mode de scrutin favorise effectivement la professionnalisation de la vie politique, car dans un parti, communauté humaine comme une autre, on a plutôt tendance à accompagner dans la progression de leur parcours politique des collègues et des collaborateurs, parce que l'on sait ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont faire – et parce que l'on croit qu'ils vous seront fidèles… En réalité, la question qui peut se poser pour le scrutin majoritaire est celle de l'impact du non-cumul des mandats ; c'est pourquoi, minoritaire en cela dans ma famille politique, je considère que le terme qui sera mis au cumul d'un mandat exécutif dans une collectivité locale et d'un mandat parlementaire va dans le bon sens.
Je ne veux en effet rien changer du coeur de nos institutions, de ce qui fait leur solidité. En revanche, je pense qu'il faut évaluer les pratiques gouvernementales, celles des parlementaires et celles des collectivités locales, mesurer les effets de nos spécificités constitutionnelles avant de les remettre en cause, et évaluer aussi les réformes constitutionnelles – au premier rang desquelles le principe de précaution, qui n'a jamais été véritablement évalué alors qu'il a été instauré de manière inconséquente, sans qu'une loi organique en ait fixé le cadre, avec les conséquences que l'on sait.
Nous devons également envisager de réformer notre mécanisme d'élaboration de la loi et de fixation de l'ordre du jour du Parlement. Moins légiférer est une priorité ; contrôler davantage et stabiliser les normes est impératif. Je considère aussi qu'il faut revoir le dispositif des études d'impact : il est anormal qu'elles ne soient exigées ni pour les propositions de loi, ni pour les amendements parlementaires et ni pour ceux du Gouvernement. À ce sujet, depuis que les textes examinés en séance publique sont ceux qui sont issus des commissions, le Gouvernement dépose des amendements de deux sortes : les amendements « normaux » par lesquels il tente de rétablir son texte, et des amendements manoeuvriers de trois pages glissés à l'entrée en séance. Ce dernier procédé, exécrable, ne permet pas un travail législatif sérieux ; nous devons évidemment revoir ce dispositif.
Le nombre de parlementaires pose des problèmes croissants, que la fin du cumul des mandats rendra plus évidents encore ; un consensus se dessine à ce sujet. Le pays souffre de la prolifération et de l'instabilité des normes. La place du Comité d'évaluation et de contrôle (CEC) de l'Assemblée nationale créé par la réforme de 2008 mérite d'être amplifiée ; j'avais contribué à la prise en compte des avis des citoyens exprimés par le biais de l'Internet et je me félicite que le président Bartolone se penche actuellement sur la question – c'est une nécessité. Enfin, la réglementation communautaire encadre et limite notre capacité à légiférer sur le plan national et les citoyens ne comprennent pas cette situation ; le Parlement doit aussi travailler à combler le fossé qui s'est creusé entre de nombreux citoyens et l'Union européenne.
Mes félicitations vont aux auteurs de l'excellent questionnaire qui nous a été adressé ; il fournit une bonne base de travail pour l'élaboration du rapport. On pourrait y insérer quelques questions techniques supplémentaires : l'évaluation de la révision constitutionnelle de 2008 et en particulier de la nouvelle rédaction de l'article 25, et celle de la session unique. En revanche, nous ne pouvons nous prononcer sur l'hypothèse de rendre obligatoire l'adhésion à un syndicat ; une telle disposition serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.
J'en viens au rapport et à sa tonalité. Il y a entre nous des incompréhensions. En cette époque marquée par l'individualisme et l'instantanéité, certains paraissent avoir perdu la foi dans les institutions et le sentiment collectif ; ce n'est pas mon cas. D'autres, et c'est plus inquiétant, semblent avoir perdu la foi en la démocratie représentative. Les quotas, certes, mais par ses questions à dessein perverses, le président Winock a fait mouche ; je rappelle que le rapport du comité Veil sur la réforme du préambule de la Constitution avait eu des conclusions définitives à ce sujet. Il faut vraiment prendre garde : comme M. Slama et M. Accoyer l'ont dit chacun à sa manière, la France est une nation fragile ; il ne faut pas la bousculer encore. L'universalisme républicain repose peut-être sur un mythe, mais ce mythe est nécessaire. Je veux demeurer aveugle, et je veux surtout que la République continue de demeurer aveugle aux couleurs de peau et aux certificats de baptême. Parce que je crois encore à la démocratie représentative, l'idée de quotas suscite en moi la plus grande défiance ; je précise que pour moi la parité n'est pas du même registre. Voilà ce qui explique ma réticence devant la démocratie participative : autant je perçois l'utilité des ateliers législatifs citoyens, autant j'exprime les plus vives réserves à l'idée d'« amendements citoyens ».
Je suis fermement convaincu que le processus d'institutionnalisation est un progrès démocratique et que tout ce qui irait vers la personnalisation de la vie politique serait une régression. La « tradition monarchique » à laquelle M. Slama a fait allusion est un mal, un vice fondamental de notre société. Une République moderne doit tendre vers l'objectif d'une plus grande institutionnalisation et se défier du « mal napoléonien », pour reprendre le titre d'un ouvrage récent. Je n'accorde aucun crédit à la tradition césariste, qui doit être définitivement extirpée de nos consciences : il est temps de nous affranchir définitivement de la mauvaise conscience due à ce que nous avons raccourci notre monarque.
Faut-il une réforme radicale ou ne faut-il pas de réforme du tout ? J'ai le sentiment qu'une ambiguïté demeure entre nous à ce sujet ; un accord général devra pourtant apparaître dans le rapport sur ce point. Il est remarquable que notre commission soit coprésidée par le président de l'Assemblée nationale – ce n'avait pas été le cas des commissions Balladur, Jospin ou Vedel – et par un historien. Ce choix donne à nos travaux une tonalité différente, celle du temps long. Il conviendra d'établir avec soin dans le rapport ce dont nous voulons accoucher, tout en prenant garde. Je ne sais s'il y a urgence à proposer des réformes constitutionnelles radicales. Peut-être ; mais nous sommes pris entre deux écueils. D'une part, une commission sur l'avenir des institutions ne peut décevoir en ne proposant rien : elle signifierait qu'il n'est pas d'avenir. Rappelons-nous les mots terribles de Georges Bernanos : « La réforme des institutions vient trop tard, quand le coeur des peuples est brisé. » D'autre part, nous ne saurions ni proposer des réformes anecdotiques, ni jouer les apprentis sorciers. Je comprends les inquiétudes de M. Accoyer : oui, la Constitution de 1958 a apporté des éléments de stabilité et elle a, à un moment, sauvé la République – mais on peut se demander si elle ne l'a pas, ensuite, entraînée par le fond.
Je reviens aux premières questions de l'excellent questionnaire qui nous a été adressé. Il y a fort à parier en effet que si notre rapport contient des propositions relatives à la réforme du pouvoir présidentiel, ce sont celles que retiendront les média. Certains cénacles, on le sait, considèrent la Quatrième République comme l'horreur absolue. Puis-je faire observer qu'elle a accompagné l'essor des Trente Glorieuses ? Sur le fond, avancer que système parlementaire est synonyme d'instabilité politique fait s'exposer à être démenti par l'observation des systèmes parlementaires européens en vigueur, par exemple en Allemagne, dont le modèle est vanté sur bien des plans.
M. Slama a évoqué la désacralisation et la dé-légitimation de la fonction présidentielle. La désacralisation a été entérinée par l'instauration du quinquennat : le président de la République, contraint d'adapter son calendrier au temps politique et médiatique, ne peut plus occuper la fonction d'arbitre qui lui était précédemment assignée. M. Accoyer faisait valoir que ce ne sont pas les institutions qui sont mises en cause par l'évolution négative du système politique en France, mais le caractère de ceux qui les incarnent ; nous pouvons en être d'accord, mais le but premier des institutions n'est-il pas de nous protéger des manifestations caractérielles de nos dirigeants ? Des institutions qui non seulement ne nous en protègent plus, mais qui sélectionnent tendanciellement les caractères les plus autoritaires, sont démocratiquement condamnées.
La fonction présidentielle est également délégitimée. Il est frappant de constater que rien n'est durable en politique sinon l'impopularité, irréversible, des présidents de la République après deux mois de pouvoir. Au-delà du caractère des hommes, il y a à cela une raison structurelle. C'est que la conception de la Cinquième République est liée à un moment où le politique gère le monde. C'est le fameux : « L'intendance suivra » – entendez par là : « L'économie suivra ». Or l'économie ne suit plus, elle dirige. Nul n'aurait imaginé Charles de Gaulle allant négocier des contrats au Moyen-Orient ou en d'autres contrées pour sauver l'emploi ! Le politique ayant perdu sa sacralité, que reste-t-il au Président de la République ? L'irresponsabilité juridique.
On retrouve dans l'actualité certains problèmes institutionnels. J'ai été frappé que, le jour même où l'on se scandalise que le président de la République ait été espionné par des services étrangers, on vote une loi instituant la surveillance généralisée des citoyens, au motif d'« empêcher les attentats ». Comme M. Accoyer, je pense nécessaire d'évaluer les lois et je serais tout à fait favorable à l'évaluation des nombreuses lois sécuritaires votées depuis une quinzaine d'années, pour mettre en parallèle le nombre d'attentats qu'elles ont supposément empêchés et les atteintes bien réelles aux libertés individuelles qu'elles ont permises.
Pour sauver la fonction présidentielle, si tant est que cela soit nécessaire, il faut limiter drastiquement les prérogatives du président de la République, pour des questions de droit mais aussi parce que la fonction présidentielle, telle que la met en scène la Constitution de la Cinquième République, est devenue, étant donné le fonctionnement réel de la démocratie, un instrument qui rend mythiques les prérogatives politiques. La déception, sinon l'amertume et la colère profonde de l'opinion publique à l'égard du Président de la République, quel qu'il soit et quelle que soit son orientation politique, ne s'explique que par le décalage devenu structurel entre ce qu'il promet – et que sa fonction est censée garantir qu'il pourra faire – et ce qu'il peut faire une fois au pouvoir, lorsqu'il se rend compte que, malgré toute sa volonté, l'intendance ne suit pas.

« Je veux que la République reste aveugle aux couleurs de peau » a dit M. Mélin-Soucramanien, ajoutant qu'il croit au mythe universaliste. Il a raison – si ce n'est qu'aujourd'hui, ce à quoi la République est aveugle, sans doute parce qu'elle n'a jamais eu à le traiter dans les proportions dans lesquelles elle doit le traiter aujourd'hui, c'est qu'elle est discriminatoire. Des citoyens français vivent quotidiennement des discriminations, et l'aveuglement de la République à leur origine ou à la couleur de leur peau ne lui permet pas de résoudre cette question. Mais, en écoutant M. Tusseau, je m'interrogeais : comment définir des quotas qui permettraient que l'assemblée parlementaire dont je suis membre soit autre ? La réponse n'a rien d'évident. Pour ma part, je ne veux pas être élue parce que j'ai été baptisée, ni devoir revendiquer mon catholicisme. Quant au débat sur l'opposition entre genre et sexe, il fonde le travail que l'on devrait faire sur l'égalité entre les femmes et les hommes puisqu'il touche directement aux questions d'éducation et que l'on est passé à côté. Cela permettrait de progresser dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de la représentation que les filles se font d'elles-mêmes ou de la féminisation des fonctions. Nous ne sommes plus du tout dans la même situation qu'en 1986, lorsque, arrivant à un dîner d'État, une femme était appelée du nom de son mari alors même qu'elle était ministre sous son nom de naissance. Cela montre l'évolution en cours. La représentation que les filles ont d'elles-mêmes et l'existence de femmes à des postes de responsabilité dans la représentation publique participent de cette évolution.
Il en va de même pour ce que l'on appelle les « minorités visibles ». Aujourd'hui, que renvoie-t-on à des enfants français de parents français parfois eux-mêmes nés en France dans des maternités françaises ? Qu'ils ne sont pas des citoyens comme les autres, particulièrement si ce sont des garçons et particulièrement s'ils sont noirs ou s'ils ont la peau foncée, puisqu'ils sont beaucoup plus souvent contrôlés par cette institution républicaine qu'est la police nationale. Nous devons résoudre cette très forte contradiction, monsieur Mélin-Soucramanien. Peut-être cela ne doit-il pas être, dans un premier temps, par l'instauration de quotas dans la représentation démocratique – j'en vois le danger. Mais il faut définir toutes les réponses utiles pour lutter contre les discriminations, qu'elles soient liées à l'adresse ou à la couleur de la peau, et dire la vérité : dans notre pays, il y a une discrimination à l'égard de ceux qui ont un prénom à consonance arabe. Rappelez-vous ce qu'a fait le maire de Béziers – voilà où nous en sommes ! Les discriminations existent, elles participent d'un sentiment de fragilité et elles se doublent de l'absence de représentation dans les medias et dans les instances politiques.
J'ai dit pourquoi je suis en désaccord avec les désignations électorales. Prétendre que l'on ne désigne pas des apparatchiks dans les élections au scrutin uninominal et, en concourant au championnat du monde de l'hypocrisie, expliquer que des gens peuvent se présenter indépendamment des étiquettes… Mais enfin, quel parlementaire a jamais été élu contre le candidat officiel de son camp dans sa circonscription ? Tout cela est faux. Au sein de mon parti, comme je vous l'ai dit, nous avons décidé qu'il fallait obtenir la parité de résultat aux élections législatives. C'était le sujet second : pour permettre qu'un groupe de dix-huit députés compte autant de femmes que d'hommes, il nous fallait d'abord conclure un accord politique avec le parti majoritaire puis, dans le cadre de cet accord, réussir à croiser le critère du sexe et la représentation locale. Nous avons réussi ; comment donc, sinon en analysant les résultats électoraux des circonscriptions considérées ? L'objectivité commande de dire que les discussions internes aux partis politiques tendent à déterminer qui sera désigné dans une circonscription gagnable. L'élection étant infiniment moins liée à la personnalité du candidat qu'au bénéfice de l'étiquette partisane, notamment celle du président de la République élu depuis un mois. L'hypocrisie qui règne à ce sujet est phénoménale. Je souhaite qu'elle soit dite car on ne peut laisser croire que le scrutin uninominal vise à ce que les futurs élus soient détachés des contingences et des rapports de force internes des partis, ou encore issus de territoires où ils sont durablement ancrés, et non-cumulards… Dire cela, c'est jouer de la flûte. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait des micro-circonscriptions, et multiplier le nombre de députés. Qui vote choisit une étiquette politique ; ainsi, mon voisin se rappelle parfaitement le parti pour lequel il a voté mais il ne se souvenait pas avoir voté pour l'horrible parachutée que je suis ! Notre commission ne doit ni mentir ni se mentir.
Le scrutin proportionnel permet d'avancer sans en passer par des quotas : il rend plus difficile de présenter aux électeurs une liste entièrement « blanche », car cela se voit. Je vous fiche mon billet, monsieur le président-candidat aux élections régionales en Île-de-France, que si vous deviez désigner des candidats micro-circonscription par micro-circonscription infra-départementale, la proportion de candidats des minorités visibles sur votre liste – que je ne connais pas – ne serait pas la même que celle qu'elle sera. Il en est ainsi pour la parité. Alors qu'aucune commission de réforme des institutions précédentes n'était paritaire, celle qui nous réunit l'est, alors que rien n'y obligeait : c'est que la tradition de la parité est instaurée, et qu'elle a poussé à cette composition. De même, des scrutins de liste poussent à une représentation plus diversifiée, comme on le voit aux élections locales : il y a plus d'élus de la diversité visible aux élections municipales et régionales qu'aux élections départementales. Je pense fondamentale une réforme institutionnelle instaurant la représentation proportionnelle, car c'est aussi le moyen de favoriser la diversité.
Alors que nous en discutions en aparté, Denis Baranger objectait qu'un tel mode de scrutin aurait l'inconvénient de donner un très grand poids à de petits partis qui allaient ensuite « faire chier » – il ne l'a pas dit exactement en ces termes…– de manière immodérée au regard de leur taille. De fait, cela donnera plus de poids à des familles politiques minoritaires. Mais la situation actuelle, favorisant le bipartisme, est stérilisante, y compris pour les partis politiques : voyez les centristes, qui s'efforcent perpétuellement à l'autonomie avant d'être immédiatement ramenés à la niche ! Il y a donc un prix à payer, celui de la complexité, mais il sera utilement contrebalancé par la revivification de la démocratie et du débat au sein du parti majoritaire. On le voit aujourd'hui : un parti qui dispose de la majorité absolue à l'Assemblée nationale freine tous les débats, empêche les passerelles et le dialogue, et nuit de ce fait à la qualité du travail parlementaire. Que des groupes majoritaires interdisent à leurs membres de cosigner des amendements avec des membres d'autres groupes politiques fossilise le débat. Ouvrir les fenêtres aiderait à restaurer le lien avec une grande partie de la population sans grandes réflexions sur la démocratie participative. Celle-ci est nécessaire, bien sûr, mais avant de parler d'amendements citoyens, commençons simplement par laisser les parlementaires exercer leur mandat dans une relative liberté au lieu de les contraindre à le faire les mains liées dans le dos.
Dorénavant, je ferai réécrire mes interventions par Cécile Duflot, qui dit les choses bien mieux que moi. Plus sérieusement, je vous suis très reconnaissant, madame Duflot, de porter une parole de vérité au sein de notre groupe de travail : vous m'avez appris mille choses.
Monsieur le président, puisque vous nous avez invités à faire de la philosophie politique, je vais m'y essayer quelques instants. Les consensus et les « dissensus » qui apparaissent au sein de notre groupe de travail sont également intéressants. Ainsi, le fait qu'ait resurgi à plusieurs reprises, au cours de nos dernières réunions, l'opposition entre régime représentatif et quotas, démocratie classique et démocratie rénovée, signifie que nous sommes là face à un dilemme collectif. À l'instar de Cécile Duflot, qui nous confiait il y a quelques instants que nos débats avaient fait évoluer sa position sur certains points, je suis moi-même beaucoup plus hésitant que je ne l'étais au début de nos travaux au sujet de la démocratie représentative. La question de savoir comment rendre nos régimes représentatifs plus démocratiques me paraît en effet extrêmement sérieuse. Nos pays sont, dit-on, des démocraties, mais celles-ci sont en fait, au plan institutionnel, des régimes représentatifs sous contrainte démocratique : la démocratie a une fonction de légitimation et de contestation, mais elle n'est pas massivement institutionnalisée. Cette contrainte démocratique est cependant extrêmement forte et ne peut être esquivée. Ainsi, nous sommes opposés aux quotas – l'universalité est une de nos valeurs cardinales –, mais la discrimination est un problème de première importance. Certes, il revient aux partis politiques d'y remédier, mais s'ils n'agissent pas, que fait-on ? Je crois, quant à moi, que la discrimination est un problème important, et qu'il ne faut pas cesser de remuer le couteau dans la plaie.
On ne se gouverne pas autrement que de manière représentative ; telle est ma conviction profonde. Placez n'importe quel partisan de la démocratie directe dans n'importe quelle position de pouvoir, il sera convaincu de la supériorité du mandat représentatif. Mais je crois également que la sédimentation, pour ne pas dire la fossilisation, produit la radicalisation. Dès lors, si l'on veut être utilement conservateur, c'est-à-dire préserver ce que nos institutions libérales démocratiques et représentatives sont depuis la Révolution, il nous faut réfléchir à leur évolution. S'en tenir à leur état de fossilisation n'est juste pas une option, comme dirait Mme Duflot.
En mai 1968, Paul Léautaud avait lancé aux étudiants qui manifestaient : « Rentrez chez vous, vous finirez tous notaires ! » – il n'avait pas tort. Je dirai, quant à moi : « Sortez dans la rue, manifestez : vous deviendrez de parfaits conservateurs ! » C'est en effet en ouvrant les fenêtres, pour employer le langage du Parti communiste des années 1970, en introduisant plus de liberté dans les institutions que l'on permettra à celles-ci de se stabiliser et de garder leur robustesse. De même que les conseils ou commissions auxquels je participe fonctionnent mieux depuis que, grâce à la parité, des femmes y siègent, de même les institutions fonctionneront mieux lorsqu'y participeront des personnes opposées au système ou hors du système.
Par ailleurs, je souhaiterais que nous liions la question de la représentativité, pour laquelle nous n'avons guère de solutions institutionnelles à proposer, et celle des libertés publiques. En effet, si les possibilités d'expression politique sont restreintes par le droit de la diffamation, si l'on se sait davantage surveillé, s'il est plus difficile de manifester – et c'est le cas – ou de s'exprimer, individuellement et collectivement, en dehors des institutions, alors on est enclin à se taire et la colère politique monte : tout le monde se radicalise et devient, peu ou prou, antisystème ou extra-système. Je ne suis pas très admiratif de l'état actuel des libertés fondamentales dans notre pays. La France est un pays de liberté, certes, mais elle ne l'est pas suffisamment pour être politiquement stable. En somme, Bernard Accoyer et Cécile Duflot : même combat !
Pour le dire plus sérieusement, nombreux sont ceux, de droite et de gauche, de M. Juppé à M. Mélenchon, qui font de la liberté une valeur essentielle. Cette composante libérale de nos institutions est consensuelle, ne la négligeons pas. Encore une fois, la question des libertés fondamentales est profondément liée à celle de la représentation politique et des institutions : si on les sépare, ces dernières se fossiliseront.
En attendant le propos définitif de Marie-Anne Cohendet sur le rôle du Président de la République, je souhaiterais faire une première réponse à Michaël Foessel. Si le Président de la République fait l'objet d'un tel désamour si peu de temps après son élection, c'est aussi parce qu'on attend beaucoup de lui. J'observe par ailleurs que, dans toutes les grandes démocraties, le pouvoir est personnifié, que ce soit par un président de la République ou par un premier ministre. Maurice Duverger avait du reste dressé, dans La Monarchie républicaine, un premier bilan fort intéressant de cette évolution. Il faut donc s'interroger sur les raisons de telles attentes et sur l'omniprésence de la fonction présidentielle.
Il me semble que, plus une société est traversée de messages différents au risque de la plus grande cacophonie, plus se fait sentir la nécessité d'une parole qui rassemble ces messages et fixe des repères par rapport auxquels se situer. Am Anfang ist das Wort : le verbe demeure consubstantiel à l'idée même du pouvoir. Je ne crois pas que l'on renforcera la légitimité du Président de la République en limitant ses pouvoirs. En revanche, il faut qu'en contrepartie de son pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, il puisse être remis en question par cette dernière. Une telle réforme contribuerait, me semble-t-il, à le relégitimer.
J'en viens maintenant à la question des valeurs. Si la diffamation, qu'a évoquée M. Baranger, joue actuellement un tel rôle, c'est parce que, dans notre société, il n'est pas admis de toucher à ce qui constitue, pour une personne, sa propre valeur, jugée inestimable. Ainsi le véritable problème réside-t-il moins, selon moi, dans le communautarisme que dans l'identitarisme, c'est-à-dire l'importance que chacun accorde à l'idée qu'il se fait de lui-même, non pas en tant qu'individu universel, mais en tant que personne singulière dotée d'un certain nombre de caractères : corporatistes, identitaires, ethniques... Voilà le principal moteur de la plainte et de la revendication.
À ce propos, j'espère, monsieur Tusseau, que vous ne vous dites pas que je m'exprime en tant que fils d'un juif et d'une catholique ayant vécu en Tunisie, qui sait donc ce qu'est une société communautarisée et qui, arrivé en France, a trouvé qu'il y respirait mieux parce que ses valeurs sont universelles. De fait, le général de Gaulle est parvenu à mettre fin à la guerre d'Algérie sans que se constitue en France un algérianisme comparable à d'autres revendications identitaires, devenues très dangereuses. Les pieds-noirs auraient très bien pu exprimer des revendications propres ; ils ont retroussé leurs manches, ont travaillé et, aujourd'hui, on ne se pose même pas la question de savoir s'ils se sont intégrés ou non à la société française.
Il est nécessaire de dépasser les particularismes. Ils sont banals aux États-Unis, mais le système déclaratif facilite l'acceptation du principe des quotas et la conscience nationale américaine repose sur le manifest destiny. En France prime l'universalisme, qui a sa valeur, à condition qu'il ne prétende pas à l'impérialisme. Sur ce point, je vous renverrai à Raymond Aron, pour qui les valeurs sont à la fois absolues et contradictoires, notamment parce qu'elles sont historiques. À chaque époque, il faut en effet, sans remettre en cause leur caractère absolu et universel, concevoir différemment leur organisation.
Je pense à la parité, par exemple. Au départ, j'y étais opposé. Mais, trouvant détestable d'être rangé parmi les machistes ou les antiféministes, je l'ai acceptée, au nom de la raison universelle. La parité est en effet peut-être nécessaire, compte tenu du mode de fonctionnement des partis politiques et du conservatisme de la société. Mais elle ne doit pas pour autant devenir un principe intangible : une fois le but atteint, on peut considérer que les mentalités ont évolué et en faire l'économie – nous verrons. Au demeurant, la politique n'est pas sexuée. Mieux vaut peut-être que soit nommé ministre un homme féministe plutôt qu'une femme antiféministe.
En tout cas, on ne peut pas figer dans l'absolu l'interprétation des valeurs que nous considérons comme intangibles, car on risque alors d'être obligé d'y toucher au point de les remettre en cause. À ce propos, je répète que je demeure absolument hostile aux quotas.

Tout d'abord, je veux rappeler que les institutions sont au service de nos concitoyens, et qu'il convient que nous les entendions, y compris dans le cadre de ce groupe de travail. J'organiserai d'ailleurs prochainement, dans ma circonscription, des ateliers législatifs citoyens afin de connaître le sentiment de la population sur nos travaux.
Nous pouvons agir à différents niveaux : au plan constitutionnel, au plan législatif et au plan réglementaire. Il est du reste possible d'améliorer très rapidement les choses en intervenant en particulier dans l'ingénierie de la fabrique de la loi.
Dans ce domaine, le non-cumul des mandats marque déjà une avancée importante ; nous devons d'ailleurs nous interroger sur ce que sera l'Assemblée nationale une fois qu'il s'appliquera effectivement, à partir de 2017. J'ajoute que la mise en oeuvre de cette réforme, qui permettra de démultiplier les forces et de favoriser le renouvellement, doit s'accompagner d'une réflexion sur le non-cumul des mandats locaux, afin de lutter contre les conflits d'intérêts et de favoriser le renouvellement des institutions locales.
Nous pourrions également nous pencher sur ce que j'appellerai le droit gouvernemental. De fait, la loi se fait au Parlement mais aussi au sein de l'exécutif. Or, nous ne connaissons pas précisément la manière dont celui-ci fonctionne dans ce domaine. Les interactions entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif sont fortes et souvent opaques : il est indéniable que des pressions s'exercent sur les députés. Nous devons donc trouver, grâce à des dispositions qui relèvent peut-être du simple règlement, les moyens qui leur permettront de s'affranchir de ces pressions et d'exprimer au mieux la volonté des citoyens.
Il est par ailleurs possible de favoriser la démocratie participative, qui est, selon moi, parfaitement complémentaire de la démocratie représentative. À cet égard, le non-cumul des mandats doit permettre aux députés de faire participer à la fabrication de la loi les forces vives de leur territoire. Ils doivent ainsi tenir compte de leur parole, s'en faire l'écho dans les débats qui se tiennent à l'Assemblée nationale et rendre compte de leur action aux personnes qu'ils ont consultées. Quant aux amendements citoyens, il s'agit d'une piste intéressante. Le dispositif doit être strictement encadré, mais il ne faut pas interrompre la démarche initiée par Claude Bartolone. Peut-être l'expérience ne sera-t-elle pas concluante, mais elle mérite d'être menée car nous en tirerons de toute façon des enseignements intéressants. J'ajoute que l'inscription automatique sur les listes électorales serait un moyen simple de faciliter la participation des citoyens aux différentes élections.
Il est beaucoup plus difficile d'agir au plan constitutionnel. Le Sénat dispose en effet d'un droit de blocage qui doit être au coeur de nos réflexions car il fait obstacle à l'adaptation de la Constitution aux exigences de modernisation. Il nous faut, au demeurant, nous interroger sur la composition du Sénat. L'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) démontre en effet combien les conflits d'intérêts sont puissants et peuvent limiter la portée d'une réforme. Comme le dit une de mes collègues, on ne demande pas à la dinde de préparer le repas de Noël. Pourquoi les forces vives du pays – chercheurs, entreprises, agriculteurs… – ne pourraient-elles pas, sans que l'on recoure pour autant aux quotas, être représentées au Sénat, au même titre que les collectivités territoriales ? Enfin, il conviendrait de réfléchir à la réserve parlementaire des sénateurs qui, parce qu'elle alimente directement leurs électeurs, est au coeur d'un conflit d'intérêts beaucoup plus important que celle des députés. Je crois également que le régime de ces derniers et celui des sénateurs devraient être harmonisés.
Je précise cependant que je suis favorable au bicamérisme : le Sénat doit conserver son pouvoir délibératif, mais il doit être profondément rénové. S'il est une réforme constitutionnelle que j'appelle de mes voeux, c'est celle du Sénat, dont le pouvoir de blocage doit être supprimé.
Je voudrais m'assurer d'avoir été bien compris. Tout d'abord, monsieur Mélin-Soucramanien, j'ai foi en la démocratie, y compris en la démocratie représentative, non pas en tant que juriste, bien entendu, mais en tant que citoyen. Les quotas ne sont évidemment pas une fin en soi. J'ai proposé ce dispositif parmi d'autres, faute de mieux, car il s'agit de faire face à une urgence. J'ajoute qu'il n'est pas exclusif des mécanismes traditionnels de la démocratie représentative.
En ce qui concerne l'identitarisme, je partage en tout point l'opinion d'Alain-Gérard Slama. Il est en effet nécessaire de dépasser les particularismes, les identités. Du reste, la question qui se pose est précisément celle de la capacité offerte aux individus de se penser comme détachés de leur identité et des déterminismes. Or, de ce point de vue, les institutions doivent être repensées, qu'il s'agisse de l'école ou des institutions politiques. En ce qui concerne ces dernières, des dispositifs, qui restent à inventer, doivent permettre aux citoyens muets et invisibles de faire entendre leur voix. L'instauration de quotas est à cet égard une proposition parmi d'autres. Cécile Duflot a, quant à elle, évoqué le scrutin de liste : ce peut être un moyen d'éviter le recours aux quotas, qui ont un caractère stigmatisant et reposent sur des préjugés plus ou moins racistes. Quoi qu'il en soit, c'est en intégrant ce type de dispositifs que les institutions feront entendre les voix aujourd'hui inaudibles et permettront aux individus de dépasser leurs déterminismes.
Je tiens à remercier à nouveau très chaleureusement les personnes qui ont conçu le questionnaire et nous assistent dans nos travaux, dont je salue la très grande qualité. Aujourd'hui, nous avons surtout entendu s'exprimer la diversité des points de vue, mais les réponses au questionnaire permettront de souligner leur unité car il me semble qu'ont émergé, au fil de nos débats, un certain nombre de points de convergence.
En ce qui concerne le diagnostic, nous étions tous d'accord pour souligner l'existence d'un schisme entre la classe politique et la société civile, la délégitimation des institutions et le sentiment d'exclusion de bon nombre de citoyens. N'oublions pas, à ce propos, qu'en démocratie, ce n'est ni de la population ni du public qu'il est question, mais bien du Peuple. Le Peuple, qu'il s'agit de replacer, dans sa diversité, au centre de nos institutions, grâce à des mécanismes qui seront nécessairement variés. En tout état de cause, la solution consistant à ne rien faire ne me paraît guère raisonnable. Lorsque le navire sombre, l'orchestre peut continuer à jouer, mais il est préférable de se préoccuper de colmater les brèches apparues dans la coque ou de gagner les canots de sauvetage.
Le rejet des institutions a des causes nombreuses, que nous avons identifiées. Certes, celles-ci ne tiennent pas toutes aux institutions – Tocqueville soulignait déjà le rôle des associations dans la société politique. On a évoqué, par exemple, le fonctionnement des services publics : les citoyens « ressentent » l'État lorsqu'à la poste ils ont le sentiment de se trouver face à une machine et non face à un individu. Mais l'ensemble de ces questions sont liées, me semble-t-il, à celle de la représentation du peuple dans sa diversité au sein des différentes institutions, en particulier à l'Assemblée nationale. Les députés, parce qu'ils ne retirent pas forcément eux-mêmes leurs paquets à la poste, n'ont pas toujours suffisamment conscience des problèmes rencontrés par leurs concitoyens.
Faut-il instaurer des quotas ? Privilégier le scrutin de liste ? Plusieurs options se dessinent. Le scrutin de liste peut être un moyen d'inciter les partis politiques, qui ne le font pas, à tenir compte de la diversité ; l'application, au moins à titre provisoire, de quotas permettrait de favoriser la représentation des jeunes, qui ont des compétences que nous n'avons pas. Quoi qu'il en soit, il faut absolument que, par des procédures complémentaires, on fasse entrer le peuple dans les institutions, dont il se sent actuellement complètement exclu.
M. Accoyer a brandi l'épouvantail des Troisième et Quatrième République. On sait que le diagnostic était faux et qu'en conséquence, les remèdes proposés étaient inadéquats. En ce qui concerne la prétendue stabilité de la Cinquième République, je rappelle que la durée de vie moyenne de nos gouvernements, qui est de dix-huit mois, est bien moindre que celle des gouvernements suédois ou luxembourgeois, et que cette stabilité est toute relative lorsqu'un député a une chance sur trois de voir son mandat abrégé car tel est le bon plaisir du Président de la République.
Nous nous accordons sur le fait que l'image du Président de la République est importante en France et qu'il n'est pas question de le jeter aux orties. Il faut, au contraire, lui rendre sa majesté. Or, celle-ci tient davantage à la représentation de l'unité du peuple qu'au fait de courir derrière l'opinion publique au fil des événements. Dans la plupart des démocraties, le pouvoir est, certes, personnifié, mais il est contrôlable et responsable. Tel est le sens des propositions que j'ai faites. Le Président de la République doit redevenir un arbitre placé au centre des institutions, la diversité et l'alternance politiques devant s'incarner dans la figure du Premier ministre, qui est en quelque sorte élu par le peuple dans la mesure où il est issu de la majorité parlementaire.
S'agissant du principe de précaution, il me semble que la majorité d'entre nous considèrent qu'il est fort mal compris mais qu'il ne faut pas y toucher, car il est absolument essentiel. Au demeurant, si nous l'écartions, il s'imposerait à nous par d'autres voies plus sévères, notamment celle du droit international.
En ce qui concerne nos méthodes de travail, il me semble que le questionnaire qui nous a été adressé sera très utile. Cependant, il est important que chacun d'entre nous puisse exprimer, sur une ou deux pages, son point de vue personnel de façon à ce que l'on puisse, dans le rapport général, faire ressortir quelques tendances majeures, qu'il s'agisse du diagnostic ou des remèdes proposés.

Je dois vous dire, en conclusion de cette avant-dernière réunion, que nos travaux ont fait évoluer ma réflexion. Peut-être est-ce dû en partie au fait que je partage la présidence de notre groupe de travail avec Michel Winock, car je suis de plus en plus convaincu de la nécessité de compléter notre approche des institutions par une analyse historique. Tout à l'heure, je vous faisais remarquer que nous parlions encore de la Constitution de 1958, alors qu'elle n'est plus tout à fait la même qu'à l'époque où elle a été adoptée. Je pourrais ajouter que le choix du scrutin uninominal à deux tours s'est fait dans un contexte politique marqué par la bipolarité : il y avait le Mur, les « rouges » et les « bleus », si je peux résumer ainsi la situation. Depuis, nous avons assisté à l'émergence de pays-continents, du risque environnemental. De fait, nombre de préoccupations n'ont pas été prises en compte dans la Constitution, car elles n'existaient pas.
Du point de vue de nos institutions, il me semble que le mandat du président Chirac, qui représente le sursaut face à la menace de l'extrême-droite, marque une césure entre deux époques : les présidents qui l'ont précédé étaient patinés par l'histoire, ceux qui lui ont succédé sont, selon moi, des enfants de la télé, représentatifs du peuple plutôt que représentants d'un courant historique.
Si ma réflexion a beaucoup évolué – je pense notamment à la question du scrutin uninominal à deux tours –, c'est parce que nul ne sait avec certitude ce que sera le développement humain. C'est également sous cet angle que nous devons nous interroger sur l'évolution de nos institutions. Certes, elles ne permettront pas, à elles seules, de rétablir la confiance, mais au moins ne doivent-elles pas être exclusives. Pour ma part, je ne crois pas du tout à la représentation miroir. Non pas parce qu'elle est complexe, mais parce qu'elle conduirait à un fonctionnement « en silo ». Imaginez en effet la situation dans laquelle nous nous trouverions si le parti écologiste devait être le seul à se préoccuper d'environnement. Il me semble que si des partis devaient se constituer sur une base uniquement religieuse, de sorte que les revendications de nos compatriotes musulmans pratiquants, par exemple, seraient défendues par un seul parti dont ce serait la mission, la démocratie en serait appauvrie.
Nous devons néanmoins répondre à cette question comme à celle, par exemple, du blocage que représente la reproduction des élites, questions qui ne se sont pas posées aux pères fondateurs de la Cinquième République, mais qui bouleversent aujourd'hui les modalités de la représentation et de l'incarnation d'un projet commun. Car tel est peut-être notre Graal : le mécanisme ou le texte qui permettrait de renforcer notre appartenance commune. C'est en tout cas l'objectif du questionnaire que nous vous avons adressé.
Ce questionnaire nous permettra de réaliser, à partir de chacune de vos réponses, une photographie qui servira de point de départ à notre prochaine réunion, qui sera donc plus complexe que celle d'aujourd'hui, dans la mesure où il nous faudra convertir nos particularités en un projet commun.
J'ai remis, il y a quelque temps, au Président de la République un rapport sur l'appartenance citoyenne, et chacun a pu constater que la proposition de rendre le vote obligatoire a éclipsé toutes les autres. Ce risque existe, mais peut-être l'éviterons-nous en insistant sur le récit républicain et institutionnel de ce que nous avons essayé de rechercher ensemble. Sans un tel préambule, il sera en effet difficile de comprendre les hésitations des uns et des autres sur chacune des propositions que contiendra le rapport.
Je vous remercie tous pour votre participation.
La réunion se termine à treize heures cinq.