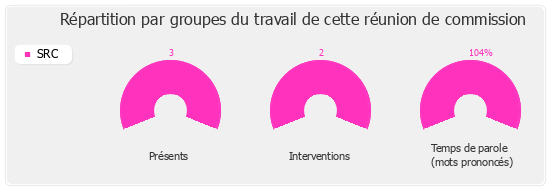Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 26 janvier 2016 à 16h30
La réunion
La séance est ouverte à 16 heures 30.
Présidence de Mme Catherine Coutelle, présidente.
La Délégation procède à l'audition de Mme Diane Roman, professeure de droit public à l'université François Rabelais de Tours, de Mme Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris, de M. Edouard Durand, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, secrétaire général de la première présidence, de Mme Catherine Le Magueresse, juriste et ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), et de M Antoine Fabre, avocat spécialisé en droit pénal, sur les violences faites aux femmes.

À la lumière d'affaires récentes, la délégation réfléchit au féminicide, ainsi qu'aux conditions de la légitime défense.
Madame Roman, vous avez publié sur le site Dalloz un article intitulé « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément » : la reconnaissance du terme de " féminicide" », et dans La Revue des droits de l'Homme un article intitulé « Féminicides, meurtres sexistes et violences de genre, pas qu'une question de terminologie ! »
Madame Le Magueresse, vous avez écrit un texte sur l'affaire Jacqueline Sauvage, cette femme qui a connu un enfer de quarante-sept ans de violences conjugales et qui a tué son conjoint « pour ne pas mourir ». Dans ce texte, vous analysez les circonstances du meurtre au regard des critères de la légitime défense qui auraient pu être appliqués à Mme Sauvage.
Pouvez-vous, les uns et les autres, nous donner votre avis sur l'introduction du terme « féminicide » dans le code pénal ? Que pensez-vous des notions de présomption de légitime défense et de légitime défense différée concernant les victimes de violences conjugales ? Enfin, pouvez-vous nous présenter la législation canadienne en la matière ?
Le « féminicide » est le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Ce terme, employé à l'étranger, est peu utilisé en France. Néanmoins, la Commission générale de terminologie et de néologie a récemment préconisé son utilisation dans le champ des sciences sociales et humaines, et le Petit Robert lui a consacré une entrée dans son édition 2015.
En droit français, un certain nombre de délits font l'objet d'une incrimination spécifique lorsqu'ils sont perpétrés en raison de leur caractère sexiste – c'est le cas des diffamations et des injures à caractère sexiste –, mais aucune circonstance aggravante n'est prévue pour les meurtres commis à l'encontre des femmes parce qu'elles sont femmes, alors que les meurtres commis en raison de motifs homophobes ou racistes font l'objet de sanctions renforcées. Néanmoins, les meurtres commis sur des femmes peuvent faire l'objet de circonstances aggravantes dans certains cas : lorsque la victime était enceinte ou lorsque le meurtre a été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS).
Faut-il aller plus loin ? Sans forcément inscrire le terme « féminicide » dans le code pénal, il semble utile d'en retenir l'idée. En effet, les homicides commis par l'ex-concubin n'entrent pas dans le champ des circonstances aggravantes précitées. De même, dans l'hypothèse où des meurtres seraient motivés par la haine des femmes – comme les meurtres commis à l'école polytechnique de Montréal en 1989 et au Mexique dans les environs de Ciudad Juarez –, les dispositions actuelles du code pénal ne permettraient pas de les sanctionner spécifiquement.
En refusant de reconnaître la spécificité de certains homicides sexistes, et en inscrivant le caractère universel du terme « homicide » – dont la vocation est de couvrir l'ensemble des violences, à l'encontre des femmes comme des hommes –, le droit pénal français contribue, selon moi, à invisibiliser une construction sociale fondée sur le genre et largement défavorable aux femmes.
C'est la raison pour laquelle je suis, à titre personnel, favorable à une modification de l'article 221-4 du code pénal, qui prévoit les circonstances aggravantes du meurtre. Il s'agirait d'insérer à l'alinéa 7° de cet article les mots « à raison du sexe, » avant les mots « de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ». Cette modification constituerait un progrès considérable en matière de défense des femmes, notamment des femmes victimes de violences conjugales.
Il est important – symboliquement et juridiquement – de visibiliser le féminicide notamment par le jeu des circonstances aggravantes. Mais cette circonstance aggravante « à raison du sexe » devrait s'appliquer à toutes les formes de violence et à tous les modes de conjugalité, y compris aux violences commises par les ex-conjoints. À l'heure actuelle, il est très difficile de prouver devant les tribunaux que les violences ont été commises « en raison des relations » comme l'exige le code pénal pour caractériser la circonstance aggravante.
La notion de « féminicide » est très importante. D'ailleurs, le « dispositif pour la prise en charge des enfants mineurs lors d'un féminicide ou d'un homicide au sein du couple » est en cours d'expérimentation à Bobigny. La richesse du mot même répond à une idée reçue, souvent avancée en matière de violences conjugales, selon laquelle les hommes aussi sont victimes. De fait, pour protéger toutes les victimes de violences conjugales, il faut passer par les violences faites aux femmes, c'est-à-dire par la dimension sexuée.
Cela étant dit, je suis réservé à l'idée de faire du sexe de la victime une circonstance aggravante. En effet, dans la lutte contre les violences, c'est la dimension conjugale qui est déterminante. L'alinéa 9 de l'article 221-4 du code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Or la création d'une circonstance aggravante à raison du sexe, outre qu'elle pourrait créer des ambiguïtés pour les magistrats, les ferait passer à côté de la dimension conjugale. Il est très important que le droit pénal consacre une circonstance aggravante au caractère conjugal des violences – qu'il faut bien sûr étendre aux relations ayant existé, c'est-à-dire aux « ex ». La dimension conjugale doit être prioritaire, j'y insiste, car cette voie est cohérente sur le plan législatif comme sur le plan jurisprudentiel.
L'analyse d'Édouard Durand est tout à fait pertinente. Je suis moi-même opposé à l'introduction d'une circonstance aggravante « à raison du sexe », car les violences au sein du couple – hétérosexuel ou homosexuel – touchent aussi bien le conjoint que la conjointe. Même si le modèle hétérosexuel est dominant, le nombre d'agressions envers les hommes est en augmentation et celui des agressions commises contre des femmes est en diminution. Récemment à Paris, s'est tenu le procès d'une femme qui avait battu son compagnon pendant une longue période. C'est donc bien le lien relationnel qui est en cause, plutôt que la notion de sexe. Les deux affaires citées par Mme Roman, au Mexique et au Canada, justifient-elles de changer la loi ? Dans mon quotidien d'avocat, je n'ai jamais eu connaissance d'agressions de femmes parce qu'elles étaient femmes ; par contre, j'ai rencontré un grand nombre de femmes victimes d'agressions parce qu'elles vivaient avec un homme violent. Ainsi, la vraie problématique est : comment sauver la vie des femmes victimes de violences ?
Dans l'affaire Jacqueline Sauvage, le dossier a été, selon moi, présenté de manière un peu simple. Je rappelle qu'un certain nombre de magistrats professionnels, tant en première instance qu'en appel, ont jugé que cette femme devait être condamnée. Ce que j'ai entendu de l'audience, c'est que la présentation selon laquelle cette femme a été victime de violences pendant une durée aussi longue n'était pas aussi certaine et qu'un des enfants n'a pas témoigné dans le sens des violences exposées, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre le délibéré qui a été rendu.
Instaurer la présomption de légitime défense serait un aveu d'échec terrible au regard des lois qui ont été votées pour lutter contre les violences conjugales – je pense en particulier à l'éviction du conjoint violent du domicile. La justice fonctionne très bien lorsque les femmes déposent plainte – ce que n'a pas fait Mme Sauvage –, la condamnation étant quasi automatique lorsque la plainte est accompagnée d'un certificat médical attestant de violences, mêmes légères. Je le constate pratiquement toutes les semaines dans mon métier.
Aucune procédure n'a été diligentée par Mme Sauvage. Deux hypothèses. Soit elle n'a pas été victime, et c'est la raison pour laquelle elle ne l'aurait pas fait. Dans ce cas, pourquoi faudrait-il créer ce flou juridique ? Soit elle est victime. Alors comment se fait-il que, pendant quarante-sept ans, cette femme n'ait jamais rencontré un interlocuteur à même de l'aider à accomplir des démarches ? Comment se fait-il qu'elle soit restée dans l'isolement aussi longtemps, malgré l'existence de permanences gratuites proposées par les avocats, d'un numéro vert et de campagnes de presse sur les violences conjugales ?

Mme Sauvage a fait trois tentatives de suicide. Il faut savoir que les femmes victimes de violences sont sous emprise et qu'elles ne parlent pas si les bonnes questions ne leur sont pas posées – notamment par les médecins et les policiers. Dans les commissariats, il existe des cellules d'accueil des femmes victimes de violences, mais tous les agents ne sont pas formés aux violences conjugales. Je connais le cas d'une femme qui avait réussi à s'échapper du domicile un week-end et à laquelle le policier a demandé de revenir porter plainte accompagnée de son conjoint !
Ni le féminicide ni la présomption de légitime défense ne régleront le problème. On ne peut pas expliquer aux femmes sous emprise que la bonne solution est de tirer sur leur mari ! La présomption de légitime défense signifie que l'auteur est présumé avoir agi dans son bon droit. Dans le cas de Mme Sauvage, cela signifierait qu'elle n'a pas fait appel au dispositif en place, mais que la solution consistant à tirer dans le dos de son mari ne mérite pas de sanction judiciaire. Cela me semble excessif.
J'interviens exclusivement dans des dossiers de femmes victimes de violences et auteures de meurtre sur conjoint violent. On vient généralement me voir comme deuxième, voire troisième avocat, lorsque l'avocat « classique » ne comprend pas le mécanisme de la violence conjugale. Je traite donc uniquement des cas qui dysfonctionnent.
Philosophiquement, idéologiquement, je suis favorable au féminicide. Malheureusement, cette notion n'entre pas dans la philosophie des magistrats ni du droit actuel, ce qui rend nécessaire une loi de genre, une loi-cadre sur le féminicide, qui définirait la notion de « violences conjugales ». En effet, si le code pénal prévoit les violences physiques ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou supérieure à dix jours, ainsi que les violences psychologiques, introduites par la loi de 2010 – notion que manient assez mal les professionnels de la justice –, il n'apporte pas une définition des violences conjugales. Si bien que nous, les avocates des femmes victimes, sommes systématiquement renvoyées vers la notion de « conflit de couple ».
Dans ce contexte, un délit de violences conjugales peut paraître intéressant, mais il impliquerait un renversement de la preuve. Aussi serait-il préférable d'insérer dans le code civil la définition des violences conjugales, telle qu'elle existe dans les textes internationaux, notamment la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la France.
Dans les dossiers de légitime défense avec meurtre – que je défends une fois par an environ –, les auteures ne sont jamais acquittées, elles sont généralement condamnées à une peine de cinq ans de prison dont trois avec sursis. À présent, l'affaire Jacqueline Sauvage ouvre le débat sur la présomption de légitime défense. Soit c'est un dossier particulier. Soit ça ne l'est pas, et alors le législateur pourrait utilement s'inspirer de la disposition canadienne sur la légitime défense féminine. En effet, la légitime défense en France fait l'objet de jugements réguliers devant les tribunaux correctionnels, car si Madame s'est défendue, elle et son conjoint sont cités à comparaître pour violences devant le tribunal correctionnel – elle a un oeil au beurre noir et lui quelques griffures –, si bien que tous deux sont sanctionnés des mêmes peines ! Ce traitement correctionnel, par le « bas du panier », est particulièrement inquiétant, car à partir du moment où les condamnations sont équivalentes ou égales pour la femme et l'homme, nous ne pouvons pas dire au juge aux affaires familiales que c'est Monsieur qui est violent, ni demander un droit de visite en lieu neutre ou en présence d'un tiers, encore moins présenter l'exercice de l'autorité parentale comme instrument de domination.

Je connais le cas d'un couple où les deux ont été condamnés, le mari parce qu'il avait frappé sa femme, et la femme parce que le premier portait quelques traces de violences car elle s'était défendue.
Présomption de légitime défense ou légitime défense différée, madame Le Magueresse ?
Ni l'une ni l'autre. J'ai commencé à travailler sur la question de la légitime défense, après avoir eu connaissance de la condamnation de Jacqueline Sauvage en première instance, condamnation extrêmement lourde par rapport à d'autres contentieux. J'ai suivi les trois jours de procès en appel à Blois, procès de haute tenue car toutes les personnes qui ont témoigné ont eu à coeur d'être précises et honnêtes dans la présentation des faits, y compris dans la reconnaissance de leur propre aveuglement.
Je rappelle que les faits se sont déroulés dans un petit village, où tout le monde était au courant des violences subies par Mme Sauvage : le maire savait, ainsi que les voisins, les gendarmes, le médecin, les pompiers. Tout le village savait. À l'audience, le maire a eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il avait connaissance des violences subies par Mme Sauvage, et l'un des assesseurs lui a même reproché d'avoir méconnu l'article 40 du code de procédure pénale selon lequel tout fonctionnaire ayant connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de crimes ou de délits est tenu d'en informer le Procureur de la République. Les voisins ont expliqué avoir été menacés de mort. Les gendarmes eux-mêmes étaient au courant, ce qu'a confirmé le maire. Les pompiers sont intervenus lors de l'une des trois tentatives de suicide de Mme Sauvage.
M. Marot, le mari de Mme Sauvage, a également fait vivre un enfer à ses enfants : deux des filles ont été violées, l'aînée a été victime d'agressions sexuelles, et le fils a été victime de maltraitances graves. Le village savait : un jour, alors qu'une des filles tardait à rentrer un soir, le père est allé la chercher en l'insultant, en la tirant très violemment devant ses camarades.
L'échec social et judiciaire est patent. Non seulement personne n'a déposé plainte concernant ces faits, mais les quatre plaintes pour menaces de mort déposées par la voisine dont le mari a été menacé de mort à de nombreuses reprises ont toutes été classées sans suite.
La plus jeune des filles, qui a été violée, a fait une fugue à dix-sept ans. Après avoir été retrouvée, elle a été placée en cellule ! Dans les locaux de la gendarmerie, elle a commencé à dénoncer le viol, mais en entendant son père arriver en hurlant, elle a eu très peur et a récupéré le formulaire de plainte pour le brûler dans les toilettes. Le gendarme n'a pas fait de signalement au parquet ni à l'aide sociale à l'enfance (ASE), mais il a informé le père que sa fille l'avait accusé de viol la mettant ainsi en danger.
Ces dysfonctionnements majeurs méritent, selon moi, un procès contre l'État : Mme Sauvage n'a pas été protégée pendant quarante-sept ans, alors qu'elle aurait dû être protégée.
Mme Sauvage s'est mariée à dix-sept ans, en 1965, année où les femmes ont obtenu le droit de travailler sans l'accord de leur mari. Les violences ont commencé tout de suite après le mariage. À l'époque, les violences au sein du couple étaient la norme – le premier refuge pour femmes victimes de violences conjugales a été ouvert en 1975. La famille de Mme Sauvage était opposée à ce mariage, car M. Marot sortait d'une maison de correction – « on t'avait bien dit de ne pas l'épouser », lui ont dit les membres de sa famille –, ce qui a contribué à l'isolement de cette femme.
Extrêmement isolée, Mme Sauvage a tenté de se protéger au travers de l'entreprise de transport qu'elle avait créée avec son mari : quand l'argent rentrait, M. Marot se calmait. Pendant ces quarante-sept ans, elle a utilisé toute son énergie pour faire en sorte que « ça aille bien », comme elle l'a dit au procès. Cette stratégie d'évitement est bien connue en matière de violences conjugales. Mme Sauvage subissait quotidiennement des violences psychologiques, sexuelles ou physiques.
Comment une condamnation à dix ans est-elle possible ? Je pense que Mme Sauvage n'a pas été aidée dans sa prise de parole par la présidente qui s'adressait à elle vertement – « Levez-vous, madame Sauvage ! » et qui lui coupait la parole. Une présidente qui osait dire « On n'est pas chez les Marot ici ! » parce que sa fille émue, s'exprimait de façon familière à la barre… À de nombreuses reprises durant l'audience, j'ai trouvé anormale que la présidente et l'avocat général – la figure de la justice – s'adressent aux témoins et à Mme Sauvage de cette façon. Quand on sait ce qu'a vécu cette femme et ce qu'il faut d'empathie pour permettre aux personnes de parler, on comprend que Mme Sauvage n'a certainement pas été invitée à parler de ce qui lui était arrivé. Heureusement, les témoins l'ont fait pour elle. Heureusement, le témoignage de ses filles, remarquables de courage, a permis de comprendre l'enfer qu'elle a vécu pendant quarante-sept ans.
L'avocat général a pensé que les jurés demanderaient une condamnation moins lourde. Dans ses réquisitions, il leur a expliqué qu'en la condamnant à dix ans, elle sortirait à telle date, qu'en cas de condamnation moindre, elle sortirait le soir même… Face un discours si peu clair, j'aurais eu du mal en tant que jurée à comprendre le message… Il aurait fallu que l'avocat général assume publiquement, soit que Mme Sauvage devait rester en prison, où elle avait déjà passé trois années, soit que Mme Sauvage devait sortir de prison le soir même, et alors il aurait dû requérir cinq ou six ans. Compte tenu des témoignages, de tout ce que cette femme a enduré – son fils s'est suicidé pratiquement au moment du meurtre –, j'ai sincèrement pensé qu'elle retrouverait ses enfants le soir même. Cela n'a pas été le cas. Tout le monde a été surpris de cette décision.
Mme Sauvage porte le viol de ses filles, dont elle se sent éminemment coupable. Après la fugue de sa fille, elle lui avait demandé « est-ce que c'est vrai ? » et celle-ci, voulant protéger sa mère « qui avait déjà son fardeau » a-t-elle dit au procès, avait répondu « non, maman, j'ai menti ». Elle avait interrogé ses autres filles, qui lui avaient répondu la même chose. Ses filles ne voulaient pas lui mettre sur le dos la responsabilité des agressions sexuelles. Mme Sauvage a dit au procès qu'elle n'aurait jamais imaginé que cet homme, en plus d'être violent, pouvait s'attaquer sexuellement à ses filles.
Cette affaire a ouvert le débat sur la légitime défense. Faut-il modifier les conditions de la légitime défense ? La France n'a pas traité cette question, contrairement à beaucoup d'autres pays – États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande – qui l'ont abordée spécifiquement sous l'angle des violences faites aux femmes et des violences conjugales. Il ne s'agit pas d'imaginer un permis de tuer. Il s'agit de penser la situation d'une femme qui se défend lorsqu'elle est victime de violences conjugales. C'est un réel problème de société : plus les filles seront éduquées au respect d'elles-mêmes, plus elles seront légitimes à se défendre – à opposer une riposte physique à une attaque injuste et illégale.
En droit, la légitime défense est définie par l'article 122-5, alinéa 1, du code pénal qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. »
Quelles sont les conditions relatives à l'agression ?
L'agression doit être injuste, d'abord. En matière de violences conjugales, l'agression est toujours injuste. Ce critère était rempli pour Mme Sauvage.
L'agression doit être réelle, ensuite. En clair, l'agression ne doit pas être imaginaire. Mme Sauvage vivait sous le risque réel d'être tuée – M. Marot la menaçait de mort quotidiennement. Ce critère était donc rempli.
Enfin, l'agression doit être actuelle – « dans le même temps » selon le code pénal. Mais les termes « dans le même temps » ne signifient pas forcément dans la seconde, dans la minute, dans la demi-heure. Jusqu'à présent, la jurisprudence a interprété ces termes comme un temps très court – cela renvoie au cas de Mme Lange qui tué son conjoint avec un couteau alors qu'il était en train de l'étrangler, et qui a donc été acquittée pour avoir rempli toutes les conditions de la légitime défense.
En raison de quarante-sept ans de violences, Mme Sauvage était détruite, elle n'avait plus aucune estime d'elle-même – c'est ce qu'on appelle le syndrome de la femme victime de violences. Tous les travaux ont montré qu'une personne ayant subi une violence grave est traumatisée – elle n'est plus une personne « raisonnable », terme utilisé par les Canadiens. Tous les repères de Mme Sauvage étaient donc déconstruits par toutes ces années de violences.
Je rappelle les faits qui ont précédé le meurtre. Alors que Mme Sauvage dormait, après avoir pris deux comprimés pour s'endormir, son mari est venu défoncer la porte de sa chambre, fermée à clé, en lui hurlant : « Va faire à manger ! ». Certes, terrorisée, Mme Sauvage a fini par lui ouvrir. Le constat de gendarmerie a bien confirmé que la porte avait été fracturée. Ensuite, M. Marot a traîné Mme Sauvage par les cheveux, lui a donné un coup de poing, ce qui lui a déchiré la lèvre, puis il est allé prendre son whisky sur la terrasse. À ce moment-là, la cocotte-minute a explosé – « ça a explosé dans ma tête », a dit Mme Sauvage au procès. Elle est alors partie chercher un fusil avec lequel elle a tiré trois coups sur son mari, assis de dos. Trois coups, ce qu'ont confirmé les voisins, car elle a tiré automatiquement – elle et son mari étaient un couple de chasseurs, elle savait tirer. À la question de savoir si elle aurait tiré si son mari avait été de face, elle a répondu par la négative – les travaux canadiens ont montré que les femmes qui tuent leur conjoint le font lorsqu'elles ne sont pas en danger d'être elles-mêmes victimes de violences. Mme Sauvage était convaincue de la dangerosité de cet homme. En effet, une des fois où elle avait tenté de quitter le domicile en voiture avec sa fille, M. Marot les avait poursuivies en voiture, puis avait mis en joue sa fille en hurlant : « Si tu ne rentres pas à la maison tout de suite, je tire ! ». Cette fois-là encore, Mme Sauvage était donc rentrée à la maison, et sa fille n'avait pas porté plainte de peur que cela ne se retourne contre sa mère, c'est-à-dire que sa mère soit tuée. Voilà pourquoi les enfants n'ont pas déposé plainte, comme elles l'ont expliqué à la barre.
Dans la situation spécifique de Mme Sauvage victime de violences durant quarante-sept ans, ce critère d'actualité était donc rempli. Des violences graves venaient de se produire, les menaces de mort étaient quotidiennes – elles avaient même été plus que verbales lorsque Monsieur avait mis en joue son enfant. Avec une interprétation jurisprudentielle plus éclairée sur les conséquences des violences conjugales sur les femmes victimes, ce critère d'actualité aurait pu être retenu lors du procès.
La légitime défense n'a pas été évoquée en première instance, ce que m'ont confirmé les journalistes sur place à l'époque. En appel, la légitime défense a été évoquée, mais je pense trop rapidement – cela n'a pas été suffisamment développé. Les plaidoiries sont intervenues très tard dans la journée – le procès a duré trois jours, mais quatre jours auraient été préférables pour une bonne organisation de la justice. Mme Sauvage était présente au procès de neuf heures du matin à neuf heures du soir, elle était sommée de répondre après trois heures de témoignages – « Qu'avez-vous à dire ? » –, mais elle n'était pas en mesure de répondre correctement dans un tel contexte. Je pense aussi que les jurés étaient saturés en raison du nombre d'informations à assimiler.
Maintenant, quelles sont les conditions relatives à la riposte ?
D'abord, la riposte doit être « nécessaire ». Pendant quarante-sept ans, toutes les stratégies que Mme Sauvage avait tenté de mettre en place pour dénoncer les faits avaient échoué, si bien qu'elle ne pensait pas que la justice était possible. Les plaintes de sa voisine avaient été classées sans suite, ce qui renforçait l'impunité du mari et la conviction de toute-puissance de celui-ci. Les menaces de M. Marot contre sa fille n'avaient pas fait l'objet d'un signalement à la justice. Mme Sauvage ne pouvait compter ni sur les voisins, ni sur le maire, ni sur la société de chasse dont le mari avait été exclu pour cause de violences, ni même sur les gendarmes ! Tout le monde était au courant, mais personne n'avait jamais rien fait ! Sur qui pouvait-elle compter ? Elle ne pensait pas que ses enfants, devenus adultes et partis de la maison, pouvaient la protéger. Ainsi, sa sécurité ne dépendait que d'elle-même, elle n'avait pas d'autres moyens que tirer sur son agresseur pour assurer sa protection. Le critère de nécessité était donc rempli.
Ensuite, la riposte doit être « proportionnée ». En l'occurrence, la question n'est pas de savoir si toutes ces violences méritaient mort d'homme. Mme Sauvage était convaincue d'être en danger de mort, autrement dit que M. Marot finirait un jour ou l'autre par mettre à exécution ses menaces de mort – il terminait ses phrases par « je vais te buter ! » Je rappelle qu'il s'agissait d'une famille de chasseurs et que plusieurs armes se trouvaient dans la maison, comme l'a confirmé le constat de police. En se plaçant, non du côté de la personne « raisonnable », mais du côté de Mme Sauvage, traumatisée par des années de violences, on comprend que le critère de proportionnalité était rempli.
Enfin, la riposte doit être « volontaire ». Je n'y insiste pas. Toutes les femmes savent qu'elles tuent.
En conclusion, le jury aurait pu prononcer un autre délibéré, mais encore eût-il fallu qu'il ait été éclairé par les conseils de la présidente et des assesseurs.

Selon vous, le fait de se sentir en danger de mort pourrait constituer un critère de la légitime défense. Or beaucoup de femmes se sentent également en danger de mort lorsqu'elles subissent des violences psychologiques. Comment faire ?
Le droit actuel ne prend pas en compte la spécificité des violences conjugales : la légitime défense a été conçue par et pour des hommes, pour protéger leur propriété, dans le cadre d'une rixe à la sortie d'un bar… La jurisprudence n'évoque que ces cas.
Le législateur français doit-il s'orienter vers la présomption de légitime défense, la légitime défense différée ou une autre piste ?
Avec la présomption de légitime défense, on joue sur le régime de la preuve, mais sans toucher à la définition même de la légitime défense. Or il est fondamental de définir la légitime défense.
Avec la légitime défense différée, les choses ne sont pas claires. Pour moi, la légitime défense s'inscrit totalement dans le processus des violences conjugales. Je rappelle que 41 % des femmes tuées par leur conjoint avaient déposé plainte, ce qui montre qu'une procédure pénale ne protège pas de la mort. En outre, parmi les femmes auteures d'homicide, à peu près la moitié avaient elles-mêmes été victimes de violences conjugales.
La troisième piste est celle du droit canadien. La première jurisprudence au Canada date de 1990, avec l'arrêt Lavallée. Mme Lavallée avait tué son conjoint à peu près dans les mêmes circonstances que Mme Sauvage : insultée par son mari lors d'une soirée, elle était montée se cacher dans sa chambre, puis son mari l'avait rejointe pour lui dire « Attends que les invités s'en aillent, tu auras de mes nouvelles ! ». Mme Lavallee avait alors tiré sur son mari qui était en train de quitter la chambre – il était donc de dos avec l'arme qu'il lui avait remise. Dans cette affaire, la juge à la Cour suprême Bertha Wilson a pris en compte la spécificité des violences conjugales. Par la suite, plusieurs arrêts ont confirmé cet arrêt.
Enfin, en 2012, des facteurs à prendre en compte pour apprécier si la personne alléguant la légitime défense a agi de façon raisonnable, ont été intégrés à l'article 34 du Code criminel canadien. Les jurés doivent ainsi tenir compte notamment de : « la taille, l'âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause ; la nature, la durée et l'historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d'emploi de la force avant l'incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace ; la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l'emploi ou à la menace d'emploi de la force ».
Le législateur français pourrait s'inspirer des critères canadiens pour redéfinir la légitime défense, de telle sorte qu'elle ne soit pas discriminante pour les femmes victimes de violences conjugales. En effet, en ne tenant pas compte de la situation spécifique des femmes victimes de violences conjugales, le code pénal français exclut les femmes violentées du droit à la légitime défense et ainsi du droit à un procès équitable.
Je souscris en tout point à l'exposé brillantissime de Mme Le Magueresse. La piste canadienne me semble très intéressante.
Sur le procès de Jacqueline Sauvage, je m'en tiens à mon devoir de réserve pour une raison simple : je suis magistrat à la Cour d'appel d'Orléans. Par contre, je peux dire que la synthèse réalisée par Mme Le Magueresse correspond aux données générales que nous connaissons, à savoir que, dans la majorité des cas d'homicide, la femme était déjà victime de violences conjugales et que, dans la majorité des cas de féminicide, la femme était également victime de violences conjugales antérieures.
Nous savons également que dans 40 % à 60 % des situations de violences conjugales, les enfants sont directement victimes de violences exercées contre eux par l'agresseur qui commet les violences conjugales. Par conséquent, les professionnels ne peuvent être pertinents dans les situations de violences conjugales s'ils n'en connaissent pas les mécanismes. Je suggère donc qu'une étude coordonnée des dossiers de mort dans le couple – homicides et féminicides – soit réalisée, travail auquel je suis tout à fait disposé à contribuer.

J'entends votre demande, mais au niveau du ministère de la justice, il semble déjà très difficile de produire des statistiques sexuées sur les condamnations pour cyberharcèlement, par exemple.
Pour les homicides conjugaux, les proportions seraient différentes et les infractions qualifiées et codées de façon plus claire qu'une infraction comme le cyberharcèlement. Je souligne que le téléphone grand danger a été inventé parce que des professionnels sur un territoire ont voulu raisonner sur les situations de féminicide.
Autre remarque : il faut absolument prendre en compte les suicides et les tentatives de suicide. Ce qui vient d'être expliqué est limpide : c'était lui ou elle ; or le plus souvent, c'est elle, y compris par suicide ou tentative de suicide. Notre responsabilité est très grande en la matière, même dix ans après la séparation quand il y a des enfants.
Je trouve dommage que vous n'ayez pas invité l'avocat du mari défunt de Mme Sauvage, car il aurait été intéressant de connaître sa position. La pensée univoque gêne l'avocat pénaliste que je suis. On nous présente M. Marot comme un violeur, mais il n'a pas été condamné pour viol. Peut-on entendre qu'une personne reste présumée innocente jusqu'à ce qu'elle ait été condamnée pour les faits qui lui sont reprochés ? À chaque fois que des affaires suscitent l'émotion, est-on obligé de considérer que la thèse d'une des parties est l'extrême vérité ?
Deuxième point : la présence de référents dans les commissariats et les gendarmeries pour écouter les femmes battues est indispensable. La priorité est celle-là, et non de raisonner philosophiquement sur des concepts. Ces femmes n'ont pas l'accueil qu'elles méritent. J'ajoute qu'il est très compliqué d'obtenir un téléphone grand danger, or c'est la rapidité de l'intervention qui peut sauver des vies.

Quelle est cette société où les femmes devraient apprendre à se défendre ? Nous nous battons pour l'égalité femmes-hommes, nous voulons que les femmes aient la possibilité de se promener dans la rue sans être agressées sexuellement. Pour ma part, je n'ai jamais constaté de harcèlement sexuel sur des hommes. Les violences conjugales restent un fléau en France et je ne supporte pas l'idée que les femmes soient obligées de se défendre !
Je souscris tout à fait à l'analyse de Mme Catherine Le Magueresse sur l'affaire Jacqueline Sauvage. Je me permets d'ajouter que, au regard des défaillances et des manquements des services publics nationaux, tous les éléments sont réunis pour une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, dont la jurisprudence est très stricte sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui interdit les « traitements inhumains ou dégradants ». Les États sont tenus d'agir positivement pour protéger les victimes de violences conjugales, qui sont considérées par la cour européenne comme des violences constitutives d'une discrimination fondées sur le sexe. Dans une affaire jugée en 2009, la Cour européenne a condamné la passivité des autorités policières et judiciaires turques à protéger une femme victime de violence.
Je souscris également à la proposition de Mme Catherine Le Magueresse sur les critères de la légitime défense permettant d'encadrer l'appréciation des magistrats.
Cela étant dit, si la question de la légitime défense s'avérait être un sujet trop sensible politiquement, je propose une solution de repli sur la base de l'article 122-2 du code pénal qui dispose que « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ». En effet, la contrainte intègre théoriquement la situation psychique de l'auteur de l'acte criminel. Par conséquent, les violences subies par la victime – asservissement, processus d'aliénation constant, humiliations répétées – pourraient être considérées comme constitutives d'une contrainte. Pour l'heure, la jurisprudence n'a pas retenu la contrainte comme cause d'irresponsabilité pénale en matière de violences, mais cela pourrait l'être en restant dans le cadre actuel du code pénal.
Il s'agit d'une disposition sur l'abolition du discernement.
L'abolition du discernement est régie par l'article 122-1 du code pénal.
Imaginer qu'une femme battue est dans un processus de contrainte me semble incroyable dans un procès ordinaire !
L'imagination est l'arme des juristes, disait Jean Giraudoux !
Elle est aussi source d'erreur judiciaire !
Comme le dit Catherine Le Magueresse, il est important d'évoluer vers une modification législative. Par contre, le législateur devra définir des critères de la légitime défense extrêmement clairs et facilement compréhensibles pour des personnes qui ne sont pas juristes, en l'occurrence des jurés de cour d'assises !
Dans des affaires au pénal comme celles-là, la victime est non seulement incapable d'expliquer le mécanisme psychologique, social, médical, judiciaire, qui s'est noué autour d'elle, mais elle est fragilisée par le maniement de la langue française de la part des pénalistes pour faire en sorte qu'elle se sente nulle – alors même que son système de pensée a été de se sentir nulle pendant toutes ces années de violences conjugales ! Dans ce contexte, nous, les avocates de ces femmes, devons être très présentes, occuper toute la place, et ne pas avoir peur d'aller au clash ! Mais il faut surtout que la loi nous aide à poser les piliers de ce rapport de force !

Les jurés ne sont pas des spécialistes du droit. Le président du tribunal fait-il de la pédagogie ?
Pour avoir eu l'honneur d'être dans le secret des délibérés des Assises à plusieurs reprises, je peux vous dire que le président d'audience fait oeuvre de pédagogie et que les jurés prennent parfois beaucoup de temps pour délibérer.
C'est possible…
La compréhension des mécanismes des violences conjugales est cruciale, non seulement pour les jurés, mais aussi pour les magistrats. D'ailleurs, des sessions de formation sont en cours pour les futurs magistrats, en plus de la formation continue pour les magistrats en place.
Chère consoeur, en défendant un grand nombre de femmes victimes de violences, je n'ai jamais échoué dans la reconnaissance de ces violences, y compris en cas de viol. Par contre, certaines de mes clientes, alors même qu'elles avaient alerté les services de police, se sentaient menacées et ont été agressées faute d'avoir été protégées. C'est tout le problème : comment protéger ces femmes, sachant que 40 % de celles qui sont tuées ont déjà porté plainte ?

On me dit que les avocats ne souhaitent pas s'en emparer.
Qu'en est-il du téléphone grand danger ? Pouvez-vous nous donner des éléments sur la formation ?
S'agissant de l'ordonnance de protection, les délais pourraient être améliorés.
Je voudrais souligner le coup de génie du législateur qui a substitué la notion de « vraisemblance » à celle de « preuve » dans la loi. Ce faisant, il a prouvé sa parfaite compréhension des violences conjugales. Malheureusement, les professionnels disent : « nous devons apporter la preuve de la « vraisemblance » »… Je peux dire que les choses progressent malgré tout.
À Bobigny, les choses fonctionnent mieux qu'ailleurs grâce à la formation et au partenariat. Formation sur les mécanismes de la violence conjugale, sur la stratégie de l'agresseur, le psycho-traumatisme, l'emprise. Partenariat avec les huissiers de justice qui se sont engagés à signifier les assignations dans un délai très bref, avec les avocats, avec les structures associatives. La conjugaison de ces deux dimensions est fondamentale pour progresser dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
J'en viens à mes propositions.
Sur la médiation, d'abord. La médiation est un outil extrêmement utile dans les situations de conflit, mais elle est totalement inadaptée dans les situations de violences conjugales. Le législateur a fort heureusement restreint le recours à la médiation pénale, mais un jour ou l'autre – et le plus tôt possible – il devra faire la même chose pour la médiation familiale, encore plus inadaptée aux situations de violences conjugales que la médiation pénale. En effet, la médiation pénale s'exerce sur l'infraction commise et suppose la reconnaissance des faits par l'agresseur, alors que la médiation familiale est un mode de règlement des conflits entre les deux parents et ne suppose pas la reconnaissance des faits.
Sur la coparentalité, ensuite. Les violences conjugales perdurent, même dix ans après la séparation du couple. Il est tragique pour une femme de rester sous l'emprise par la parentalité, après avoir été victime de violences conjugales et être parvenue à sortir de l'emprise de l'agresseur. Le législateur devrait y remédier, en limitant l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. » Je pense que les violences conjugales constituent un motif légitime pour confier l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Sur ce dernier sujet, nous sommes d'accord, mais nous n'arrivons pas à nous faire entendre par le ministère de la justice. L'enjeu est pourtant de protéger l'enfant.
Je vous propose cette piste : on peut dire que, dans les violences conjugales, l'agresseur n'est pas un parent protecteur.

Dans un procès récent, un homme condamné pour violences graves envers sa femme ne s'est pas vu retirer l'autorité parentale au motif, dixit le magistrat, qu'il est « un mauvais mari, mais un bon père » !
D'où l'intérêt de la formation, mais aussi de l'intervention du législateur. Certes, la loi de 2014 a été peu mise en application sur le retrait de l'autorité parentale – car on touche là au coeur de nos représentations de la famille, à une conception patrimoniale de l'autorité parentale. L'autorité parentale est conçue moins comme un outil juridique pour protéger et éduquer l'enfant que comme un outil juridique permettant de reconnaître le parent comme parent. Or dans la vie quotidienne, l'exercice conjoint de l'autorité parentale dans les situations de violences conjugales est inconcevable. Jusqu'en 1987, l'autorité parentale était liée à la garde de l'enfant et les enfants de parents divorcés ont toujours su qu'ils avaient deux parents !
La suspension de l'autorité parentale est une piste intéressante dans les cas de féminicide ou de tentative de féminicide. Comme juge des enfants, j'ai vu un père condamné à la prison pour avoir tué sa femme et qui continuait à exercer l'autorité parentale, en refusant de donner l'autorisation à la justice d'envoyer l'enfant chez un pédopsychiatre, car il s'agissait du pédopsychiatre de la branche maternelle… Le système est donc totalement pervers. Une disposition du code civil permet au juge des enfants, par exemple, de déléguer ponctuellement au gardien – famille, tierce personne, service éducatif, aide sociale à l'enfance – la charge de certains actes.

Dans ma permanence, j'ai accueilli une femme dont le mari refusait de lui donner le passeport de son fils, alors que celui-ci devait partir en voyage scolaire à l'étranger !
Il faudrait que la mère demande au juge aux affaires familiales l'exercice exclusif de la garde, puisque l'autorité parentale devient l'arme pour perpétuer l'emprise !
Dans une situation de féminicide ou de tentative de féminicide, l'auteur continue à exercer l'autorité parentale pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant la condamnation par la Cour d'assises. Je préconise donc une suspension provisoire de l'exercice de l'autorité parentale, car si des motifs justifient la détention provisoire, ils peuvent aussi justifier que ce soit le tiers désigné comme protecteur par la justice qui décidera si l'enfant doit aller voir un pédopsychiatre.
Je voudrais finir sur le problème des enfants victimes des violences conjugales. En effet, s'ils ne sont pas directement victimes de violences exercées contre eux, les enfants ne sont pas victimes au sens pénal. Je vois deux pistes. La première est de faire de la présence des enfants une circonstance aggravante de l'infraction de violences. Elle n'a pas ma préférence, car elle aurait l'inconvénient de signifier que les violences dans le couple commises en l'absence d'enfant ou en l'absence de l'enfant sont moins graves. La deuxième piste est le cumul d'infractions, par la création d'une infraction autonome selon laquelle les violences conjugales constituent une violence contre l'enfant. Le cumul idéal de qualifications est envisageable dans deux cas de figure : d'une part, la pluralité d'atteintes à des valeurs sociales différentes – violences dans le couple et maltraitance faite à l'enfant : nous savons qu'il n'y a pas de maltraitance plus grave faite à l'enfant que les violences conjugales – et, d'autre part, la pluralité de victimes. Ces deux conditions sont réunies dans les situations d'enfants victimes des violences conjugales.
Nous sommes tous d'accord sur un point : notre justice est relativement imparfaite. L'affaire Sauvage le montre. Il arrive que la justice se trompe.
Avec tout le respect que je vous dois, madame la présidente, il me semble qu'un mari violent peut être un bon père.
Mon cabinet est situé près de Trappes, et je sais qu'un très grand nombre de femmes en situation irrégulière ont porté plainte pour violences légères afin d'être régularisées, or les hommes concernés ont été relaxés dans un grand nombre de cas.
Dans un système judiciaire imparfait, où l'on peut être tenté d'instrumentaliser la justice, créer une disposition pour priver une personne présumée innocente de l'autorité parentale me semble dangereux. Vendredi, j'ai fait libérer un homme, après deux ans et demi de détention provisoire, accusé à tort de viol sur sa conjointe : dans quel état serait-il aujourd'hui si l'autorité parentale lui avait été retirée ?

Nous n'avons pas l'impression d'en faire trop pour lutter contre les violences conjugales. Les enfants qui ont vu leur mère battue sont marqués à vie.
J'ai été auditionnée par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) sur la modification de la définition juridique du viol et la notion d'agression sexuelle.
Il s'agirait d'introduire à l'article 222-22 du code pénal sur les agressions sexuelles une définition positive du consentement. Là encore, le code canadien est intéressant, en ayant introduit comme définition du consentement « l'accord volontaire donné à l'activité sexuelle ». Il serait préférable d'inscrire un consentement positif dans le code pénal, au lieu de continuer à penser l'absence de consentement de la victime en termes de « violence, contrainte, menace ou surprise » de l'agresseur, cette situation aboutissant à déposséder totalement les femmes de leur pouvoir de dire oui ou non. Autrement formulé, il y aurait viol ou agression sexuelle quand la femme ne dit pas « oui », pas seulement quand elle dit « non ».
Cette notion de consentement est primordiale. Pour m'être rendue dans différents lycées d'Île-de-France, les jeunes lycéens que j'ai interrogés étaient incapables de répondre à ma question « qu'est-ce que le consentement ? » et toutes les lycéennes d'une autre classe m'ont soutenu que « si l'on sourit à un garçon on doit coucher avec lui après, sinon on est une salope ».
La Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), dont je suis membre, souhaiterait travailler sur la question des violences envers les femmes, aussi bien sur le féminicide que sur la légitime défense. Une saisine de votre délégation pourrait constituer une première étape intéressante.
Les femmes qui sont déjà sous un système de protection ne sont pas suffisamment protégées. En effet, malgré le contrôle judiciaire, le sursis avec mise à l'épreuve ou encore l'ordonnance de protection, certains hommes passent à l'acte. Je pense que la responsabilité de l'État est engagée dans le cas de cette femme assassinée à Grande-Synthe, qui avait déposé plainte pour violences conjugales, son compagnon était sous contrôle judiciaire et devait être jugé un mois et demi plus tard, mais il l'a poursuivi en voiture et l'a tuée à coups de revolver, ainsi que le père et la mère de celle-ci, alors qu'elle venait d'appeler le 17. Dans cette affaire, le contrôle judiciaire ne s'est jamais exercé, alors que cette femme s'était présentée quatre fois dans des commissariats. La protection des femmes, lorsque le conjoint veut tuer, est un gros souci.

Certains tribunaux demandent peu de téléphones grand danger.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs.
La séance est levée à 18 heures 35.