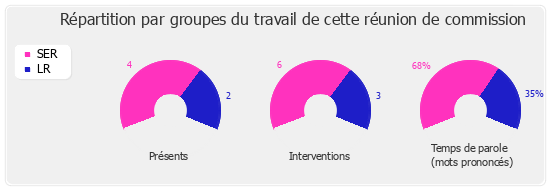Mission d'information sur les suites du référendum britannique et le suivi des négociations
Réunion du 15 décembre 2016 à 10h00
La réunion
La table ronde commence à dix heures dix.

Madame, messieurs, nous sommes heureux d'accueillir ce matin plusieurs représentants des cercles français de réflexion sur l'Europe. Nos travaux et nos déplacements nous ont déjà montré combien nous devions être attentifs aux négociations qui vont s'enclencher. La Grande-Bretagne, de son côté, commence à s'organiser : la Chambre des Communes a voté l'obligation pour le Gouvernement d'indiquer ses intentions en échange de l'autorisation d'activer l'article 50 du traité ; la décision de la Cour suprême, qui doit décider de la procédure qui sera utilisée, est attendue pour début janvier.
Les Vingt-Sept doivent s'entendre pour négocier. Et l'avertissement que représente pour l'Union européenne le vote britannique doit être entendu : c'est la première fois qu'un pays s'estime mieux protégé en sortant de l'Union européenne.
Merci, M. le président, de nous recevoir ce matin. Plusieurs de vos interlocuteurs précédents ont travaillé ou publié à la Fondation Robert Schuman, et nous lançons à la fin de cette semaine un laboratoire de recherche consacré au Brexit ; nous avons fait réaliser dans cinq pays européens un sondage, qui sera publié par la presse, sur le sentiment des Européens vis-à-vis du Brexit : je vous en remets les résultats en avant-première.
Vous savez que le Brexit n'est pas encore fait ; ce sera un processus de négociation long et complexe. Nous souhaitons que la négociation se déroule dans la sérénité, sans esprit de revanche ou de punition, mais dans le respect des règles européennes. Les Vingt-Sept doivent donc être très unis, et ne pas devancer les demandes britanniques en se montrant prêts à y répondre ; ces demandes ne sont d'ailleurs pas toutes connues, et parfois contradictoires. Le pire serait que le continent se divise, et fasse l'objet d'une négociation « curiacée » : ce serait en réalité préjudiciable à tous.
On tentera vraisemblablement d'aboutir à un accord de retrait. Mais, quoi qu'il en soit, avec ou sans le Royaume-Uni, avec ou sans accord, l'Union européenne – nous en sommes convaincus – continuera d'exister, comme elle existait avant l'adhésion britannique.
Cela ne veut pas dire que l'Union ne doit pas changer. Nous ne pensons pas qu'il faille « refonder » l'Europe, comme on l'entend trop souvent, mais qu'il faut l'adapter, en considérant qu'elle a réussi une première partie de son projet initial, et l'a même dépassé. Il est nécessaire aujourd'hui de lui fixer de nouveaux objectifs pour répondre à de nouveaux défis. À mon sens, les fondations de la maison Europe demeurent solides ; ce sont ses murs et ses façades qui demandent à être rénovés.
Il y a aujourd'hui de nouvelles tendances, de nouveaux défis, des surprises stratégiques qui résultent de bouleversements technologiques et géopolitiques : l'Europe doit apporter des réponses à ces évolutions. Cinq sujets me paraissent essentiels pour les démocraties et plus particulièrement pour les politiques européennes.
Il faut d'abord mentionner les libertés économiques, le rôle de l'État, le libre-échange, le commerce international.
Je pense également au rôle des institutions européennes dans ce cadre : doivent-elles par exemple négocier seules des accords de libre-échange ou des accords commerciaux ?
Le troisième de ces sujets, c'est la liberté de circulation, et le défi migratoire, qui est là pour durer.
Le quatrième de ces sujets, c'est la convergence et la gouvernance économiques de l'euro, qui posent des problèmes de souveraineté et de contrôle démocratique.
Enfin, le terrorisme et les guerres que nous menons au Levant constituent pour l'Europe une surprise stratégique : le cinquième sujet, c'est donc la sécurité et la défense.
Désormais, on peut dire que la politique d'élargissement est stoppée. On peut dire que la politique de concurrence est de plus en plus critiquée. On peut s'interroger sur la nécessité de la repenser – beaucoup appellent notamment de leurs voeux une refonte de la politique industrielle européenne. J'irai enfin jusqu'à dire qu'il faut modifier le logiciel des institutions communes. M. Jean-Claude Juncker le dit lui-même : nous avons trop réglementé ; le droit est indispensable au fonctionnement des institutions européennes, mais il ne doit pas constituer une fin en soi. Le mantra de « l'union sans cesse plus étroite » ne suffit pas : l'utilité même de l'intégration doit désormais être prouvée.
Sur tous ces points, la pratique de la Commission Juncker a déjà changé ; elle a même pris des libertés avec les traités.
Mais nous regrettons l'absence de parole forte des États membres sur ces interrogations partagées partout en Europe. La différence entre politiques communautaires et politiques intergouvernementales n'est pas la bonne grille d'approche pour fixer de nouveaux objectifs à l'Union : les avancées sont toujours venues de la volonté des États membres.
À l'avenir, l'intégration se fera, je crois, par l'exemple. Les États membres doivent exercer pleinement leurs compétences propres : l'immigration, par exemple, n'est pas une compétence des institutions communes.
En matière d'union économique, nous pourrions aussi attendre des initiatives – notamment franco-allemandes : je pense par exemple à un plan de rapprochement de nos fiscalités, en commençant par l'impôt sur les sociétés, puis en élargissant peu à peu à des problèmes aussi complexes que la parafiscalité, notamment sociale. Pour un rapprochement sur dix ans, chacun devrait faire chaque année un vingtième du chemin vers l'autre. Nous changerions ainsi la façon dont les investisseurs internationaux voient une union économique franco-allemande, puis européenne.
S'agissant des mouvements migratoires, les États les plus concernés pourraient également prendre des initiatives communes pour harmoniser les conditions d'octroi de l'asile et de gestion des migrations – délai, procédure, aides financières…
Nous pourrions également organiser la défense de l'Europe, au lieu de passer notre temps à nous interroger sur l'organisation de la défense européenne. Nous avons ainsi proposé un traité à trois rassemblant l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Il aurait pour objet de rassurer nos amis britanniques, mais aussi certains États membres sur notre engagement dans l'OTAN. Il autoriserait aussi les États de l'Union à construire une défense européenne qui rencontre les grandes difficultés que nous connaissons. Ce traité pourrait fixer des objectifs que le ministre de la défense M. Jean-Yves Le Drian a récemment rappelés – 2 % du PIB consacrés à la défense –, mais aussi organiser une coopération entre nos trois pays. Nos armées collaborent d'ailleurs déjà.
Ce projet pourrait permettre de débloquer l'idée d'une défense européenne, qui, aujourd'hui, piétine, malgré une initiative franco-allemande due à M. Le Drian et à son homologue allemande Mme Ursula von der Leyen. Au sein de l'Union européenne, les questions de défense sont un atout pour la France : c'est un domaine où nous sommes très crédibles, car nous sommes les seuls à disposer d'une armée complète, engagée en ce moment même sur plusieurs fronts.
Il me semble donc essentiel de fixer à l'Union européenne de nouveaux objectifs, et des objectifs précis. Au risque de vous surprendre, je rejoins sur ce point M. Hubert Védrine, qui a souhaité l'organisation d'une deuxième Conférence de Messine – je n'irai peut-être pas jusque-là, mais il faut à mon sens que les États membres disent clairement ce qu'ils attendent de l'Union européenne, profitant du fait que M. Jean-Claude Juncker a compris que l'Europe doit être plus politique.
Plus que des États malades de l'Europe, je crois que l'Europe est aujourd'hui malade de ses États. Ceux-ci doivent être plus actifs, plus impliqués. De grands débats vont se dérouler l'an prochain en France puis en Allemagne : ce sera, je l'espère, l'occasion pour nos États de s'engager plus avant dans la construction européenne et son avenir.

M. Pisani-Ferry, j'espère vous entendre sur le texte que vous avez commis cet été, et qui a provoqué un certain émoi en suggérant de séparer la libre circulation des personnes des trois autres libertés. C'était là une proposition bien pro-britannique !
Je ne manquerai pas de revenir, M. le président, sur ce texte « infâme », que j'ai signé à titre personnel. (Sourires.)
Je commencerai néanmoins par dire quelques mots plus généraux. La crise européenne ne se résume pas au Brexit. Aujourd'hui, nous avons collectivement le sentiment que nous ne sommes pas capables d'aller de l'avant, que nous ne voulons pas reculer, et que nous ne voulons pas demeurer dans la situation inconfortable où nous nous trouvons. Le sentiment général est que le moment n'est pas bon pour élargir encore l'Union européenne ; d'un autre côté, en dépit de toutes les difficultés que nous connaissons, personne n'a voulu sortir de l'euro. Donc il n'y a ni avancées franches ni reculs prononcés ; mais le statu quo ne satisfait personne.
Il est donc nécessaire de rouvrir la discussion, de façon libre, c'est-à-dire en se permettant de réexaminer certains éléments du contrat, de proposer d'aller de l'avant dans certains domaines, mais aussi de renationaliser d'autres politiques. Il faut en tout cas réfléchir en oubliant l'approche traditionnelle selon laquelle toute discussion a pour objet de franchir une nouvelle étape vers l'intégration – ce qui peut être nécessaire dans certains domaines, mais pas dans tous.
Dans le contexte général de la mondialisation et de la montée des populismes, il me semble qu'il existe aujourd'hui un doute sur le contrat fondamental qui stipule qu'en matière économique et sociale, l'Union s'occupe de l'efficacité et les États membres de la redistribution et du partage des revenus. C'est évident en matière commerciale : l'Union soutient et promeut la libéralisation, tandis que les États membres se préoccupent des conséquences de ces politiques. Cela veut dire que ce sont les États qui doivent gérer les « perdants de la mondialisation », tandis que l'Union est relativement absente de ces débats. Elle est inexistante dans les débats sur les inégalités, quand elle n'apparaît pas comme indifférente aux conséquences de ses propres politiques, voire comme entravant des politiques nationales destinées à corriger les effets de ces politiques.
C'est un problème grave d'économie politique : cette répartition des rôles a très bien fonctionné pendant longtemps, parce qu'elle préservait l'indépendance des États en matière de politique sociale tout en laissant à l'Union européenne le soin de soutenir le développement économique. Aujourd'hui, cela ne marche plus, et les États membres se retournent contre une Union qui, je le redis, est absente des débats sur la montée des inégalités. Cela nous ramène au Brexit et à l'interprétation du vote britannique.
À mon sens, la sortie britannique peut aussi nous permettre de rouvrir certains sujets qui étaient jusque-là bloqués.
Je pense par exemple au budget européen, qui ne correspond pas aujourd'hui à ce que nous pourrions espérer, tant en ce qui concerne ses priorités que ses niveaux d'action. On peut se demander si l'échelle régionale est la plus judicieuse. N'aurions-nous pas besoin de politiques beaucoup plus fines, plus temporaires aussi, destinées par exemple à absorber des chocs et à revitaliser des régions, mais aussi de politiques d'investissement dans le capital humain plus que dans le développement régional ? Aucun bilan exhaustif n'a été dressé, mais la crise de l'euro a montré, je crois, que ces politiques régionales n'ont pas vraiment contribué à une meilleure résilience économique des pays qui en ont bénéficié.
De même, les Britanniques étaient, pour des raisons doctrinales, les principaux opposants à l'ouverture d'une discussion sur la question fiscale : nous pourrions rouvrir ce débat.
J'en viens maintenant au texte que vous avez mentionné, M. le président, et que j'ai rédigé avec d'autres, tous agissant à titre personnel. Notre idée était que le Brexit nous faisait courir des risques substantiels, et que son coût économique direct pourrait être important – et cela d'autant plus que l'on s'achemine vers un divorce pur et simple. Il existe aussi un risque d'affaiblissement de l'Europe, dans un contexte particulièrement instable et dangereux ; un risque d'accélération de notre disparition collective de la scène mondiale, alors que s'affirment des puissances nouvelles ; un risque, enfin, d'accentuation de la concurrence budgétaire et fiscale sur le continent européen.
Mais le Brexit offre aussi, à notre sens, des opportunités, et notamment celle de réfléchir à la façon dont l'Union européenne organise les relations avec son voisinage, dans un nouveau contexte où les perspectives d'élargissement sont quasi inexistantes, où il nous faut pourtant trouver une solution, s'il en est encore temps, à la question turque, et plus largement où il est nécessaire de proposer des solutions à d'autres pays qui n'ont pas vocation à rentrer dans l'Union, mais qui entretiennent et entretiendront néanmoins des relations étroites avec elle.
Notre idée était donc de faire du Brexit l'occasion d'une réflexion sur une nouvelle organisation de l'espace européen, qui comprendrait un cercle très intégré autour de l'Union – cercle qui se rapprocherait fortement, à terme, de la zone euro – et un cercle plus large, dont les liens avec l'Union seraient différents, qui serait organisé autour de l'Union et plus multilatéral qu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons proposé ce « partenariat continental », destiné à associer à l'Union des pays qui n'en sont pas membres – le Royaume-Uni et les pays de l'espace économique européen, mais aussi demain l'Ukraine ou la Turquie, voire d'autres pays du pourtour méditerranéen. Ces pays seraient étroitement associés à la décision, de façon plus partenariale que ne sont les relations que nous avons aujourd'hui avec la Norvège par exemple. Ce partenariat serait construit sur une base strictement intergouvernementale – la sortie britannique constituant bien un refus de participer à l'Union et à sa gouvernance.
Je précise ici que ce texte est aujourd'hui largement caduc, compte tenu de l'orientation prise de part et d'autre.
Nous avions souligné trois problèmes à résoudre.
Le premier est celui du marché intérieur et des quatre libertés. Nous défendons dans ce texte l'idée que la liberté de circulation des personnes est fondamentale pour les pays membres de l'Union européenne : c'est un élément de citoyenneté économique. La possibilité pour un citoyen de l'Union d'aller chercher du travail ailleurs, sans demander la permission à personne, est essentielle, surtout aux yeux des jeunes, qui en font d'ailleurs largement usage.
En revanche, elle n'est pas indispensable au fonctionnement d'un marché intégré des biens et des services : celui-ci a besoin d'un degré élevé de mobilité, mais ce n'est pas la même chose que la liberté d'installation. L'idée que l'on ne puisse pas dissocier intégration économique et liberté de mouvement des travailleurs passe difficilement le test de l'analyse froide. C'est pourquoi nous avions proposé cet arrangement, qui aurait naturellement concerné uniquement des pays non membres de l'Union. Nous n'avons jamais pensé à remettre en cause la liberté de circulation des personnes au sein de l'Union ! Les négociations avec l'Ukraine vont d'ailleurs dans le sens que nous indiquions : accès au marché intérieur, mais pas de liberté de circulation des personnes.
La deuxième question est celle des formes de l'association à la décision. Dans un partenariat continental, les pays non membres de l'Union ne pourraient évidemment pas détenir de droit de vote : l'Union doit préserver ses procédures propres de décision. En revanche, elle peut mettre en place des procédures de consultation étendues, permettant, au fur et à mesure de l'élaboration d'un texte, de recueillir des remarques et des propositions d'amendements des pays partenaires. Nous proposions donc un conseil du partenariat, où s'ouvrirait un dialogue sur les initiatives législatives.
La troisième question est celle de l'application des règles. Il est évident que l'on ne peut avoir accès au marché intérieur si l'on n'applique pas ses règles et si l'on ne se soumet pas à sa discipline. La politique de la concurrence, certaines normes sociales et de protection du consommateur sont essentielles ; leur respect doit faire l'objet d'une vérification, dont les mécanismes sont nécessairement supranationaux.
Voilà les propositions que nous avions faites. Il ne s'agissait pas pour nous de proposer un agenda du divorce, dont les négociations seront très dures et très complexes. Ce que nous voulions, c'est fixer un objectif à terme, suggérer une solution durable à la question des relations entre le Royaume-Uni et les Vingt-Sept. Nous espérions ainsi minimiser le coût pour les uns et les autres d'une séparation trop abrupte, mais aussi informer les conditions de la négociation du divorce, sans que les préoccupations tactiques la dominent à l'excès.
L'orientation que prend la discussion, de part et d'autre, n'est pas celle-là : les Britanniques sont intransigeants et les Vingt-Sept sont unanimes sur le fait que les quatre libertés sont inséparables. Reste que nous devons bien nous interroger sur les conséquences de ce divorce.
Les quatre organisations réunies ce matin ont beaucoup de points communs, mais aussi quelques différences : c'est ce qui fera la richesse de notre débat.
Je partirai d'un paradoxe : la plupart des défis auxquels nos pays sont confrontés devraient nous conduire à renforcer l'intégration européenne, mais partout en Europe, le repli national est à l'ordre du jour.
Le Brexit n'illustre pas une crise britannique, mais européenne, et au-delà une crise des pays occidentaux. Nous faisons face à une menace d'explosion ou de délitement de l'Union européenne : il faut y prendre garde.
Cette crise est d'abord économique et sociale – je ne reviens pas sur la faible croissance que connaît notre continent ni sur la croissance des inégalités. Elle résulte aussi d'une inquiétude de nos concitoyens face à des défis nouveaux en matière de sécurité, de changement climatique, de numérique ; ces inquiétudes poussent nos concitoyens au repli. La crise est enfin une crise démocratique : la méfiance croît vis-à-vis des institutions. Les Européens ont, plus largement, le sentiment d'être dépossédés de leur avenir.
C'est la nature de cette crise qui nous pousse à dire que l'Union européenne doit dire où elle veut aller dans les années qui viennent : c'est un passage obligé pour animer la négociation avec les Britanniques. Nous parlons, nous, de « se réinventer », de « se refonder » : les défis auxquels l'Union est confrontée ne sont pas sur la trajectoire tracée par les cinquante années de construction européenne. La profondeur du désarroi des Européens oblige à consentir un effort important.
On parle beaucoup de la distance qui sépare l'idée européenne, ou l'Union européenne, des peuples. Notre organisation travaille avec les acteurs économiques et sociaux des différents pays européens : eux aussi ressentent cette distance. Je ne prendrai qu'un seul exemple : celui du climat. La réussite de la COP21 nous amène à attendre de l'Union européenne une politique très forte en la matière. Or nous sommes absolument en panne, sur la question du prix du carbone comme sur l'établissement d'une stratégie – les États communiquent leurs stratégies, mais celles-ci entrent en contradiction les unes avec les autres. Nous sommes tout autant en panne sur le plan industriel : champions de l'installation d'équipements utilisant les énergies renouvelables, nous sommes pourtant incapables de construire des filières de production industrielle dans ce domaine. Cela montre la profondeur de la rénovation nécessaire.
Le Brexit sera hard : cela apparaît comme une évidence. Les Vingt-Sept doivent donc tenir bon sur les fondamentaux tels qu'ils existent aujourd'hui ; toute autre démarche serait suicidaire. Mais ce sera très difficile dans des délais très brefs. Il est un point sur lequel nous sommes particulièrement vigilants : un accord intérimaire qui déterminerait un calendrier en vue d'une série de négociations échelonnées dans le temps risquerait d'aboutir à une addition de concessions dans lesquelles les Vingt-Sept perdraient leurs objectifs stratégiques et d'intérêt commun au profit d'intérêts nationaux divers et fluctuants. Voilà pourquoi ils vont devoir dire très clairement ce qu'ils veulent faire ensemble demain.
Comment la chose est-elle perçue, nous demandez-vous, dans d'autres pays de l'Union européenne, particulièrement en Europe centrale ? Cette question est vitale, car l'une des faiblesses de la construction européenne est une grande difficulté à entendre et à comprendre les différences politiques, socio-économiques et culturelles entre nos pays, d'où une certaine tendance, au niveau des institutions européennes, à confondre union et uniformité. Pour notre part, nous sommes convaincus que le respect des différences n'est pas contraire à la solidarité ni à la communauté de destin, mais qu'ils doivent être intimement liés. Les dirigeants polonais et hongrois, notamment, trouvent dans le Brexit une confirmation de leur diagnostic sur le besoin d'une réforme profonde de l'Union européenne. Schématiquement, ils se posent en défenseurs de la souveraineté et de l'identité nationales et s'inquiètent d'une intégration plus poussée, en particulier au sein de l'union économique et monétaire ; ils veulent davantage d'intergouvernemental. Toutefois, les citoyens de ces pays, et probablement une partie de leurs dirigeants, restent attachés à l'idée et à l'Union européennes. Il n'y aura donc sans doute pas de tentative réelle de sortie de l'Union.
En revanche, il existe des inquiétudes, notamment concernant les fonds structurels. La sortie des Britanniques va obliger l'Union européenne à retrouver 10 milliards d'euros pour compenser les recettes manquantes et, si les mesures d'accompagnement, particulièrement les fonds structurels, venaient à diminuer, cela poserait dans ces pays des problèmes de croissance, mais également de gros problèmes d'adaptation au moment où des efforts considérables doivent être consentis.
Nous ne croyons absolument pas que la future dynamique européenne reposera sur un renforcement de l'intergouvernemental, contrairement à ce que disent par exemple les Polonais. En revanche, le besoin de réinventer et de réarticuler les relations entre l'union économique et monétaire et les États membres est évident. C'est, de notre point de vue, l'un des aspects d'une réinvention de l'Europe susceptible de réconcilier les citoyens avec le projet européen. À cet égard, nous ne croyons guère que quelque sommet de chefs d'État que ce soit permette de refonder l'Europe, une Europe qui prendrait en compte les attentes de ses citoyens. Cela ne veut pas dire que nous n'en attendons pas beaucoup des gouvernements ; au contraire. Mais, dans ce domaine, nous sommes assez sceptiques.
Nous ne croyons guère plus au référendum. Les trois consultations référendaires qui se sont déroulées en Europe cette année – au Royaume-Uni, en Hongrie, en Italie – mêlaient chacune, à des degrés divers, de vraies questions et des enjeux de politique partisane. Il est absolument nécessaire, et même vital en démocratie, de consulter les citoyens, mais il faut se méfier de l'instrumentalisation de cet outil et, surtout, ne pas oublier qu'il ne saurait combler le manque d'espaces de délibération, qui seuls permettent de dépasser l'opposition des intérêts dans chacun de nos pays et entre les pays européens. C'est d'autant plus vrai dans un monde dont la complexité est croissante et où les compromis sont de plus en plus difficiles à trouver.
Tout cela conduira certainement, si l'on avance dans le processus de refondation, à modifier les institutions, mais ce changement ne pourra intervenir qu'en conclusion de ce processus : il ne saurait être une clé d'entrée, compte tenu de la nature de la crise que nous connaissons.
C'est la question de l'avenir de l'Union qui nous est posée, et du risque de son délitement. Le problème de fond est le suivant : malgré la défiance qui s'est installée, qu'acceptons-nous de partager entre Européens, entre peuples européens, au sein de la zone euro et de l'Union européenne, et dans quel dessein ? C'est ce qu'il importe de se demander au lieu de commencer par des institutions et des traités, ne serait-ce que parce qu'ils ne peuvent pas nous être imposés d'en haut, mais supposent que l'on rapproche au préalable les peuples et les nations.
J'aborderai d'abord la consolidation de l'union économique et monétaire – le premier cercle – et ce que le Brexit y change. Mais cette consolidation n'est pas possible sans celle de l'Union européenne. Les Britanniques pourraient être inclus dans un troisième cercle. Enfin, j'évoquerai le besoin d'union politique.
Sur le premier point, le principal défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés résulte des déséquilibres des balances des paiements courants et des divergences de trajectoire de compétitivité industrielle, qui menacent l'intégrité de l'Union et plus encore celle de l'union monétaire. Le départ des Britanniques change la donne, puisqu'ils n'auront plus leur mot à dire sur cette consolidation. Mais, à l'heure actuelle, il n'existe pas de consensus, notamment franco-allemand, sur les grandes réformes qui ont été esquissées et dont nous avons besoin, en particulier s'agissant de la conciliation entre la solidarité et la mutualisation des investissements, d'une part, et d'autre part les indispensables réformes de structure nationales qui ne sont pas nécessairement mises en oeuvre. La Commission prépare un livre blanc sur le sujet pour le printemps ; l'enjeu est précisément de parvenir à un accord entre États membres – ce qui impose à chacun un travail sur soi.
Cette consolidation, je l'ai dit, n'est pas envisageable sans une consolidation de l'Union européenne. À ce propos, il convient de noter un certain tropisme français qui nous incite à nous concentrer sur la zone euro alors que des questions absolument essentielles – la stratégie de compétitivité industrielle, l'union pour l'investissement ou union des marchés de capitaux, la sécurité intérieure et extérieure, les migrations, le climat, la politique extérieure – se décideront plutôt au niveau de l'Union européenne. Celle-ci ne doit pas être réduite à un grand marché, contrairement à ce que les Français ont tendance à faire, mais intégrer aussi des dimensions de politique publique européenne. Par ailleurs, en nous repliant sur la zone euro, nous échouerions à atteindre la masse critique requise et nous renoncerions à l'idéal fondateur d'union de tous les Européens.
Cette union doit donc tenter de devenir une union pour l'investissement. Nous souffrons en Europe d'une carence majeure d'investissements – en capital humain, dans l'innovation industrielle, transfrontières. Or ces investissements se traduisent en production et en emplois sur tout le territoire européen, et non dans la seule zone euro, et permettent de gagner en compétitivité, donc de parer au risque de divergences qui pourraient faire exploser l'Union.
Enfin, nous avons besoin d'union politique, à un moment où les peuples doutent de l'Union – non qu'ils la remettent entièrement en cause, mais parce qu'ils s'interrogent sur la direction qu'elle prend et la manière dont elle se construit depuis le début. Ils ont le sentiment que les politiques européennes sont imposées d'en haut, ce qui n'est plus admissible pour la plupart d'entre eux, notamment pour le peuple français.
Nous aurions besoin d'un traité de refondation de l'Union, mais toutes les conditions n'en sont pas pour l'heure réunies : il faudrait s'accorder sur beaucoup alors que nous ne sommes prêts à nous accorder que sur très peu, comme le disait M. Philippe Herzog, président fondateur de Confrontations Europe. L'enjeu est donc de parvenir à s'accorder sur des domaines d'intérêt stratégique commun dans lesquels il serait possible de développer des coopérations renforcées : par exemple, la sécurité collective, l'investissement dans le capital humain et l'innovation – un domaine où l'Union est aujourd'hui beaucoup trop faible –, le climat et le développement durable ou encore la réindustrialisation.
Dans ce cadre, quelle est actuellement la place du Royaume-Uni en Europe ? Les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union, donc du deuxième cercle ; il convient d'en prendre acte. Ils restent cependant un partenaire essentiel, dont il faut par conséquent prévoir la place au sein d'un troisième cercle. Confrontations Europe propose un statut d'État associé qui pourrait être étendu à d'autres, mais qui serait ad hoc – à rebours du one size fits all – et prendrait la forme d'une sorte de contrat négocié avec le Royaume-Uni.
L'union politique a besoin de réformes de fond, pour une véritable autorité politique qui assume entièrement ses responsabilités, dans le dessein non pas d'imposer quoi que ce soit d'en haut, mais de rapprocher les perspectives dans les domaines d'intérêt stratégique, par l'intermédiaire de quelques ministres. Peut-être faudrait-il également aller vers la synchronisation des élections nationales et des élections européennes, et resserrer de plusieurs crans la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux – à cet égard, la balle est dans votre camp.
Je commencerai par un constat sur le vote du 23 juin dernier : il s'agit d'un choix démocratique dont il faut évidemment tenir compte. L'Union européenne n'est pas une prison ; le vote britannique a le mérite de nous le rappeler. C'est une différence notable avec l'Union soviétique à laquelle on lui reproche souvent de ressembler. Les Britanniques ont fait ce choix que, pour ma part, je regrette, mais dont nous devons prendre acte.
Pour l'Institut Jacques Delors, il s'agit d'un cas d'espèce. Les Britanniques étaient depuis le début à moitié dans l'Union, à moitié dehors, suffisamment peu convaincus de la nécessité d'appartenir à la Communauté économique européenne pour organiser un référendum d'appartenance deux ans après l'adhésion, ce qui était assez original et signalait bien un malaise. Ce cas d'espèce s'intègre certes dans un contexte international, dans une tectonique des plaques qui concerne l'ensemble des pays européens et, de manière générale, occidentaux, dont les États-Unis ; mais, lorsqu'il s'agit de discuter de la sortie ou non, de l'appartenance ou non à l'Union européenne, c'est bien un cas d'espèce.
Il ne faut pas confondre l'europhobie majoritairement exprimée par les Britanniques, et qu'incarnaient si bien leurs tabloïds, avec les euroscepticismes. Ceux-ci existent sur notre continent depuis des années, y compris parce que l'Union européenne a agi, même si elle l'a fait trop peu et trop tard, face à la crise de la zone euro. Son action a suscité un euroscepticisme anti-austérité qui est l'exact pendant de l'euroscepticisme antisolidarité. Les Allemands, les Slovaques, les Finlandais n'ont pas aimé être solidaires. Les Grecs, les Irlandais, les Portugais n'ont pas aimé les conditions dans lesquelles cette solidarité a été accordée. On pourrait dire la même chose à propos de la crise migratoire.
En bref, nous assistons aujourd'hui en Europe à une crise de copropriétaires. Les Britanniques déménagent, les autres vont rester. Dire cela, ce n'est pas minimiser ce genre de crise, qui peut être terrible : on ne se parle plus, on ne veut plus payer les charges communes, etc. Mais il importe de bien caractériser la situation.
Dans ce contexte, que faire ? M. Jacques Delors évoque souvent à propos de la construction européenne les pompiers, les maçons et les architectes : ce sont ces trois corps de métier qui vont devoir se mettre en mouvement – disons-le tout de suite, nous manquons un peu d'architectes.
Les pompiers, d'abord, doivent non pas éteindre l'incendie parce qu'il risquerait de se propager selon la théorie des dominos, mais organiser un divorce. Les Britanniques ont voté : ils vont partir ; comment ? Je dirais qu'ils ont tiré les premiers, mais que la balle est toujours dans leur camp : il ne faut pas les devancer ; c'est d'ailleurs sans doute la manière dont il tentait de le faire qui m'a le plus choqué dans l'article cosigné par M. Jean Pisani-Ferry.
Les Britanniques ont d'autant plus de mal à savoir ce qu'ils veulent que le « non » à l'Europe était divers : il se composait d'un « non » souverainiste, qu'incarnait bien M. Boris Johnson ; d'un « non » anti-libre circulation, anti-immigration, représenté par M. Farage ; enfin – ne l'oublions pas –, de celui de M. Murdoch, très libéral, qui veut sortir de l'Europe pour retrouver des marges de manoeuvre dans les relations commerciales, en particulier avec les pays émergents. Qu'ils se mettent d'accord ! Rendons à Shakespeare ce qui est à Shakespeare.
De notre côté à nous, Européens, le menu est varié : statut à la norvégienne, à la suisse, à la canadienne, à la turque – à eux de choisir. Mais ils voudront évidemment commander à la carte ; et ils auront, je crois, un statut à la britannique. Ils l'avaient déjà en étant membres de l'Union ; ils le rechercheront lorsqu'ils ne le seront plus. Peut-être aurons-nous d'ailleurs intérêt à leur concéder deux ou trois aménagements pour qu'ils se sentent à l'aise, car ils devront rester notre partenaire stratégique. Cela dit, je le répète, laissons-les exprimer leurs désirs et lancer eux-mêmes la procédure.
Venons-en aux maçons et concentrons notre attention sur l'Union européenne à vingt-sept, à l'heure où un Conseil européen se réunit dans ce format. Que peuvent faire les Européens à vingt-sept, sinon s'efforcer de ne pas se désunir dans la gestion du divorce avec les Britanniques ? Ils doivent évidemment se concentrer sur plusieurs projets communs, qui ont été assez bien identifiés à Bratislava. On peut également citer l'union de l'énergie, que nous promouvons au sein de l'Institut Jacques Delors depuis de nombreuses années ; l'approfondissement de l'union économique et monétaire, à propos duquel nous avons aussi produit des documents en franco-allemand ; le soin à apporter à la conduite des politiques commerciales européennes, laquelle doit être plus transparente.
À Bratislava, plusieurs éléments se dégagent, à commencer par les enjeux de migration et de frontières, identifiés comme essentiels par les Vingt-Sept et qui renvoient à ce que souhaitent les opinions publiques. Nous devons avancer dans cette direction, et c'est ce que vont faire, je l'espère, les chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui et demain. Un corps européen de garde-frontières va se mettre en place ; c'est une avancée fédérale qu'il faut consolider. Mieux vaut contrôler ensemble nos frontières européennes plutôt que rétablir ponctuellement des contrôles à nos frontières nationales, même si cette démarche est tout à fait autorisée. Harmonisons aussi le droit d'asile. Tout cela dessine un chemin.
Un autre chemin est celui de la sécurité collective, dans un contexte favorable du fait de la sortie du Royaume-Uni, d'une part, et de la victoire de M. Donald Trump, d'autre part. Il s'agit d'abord de la sécurité intérieure. Nos compatriotes, français et européens, se sont fait tuer par des terroristes au cours des mois précédents ; cela arrivera peut-être à d'autres : la menace demeure. Face à cette menace, il faut renforcer la coopération judiciaire, policière et l'échange de renseignements. Ce n'est pas facile, mais nous en avons grand besoin.
Il s'agit ensuite, naturellement, de la sécurité extérieure. Le pilier européen de la défense atlantique doit être consolidé. Tout nous y pousse désormais. L'Europe de la défense a été lancée à une époque où nous n'avions pas besoin de nous défendre et où il n'y avait pas d'Europe : cela ne facilitait pas la tâche. Aujourd'hui, au contraire, les menaces sont partout autour de nous – la Russie, l'État islamique, le chaos en Syrie, la Libye, le Sahel – et peut-être y aura-t-il une véritable Europe de la défense dès lors que l'oncle Trump pourrait ne pas nous aider autant qu'il le faudrait et que le Royaume-Uni, qui doit rester un acteur important, ne sera plus membre de l'Union européenne.
Il s'agit, enfin, de l'investissement et de la priorité accordée à la croissance et à la jeunesse. La capacité financière du plan Juncker a été tout récemment accrue ; il faut s'en féliciter. Le programme Erasmus Pro va être expérimenté, comme nous l'avions proposé ; nous nous en réjouissons.
Mais, une fois que les maçons auront défini leur feuille de route, une fois qu'ils auront, aujourd'hui et demain, progressé à ce sujet, si nous ne disons pas où nous allons, nous ne susciterons que l'enthousiasme modéré des peuples – même s'ils sont divisés quant à la destination de l'entreprise européenne. M. Jean-Dominique Giuliani a eu raison de souligner que ce qui a été fait jusqu'à présent est un succès. Il faut maintenant aller plus loin, peut-être sur un mode différencié : si tout le monde n'est pas prêt à avancer, faisons-le à quelques-uns ! Quoi qu'il en soit, il faut situer toutes ces réalisations dans une perspective d'ensemble. À l'heure où nous sommes amputés d'un membre, il est d'autant plus essentiel de nous demander pourquoi nous restons ensemble.
Premier élément de cette vision d'ensemble : il faut redonner un sens à l'Union européenne comme espace d'opportunités et surtout, en temps de crise, comme réponse aux menaces, à condition de se donner le temps et l'énergie politique de nommer celles-ci – sans quoi c'est l'Union elle-même qui peut apparaître comme une menace. Aux menaces sécuritaires déjà mentionnées s'ajoute d'abord le changement climatique, qui fournit un bon exemple de la capacité de mobilisation européenne : une fois la menace identifiée, les Européens, unis dans leur diversité, ont entraîné le monde vers la signature de l'accord de Paris sous l'impulsion de la France. Ensuite, la finance folle : que font les Européens pour lutter contre elle ? Quant à la montée en puissance de la Chine, c'est aussi une menace supplémentaire, et non pas seulement une opportunité.
Deuxièmement, au moment où les Britanniques s'apprêtent à nous quitter, nous devons essayer de montrer ce qui nous unit dans notre diversité. Nous représenterons bientôt 6 % de la population mondiale. Nous sommes évidemment différents les uns des autres, mais de la même façon qu'un Aquitain est différent d'un Nordiste ! Il faut regarder le monde pour se sentir plus européens. Nous sommes unis par un modèle qui tente de concilier efficacité économique, cohésion sociale et protection de l'environnement ; un modèle dont on verra comment, avec M. Donald Trump, l'Amérique va s'éloigner encore davantage : car c'est un modèle européen, et non pas seulement occidental. On le mesure aussi au regard de la Chine. Nous sommes européens parce que nous avons en partage la démocratie, l'État de droit, le respect des minorités, l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous devons en être fiers, souligner que cela nous unit. Nous sommes européens parce que nous avons appris à privilégier le règlement pacifique des différends ; nous n'envoyons pas des soldats sans uniforme se faire tuer en Ukraine : nous ne sommes pas les Russes ! Il faut affirmer plus clairement notre identité et notre vision européennes.
Dans une crise de copropriétaires, ceux-ci peuvent continuer d'avoir intérêt à rester ensemble – comme cela arrive dans les divorces, pour les enfants. Si les copropriétaires de la maison européenne se donnaient la peine de regarder ce qui se passe sous leurs fenêtres – tout brûle autour de nous ! – et un peu plus loin, peut-être ressentiraient-ils davantage la nécessité de mettre en oeuvre des projets collectifs, mais aussi le sens de leur appartenance à l'Union européenne. C'est important, même si cela paraît purement conceptuel : là est aussi le défi que nous ont lancé les Britanniques en nous annonçant leur départ.

Merci à tous les intervenants pour leurs exposés, tous très intéressants par-delà les différences d'analyse.
Je ne partage pas la thèse selon laquelle le Brexit serait une exception accidentelle. Certes, il existe historiquement une spécificité britannique qui distingue le grand large du continent, mais j'observe que la construction européenne a une image très dégradée, ou du moins qu'elle suscite une très forte interrogation, dans pratiquement tous les milieux. Cette interrogation est motivée par la crise identitaire, qui renvoie à l'impuissance européenne présumée à contenir les flux migratoires et à défendre notre territoire, et par la crise sociale, qui renvoie à une autre forme d'impuissance face à la mondialisation, l'Europe étant même considérée comme le porte-avions de la mondialisation et du déclassement. Ces deux éléments, très dangereux, conduisent l'Europe à marcher sur un fil.
Je suis tout à fait d'accord pour dire que de nouvelles urgences se sont fait jour, auxquelles nous devrions pouvoir répondre : la sécurité, les frontières, l'asile, etc. Dans ces domaines, l'Europe agit, et assez vite. Nous devons reprendre cette démarche pragmatique s'agissant de nouvelles politiques.
Mais il nous faut être clairs quant à l'articulation entre la nation et l'Union. Nous – nous-mêmes, Français – ne cessons d'entretenir l'équivoque. Quand un problème nous gêne, c'est la faute de l'Europe. On suggère ainsi que l'Europe est une nation. Mais on ne peut pas dire « l'Europe a décidé » : l'Europe, c'est nous ! Tout le monde dans ce pays est capable de comprendre, si on le lui explique, que l'Europe est plutôt une communauté de communes ou un syndicat de communes qu'une nation qui décide et qui nous impose ses décisions.
Il est urgent de reprendre le contact avec l'opinion. Nous avons fait une construction politique par la voie juridique, et non par la voie démocratique. Or on ne peut plus contourner la voie démocratique quand on est débordé par les réseaux sociaux où circulent toutes sortes de rumeurs.
D'où ma question, quelque peu paradoxale : sachant que nous sommes paralysés lorsqu'il s'agit de réformer les traités, à moins de satisfaire la revendication référendaire qui ferait tout disjoncter, ici comme au Royaume-Uni, la reconquête de l'Union ne passe-t-elle pas par celle des opinions publiques nationales ? N'est-ce pas dans l'espace public national qu'il faut résoudre le problème ?
Je pourrais poser la même question aux politiques, et je crains le pire dans les semaines à venir. Nous vivons une panne terrible : le seul espace public acceptable pour la population est l'espace public national. Or, dans cet espace, on ne l'informe pas de ce que fait l'Europe, dont on a au contraire tendance à parler de manière uniquement péjorative.
Les évolutions actuelles en matière de protection des frontières sont rapides ; il ne s'agit pas seulement de Frontex, mais aussi du fameux document d'autorisation d'entrée en Europe, sur le modèle de l'autorisation américaine – bref, d'éléments très concrets. Qui le sait en France ? Qui, dans notre pays, a conscience du fait que, grâce à l'Europe, nous avons évité le pire dans la crise des dettes souveraines, même si cela a été très pénible ?
Dans cette matière, ce n'est pas seulement Bruxelles qui est interpellée, mais nous-mêmes, directement. C'est un problème de transparence et de pédagogie : il faut expliquer ce qu'est l'Europe, ses forces comme ses faiblesses. La fuite en avant dans de nouveaux projets européens et de nouveaux traités est impossible. Soyons donc au moins clairs avec nos opinions publiques. Qu'en pensez-vous ?

Je vous remercie à mon tour de ce que vous avez dit, qui nous aide beaucoup à réfléchir ; c'est très intéressant et plus que jamais nécessaire.
Je partage l'analyse selon laquelle le Brexit ne fait que révéler une crise profonde. Tout dépend de la façon dont nous allons y répondre. Cessons donc de nous interroger : nous prendrons acte de la décision britannique, même si nous la déplorons ; mais c'est d'abord de nous que dépend l'évolution de la situation, de nous qui restons au sein de l'Union européenne.
Je ne m'attarderai pas sur l'article de M. Jean Pisani-Ferry, auquel j'avais d'ailleurs immédiatement réagi lors d'un dîner à l'ambassade du Royaume-Uni où nous étions l'un et l'autre conviés, en faisant valoir que l'on n'entre pas dans une négociation en abandonnant le principe de l'unité du marché intérieur ; mais M. Jean Pisani-Ferry en prend maintenant acte, et nous sommes passés à autre chose.
Je crois moi aussi essentiel de réfléchir à la future architecture européenne, et d'écarter l'éventualité d'un partenariat unique qui s'appliquerait au Royaume-Uni comme à la Turquie : une approche différenciée sera nécessaire. Je partage le point de vue selon lequel il vaut mieux réfléchir à une forme d'accord d'association renforcée, en prêtant attention à ce que veut le Royaume-Uni ; j'espère que le pays fera les concessions nécessaires pour être le plus proche possible de l'Union européenne.
En vue de notre rapport, il importe de bien situer le principal problème auquel l'Union européenne est aujourd'hui confrontée, à savoir l'éloignement des peuples. Sur ce point, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Gilles Savary. Cela va nous obliger à nous demander comment remédier aux défauts de l'Union européenne, à recentrer nos objectifs – comme vous l'avez tous dit – sur des priorités compréhensibles par les peuples, et non sur des réglementations que personne ne comprend et qui, souvent, insupportent, à juste titre. Enfin, il faudra adapter nos moyens. Sur tous ces sujets, vous avez formulé des propositions intéressantes.
Le big bang institutionnel… on s'y est essayé en 2005. À l'évidence, ce ne peut être que l'aboutissement d'une réflexion démocratique sur les projets que l'on veut poursuivre avec les peuples – et il est faux de prétendre que l'on puisse du passé faire table rase. Quelles sont donc les réussites, même imparfaites, de la construction européenne ? L'espace Schengen, l'euro, Erasmus. Ce sont trois desseins précis, mais pour la réalisation desquels les moyens, notamment institutionnels, ont par la suite été quelque peu comptés.
Notre entreprise collective doit être de définir mieux encore ce qui nous unit et de mieux répondre aux peurs des peuples, à la hantise du déclin économique et social – nous ne pouvons faire l'impasse sur le chômage des jeunes ! Il nous faut aussi réussir à régler la crise suscitée par les migrations et assurer la sécurité collective. Il est heureux que le Conseil européen se consacre aujourd'hui même – enfin ! – à ces questions ; il serait bon de reprendre la proposition tendant à la tenue de ce Conseil ad hoc au moins une fois par an. Et puis, parce que les peurs des peuples européens ne tiennent plus seulement aux difficultés internes à l'Union, mais aussi à l'évolution du monde, il faut déterminer les composantes extérieures de toutes les politiques européennes sans exception. Nous devons enfin réfléchir à une nouvelle architecture institutionnelle pour une Europe « unie dans la diversité », comme le veut sa devise.
Dans un contexte d'extrême gravité, puisque le risque de dislocation et de désintégration de l'Union européenne est réel, vous, qui, à quelques nuances près, partagez la même envie que l'Union européenne s'en sorte, ne pourriez-vous définir ensemble ce qui nous unit tous ?

Vous entendre vous interroger, madame, messieurs, est pour moi un plaisir sans mélange. Enfin ! Vous, que beaucoup considéraient comme des « euro-béats » convaincus, commencez à questionner la faillite d'une construction européenne qui ne peut aller de l'avant sur sa lancée actuelle.
Pour commencer, deux axiomes s'imposent. Le premier est que, si le Royaume-Uni est sorti d'une organisation internationale qui a pour nom « Union européenne », il n'est pas sorti de l'Europe ; les lois de la géographie valent pour le Royaume-Uni comme pour le reste de l'Europe. Le second est que, comme l'a rappelé M. Gilles Savary, la démocratie s'exerce au niveau de la cité et de la nation, lieux de cohésion culturelle que ne sont ni un continent ni l'Organisation des Nations unies.
Ensuite, comment en est-on arrivé là ? Le projet d'Union européenne est né dans les années 1950, à juste titre, pour éviter une nouvelle guerre franco-allemande. La tentative de Gustav Stresemann et la Société des Nations ayant échoué, il fallait trouver autre chose. On y a réussi, non par un traité et des règles, mais grâce à une révolution culturelle, l'Allemagne ayant compris qu'elle devait vivre en harmonie avec ses voisins. Mais, parce que l'on pensait en fonction de ce qu'était le monde d'alors, celui des blocs, le projet a été de constituer un bloc européen entre le bloc américain et le bloc soviétique, et l'on a poursuivi sur cette voie, celle d'une Union européenne unique au point d'en devenir intégriste. Cet intégrisme, sous sa forme la plus achevée, l'euro, est en train de tuer l'Europe, car une monnaie commune à des économies divergentes, sans budget fédéral, est vouée à l'échec – et l'euro échouera. Un jour qu'il était reçu dans cette salle, j'ai eu l'occasion de dire à M. Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, qu'il avait bien du courage d'être à la tête du Titanic, lui rappelant la longue liste des cinquante monnaies uniques mortes depuis un siècle. On a rêvé un monde qui n'existe pas ; il faut abandonner ce logiciel intégriste et en appliquer un autre.
Au moment de l'élargissement de l'Union, M. Valéry Giscard d'Estaing, grand Européen qui, initialement, ne le voulait pas, m'avait dit : « Maintenant, il faut faire autre chose. » Seulement, cela n'a pas eu lieu. S'en est suivi le traité de Maastricht, contre lequel j'ai voté, et l'on a abouti à une « Europe-kibboutz » : tout le monde dort dans la même chambre et tout le monde veut tout faire. Cela ne peut pas fonctionner. D'une part, il faut repenser l'Union, qui doit maigrir en appliquant à la lettre le principe de subsidiarité pour ne traiter que de l'essentiel. D'autre part, les valeurs européennes ne sont plus seulement en Europe, elles sont partagées par beaucoup d'autres États dans le monde. Parlant du fonctionnement de l'Alliance atlantique, M. Donald Rumsfeld avait déclaré : « C'est la mission qui définit la coalition et non la coalition qui définit la mission. » De fait, en fonction du problème traité au niveau planétaire, des Européens peuvent être sur la même ligne, ou être en désaccord entre eux. Parce que nous sommes désormais à l'ère des puissances relatives dans un village planétaire, une réorganisation s'impose.
Dans un monde transnational, il faut des lois uniformes, comme les conférences de La Haye ont permis, bien avant la Commission européenne, qu'il en existe depuis le début du XIXe siècle. Des normes sont nécessaires, mais elles dépassent le cadre européen. Nous devons, bien sûr, garder un marché commun, et je sais gré à M. Giuliani d'avoir parlé de politique industrielle pour tempérer la concurrence. Songez qu'elle n'est mentionnée qu'à l'article 173 du traité sur le fonctionnement de l'Union, en un seul article ramassé, alors que le traité contient dix articles relatifs à la concurrence ! Cela ne peut pas fonctionner. Enfin, il convient de tout régler à la carte, au niveau inter-gouvernemental. Dans un tel cadre institutionnel, qui ne serait plus celui d'une Union intégriste, mais d'une Union plus ouverte et plus souple, le Royaume-Uni comme la Turquie peuvent trouver leur place.

Chacun convient qu'il faut redonner du sens à la construction européenne et analyser ce qui n'a pas fonctionné. Actuellement, on s'occupe plus de rafistoler et de réagir aux événements que de concevoir des projets politiques, alors qu'il faudrait en mener à bien de nombreux : l'union de l'énergie a été mentionnée, de même que la politique industrielle – c'est à peu près mon seul point d'accord avec M. Jacques Myard…

Les pistes d'action sont donc connues. C'est sur l'architecture de l'Union que je m'interroge. À mon sens, l'une de ses faiblesses tient au trop grand nombre de dérogations et d'exceptions consenties ; elles ont rendu la construction européenne incompréhensible. Je suis un farouche partisan de l'intégration différenciée, mais elle doit être organisée en deux cercles cohérents, trois au plus. C'est pourquoi je juge intéressante la proposition de M. Pisani-Ferry, même si elle est venue trop tôt : elle reprend l'idée chère à François Mitterrand d'une confédération autour d'un noyau d'États fédérés, avec la perspective d'organiser un cercle extérieur au nôtre.
Une autre Europe pourrait être ainsi construite, composée de la zone euro, d'une Union européenne conçue comme un sas vers une union économique et monétaire véritablement intégrée, d'un cercle plus lâche de pays avec lesquels des accords commerciaux clairs pourraient être conclus. Ce cercle irait-il jusqu'à inclure la Turquie ? En tout cas, cette architecture serait plus claire et mieux compréhensible par les citoyens.
La nécessaire fermeté des Vingt-Sept à l'égard du Royaume-Uni doit persister : sinon, les populistes en tireront argument pour avancer que le choix du peuple n'est pas respecté ; mais, au Royaume-Uni, les partisans du maintien dans l'Union pensent encore que l'on pourra revenir sur cette décision. La fermeté est-elle unanimement partagée en Europe ? Elle me semble avoir quelques failles dans certains pays, où l'on attend les élections à venir en France et en Allemagne pour assouplir la position. Ce serait très dangereux pour notre crédibilité.
Pour M. Jacques Delors, l'Union européenne est une fédération d'États-nations. Cette union dans la diversité ne peut être forte qu'autant que ses États membres le sont. Or, beaucoup sont affaiblis, dont la France, car les Français, peu convaincus par la manière dont leur pays est gouverné depuis une dizaine d'années, sont devenus « franco-sceptiques ». Aussi longtemps que cet état d'esprit prévaudra, la France et l'Union européenne auront un problème.
Je suis en désaccord avec vous, M. Savary, et je maintiens que le Royaume-Uni est une exception, car si dans d'autres pays existent différentes formes d'euroscepticisme, l'europhobie n'y est pas le sentiment majoritaire. L'exception britannique tient au rapport au monde qu'entretient ce pays : c'est bien à la City de Londres – et aux États-Unis – qu'a été organisée la dérégulation financière folle, non en Pologne ; ce ne sont pas les Portugais qui ont inventé les prêts hypothécaires à risque – les subprimes. De même, l'ouverture à la mondialisation sans protection sociale élaborée n'est ni l'oeuvre de la Suède ni celle du Danemark. M. Jean Pisani-Ferry a raison de souligner que l'Union ouvre ses frontières puis laisse les États membres assumer la protection sociale. Il se trouve que les Britanniques l'assument mal, et le fait est que cela entraîne plus de dégâts au Royaume-Uni et aux États-Unis qu'en Suède ou au Danemark.
Les peuples de la zone euro sont attachés à leur monnaie. Le peuple français a adopté l'union monétaire et il y est attaché, tous les sondages le montrent. Face à la menace de la finance folle, il existe une protection : l'union monétaire. Imaginons quel serait le poids du franc dans la mondialisation financière… Mais on n'entend guère le discours décrivant l'union bancaire pour ce qu'elle est : une manière de répondre à la finance folle qui a contraint des générations d'Irlandais et d'Espagnols à rembourser les folies commises par leurs banques qui, à l'époque, étaient contrôlées au seul niveau national et qui seront beaucoup mieux contrôlées au niveau européen. La mesure s'impose donc dans la manière de caractériser la crise, et il faut dire haut et fort ce que peut faire l'Union quand on lui en donne les moyens.
Oui, Mme Guigou, comme Washington l'est pour les Américains, les institutions bruxelloises seront toujours loin des peuples européens, en particulier parce que, en raison du principe de subsidiarité, elles n'ont pas tous les pouvoirs. Agriculteurs et pêcheurs savent que se définissent là les politiques qui les concernent, mais, pour les autres, Bruxelles est loin parce que les institutions européennes n'ont pas autant de compétences et de pouvoirs qu'on le dit. En revanche, la prolifération des normes en comitologie est bien trop ressentie. M. Jean-Claude Juncker essaye de contrôler ce flux normatif, puisque plus de directives et de règlements sont adoptés chaque année par la Commission que par le Parlement ou le Conseil. Le problème n'est pas seulement celui du déficit démocratique, il est politique : il n'y a aucun marketing politique, aucun service après-vente politique, et lorsqu'une controverse se déclenche, on se déballonne ! Voyez ce qu'il en a été avec Mme Ségolène Royal… Finissons-en avec l'excès de normes comitologiques : il en faut, mais a minima. On donnera ainsi moins l'occasion à M. Boris Johnson et à tant d'autres de railler une normalisation utile sur les plans technique, économique et sanitaire, mais politiquement désastreuse.
Enfin, je rappelle que l'Union européenne est née au son de l'hymne à la peur : nous avions peur de nous entre-tuer à nouveau, mais aussi peur de Staline. Certes, M. Myard, l'époque n'est plus celle de Staline et de Truman, mais c'est celle de M. Poutine et de M. Trump. Cette conjoncture crée les conditions pour que les Européens se prennent davantage en main. Elle incite à l'inquiétude, mais aussi à la résolution.
Passer d'une construction juridique à une construction plus démocratique, selon les termes de M. Gilles Savary, me paraît bien résumer les enjeux, et la question n'est pas étrangère à la nécessité de revivifier la démocratie représentative dans notre propre pays. Mieux mettre en évidence dans les débats nationaux la plus-value qu'apporte la dimension européenne aux solutions nationales oblige à mieux appréhender la dimension extérieure des problèmes nationaux dont on traite. D'autre part, chaque État membre doit mieux mesurer les effets, positifs et négatifs, de ses décisions pour ses voisins. Cela participe de la reconsolidation de l'union économique et monétaire.
Nous avons tous insisté sur la nécessité de redonner des perspectives aux politiques économiques et industrielles européennes, mais peu a été dit de la nécessité de repenser dans le même temps les politiques commerciales extérieures. Nous venons de connaître les épisodes relatifs à l'accord économique et commercial global avec le Canada, d'une part, au partenariat transatlantique de commerce et d'investissement avec les États-Unis, d'autre part. Dans un monde dérégulé, où les politiques multilatérales sont en panne, l'Union européenne doit définir et appliquer une politique commerciale véritable – ou alors, c'est la fermeture. Étant donné les défis majeurs qu'il nous faut affronter et le bousculement provoqué par les nouvelles technologies, des accords de plus en plus larges sont nécessaires, qui doivent de plus en plus intégrer les États.
Confrontations Europe, la Fondation Robert Schuman, l'Institut Jacques Delors, le Mouvement européen et EuropaNova travaillent déjà ensemble. France Stratégie n'est pas encore dans le cercle que nous avons constitué et peut-être faudrait-il l'y associer, mais, depuis un an, tous ces groupes de travail se rencontrent une fois par trimestre pour définir comment mieux valoriser ce qui rassemble les États membres et comment mieux traiter les enjeux européens.
Nous sommes très favorables à l'idée d'une Union européenne constituée en trois cercles et nous insistons sur la nécessaire articulation entre l'Union européenne et une union économique et monétaire qui doit être consolidée. Détricoter l'euro serait extrêmement douloureux et très coûteux, mais il faut construire une trajectoire pour les pays membres de l'Union non membres de la zone euro. On ne peut refaire ce qui a eu lieu lors des élargissements – exiger des nouveaux entrants qu'ils absorbent l'acquis communautaire en oubliant quelque peu le nécessaire accompagnement de pays aux cultures différentes.
La fermeté à l'égard du Royaume-Uni ne fait pas débat pour l'instant, mais elle est extraordinairement fragile. Si les Vingt-Sept ne consolident pas leurs relations en cette période douloureuse, l'Union peut voler en éclats – et le résultat des élections à venir peut rebattre toutes les cartes.
Le sujet fondamental est celui qu'a évoqué Mme Guigou en invitant à prendre en considération les composantes extérieures de toute politique européenne. Toute réflexion sur l'Union européenne doit s'inscrire dans son temps. Le monde dans lequel la question de l'utilité de l'Union européenne se posait était celui des années 2000, celui de la globalisation multilatérale régulée par l'ordre américain ; à l'époque, Gordon Brown l'avait théorisé en déclarant explicitement que l'échelle régionale n'avait plus de sens et qu'il fallait raisonner à l'échelle globale.
Mais le monde actuel n'est plus du tout celui-là : c'est un monde d'affirmation et de puissances, dans lequel l'échelon régional est essentiel. Au nombre de ce que peut offrir l'Union européenne et de ce que peuvent être ses atouts, il y a bien sûr son marché et sa régulation, mais aussi la capacité d'émettre une monnaie internationale, ce qu'aucun de nos pays n'est en mesure de faire individuellement. Renoncer à cela, simplement du point de vue externe, serait un choix très lourd puisque c'est un des éléments qui nous permettent d'exister dans un monde dans lequel, économiquement, nous pèserons de moins en moins. La capacité d'émettre une monnaie internationale n'est pas à la portée de tous les pays, les Chinois le savent d'expérience.
Faut-il faire le gros dos en se disant que l'appétit manque pour une intégration supplémentaire, ou faut-il être ambitieux ? Faire le gros dos n'est pas une stratégie, car la situation est insatisfaisante : l'Union ne crée pas assez de prospérité, n'a pas de capacité suffisante de création d'emplois et de sécurité pour que l'on puisse se contenter de la défendre telle qu'elle est. Il faut reconnaître ses faiblesses et être ambitieux. Cela signifie se projeter dans le futur sans se focaliser exclusivement sur ce qui nous oppose les uns aux autres.
Je prendrai pour exemple la discussion avec l'Allemagne sur l'avenir de l'euro. La France et l'Allemagne ont des sujets de contentieux hérités de la crise récente – la compétitivité relative ou la relation créanciers-débiteurs, par exemple. Mais une question bien plus large se pose : vers quoi voulons-nous tendre pour les dix ou vingt ans à venir, et selon quels principes ? Si nous restons bloqués sur les sujets immédiats, c'est l'impasse. Cela exige que nous, Français, disions beaucoup plus clairement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Nous avons une certaine difficulté à le faire, car il est assez facile de passer des compromis internes qui ne sont ni toujours très clairs ni toujours très sensés. Pour des raisons de politique interne compréhensibles, on peut assez facilement se mettre d'accord sur des positions qui, ensuite, ne nous portent pas très loin dans le dialogue avec nos partenaires européens. Nous devons dire beaucoup plus clairement ce que nous voulons nous-mêmes.
La proposition de partenariat continental est-elle une mauvaise idée ou vient-elle trop tôt ? Choisir d'attendre et de laisser l'initiative au Royaume-Uni a pour inconvénient que, pendant que les Britanniques se préparent, on s'abstient de réfléchir. Sans doute sont-ils en proie à un certain désarroi sur la manière d'aborder la négociation, mais le moment viendra où elle commencera. Mieux vaut, pour les Vingt-Sept, s'être mis d'accord sur le futur vers lequel ils veulent aller que d'être uniquement guidés par une considération tactique – ne pas bouger, alors que les Britanniques seront mobiles. Le danger est que le Royaume-Uni, adoptant la stratégie des Horaces et des Curiaces, ne détricote certains compromis en privilégiant des négociations sectorielles. Pour éviter cela, mieux vaut que les Vingt-Sept, plutôt que de se fixer simplement un compromis défensif, aient une idée de l'aboutissement qu'ils souhaitent.
J'ai essayé de théoriser l'intégration par l'exemple, car je pense que l'Europe souffre d'abord d'une indifférence des États membres. L'Assemblée nationale devrait se pencher davantage sur cette question, car les sujets qui préoccupent nos concitoyens et qui interpellent l'Europe – migrations, défense, sécurité – mettent en jeu des compétences partagées ou nationales qui n'appartiennent pas aux institutions communes. Or les États membres ne les exercent pas correctement. Rien n'interdit au gouvernement français de proposer une initiative à nos voisins italiens ou allemands pour rapprocher les conditions d'octroi de l'asile, ou, en matière de sécurité, pour organiser une vraie défense de l'Europe, au lieu de se polariser sur la défense européenne.
Nous confondons les objectifs et les moyens. Chaque fois que des avancées ont été faites en Europe, c'est à la suite d'initiatives des États membres – souvent la France et l'Allemagne – qui ont ensuite permis de donner aux institutions communes des règles pour gérer les problèmes en commun.
C'est la vraie question de la bureaucratie. En 1963, Robert Schuman disait : « L'intégration européenne doit, d'une façon générale, éviter les erreurs de nos démocraties nationales, surtout les excès de la bureaucratie et de la technocratie. » Nous y sommes, par défaut des gouvernements nationaux. Je pourrais citer une dizaine d'exemples, notamment en matière environnementale, de cas dans lesquels une réglementation est réclamée à Bruxelles par le ministère français de l'environnement, se gère dans des comités obscurs, et donne ensuite l'impression que l'Europe n'est que la contrainte. Si nous voulons ouvrir cette brèche, il faut que les politiques européennes des États membres soient plus offensives et plus assumées. Qu'elles se déploient sur le mode intergouvernemental ne me choque pas dès lors que par la suite, l'exemple aidant, se développe l'idée de les consolider à vingt-sept. Il n'est pas nécessaire de commencer à vingt-sept : à deux ou à trois, c'est suffisant. Il y a urgence en matière de défense, et l'immigration est la mère de toutes les batailles contre le populisme.
En matière de gouvernance économique, je suis d'accord avec M. Jean Pisani-Ferry. Dire que l'Europe doit s'occuper de l'essentiel, c'est laisser entendre que les États ne doivent s'occuper que de l'accessoire. Il faut que chacun exerce ses compétences, et donc que les États membres exercent les leurs, ce qu'ils ne font pas depuis plus de vingt ans sur les questions européennes. Si, en matière économique, en matière de défense, d'immigration ou de bureaucratie, les États membres avaient des politiques européennes plus actives, nous ne nous en porterions que mieux, et cela tiendrait lieu de pédagogie naturelle à l'intention de nos citoyens.
Je rappelle aussi à M. Myard que la célèbre conférence d'Ernest Renan Qu'est-ce qu'une nation ? se termine ainsi : « Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. » Nous n'y sommes pas encore, même si nous souhaitons un jour y parvenir.

Merci à chacun d'entre vous. Nous attendons vos contributions écrites, si vous souhaitez approfondir vos réponses aux questions qui ont été posées. Nous souhaitons que ce rapport sur le Brexit soit utile et permette aux Vingt-Sept de résister et de partager un point de vue commun, mais c'est aussi pour les Européens un bon moyen de s'interroger sur la suite.
La mission d'information auditionne ensuite M. Frédéric Baab, membre national d'Eurojust pour la France.

M. Baab, nous souhaitons aborder avec vous la question d'apparence plus technique, mais en réalité hautement politique, des conséquences de la sortie du Royaume-Uni sur la coopération judiciaire européenne, notamment en matière pénale. Nous aurons également, au mois de janvier, l'occasion d'auditionner le ministre de l'intérieur sur la coopération policière. Ces deux auditions sont très importantes. La fin de la règle de l'unanimité s'est accompagnée de la création d'un régime dérogatoire consistant en un droit de retrait ou de participation. En pratique, le retrait du Royaume-Uni mettra fin à de nombreuses coopérations qu'il avait choisies. Merci de nous faire part de vos réflexions sur ces différents points.
Merci de m'avoir invité à participer aux consultations que vous conduisez aujourd'hui sur le Brexit et ses conséquences probables, non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi plus largement pour l'Union européenne, et en particulier – puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui – dans le domaine de la coopération judiciaire pénale. Après les attentats terroristes commis en France et en Belgique, et au vu de la menace de plus en plus forte que représente l'organisation terroriste Daech sur le territoire européen, ces sujets sont extrêmement importants. Il faut avoir des idées claires avant d'entrer réellement dans les négociations qui vont s'ouvrir avec le Royaume-Uni. J'ai entendu hier que le ministre britannique chargé du Brexit, M. David Davis, n'excluait pas la possibilité d'un accord de transition avant que le Royaume-Uni ne quitte définitivement l'Union européenne, ce qui veut dire que les solutions pourront être très différentes au sein des cinquante-sept volets qui ont été ouverts par le Royaume-Uni, en particulier en fonction des impératifs de sécurité.
Permettez-moi de présenter Eurojust en quelques mots, avant d'aborder spécifiquement la question du Brexit. Il s'agit d'une agence intergouvernementale, et elle le restera. Le parquet européen sera très différent, puisqu'il s'agira d'une véritable institution judiciaire intégrée. Eurojust conservera son modèle intergouvernemental, avec vingt-huit bureaux nationaux qui représentent chacun leur pays, et un fonctionnement qui reste dans la logique intergouvernementale.
Si une autorité judiciaire française veut faire exécuter une commission rogatoire internationale en Allemagne, elle ne saisit pas directement le bureau national allemand, mais le bureau national français, qui va ensuite transmettre immédiatement cette commission rogatoire internationale au bureau allemand, qui la transmettra à son tour aux autorités judiciaires allemandes compétentes. On peut trouver cette procédure terriblement bureaucratique et d'une grande lourdeur, mais c'est exactement le contraire. Dans l'espace judiciaire européen qui s'est établi à la suite du Conseil européen de Tampere en 1999, nous constatons souvent que le principe de communication directe entre les autorités judiciaires d'émission et celles d'exécution – sur lequel il repose en théorie – ne peut pas être mis en oeuvre, car les gens ne se comprennent pas. Il faut des intermédiaires spécialisés pour permettre à la coopération judiciaire de porter ses fruits. En 1993, les premiers magistrats de liaison ont été créés entre la France et l'Italie. Ce fut une étape extrêmement importante dans la construction de l'espace judiciaire européen. Le réseau judiciaire européen a ensuite vu le jour, puis l'agence Eurojust, en 2002.
Aujourd'hui, Eurojust a une activité opérationnelle très importante. Nous avons ouvert 2 214 dossiers l'année dernière. Le bureau français, à lui seul, en a ouvert 140, et il a été requis dans 241 dossiers. Autrement dit, notre activité portait l'année dernière sur 381 dossiers.
Non seulement le volume de coopération a augmenté, mais nous avons aussi été requis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, dans lequel Eurojust n'était pas présent jusqu'alors. Cela s'explique très simplement : il y a dix ans, l'essentiel des dossiers en matière de terrorisme appelait une coopération principalement bilatérale. C'était l'époque, par exemple, de la lutte contre l'organisation basque ETA. L'essentiel de la coopération dans ce genre de dossiers se faisait entre la France et l'Espagne, dans un cadre bilatéral. Pour mettre en oeuvre la coopération, il fallait des liens directs avec les magistrats de l'Audience nationale, ou s'appuyer sur des magistrats de liaison qui servaient de supports opérationnels à la coopération judiciaire.
Al-Qaida et surtout Daech représentent des menaces multilatérales concernant potentiellement n'importe quel pays européen, qu'il constitue une cible d'attentats ou une base arrière abritant des cellules dormantes susceptibles d'être activées à tout moment. Nous voyons ces phénomènes à l'oeuvre dans certains des dossiers dont nous sommes saisis. Nous devons donc coopérer de manière efficace avec des pays qui ne sont pas nécessairement des partenaires habituels de la France en matière pénale. Dans le cas des attentats du 13 novembre 2015 en France, le bureau français d'Eurojust, saisi par les juges d'instruction antiterroristes, a coopéré avec l'Autriche et la Grèce. Ce sont deux pays amis, mais pas des partenaires avec lesquels nous coopérions beaucoup dans les affaires de terrorisme. Néanmoins, c'est dans un camp de réfugiés en Autriche qu'ont été interpellés deux des candidats kamikazes pour les attentats du 13 novembre, et nous avions besoin d'obtenir des informations de la Grèce à propos du flux de migrants qui est entré dans l'Union européenne lors de la période qui nous intéressait.
Pour apporter un support de coopération efficace et utile aux autorités judiciaires françaises, Eurojust est la seule agence qui permette une coopération multilatérale. Cette coopération se fait de deux manières. Nous organisons tout d'abord des réunions de coordination qui permettent de rassembler tous les acteurs judiciaires des pays concernés par un même dossier, avec un service d'interprétariat afin que chacun puisse s'exprimer dans sa langue maternelle et échanger directement des informations avec les partenaires étrangers. Ces réunions permettent de définir des stratégies d'enquêtes communes, qui concernent non seulement la direction des enquêtes, mais aussi celle des poursuites, puisque la décision ultime dans un dossier complexe, multilatéral, qui concerne plusieurs États membres, est de déterminer devant quelle juridiction l'affaire sera jugée, et s'il est opportun de réunir l'ensemble du dossier devant une même juridiction de jugement.
De plus, nous avons de plus en plus souvent recours, dans tous types de dossiers, notamment dans les affaires de terrorisme, à des équipes communes d'enquête. Ce fut le cas, par exemple, dans le dossier du 13 novembre et dans le dossier Reda Kriket.
Telle est la place qu'occupe aujourd'hui Eurojust dans le dispositif de coopération judiciaire en Europe : une agence multilatérale fonctionnant sur un modèle intergouvernemental qui fait sa force, car il permet un contact direct avec des correspondants nationaux au sein de l'agence. Elle n'a aucun pouvoir, et nous en sommes très heureux, car cela nous permet d'avoir une relation extrêmement simple avec les autorités judiciaires françaises : il ne peut pas y avoir de rivalité ou de concurrence. Nous ne nous trouvons jamais dans une situation où il n'y aurait qu'un siège pour deux : quand on exerce des poursuites, il ne peut y avoir qu'une seule autorité compétente, en l'occurrence les autorités judiciaires françaises. C'est peut-être ce qui explique qu'elles n'aient plus aucune réticence à nous saisir dans les dossiers les plus sensibles.
En ce qui concerne le Brexit et ses conséquences sur la coopération judiciaire pénale en Europe, je propose d'aborder quatre sujets : les agences européennes (Europol et Eurojust) ; les instruments de reconnaissance mutuelle ; l'interconnexion électronique des casiers judiciaires et le parquet européen, sujet d'actualité puisque les négociations ont échoué lors du Conseil « Justice et affaires intérieures » du 8 décembre dernier.
Je souhaite vous parler des deux agences européennes, car Europol me semble aujourd'hui un élément de coopération extrêmement important. Dès que le Royaume-Uni sortira de l'espace judiciaire européen unique, il quittera également les agences européennes. Il est difficile d'imaginer une marge de négociation sur cette question de principe. Mais cela ne signifie pas que les Britanniques cesseront de collaborer avec Eurojust. Aujourd'hui, nous avons déjà passé un certain nombre d'accords de coopération avec des pays tiers : la Suisse, les États-Unis et la Norvège. Ces accords ont permis à ces trois pays de créer un poste de procureur de liaison rattaché à Eurojust. Nous avons donc un point de contact direct au sein d'Eurojust avec ces trois pays.
Ces procureurs de liaison ont à peu près les mêmes capacités d'action que les membres nationaux : ils peuvent ouvrir un dossier, organiser des réunions de coordination et les présider, et participer à une équipe commune d'enquête. La Suisse ayant ratifié le deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire de 1959, le procureur de liaison suisse ne se distingue presque pas, sur le plan opérationnel, d'un membre national. La seule différence avec les membres nationaux est que les procureurs de liaison ne participent pas aux réunions du Collège d'Eurojust, c'est-à-dire à la gouvernance de l'organisation. Dans une agence intergouvernementale qui n'exerce aucun pouvoir propre, ces réunions ne portent que sur des éléments de fonctionnement quotidien de l'agence. Aucune décision d'importance susceptible d'engager l'avenir d'Eurojust ne peut être prise au sein du collège. Finalement, c'est presque une chance pour ce procureur de liaison de ne pas participer aux réunions du Collège, qui ne sont pas toujours extrêmement passionnantes…
Sur le plan opérationnel, j'imagine que les Britanniques feront le choix de créer un poste de procureur de liaison. Nous n'avons aucune raison de nous y opposer, cela fait partie des relations normales que nous pouvons établir avec des pays tiers. Les Britanniques, aujourd'hui très impliqués dans le fonctionnement d'Eurojust, feront en sorte de nommer un procureur de liaison doté d'adjoints et d'un secrétariat, ce qui leur permettra d'avoir exactement la même capacité opérationnelle qu'actuellement.
Il en ira de même pour Europol, qui peut également passer des accords de coopération opérationnels et stratégiques avec des pays tiers. J'imagine que le Royaume-Uni demandera à bénéficier de ce statut. Il est d'autant plus important pour nous de conserver une coopération étroite avec les Britanniques qu'ils sont particulièrement actifs et compétents sur le terrain du renseignement. Il faut établir avec eux des collaborations très fortes et très étroites, qui permettent de continuer à travailler ensemble, d'autant qu'aujourd'hui Europol et Eurojust sont très étroitement associés dans tous les champs de la criminalité organisée, également en matière de terrorisme, ce qui n'était pas le cas auparavant. Europol est un énorme bureau d'analyse criminelle. En matière de crime organisé, il traite 25 millions de renseignements – que l'on appelle « entités structurées » – et 3 millions en matière de terrorisme.
Ce bureau d'analyse criminelle recoupe en permanence toutes les informations qu'il reçoit des services de police et de renseignement des États membres, mais aussi des pays tiers avec lesquels Europol a un accord de coopération opérationnelle.
Europol a ouvert vingt-sept ou vingt-huit fichiers d'analyse criminelle – que l'on appelle des « points focaux » – consacrés chacun à une thématique particulière : les transactions financières suspectes, la surveillance des sites internet terroristes, et cinq fichiers particuliers en matière de terrorisme. Parmi ces derniers, les deux plus importants sont aujourd'hui les fichiers « Hydra », consacrés au terrorisme islamiste en général ; et le fichier « Travellers », consacré aux combattants terroristes étrangers.
Jusqu'en 2015, il n'existait pas d'accord d'association entre Eurojust et Europol en matière de terrorisme, faute de confiance. Après les attentats de janvier et novembre 2015, l'urgence opérationnelle et la pression politique qui s'est exercée ont été telles que nous avons signé en quelques mois des accords d'association avec Europol sur les deux fichiers que je viens de citer. J'ai été désigné par le Collège « point de contact » de ces fichiers, ce qui me permet de participer à toutes les réunions opérationnelles s'y rapportant et d'entretenir des relations très étroites avec les analystes d'Europol qui travaillent sur ces sujets.
Le Royaume-Uni est pour nous un partenaire extrêmement important dans le champ de la sécurité, et nous devons continuer à coopérer selon les modalités déjà prévues pour les pays tiers.
J'en viens aux instruments de reconnaissance mutuelle. Ce principe s'est imposé à partir du Conseil européen de Tampere, en octobre 1999, qui en avait fait la pierre angulaire de la coopération judiciaire en Europe. Après cette grande déclaration politique, il s'est ensuite passé ce qui arrive parfois au sein de l'Union européenne : pas grand-chose. Il a fallu les attentats du 11 septembre 2001 pour que l'Union commence sérieusement à mettre en oeuvre le programme de Tampere dans le domaine de la coopération judiciaire. La pression politique très forte que les États-Unis ont exercée sur les États européens a eu pour résultat l'adoption de la décision concernant Eurojust le 28 février 2002. Le projet était déjà en cours, fortement soutenu par la France, mais les négociations avançaient très difficilement, notamment du fait de l'opposition de l'Allemagne. Autre résultat de cette pression des États-Unis, l'adoption quelques mois plus tard du mandat d'arrêt européen. Dans le champ de l'extradition, c'est une révolution copernicienne : nous avons changé de monde.
Que signifie le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice ? Que la demande n'est plus une demande, mais une décision. Par exemple, si un juge d'instruction français décerne un mandat d'arrêt européen contre un ressortissant allemand qui réside en Allemagne, il ne s'agit plus d'une demande aimable formulée par le juge d'instruction français aux Allemands, mais d'une décision prise par l'autorité judiciaire française et qui sera exécutée en Allemagne presque comme s'il s'agissait d'un mandat d'arrêt allemand. Il existe un principe d'assimilation de la décision étrangère à la décision nationale. Les motifs de refus sont extrêmement limités, et leur mise en oeuvre est très encadrée.
L'obligation pour les États membres d'extrader leurs ressortissants nationaux constitue également un progrès considérable, puisque, vous le savez, le principe est que la France n'extrade pas les siens.
Le mandat d'arrêt européen repose sur cette logique et marque une étape très importante dans la création de l'espace judiciaire européen, auquel elle donne tout son sens. Des instruments ont été créés pour toutes les décisions que peut prendre un procureur ou un juge d'instruction et qui sont susceptibles d'être appliquées en dehors du territoire français. Le principe de reconnaissance mutuelle a été décliné dans toutes les matières possibles, de la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires à celle des décisions de gel des avoirs et des preuves – outil important dans le traitement des dossiers de faux ordres de virement, forme d'escroquerie qui s'est développée depuis quelques années et cause des préjudices considérables aux entreprises. Dans ce domaine, la première mesure à prendre ne consiste pas à arrêter les gens, mais à geler l'argent, à essayer de récupérer ce qui peut l'être par le biais d'une mesure qui sera exécutée immédiatement par les autorités judiciaires du pays concerné. Le gel – mesure provisoire – est suivi de la confiscation – à moins que l'on ne restitue ses biens à leur propriétaire.
Toujours dans le cadre de la reconnaissance mutuelle, le contrôle judiciaire, décerné par un juge français, peut aussi être exécuté à l'étranger. Enfin, dernier instrument en date, la décision d'enquête européenne va couvrir l'ensemble de la coopération judiciaire pénale et remplacer définitivement les commissions rogatoires internationales.
Dès lors que le Royaume-Uni sort de l'espace judiciaire européen, il ne peut plus utiliser les instruments de reconnaissance mutuelle. Malgré toute l'empathie que je peux avoir, à titre personnel, pour les Britanniques, je n'imagine pas comment, dans ces conditions, nous pourrions conserver le Royaume-Uni à bord. La reconnaissance mutuelle nécessite un niveau de confiance qui ne peut exister qu'au sein de cet espace, puisque les autorités judiciaires doivent exécuter quasiment les yeux fermés la décision qu'elles reçoivent : un mandat d'arrêt européen comporte un résumé très succinct des raisons pour lesquelles le juge étranger l'a décerné, et il n'y a pas de contrôle d'opportunité possible.
Par ailleurs, des missions d'évaluation mutuelles sont régulièrement réalisées par des magistrats et des fonctionnaires de la Commission européenne qui vont mesurer dans chaque État membre la manière dont les instruments en question ont été transposés en droit interne et sont appliqués par les autorités judiciaires. Ces mesures de contrôle inhérentes à la reconnaissance mutuelle ne pourraient plus être appliquées à un pays qui ne sera plus membre de l'Union européenne, mais qui sera désormais un pays tiers.
La seule solution pour le Royaume-Uni est d'en revenir aux anciens instruments de coopération judiciaire, non pas ceux de l'Union européenne, donc, mais ceux du Conseil de l'Europe – notamment la convention d'extradition de 1957. Nous aurons même des difficultés à faire bénéficier le Royaume-Uni des conventions de l'Union européenne de 1995 et 1996 adoptées par la suite et visant à mettre en place une procédure simplifiée en matière d'extradition. J'imagine que les juristes du secrétariat général du Conseil et ceux des États membres trouveront des solutions plus élégantes et mettront en place des procédures plus rapides et simplifiées avec le Royaume-Uni.
Vous allez considérer qu'on en revient à l'âge de pierre dans nos relations avec le Royaume-Uni ; d'une certaine manière, c'est vrai. Aussi est-ce sans doute à ce pays de faire un effort supplémentaire pour faciliter la coopération avec les États de l'Union européenne et pour ne pas en revenir aux situations que nous avons connues avec un dossier comme celui de Rachid Ramda.
Il a en effet fallu dix ans – 1995-2005 – pour obtenir l'extradition de quelqu'un qui était clairement et directement impliqué dans les attentats de 1995 à Paris et en particulier dans l'attentat perpétré dans le RER Saint-Michel, qui avait causé la mort de huit personnes.
Troisième point, l'interconnexion des casiers judiciaires, grande avancée, est issue d'un projet franco-allemand. À l'époque, j'étais magistrat de liaison à Berlin et j'avais reçu mandat – avec obligation non de moyens, mais de résultats – de signer dans les délais les plus brefs un accord avec l'Allemagne permettant un échange électronique rapide et simplifié d'informations entre les casiers judiciaires français et allemands. Nous avions même pensé, initialement, à réaliser un casier judiciaire unique, idée quelque peu déraisonnable qui n'a pas passé le cap de la première réunion de travail entre les experts français et allemands.
Nous disposons d'un système informatisé baptisé ECRIS (European Criminal Records Information System – Système européen d'information sur les casiers judiciaires) qui permet l'interconnexion électronique des casiers judiciaires au niveau européen. Il a été adopté en 2009 et est entré en vigueur en 2011. Grâce à ce système, il est possible d'envoyer un avis de condamnation au casier judiciaire de l'État dont la personne concernée est ressortissante. La convention européenne d'entraide judiciaire de 1959 le permettait déjà : en théorie, à l'époque, les États membres devaient envoyer au pays signataire de la convention tous les avis de condamnation concernant ses ressortissants. Par exemple, si un Allemand est condamné en France, le casier français doit envoyer l'avis de condamnation au casier judiciaire allemand qui va l'enregistrer. La France a tiré toutes les conséquences juridiques possibles de ces échanges d'informations puisque, aujourd'hui, une condamnation prononcée à l'étranger contre un ressortissant français peut servir de premier terme de récidive.
Prenons l'exemple d'un ressortissant espagnol interpellé en France : l'interconnexion électronique permet de connaître ses antécédents judiciaires dans un délai de dix à vingt jours, ce qui est très bref comparé aux délais antérieurs – et même, en réalité, il n'y avait aucun échange entre les casiers judiciaires des différents pays. Le système, j'y insiste, s'appuie sur un principe de nationalité : toutes les condamnations prononcées en Europe contre des ressortissants européens sont centralisées auprès du casier judiciaire du pays de la personne concernée, seul casier qui puisse être interrogé, ce qui évite d'avoir à consulter vingt-sept autres casiers judiciaires. Là encore, on peut imaginer que le Royaume-Uni devra sortir de ce dispositif propre à l'Union européenne. Or le volume d'informations judiciaires échangées entre la France et le Royaume-Uni est très important.
J'en viens au quatrième et dernier point, le parquet européen. Il s'agit là, sans doute, de la question la plus facile à résoudre, puisque vingt-cinq pays ont participé au projet initial, soit les Vingt-Huit à l'exception, précisément, du Royaume-Uni, mais aussi du Danemark et de l'Irlande. Cela étant, d'autres pays resteront peut-être en dehors du projet de parquet intégré. Celui-ci détiendra à ce titre toutes les prérogatives de l'action publique, ce qui implique un transfert de souveraineté des États membres vers l'échelon européen : c'est le parquet européen qui devrait donc conduire les enquêtes et exercer les poursuites en s'appuyant sur des points de contact dans les États membres – des procureurs européens délégués – qui travailleront pour le compte et au nom du parquet européen, mais qui resteront intégrés dans la hiérarchie judiciaire des États membres. J'ignore de quelle manière le dispositif sera transposé dans le droit français, mais on peut imaginer qu'il y aura un point de contact par juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) ou bien un point de contact centralisé auprès du parquet national financier, puisque la compétence du parquet européen est limitée à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – limitation du reste importante : j'ai cru comprendre que, pour la seule fraude à la TVA, le seuil de compétence se situait à 10 millions d'euros de préjudice…
Il faudra en tout cas créer un système assurant la connexion opérationnelle entre l'échelon européen et l'échelon national, sachant qu'il n'y a pas de juridiction européenne correspondant à ce parquet européen et que les dossiers seront jugés devant les juridictions nationales avec un représentant du ministère public représentant le parquet européen.
Le 8 décembre dernier, les négociations ont échoué. Plusieurs pays se sont montrés réticents vis-à-vis de ce projet. La Suède a clairement affirmé ne pas vouloir y participer, un peu à l'instar d'autres États, même s'ils ont formulé leur avis de façon plus diplomatique : la Pologne, la Hongrie et, plus inquiétant, les Pays-Bas ; quant à l'Italie, son refus tient à des raisons inverses, le ministre italien considérant que le parquet européen n'allait pas assez loin dans l'intégration. En l'absence d'unanimité, ce projet sera adopté dans le cadre de ce qu'on appelle une coopération renforcée, qui nécessite la participation d'au moins neuf États membres, parmi lesquels la France et l'Allemagne.
Reste, je le répète, que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'aura aucune conséquence sur ce processus puisque, dès l'origine, ce pays n'a pas souhaité en faire partie.

Je remercie M. Baab pour son intervention sur un sujet énorme, évidemment méconnu – et sur lequel nous-mêmes avons besoin d'actualiser nos connaissances. Vous vous êtes montré très pédagogue en tout cas.
Nous avons eu raison d'en rester à la coopération intergouvernementale. Lorsque j'ai participé au Conseil européen de Tampere, avec le Premier ministre finlandais dont le pays venait d'adhérer à l'Union européenne, nous avons immédiatement posé le principe selon lequel il ne saurait être question que la Finlande intègre le système communautaire sur ces questions.
Nous avons raison, j'y insiste, de continuer dans cette voie, car il ne peut y avoir de justice européenne supranationale sous quelque forme que ce soit s'il n'existe pas un système politique fédéral. La question est en effet de savoir, comme toujours, qui contrôle les contrôleurs. Et avancer de manière pragmatique ne nous a pas empêchés de beaucoup progresser : le principe de reconnaissance mutuelle, proclamé à Tampere, et que nous avons constamment développé par la suite, a tout de même abouti au mandat d'arrêt européen. Sur ce dernier point, vous l'avez rappelé, il a fallu dix ans pour extrader Rachid Ramda vers la France – je garde un souvenir précis de mes conversations avec mon homologue de l'époque –, alors que, grâce au mandat d'arrêt européen, Salah Abdeslam a été remis aux autorités françaises au bout de quatre ou cinq semaines seulement.
Pour ce qui est du parquet européen, il faudra que le rapport de la mission d'information le définisse clairement – or vous l'avez très bien fait, M. Baab. Je me souviens de débats constants avec les Britanniques sur la question de savoir s'ils allaient adopter ce dispositif, de débats féroces entre Britanniques eux-mêmes, très allants quant à la coopération judiciaire et policière en matière de lutte contre la criminalité organisée et de lutte contre le terrorisme, et donc inquiets pour certains à l'idée de devoir abandonner les instruments dont il est ici question. J'ai en mémoire le cas, abondamment commenté dans les journaux d'outre-Manche, d'un moniteur britannique de colonie de vacances, qui avait, je crois, agressé sexuellement une petite fille et s'était réfugié en France, les Britanniques nous demandant naturellement son extradition.
Dès lors qu'on considère qu'ils ne peuvent formellement rester au sein des agences européennes, il s'agit de savoir quels dispositifs mettre en place avec eux, de façon pragmatique et bilatérale, si jamais ils manifestent la volonté, que nous avons intérêt à encourager, de continuer à coopérer dans le cadre de mandats d'arrêt européens ou dans le cadre du principe de reconnaissance mutuelle. Il en va d'ailleurs un peu de même dans le domaine de la défense. Personne n'aurait rien à y perdre. Je rappelle que nous avons créé Eurojust – c'est en tout cas la proposition que j'avais faite à l'époque – pour donner un pendant judiciaire à Europol qui existait déjà. Or il ne faudrait pas que la sortie des Britanniques de l'Union européenne crée un appel d'air, le Royaume-Uni devenant le refuge de tous ceux que nous souhaitons traduire devant nos tribunaux.

Je vous ai écouté avec grand intérêt, M. Baab, et je n'ai pas tout à fait compris certaines de vos positions.
Une fois n'est pas coutume, je suis tout à fait d'accord avec Mme Élisabeth Guigou pour considérer que la justice relève de la souveraineté nationale. Je constate qu'aux États-Unis d'Amérique la justice est tout à fait distincte d'un État fédéré à l'autre, ce qui n'empêche pas l'ensemble de constituer un pays. Aussi le parquet européen tel que vous l'avez décrit ne me paraît-il pas viable. Je préférerais une somme de parquets nationaux qui engageraient des poursuites dès lors qu'on constaterait d'un commun accord, par exemple, une escroquerie aux finances de l'Union européenne. On ne peut donc guère imaginer le parquet européen que comme « flottant », dépourvu qu'il serait d'instructions de la part des responsables politiques.
En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle, le mandat européen est très certainement une avancée aussi forte que nécessaire, j'en suis bien d'accord. Vous avez néanmoins pu constater que plusieurs cours d'appel françaises ont refusé d'exécuter un mandat européen précisément par manque de confiance. Or, dans le contexte des négociations transatlantiques que nous avons menées avec les Américains, l'arbitrage que ceux-ci ont proposé provenait de leur absence totale de confiance dans les juges de certains États de l'Europe de l'Est. Tout réside en effet dans la confiance réciproque des systèmes judiciaires. La souplesse des relations intergouvernementales n'en apparaît que mieux : aussi faut-il la conserver.
J'en viens plus précisément à notre sujet : la confiance existe bel et bien avec les Britanniques. Pourquoi, dès lors, voulez-vous les priver de l'interconnexion électronique des casiers judiciaires ? Il y va de notre intérêt de n'en rien faire et l'opinion publique risque de se révolter s'ils n'ont plus accès à ce dispositif.
Depuis l'affaire Calas, les Français sont attachés à la justice plus encore qu'à la liberté. La notion de justice est consubstantielle à notre conception de ce qu'on appelle le « vouloir-vivre-ensemble ». Je ne vois donc pas pourquoi nous expulserions les Britanniques d'un système qui peut fonctionner dès lors que nous y avons tous avantage, et qui garantit l'efficacité de la sanction prononcée contre les malfrats.
Quand vous estimez, Mme la présidente Guigou, que le parquet européen et, en général, tout élément de justice supranationale est difficilement concevable dans une Europe qui n'est pas fédérale, sachez que c'est également ma conviction. Je vous ai proposé la présentation standard du parquet européen qui est peu ou prou celle du gouvernement français. Du coup, M. Myard, sur ce point, je suis également en plein accord avec vous : ce qui fait la force et l'efficacité du système Eurojust, c'est précisément qu'il s'appuie sur un modèle intergouvernemental.
Je suis en outre d'accord avec vous sur la nécessité de conserver une relation étroite avec le Royaume-Uni, mais pas dans n'importe quel domaine. Le bureau français d'Eurojust a deux priorités : la lutte contre le terrorisme – nous sommes saisis de tous les grands dossiers d'action publique en la matière – et la lutte contre le trafic de migrants. Nous avons, à l'initiative de la procureure générale de Douai, créé un groupe de travail opérationnel associant les quatre pays de la mer du Nord, ainsi dénommés pour donner au groupe une certaine visibilité politique, à savoir la France, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, pays directement concernés par la situation non seulement de Calais, mais encore de Dunkerque, de Grande-Synthe… Président du tribunal de grande instance de Dunkerque dans une vie antérieure, je connais bien la région.
Dès lors que les contrôles sont de plus en plus serrés à Calais, les migrants en situation irrégulière sont présents sur toute la façade maritime, mais aussi dans l'arrière-pays de tous les États européens à proximité. Les quatre pays du groupe ont travaillé avec les magistrats de liaison britanniques, dont celui spécialement désigné pour travailler à Lille sur les dossiers de trafics de migrants. Nous avons évidemment intégré ces magistrats britanniques dans notre groupe de liaison et je considère qu'il est indispensable de maintenir cette coopération régionale avec eux pour coordonner nos enquêtes. En sortant de l'Union européenne, les Britanniques vont-ils perdre leurs magistrats de liaison ? Non, puisque leur existence repose sur un accord bilatéral. Nous pourrons donc maintenir la coopération que nous avons mise en place dans un cadre explicitement intergouvernemental.
Cependant, pour ce qui est de la reconnaissance mutuelle, le pays qui a le plus durement attaqué ceux de la partie la plus orientale de l'Europe auxquels vous avez fait allusion, M. Myard, à commencer par la Pologne, est le Royaume-Uni. Plusieurs mandats d'arrêt polonais ont été critiqués, à mon avis à juste titre, par les États membres qui considéraient qu'ils avaient été décernés pour des faits des plus mineurs, pour des queues de cerise. Reste que ces mandats d'arrêt peuvent concerner des ressortissants français, britanniques ou allemands, et pas seulement des Polonais qui auraient commis des infractions en Pologne. Le Royaume-Uni, par sa dureté, a affaibli le dispositif en lui portant de véritables coups de boutoir et en adoptant une deuxième loi de transposition beaucoup plus protectrice des intérêts britanniques. Or – et c'est un point de désaccord avec vous –, nous devons conserver contre vents et marées ce principe de reconnaissance mutuelle et cette idée qu'il doit s'appuyer sur une confiance mutuelle élevée entre les autorités judiciaires des États membres, même si, parfois, en effet, nous éprouvons des difficultés à exécuter des mandats d'arrêt qui nous paraissent disproportionnés par rapport…
Vous avez raison et, d'ailleurs, nous en discutons. Nous voyons précisément que le système est en train, petit à petit, de se défaire, parce qu'il est de plus en plus critiqué par certains pays et par certaines autorités judiciaires qui exercent un contrôle de plus en plus étroit sur les mandats d'arrêt européens étrangers qui lui sont adressés. Si nous entrons dans cette logique, c'est la fin du mandat d'arrêt européen.

Évidemment ! Je ne comprends pas comment nous pouvons imaginer nous désarmer ainsi alors que nous avons accompli des progrès gigantesques, grâce à cet instrument juridique, qui concerne toutes les formes de criminalité. Et ce n'est pas parce que certains pays européens abusent de cet outil qu'il faut le rejeter tout entier.

On ne peut pas, d'un côté, regretter une protection insuffisante et, de l'autre, contribuer à l'affaiblir.

J'ai mentionné l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui a refusé d'exécuter un mandat d'arrêt européen. En l'occurrence, il ne s'agit donc pas des Britanniques. Il va bien falloir réviser le mandat européen afin qu'il ne soit plus délivré, comme vous l'avez dit vous-même, M. Baab, pour des queues de cerise.
D'abord, la décision de la cour d'appel de Montpellier reste très isolée. Ensuite, nous nous sommes toujours opposés, et avec la plus grande force, à la volonté du Royaume-Uni de réviser le dispositif. Si, en effet, vous introduisez un contrôle de proportionnalité au moment de son exécution, vous tuez le mandat européen ; nous en reviendrions alors au système antérieur avec, pour seul progrès, que la procédure serait entièrement judiciarisée et que la décision finale ne serait plus une décision de gouvernement. Pour le reste, nous affaiblirions cet instrument qui a produit des résultats remarquables.
Je souhaite dire un dernier mot sur les échanges d'informations concernant les condamnations – le système ECRIS. Je vous ai dit, position que l'on peut logiquement adopter dans un premier temps, que, si l'on sort de l'Union européenne, on sort en même temps du système d'interconnexion des casiers judiciaires. Ma conviction, en tant que praticien de l'entraide, confronté aux mécanismes de grande criminalité organisée et de terrorisme, est que nous devons évidemment trouver des solutions techniques permettant au Royaume-Uni de rester dans le système. Je suis tout à fait d'accord avec vous : il faut conserver cet échange d'informations avec les Britanniques, échange qui suivra peu ou prou le même modèle que celui qui prévaudra dans leurs relations avec Europol, dès lors qu'ils auront passé avec cette agence un contrat de coopération opérationnel et stratégique. Il faut conserver la fluidité des échanges d'informations.

Nous vous remercions, M. Baab, et nous recevrons volontiers une éventuelle contribution écrite de votre part.
L'audition s'achève à midi trente-cinq.
Membres présents ou excusés
Présents. - .M. Claude Bartolone, M. Philip Cordery, Mme Elisabeth Guigou, M. Pierre Lequiller, M. Jacques Myard, M. Gilles Savary.
Excusés. - Mme Nicole Ameline, M. Éric Elkouby, M. Joël Giraud, Mme Marietta Karamanli, M. Michel Piron.