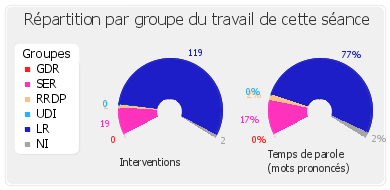Séance en hémicycle du 5 octobre 2015 à 21h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.


Cet après-midi, l’Assemblée a commencé la discussion des articles de la proposition de loi, s’arrêtant à l’article 3.

La parole est à Mme Bernadette Laclais, première inscrite sur l’article.

Messieurs les rapporteurs, vous ne serez pas surpris que je fasse référence à une formulation qui a déjà été évoquée en séance comme en commission, et qui n’est pas, me semble-t-il, totalement satisfaisante : vous en avez convenu puisque vous avez bien voulu envisager qu’elle soit revue dans le cadre des débats au Sénat. Nous savons qu’il sera difficile, dans le cadre de la navette, de parvenir à une position satisfaisante. Néanmoins, vous nous avez invités à formuler des propositions. C’est ce à quoi je m’emploierai par l’amendement no 229 , qui a pour objet de proposer une formule alternative aux mots « de ne pas prolonger inutilement » figurant à l’alinéa 2. De fait, le mot « inutilement » n’est pas compris dans le sens que vous avez entendu lui donner : il est perçu de manière négative, comme s’il y avait des vies utiles et des vies inutiles. Ce n’est bien sûr pas le sens que vous avez souhaité donner à ce mot, mais je crois qu’il serait opportun, dans l’esprit que vous avez recherché tout au long de ce texte, que nous arrivions à une formule plus consensuelle.

Les soixante-sept associations membres du comité d’entente des associations représentatives de personnes handicapées et de parents d’enfants handicapés sont également inquiètes car à deux reprises, la proposition de loi dispose que l’arrêt des soins ne peut être entrepris, pour des personnes hors d’état d’exprimer leur volonté, telles que les personnes présentant des handicaps complexes de grande dépendance, qu’à l’occasion d’une procédure collégiale comprenant, dans la plupart des cas, un médecin hospitalier et en recueillant, à défaut de directives anticipées, le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage émanant de la famille ou des proches. Cette disposition n’est, selon elles, pas protectrice pour les personnes en situation de handicap complexe de grande dépendance, car seul le médecin référent de l’établissement ou du service qui les suit est à même de poser un diagnostic averti sur leur situation réelle. Accepteriez-vous, madame la ministre, d’ajouter la consultation du médecin référent à la liste des personnes devant être consultées lors de la procédure collégiale ?
L’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens demande également que le processus de décision d’une fin de vie soit véritablement de nature collégiale, associe tous les proches à la décision et soit défini par voie réglementaire ; on ne saurait se contenter, selon elle, d’une simple référence au code de déontologie médicale. À ses yeux, il est important de préserver le droit d’un patient à être endormi pour passer un cap difficile de sa vie ou terminer sa vie sans qu’elle ne soit raccourcie. Néanmoins, pour ne pas priver le malade de sa liberté, il faut pouvoir le laisser se réveiller régulièrement, par exemple toutes les vingt-quatre heures, afin de voir, le cas échéant, comment il envisage les choses. Étant encore sous l’effet de calmants sédatifs, il est apaisé, ce qui rend possible une conversation sereine. S’il souhaite dormir à nouveau, on peut le rendormir autant de fois que nécessaire et ce, malheureusement, jusqu’à la mort, s’il le faut. Mais s’il se sent mieux, la vie peut prendre un nouveau sens, et le malade peut préférer ne pas être rendormi. Ce droit de vivre encore est légitime et doit être protégé. La sédation profonde est une arme de dernier recours, lorsque l’on ne peut pas répondre autrement à la souffrance physique, psychique ou existentielle, quand on a tout tenté.

Cette proposition de loi introduit, dans son article 3, alinéa 2, une nouveauté : la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Plusieurs études démontrent que, lorsque les recommandations de bonnes pratiques rédigées en 2009 par la Société d’accompagnement et de soins palliatifs sont respectées, la sédation ne précipite pas la mort. Son but doit être de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient. Cependant, cette sédation profonde et continue suscite toujours, à mes yeux, de nombreuses questions. Pourquoi une sédation deviendrait-elle systématiquement profonde et continue lorsque d’autres modalités de sédation sont possibles ou légitimes ? Pourquoi la sédation profonde et continue s’accompagne-t-elle nécessairement de l’arrêt de tout traitement de maintien de vie ? Nous avons discuté, lors de l’examen de l’article 2, de l’arrêt chez le patient sédaté de certains traitements, dont la nutrition et l’hydratation. Je souhaite que le débat nous permette de répondre à toutes ces questions.

Avec cet article 3, nous arrivons à l’une des dispositions les plus importantes de ce texte, puisque, de fait, il instaure un droit à la sédation profonde et continue. Cet article soulève plusieurs problèmes. Premièrement, il emploie le terme de « souffrance » sans préciser s’il s’agit d’une souffrance physique, psychique ou morale ; or, on sait que ces différences peuvent être importantes. Deuxièmement, je rejoins tout à fait ce que disait notre collègue Bernadette Laclais à propos de la formulation « de ne pas prolonger inutilement sa vie », qui pose problème depuis la première lecture. On ne peut la laisser en l’état, et il faut souhaiter que nos débats permettent d’en trouver une autre. Troisièmement, le fait que la sédation soit continue et non réversible jusqu’au décès peut conduire à s’interroger sur les motivations de cette sédation. Quatrièmement, sur les trois cas qui ouvrent ce droit à la sédation profonde et continue, l’un – défini à l’alinéa 4 – pose plus particulièrement problème : dans ce cas, c’est la décision du patient – et non son état – qui ouvre le droit à la sédation profonde et continue. On voit bien que l’on est en train de passer à une autre logique que celle qui prévalait jusqu’à présent dans les textes sur la fin de vie.

C’est la deuxième fois que nous avons cette discussion dans l’hémicycle, et je voudrais en profiter pour saluer la grande tenue de nos débats et le respect manifesté envers l’ensemble des positions exprimées. J’en remercie nos deux rapporteurs. S’agissant de l’article 3, je voudrais manifester mon soutien à l’amendement no 64 de Jean-Louis Touraine, cosigné par plusieurs de nos collègues, qui a pour objet de légaliser l’aide active à mourir. Comme vous le savez, beaucoup sur ces bancs et, plus généralement, au sein de la population de notre pays, regrettent que le texte passe à côté de cette occasion. Je voudrais dire deux choses. Quant à la méthode, il a clairement été fait le choix, sur ce texte, d’une démarche consensuelle. Je ne suis évidemment pas opposée au consensus en soi, mais les grandes avancées sociétales qui ont caractérisé notre pays n’ont jamais été obtenues par consensus : il faut parfois assumer le fait de faire bouger les lois pour faire encore plus, par la suite, bouger les opinions et les mentalités. Nous aurions donc pu adopter une autre démarche.
C’est d’autant plus vrai qu’il existe une adhésion citoyenne de grande ampleur dans notre pays, dont il faut avoir conscience, en faveur de l’aide active à mourir. Partout en France, dans les territoires, se manifeste un vrai soutien citoyen, une vraie demande à la concrétisation de ce nouveau droit : celui d’être pleinement maître de sa fin de vie.

Je plaide donc pour que nous puissions enfin répondre à cette attente qui, encore une fois, ne vise pas à forcer quiconque à utiliser ce droit, mais bien à permettre à tous ceux qui le veulent de faire usage de cette ultime liberté.

J’espère que nous pourrons enfin répondre à cette attente qui, j’insiste à nouveau, s’exprime très fortement dans notre pays.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Il s’agit d’un article essentiel, dans la mesure où il fonde la grandeur du texte, au demeurant important, que nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture. La notion de sédation profonde jusqu’au décès désigne un acte fort qui donne au patient, dont on sait qu’il va mourir, le moyen d’abréger ses souffrances, qu’elles soient physiques ou psychologiques. C’est un changement extrêmement important, structurant pour la société française. Il ne s’agit ni plus ni moins que de l’acceptation de la mort comme pouvant être une décision accompagnée par les soignants. J’ai déposé quelques amendements sur cet article et défendrai au cours des débats l’idée qu’il n’y a pas de vie inutile. Je souhaiterais d’ailleurs que, dans cet article, on supprime le mot « inutile ». Aucune vie n’est inutile. En revanche, il appartient à celui qui souffre, qui va mourir, de demander que l’on abrège ses souffrances. Il convient donc de supprimer ce concept d’inutilité. L’utilité ou l’inutilité d’une personne est une notion qui lui appartient.

Je voudrais, à cet instant du débat, insister sur le moment important que nous vivons – le qualifier d’historique serait sans doute excessif. Depuis que l’homme est sur Terre, il meurt en souffrant. L’analgésie, qui, si je ne me trompe, n’est pas si ancienne, permet aujourd’hui de combattre efficacement les rages de dents, les migraines et les douleurs les plus sévères. Le rêve de l’homme moderne est peut-être, à l’instar de Molière, de mourir sur scène, mais aussi – c’est là une certitude – de ne pas mourir en souffrant : comme on le voit dans nos permanences, c’est indéniablement l’élément le plus rassembleur.
J’entends que certains voudraient revenir sur des textes existants, ne pas aller aussi loin que le fait l’article 3, tandis que d’autres voudraient aller au-delà. Il me semble, pour ma part, que c’est un progrès considérable que de pouvoir se dire que, le moment venu, si l’on souffre d’une maladie n’offrant aucune issue, cette possibilité s’ouvrira à nous. J’entendais tout à l’heure un de nos collègues dire que l’on pouvait endormir, réveiller puis, à nouveau, endormir le patient mais, lorsque la personne est en fin de vie, la date de sa mort est quasiment connue, à quelques jours près. L’essentiel est que, même si l’on est à domicile, toute douleur, physique comme psychique, puisse être contrôlée : voilà ce que les gens nous demandent. En tout état de cause, nous assumons une lourde responsabilité, car c’est sans doute la première fois que nous proposons un texte qui va aussi loin en termes d’euthanasie, même s’il ne s’agit pas de l’euthanasie active que certains suggèrent.

Cet article montre à nouveau combien chaque terme est important et combien ce texte va loin. Le deuxième alinéa parle de « prolonger inutilement sa vie ». Qui est apte à juger de l’utilité d’une vie ? Rendons-nous compte, mes chers collègues, de l’angoisse que nous provoquons en légiférant sur ce sujet : angoisse chez les personnes âgées hospitalisées en gériatrie, notamment pour celles qui n’ont pas de famille et qui craignent que l’on estime que leur vie est inutile, angoisse des personnes lourdement handicapées – les nombreux courriels que nous avons reçus en sont la preuve.
Cet article aborde la difficile et pénible question de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Il n’est plus seulement question de soulager, mais de conduire à la mort. C’est un pas que beaucoup de médecins ne sont pas prêts à franchir. Ils l’estiment contraire à leur déontologie, et l’on doit prévoir à leur intention une clause de conscience, afin de respecter leurs convictions personnelles et éthiques. Éviter toute souffrance, c’est le but des soins palliatifs. Il convient donc – on ne le répétera jamais assez – d’améliorer les dispositifs pour soulager la souffrance, mais aussi de développer ces soins palliatifs trop rares, notamment en zone rurale. Il y a là une inégalité inacceptable. Mais n’allons pas plus loin : la sédation peut être contrôlée et réversible, permettant au malade d’avoir des temps de communication, si importants, avec son entourage. Ne systématisons donc pas les choses, sur un sujet si délicat, et faisons confiance aux équipes médicales : les médecins adaptent d’ailleurs, d’ores et déjà, les mesures à prendre en fonction de chaque situation.

Je suis saisie de quatre amendements de suppression de l’article, nos 13, 60, 244 et 316.
La parole est à Mme Marion Maréchal-Le Pen, pour soutenir l’amendement no 13 .

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement identique no 60 .

Nous n’avons pas déposé d’amendements de suppression sur d’autres articles que celui-ci, car c’est cet article 3 qui pose le plus de problèmes. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une opposition frontale : nous nous interrogeons simplement sur des dispositions qui nous apparaissent très clairement dangereuses. Cet article se singularise par des maladresses de rédaction, qu’il s’agisse du recours au concept d’utilité – je fais référence aux mots « de ne pas prolonger inutilement sa vie », – sur lequel on peut s’interroger, ou de la notion de souffrance, qui peut également susciter des interrogations : s’agit-il uniquement de la souffrance physique, ou cela peut-il aller jusqu’à des souffrances psychiques ou morales, beaucoup plus difficiles à évaluer ? Quant à la notion de sédation profonde et continue, il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, les sédations sont dans quasiment tous les cas réversibles : aller vers une sédation continue jusqu’au décès, c’est donc faire évoluer nos pratiques. Enfin, trois cas ouvrent droit à la sédation profonde et continue, dont celui, inscrit à l’alinéa 4, qui ne se fonde pas sur l’état de santé du patient, mais sur sa volonté : c’est sa décision d’arrêter un traitement qui lui ouvre ce droit. Nous sommes très clairement confrontés à une dérive euthanasique que nous contestons. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

La parole est à M. Jacques Bompard, pour soutenir l’amendement identique no 244 .

Ce qui nous inquiète dans cette législature, chers collègues, c’est que la majorité prétend tout régler par la loi. Je crois que cela est très prétentieux.
Il y a un certain nombre d’années, madame la ministre, votre prédécesseur, sous Mitterrand, avait déclaré la guerre à la pauvreté. On sait ce qu’il en est : malgré les lois, la pauvreté s’est développée – au point, d’ailleurs, de devenir un peu insupportable.
Vous considérez que l’homme est au-dessus des lois de la nature. Nous sommes là dans le mythe de l’apprenti sorcier, avec les résultats que l’on sait.
Cet article revient à créer un suicide médicalement assisté. Je rappellerai dans toutes mes interventions cette réalité profonde, violente et tout à fait bouleversante pour notre société.
Toutes les dispositions de l’article 3 sont d’ailleurs singulièrement morbides. Nous craignons qu’elles n’ouvrent la voie à des dérives encore plus néfastes.
Qu’une assemblée française puisse estimer qu’une prolongation de la vie peut être inutile évoque un vocabulaire sinon effrayant, du moins particulièrement malheureux.
Très simplement, c’est aussi une porte ouverte à toutes les dérives. Nos collègues proposent déjà, par voie d’amendement, l’aide active à mourir. À quand une marchandisation de la mort ou l’organisation d’une fin de vie sur catalogue ?
Nous ne pouvons tolérer que notre société aille à sa perte et à l’implosion éthique.

Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements de suppression ?

On peut effectivement jouer à se faire peur et dire que ce qui ne figure pas dans le texte aboutira plus tard à une dérive. Mais on peut en dire autant de tous les textes : mal interprétés, ils peuvent entraîner une dérive.
Le fait de dire, dans le code de déontologie, que le médecin ne doit pas prolonger inutilement l’agonie est-il choquant ? Non. Ce n’est pas la vie qui est inutile, c’est parfois sa prolongation : il s’agit là de deux éléments fondamentalement différents.
J’en suis désolé : la vie est la vie, et la prolongation d’une vie qui – nous l’avons dit tout à l’heure – est purement biologique paraît en effet médicalement inutile. Elle entre donc dans le cadre de l’obstination déraisonnable.
S’agissant de la sédation, je voudrais tout de même citer deux textes issus de propositions faites par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs en vue de poursuivre en France une politique de soins palliatifs.
La première vise à améliorer la sédation en phase terminale – c’est bien de cela que nous parlons. Chaque patient doit être assuré d’être soulagé s’il présente un symptôme insupportable. La Société française d’accompagnement et de soins palliatifs considère que les droits des patients doivent être utilement renforcés en leur donnant la possibilité de demander une sédation lorsqu’ils présentent un symptôme qu’ils jugent insupportable.
Mais qu’est-ce donc, du point de vue des soins palliatifs, qu’un symptôme insupportable ? Selon la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, les symptômes physiques réfractaires vécus comme insupportables par le patient se définissent comme « tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé, en dépit des efforts pour trouver une solution thérapeutique adaptée, sans compromettre la conscience du patient ».
Le caractère réfractaire, ainsi que la pénibilité pour la personne malade, plus que le symptôme en lui-même, justifient donc cette sédation. Cette proposition figure au chapitre « sédation continue en phase terminale ».
Je rappelle que ce texte ne trahit pas la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, mais qu’il s’inscrit dans sa continuité.
À mes yeux, il provoque une avancée significative pour au moins une raison : ce droit du malade à être soulagé – dont parlent les sociétés de soins palliatifs – lorsque la souffrance est réfractaire au traitement qu’on lui propose et que la médecine est devenue impuissante, eh bien oui, dans ces conditions, devient légitime.
Est-ce un scandale d’avoir le droit de ne pas souffrir avant de mourir, lorsque la médecine est impuissante à soulager vos souffrances ? La réponse apparaît assez évidente.

La parole est à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, pour donner l’avis du Gouvernement.
Défavorable.

Je réagis aux propos du rapporteur Jean Leonetti. La notion de souffrance réfractaire est absente dans l’un des trois cas qui figurent à l’article 3 – le deuxième, prévu à l’alinéa 4. Je cite : une sédation profonde et continue peut être mise en oeuvre « lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme. » À aucun moment il n’est fait état de souffrance réfractaire.
Dans le premier cas, cette condition figure bien à l’alinéa 3, qui prévoit qu’une sédation profonde et continue est mise en oeuvre « lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ».
Dans le troisième cas, prévu à l’alinéa 5, cette sédation est également mise en oeuvre « lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable ». On peut considérer que cette obstination inclut la notion de souffrance réfractaire.
Mais dans le deuxième cas, c’est différent : ce critère n’est pas satisfait.

Pardon de faire appel à un cas concret : prenons l’exemple d’un patient atteint d’une maladie dégénérative comme une sclérose latérale amyotrophique en phase terminale maintenu artificiellement en vie par une assistance respiratoire.
Si ce patient demande à ce que l’on débranche cette assistance, a-t-on le droit de la lui infliger alors qu’il la refuse de manière réitérée ? La réponse, qui figure dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et est confirmée par la loi du 22 avril 2005, est non. On ne peut pas imposer un traitement à une personne qui le refuse, même s’il l’a antérieurement accepté.
Par conséquent, on va débrancher le respirateur, ce qui va entraîner – on le sait – un étouffement du patient et, à court terme, sa mort certaine. Ce traitement de survie étant suspendu, comment pourrait-on attendre la souffrance réfractaire, dont on sait qu’elle va inéluctablement survenir, pour mettre en place le traitement qui va essayer d’empêcher sa survenance ?
On voit bien qu’on est obligés non seulement – pardon de le dire techniquement – d’associer une sédation profonde, pour ne pas avoir les effets négatifs de l’arrêt d’un traitement, à l’arrêt du respirateur, en procédant d’abord à la première et ensuite au second.
On va donc d’abord endormir le patient pour ensuite débrancher le traitement de survie : il paraît logique que les actes s’enchaînent dans cet ordre.
Nous pourrions prendre d’autres exemples – et ils sont nombreux – que celui que je viens de citer. Bien entendu, il ne s’agit pas d’un patient qui dit à son médecin : « arrêtez mon traitement antibiotique, j’ai droit à une sédation ».
Le dispositif s’applique à un patient dont l’arrêt du traitement va mettre la vie en danger à court terme, et dont on ne peut éviter la souffrance – à la fois atroce et impossible à éviter – entre le moment où le traitement est arrêté et celui où la mort survient.
Effectivement, on associe automatiquement à cet arrêt une sédation profonde et continue jusqu’au décès, qui va survenir parce que le traitement de survie a été arrêté.
Je comprends donc très bien que l’on puisse imaginer que le dispositif puisse s’appliquer à quelqu’un qui dit : « arrêtez mon traitement contre le diabète ». On imagine que ce patient, qui va donc mourir du fait de l’arrêt de son traitement, réclame la même sédation profonde.
Or tout le monde sait que l’arrêt d’un traitement anti-diabétique ne provoque pas la mort dans les secondes qui suivent : un patient dans ce cas peut survivre des semaines, des mois ou même des années. Dans ce cas, il n’aura pas « droit » à la sédation profonde, car il sera éventuellement possible d’examiner si son état s’accompagne d’une souffrance réfractaire.
Si c’est le cas, elle pourra être prise en charge, même dans le cas d’un arrêt de traitement, dans un dialogue singulier entre le médecin et son malade.
En revanche, l’arrêt de certains traitements de survie entraîne la mort immédiatement et de façon inéluctable, mais la certitude quant à sa survenance s’accompagne d’une latence : elle n’arrive pas à la seconde où l’on arrête le traitement.
On va donc vivre ensuite une période, dite agonique, au cours de laquelle on va essayer d’éviter toute souffrance. Voilà pourquoi un deuxième cas est prévu.
Permettez-moi de rappeler le troisième cas : il s’agit de l’arrêt du traitement d’une personne cérébro-lésée qui ne peut pas exprimer sa volonté et pour laquelle on décide de mettre fin aux traitements de survie.
Si on y met fin, il paraît logique, dans ce cas également, que la médecine, ou plutôt la société à travers elle, accepte la volonté du patient et la décision collégiale des médecins. En même temps qu’elle le fait, elle doit aussi garantir la non-souffrance.
Rappelez-vous tout de même le cas de ce jeune homme pour lequel on avait arrêté tout traitement : on a regardé sa mort survenir sans qu’aucun traitement sédatif ou antalgique ne soit mis en place.
Je rappelle également l’article 37-3 du code de déontologie, entré en vigueur en accord avec le Conseil de l’ordre et le Conseil d’État, qui prévoit que lorsque l’on se trouve dans cette situation d’arrêt des traitements par refus d’une obstination déraisonnable, on est bien obligés, par solidarité et afin d’éviter toute souffrance, de mettre en place la sédation profonde et continue.
Par conséquent, il ne s’agit pas de situations imposées, mais de situations dans lesquelles on sait qu’une agonie douloureuse va survenir. Il s’agit de l’éviter pour aboutir à une fin de vie sereine et apaisée dont nous espérons tous, comme l’ensemble des Français, pouvoir bénéficier.

Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 1, un alinéa ainsi rédigé : « une personne a le droit de demander une sédation transitoire pour être calmée de souffrances physiques ou morales mal soulagées. Un traitement à visée sédative provoquant une altération de la vigilance est proposé. Il est réversible à tout moment et réévalué quotidiennement après un bref temps d’éveil de la personne. Il est associé à l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité de ses douleurs. »
Cet amendement prévoit effectivement des sédations transitoires, qui ne sont pas continues jusqu’au décès avec une possibilité – à tout moment – de réversibilité. Il prévoit également que ces sédations s’accompagnent de l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité des douleurs, ce qui n’est pas prévu dans le texte aujourd’hui.
Il est en effet important de prévoir des modes de sédation qui ne condamnent pas obligatoirement à aller jusqu’au décès, mais qui permettent, en fonction de l’évolution de l’état de santé, une proportionnalité et une réversibilité.
L’amendement no 59 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.

Cet amendement reprend un amendement qui a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat et qui visait à clarifier et à améliorer le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Il a pour objet de récrire complètement les alinéas 2 à 7 de cet article 3. Il ne revient pas sur les trois cas que venons d’évoquer : son intérêt est de n’en retenir que deux. Le premier est celui dans lequel « le patient atteint d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire à tout autre traitement, exprime la volonté d’éviter toute souffrance ».
Dans ce cas, il s’agit effectivement de critères cumulatifs et l’on retrouve bien l’affection grave et incurable, l’engagement du pronostic vital, ainsi que la souffrance réfractaire.
Or, dans la rédaction actuelle, l’alinéa 4 supprime la notion de souffrance réfractaire, et même la possibilité d’une telle souffrance, puisqu’il n’est aucunement fait mention d’une fin et d’une agonie douloureuses – je ne fais que reprendre les termes employés par Jean Leonetti.
Il y aura donc un deuxième cas dans lequel « le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et sauf si ses directives anticipées s’y opposent, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie au titre de l’obstination déraisonnable et que la souffrance du patient est jugée réfractaire. »
À nouveau, ces critères sont cumulatifs. Dans cas, une sédation profonde et continue serait administrée. On le voit, cette rédaction est bien meilleure et bien plus précise. En outre, elle n’ouvre pas la voie à une dérive euthanasique comme le fait le deuxième cas prévu à l’alinéa 4.
C’est pour ces raisons que nous reprenons cet amendement adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.
L’amendement no 269 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement identique no 106 .

Le recours à une sédation profonde et continue n’a de sens que si elle est précédée de soins palliatifs, qui constituent la solution la plus adaptée pour créer les conditions d’une fin de vie apaisée.
Il est donc essentiel qu’un effort national en faveur de leur généralisation et de leur amélioration permette qu’ils soient systématiquement mis en place pour chaque patient y ayant droit.
J’en profite pour saluer la proposition de loi de M. Gosselin qui vise à reconnaître les soins palliatifs comme grande cause nationale 2016.

Toujours dans le but d’éviter la rédaction dangereuse qui a été adoptée en première lecture, nous proposons une référence aux soins visés à l’article L.1110-10, parce que les soins palliatifs sont un droit fondamental et que cela permettrait d’évacuer l’expression « prolonger inutilement sa vie », qui nous fait tous nous interroger, je pense.

La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement identique no 318 .

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement no 20 .

Bénéficier de soins palliatifs est un droit fondamental pour le patient. Avant d’accéder à la demande d’une sédation, le médecin doit s’assurer que les soins palliatifs ont bien été mis en oeuvre.
L’amendement no 20 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.

L’alinéa 2 de l’article 3 prévoit qu’une sédation profonde et continue est effectuée à la demande du patient afin, notamment, d’éviter toute souffrance. Une telle notion peut être très large. La souffrance peut être passagère, elle peut être d’ordre psychologique, mais il est alors difficile de la définir. C’est la raison pour laquelle nous proposons de bien préciser que la souffrance doit être réfractaire et physique : réfractaire, c’est-à-dire qu’on ne peut pas lutter contre, et physique, pour éviter les appréciations purement subjectives d’une souffrance psychologique.
L’amendement no 399 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour soutenir l’amendement no 62 .

Il est important de préserver le droit d’un patient à être endormi pour passer un cap difficile de sa vie ou terminer sa vie sans qu’elle soit raccourcie.
Il est possible de réaliser une sédation contrôlée et réversible à tout moment pour ne pas priver le malade de sa liberté. Régulièrement, par exemple toutes les vingt-quatre heures, il convient de laisser le malade s’éveiller et de voir comment il envisage les choses. Étant encore sous l’effet du calmant sédatif, il est apaisé et il est possible d’avoir une conversation sereine avec lui. S’il souhaite dormir à nouveau, on peut le rendormir autant de fois que c’est nécessaire, et ce jusqu’à la mort s’il le faut, mais, s’il se sent mieux, la vie peut prendre un nouveau sens et il peut préférer ne pas être rendormi.
Ce droit de vivre encore est légitime et doit être protégé.
L’amendement no 62 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.

L’expression « et de ne pas prolonger inutilement sa vie » induit un jugement sur la valeur de la vie du patient. Elle n’a tout simplement pas sa place dans un texte de loi.

La parole est à Mme Bernadette Laclais, pour soutenir l’amendement no 229 .

J’ai déjà partiellement défendu cet amendement il y a quelques minutes. Je vous propose la formule « afin de lui permettre de terminer sereinement et dignement sa vie ».

L’adverbe « inutilement » entraîne incontestablement, à l’Assemblée comme au Sénat, des interprétations qui ne sont pas dans l’esprit de la proposition de loi. Soyons clairs, il s’agit bien ici de ne pas infliger à un patient en fin de vie des traitements inutiles, et non pas de considérer qu’une vie peut être inutile.
Comme Bernadette Laclais, j’ai cherché une autre formule, et je vous propose « terminer sa vie dans la dignité ».

Le mot « inutilement » pose problème depuis la première lecture. Nous étions convenus de le modifier. C’est ce que le Sénat avait fait. On ne peut pas le laisser à la fin de cette deuxième lecture. Il faut donc soit le supprimer, soit le remplacer par un terme sur lequel nous pourrions nous retrouver.

Je vous laisse la parole, monsieur Breton, pour soutenir l’amendement no 63 .

L’expression « ne pas prolonger inutilement sa vie » paraît nous conduire sur le terrain de l’euthanasie ; l’on serait dans une conception utilitariste de la vie humaine. Il faut donc lever cette ambiguïté.
Pour autant, il est nécessaire de conserver le refus de tout acharnement thérapeutique. Aussi, nous proposons de remplacer le mot « inutilement » par l’adverbe « artificiellement » afin de conserver l’esprit de l’article sur l’obstination déraisonnable, qui utilise l’expression « maintien artificiel de la vie ».

La parole est à M. Dino Cinieri, pour soutenir l’amendement identique no 107 .

Nous sommes très nombreux à considérer que le mot « inutilement » n’est pas approprié du tout, et peut même parfois en choquer certains. J’ai longuement cherché, je le reconnais, ce qui aurait pu le remplacer. J’ai proposé les mots « en vain », faute de trouver mieux. Je n’en suis pas très satisfait. Il serait bien de trouver une autre formule. M. Leonetti parlait tout à l’heure d’une obstination déraisonnable. Peut-être. Il faut en tout cas trouver un mot pour remplacer « inutilement ».
Défavorable.

Vu tout ce que nous venons d’entendre, c’est clairement une notion qui pourra être réexaminée en deuxième lecture au Sénat. Peut-être arriverons-nous à un consensus en commission mixte paritaire.

Nous attendions au moins que Mme la ministre ou l’un des rapporteurs nous explique qu’ils allaient faire ce travail, que des termes comme « artificiellement » sont intéressants ou qu’il faudra en trouver un autre. Ne pas répondre, c’est vraiment une forme de mépris par rapport au travail que nous faisons.

Monsieur le député, loin de moi l’idée de mépriser qui que ce soit dans cet hémicycle, et surtout pas vous, mais nous voyons bien qu’aucune formulation ne satisfait tout le monde.
Nous cherchons, et, comme l’a très bien dit, avec sincérité, M. Lurton, il n’y a pas de formule efficace. « Artificiellement », il me semble que cela avait même été proposé par le Gouvernement. Je ne suis pas opposé à cette idée, mais à chaque fois, on limite et ce n’est pas ce que l’on voudrait dire. « En vain », cela ne « colle » pas ; l’obstination déraisonnable renvoie encore à quelque chose qui existait déjà antérieurement.
Je continue donc à penser que la prolongation peut être inutile, mais que la vie n’est pas inutile, et que, dans le texte, on parle bien de traitements inutiles qui prolongent inutilement la vie, qui n’est jamais inutile.
Si quelqu’un avait trouvé quelque chose de génial et de consensuel, on aurait pu l’adopter. Il y aura encore une lecture au Sénat et une commission mixte paritaire. Je suis sûr que d’ici là, grâce soit à la sagesse du Sénat, soit à l’intelligence conjuguée de l’Assemblée nationale et du Sénat, nous parviendrons à une rédaction équilibrée.
L’amendement no 113 n’est pas adopté.

Comme je vous l’expliquais dans la discussion générale, je propose de légaliser une alternative à la sédation profonde et terminale pour les Françaises et les Français qui le souhaitent et sont en mesure de l’exprimer, de permettre donc un véritable choix et non pas seulement une sédation.
Cette proposition est conditionnée, il est important de le préciser, au fait que le patient soit « en mesure d’accéder à toutes les solutions alternatives d’accompagnement et de soulagement de la douleur physique ou psychique ». Cette condition évacue la crainte légitime que la demande à mourir soit seulement la conséquence d’un manque de places en soins palliatifs, réalité insupportable dans notre pays.
Il s’agit donc ici de répondre à une demande clairement exprimée qui persiste en dépit des soins et de l’accompagnement approprié en toute clairvoyance.
Il s’agit de cas où l’on ne peut remettre en question les motivations du patient qui demande à mourir, patient qui sait qu’il va mourir, qui souhaite en choisir le moment et la manière, un patient qui souhaite partir en toute conscience, un patient qui ne souhaite pas imposer à ses proches la lente dégradation qui précède le décès lors d’une sédation profonde.
Je crois qu’en toute humanité, nous ne pouvons pas ignorer ou refuser cette demande. C’est la raison pour laquelle je vous invite à voter cet amendement.

Je vous demande une suspension de séance de vingt minutes, madame la présidente.
La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.

La séance est reprise.
La parole est à M. Jean-Louis Touraine, pour soutenir l’amendement no 64 .

Il existe aux États-Unis un mouvement d’activistes « anti-choice », contre le choix en début et en fin de vie. Curieusement, ce mouvement, qui s’appelle aussi « pro-life », milite également en faveur de la peine de mort. Il multiplie les nuisances, les menaces, les coups de force ou encore les enquêtes truquées.
La France a heureusement choisi d’emprunter des chemins différents, plus humanistes. Elle est pour le choix en début de vie, contre la peine de mort et, aujourd’hui, elle va peut-être s’exprimer pour le choix en fin de vie. C’est ce à quoi je vous exhorte de façon très raisonnable et très contrôlée. Je sais bien que, pour certains, ma proposition est trop restrictive et trop conditionnée à l’accord concomitant de la personne concernée et d’un collège de médecins.
Nous souhaitons enrichir le texte sans le dénaturer, soit ne faire qu’un pas très modéré. Ce supplément de liberté offert à chacun ne serait utilisé que par ceux qui le souhaitent. Les conditions d’encadrement éviteraient tout risque de dérapage et les travers de la situation actuelle cesseraient, quand 3 400 fins de vie sont provoquées en catimini et en toute illégalité dans nos hôpitaux. Ce serait la fin d’une attitude répressive et privative de liberté à l’égard du malade moribond.
Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen, du groupe écologiste et du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg, pour soutenir l’amendement no 84 , identique au précédent.

Je n’ai aucune capacité à délivrer des titres de noblesse ; sinon, je qualifierais amicalement Jean Leonetti de prince de l’ambiguïté et de marquis de l’euphémisme. En effet, il ne s’agit pas d’une sédation, mais d’une anesthésie générale. Nous savons qu’elle peut durer plusieurs jours. Selon le professeur Sicard, le décès se produit au bout de deux à huit jours, quand d’autres disent que ce serait après une ou deux semaines. C’est un temps d’attente très long, autant pour le patient que pour la famille.
Je ne reviens pas sur la polémique autour de la cessation de l’hydratation et de l’alimentation artificielles, mais nous risquons, avec ces deux solutions, d’imposer aux patients des conditions lentes et douloureuses de fin de vie.
Nous avons affaire à un malade en pleine souffrance, atteint d’une maladie incurable, et nous allons ajouter l’angoisse à la souffrance. C’est pourquoi, pour notre part, nous préconisons d’agir avec davantage de clarté en prévoyant une aide médicalisée à mourir, de manière que le patient ne subisse pas cet ensemble d’inconvénients.
J’ajoute qu’il y a un autre inconvénient : étant sous anesthésie générale continue « jusqu’au décès », selon les termes du texte, le patient ne peut avoir aucun contact avec sa famille alors qu’il souhaiterait sans doute avoir un dernier échange avec elle.
Je vois bien les inconvénients de la solution proposée dans ce texte, et nullement les avantages. Je pense qu’elle est plus pratique pour les médecins que pour les patients, car les premiers pourront toujours dire – du moins certains médecins, car cette position devrait être heureusement rare – qu’ils se sont bornés à soulager, et non pas à faire perdre la vie, et ainsi échapper aux incriminations qui y sont liées. En revanche, je ne vois pas l’intérêt pour le patient qui, pendant une, voire deux semaines, va vivre souffrance, détresse et angoisse, car on ne sait pas, en réalité, ce qu’une anesthésie générale d’une dizaine de jours peut donner.
C’est pourquoi les radicaux, qui ont toujours été très attachés au droit de mourir dans la dignité depuis la proposition de loi d’Henri Caillavet en 1978, ou encore à travers celle déposée ici même le 26 septembre 2012, sont favorables à une autre solution : l’aide médicalisée au décès.
Applaudissements sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et du groupe écologiste.

Sur l’amendement no 257 , ainsi que sur les amendements identiques nos 64 et 84 , je suis saisie par le groupe écologiste et par le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste d’une demande de scrutin public.
Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg, pour soutenir l’amendement no 90 .

Il s’agit hélas d’un amendement de repli, mais il peut exister une pluralité de solutions. Entre celle préconisée par le texte et la solution de l’assistance médicalisée que nous sommes nombreux à défendre, il est possible de faire un choix qui n’exclurait ni l’une ni l’autre.

La parole est à M. Alain Claeys, rapporteur, pour donner l’avis de la commission sur ces quatre amendements.

Nous sommes en présence d’amendements qui visent à introduire soit l’assistance médicale au suicide, soit l’assistance médicalisée active à mourir. Je rappelle au préalable à Véronique Massonneau que le Comité national d’éthique n’a pas retenu dans son avis l’assistance médicale au suicide. Il a seulement fait un rapport de synthèse dans lequel il indique qu’elle avait été évoquée au cours de la conférence citoyenne.
Nous avons été tout à l’heure face à un choix : adopter la disposition proposée dans le texte ou ne pas bouger et revenir à la loi de 2005 voire, pour certains, à l’état antérieur. Les termes du choix qui nous est proposé maintenant sont bien posés : il ne s’agit pas de tous les malades, mais de ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme. L’amendement de Véronique Massonneau reprend intégralement l’article 3, y ajoutant seulement le choix entre sédation ou assistance médicale au suicide. Les amendements identiques de nos collègues Jean-Louis Touraine et Roger-Gérard Schwartzenberg réécrivent totalement l’article 3 et proposent l’assistance médicalisée active à mourir.
Je respecte profondément ces positions, comme j’ai respecté celles exprimées par certains membres de l’opposition à l’occasion d’amendements précédents, mais je me demande si nous allons sortir de ce débat avec une réponse à la double question que se posent nos concitoyens : comment être entendu ? comment avoir une fin de vie apaisée ? Telle est leur volonté et voilà comment nous sommes aujourd’hui interpellés. Nous l’avons répété les uns et les autres, sur tous les bancs : il y a aujourd’hui dans notre pays une inégalité territoriale et une inégalité par rapport aux établissements – selon que l’on meurt dans un CHU, dans un EHPAD ou à domicile –, mais nous avons aussi le devoir de répondre à cette double question, et donc de faire un certain nombre d’avancées. Nous savons que ce débat traverse notre société. Ce n’est pas au terme d’une discussion parlementaire que nous le réglerons définitivement. Il est parfois d’origine philosophique, parfois d’origine religieuse, il faut en tenir compte. Mais nous devons converger vers des propositions qui répondent à la demande de nos concitoyens. J’espère que ce sera le cas avec les directives anticipées, un moyen d’être entendu, et avec la sédation profonde et continue jusqu’au décès, un moyen d’avoir une fin de vie apaisée.
La rédaction à laquelle Jean Leonetti et moi-même sommes parvenus ne constitue pas un compromis entre nous deux. Nous avons participé ici même à des débats sur le début de la vie, sur la bioéthique, et traduit par nos votes des désaccords. Ici, nous avons considéré que nous pouvions converger vers une proposition de loi qui réponde concrètement à l’attente de nos concitoyens. C’est pour cette raison, et je vous le dis en conscience ce soir, mes chers collègues, tout en respectant les positions des uns et des autres, que je ne voudrais pas qu’à cause d’un amendement, nous ne parvenions au bout du compte, dans quelques mois, à aucun texte. Car alors nous aurions failli devant nos concitoyens.

J’ajoute que nous savons tous très bien que ce n’est pas uniquement avec ce texte que nous ferons reculer en France le mal-mourir. Mme la ministre a évoqué d’autres aspects de la question, tels que les soins palliatifs. Ils sont, eux aussi, sur la place publique et il faut trouver des solutions. Mais ce soir, si nous ne pouvons pas concrétiser cette convergence, je crains que nous n’aboutissions au final, je le répète, à aucun texte. Pour toutes ces raisons, je vous demande en conscience de repousser ces amendements.
Le Gouvernement demande que ces amendements ne soient pas votés. Je ne reprendrai pas le débat au fond, car nous l’avons déjà eu longuement en première lecture. Je vous ai appelés tout à l’heure, mesdames, messieurs les députés, à respecter l’équilibre issu du texte voté par votre assemblée. Je me contenterai de faire deux observations.
La première, c’est qu’à entendre certaines interventions des auteurs de ces amendements, on a le sentiment que ce texte ne se limiterait qu’à des avancées sur les soins palliatifs. Ceux-ci sont évidemment tout à fait essentiels, et nous devons parvenir à les diffuser plus largement et plus équitablement sur l’ensemble du territoire. Je crois que ce point nous rassemble. Mais ce texte, je tiens à le dire avec force, ne se limite pas aux soins palliatifs. Il ne faudrait pas oublier les avancées fondamentales qu’il comporte dans la reconnaissance de la parole et de la volonté du patient en fin de vie. Il me semble que certains d’entre vous en sous-estiment la portée, alors qu’il s’agit d’une véritable rupture par rapport à l’état du droit aujourd’hui. C’est à partir de là que d’autres évolutions seront envisageables un jour.
Ma seconde observation, c’est que ce moment du débat, celui de la deuxième lecture, se situe après l’échange des différents arguments qui a permis à chacun d’affirmer ses positions, et après le débat au Sénat qui a fait apparaître des lignes de fracture beaucoup plus fortes que ce qu’on pouvait imaginer. L’existence d’éléments d’affrontement à l’Assemblée serait gage d’inquiétude pour nos concitoyens.
C’est pour ces deux raisons, parce que ce texte comporte des avancées extrêmement déterminantes et parce que nous avons besoin de nous rassembler pour aller de l’avant, que je donne un avis défavorable à ces amendements et vous appelle à rester dans la ligne de l’architecture élaborée par la proposition de loi.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants: 52 Nombre de suffrages exprimés: 48 Majorité absolue: 25 Pour l’adoption: 11 contre: 37 (L’amendement no 257 n’est pas adopté.)
Il est procédé au scrutin.

L’amendement no 90 n’est pas adopté.


Cet amendement a pour objet de rappeler que la sédation requise par l’état d’un patient en soins palliatifs n’est pas forcément « profonde et continue ». Elle peut être ponctuelle, intermittente ou prolongée. Certains patients, s’ils souhaitent dormir lorsqu’ils présentent une souffrance insupportable, apprécient des plages d’éveil pour rester en relation avec leur entourage et communiquer avec lui, dans la mesure du possible. Cela est particulièrement fréquent lorsque le patient a subi une sédation pour des symptômes rebelles et des situations de détresse. Ce nouveau droit à la sédation profonde et continue pourrait faire oublier que d’autres modalités de sédation sont possibles et légitimes.

La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement identique no 334 .
Même avis.

La proposition de loi prévoit que la sédation profonde et continue est maintenue jusqu’au décès. Cette approche ne permet pas que le patient, s’il le souhaite, puisse être réveillé, afin de vivre ses derniers moments de conscience et d’entrer en relation avec son entourage. C’est pourquoi il est proposé de supprimer les mots « maintenue jusqu’au décès ».
L’amendement no 69 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.

Cet amendement vise à supprimer les mots « et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie » à l’alinéa 2. En effet, si la mise en oeuvre d’une sédation associée à l’arrêt des soins et traitements inutiles et disproportionnés est justifiée, celui des soins et traitements utiles et proportionnés ne l’est pas.
L’amendement no 70 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.
Même avis.
L’amendement no 71 n’est pas adopté.

L’alinéa 2 soulève des inquiétudes sur les notions de souffrance, de prolongation inutile de la vie et de sédation profonde et continue. Cet amendement vise à le compléter en prévoyant que cette sédation s’effectue, selon une précaution d’usage, « conformément aux recommandations de bonne pratique édictées par la Haute autorité de santé ». Ces recommandations permettraient de s’assurer que les risques identifiés dans cet alinéa sont bien endigués par la HAS.
Même avis.
L’amendement no 72 n’est pas adopté.

La parole est à M. Jacques Bompard, pour soutenir l’amendement no 389 .

Si la société a pour rôle d’empêcher le suicide, cette tâche ne revient pas fondamentalement à l’État. En revanche, dans la mesure où celui-ci a pour rôle de préserver la paix civile, il lui appartient de ne pas pousser sa population à de telles pratiques, voire de les interdire dans la loi. Car si l’homme incline naturellement à la vie, ce dernier, dans des passages difficiles, peut être tenté de supprimer son existence, non par pulsion de mort, mais parce que sa vie ne lui convient pas. En d’autres termes, il s’agit de traiter les causes du mal plutôt que de valider la misère humaine en acceptant des expédients mortels tels le suicide.
Le suicide est également un crime envers la société : un homme ne peut pas agir individuellement sans que ses actes n’aient de répercussion. En se tuant, il fait du mal à la société. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre en charge les personnes souffrantes, mais également de leur faire comprendre la gravité de leur acte. C’est dans cet esprit que la loi interdit le suicide.
Or la loi sur la fin de vie introduit implicitement la légalité du suicide, comme nous venons de le voir. Cet article n’est donc pas seulement illégal, car le suicide assisté est considéré en France comme un homicide, mais il est encore plus rigoureusement interdit en vertu de l’article 223-6 du code pénal, comme non-assistance à personne en danger.

Avis défavorable. Je précise que la loi n’interdit pas le suicide. C’est un droit-liberté qui, contrairement aux droits-créances, peut être demandé à la société. Chacun a la liberté de mettre fin à ses jours. Ce principe vaut depuis 1792. Monsieur Bompard, je vous invite à actualiser vos connaissances.
Avis défavorable.
L’amendement no 389 n’est pas adopté.


Nous en venons avec ces amendements aux trois cas de mise en oeuvre de la sédation profonde et continue. L’alinéa 3 expose le premier, « lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ». Cet amendement prévoit de substituer aux mots « dont le pronostic vital est engagé à court terme » l’expression « en phase terminale ». Si cet article vise à mieux diffuser les bonnes pratiques de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, il convient d’être très précis et de limiter la sédation systématique proposée par cet article à la toute fin de vie, qualifiée par la SFAP de « phase terminale ».

La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement identique no 333 .

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement no 22 .

La mention « court terme » est imprécise du point de vue législatif. En outre, il importe de ne pas garantir excessivement la fiabilité des pronostics médicaux. La médecine est parfois étonnante : à raison, les médecins se gardent généralement de quantifier des « délais de reste à vivre » à leur patient reconnu pourtant en fin de vie.

La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour soutenir l’amendement no 246 .

Cet amendement vise à soumettre la mise en place d’une sédation à la condition d’une impasse thérapeutique, et non d’un pronostic vital engagé à court terme. MM. les rapporteurs ne partagent pas ma vision, mais je persiste. Qu’entendons-nous par « pronostic vital engagé à court terme » ? La définition de ce délai est-elle laissée à l’appréciation du médecin, pouvant dès lors varier selon les praticiens ?
La définition de l’ « impasse thérapeutique » que je propose d’introduire est certainement moins sujette à controverse. Il s’agit là d’un état que la médecine reconnaît comme étant celui de personnes atteintes d’une maladie grave et incurable sans rémission possible, d’une personne condamnée par sa maladie. Il est bien question ici de maladie, et non de handicap.
J’ajoute que l’impasse thérapeutique n’est pas la simple condition au bénéfice de la sédation profonde. Elle vaut aussi pour des personnes malades dont les souffrances sont insupportables et inapaisables. Dans ces cas, il est légitime de répondre à de telles souffrances, que la fin de vie soit pronostiquée à court terme ou non.

Il existe une réelle incertitude sur la portée de la notion de « pronostic vital engagé à court terme ». Ainsi, à la lecture de l’article 3 de la proposition de loi, il est difficile de savoir si le court terme désigne uniquement les situations où le patient risque de décéder dans les quelques heures ou quelques jours qui suivront, ou s’il vaut également pour les situations où le patient risque de décéder dans les semaines ou les mois qui suivront.
Compte tenu de cette incertitude sur la limite temporelle de cette disposition, il existe de sérieux risques qu’elle soit utilisée pour provoquer délibérément la mort de patients dont le pronostic vital ne serait engagé qu’à l’échéance de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, ce qui serait constitutif d’une euthanasie.
Ainsi, la volonté des auteurs de la proposition de loi de ne pas autoriser en droit français l’euthanasie se verrait contournée. De plus, le flou de cette notion de « pronostic vital engagé à court terme » risque de se traduire par une multiplication des poursuites pénales et des actions en responsabilité contre les médecins, au rebours de l’objectif de la proposition de loi, qui est de sécuriser la situation juridique de ces médecins.
Par conséquent, il est essentiel de circonscrire de façon beaucoup plus claire les cas visés par cette disposition en limitant le recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès aux cas visés par cette disposition, lorsque le pronostic vital des patients est « engagé à très court terme », c’est-à-dire dans les quelques heures ou quelques jours qui suivront l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie.

La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement identique no 332 .

Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements en discussion commune ?

Avis défavorable. D’après les auditions que nous avons effectuées auprès des médecins concernés, la « phase terminale » peut se compter en semaines ou en mois. Elle est donc plus longue qu’un « pronostic vital engagé à court terme ». Nous ne pouvions naturellement pas mentionner dans la proposition de loi « quelques heures » ou « quelques jours ».
Certains médecins cancérologues considèrent que la phase terminale commence à partir du moment où se produit un échappement thérapeutique, c’est-à-dire où ils ne peuvent plus garantir que la situation va s’améliorer. Cette situation, on le sait, peut heureusement durer des mois ou des années. Les médecins nous ont rappelé que l’expression « phase terminale » couvrait un espace de temps beaucoup trop large pour notre objectif, cette situation d’impasse thérapeutique où l’on ne parvient pas à calmer le patient alors que, dans le même temps, le pronostic vital est engagé à court terme. C’est la raison pour laquelle nous avons utilisé ce terme qui correspond, monsieur Breton, à des jours et des heures, non à des mois et des années.
Ce débat est important : nous ne proposons pas de faire une sédation profonde et continue à une personne qui a un an à vivre, même si elle est entrée dans la phase terminale de sa maladie, si celle-ci échappe aux traitements et si, malgré la mise en place de ce traitement, l’état de la personne commence à se dégrader.
L’expression « pronostic vital engagé à court terme » semble donc plus restrictive et plus précise. Tel est du moins le sentiment des médecins de soins palliatifs, cancérologues ou gérontologues.
Avis défavorable.

M. le rapporteur indiquait que le court terme se rapportait à des heures et des jours, non des mois et des années. Restent les semaines…

Les semaines entrent-elles dans le court terme ? Telle est l’ambiguïté. Nous sommes d’accord pour limiter le court terme aux heures et aux jours. Mais il serait abusif de raisonner en termes de semaines.


Cet amendement vise à insérer le mot « physique » après le mot « souffrance » dans l’alinéa 3. Les personnels soignants constatent en effet régulièrement qu’une personne en fin de vie dont la souffrance physique est apaisée ne demande plus d’aide active à mourir, même si elle avait pu exprimer un tel souhait auparavant. L’état dépressif qu’elle avait pu connaître s’éloigne d’autant. C’est donc bien la seule souffrance physique réfractaire qui peut entraîner l’application des dispositions du présent article.

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement identique no 221 .

Cicely Saunders, qui a décrit les soins palliatifs au XXe siècle, affirmait que la fin de vie est l’objet d’une souffrance globale, dont on ne parvient pas à distinguer la part physique de la part psychique.
C’est précisément l’objectif des soins palliatifs que de prendre en charge globalement cette souffrance. Limiter celle-ci à des douleurs purement physiques restreindrait leur mission, qui est d’accompagner et de soulager. C’est pourquoi je juge plus approprié d’employer le terme de « souffrance réfractaire ».
Défavorable.

Il s’agit de compléter l’alinéa 3 par le mot « disproportionné » car, sur le plan éthique, un traitement ne peut être arrêté que s’il est disproportionné.
L’amendement no 79 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Il s’agit d’un amendement crucial, puisqu’il tend à supprimer l’alinéa 4, qui prévoit la mise en oeuvre d’une sédation profonde et continue lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme.
Quelles sont donc les conditions pour que la sédation profonde et continue soit mise en oeuvre ? La décision du patient d’arrêter un traitement, ce qui peut engager le pronostic vital à court terme. On voit la logique qui est à l’oeuvre : ce n’est pas l’état de santé du malade qui justifie la sédation profonde et continue, c’est sa décision d’arrêter le traitement. Il s’agit bien d’une dérive, puisque l’on part de la volonté du patient et non de sa santé physique. Comme le soulignait tout à l’heure le rapporteur, il s’agit d’un cas de figure qui, parfois, peut se justifier médicalement, mais une telle rédaction risque de donner lieu à toutes sortes de dérives : on pourrait citer d’autres exemples où la décision d’arrêter le traitement engagerait en elle-même le pronostic vital à court terme, alors même qu’il n’y aurait aucune souffrance, actuelle ou à venir ; pourtant, le droit à la sédation profonde et continue s’appliquerait. Cet alinéa 4 est vraiment très dangereux, c’est pourquoi nous insistons pour obtenir sa suppression.

Pour compléter ce que vient de dire mon collègue, cet alinéa est en rupture avec l’équilibre de la loi de 2005, car il renvoie à la situation où le patient n’est pas en fin de vie, mais se place volontairement en situation de fin de vie, en exigeant l’arrêt d’un traitement, puis une sédation terminale.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 193 .

J’ajouterai un mot à ce que viennent d’exposer excellemment mes collègues Breton et Cinieri.
Monsieur le rapporteur Leonetti, vous avez noté tout à l’heure que l’une des acceptions que l’on pouvait donner au mot « dignité » relevait de l’estime de soi. Au fond, je pense que si j’ai moi aussi déposé un amendement tendant à supprimer l’alinéa 4, c’est que si la volonté d’un patient d’arrêter un traitement conduisait à mettre fin à sa vie, sans que son état médical ne le justifie nécessairement, ce qui correspond à l’une des conditions énoncées dans cet article, on privilégierait alors la conception de la dignité comme estime de soi par rapport à celle qui y voit une forme de respect liée consubstantiellement à l’humanité – pour reprendre vos propres termes. Et c’est parce que je suis totalement opposé au fait de donner la priorité à la première conception sur la seconde que je souhaite supprimer cet alinéa.

Défavorable. Je signale à M. Poisson que l’alinéa 4 n’a rien à voir avec l’estime de soi et la notion de dignité. Il s’agirait plutôt de répondre à la question suivante : un malade a-t-il le droit de refuser un traitement qui le maintient ou le maintiendrait en vie ? La réponse est oui. Ainsi, si vous proposez à un malade de l’opérer, ce dernier a le droit de refuser, même si vous lui expliquez qu’il met alors sa vie en danger. De même, si un patient a déjà bénéficié d’un traitement et qu’il demande à l’interrompre, le médecin pourra bien entendu essayer de le convaincre du bien-fondé du traitement, mais il ne pourra pas s’opposer à la volonté du patient. Cela n’a rien à voir avec la dignité, cela a à voir avec l’autonomie et avec l’impossibilité – philosophique, dirais-je – d’imposer à quelqu’un qui ne le souhaite pas un traitement, quel qu’il soit.
Le patient arrête donc le traitement et va mourir. L’arrêt du traitement risque d’entraîner des souffrances ; par conséquent, dans le cadre des soins palliatifs, on va accompagner le patient afin qu’il ne souffre pas. C’est la raison pour laquelle la sédation accompagne l’arrêt des traitements de survie. Tout cela n’a rien à voir avec la dignité, et je continue à penser ce que j’ai dit tout à l’heure sur la définition de celle-ci – d’ailleurs, je crois que M. Poisson partage mon point de vue sur la question.
Défavorable.


Le présent amendement vise à insérer, après le mot « incurable », les mots : « , en phase terminale, ».
Si cet article souhaite mieux diffuser les bonnes pratiques de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, alors il convient d’être très précis et de limiter la sédation systématique à la toute fin de la vie, qualifiée de « phase terminale ».

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 235 .


Il s’agit de préciser la notion de « pronostic vital à court terme » – mais nous avons eu ce débat tout à l’heure.
Pour revenir aux explications du rapporteur sur cet alinéa, elles ne m’ont pas totalement convaincu. On voit bien qu’une personne qui serait atteinte d’une affection grave et incurable, qui en aurait assez de la vie et déciderait d’arrêter le traitement, ce qui aurait pour conséquence d’engager son pronostic vital à court terme, aurait droit à une sédation profonde et continue. Il s’agit très clairement d’une logique euthanasique – ou alors, c’est que je ne sais pas ce qu’est l’euthanasie ! À partir du moment où la décision de quelqu’un qui en a assez provoque la sédation profonde et continue jusqu’à la mort, l’enchaînement est écrit.
Il existe entre nous une différence d’interprétation, et même de conception : le mécanisme enclenché par ce texte obéit à une logique dont le point de départ est la volonté du patient, jamais son état médical, et l’aboutissement la mise en oeuvre d’une sédation profonde et continue.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 352 .

Si M. Breton le permet, je vais conclure sa démonstration.
La formulation actuelle de l’alinéa 4 est une des raisons qui m’ont fait insister tout à l’heure à la tribune sur le fait que ce texte contenait des risques effectifs de dérive euthanasique – Xavier Breton vient d’ailleurs de le souligner.
J’entends que les rapporteurs n’ont pas cette intention, et je les connais tous les deux suffisamment bien pour savoir que ce n’est pas le cas ; je ne leur ferai donc pas ce procès. Mais à partir du moment où l’on refuse de définir avec précision les états médicaux, pouvant être constatés d’une certaine façon scientifiquement, à partir desquels on pourra engager un tel processus, et que l’on se contente d’une définition vague, cela ouvre la porte à toutes les dérives, y compris à celles à caractère euthanasique. Nous le refusons. Tel est le sens de cet amendement.

Je vais être contraint de revenir sur certains points.
Qu’est-ce que pratiquer l’euthanasie, selon l’acception communément admise dans notre pays ? C’est donner délibérément la mort, généralement à la demande d’une personne.
Je vous pose de nouveau la question, messieurs Breton et Poisson : un malade a-t-il le droit de demander à arrêter un traitement qui le maintient ou le maintiendrait artificiellement en vie ?

La réponse est bien évidemment oui. C’est cela qui va entraîner sa mort, et non la sédation ; la sédation n’est qu’un outil qui permet de soulager la souffrance entre le moment où l’on décide d’arrêter un traitement et le moment où le décès survient. Elle s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement et de soins palliatifs. Ce n’est donc pas elle qui va provoquer la mort, c’est l’arrêt du traitement de survie.
Si vous pensez que l’euthanasie c’est cela, alors elle existe en France depuis 2002 et la loi Kouchner, qui dit que l’on peut refuser un traitement. Cela a été confirmé par la loi de 2005, qui a précisé que cela était possible même si l’arrêt du traitement avait pour conséquence l’arrêt de la vie. Il s’agit donc de textes bien antérieurs.
Répétons-le : la sédation n’accélère pas la mort, elle empêche la souffrance. L’objectif est d’empêcher la souffrance durant cette période. Il s’agit donc, non pas d’une étape supplémentaire vers quelque chose d’autre, mais de l’accompagnement d’un dispositif qui existe déjà depuis 2002, et qui a été confirmé en 2005.
Défavorable.


Il s’agit de compléter l’alinéa 4 par les mots : « , si la situation clinique l’exige ». Il convient en effet de maintenir pour le bénéfice du patient l’équilibre de la loi de 2002 qui permet à ce dernier de prendre ses décisions avec le professionnel de santé. Une telle modification permettrait l’intervention des personnels de santé dans l’appréciation de la situation.
Pour revenir sur ce que vient de dire notre collègue Leonetti, certes, on doit tenir compte des lois antérieures, mais on s’aperçoit que l’on s’avance pas à pas vers autre chose. S’il existe déjà la possibilité d’arrêter un traitement, avec ce texte, quelqu’un qui voudra aller vers son décès en aura les moyens : il pourra organiser ce dernier. Il dira : « Je souffre d’une maladie grave et incurable, je décide d’arrêter le traitement, ce qui engage le pronostic vital à court terme, et j’ai donc droit à une sédation profonde et continue. » Peut-être était-ce contenu dans les lois antérieures, mais cela démontre que l’on s’achemine de plus en plus vers une démarche euthanasique. On franchit là une nouvelle étape.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 348 .


La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 350 .

L’alinéa 5 contrevient à l’équilibre de la loi Leonetti de 2005, puisqu’il prévoit que toute personne « hors d’état d’exprimer sa volonté », même si elle n’est pas en fin de vie, sera susceptible de subir une sédation profonde et continue jusqu’au décès si le médecin juge qu’il y a obstination déraisonnable. Cela concerne par exemple les quelque 1 700 patients en état pauci-relationnel ou végétatif chronique.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 196 .

Là, monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas de l’expression de la volonté du patient : c’est même la condition posée par l’alinéa. Si l’on pouvait entendre vos arguments précédents – quoique vous ne m’ayez pas convaincu –, pour ce qui est de cet alinéa, ce sera plus difficile…
Puisque, par définition, le patient sera dans l’incapacité d’exprimer quelque souhait que ce soit, la décision reviendra au médecin, et, d’une certaine façon, à lui seul – même si l’on prévoit des mécanismes de concertation. Et la seule référence aux directives anticipées du patient – si tant est qu’elles existent, car cela reste une hypothèse – donne toute autorité au médecin d’agir comme il l’entend sur un patient incapable d’exprimer un souhait. Dans l’exposé des motifs de l’amendement, nous appelons ainsi votre attention sur les quelque 1 700 patients en état pauci-relationnel ou végétatif chronique ; c’est un ordre de grandeur, puisque ce nombre varie tous les jours. Voilà qui soulève une très grande difficulté, et nous considérons que la pratique de la sédation telle qu’elle est décrite dans cet article soulève un risque très clair de dérive euthanasique. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa.

Cet alinéa 5 risque en effet de créer un flou juridique en laissant penser que toute personne hors d’état d’exprimer sa volonté peut faire l’objet d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de sa conscience jusqu’au décès.
Comme il permettrait de pratiquer une sédation profonde à des patients qui ne seraient pas en fin de vie, nous vous proposons de le supprimer.

Je vais tout de même essayer de convaincre mon collègue Poisson car, me semble-t-il, il était favorable à la loi de 2005, précisée par la loi de 2008 à travers un article 37-3 du code de déontologie médicale. Comment le convaincre ?
En rappelant l’affaire Pierra, soit l’arrêt du traitement d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, dont les lésions cérébrales étaient majeures et irréversibles, le corps médical ne l’accompagnant malheureusement pas par des soins et le laissant agoniser avec un encombrement pulmonaire et des convulsions, tout cela devant une famille impuissante. Cette situation est à mes yeux intolérable.
Lorsque l’on se trouve face à une personne cérébro-lésée, incapable d’exprimer sa volonté et dont le traitement de survie est interrompu, il est évident que l’on se doit de faire en sorte que sa fin de vie soit sinon sereine et apaisée, du moins, de ne prendre aucun risque potentiel de la faire souffrir.
En même temps, il convient d’accompagner la famille dans cette situation pour le moins difficile.
C’est ce que permet l’article 37-3 du code de déontologie, qui a été validé par le Conseil de l’ordre, par les sociétés françaises de soins palliatifs et par le Conseil d’État.
Cela a aujourd’hui force de loi, le code de déontologie servant éventuellement à déterminer des attitudes médicales, lesquelles sont validées devant les tribunaux.
Nous avons pensé qu’il était préférable d’inclure le contenu de cet article dans un dispositif adéquat dès lors qu’il se réfère à une éventualité qui est loin d’être négligeable puisque, nous le savons, des dizaines de milliers d’arrêts de traitements de survie – en particulier de respirateurs – se produisent en réanimation et qu’il n’est pas possible d’arrêter ces derniers sans faire un geste d’accompagnement et de sécurité visant à ne pas faire souffrir le patient. Le texte que nous proposons correspond à cette situation-là.
Je suis certain qu’en imaginant cette situation en réanimation, compte tenu de l’obligation d’arrêter un traitement parce qu’il serait déraisonnable qu’il en soit autrement, que l’accompagnement de la personne est obligatoire pour garantir à cette dernière – dans le respect de sa dignité humaine – l’absence de toute souffrance, vous ne pouvez qu’être convaincu, monsieur Poisson. Je connais, de surcroît, la pertinence de votre réflexion.
Avis défavorable.

Peut-être n’ai-je pas bien compris la première partie de votre réponse, monsieur le rapporteur, et si tel est le cas nous en discuterons un peu plus tard.
Vous avez commencé par répondre de la sorte à l’argumentation que j’ai formulée tout à l’heure : si la question est bien celle de l’application de la loi de 2005 – grosso modo, c’est ce que vous avez commencé à dire – constatant qu’une loi s’applique mal, faut-il une autre loi afin que cette dernière s’applique mieux ? Tel est le problème qui nous est posé.

Pas du tout ! Vous êtes en train de nous dire – tout le monde en sera d’accord comme cela fut le cas lors de la discussion générale – que la loi de 2005 ne s’applique pas bien, non en raison de son écriture mais de sa propagation et des moyens qui ont malheureusement cessé d’être attribués aux soins palliatifs voilà maintenant trois ans, ce qui est très regrettable – mais il n’y a pas que cela : nous savons aussi ce qu’est la culture du corps médical.
Si la réponse consiste à opérer une simple transcription du code de déontologie dans la loi, le Parlement a le droit de contester ce dernier et, de surcroît, si une loi est nécessaire pour pallier la mauvaise application d’une autre, j’ai eu raison de faire état de mes doutes tout à l’heure.


Il s’agit d’ajouter après le mot « traitement » le mot « disproportionné » car, comme nous l’avons dit tout à l’heure, sur un plan éthique un traitement ne peut être arrêté que s’il est disproportionné.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 302 .


Il s’agit d’indiquer que l’alinéa 5 de cet article 3 ne s’applique que si la situation clinique l’exige. En effet, il convient de s’adapter à la singularité de la situation dans laquelle se trouve le patient.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 297 .

L’alinéa 5 de l’article 3 prévoit que le médecin applique une sédation profonde et continue. Nous proposons qu’il s’agisse simplement d’une possibilité.
En effet, nous savons qu’outre les dangers de dérives euthanasiques que nous avons pointées, ce texte soulève un problème important s’agissant des relations de dialogue et d’écoute qui doivent exister entre les professionnels de santé, particulièrement les médecins d’un côté et, de l’autre, les malades et les familles.
Si les médecins deviennent de simples prestataires de services, de simples exécutants, le risque de leur déresponsabilisation sera bien réel.
Nous proposons donc que la pratique de la sédation soit pour eux une possibilité, non une obligation.
L’amendement no 400 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.


La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 299 .


L’alinéa 5 prévoit que l’altération de la conscience provoquée par la sédation profonde et continue est maintenue jusqu’au décès.
Nous proposons d’indiquer qu’elle est maintenue « si nécessaire » jusqu’au décès, faute de quoi, la volonté est très claire d’aller jusqu’au décès.
Les choses doivent donc être bien précisées : si la sédation est nécessaire, nous la comprenons, sinon, cela signifierait que le décès est en ligne de mire. C’est pourquoi nous proposons d’ajouter les mots « si nécessaire ».

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 300 .

Nous avons déjà parlé de cette question à l’article 2, madame la présidente.
Si le Parlement estime être dans son rôle en précisant les gestes qui relèvent du soin ou du traitement, alors il faut être exhaustif.
Pour mieux discerner ce qui relève d’un traitement ou d’un soin, je propose d’ajouter trois alinéas afin de les définir.
Il convient particulièrement de définir les soins élémentaires dus à toute personne vivante quand elle ne peut y subvenir elle-même ou doit être aidée.
Le modèle des 14 besoins fondamentaux présenté par Virginia Henderson à l’Organisation mondiale de la santé, enseigné dans toutes les écoles d’infirmières, semble la meilleure référence.
L’amendement no 110 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Nous revenons sur la question de l’égale répartition des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement vise à qu’ils puissent être appliqués à des personnes hospitalisées à domicile.
L’amendement no 329 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Madame la présidente, nous avons vu que la mise en oeuvre de la sédation profonde et continue dans les différents cas envisagés présentait un certain nombre d’ambiguïtés potentiellement inquiétantes.
Nous vous proposons donc de clarifier cette mise en oeuvre en indiquant que la sédation constitue un traitement exceptionnel dont le seul but doit être de soulager le patient.
Au moins, cela sera clairement dit. Le contraire signifierait que l’on veut cacher quelque chose et qu’il existe une autre intention que le soulagement.

Il s’agit d’un point fondamental de la loi. Il convient donc à tout moment de rappeler que ce texte n’a pas de visée euthanasique mais qu’il respecte totalement les missions du personnel médical : soulager les patients en fin de vie.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 341 .

Une telle formulation ne devrait gêner personne. Comme elle permet de rassurer nombre de nos collègues dans cet hémicycle quant aux visées de cette pratique, ma foi, il ne doit pas y avoir d’obstacle à l’inscrire dans un article de loi.

S’il faut écrire que la sédation est faite pour soulager et que les analgésiques sont faits pour enlever la douleur, c’est embêtant car cet exercice sémantique alourdira considérablement le texte !

Il est évident que la sédation vise à sédater, soit, alléger la souffrance physique ou morale. Elle est faite pour cela. Redonner une définition reviendrait à restreindre le texte et à l’alourdir.
Avis défavorable.
Même avis.

Je ne voudrais pas que d’aucuns fassent un contresens sur la nature de la sédation.
L’analgésie vise à lutter contre la douleur et la sédation tend à altérer la conscience. Jusque-là, nous sommes d’accord. Le malade peut se réveiller à l’issue d’une sédation, bien évidemment, d’autres sédations, profondes et continues jusqu’au décès, permettant quant à elles de l’endormir jusqu’au bout. Que l’on soit donc parfaitement clairs !
Lors de la défense de son amendement, M. Poisson m’a semblé faire un contresens volontaire par rapport à l’esprit du texte.
Sourires

J’entends ce que vous dites.
Monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas d’introduire le dictionnaire dans la loi mais de prendre simplement en compte le fait que, pour un certain nombre d’entre nous, la pratique de la sédation telle qu’elle est décrite dans ce texte peut répondre à d’autres objectifs que ceux qui viennent par ailleurs d’être excellemment rappelés par le Docteur Sebaoun.
Nous ne sommes pas à l’Académie française ici ! Je ne tiens pas à écrire dans le marbre de la loi la signification des mots – cela a d’ailleurs été reproché à quelques collègues ici même il n’y a pas très longtemps dans d’autres circonstances, madame la présidente.
Il n’en reste pas moins, je le répète, nous répétons, qu’autant la définition des termes est claire – je fais crédit à notre collègue Sebaoun de ses propos –, on ne m’empêchera pas de dire que dans un texte dont la rédaction permet un certain nombre d’interprétations et d’actes qui peuvent constituer des dérives par rapport à son objet même et à son intention, il est important de rappeler les objectifs pratiques de la sédation.
Il ne s’agit pas d’une définition mais de rappeler un impératif que certain appellerait « catégorique » – mais il ne s’agit pas de faire de la lexicologie ou de la philosophie ici, en tout cas, pas pour l’instant.


La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 295 .

La défense de cet amendement est pour moi l’occasion de saluer l’excellent texte de la Haute autorité de santé sur les pratiques palliatives – d’ailleurs disponible sur son site internet – et de faire référence à cette dernière.
J’entends bien que cela est d’ordre réglementaire et ne saurait peut-être se traduire législativement de manière très satisfaisante mais, enfin, cette référence à l’HAS est partagée par tous et la profession la reconnaît même si elle est par ailleurs évolutive.
J’ajoute que cette pratique et la mise en oeuvre de ces soins répondent à un certain nombre d’impératifs et de pratiques parfaitement codifiées et établis.
Si, d’une certaine manière, on pouvait y faire référence – à celles-ci ou à d’autres – d’une manière un peu plus explicite, ce serait parfait.

L’adoption du présent amendement permettrait d’empêcher la survenue d’agonies prolongées chez les patients ayant choisi la sédation profonde définie à l’article 3.
L’arrêt des traitements ne permet pas de connaître le moment de survenue du décès qui, par définition, dépend de l’infection etou de l’état général des fonctions vitales du patient.
Le décès peut donc intervenir après seulement quelques minutes et jusqu’à plusieurs jours. Une fois la sédation administrée et les adieux faits, il est particulièrement pénible pour les proches du malade d’attendre plusieurs jours le moment de la fin.
C’est pourquoi, en votant cet amendement, je vous propose de permettre de recourir à un geste actif induisant la survenue plus rapide du décès, dans le respect des conditions de déontologie et de dignité qui s’imposent, uniquement dans le cas d’une sédation profonde qui se prolongerait au-delà du délai raisonnable et du supportable.
Il ne s’agit pas là d’introduire de la confusion ni de contourner l’esprit de la proposition de loi, mais d’apporter une réponse concrète à un cas de figure douloureux qui se posera aux équipes médicales et aux proches.
L’amendement no 385 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour soutenir l’amendement no 277 .

L’amendement tend à insérer, après l’alinéa 7, l’alinéa suivant :
« S’agissant des personnes en situation de handicap complexe, habituellement accueillies ou suivies par un établissement ou service médico-social, le médecin référent de l’établissement est associé à la procédure collégiale. »
Il s’agit, en somme, d’associer le médecin référent d’une personne en situation de handicap complexe à la procédure collégiale. Le personnel responsable du patient, en effet, ne dispose pas toujours de l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la décision. La mesure que je propose est donc protectrice.
L’amendement no 277 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.


Les dispositions relatives à la sédation profonde et continue étant ambiguës, il convient de prévoir une clause de conscience pour le personnel médical. Aussi proposons-nous d’insérer, après l’alinéa 7, l’alinéa suivant :
« En vertu des articles 221-1 du code pénal et R. 4127-38 du code de la santé publique, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une sédation profonde et continue prévue au présent article. »
Dans certains cas, on l’a vu, c’est la décision du patient d’arrêter son traitement qui engage son pronostic vital à court terme et, partant, ouvre droit à une sédation profonde et continue. Le personnel médical doit avoir la possibilité de refuser une telle logique euthanasique.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 293 .

Nous avons abordé le sujet en première lecture, mais il sera utile de réentendre les rapporteurs. La seule question est de savoir si les dispositions générales du code de déontologie s’appliquent ou non aux situations visées par la proposition de loi.
Si la moindre ambiguïté devait subsister, il serait impératif de préciser que la sédation profonde peut faire l’objet d’une objection de conscience.

La liberté de conscience constituant l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il est essentiel de prévoir une clause de conscience pour les professionnels de santé. Ceux-ci pourront ainsi refuser de pratiquer ou de concourir à une sédation profonde et continue qui, bien qu’autorisée par la loi, serait contraire à leurs convictions personnelles et éthiques, et qu’ils regarderaient comme une forme d’euthanasie ou de suicide assisté.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 189 .

L’amendement no 87 rectifié de M. Roger-Gérard Schwartzenberg a été retiré.
L’amendement no 87 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements en discussion ?

La clause de conscience n’a pas lieu d’être dès lors qu’il s’agit de faire son devoir, comme l’a confirmé le Conseil de l’Ordre, qu’Alain Claeys a consulté une deuxième fois pour le saisir de ce point spécifique. L’introduction d’une telle clause, en revanche, aurait été nécessaire en cas de suicide assisté ou d’euthanasie ; or le Conseil de l’Ordre, dans sa sagesse et sa lucidité, a considéré que le texte visait l’accompagnement en fin de vie, dans le cadre de soins palliatifs préconisés par le code de déontologie. Avis défavorable.
Défavorable également.

La clause de conscience ne peut être écartée par la position de telle ou telle institution, fût-elle légitime : elle renvoie à des convictions intimes, et nous parlons d’un cas suffisamment grave – provoquer le décès – pour qu’elle puisse être invoquée, au-delà même de l’appréciation que l’on peut avoir du texte.
L’amendement no 95 n’est pas adopté.

Afin d’éviter toute dérive et un recours systématique à la sédation, il convient de mettre en place un dispositif de contrôle complémentaire qui pourrait prendre la forme d’un registre des sédations terminales réalisées dans chaque établissement de soins.
L’amendement no 112 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.
L’article 3 est adopté.

Nous défendrons, à cet article, des amendements visant à préserver, dans la loi, la notion de « double effet » que le présent texte entend supprimer : elle désigne le cas où des soins destinés à apaiser la souffrance risquent de provoquer le décès, sans que celui-ci ait été décidé intentionnellement. Nos amendements, j’y reviendrai, se justifient par une rédaction selon nous ambiguë.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 201 .

Les soins palliatifs requièrent un savoir-faire et des comportements qui doivent être reconnus. Or, en ce domaine, la formation, dans les cursus médicaux, reste très insuffisante. Les médecins appelés à engager des pratiques sédatives doivent pourtant en être des spécialistes.
L’amendement contribuerait donc à la reconnaissance d’une discipline qui se développe dans les établissements de santé, lesquels manquent d’effectifs spécialisés.
L’amendement no 201 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 3 dispose que « le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade […] ».
Je propose d’insérer, après le mot : « répondre », les mots : « à doses minimales efficaces ». Cet amendement fait suite à l’une de mes rencontres avec des professionnels d’une unité de soins palliatifs.
L’amendement no 397 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement no 23 .
L’amendement no 23 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour soutenir l’amendement no 259 .

Cet amendement étant de coordination avec le 246, qui a été rejeté, je le retire.
L’amendement no 259 est retiré.

Aux termes du texte, le médecin met en place des traitements pour répondre à une souffrance réfractaire « même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie » : cette formulation, ambiguë, permettrait au médecin de provoquer délibérément la mort, ce qui est contraire à l’article R. 4127-38 du code de la santé publique.

La disposition que l’amendement tend à supprimer renvoie au double effet dont vous déploriez l’absence dans le texte, monsieur Breton. Le terme « même » suggère que l’effet possible – abréger la vie – est secondaire et non voulu, et le mot « si », que cet effet est seulement éventuel.
Une sédation est administrée « même si » elle accélère la mort : l’effet est possible mais pas escompté, et en tout état de cause pas certain. Contrairement à ce que vous avez suggéré, le texte est donc très précis. Du reste, nous avons travaillé avec des membres du Conseil d’État pour vérifier que les deux termes recouvrent bien les deux valeurs de sens que je rappelais. Avis défavorable.
Défavorable également.
L’amendement no 114 n’est pas adopté.

Les mots « même si » ne disent rien de l’intention, monsieur le rapporteur, ni dans un sens, ni dans l’autre.

Non, et c’est pourquoi les choses doivent être précisées. Nous proposons donc, avec le présent amendement, de rédiger en ces termes, après le mot : « terminale », la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : « avec l’intention de soulager la souffrance sans avoir l’objectif de donner la mort ».
Les mots « même si » ne suggèrent pas plus une intention de donner la mort que de ne pas la donner ; aussi le texte supprime-t-il le double effet. La formulation reste ambiguë, car l’intention, sans être précisée, n’est pas exclue.
Votre allusion au Conseil d’État me donne une nouvelle occasion de déplorer que ce texte sensible n’ait pas été présenté sous la forme d’un projet de loi, car il aurait alors fait l’objet d’une étude d’impact et d’une analyse juridique du même Conseil d’État.
L’amendement no 116 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Cet amendement, qui s’inscrit dans la même logique que le précédent, tend à insérer, après le mot : « effet », les mots : « secondaire et indésirable ». Cette précision est nécessaire si l’on entend préciser qu’il n’y a eu aucune intention de donner la mort ; faute de quoi le texte resterait ambigu.

Nos concitoyens aspirent à une fin de vie paisible dans le cadre d’une prise en charge globale respectueuse de la dignité de chacun, et le soulagement de la douleur est un objectif parfaitement légitime et consensuel.
Néanmoins, il est important de préciser que l’intention première reste bien de soulager la souffrance, même si, par une conséquence « secondaire », le produit utilisé – par exemple la morphine – risque d’accélérer la survenue du décès à une échéance non prévisible.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement no 239 .
L’amendement no 117 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Il est important de mentionner que la règle du double effet n’est valable que si les médicaments utilisés sont administrés à dose progressive et ajustée à l’intensité de la souffrance physique ou morale. Ces médicaments ne doivent pas servir à provoquer la mort par un surdosage volontaire. C’est pour cela que nous proposons de modifier l’alinéa 3 de l’article 4 comme suit : « Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet secondaire non voulu d’abréger la vie. Les doses utilisées restent proportionnées à l’intensité de la douleur physique ou de la souffrance morale que l’on cherche à soulager. Ces traitements ne peuvent servir à provoquer intentionnellement la mort. »
Vous le voyez, la formulation est ici très claire et permettrait de lever l’ambiguïté de la rédaction actuelle.
L’amendement no 115 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement no 25 .

Il est clairement démontré que la prise en charge précoce des patients en fin de vie, si elle est anticipée, permet une fin de vie apaisée. Aujourd’hui, les unités de soins palliatifs sont contactées trop tardivement, c’est-à-dire peu de temps avant le décès. Les agences régionales de santé n’encouragent pas suffisamment la prise de contact précoce du patient avec l’unité de soins palliatifs dont il pourrait bénéficier. Cet amendement vise à y remédier.
L’amendement no 25 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.
L’article 4 est adopté.
Article 4
L’article 4 bis est adopté.

Il s’agit de préciser que la personne doit être en état de prendre une décision libre et éclairée. La décision est valable également lorsqu’il s’agit de refuser une partie des traitements. C’est la raison pour laquelle nous proposons de rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 5 après le mot « personne » : « consciente, en état de discernement et dûment informée, a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés ».
L’amendement no 121 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Le présent amendement vise à permettre au médecin de se libérer de sa responsabilité vis-à-vis du patient lorsque celui-ci décide de refuser ou d’interrompre tout traitement.
L’amendement no 327 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Cet amendement vise à ce que le médecin ne soit pas un simple prestataire de services, un simple exécutant. Nous proposons à cette fin d’insérer après la première phrase de l’alinéa 5 la phrase suivante : « Le médecin doit tout mettre en oeuvre pour convaincre [la personne] d’accepter les soins qu’il estime, en conscience, indispensables. » L’action du médecin ne doit pas se résumer au strict suivi d’un protocole légal, elle doit s’insérer dans une logique de conviction, de dialogue, d’écoute. Le texte dans sa rédaction actuelle risque précisément d’assécher la relation entre le malade et le médecin.
L’amendement no 124 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.


De telles situations requièrent un véritable dialogue, dans la confiance réciproque, la vérité, l’empathie, pour évaluer avec le patient son état à un moment donné, l’opportunité ou non de poursuivre tel traitement ou d’en proposer un autre, ainsi que son véritable désir.

Dans la même logique de renforcement du dialogue entre la personne malade et le médecin, nous proposons de compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : « et avoir dialogué avec elle pour juger du bien-fondé de la demande ».
En effet, s’en tenir au terme « informer » est tout à fait insuffisant. De telles situations demandent un véritable dialogue, une confiance réciproque pour évaluer avec le patient son état à un moment donné et l’opportunité ou non de poursuivre le traitement.

Nous proposons que le médecin s’assure que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. On sait en effet que toute personne confrontée à une situation de santé difficile, avec un diagnostic grave, une dépendance lourde ou l’annonce d’une possible mort, source d’angoisse, doit être soutenue, réconfortée, entourée par les soignants, les proches ou les bénévoles pour vivre le plus paisiblement possible la fin de sa vie.
Entre l’abandon et l’euthanasie, il faut instaurer un droit fondamental à une prise en charge globale de toutes les personnes âgées ou malades dans le respect de la dignité de chacun.
C’est pourquoi nous proposons d’ajouter les termes indiqués à l’alinéa 5 de l’article.

À l’alinéa 5, je souhaite compléter la première phrase par les mots : « et s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement ».

Si la loi doit entériner le fait que, dans certains cas, à la demande du patient, les professionnels de santé sont tenus d’interrompre l’alimentation et l’hydratation ou d’administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès, il convient d’introduire dans la loi une clause de conscience pour les médecins et le personnel soignant.
L’amendement no 132 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.
L’amendement no 120 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Nous proposons, à l’alinéa 7, d’insérer après le mot « décès » les mots « de manière non intentionnelle ». Il est en effet nécessaire selon nous de prévoir qu’il n’y a aucune intention de provoquer le décès ; il est préférable de le dire.
L’amendement no 119 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

La personne malade doit être consultée. À l’expression de sa volonté, il faut ajouter les confidences qu’elle a faites à sa famille, à la personne de confiance, et les directives anticipées. Une décision du médecin conforme à la volonté du patient serait plus totale grâce à la consultation de tous ceux qui rapportent l’expression de la volonté du malade. Tel est le sens du présent amendement.
L’amendement no 125 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.


À deux reprises, la proposition de loi prévoit que, pour les personnes hors d’état d’exprimer leur volonté telles que les personnes présentant des handicaps complexes de grande dépendance, l’arrêt des soins ne peut être entrepris qu’à l’occasion d’une procédure collégiale comprenant dans la plupart des cas un médecin hospitalier et en recueillant, faute de directives anticipées, le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches en relation avec le patient.
Cette disposition n’est pas protectrice pour les personnes en situation de handicaps complexes de grande dépendance. L’appréciation du fait de savoir si ces dernières sont ou non en fin de vie ne peut être par ailleurs réalisée par un médecin hospitalier qui ne connaît pas leur parcours et ne sait pas si les séquelles graves de lésions cérébrales congénitales ou acquises qu’elles subissent sont la suite d’éventuelles phases de décompensation antérieures.
L’opinion des familles risque d’être de peu de poids compte tenu de la complexité des handicaps de ces personnes. Or ces dernières font nécessairement l’objet de soins courants dispensés par un médecin attaché à des institutions médico-sociales. Seul le médecin référent de l’établissement du service qui les suit est à même de poser un diagnostic averti sur leur situation réelle. C’est pourquoi cet amendement vise à proposer l’ajout du médecin référent à la liste des personnes devant être consultées lors de la procédure collégiale.

Je compléterai les propos de mon collègue Xavier Breton par quelques mots. En commission, au sujet de cet amendement, il nous a été opposé que le recueil de l’avis du médecin référent ou du médecin traitant compliquerait la procédure. Il me semble au contraire que cela pourrait la faciliter.
L’article 5 est adopté.
L’article 6 est adopté.

L’amendement no 127 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.
L’article 7 est adopté.

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 8.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

Madame la ministre, mes chers collègues rapporteurs, l’article 8 de la présente proposition de loi renforce la portée des directives anticipées. Ces dernières permettent au corps médical de connaître avec certitude les volontés du patient. Si l’ambition est louable, des inquiétudes subsistent, et je souhaite vous en faire part.
Tout d’abord, si le modèle des directives anticipées sera fixé par décret en Conseil d’État, qu’en est-il du contenu envisagé ? Dans la forme actuelle du texte, la personne est libre de rédiger ce que bon lui semble. Elle peut donc préciser ses souhaits quant à la fin de sa vie, mais également coucher sur le papier des volontés qui ne seraient pas conformes avec les lois en vigueur dans notre pays. Il n’est pas question de censurer les volontés du patient, mais il faudrait cependant pouvoir s’assurer au préalable de leur contenu. Ces directives ne devraient ainsi pas contenir de dispositions contraires au serment d’Hippocrate, à plus forte raison si elles doivent être opposables au médecin.
Je m’inquiète en outre du manque cruel d’information autour de ces directives anticipées. Pensez donc à votre entourage, et demandez-vous combien de nos concitoyens connaissent réellement l’existence de ce dispositif ! Afin que les mesures que nous votons dans cet hémicycle soient pleinement efficaces, il conviendrait d’envisager une campagne de sensibilisation et d’information auprès des Français. Les termes du présent article doivent donc être précisés afin que les directives anticipées deviennent incontournables pour les patients et pour le corps médical.

L’article 8 va nous permettre de traiter des directives anticipées. On voit que l’association entre le mécanisme attaché au droit à une sédation profonde et continue et le mécanisme d’opposabilité des directives anticipées, selon les termes de Mme la ministre, peut être dangereuse.
Dès lors, les professionnels de santé se trouvent totalement déresponsabilisés : ils deviennent de simples exécutants, de simples prestataires de services.
Nous proposerons plusieurs amendements visant à améliorer ce dispositif des directives anticipées.

La rédaction de l’article 8, qui constitue une évolution très sensible par rapport à la loi de 2005, pose trois difficultés principales.
Tout d’abord, je continue de m’interroger sur l’extrême difficulté de rédiger de telles directives, même s’il existe un « formulaire cadre ». Je veux témoigner à nouveau devant cette assemblée du fait que j’ai moi-même tenté l’exercice : je me suis arrêté assez vite, car il est affreusement difficile de se projeter dans des circonstances inimaginables, de les décrire et de demander en conséquence au corps médical d’agir de telle ou telle manière.
Par ailleurs, je vois une forme d’antinomie, renforcée par le caractère désormais opposable des directives, entre le caractère profondément personnel de cette démarche – c’est l’esprit de ce texte, puisqu’il s’agit pour chacun de se prononcer non pas de façon générale, mais sur la manière dont il voudrait être traité personnellement – et le recours à un formulaire type. Il y a là un paradoxe que je veux souligner. Je finis par me demander si le recours à ce formulaire type n’irait pas, en fin de compte, à l’encontre de l’objectif recherché, à savoir l’expression d’un souhait authentiquement personnel et singulier dans une situation éminemment singulière où l’on demande au corps médical de se livrer à un certain nombre de pratiques.
Enfin, je le disais à la tribune tout à l’heure, l’opposabilité de ces directives réduit l’ensemble du corps médical à une mission d’exécutant qui ne sied ni à son expérience, ni à sa qualité.
Pour ces raisons, je soutiendrai des amendements sur cet article 8.


Cet amendement reprend le travail effectué par nos collègues sénateurs, qui ont cherché à mieux rédiger cet article 8. On peut convenir que la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale est imparfaite.

C’est pourquoi les sénateurs ont cherché à réécrire les différentes dispositions relatives aux directives anticipées, notamment celles qui concernent la procédure. L’amendement no 262 reprend in extenso le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, afin que nous puissions améliorer cette proposition de loi.

Il est important de s’entendre sur la portée des directives anticipées, tant en termes d’opposabilité que de contenu. Si l’on prévoit que ces directives ne peuvent exprimer que « la volonté de la personne relative à sa fin de vie », alors on fléchera leur contenu. C’est pourquoi nous souhaitons que la rédaction de l’alinéa 2 soit plus ouverte et que l’on évoque plutôt « les souhaits de la personne relatifs à son parcours de soins ». Au lieu de se limiter à la perspective de la fin de vie et du décès, il convient que ces souhaits concernent l’ensemble du parcours de soins.

Comme vient de l’expliquer Xavier Breton, les directives anticipées ne concernent pas seulement la fin de vie mais expriment les souhaits de la personne sur l’ensemble de son parcours de soins dès sa prise en charge médicale. Il est difficile de déterminer précisément le moment où la personne malade entre en fin de vie : elle doit donc pouvoir émettre des souhaits sur la manière dont elle souhaite être soignée en général.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 258 .


Là encore, il s’agit de proposer que les directives anticipées permettent à la personne de préciser les soins qu’elle désire recevoir et le lieu où elle souhaite finir sa vie. Il ne faut pas se placer dans une logique de fin de vie ou de décès proche, mais d’accompagnement dans un sens plus large.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 256 .

J’insiste sur la forme induite par la rédaction de la seconde phrase de l’alinéa 2, qui est exclusive. Dans le texte qui nous est proposé, les directives anticipées ne peuvent concerner que les objets désignés dans cette phrase, à l’exclusion de tous les autres. La formulation même de la phrase nécessite que l’on indique, d’une manière ou d’une autre, les autres objets que les directives anticipées peuvent concerner. Je comprends que c’est l’esprit des rapporteurs : il convient donc de préciser ces objets, au moins en termes génériques.

Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 217 et 321 rectifié .
La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 217 .

La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement no 321 rectifié .

Pour ma part, je reste très dubitatif quant à la capacité de toute personne bien portante de rédiger des directives anticipées. Ce que l’on peut rédiger quand on est bien portant risque de ne pas correspondre à nos souhaits le jour où l’on sera gravement malade et encore en capacité d’exprimer sa volonté.
Les amendements identiques nos 217 et 321 rectifié , repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

Il vise à revenir sur le caractère opposable des directives anticipées.
L’amendement no 325 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

À notre sens, la rédaction actuelle de l’alinéa 3, qui évoque un modèle « unique » dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, est trop restrictive. C’est pourquoi je propose une écriture différente, consistant à substituer aux mots : « selon un modèle unique » les mots : « conformément à un modèle ».

J’en déduis, monsieur Sebaoun, que vous venez de rectifier l’amendement que vous avez déposé.
L’amendement no 213 , tel qu’il vient d’être rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Pour établir ses directives anticipées en connaissance de cause, il semble indispensable que la personne soit éclairée dans le cadre d’un véritable dialogue avec un médecin.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 253 .

La parole est à Mme Michèle Delaunay, pour soutenir l’amendement no 394 .
L’amendement no 394 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Il vise à rédiger différemment l’alinéa 4, qui dispose aujourd’hui que les directives anticipées « s’imposent au médecin, pour toute décision d’investigation, d’actes, d’intervention ou de traitement ». Nous souhaitons que l’alinéa soit ainsi rédigé : « Le médecin en tient le plus grand compte possible pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. »
Les directives anticipées ne peuvent s’imposer purement et simplement à un médecin, sauf à réduire ce dernier à un rôle d’exécutant de la volonté du patient, sans entrer dans un dialogue. On ne peut pas considérer les médecins comme de simples prestataires de services – le message est d’ailleurs fortement exprimé aujourd’hui par la profession médicale. Nous devons retrouver la volonté d’écoute et de dialogue qui existait jusqu’à présent. Avec la mise en oeuvre d’une sédation profonde et continue et l’établissement de directives anticipées contraignantes, nous opérons un basculement – Mme la ministre elle-même l’indiquait tout à l’heure – et nous rompons l’équilibre qui existait jusqu’à présent. C’est pourquoi nous souhaitons que le médecin tienne le plus grand compte possible des directives anticipées, parce que ces dernières signifient quelque chose, mais qu’elles ne s’imposent pas au médecin qui n’aurait plus qu’à les exécuter sous peine de contentieux.

Je souhaite dire quelques mots des directives anticipées et de leur caractère « contraignant », et non « obligatoire ». Effectivement, on passe d’une situation dans laquelle ces directives pouvaient ne pas être prises en compte – vos amendements essaient d’y revenir –…

…à une situation dans laquelle elles s’imposent. Toutefois, nous prévoyons évidemment des portes de sortie. La première exception est l’urgence : on pense par exemple au suicide, qui nécessite évidemment un geste de réanimation. L’urgence n’est pas propice à une réflexion approfondie, en collégialité, sur la nécessité de poursuivre ou de ne pas poursuivre des traitements. Il existe une deuxième exception lorsque ces directives paraissent inappropriées : dans ce cas, le médecin n’est pas obligé d’en tenir compte.
Le médecin n’est jamais un prestataire de services. Au mieux, les directives anticipées lui imposent non de faire un geste, mais de ne pas faire un geste – en d’autres termes, elles lui imposent une limitation ou un arrêt des traitements. On peut se trouver dans une situation où le malade, s’il est conscient, demande de ne pas faire telles investigations ou tels traitements ; s’il ne peut pas s’exprimer, les directives anticipées permettent de connaître sa volonté. C’est le médecin qui juge – en collégialité, puisqu’il appelle un confrère – s’il doit aller ou non dans le sens des directives écrites.
M. Poisson a évoqué un deuxième problème : faut-il ou non établir un modèle ? Si le modèle consiste à cocher des cases,…

…alors M. Poisson a évidemment raison : la démarche perd totalement son caractère personnel. Mais lui-même s’est trouvé dans des situations un peu difficiles, quand il a pris une feuille blanche et qu’il a été obligé d’écrire ses dispositions alors même qu’il est en parfaite santé – c’est une évidence ! – et qu’il ne doit pas envisager sa mort à moyen ou à court terme.
Sourires.

Cette situation est évidemment difficile. En fait, il existe deux cas de figure : celui de la personne qui se sait porteuse d’une maladie et qui peut envisager, sans en être certaine, la façon dont elle pourrait mourir, et la situation de chacun d’entre nous qui pouvons malheureusement, suite à un accident sur la voie publique, souffrir de lésions cérébrales majeures et irréversibles et qui avons pris la précaution d’écrire que, dans telle circonstance, nous ne souhaitons pas aller au-delà de telle thérapeutique, de telle réanimation, ou que notre vie soit prolongée de façon artificielle. On retrouve ici la notion d’obstination déraisonnable, sur laquelle le malade est amené à exprimer sa volonté.
L’architecture des directives anticipées est contraignante mais ne présente pas de caractère obligatoire. Suite à l’adoption de l’amendement de M. Sebaoun, il n’y a plus de modèle unique obligatoire, mais un modèle dont chacun pourra s’inspirer en ayant la liberté d’écrire ce qu’il souhaite. Pour ma part, je pense qu’il vaut mieux le faire en discutant avec son médecin plutôt que tout seul. Mais faut-il encore ajouter cette obligation dans le texte ?
Laissons respirer nos concitoyens, et faisons en sorte que chacun écrive ses directives anticipées avec un modèle. En Allemagne, il existe un modèle et 12,5 % des Allemands ont rédigé leurs directives anticipées. En France, nous n’avons pas de modèle et seuls 2,5 % de nos concitoyens ont accompli cette démarche. Or on sait très bien que les directives anticipées allemandes s’inscrivent à peu près dans le même cadre que celui de la loi adoptée en 2005 par l’Assemblée nationale. En ayant un modèle et un guide qui ne soit pas pour autant contraignant, on peut penser que chacun d’entre nous pourra avoir une meilleure prospective sur sa propre finitude.
L’amendement no 137 , repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.

L’objet de cet amendement est de clarifier le caractère contraignant des directives anticipées. L’article 8 de la proposition prévoit que celles-ci sont révocables à tout moment, et rédigées selon un modèle unique permettant d’assurer leur effectivité, leur respect de la loi et leur compréhension par tous.
Ce même article prévoit deux cas dans lesquels un médecin peut se délier de ces directives, pourtant contraignantes : l’urgence et des directives « manifestement inappropriées ». Or ce deuxième cas pose problème. En effet, la dimension inappropriée des directives n’est pas définie, et cette absence de définition fait peser le risque d’une évaluation trop subjective de la part des équipes médicales.
Pour qu’un droit ouvert soit efficient, il faut que son application puisse être garantie partout, et de la même manière. Soit les directives sont conformes à la législation en vigueur sur la fin de vie, et elles doivent être appliquées si elles n’ont pas été préalablement révoquées par leur auteur, soit elles ne le sont pas, et elles ne peuvent légalement pas s’appliquer. Dans ce cas, le médecin en est délié de facto, sans qu’un avis collégial soit nécessaire.
Maintenir ainsi une procédure collégiale, nécessitant de réunir plusieurs médecins dans l’urgence pour statuer sur le caractère inapproprié de directives anticipées, risquerait d’alourdir la procédure entourant la fin de vie et, surtout, d’introduire du flou et un doute sur le bien-fondé de ce document, pourtant contraignant et conçu comme un droit.
L’amendement no 386 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Les directives anticipées doivent pouvoir traduire le souhait du patient concernant les conditions d’accompagnement en soins palliatifs jusqu’à sa fin de vie. Elles ne peuvent s’imposer au médecin au nom de la clause de conscience, y compris dans les conditions déontologiques de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique.

La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement identique no 144 .

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement identique no 245 .

Comme les deux amendements suivants, nos 247 et 263, il repose sur une argumentation développée lors de mon intervention sur l’article. Je le considère donc comme défendu.

Plutôt que de prévoir que les directives « s’imposent au » médecin, l’article devrait prévoir qu’elles « sont une aide » pour le médecin. Rendre contraignantes ces directives anticipées risque de supprimer le dialogue, pourtant nécessaire, avec la personne de confiance ou la famille, le médecin se retranchant derrière ces directives anticipées pour éluder toute responsabilité.
Les professionnels de santé connaissent les limites des directives anticipées, ayant été confrontés dans la pratique à la contradiction entre ce qui y est écrit et ce que souhaite réellement la personne qui doit prendre une décision la concernant.
Ces directives étant par définition anticipées, elles ne peuvent rendre véritablement compte des souhaits d’une personne lorsqu’elle est confrontée à une décision à prendre. Il faut donc les tenir pour une aide – précieuse – à la décision, mais ne pas les rendre contraignantes.



Le médecin ne doit pas être déresponsabilisé au moment où il doit prendre ces décisions.
L’amendement no 322 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Si l’on maintient la référence à des directives anticipées « inappropriées », il apparaît à tout le moins nécessaire de renforcer la rédaction de l’alinéa, encore floue et prêtant trop le flanc à des interprétations contraires à l’esprit de la proposition de loi.
En premier lieu, l’amendement introduit une notion de délai, dans lequel le médecin doit solliciter un avis collégial en vue de se délier de directives anticipées jugées inappropriées. Les conditions de recours aux directives anticipées sont le plus souvent marquées par l’urgence. Il est donc important de prévoir que, si ces dernières doivent être rejetées car inappropriées, l’avis collégial puisse être rendu le plus rapidement possible.
Par ailleurs, l’amendement entend préciser la composition du collège amené à se prononcer sur ces directives anticipées. Celui-ci doit comprendre impérativement au moins un médecin extérieur à l’équipe médicale, afin d’assurer l’impartialité de son avis, et éviter notamment tout risque d’avis de complaisance.
L’amendement no 387 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement no 241 .

Il s’agit d’un amendement déposé par M. Darmanin. Le médecin joue aussi le rôle de conseil auprès de son patient. Si un désaccord devait persister entre eux, il serait légitime que le médecin puisse choisir de confier son patient à l’un de ses confrères.
Tout comme il est primordial d’écouter les volontés du patient, il est également important de ne pas contraindre les médecins à suivre une décision qu’ils jugent inadaptée, donc de leur donner le pouvoir de s’en décharger.
L’amendement no 241 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement no 26 rectifié .

Le droit du citoyen à être soigné de façon bienveillante et sensée par des équipes médicales bien formées, évitant ainsi les situations d’acharnement thérapeutique ou de douleurs mal soulagées, devrait rendre inutile la rédaction de directives anticipées.
Mais faute de confiance suffisante entre soignants et soignés, le législateur a prévu, depuis la loi Leonetti de 2005, la rédaction de directives anticipées, consultatives pour le médecin. La nouvelle proposition de loi entend les rendre opposables, au risque que certaines apparaissent inappropriées.
Il faut penser aux choix – cornéliens – de traitements que le patient devra faire, sous la pression insidieuse d’une société soucieuse de réduction des coûts et d’économies dans la prise en charge du grand âge ou du handicap !
En outre, les directives contraignantes risquent de transformer le médecin en un simple prestataire de services, alors qu’elles pourraient contenir des demandes illégitimes ou illégales. Il est à rappeler que les excès de mise sous sédations profondes, combinés à des arrêts inopportuns d’alimentation et d’hydratation etou aux arrêts abusifs de certains traitements, sont constitutifs de l’euthanasie masquée.
L’amendement no 26 rectifié , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Les directives contraignantes transforment le médecin en un simple prestataire de services. Afin que celui-ci ne se trouve pas en conflit avec le serment d’Hippocrate, il doit être précisé qu’elles ne peuvent contenir des demandes illégitimes ou illégales.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement identique no 203 .

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement identique no 240 .

L’objet de cet amendement est de préciser dans la loi que les directives ne peuvent contenir des dispositions contraires au code de déontologie.

La mise en place d’un registre national informatisé pour centraliser les directives anticipées soulève des objections de principe et entraîne des difficultés pratiques. C’est la raison pour laquelle je propose la suppression de cette disposition.
L’amendement no 133 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

L’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, permet à toute personne majeure, sans distinction, de rédiger des directives anticipées afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où elle ne serait pas, à ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté.
Actuellement, les personnes bénéficiant d’une mesure de protection disposent des mêmes droits, mais l’alinéa 5, qu’il est proposé de supprimer, conditionne à l’autorisation du juge des tutelles leur droit de rédiger des directives anticipées.
Cette restriction est faite sans distinction de mesure de protection. Elle s’impose à un droit acquis, ignore l’esprit de la loi de 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et méconnaît l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Cet article, qui réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique, dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Le fait de rédiger ses directives anticipées est un acte intime et strictement personnel qui ne peut être qu’accompli que par le majeur seul, sans que le juge puisse autoriser le curateur ou le tuteur à assister le majeur, ni a fortiori à le représenter.
L’article R. 1111-17 du code de la santé publique prévoit la possibilité, pour l’auteur des directives, de se faire assister de deux témoins lorsqu’il est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document.
L’amendement no 391 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.
L’article 8, amendé, est adopté.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Vote solennel sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
Suite de la deuxième lecture de la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie ;
Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 6 octobre 2015 à zéro heure trente.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly