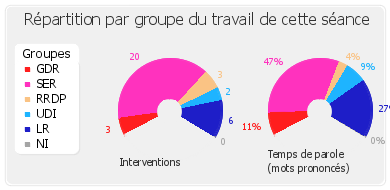Séance en hémicycle du 6 juillet 2015 à 16h00
Sommaire
- Règlement du budget et approbation des comptes 2014 (voir le dossier)
- Accessibilité des établissements des transports et de la voirie pour les personnes handicapées et accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (voir le dossier)
- Ordre du jour de la prochaine séance (voir le dossier)
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à seize heures.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale de la commission des finances, mesdames et messieurs les députés, par ce projet de loi de règlement, nous vous proposons d’approuver des résultats d’exécution qui ont déjà donné lieu à de nombreux échanges en commission des finances : d’abord le 11 février dernier, puis les 15 et 22 avril lors de la présentation du programme de stabilité, enfin mercredi dernier lors de la présentation de ce texte. Le travail en commission a donc été important : je crois que les analyses techniques ont été menées de manière approfondie et je souhaiterais plutôt concentrer mon intervention sur trois points plus généraux.
Le premier point est la fiabilité et la transparence des chiffres soumis à votre délibération. C’est un aspect dont on parle trop peu quand on aborde les questions budgétaires, alors qu’il est indispensable. Cette qualité de l’information dont vous disposez se retrouve dans les trois comptabilités.
En comptabilité générale, d’abord : les comptes de l’État ont été certifiés pour la neuvième année consécutive par la Cour des comptes et celle-ci a continué à lever certaines composantes de ses réserves, ce qui prouve l’amélioration de la qualité des comptes.
L’information dont vous disposez est aussi établie en comptabilité budgétaire, celle des lois de finances : elle a également fait l’objet d’un examen par la Cour des comptes dans le cadre de la certification, pour vérifier sa cohérence avec la comptabilité générale et dans le cadre du rapport sur les résultats et la gestion budgétaire.
Enfin, en comptabilité nationale, l’INSEE a calculé le niveau du déficit public pour 2014 en toute indépendance et le Haut Conseil des finances publiques, qui n’est pas moins indépendant que l’INSEE, a validé le calcul du solde structurel dans l’avis qui vous a été transmis.
Ces éléments sont connus mais il faut les rappeler car ils prouvent la qualité de l’information budgétaire produite par le Gouvernement et contrôlée par des organismes indépendants. C’est un élément indispensable pour la crédibilité de notre pays et pour maintenir la confiance que les créanciers accordent à sa signature. C’est tout autant indispensable à la bonne information du Parlement, la qualité de nos débats et, plus largement, celle de la gestion des finances publiques. Mais la transparence est aussi, et surtout, une condition nécessaire pour rétablir la confiance de nos concitoyens dans la parole publique – en particulier en matière budgétaire. C’est pour cette raison que j’attache la plus grande importance à garantir l’information la plus complète du Parlement sur ces questions et la rapporteure générale, qui échange régulièrement avec mes services, peut, je crois, en témoigner. Et encore aujourd’hui, je serai bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes les questions et demandes de précisions sur cette exécution.
Mon deuxième point porte sur le fond de ce projet de loi. Il y a, je crois, un enseignement majeur que l’on peut tirer de l’exécution 2014 : les efforts que nous avons demandés aux Français portent leurs fruits. Les efforts paient,…
…produisent des résultats et les chiffres le prouvent. Le déficit public est en constante diminution : à 4 % en 2014, il est au plus bas depuis 2008. Il peut pourtant y avoir, chez certains de nos concitoyens, de la lassitude, peut-être du découragement, devant une réduction du déficit public qui est réelle mais qui n’est peut-être pas aussi rapide qu’espéré. Je ne méconnais pas cette réalité mais il faut insister sur un point : cette réduction du déficit, nous l’avons obtenue dans un contexte peu favorable de faible croissance et d’inflation quasi nulle.
C’est d’ailleurs un contexte que personne n’avait anticipé : en avril 2014, alors que l’année était déjà bien entamée, le Haut Conseil des finances publiques estimait que les prévisions du Gouvernement pour 2014 étaient « réalistes » et qu’elles n’étaient « affectées d’aucun aléa baissier ». Ces prévisions étaient de 1 % pour la croissance et de 1,2 % pour l’inflation. Finalement, la croissance a été de 0,2 % et l’inflation de 0,5 %. Ce contexte vient, à lui seul, dégrader mécaniquement le déficit public de 0,5 % du PIB. Mais si l’on déduit ces effets de la conjoncture et que l’on regarde les fondamentaux de nos finances publiques, on voit qu’ils s’améliorent de manière très nette car, en 2014, le déficit structurel est au plus bas depuis l’an 2000.
Au-delà du caractère un peu abscons de la notion de déficit structurel, il existe une réalité : nous sommes en train de renforcer la structure même de nos finances publiques. Les Français doivent le savoir, il faut le répéter : ce sont des bases solides que nous sommes en train de redonner à notre budget et, grâce aux efforts de tous – État, Sécurité sociale, collectivités territoriales et établissements publics –, nous mettons en ordre nos comptes et nous pourrons transmettre des finances publiques saines après trente ans d’excès.
J’ouvre une parenthèse sur l’évolution des effectifs, sujet que votre rapporteure générale a particulièrement examiné cette année et sur lequel je voudrais revenir pour rappeler quelques constats et éviter toute erreur d’interprétation.
Je souligne d’abord que, là aussi, la transparence est complète : les effectifs réels de l’État en 2014, fonctionnaires ou agents contractuels, vous sont présentés dans le projet de loi de règlement et détaillés dans les rapports annuels de performance par programme, comme d’ailleurs ceux des opérateurs. Il est naturel de comparer ces effectifs réels aux plafonds d’emplois votés en loi de finances initiale. Encore faut-il rappeler que les contraintes de la gestion des effectifs, notamment la difficulté à prévoir avec précision les départs à la retraite des agents, imposent de maintenir une marge de sécurité minimale par rapport à ces plafonds, précisément pour garantir que votre autorisation soit respectée en dépit des aléas de la gestion.
En 2014, les effectifs réels de l’État représentaient 98,5 % des plafonds : on est bien dans la marge technique, d’autant que ce pourcentage a peu varié globalement ces dernières années. Attention donc à ne pas surinterpréter cet écart ! Et si vous regardez l’évolution des effectifs réels par rapport à 2013 – car c’est bien ce qui compte in fine, comme pour les dépenses –, vous retrouverez les créations d’emplois dans les secteurs prioritaires comme l’éducation, la sécurité et la justice, compensées par des efforts dans les autres secteurs, avec une légère diminution au total – moins 3 364 équivalents temps plein à périmètre constant.
Pour conclure, je voudrais faire le lien entre ce projet de loi et les perspectives que nous avons tracées jusqu’à la fin de la législature, car l’exécution 2014 prouve que nous pouvons réduire le déficit tout en baissant les impôts. Avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, et la réduction exceptionnelle de l’impôt sur le revenu, nous avons mis en oeuvre des baisses d’impôts, les premières depuis le début de la crise. Et ces allégements, nous ne les avons pas financés à crédit : ce sont les économies réalisées sur la dépense publique qui les ont financés. En effet, la maîtrise de la dépense publique est, elle aussi, attestée par les chiffres : la dépense totale de l’ensemble des administrations publiques a progressé de seulement 0,9 %, soit le niveau le plus bas depuis que les statistiques existent.
C’est là une conclusion importante que l’on peut tirer de cette exécution : cet engagement de réduire le déficit tout en baissant les impôts, nous sommes en capacité de le tenir. Nous l’avons tenu en 2014 et nous le tiendrons cette année. Et l’an prochain aussi, nous diminuerons à la fois le déficit et les impôts.
Voilà, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, l’essentiel de ce que vous présente le Gouvernement avec ce projet de loi. Cette exécution nous livre un message d’optimisme : malgré des circonstances qui n’étaient pas favorables aux finances publiques, nous avons poursuivi la réduction du déficit et nous avons commencé à alléger les impôts tout au long de cette année 2014. C’est la preuve que les efforts portent leurs fruits ; c’est la preuve que la baisse des impôts n’est pas qu’une promesse ; c’est, enfin, la preuve que nos finances publiques vont mieux.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

La parole est à Mme Valérie Rabault, rapporteure générale de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, ce projet de loi de règlement porte sur le périmètre des dépenses et des recettes de l’État, à l’exception de l’article liminaire, qui porte sur le solde des administrations publiques, c’est-à-dire l’État, les administrations de Sécurité sociale et les collectivités territoriales. Je m’en tiendrai aujourd’hui au seul périmètre de l’État et des organismes qui lui sont rattachés.
Pour nous, députés, examiner le projet de loi de règlement, c’est dire si ce que nous avons voté en projet de loi de finances a été exécuté de manière fidèle ou non par le Gouvernement. Et je dois dire, à la lecture de ce projet de loi, que l’exécution du budget 2014 a été réalisée de manière fidèle par rapport à ce que nous avons voté, voire avec des améliorations. N’en déplaise à mes chers collègues de l’opposition, dans de nombreux domaines, cette exécution a atteint l’ensemble de ses objectifs, voire les a dépassés.

Je devance vos propos car j’ai déjà eu l’occasion de les entendre !
Examiner un projet de loi de règlement, c’est, bien entendu, aborder beaucoup de sujets, tant le budget de l’État recouvre de missions. Pour ma part, je souhaiterais limiter mon propos à cinq sujets, monsieur le secrétaire d’État.
Premièrement, l’État, en 2014, a-t-il dépensé plus ou moins qu’en 2013 ?

Et a-t-il dépensé plus ou moins que ce que nous avions voté ? Pour répondre à ces questions, je me réfère aux chiffres : en 2014, l’État a dépensé 1,9 milliard d’euros de moins qu’en 2013.

Tout simplement, monsieur le président de la commission des finances, parce que 288,6 milliards d’euros, c’est moins que 290,5 milliards d’euros. Donc, en 2014, l’État a dépensé moins qu’en 2013 et il a dépensé 6,3 milliards d’euros de moins que ce que nous avons voté. Là aussi, mes chers collègues, les chiffres parlent d’eux-mêmes et il serait inutile de relancer une polémique. Je remercie d’ailleurs ceux de mes collègues de l’opposition qui, en commission des finances, ont reconnu que, pour la première fois, l’État avait dépensé moins que l’année précédente.
On m’objecte que ce serait grâce à la baisse des taux d’intérêt.

Certes, ils ont baissé et cela a diminué la charge de la dette payée chaque année par l’État.

Mais ce n’est pas, mes chers collègues de l’opposition, la seule explication car il y a bien eu, pour un certain nombre de missions, une réduction de la dépense publique.
Et même si les taux d’intérêt n’avaient pas autant baissé – ils ont beaucoup baissé, je vous l’accorde –, l’État aurait dépensé moins en 2014 que ce que nous avions voté.
Deuxième question : les recettes de l’État ont-elles été inférieures ou supérieures à ce que nous avions voté ?
M. le secrétaire d’État l’a répété : elles ont en effet diminué d’une dizaine de milliards d’euros.

Les analyses montrent que 90 % de cet écart s’explique par une conjoncture plus dégradée que prévu.
Troisième question – M. le secrétaire d’État y a fait référence : nous avons souhaité disposer d’une photographie aussi précise que possible des effectifs de l’État. Nous avons souhaité savoir si les plafonds que nous votons – c’est-à-dire les effectifs maximaux – étaient ou non atteints et, s’ils ne l’étaient pas, dans quelle mesure.
Je ne vous cache pas que, depuis quelques jours, j’entends beaucoup de choses plus ou moins exactes. Je souhaite donc profiter de cette tribune pour faire une série de mises au point.
Première mise au point : c’est la première fois, mes chers collègues, que nous réalisons un bilan consolidé – plusieurs d’entre vous, de la majorité comme de l’opposition, l’avaient demandé – afin de disposer d’une véritable photographie des effectifs de l’État. À cet égard, je remercie les services de Bercy et de la commission des finances, car si la réalisation de tableaux synthétiques et d’additions peut paraître très simple, il faut parfois aller chercher des données qui se cachent dans bien des recoins, ce qui est tout de suite un tout petit peu plus compliqué.
En nous livrant à un tel exercice, nous affirmons le souhait du Parlement d’exercer pleinement son pouvoir et son devoir de contrôle : nous souhaitons savoir si, oui ou non, les postes que nous votons chaque année ont été pourvus.
Deuxième mise au point : un écart existe entre les plafonds votés et les effectifs réels.
Je me tourne vers mes collègues de l’opposition qui se sont beaucoup exprimés ce week-end dans quelques médias pour leur dire que cela n’est pas nouveau mais, comme l’exercice n’avait jamais été effectué d’une manière aussi précise, sans doute ne s’en sont-ils pas rendu compte. Toujours est-il que cet écart entre les plafonds et les effectifs réalisés est relativement stable.
Troisième mise au point, toujours sur cette question des effectifs : les effectifs liés aux missions prioritaires décidées par le Gouvernement et soutenues par notre majorité, eux, ont augmenté. Je prendrai quelques chiffres pour illustrer ce propos. S’agissant de l’enseignement scolaire, 959 376 postes étaient ouverts en 2012 ; il y en a eu 969 344 en 2014. Mes chers collègues de l’opposition, je vous invite à reconnaître avec moi que le second chiffre est supérieur au premier et même au nombre de postes ouverts les années précédentes.
S’agissant maintenant des effectifs, soit les agents occupant effectivement un poste – le comptage est en l’occurrence à 100 % –, ils étaient au nombre de 950 007 en 2012 et de 956 059 en 2014. Là encore, je vous invite à considérer avec moi que le second chiffre est supérieur au premier et que, par conséquent, la hausse des effectifs a été réelle pour les ministères et les missions prioritaires du Gouvernement et de sa majorité.
Quatrième question que je souhaite aborder à cette tribune : le budget de la défense. La loi de programmation militaire prévoit qu’entre 2014 et 2019 les dépenses atteignent 31,4 milliards, hors contribution au compte d’affectation de pensions, qui est de 1,8 milliard. Là aussi, nous le savons, des dépassements ont été constatés en cours d’année, principalement en raison du lancement de nouvelles opérations – Sangaris à la fin de 2013, encore l’intervention dans la bande sahélo-saharienne.
Le Gouvernement a pris ses responsabilités puisque, au total, le budget de la défense a été abondé d’1 milliard au cours de 2014 : nous sommes ainsi passés de 31,4 à 32,4 milliards. Je souhaitais le dire à cette tribune puisque, là encore, il m’arrive parfois d’entendre des commentaires qui ne me paraissent pas tout à fait exacts. Nous soutenons nos militaires, nous soutenons la défense comme nous l’avons montré en 2014 avec ce milliard supplémentaire alloué au budget de la défense.
Cinquième et dernière question : l’investissement, y compris l’investissement public. En commission des finances, nous avons été amenés à aborder à plusieurs reprises le problème du soutien à la croissance, lequel nécessite bien entendu un soutien à l’investissement privé – avec le CICE et le pacte de responsabilité – et public, avec l’État et les collectivités locales.
Une fois de plus, le Gouvernement a pris ses responsabilités puisqu’un deuxième programme d’investissements d’avenir a été ouvert en 2014, à hauteur de 12 milliards. Le bilan chiffré des sommes effectivement décaissées s’élevait à plus de 10 milliards – en comptant les deux PIA de 35 et 12 milliards – à la fin du mois de décembre de 2014, dont 3,3 milliards pour la seule année 2014, une petite partie ayant bénéficié à la défense.
Lors de leur audition, les représentants de la Cour des comptes ont souhaité lancer un débat sur l’inclusion ou non des décaissements des PIA dans le solde public. J’avoue que je ne les rejoins pas : le premier PIA existe depuis 2009-2010 et, tout d’un coup, la Cour se réveillerait pour donner une nouvelle interprétation des décaissements des PIA. Il semble extrêmement dangereux de vouloir changer le thermomètre parce qu’on a l’impression que la température évolue. Mieux vaut conserver un instrument et une méthode de comptabilité uniques. Par conséquent, il est pertinent d’en rester à la façon dont nous envisageons la comptabilité des PIA.
Pour conclure, j’apporte mon soutien à ce projet de loi de règlement qui, je crois, propose une image fidèle de la situation au regard de ce que nous avons voté dans le cadre de la loi de finances pour 2014 et qui témoigne d’un effort inédit en matière de dépenses de l’État.

La parole est à M. le président de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteure générale, chers collègues, j’appelle votre attention sur le fait que, pour la première fois depuis le mois de décembre dernier, nous parlons d’économie et de finances publiques dans cet hémicycle. Le Gouvernement a en effet refusé que l’on évoque ici le programme de stabilité et il persiste dans son refus d’examiner un collectif de mi-année. Notre discussion, cette après-midi, porte donc sur les finances publiques au titre de l’exécution des comptes de 2014.
De quoi cette loi de règlement pour 2014 témoigne-t-elle ? D’une situation extrêmement préoccupante, pour ne pas dire calamiteuse, de nos finances publiques et de notre économie.
Voilà qui commence bien…

Vous venez de vous livrer à un petit tour de passe-passe, monsieur le secrétaire d’État, aidé par Mme la rapporteure générale, et c’est normal. Il me revient donc la lourde tâche de rétablir la vérité de nos comptes publics.

Je commencerai par parler de la croissance, que nul n’a évoquée. La croissance de la France, en 2014, s’est élevée à 0,2 % alors que la prévision était de 0,9 %, voire 1 %. Dans le même temps, la croissance moyenne des pays de la zone euro s’est quant à elle élevée à 0,9 %. Nous avons fait quatre fois moins bien ! D’ailleurs, l’envolée de la courbe du chômage pendant toute l’année dernière, hélas, en témoigne.

Le déficit public ? Parlons-en ! En 2014, il s’est alourdi de 10,7 milliards supplémentaires sur le budget de l’État par rapport à l’année précédente. Il faut se livrer à des contorsions et retraiter les comptes des PIA pour réduire cette progression à seulement 5,5 milliards.
Ce n’est pas vrai !

Ce sont donc 3 milliards de déficit supplémentaires par rapport à la prévision en LFI. Et, si l’on prend les chiffres consolidés de l’ensemble de nos comptes publics, monsieur le secrétaire d’État, derrière lesquels vous vous êtes réfugié, le déficit public ainsi calculé ne diminue que de 0,1 point – il est passé de 4,1 en 2013 à 4 points aujourd’hui –, et pas grâce à l’État mais aux comptes des collectivités locales, ce que ni vous ni la rapporteure générale n’avez souligné.

Il faut bien tenir compte de la situation suivante : le déficit de l’État, qui est de 80 milliards, représente – tenez-vous bien – trois mois de dépenses : à partir du 1er octobre, l’État paie son personnel et ses interventions en s’endettant.
Lorsque vous étiez au pouvoir, c’était pendant quatre mois !

Les recettes fiscales ont été inférieures de 10 milliards à la prévision en LFI et de 9 milliards par rapport à la prévision en termes de croissance spontanée.
Monsieur le secrétaire d’État, il se passe des choses en la matière ! L’overdose fiscale dont vous êtes responsables entraîne des changements de comportements. Or, dans votre document, vous n’évoquez nulle part les 5 milliards d’impôts sur le revenu qui font défaut. Cela mériterait pourtant que nous nous interrogions.
S’agissant des dépenses, leur croissance ralentit, monsieur le secrétaire d’État, je le reconnais, mais l’augmentation n’en est pas moins réelle. Si l’on ne prend pas en compte la baisse énorme des frais financiers – j’y reviendrai – et si l’on retraite les comptes des PIA, la hausse, entre l’exécution 2013 et l’exécution 2014, s’élève à 850 millions. Elle est tout à fait légère, je le reconnais, mais pour arriver aux 2 milliards évoqués par Mme la rapporteure générale, il convient évidemment de prendre en compte la baisse des frais financiers dans le budget de l’État.

Vous n’avez pas non plus évoqué un certain nombre de signaux inquiétants.
Tout d’abord, la débudgétisation – vous en avez un peu parlé avec le PIA, madame la rapporteure générale. Je prends à témoin M. Cornut-Gentille : à peu près 2 milliards devraient normalement relever du domaine des dépenses budgétaires alors qu’on les considère comme relevant du PIA, notamment par l’intermédiaire du Commissariat à l’énergie atomique.
Vous n’avez pas non plus évoqué les reports de charges de l’exercice de 2014 sur celui de 2015, monsieur le secrétaire d’État, non plus que le fait que la dette de l’État vis-à-vis de la Sécurité sociale recommence à augmenter, et cela, malgré une économie comme nous n’en avions jamais connu jusqu’à présent de 3,5 milliards sur les intérêts de la dette par rapport à la LFI et, également, malgré un gel de crédits qui a atteint des proportions énormes au début de l’année avec 9 milliards ainsi que 3,3 milliards d’annulations. Vous avez utilisé à tour de bras l’annulation de crédits d’investissements pour faire face à la marée montante des interventions sociales ou, dans le domaine de la défense, des OPEX, qui étaient sous-budgétées.
En consolidé, sur l’ensemble de nos comptes – cela non plus, vous ne l’avez pas dit – les prélèvements obligatoires, chers collègues, sont passés de 44,7 % à 44,9 % du PIB. Or, que lit-on dans le document ? Que les prélèvements obligatoires sont en « légère augmentation ». Bref, tout va bien ! Je vous rappelle que ce niveau de 44,9 % constitue notre record historique : jamais la France n’a connu un tel niveau de prélèvements obligatoires.
Vous affirmez que les dépenses publiques, quant à elles, ont été maîtrisées. Or, elles représentaient 57 % du PIB en 2013 et elles sont passées à 57,5 % en 2014. Là aussi, c’est un record historique mais pas seulement : c’est également un record mondial ! En effet, cette année, nous avons réussi à dépasser le Danemark, seul pays d’Europe dont la dépense publique était supérieure à la nôtre. Maintenant, la France est en tête.
Ces chiffres sont sans appel mais la majorité n’en a pas vraiment conscience car plusieurs choses se sont produites.
Tout d’abord, vous avez eu l’habileté – mais peut-être n’était-ce pas volontaire, c’est à vous de le dire, monsieur le secrétaire d’État – de présenter un deuxième PLFR, l’année dernière, qui a complètement noirci le tableau, puisqu’il prévoyait un déficit de 4,4 points de PIB afin de pouvoir expliquer trois mois après qu’il ne serait finalement que de 4 % et que l’on avait parfaitement réussi à le réduire, ce qui a permis de faire oublier, notamment aux médias, que la prévision initiale de déficit en PLFI pour 2014 était de 3,6 points de PIB !

Ce qu’il faut observer, c’est donc le dérapage : il y a une différence de 0,4 point de PIB par rapport aux prévisions.
Le deuxième point auquel nous devons prêter attention est l’effet anesthésiant des taux d’intérêt. Rendez-vous compte : en 2014, l’État est responsable à lui seul de 80 % de nos 2 000 milliards de dette. Sa contribution à la dette a progressé de 71 milliards, pour arriver à près de 1 540 milliards. Parallèlement, les frais financiers liés à cet endettement diminuent de 1,7 milliard. Autrement dit, plus on s’endette, moins cela coûte. Pourquoi se gêner ?
Cet effet anesthésiant conduit à un manque total de lucidité sur la réalité de nos comptes. Dans la période troublée que traverse la zone euro, ce manque de lucidité risque d’être très préjudiciable à notre pays.
Par ailleurs, la comparaison entre les chiffres proposée dans votre document est un véritable embrouillamini.
Ainsi, plutôt que de comparer systématiquement l’exécution 2014 à celle de 2013, on la compare tantôt à la loi de finances initiale, tantôt à la première loi de finances rectificative, tantôt à la seconde, et seulement de temps en temps à l’exécution. Pour faire bonne mesure, quand les comparaisons atteignent les extrémités des tentatives de présentation avantageuse, on va chercher le solde structurel, très commode parce que personne n’y comprend rien.
En ce qui me concerne, je comprends au moins une chose : un solde structurel, avec une fraction conjoncturelle de 1,9 point, qui ne cesse d’augmenter ces dernières années, ne veut plus rien dire du tout. Si Charles de Courson était là, je suis sûr qu’il m’approuverait.
Sourires.

Ces chiffres sont inquiétants et ils appellent de notre part un effort de rigueur renouvelé car je crains qu’avec tous les soubresauts que connaîtra la zone euro dans les prochaines semaines, l’heure de vérité sonne pour certaines trajectoires de retour à l’équilibre ou de diminution du déficit encore trop fragiles ou vulnérables.
Je voudrais conclure par deux suggestions, très modestes.
Tout d’abord, au vu de ce qui s’est passé en 2013 et en 2014, le Gouvernement devrait s’efforcer de présenter chaque année au Parlement ses prévisions en matière de recettes fiscales ainsi que le mode de calcul retenu. Nous pourrions ainsi nous appuyer sur un rapport spécifique, une grille d’analyse avec, impôt par impôt, le choix des taux d’élasticité et les hypothèses comportementales. Cela nous éviterait de nous retrouver une fois de plus, en 2016, avec quelques milliards en moins à la fin de l’année.
Quant aux dépenses, nous devons sortir, madame la rapporteure générale, de la problématique des dépenses exceptionnelles. Les dépenses exceptionnelles – PIA, MES –, ce sont aussi des sommes que nous empruntons. Or d’où viendront les problèmes de notre pays ? De la dette. La seule dépense qui compte, c’est celle que l’on emprunte. C’est cela, la bonne norme.
Je vous propose donc de changer de méthode pour les PIA afin d’intégrer chaque année dans la norme nouvelle, deux éléments : les dotations consommables à hauteur de leur utilisation par les opérateurs et les intérêts versés par l’État.
Vous avez cité à plusieurs reprises, monsieur le secrétaire d’État, le terme de transparence. Dans notre situation, très difficile, nous avons un devoir de lucidité, qui passe par des comptes sincères et transparents.
Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

J’ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de renvoi en commission déposée en application de l’article 91, alinéa 6, du règlement.
La parole est à M. François Cornut-Gentille.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, voici maintenant des années qu’inexorablement, législature après législature, notre assemblée devient l’ombre d’elle-même. Il serait certes faux de dire que rien n’a été entrepris pour y remédier. Bien au contraire. Depuis Philippe Séguin jusqu’à Claude Bartolone, chaque président a vainement tenté d’inverser ou, du moins, de ralentir le cours des choses. Pourtant, en dépit de multiples innovations animées des meilleures intentions, il nous faut bien reconnaître un malaise de plus en plus profond.
De ce point de vue, notre dernière session marque sans doute le franchissement d’un nouveau seuil. Trois faits me paraissent significatifs : le dernier recours à l’article 49, alinéa 3 pour la loi Macron, qui n’est pas venu mettre fin à un débat tumultueux mais interdire tout débat ; la saisine inédite, pour la loi sur le renseignement, du Conseil constitutionnel par l’exécutif lui-même ; enfin, l’épisode des frondeurs, que l’on a tort de regarder essentiellement comme un débat interne au groupe socialiste.
En effet, au-delà de la ligne politique, ce sont bien davantage la question institutionnelle et celle du rôle du député qui se trouvent posées. Au fond, personne ne juge la situation satisfaisante mais personne n’ose le dire clairement de peur d’aggraver encore les choses.
Alors qu’il nous faudrait prendre du recul afin d’analyser l’origine de cet affaiblissement parlementaire, nous nous réfugions obstinément dans une suractivité législative toujours plus aveugle et toujours plus routinière. Loin de nous ouvrir les yeux, les déconvenues qui s’accumulent sont vite oubliées.
Inlassablement et mécaniquement, nous répétons le rituel législatif en refusant de voir que les Français se montrent de moins en moins concernés et même de plus en plus hostiles. En fait, ils ne savent plus à quoi sert le Parlement, mais le savons-nous nous-mêmes ?
C’est dans ce contexte d’un irrésistible déclin parlementaire annonçant à terme une crise majeure qu’il faut resituer le débat d’aujourd’hui.
Une nouvelle fois, nous allons adopter la loi de règlement dans l’indifférence générale : désintérêt des parlementaires qui considèrent ce texte comme technique et sans enjeux, désintérêt de la presse et de l’opinion qui en ignorent même l’existence.
Incroyable désinvolture, lorsque l’on sait que la loi de règlement reflète la réalité du budget exécuté ! En effet, le budget exécuté est toujours assez éloigné de celui qui a été voté en loi de finances initiale. Cela signifie en fait que la majorité ne souhaite pas vérifier que le Gouvernement a bien mis en oeuvre les choix pourtant solennellement annoncés lors du débat budgétaire.
Tout aussi curieusement, l’opposition ne semble attacher aucune valeur au respect ou non par le Gouvernement de ses engagements. Alors se pose une question : ce refus de voir les réalités n’est-il pas très éclairant sur nos dysfonctionnements ?
Toujours négligée, alors qu’elle pourrait servir de base à un débat extrêmement utile, la loi de règlement doit être l’occasion de réfléchir à notre pratique parlementaire actuelle.
Aussi, je vous propose d’examiner rapidement les différentes explications données à ce malaise parlementaire que chacun ressent depuis des années. Jusqu’à présent, deux types d’approches ont retenu l’attention.
La première tend à minimiser l’ampleur de la crise et considère que le Parlement souffre essentiellement d’un problème d’image.
La seconde découle d’une analyse institutionnelle et fait du Parlement la victime d’un exécutif trop puissant.
Pour ma part, je voudrais défendre une troisième approche. Je crois plutôt que le Parlement se décrédibilise lui-même dans une suractivité législative qui souligne désormais son impuissance. Il ne tient cependant qu’à lui de retrouver un rôle valorisant et utile en se concentrant sur une nouvelle manière de remplir sa mission de contrôle et d’interpellation.
La rénovation du Parlement est une tâche à laquelle se sont systématiquement attelés tous les présidents de notre assemblée depuis une vingtaine d’années.
Leurs efforts ont porté dans trois directions : mieux organiser le travail parlementaire, faire connaître le travail parlementaire et améliorer l’image des parlementaires.

Pour ce qui est de l’organisation du travail, on rappellera les principales initiatives que sont l’instauration de la session unique, la création de nouvelles commissions et la mise en place du temps législatif programmé. Pour la meilleure communication de l’activité parlementaire, on notera essentiellement la création de la chaîne parlementaire, la retransmission du travail en commission et l’élaboration de statistiques sur l’activité des parlementaires.
Enfin, on espère une amélioration de l’image des parlementaires de mesures aussi diverses que le non-cumul des mandats, la baisse et l’encadrement de l’IRFM, la publicité donnée à la réserve parlementaire, la création du déontologue, ou la présence obligatoire en commission le mercredi matin.
Ajoutons que beaucoup jugent que l’Assemblée nationale souffre encore de ne pas être suffisamment représentative. À gauche, on insiste sur la trop lente progression de la diversité et de la féminisation ; à droite, sur le poids jugé excessif de la fonction publique.
On peut discuter à l’infini de la pertinence de ces axes de progrès. Il y a certainement eu des réussites comme des mesures à l’impact plus discutable.
Cependant, une évidence s’impose : toutes ces innovations, aussi fondées soient-elles, n’ont pas permis d’améliorer l’image du Parlement. Pire, elles semblent avoir accompagné la dégradation de notre image.
Il faut enfin distinguer quelques initiatives qui indiquent un début de prise de conscience de notre inefficacité croissante. Ce souci de sortir nos débats des déclarations d’intention et de porter une attention nouvelle à l’efficacité réelle des politiques publiques est à l’oeuvre dans le développement des missions d’évaluation et de contrôle, comme dans la création du comité d’évaluation et de contrôle ou l’obligation des études d’impact pour tous les projets de loi. Il ne semble en effet plus possible de continuer à voter des textes et des budgets sans nous soucier de leur effet réel.
Pourtant, ces dispositions n’ont pas atteint leur but. En effet, restées à la marge d’une activité législative proliférant toujours plus, elles n’ont pas pu parvenir à modifier en profondeur notre façon de travailler.
Ces semi-échecs confirment celui de la réforme budgétaire initiée en 2001 avec la LOLF. Près de quinze ans plus tard, le bilan est extrêmement décevant. Les députés ne se sont pas emparés des outils mis à leur disposition. Quant à l’exécutif, il a laissé aux administrations le soin de définir leurs missions et d’évaluer leur propre performance. Dès lors, la réforme de l’État se borne à n’être qu’un slogan ou, au mieux, une recherche d’économies.
Dans ce contexte où la rénovation de l’Assemblée ne s’est que très partiellement portée sur le problème de fond de la pratique parlementaire, les résultats, comme on le voit depuis vingt ans, sont forcément décourageants. Il est alors tentant de chercher d’autres causes, par conséquent d’autres remèdes, à nos difficultés.
La piste institutionnelle est privilégiée par de nombreux acteurs et observateurs de la vie politique. Le malaise actuel trouverait donc sa source dans les institutions de la Ve République. Par le pouvoir, jugé excessif, qu’elles accordent à l’exécutif et en particulier au Président de la République, elles enfermeraient le Parlement dans un rôle secondaire. Certes, ce trop fort déséquilibre est peut-être un facteur de stabilité, mais il finit par engendrer de graves effets pervers.
Le résultat est une sorte de stérilisation de notre vie politique, en empêchant le Parlement d’exprimer des débats utiles.
On connaît cette critique qui remonte à l’origine de notre Constitution. Il faut surtout souligner qu’elle s’était considérablement atténuée au fil du temps, le parcours personnel de François Mitterrand reflétant parfaitement cette évolution.
Pourtant, voici une vingtaine d’années qu’elle revient en force, notamment chez les promoteurs de la VIe République. Pour libérer un Parlement infantilisé, selon lui, par le Président de la République, Arnaud Montebourg va jusqu’à revenir sur l’élection de celui-ci au suffrage universel.
Autre fait nouveau, ces critiques traditionnellement portées par la gauche sont désormais reprises, sans aller aussi loin, par une partie de la droite. C’est en effet cette recherche d’un rééquilibrage en faveur du Parlement qui est la marque de la révision constitutionnelle de 2008 avec la limitation du recours à l’article 49, alinéa 3.
Les frondeurs, quant à eux, appellent de leurs voeux une nouvelle pratique parlementaire. Pour Laurent Baumel, la suppression du 49-3 et du droit de dissolution en constituent les « préalables incontournables ».
Toutes ces démarches reposent sur une lecture de la Constitution qui est aujourd’hui presque unanimement acceptée, celle d’un Parlement écrasé par le pouvoir exécutif.
Inlassablement répétée, l’affirmation est-elle encore juste pour autant ? C’est assurément vrai sous la République gaullienne et sans doute jusqu’aux mandats de François Mitterrand. Mais sommes-nous encore dans cette continuité historique ? N’y a-t-il pas eu rupture ?
Au-delà du texte constitutionnel, l’exécutif est-il aujourd’hui, dans la pratique, aussi puissant qu’on le dit ? Notre vision n’est-elle pas déformée par la réalité du pouvoir jusqu’aux années quatre-vingt que nous continuons à projeter sur une situation aujourd’hui très différente ?
S’il est vrai que le Parlement reste extrêmement faible, la cause en réside-t-elle toujours dans un excès de pouvoir de l’exécutif comme au début de la Ve République ?
Depuis les années quatre-vingt-dix et les mandats de Jacques Chirac, ne faut-il pas au contraire souligner une faiblesse inédite de l’exécutif qui ne s’est accompagnée d’aucune revalorisation parallèle du Parlement ? Dans ce nouveau contexte, réduire les prérogatives de l’exécutif, est-ce aussi nécessairement qu’on le croit réhabiliter le Parlement ?
En fait, les tenants d’une nouvelle donne institutionnelle me paraissent conditionnés par une lecture trop historique des institutions. Une lecture pertinente jusque dans les années quatre-vingts mais qui méconnaît les profondes évolutions qui sont intervenues depuis. Au terme de celles-ci, si nous sommes toujours formellement en Ve République, l’exécutif n’est plus du tout, en pratique, dans la position dominante voulue par les promoteurs de la Constitution.
Pour le comprendre, il importe de préciser les causes de cet affaiblissement sans précédent. Elles sont au nombre de trois.
Alors que le monde a radicalement changé au cours des trente dernières années, nous avons pour l’essentiel conservé nos outils et nos modes d’action publique hérités d’un autre temps, et donc conçus pour traiter d’autres problèmes. Quelques exemples : Pôle emploi est-il l’outil adapté aux chômeurs d’aujourd’hui ? Nos forces de sécurité sont-elles formées et organisées pour répondre aux nouvelles formes de la délinquance ? Ou encore, notre porte-avions est-il l’instrument pertinent pour les conflits du XXIe siècle ? La première faiblesse de l’exécutif, c’est de ne plus disposer des outils adéquats pour une action publique efficace.
La deuxième tient à l’évolution du débat public. Jusqu’aux années Mitterrand, l’accès aux médias et à la force de frappe qui en résulte est réservé à l’État et à quelques grandes organisations. Or depuis quelques années, avec l’explosion des médias et d’internet, ce sont toutes les composantes de la société qui ont soudain accès à cette médiatisation. Toute structure – un collectif, une organisation, un groupe de pression ou même une personnalité – peut s’organiser en « marque » et exercer, selon son réseau ou son habileté, une influence plus ou moins forte. Désormais, l’exécutif ne parle plus d’un lieu privilégié et se trouve en concurrence avec tous ces nouveaux intervenants.
Enfin – troisième faiblesse –, l’exécutif est maintenant lui-même divisé en marques.
Alors que sa vocation est de conduire une politique, il ne sait plus parler d’une seule voix. Chaque structure de l’État semble désormais poursuivre son propre but, en compétition avec d’autres structures étatiques. Ainsi, pour s’affirmer, le ministère de l’environnement doit impérativement entrer en conflit avec ceux de l’industrie et de l’agriculture.
Ces trois tournants des années quatre-vingt-dix modifient complètement la donne institutionnelle. On comprend en effet que, telle qu’elle prospère depuis des années, notre suractivité législative renforce les marques ou les lobbies, au détriment de l’action publique d’intérêt général. Ainsi, plus nous légiférons, plus nous consolidons des intérêts catégoriels. Dans cette situation, la question traditionnelle du rééquilibrage des pouvoirs n’a plus grand sens.
Car peu importe, en vérité, que les avancées des corporatismes soient portées par l’exécutif ou par le législatif. La question n’est plus de renforcer le législatif, mais de casser cette mécanique hors de contrôle qui affaiblit globalement tous les pouvoirs, législatif comme exécutif.
Car si l’affaiblissement du pouvoir n’est pas un drame en soi, les conséquences qui en découlent sont, elles, inquiétantes. Depuis vingt ans, sous la pression des lobbies, notre ardeur législative n’a eu d’autre effet que d’accentuer l’impuissance publique et le mépris de nos concitoyens. Par ce processus vicieux la loi du plus fort – médiatiquement – est en train de devenir insidieusement la loi officielle. Telle est la véritable cause des tensions sociales que nous voyons partout progresser. Colère des marques qui en veulent toujours plus ; colère également de tous ceux qui se sentent oubliés.
On le voit, la piste de la rénovation institutionnelle est séduisante mais reste très théorique et coupée de l’exercice du pouvoir. Le malaise parlementaire croissant n’est pas plus dû à un déséquilibre institutionnel qu’à un problème d’image ; c’est un problème de fond – pas abstrait, mais extrêmement pratique. La question peut se formuler assez simplement : à quoi peut donc servir le Parlement dans le contexte d’impuissance publique que nous venons de décrire ? Car il est certain qu’un Parlement éventuellement renforcé par rapport à l’exécutif ne serait pas davantage capable que ce dernier de résister aux corporatismes qui ont envahi tout l’espace public.
Et c’est ici, mes chers collègues, que nous retrouvons cette loi de règlement et la fonction de contrôle dont nous disposons et que nous exerçons si mal et si peu.
Quel paradoxe ! L’essentiel de l’activité de notre assemblée est organisé pour et autour de la production législative, alors que c’est elle qui, année après année, nous décrédibilise. À l’inverse, la place accordée au contrôle demeure extrêmement marginale, en dépit de quelques efforts ponctuels, alors que c’est lui qui peut permettre à l’Assemblée de retrouver un rôle valorisant.
Mais il est important de préciser la nature du contrôle à exercer. Il ne s’agit pas d’un contrôle technique ou financier. L’Assemblée n’a pas à doublonner les différents corps d’inspection ou la Cour des comptes.
Il ne s’agit pas plus d’un contrôle politique. Trop souvent le contrôle est en effet utilisé par l’opposition comme un moyen de mettre en difficulté le Gouvernement.
Le contrôle doit se situer à un autre niveau, celui de l’action publique. Au fond, il s’agit de procéder à l’examen des missions de l’État – examen d’ailleurs prévu initialement par la LOLF, mais jamais réellement effectué – et vérifier que les objectifs de l’action publique sont clairs et le mode d’action adapté. L’administration ne peut pas faire ce travail sur elle-même. Quant à l’exécutif et aux ministres, ils sont les plus mal placés pour entreprendre cette tâche. Imagine-t-on un ministre du travail s’interrogeant sur la pertinence de Pôle emploi ? Un ministre de l’intérieur s’étonnant de l’organisation archaïque et corporatiste de nos forces de sécurité ? Un ministre de la santé faisant part de sa perplexité face à l’organisation des urgences ? Et l’on peut également se poser des questions sur les fédérations sportives ou les ordres professionnels.
Toutes ces questions ne sont jamais formulées au niveau politique. Elles sont abordées sous un angle prétendument technique, qui masque en réalité des intérêts particuliers. Il appartient donc aux députés d’ouvrir ces débats en réintroduisant des enjeux d’intérêt général. C’est en tant que parlementaires que nous devons le faire, car nous sommes des parlementaires avant d’être membres de la majorité ou de l’opposition. L’important n’est plus de soutenir ou de critiquer le Gouvernement mais de dire simplement les choses.
En se livrant à ce travail de contrôle de l’action publique, lors de la loi de règlement ou à toute autre occasion, les députés pourront enclencher un processus inédit.
Trois effets bénéfiques sont attendus.
En posant des questions que les gouvernements et les corporatismes évitent soigneusement, les députés font écho à l’inquiétude des Français. Depuis vingt ans en effet, le discours lénifiant de l’exécutif sur le retour de la croissance, alors que l’impuissance publique devient évidente, décrédibilise chaque jour la parole publique. En indiquant tous les dysfonctionnements, le député acquiert une nouvelle valeur. Il cesse d’être vu comme un représentant de partis aujourd’hui discrédités pour redevenir un représentant du peuple – pour utiliser la langue d’aujourd’hui, on dira un « lanceur d’alerte ». Nul besoin alors d’amendement démagogique pour retenir l’attention. Nul besoin non plus de fausse proximité : les députés sont à nouveau écoutés, tout simplement parce que leurs questions audacieuses recoupent les préoccupations des Français.
Deuxième effet bénéfique : face à ces questions d’intérêt général, les marques ou lobbies qui monopolisent le débat politique depuis des années se trouvent dévoilés et déstabilisés. La transparence doit être demandée à ces lobbies.
D’où le troisième effet bénéfique. Les gouvernements, jusqu’à présent pris en otage par la pression continuelle de ces lobbies tout-puissants – on appelle cela l’actualité –, se trouvent à nouveau encouragés à engager de véritables changements. Ils sont incités à concevoir, enfin, l’action publique efficace adaptée à notre époque. Ils le peuvent, parce que les questions des parlementaires desserrent la pression des lobbies et suscitent une attente sur laquelle il est possible de s’appuyer.
Le contrôle n’est pas une nouvelle façon d’alimenter le processus législatif. C’est un moyen pour sortir de l’immobilisme actuel en ouvrant des débats aujourd’hui impossibles. On sort du traditionnel débat institutionnel aujourd’hui dépassé.
Il ne s’agit plus de renforcer le législatif au détriment de l’exécutif, ou l’inverse. En se saisissant pleinement de son pouvoir de contrôle, le Parlement retrouve un rôle majeur. Il redevient crédible dans l’opinion tout en aidant le Gouvernement à s’engager dans une nécessaire reconstruction de l’action publique.
Aussi, sa force retrouvée n’est pas une menace mais un soutien pour l’exécutif. Dans cet esprit, il serait insuffisant de se contenter de renforcer notre fonction de contrôle, comme tout le monde le demande désormais. Il faut en effet aller beaucoup plus loin : c’est autour de cette mission de contrôle, et non plus autour de la mission législative que nous devons imaginer et bâtir le Parlement de demain.
Mes chers collègues, comme les frondeurs, nous ne supportons plus le rôle ingrat de godillot auquel nous sommes réduits – il y a des godillots de la majorité, mais il y en a aussi de l’opposition –, un rôle qui n’est valorisant que lorsque l’exécutif procède à d’ambitieuses réformes, ce qui ne s’est pas vu depuis longtemps ; un rôle très humiliant dans le train-train quotidien. Mais, à la différence des frondeurs, je ne crois pas que nous valorisons notre rôle par des initiatives législatives. Au contraire, nous risquons d’ajouter encore de la confusion à la confusion.
Mes chers collègues, il est pénible de le reconnaître : le Parlement est davantage victime de sa propre routine que du déséquilibre institutionnel entre le législatif et l’exécutif. Mais il peut s’éveiller demain ; il le peut sans demander l’autorisation à personne, car il n’a pas à quémander de nouveaux droits auprès de l’exécutif. Il lui suffit de le vouloir.
Pour cela, il n’a qu’à se saisir pleinement de sa mission de contrôle qu’il dédaigne aujourd’hui. C’est par ce nouvel exercice du pouvoir que le Parlement retrouve un rôle positif et redonne des marges de manoeuvre à un exécutif aujourd’hui tétanisé. Le voulons-nous ? Le voulez-vous, mes chers collègues ?
Tel est le sens de cette motion de renvoi en commission. Je ne vous propose pas de vous prononcer sur l’action du Gouvernement. En votant contre, vous signifiez que vous vous accommodez de la pratique parlementaire actuelle. En votant pour, vous indiquerez qu’il est urgent de changer cette pratique défaillante en mettant au coeur de notre travail notre fonction de contrôle.
Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.
Monsieur le député, il est peu courant que le ministre s’exprime lors d’une motion de renvoi, qui concerne plus la méthode et le travail du Parlement. Je voudrais juste faire quelques remarques, et aussi en profiter, vous le constaterez, pour répondre à un certain nombre d’interventions précédentes.
Tout d’abord, je tiens à vous assurer de l’ouverture du Gouvernement quant à la proposition d’une nouvelle méthode de travail, d’analyse, de rétrospective sur l’exécution de l’année précédente. D’ailleurs, je crois que votre commission des finances a commencé à le faire, puisqu’elle a eu l’occasion de travailler sur plusieurs programmes – notamment sur la culture, l’enseignement supérieur et la police. Lors de ces auditions, vous avez sollicité la présence de membres de la direction du budget, qui ont bien sûr été mis à votre disposition. Régulièrement, nous sommes saisis de demandes, aussi bien des rapporteurs spéciaux que du président de la commission ou de la rapporteure générale.
Bien entendu, le Gouvernement est ouvert à toute forme d’exercice de votre droit de contrôle – car c’est bien ce que vous appelez de vos voeux.
Pour le reste, je laisserai les parlementaires se prononcer sur la pertinence de cette motion de renvoi sur le projet de loi de règlement qui vous est soumis aujourd’hui.
Chacun aura compris que vous souhaitiez, et c’est tout à votre honneur, développer un certain nombre de thèmes qui vous sont chers et sur lesquels, à titre personnel, nous avons déjà eu l’occasion d’échanger.
Je veux profiter de mon temps de parole pour répondre à un certain nombre d’interpellations excessives que vous m’avez adressées, monsieur le président de la commission. Vous avez parlé de « gestion calamiteuse ». S’il vous plaît, faites preuve d’un peu de modestie au regard d’un certain nombre de lois de règlement qui nous ont déjà été présentées dans cette assemblée, souvent par vous-même, et où le déficit ne s’élevait pas à 4 %, mais quasiment au double !
Et nous, nous ne subissons pas la crise ? Quand cela va mieux, vous dites que nous n’y sommes pour rien : nous profitons simplement de la conjonction positive des astres.
Et quand la situation est mauvaise pour vous, c’est à cause de la crise.
L’histoire jugera, si j’ose dire. Les électeurs aussi, d’ailleurs, et ils ont déjà eu l’occasion de le faire. Un peu de modestie, monsieur le président de la commission !
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains.
Vous avez parlé de « gestion calamiteuse ». Quand la dépense publique n’augmente que de 0,9 %, alors qu’elle augmentait de 3,5 % en moyenne sur cinq ans lorsque vous étiez aux responsabilités, il faut tout de même reconnaître – vous l’avez un peu fait – qu’en termes de maîtrise de la dépense, on a rarement vu mieux ces dernières années. Vous savez vous-même que ce n’est pas facile.
Vous dites que c’est la première fois que l’on parle de questions budgétaires depuis six mois dans cet hémicycle.
Vous allez être gâté, comblé, puisque nous le ferons deux fois cette semaine : aujourd’hui, puis jeudi prochain.
Depuis le début de l’année, j’ai eu l’occasion de m’exprimer à au moins trois reprises devant votre commission. Je crois n’avoir jamais refusé de me rendre devant la commission des finances lorsque vous me sollicitiez.
J’entends bien le refrain habituel : vous réclamez une loi de finances rectificative. En la matière, vous avez été les champions : l’année où le déficit public a été le plus élevé, vous avez présenté trois lois de finances rectificatives.
Comme s’il suffisait d’adopter une loi de finances rectificative pour moins dépenser… Pour cela, il n’y a qu’une chose à faire : ne pas dépasser l’autorisation de dépenses accordée par le Parlement. Il n’y a pas besoin d’adopter une loi. Une loi de finances rectificative est nécessaire dans un seul cas, lorsqu’il s’agit de prévoir des recettes supplémentaires au moyen de mesures nouvelles. Ce n’est pas l’intention du Gouvernement. Il n’y aura pas de mesures fiscales : je l’ai dit, je le répète, je le confirme.
Quant à la prise en compte des PIA dans les dépenses exceptionnelles, vous l’avez fait vous-mêmes ! C’est l’usage, la norme, la pratique, l’esprit et la lettre de la LOLF. C’est d’ailleurs ce que fait la Commission européenne lorsqu’elle étudie la présentation de notre trajectoire budgétaire. Nous n’avons donc rien inventé : nous avons repris les pratiques et la norme, comme l’a d’ailleurs expliqué avec beaucoup de précision la rapporteure générale.
Vous avez parlé des taux d’intérêt comme s’ils étaient une sorte de drogue anesthésiante. Je vais donc vous rappeler une nouvelle fois les taux d’intérêt prévisionnels sur lesquels repose notre trajectoire de finances publiques – vous les connaissez, puisqu’ils figurent dans tous les documents que nous vous avons transmis.
Pour 2015, nous avons prévu des taux d’intérêt de 1,2 %. Depuis le début de l’année, alors même que nous avons réalisé plus de la moitié des émissions de l’année, nous sommes très largement en dessous de ce niveau. Pour 2016, nous avons prévu des taux d’intérêt de 2,1 %, niveau qui n’a pas été atteint depuis plusieurs années. Nous montons à 3 % pour 2017 et à 3,5 % pour 2018.
Je vais vous faire une confidence. Dans le cadre de débats internes au Gouvernement, certains disent que nos prévisions sont beaucoup trop prudentes, et que des prévisions un peu moins pessimistes nous permettraient peut-être de trouver un peu de marges de manoeuvre. Or nous conservons des marges de précaution – de couverture, si je puis dire –, car nous ne sommes jamais à l’abri d’un accident sur les marchés, ou de mouvements brutaux, qui peuvent être ponctuels ou plus durables.
Nous sommes à peu près tous certains que les taux d’intérêt ne resteront pas indéfiniment aussi bas qu’ils le sont aujourd’hui. Cela dit, les chiffres que je viens de donner montrent que le Gouvernement ne considère pas que le sujet est « anesthésié », mais qu’il doit faire l’objet d’une attention de tous les jours. Cette préoccupation est légitime, mais il était bon de remettre les pendules à l’heure.
Vous avez également évoqué des méthodes de calcul de prévisions de recettes qui seraient opaques, mal définies, imprécises, mal transmises… Tout est dans les documents qui vous ont été communiqués. Dans le tome I du rapport d’évaluation des voies et moyens, sont précisés les taux d’élasticité et l’ensemble des données dont vous avez parlé. Dans le rapport économique, social et financier figurent la prévision des recettes publiques, toutes administrations publiques confondues, et tous les chiffres que vous avez demandés.
Par ailleurs, vous êtes président de la commission des finances. Si vous m’interrogez sur un certain nombre de détails qui ne figureraient pas dans les documents, je me ferai une obligation de vous répondre dans les meilleurs délais.
La prévision est un exercice difficile – l’histoire budgétaire de ces dernières années nous l’a beaucoup démontré. Quand nos prévisions sont supérieures à ce que nous constatons, on nous trouve trop optimistes. Dans le cas contraire, on nous trouve trop prudents. C’est toujours facile de refaire l’histoire !
Nous avions prévu, dès la loi de finances initiale, une augmentation du déficit de l’État. Cette augmentation a été constatée, ni plus, ni moins, avec un décalage. Cependant, toutes administrations publiques confondues, le déficit a bel et bien baissé, puisqu’il s’établit finalement à 4 %. Or, à l’époque, la Commission européenne avait prévu un déficit de 4,3 %.
Je ne dis pas que tout est idéal, merveilleux, que tout est achevé, mais je récuse l’accusation de « gestion calamiteuse ». La conjoncture n’est évidemment pas indépendante de la politique que nous conduisons. Pour autant, elle n’est pas soumise à ces seuls facteurs : le contexte international a évidemment compté, et il comptera encore. Vous ne pouvez pas dire que, quand cela va mal, c’est uniquement la faute du Gouvernement,…
…et que quand cela va mieux, c’est uniquement grâce à la conjoncture extérieure.
Voilà quelques éléments que je souhaitais aborder. Il y en aura d’autres, et j’interviendrai certainement à la fin de la discussion générale.
Monsieur Cornut-Gentille, vous avez dressé un tableau et présenté des perspectives qui concernent beaucoup le fonctionnement du Parlement, mais je vous redis la disponibilité du Gouvernement pour aller dans le sens des propositions que vous avez faites.

Au titre des explications de vote, la parole est à M. Éric Alauzet, pour le groupe écologiste.

Les réflexions de notre collègue M. Cornut-Gentille étaient très intéressantes. Je ferai deux observations sur le fond et une sur la forme.
Sur le fond, il est évident que notre Parlement légifère beaucoup trop et ne contrôle pas assez. Cela a été dit et redit. Je ne sais pas quels moyens on trouvera pour changer de braquet. Nous, députés, avons une sorte d’obsession, sans doute pour nous faire valoir, qui consiste à multiplier les amendements parce que nous ne sommes pas capables d’exercer notre mission de contrôle. Nous compensons cette carence en votant toujours plus de lois, qui s’accumulent et se complexifient, alors que nous aurions plus que jamais besoin d’alléger la législation, de faire du nettoyage et, pour ce faire, d’évaluer l’efficience des politiques publiques. Oui au contrôle afin de moins légiférer !
Oui, aussi, à la modernisation de la vie publique. Il faut sans doute faire plus de place au Parlement. Mais je ne voudrais pas que nous nous racontions des histoires : plus cela va mal, plus on dit qu’en rénovant la méthode, on trouvera des solutions. Non ! Nous ne trouverons des solutions que si nous faisons de bonnes propositions. Même si je la souhaite, comme vous, ce n’est pas la réforme institutionnelle qui permettra de résoudre la crise profonde que vit non seulement la France, mais le monde entier. Ne nous racontons donc pas d’histoire en disant que la VIe République réglera nos problèmes économiques.
Sur la forme, comme l’a dit M. le secrétaire d’État, le sujet évoqué par M. Cornut-Gentille est intéressant mais n’a pas de rapport avec l’objet de notre discussion. Je ne pourrai donc pas soutenir cette motion de renvoi en commission.

La parole est à M. Christophe Caresche, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.

J’ai, moi aussi, écouté avec beaucoup d’attention M. Cornut-Gentille, qui a d’ailleurs eu l’occasion de développer ces réflexions dans un livre très intéressant qu’il vient de publier. Si M. Cornut-Gentille a exposé un certain nombre de pistes que je trouve intéressantes, son intervention est plutôt liée au fonctionnement de l’Assemblée et à la crise de la représentation : elle ne portait pas directement sur le sujet dont nous discutons, à savoir le budget 2014.
Certes, comme l’a dit M. le secrétaire d’État, des améliorations sont toujours possibles. Toutefois, l’exécution de ce budget est conforme à ce qui avait été voté en loi de finances, ce qui n’est pas si fréquent dans notre histoire récente ! Si les prévisions initiales ont effectivement dû être rectifiées, à cause d’un problème de croissance qui n’avait pas été anticipé, le Gouvernement a essayé d’exécuter le budget 2014 de manière sincère. C’est cela qu’il nous revient d’examiner aujourd’hui, et je pense que nous devons lui en donner quitus.
La motion de renvoi en commission, mise aux voix, n’est pas adoptée.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, ce projet de loi de règlement est assurément le constat de l’échec de la politique menée par la majorité depuis son arrivée au pouvoir. Il met aussi en lumière un certain nombre d’inexactitudes exprimées par le Gouvernement sur les comptes publics.
D’abord, monsieur le secrétaire d’État, vous vous félicitez de maîtriser la dépense publique. Pourtant, alors même que vous aviez promis un effort de 15 milliards d’euros pour l’année 2014, la dépense publique a bel et bien continué d’augmenter. En effet, vous avez substitué à la dépense budgétaire des crédits d’impôts, qui ne sont pas comptabilisés comme tels mais qui représentent, dans les faits, une dépense de l’État et doivent donc bien évidemment être financés. C’est ainsi qu’en 2014, la dépense publique totale a continué d’augmenter deux fois plus vite que le produit intérieur brut, comme en 2013.
Les chiffres sont têtus et très éloquents. En 2013, la dépense publique a progressé de 1,6 point de PIB, alors que la croissance du PIB en valeur n’était que de 0,8 %. En 2014, le même phénomène s’est produit : la dépense publique a crû en volume de 1,8 point de PIB, alors que le PIB n’a progressé que de 1,1 %. Loin de diminuer, comme vous le prétendez, la dépense publique a donc légèrement augmenté en volume. En valeur, vous n’avez fait que freiner la hausse de la dépense publique, effort qui ne peut certes être nié, mais qui reste totalement insuffisant au regard de la situation de nos finances publiques.
La Cour des comptes a pourtant indiqué que la France se plaçait au plus haut niveau de dépenses de l’OCDE, sans que, selon son président, Didier Migaud, la qualité des services publics ne soit forcément à la hauteur.
La raison est simple : depuis le début du quinquennat, vous avez refusé obstinément de mettre en place les réformes structurelles nécessaires à la lutte contre le déficit et favorables à la reprise économique.
La réforme de l’État et des collectivités territoriales, la réforme de la protection sociale et de la santé, la réforme du paritarisme, la transition écologique, la valorisation de la ressource humaine de notre nation sont autant de chantiers qu’il est urgent de lancer et que vous avez refusé de prendre à bras-le-corps. Seules ces réformes seraient à même d’endiguer la hausse de la dépense publique et de conduire à de véritables économies, supportables par tous et fructueuses sur le long terme.
Pour ne prendre qu’un exemple, je tiens à rappeler que la révision générale des politiques publiques mise en place par la précédente majorité avait permis, sur la période 2009-2012, de dégager près de 12 milliards d’euros de réduction de dépenses. Le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux avait conduit à une baisse de 3 % des effectifs des services de l’État, soit 30 000 postes par an.
À son arrivée au pouvoir, le Gouvernement a supprimé la RGPP, qu’il avait tant critiquée, et promis à sa majorité une stabilisation des effectifs de la fonction publique. Or – nous vous l’avons dit et répété –, il est impossible de réaliser des économies sans baisser les effectifs, étant donné que les dépenses de personnel de l’État représentent près de 42 % de ses dépenses nettes. C’est pourquoi nous avions déploré que le Gouvernement refuse de poursuivre cet effort de modernisation de l’État.
Toutefois, force est aujourd’hui de constater que la volonté affichée de stabiliser les effectifs ne s’est pas traduite dans les faits. Ainsi, par rapport aux plafonds fixés en loi de finances, les effectifs de la fonction publique ont baissé de plus de 46 000 postes en 2013 et de près de 49 000 postes en 2014.
Nous saluons la prise de conscience du Gouvernement, tout en déplorant le décalage immense entre son discours et ses actes. Si la baisse des effectifs est en effet nécessaire, la transparence du Gouvernement sur la politique l’est tout autant.
Il en est de même en ce qui concerne les prélèvements obligatoires. Le Gouvernement a communiqué à outrance sur leur baisse, afin de tenter de calmer le ras-le-bol fiscal de nos concitoyens, assommés d’impôts depuis le début du quinquennat.
Toutefois, les chiffres, encore une fois, sont têtus et ne trompent pas. Ainsi, le taux de prélèvement obligatoire est passé de 44,7 % en 2013 à 44,9 % en 2014, soit une augmentation de 4 milliards d’euros de la pression fiscale.
Tout comme pour la dépense publique, le Gouvernement ne procède pas à une baisse des prélèvements obligatoires, mais simplement à un freinage de leur hausse.
Quant au déficit, il demeure à un niveau particulièrement élevé, bien au-delà de celui de nos voisins européens. Rappelons que dans son engagement numéro 9, le candidat Hollande promettait de le ramener à 3 % en 2013. Or loin de se rapprocher de cet objectif, le déficit n’a diminué que de manière très marginale, passant de 4,1 % en 2013 à 4 % en 2014.
En outre, cette légère baisse du déficit global est due, pour la majeure partie, aux collectivités locales que vous avez mises à la diète et dont les investissements ont chuté de manière dramatique, conséquence certes du cycle électoral, mais aussi et surtout de la baisse des dotations de l’État. Cette baisse des investissements pèse sur la croissance et le redémarrage économique. Nos entreprises, que je rencontre régulièrement, comme vous, sont étouffées par cette baisse de la demande globale.
Pendant que les collectivités se serrent la ceinture, que les ménages continuent d’être matraqués, le déficit de l’État, lui, a augmenté en 2014, passant de 3,6 % à 3,8 %.
Nous ne pouvons que nous élever contre cette méthode qui consiste pour l’État à se contenter de demander des efforts considérables aux autres, tout en s’affranchissant dans le même temps de réduire son propre déficit.
C’est également la crédibilité de la France qui est mise à mal auprès de nos partenaires européens, et cela alors même que la plupart de nos voisins ont fait des efforts considérables afin de respecter les objectifs communs.
Enfin, alors que le Gouvernement tablait initialement sur une croissance de 1 %, celle-ci n’a été que de 0,2 % en 2014. Or selon l’INSEE, et vous le savez pertinemment, l’inversion de la courbe du chômage nécessiterait une croissance comprise entre 1 % et 2 %.
En conséquence, et malgré toutes les promesses présidentielles, le chômage a continué de progresser en 2014, et ne devrait commencer à baisser, au mieux, qu’à partir de 2017.
Mes chers collègues, après l’échec qu’a constitué l’année 2013, le groupe UDI espérait que le pacte de responsabilité et de solidarité constitue une opportunité de redressement pour notre pays afin que l’année 2014 soit celle du retour de la croissance, de l’emploi et, surtout, de la confiance. Il n’en a rien été et vous êtes aujourd’hui face à un constat d’échec.
Nous déplorons que le Gouvernement, plutôt que de reconnaître le dérapage des comptes de l’État en 2014 et de tenir un discours de vérité aux Françaises et aux Français, tente de dissimuler cette réalité derrière des artifices comptables.
Tout comme le groupe UDI, la Cour des comptes appelle de ses voeux des économies « structurelles significatives et pérennes ».
Votre refus de les engager et de mener une action courageuse au service de la France empêchera toute relance durable de la croissance, et ce malgré la conjoncture internationale particulièrement favorable. C’est la raison pour laquelle le groupe UDI votera contre ce projet de loi de règlement des comptes de l’année 2014.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, voici venu le moment de l’analyse politique de la loi de finances pour 2014 au regard de l’exécution du budget qui nous est présentée par le Gouvernement.
Celle-ci se caractérise tout à la fois par des engagements tenus et un excès d’optimisme, partagé, au-delà du Gouvernement, par de nombreux analystes financiers. Cela ne serait pas grave s’il ne s’agissait que de quelques exercices budgétaires. Le problème est que cet optimisme sévit depuis trente-cinq ans et qu’il est en grande partie responsable des déséquilibres auxquels nous devons faire face. J’observe cependant qu’il se tempère au fil des ans, au moins depuis 2012 – année depuis laquelle je siège dans cet hémicycle.
Ces deux caractéristiques se vérifient à la lumière des chiffres les plus marquants des comptes du budget 2014.
S’agissant du respect des engagements, l’évolution de la dépense publique a été conforme aux annonces faites en loi de finances, soit 0,9 %.
Pour ce qui est de l’excès d’optimisme, une fois encore, la prévision de croissance a été bien au-dessus de la réalité. La conséquence immédiate aura été une moindre recette fiscale, à hauteur de 9,7 milliards d’euros, ce qui pèse bien entendu sur la trajectoire de réduction des déficits publics.
Encore faudrait-il être en mesure d’indiquer la part de moindres recettes liées à la faible croissance et celle qui pourrait être due à d’autres mécanismes, telle la modification du comportement des agents économiques pour éviter l’impôt. Sur ce point, je rejoins la question régulièrement posée par le président de la commission des finances, Gilles Carrez. J’y reviendrai ultérieurement.
Bref, avec des recettes moindres, la réduction des déficits ne peut pas être au niveau attendu. À cet égard, il n’est pas inutile de mettre en regard ce manque à gagner fiscal de 9,7 milliards d’euros avec les dépenses fiscales votées en loi de finances. Je pense en particulier au CICE, à l’origine d’une perte de 6,5 milliards d’euros, et à l’allégement fiscal pour 1,3 milliard d’euros pour les ménages les plus modestes. Nous sommes à peu près dans les mêmes valeurs : 8 milliards d’un côté, 9,7 milliards de l’autre.
Alors que la prévision de déficit était de 3,6 % en loi de finances initiale, ce taux a été constamment revu à la hausse au fur et à mesure que la situation économique ne se redressait pas pour culminer dans les estimations à 4,4 %. Ce qui aurait constitué un très mauvais signal en comparaison du déficit de 2013, arrêté à 4,1 %. Heureusement, quelques ajustements budgétaires et un léger redémarrage de l’activité fin 2014 auront permis de passer juste en dessous de la barre des 4,1 % pour terminer à 4 % : bref, pour sauver la face.
Cela dit, il faut bien prendre en considération que les avantages fiscaux consentis aux agents économiques – 6,5 milliards d’euros aux entreprises au titre du CICE en dépenses nettes et 1,3 milliard d’euros aux ménages par le biais du pacte de solidarité –, tout en marquant une totale rupture avec la logique fiscale qui avait prévalu depuis les années 2010, ont privé l’État d’une recette équivalente aux moindres rentrées fiscales. Autrement dit, sans les baisses d’impôts – certes prises en compte en loi de finances initiale, mais uniquement pour le CICE –, le déficit serait, pour la loi de règlement 2014, très proche des 3,6 % attendus.
À l’inverse, les recettes liées à la lutte contre l’évasion fiscale des particuliers résultant de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière sont venues compenser pour partie ces dépenses fiscales, ce qui permet au passage de souligner la réussite de cette politique qui aura précisément permis, dès 2014, de financer la totalité de la baisse d’impôt – 1,9 milliard d’euros de recettes s’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, 1,3 milliard d’euros s’agissant des ménages – pour 4,2 millions de ménages modestes par la réintégration dans l’assiette fiscale de revenus détournés par les personnes les plus argentées.
Finalement, si 2014 marque une sorte de pause dans la réduction des déficits budgétaires, c’est avant tout le résultat d’un choix politique consistant à ne pas peser trop fortement sur l’activité économique. Mais il faut insister sur le fait que cette pause aura été le résultat non d’un relâchement dans l’objectif d’économies des dépenses publiques, mais d’un soutien aux entreprises et aux ménages.
Seule cette stratégie pouvait recueillir l’assentiment de l’Union européenne et permettre de repousser à 2017 l’objectif des 3 %. Il faut d’ailleurs expliquer à cette occasion, puisque l’on fait souvent le reproche au Président de la République et au Gouvernement de ne pas avoir renégocié le pacte de stabilité, que cela a néanmoins été réalisé – certes sournoisement –, puisque l’échéance de 2013 pour les 3 % a d’abord été repoussée à 2015, puis à 2017. Mais il ne faut pas le dire trop fort !
L’orthodoxie budgétaire de l’Union européenne aura donc conduit à biaiser pour ne surtout pas faiblir sur la trajectoire de baisse des dépenses publiques, quitte à lâcher du lest sur les recettes fiscales. L’optimisme en matière de recettes et de croissance a contribué à préparer cet ajustement s’agissant de l’inflexion de la trajectoire de la baisse des déficits publics.
Le Gouvernement aura tenu bon sur ses objectifs de baisse de dépenses même si le ralentissement économique et la baisse de l’inflation l’auront aidé. C’est le revers positif de la médaille qui, sur l’autre face, réduit les rentrées fiscales.
Pour autant, la baisse des dépenses publiques peut avoir un effet récessif sur l’activité et sur l’emploi. Il n’est pas certain que ce risque soit bien mesuré – sans doute pas par la droite parlementaire, qui propose constamment d’amplifier les baisses de dépenses, à un niveau deux fois supérieur au processus en cours. Ce serait une folie absolue et le résultat d’un dogme qui consiste à penser que l’emploi privé est systématiquement source de richesse quand l’emploi public ne serait qu’une charge.
Si l’on tente de mesurer l’impact direct des politiques publiques sur l’emploi, on observe un coût pour la collectivité des emplois aidés de 10 000 à 15 000 euros par an – emplois d’avenir, contrats de génération – et un coût se situant entre 70 000 à 100 000 euros pour l’emploi privé – CICE et autres dispositifs, tout en sachant que, pour les premiers, l’effet est précis et immédiat, alors que, pour les seconds, il est décalé et incertain.
Il ne s’agit pas dans mon propos de caricaturer tel ou tel dispositif, mais d’approcher le sujet avec le plus d’objectivité possible, sachant que ces chiffres doivent sans doute être modulés. A contrario, on ne connaît pas avec suffisamment de précision le coût en emplois de la baisse de la dépense publique. Monsieur le secrétaire d’État, il serait utile que la représentation nationale et peut-être même le Gouvernement puissent être mieux éclairés sur ce point.
Concernant la croissance – et je veux terminer sur ce point essentiel –, elle est toujours plus faible que prévu et qu’annoncé depuis trente-cinq ans. Elle conduit d’année en année à reproduire les mêmes déséquilibres budgétaires. En 2014, on constate 9,7 milliards d’euros de moindres recettes fiscales pour une moindre croissance de 0,7 % – 0,2 % au lieu de 0,9 %. En 2013, c’était environ 15 milliards d’euros de manque à gagner pour un déficit de croissance de 0,5 %, avec une croissance annoncée à 0,8 % et une croissance constatée à 0,3 %.
L’on pourrait constater le phénomène inverse en 2015, puisque la croissance sera sans doute un peu supérieure à ce qui a été annoncé et il sera alors particulièrement intéressant d’observer et surtout d’analyser la réalité des recettes fiscales au regard des prévisions. Dès lors, nous pourrons apporter un début de réponse à la question régulièrement posée par Gilles Carrez et que, pour ma part, je relaie aussi, qui est de savoir si, en dépit d’une croissance plus élevée, nous continuons à avoir des pertes fiscales par rapport à ce qui a été annoncé. Je parie que tel ne sera pas le cas. L’option avancée par Gilles Carrez ne représente sans doute qu’une petite partie de l’explication de ces moindres recettes fiscales.
Cette embellie – modeste – de la croissance nous fera du bien, surtout à l’emploi, mais nous devons rester lucides et ne pas retomber dans les travers habituels d’un optimisme systématiquement « douché » et démobilisateur quand vient le moment des bilans. En effet, nombre d’observateurs avisés nous prédisent une croissance de long terme plutôt molle, autour de 1 %, et il ne faudrait pas que le rebond de 2015-2016 nous conduise à une nouvelle illusion. Au demeurant, ces prévisions doivent nous conduire à relativiser et à repenser les notions de déficits structurel et conjoncturel. Comme je le dis souvent, quand le structurel devient conjoncturel, il y a un problème.
L’enjeu est bien de construire une société de l’activité et de l’emploi avec une croissance faible, sur la base de nouveaux indicateurs de richesse qui prennent réellement en compte le développement durable et les formes émergentes de l’économie.

Monsieur le secrétaire d’État, vous revenez de loin. Certes, depuis la fin 2008, la crise a affecté la plupart des pays de la zone euro, mais elle n’a guère été atténuée, en France, par la gestion des deux principaux ministres qui ont précédé votre arrivée à Bercy.
Sous le quinquennat précédent, la dette, publique a progressé au total de 600 milliards d’euros. Cette augmentation dénotant un grand laxisme s’est produite pour l’essentiel lorsque Mme Christine Lagarde était ministre de l’économie et des finances, de 2007 à 2011, mais celle-ci, devenue depuis lors directrice générale du FMI, adresse désormais remontrances et leçons de rigueur à chacun, toujours avec assurance, parfois avec arrogance.

De son côté, Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances de 2012 à 2014, n’a pas véritablement obtenu un succès éclatant dans la réduction du déficit public, mais depuis 2014, devenu commissaire européen aux affaires économiques, il se comporte en contempteur zélé d’une politique qu’il a lui-même conduite auparavant. Ainsi, en novembre 2014, l’ancien patron de Bercy devenu commissaire à la bonne conduite déclarait à propos du budget français pour 2015 : « La Commission européenne sera extrêmement vigilante ; le moment venu, elle n’hésitera pas à prendre ses responsabilités ».
Dans de telles circonstances, est-il indispensable de se transformer en censeur pointilleux, sourcilleux, vétilleux ?

Et, dans ces deux cas, ce changement d’attitude est-il très convenable ? La politique monétaire n’est pas un jeu de rôles où l’on adopterait des postures contraires selon les fonctions exercées.
Je rappellerai un seul fait : l’augmentation excessive des impôts dans le passé, solution de facilité face à la crise des finances publiques. Entre 2011 et 2012, les augmentations décidées par la précédente majorité ont été de 36,5 milliards d’euros. Pour 2012 et 2013, celle qu’a votée l’actuelle majorité a été de 33,4 milliards, auxquels s’ajoutent 3,7 milliards au titre de 2014, soit au total 73,6 milliards d’euros. Bien évidemment, cette flambée des impôts a contribué à freiner l’activité et à handicaper toute véritable reprise.
Désormais, en tout cas – et c’est un fait nouveau –, le Gouvernement a le mérite de mener enfin une politique équilibrée, qui concilie le sérieux budgétaire et les mesures en faveur de la croissance. La réduction du déficit public s’effectue à un rythme raisonnable, afin de ne pas empêcher une reprise de l’économie.
Comme l’a dit François Hollande au sommet de Milan sur l’emploi, « il faut ajuster le rythme des politiques budgétaires par rapport à l’enjeu de la croissance ». Au fond, l’exécutif suit désormais le précepte d’Alceste dans Le Misanthrope :
« La parfaite raison fuit toute extrémité,
Et veut que l’on soit sage avec sobriété. »
Merci pour cette sobriété !
L’examen de l’exécution du budget 2014 au moyen de cette loi de règlement confirme cette analyse.
Le déficit public nominal, qui était de 5,1 % en 2011, s’établit à 4 % en 2014 et devrait être ramené à 3,8 % en 2015, malgré un effort structurel que certains jugent limité – jugement qui n’est peut-être, cependant, que peu fondé.
Par ailleurs, après une hausse continue et importante depuis 2009, le taux des prélèvements obligatoires n’a que très faiblement progressé en 2014, où il s’établit à 44,9 % du PIB après 44,7 % en 2013. Cette gestion est conforme au principe qu’a toujours soutenu notre groupe dès 2012 : préférer la réduction de la dépense à l’augmentation des impôts et éviter l’overdose fiscale, qui pénalise notamment les classes moyennes et populaires et qui entrave la reprise.
Toutefois, cette gestion budgétaire « sérieuse », selon l’adjectif traditionnel, n’a pas encore conduit, en 2014, à des résultats économiques pleinement satisfaisants. La croissance n’a été que de 0,2 % en 2014, loin de la croissance moyenne de la zone euro, qui s’est établie à 0,9 % – sans même parler du Royaume-Uni, où elle est de 2,8 %.
Du reste, la croissance française pour 2015, qui devrait être de 1,2 % selon l’INSEE, semble due surtout à des facteurs exogènes, à savoir la forte baisse du prix du pétrole et des taux d’intérêt.
Deux autres points apparaissent assez préoccupants dans le bilan de cette année 2014.
D’abord, la dette des administrations publiques a continué à progresser à un rythme soutenu : elle atteint 2 037 milliards d’euros fin 2014, soit 95,6 % du PIB. Dans l’immédiat, la faiblesse des taux d’intérêt permet de contenir la charge de la dette. Toutefois, cette faiblesse exceptionnelle peut ne pas se maintenir, ce qui pourrait rendre notre dette difficilement soutenable sur le long terme.
Ensuite, l’investissement a marqué en 2014 un fort repli – de 0,6 point. Même en 2015, il reste relativement atone et tarde à repartir, même si l’on nous prédit de meilleurs résultats pour ce second semestre. L’investissement des entreprises devrait progresser, au mieux, de 1 % en 2015 et la reprise tient surtout à la consommation des ménages.
En fait, la croissance, prévue comme devant être encore faible pour 2015, avec un taux de 1,2 %, est une croissance sans emploi et sans investissement.
Loin de décroître, le chômage continue de progresser. Il concernait 3 496 400 demandeurs d’emploi de catégorie A à la fin de 2014 et en concerne 3 552 000 en mai 2015, soit 660 000 chômeurs de plus qu’en avril 2012.
Les deux objectifs principaux du ClCE – mis en oeuvre dès le 1er janvier 2013 et dont on ne dira jamais assez les mérites, ni surtout les défauts – et du pacte de responsabilité sont d’obtenir un effort accru des entreprises en matière d’emploi et d’investissement, en « contrepartie », pour employer un mot que ne supporte pas le MEDEF, des allégements d’impôts et de charges qui leur sont consentis et qui représentent une somme très considérable : 41 milliards d’euros en trois ans pour le CICE.
Est-il sûr que ces allégements soient réellement ou principalement utilisés pour l’emploi et l’investissement ? Actuellement, personne ne peut vraiment le dire, vu la lenteur et la vacuité des rapports d’évaluation émanant du comité de suivi issu de France Stratégie.
Mon groupe votera pour cette loi de règlement, mais il le fera en regrettant l’ignorance dans laquelle le Parlement est tenu quant à l’utilisation effective de 41 milliards d’argent public par les dirigeants d’entreprise. Ce défaut de transparence est très inhabituel dans le domaine budgétaire et il restreint les droits du Parlement. Cette érosion du contrôle parlementaire n’est jamais souhaitable.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, l’examen par notre assemblée des comptes de l’année écoulée se déroule aujourd’hui dans le contexte particulier d’un formidable élan démocratique de refus de l’oligarchie financière qui assène plan d’austérité sur plan d’austérité aux peuples européens, avec des résultats minables.
Le vote des Grecs est, en ce sens, une formidable bouffée d’oxygène pour toutes celles et tous ceux qui plaident pour une Europe de la solidarité, de la coopération et de la paix contre cette Europe des marchands et des marchandises.

Le peuple grec a donné une leçon à cette caste de financiers qui n’ont que le niveau du CAC 40 ou de la bourse de Francfort comme horizons.
Le peuple grec a dit non à des mesures qui ont fait tant de mal, avec des droits humains bafoués, des salaires et pensions des couches moyennes ou modestes rabotés de 25 % à 50 %, un accès aux soins mis en cause et des riches toujours plus riches.
Le peuple grec a dit non, car il est insupportable de voir M. Juncker, qui a organisé la fraude et l’évasion fiscales lorsqu’il était Premier ministre au Luxembourg, jouer les pères-la-vertu. Il est aussi insupportable de voir M. Draghi et la BCE se montrer inflexibles, alors même que l’actuel président de la BCE était responsable de Goldman Sachs en 2006 et a contribué à falsifier les comptes de l’État grec pour favoriser son entrée dans l’euro. Il est, enfin, encore plus insupportable de voir Mme Lagarde aussi intransigeante pour 1,6 milliard d’euros dus au FMI, alors qu’elle était si conciliante avec Bernard Tapie quand elle était ministre de M. Sarkozy.
Pourtant, la question de la dette grecque, comme celle du financement de son économie, n’est pas une question d’argent, mais une question politique.
Les Grecs ont fait confiance à un gouvernement et à un Premier ministre qui proposent d’emprunter un chemin différent de celui des libéraux, qu’ils soient conservateurs ou sociaux-libéraux : voilà qui fait désordre et risquerait de mettre à mal le petit monde de l’entre-soi maastrichtien et les fameux 3 % de déficit budgétaire.
Pourtant, depuis trente ans que la contre-révolution des libéraux est en route, qu’avons-nous en Europe ? Un chômage de masse endémique, avec un pic de plus de 5 millions de chômeurs en France qui marque l’échec de l’orientation actuelle, laquelle s’inscrit malheureusement dans la ligne de l’orientation précédente. Des inégalités qui ne cessent de se creuser partout en Europe, avec un taux de pauvreté inégalé en Allemagne, mais avec aussi des riches de plus en plus riches, comme le prouvent par exemple les études de M. Piketty. Une guerre économique destructrice, mortifère, avec un système de politiques à court terme qui crée des divisions entre les peuples et à l’intérieur des peuples, faisant peser un risque politique majeur sur le projet commun. Des dettes souveraines, enfin, qui ont explosé sous l’effet des pressions exercées par les plus fortunés pour diminuer leur contribution et de l’addiction aux marchés financiers.
Dans le même temps où la dette française a été multipliée par huit en trente ans, le patrimoine des 1 % les plus riches a été multiplié par dix, les deux chiffres s’établissant à un peu plus de 2 000 milliards d’euros. C’est éclairant !
Voilà les résultats des doctrines et des dogmes hérités de la révolution conservatrice de M. Reagan et de Mme Thatcher, qui ont mené à la déroute et continuent de conduire l’Europe dans le mur – mais la plupart des dirigeants européens s’y cramponnent, persuadés que ce n’est pas la doctrine qui a tort, mais la réalité qui se trompe.
La gouvernance par les traités alimente l’illusion d’une technicisation des choix politiques et explique sans doute pour une large part l’incompréhensible alignement des sociaux-démocrates, à l’échelle de l’Europe, sur la droite déflationniste et ultralibérale.
En France comme ailleurs en Europe, les politiques budgétaires restrictives n’ont pas produit les effets attendus : nombre de nos concitoyens ont vu leurs impôts augmenter, les prestations dont ils bénéficient diminuer, les salaires stagner. Rien n’a été fait pour les inciter à consommer et investir.
Dès lors, les entreprises restent, elles aussi, prudentes, malgré les cadeaux fiscaux qui s’accumulent avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et le pacte dit improprement « de responsabilité ». Les entreprises n’utilisent toujours pas ces cadeaux fiscaux pour investir et embaucher, mais pour baisser leurs prix ou, pour les plus grandes d’entre elles, rémunérer leurs actionnaires. Il faudra y revenir, car les 15 milliards d’euros qu’il reste à restituer pourraient servir enfin à conforter la demande, et non l’offre – j’ai cru lire cela dans certain programme politique.
La baisse des dépenses publiques et sociales accentue, de son côté, la stagnation. Toute reprise durable est aujourd’hui tuée dans l’oeuf. Il ne s’agit pas de pinailler sur les calculs de la Cour des comptes, sur l’opportunité d’intégrer ou de ne pas intégrer les programmes d’investissement d’avenir dans les déficits ou sur la question de savoir si le déficit supplémentaire pour l’État sera de 10,7 milliards ou de 5 milliard d’euros, compte non tenu des collectivités locales, dont l’endettement baisse parce que leur investissement s’assèche.
Au-delà des déficits, la dette continue de s’accroître et les recettes fiscales s’effondrent, car on tend à éteindre l’impôt sur les sociétés au moyen du CICE. En fait, c’est : « ceinture » pour les salariés, les retraités et les chômeurs, et « open bar » pour les milliardaires !
Il est un chiffre qui ne figure ni dans le rapport de la Cour des comptes ni dans le rapport parlementaire : c’est le nombre de milliardaires en euros que l’on trouve en France, passé de 45 en 2013 à 55 en 2014. Quant au patrimoine des cent plus grandes fortunes en France, il a atteint 320 milliards d’euros : le niveau de la dette grecque – comme c’est bizarre !
Les piètres résultats enregistrés sont emblématiques de la déshérence des politiques économiques et budgétaires à l’heure de l’austérité européenne. Notre politique budgétaire est ainsi contre-productive à la fois économiquement – on le voit avec l’explosion des chiffres du chômage et la croissance durablement anémique – et au regard de l’objectif principal qu’elle affiche. En réalité, elle empêche le désendettement public qu’elle est censée favoriser.
Cela n’empêche ni la Cour des comptes ni la Commission européenne de réclamer plus d’efforts et de continuer à promouvoir une diminution drastique des dépenses publiques et sociales.
Ce sont nos médecins de Molière modernes, si friands de saignées.
Face à cet échec, et en réponse aux exigences de la Commission européenne, qui exige des réductions de dépenses publiques et sociales, notamment dans le secteur de la Sécurité sociale et des collectivités locales, le chemin emprunté par le Gouvernement est malheureusement celui d’une austérité renforcée. Cela s’est traduit par l’annonce de 50 milliards d’économies d’ici à 2017. Et l’on nous promet plus de larmes encore, en accroissant l’assèchement des comptes sociaux et le dépeçage des collectivités locales.
Pourtant, la baisse des dotations de l’État est en train de faire des ravages dans certains territoires : fermetures d’équipements publics, restriction de l’accès à la culture et de sa diffusion, ou encore effondrement de l’investissement public local de près de 10 %, selon les données de la Cour des comptes. Ces évolutions auront des conséquences très négatives sur l’emploi dans le BTP et sur la cohésion sociale – qui plus est dans les territoires où le capital privé investit peu, comme c’est le cas dans les zones hors métropoles.
Monsieur le secrétaire d’État, les comptes du budget 2014 que vous nous présentez ne peuvent être lus et compris qu’à l’aune de ce qui s’est passé en Grèce, mais aussi de ce qui ne manquera pas de se produire en Espagne très bientôt.
La gauche européenne a aujourd’hui une grande responsabilité. Il faut cesser la course à l’échalote libérale à laquelle se livrent les sociaux-libéraux et les conservateurs : elle conduit aux pires régressions sociales.
Nous n’attendons rien d’une droite revancharde et d’une extrême droite haineuse qui, pour l’une, veut en finir avec notre modèle socio-économique, et pour l’autre, se complaît dans la division et la haine, qui sont le carburant de leur progression.
Monsieur le secrétaire d’État, la renégociation du traité de stabilité, de coordination et de gouvernance, qui n’a pas été engagée par le Président Hollande, fait cruellement défaut.
Il existe pourtant une fenêtre pour remettre en place une vraie Europe solidaire, redéfinir ses objectifs, réorienter la monnaie, permettre un véritable plan d’investissement vers la transition écologique, lancer le chantier de l’harmonisation fiscale, briser le scandale de l’évasion et de la fraude fiscales organisées par l’oligarchie financière, qui pèsent tant sur les budgets publics, entendre les peuples européens qui, du « non » français au TCE il y a dix ans, au « non » grec d’hier, n’en peuvent plus de cette Europe des financiers.
La social-démocratie européenne ne peut pas se contenter des déclarations de M. Dijsselbloem, ministre social-démocrate des finances néerlandais, inflexible partisan de l’austérité, ou de M. Schulz, président du Parlement européen, membre du SPD allemand, qui s’est prononcé pour la nomination d’un gouvernement de technocrates à la tête de la Grèce – on croit rêver !
Monsieur le secrétaire d’État, la France doit offrir une autre voie, celle de la contestation de la domination de la finance, pas seulement dans les mots, mais dans les actes. Il nous faut désormais avoir le courage de dire non au coup d’État financier permanent orchestré par les institutions telles que la BCE, le FMI ou la Commission européenne.
La dette est une chose trop importante pour qu’on la laisse aux seuls banquiers et financiers. C’est pourquoi nous vous invitons, comme nous l’avons fait il y a quelques semaines, à tout mettre en oeuvre pour que la France prenne l’initiative d’une grande conférence européenne sur la dette, réunissant gouvernements, associations, citoyens et parlementaires, afin de sortir de cette spirale, restructurer la dette en en effaçant une part et remettre l’Europe sur le seul chemin de l’espoir, celui de la démocratie, de la solidarité et de l’écologie !
Dans le même esprit, nous jugeons indispensable que le Parlement puisse débattre dans les prochains jours de l’avenir de l’Europe, à la lumière du vote grec de dimanche.
Dans la période qui vient, vous pourrez compter sur la détermination des députés Front de gauche. Nous ne nous résignerons jamais à voir le projet européen devenir la propriété d’une oligarchie financière, qui s’en sert allègrement, au risque de jeter les peuples les uns contre les autres.
Oui, monsieur le secrétaire d’État, en ces moments de crise, la France doit être à la hauteur, pour choisir le seul chemin qui vaille, celui de la solidarité, de la paix, de la coopération ; celui de l’humain, qui passe avant les marchés financiers.
Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, le projet de loi de règlement de l’exercice 2014 du budget de l’État, soumis aujourd’hui à notre discussion et à notre vote, est, au-delà de l’approbation formelle des résultats de l’exécution de l’année passée, l’occasion pour le Parlement d’exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles le Gouvernement a mis en oeuvre et respecté l’autorisation parlementaire en loi de finances.
C’est aussi le moment privilégié pour faire le point sur la trajectoire de redressement des comptes publics, celle des comptes de l’État bien sûr mais aussi celle de l’ensemble de nos finances publiques, dans la perspective du débat d’orientation budgétaire qui aura lieu ici jeudi.
S’agissant des comptes en eux-mêmes, et de leur approbation, ils ont été examinés et certifiés par la Cour des comptes – nous sommes d’ailleurs l’un des rares pays européens et de l’OCDE à disposer de comptes certifiés. L’acte de certification des comptes 2014, adopté par la Cour, fait état d’une levée d’un nombre important de réserves. Cela témoigne des progrès réalisés par les administrations, qu’il faut féliciter pour leur travail, en particulier celle placée sous votre autorité, monsieur le secrétaire d’État, la direction générale des finances publiques.
Au-delà de son aspect purement comptable, la fiabilisation des comptes qui en résulte et, surtout, la meilleure appréciation des engagements de l’État pour l’avenir sont des enjeux importants dans la stratégie de redressement des comptes publics que nous avons choisie, et pour la confiance que doivent avoir nos concitoyens dans la gestion de l’État.
Certes, la certification des comptes de l’État n’est pas l’objet central de notre débat, mais je veux souligner, en ma qualité d’ancien contre-rapporteur de cet acte, que nous devons nous intéresser davantage à ce travail très important mené depuis neuf ans. Il faudra que les administrations, le Gouvernement et le Parlement s’appuient sur cet exercice dont on ne parle pas assez, pour éclairer les choix de politiques publiques, comme pour améliorer la pertinence de la gestion publique.
Les comptes de l’État sont fidèles et sincères ; c’est la première raison pour laquelle le groupe socialiste les adoptera sans réserve.
L’autorisation parlementaire a été parfaitement respectée dans son exécution, ainsi que l’indique très précisément la rapporteure générale du budget dans son rapport.
La dépense est en effet inférieure de plus de 6 milliards d’euros à l’autorisation parlementaire et le plafond des emplois a été respecté. Cela traduit la grande rigueur du Gouvernement dans le pilotage infra-annuel de la dépense publique. Cette rigueur est essentielle, dans une période où il est indispensable de réduire les déficits publics et de stabiliser au plus vite l’évolution de la dette publique, qui est d’abord et essentiellement une dette de l’État.
Puisqu’il y a eu hier une petite poussée médiatique sur le thème des emplois de l’État non pourvus, je veux rappeler que le Parlement vote une autorisation de dépenser, qui n’est pas une obligation. C’est heureux, dans une période où les aléas de la conjoncture et de l’exécution obligent à une gestion infra-annuelle resserrée et adaptée à ces évolutions conjoncturelles.
La question n’est donc pas celle de la non-consommation de crédits et d’emplois en cours d’année ; elle est davantage de s’assurer que les choix d’exécution du Gouvernement et des administrations respectent les choix politiques explicites et sous-jacents de l’autorisation parlementaire, en clair, de s’assurer du respect des priorités politiques sur lesquelles nous nous sommes prononcés en loi de finances initiale.
De ce point de vue – le rapport établi par la rapporteure générale le montre excellemment –, les priorités de la loi de finances pour 2014 ont été globalement respectées. C’est une deuxième raison, pour nous, d’adopter ce projet de loi de règlement.
Il nous reste donc à examiner les résultats de la gestion 2014, à l’aune de la stratégie de redressement des comptes publics telle qu’elle a été décidée par notre assemblée.
Si j’ai bien compris, le débat semble s’orienter, de façon assez confuse, sur la question de savoir si le déficit de l’État est en réduction ou en augmentation.
L’opposition – qui a tant à se faire pardonner, au regard de l’inconséquence de sa gestion des finances publiques au cours des deux derniers quinquennats – s’appuie sur les travaux de la Cour des comptes et la façon dont cette dernière traite les dépenses du programme d’investissements d’avenir. Le président de la commission des finances nous a abandonnés, mais je répète ce que j’ai déjà eu l’occasion de dire en commission : j’indexe les énervements et les passions de M. Carrez, lorsqu’il dénonce à la tribune notre gestion, au remords qui est le sien d’avoir été rapporteur général du budget pendant dix ans, alors que le record historique d’accumulation de la dette, à hauteur de 1 000 milliards, était battu.
Cela n’empêche pas l’opposition de droite de mener systématiquement campagne contre les mesures prises par le Gouvernement – notamment la participation juste et légitime des collectivités locales à l’effort de redressement, à proportion de leur part dans la dépense publique – sans jamais dire, d’ailleurs, où se feraient les coupes austéritaires de 100 milliards d’euros qu’elle préconise.
Alors, disons les choses simplement : le déficit global des finances publiques qui, par définition, intègre tout, est en réduction en 2014 par rapport à 2013. Le déficit du budget de l’État, hors dotation du deuxième PIA, est également en réduction, de 75 à 73 milliards d’euros. Les normes en valeur et en volume, dont chacun s’accorde à reconnaître qu’elles ont été durcies en 2014, ont été respectées, même au-delà.
Au final, alors que la dépense publique augmentait en moyenne de 3,6 % par an sous les deux précédents quinquennats, elle n’aura augmenté en 2014 que de 0,9 %, soit une division par quatre en un demi-quinquennat. D’aucuns disent que ce n’est pas suffisant, mais c’est déjà bien !
Mieux encore, le déficit structurel, que nous avions laissé en 2002 à 4,2 % et que la droite avait amené en 2012 à 4,4 %, s’établit aujourd’hui à 2,1 %, son plus bas niveau depuis la fin des années 1990. Bref, en un demi-quinquennat, cette majorité parlementaire a effacé la gestion erratique des finances publique des deux quinquennats précédents.
Fallait-il aller plus vite ? Notre réponse est non, car cela aurait conduit à mener des politiques d’austérité, au coût économique et social élevé, qui auraient probablement affaibli notre pays, son industrie et sa croissance. Fallait-il aller moins vite ? Notre réponse est également non, car notre indépendance financière aurait été mise en cause. Chacun a bien compris que le redressement des finances publiques est d’abord une question de souveraineté.
Faut-il donc continuer ? Notre réponse est oui ; nous aurons l’occasion d’en débattre jeudi. Le choix de l’Assemblée d’un redressement des comptes publics dans la durée, dans le respect de nos priorités politiques et des engagements que nous avons pris en 2012 devant les Français, exige détermination, constance et cohérence.
C’est bien ce qu’expriment les comptes qui nous sont présentés aujourd’hui, et que le groupe socialiste votera. Dans la préparation du projet de loi de finances pour 2016, vous pouvez être assuré, monsieur le secrétaire d’État, que le groupe socialiste, dans un dialogue constant, soutiendra le Gouvernement dans cette stratégie de redressement des comptes publics. Celle-ci écarte résolument les politiques d’austérité auxquelles appelle l’opposition, tout comme le laisser-aller dont la droite a fait preuve lorsqu’elle était aux responsabilités.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale, mes chers collègues, il n’y a, dans notre position, cher collègue Lefebvre, aucune confusion : nous voterons contre ce projet de loi de règlement.
Cela est absolument justifié. Non pas que les gestions antérieures aient été en tous points remarquables. Pour ce qui me concerne, et pour ce qui concerne – je crois pouvoir le dire – le président de la commission des finances, alors rapporteur général, nous avons toujours eu la liberté et la capacité de formuler des critiques et de souligner les défauts des politiques budgétaires antérieures.
Reste que, s’agissant de l’exécution budgétaire 2014, la charge est lourde. Puisque l’on parle de confusion, autant partir d’éléments simples et factuels : les remarques de la Cour des comptes.
La Cour des comptes note que « la réduction du déficit budgétaire de l’État amorcée depuis 2010 a été interrompue en 2014 » et que « la dette de l’État continue à progresser à un rythme soutenu ».
La Cour des comptes prévient que « des risques pèsent sur les recettes fiscales, avec notamment une incertitude sur la montée en charge du CICE et les modalités de financement du pacte de responsabilité et de solidarité », modalités non assurées de manière pérenne. Elle souligne « l’augmentation de la dette de l’État envers les organismes de Sécurité sociale, qui est passée de 249 milliards d’euros fin 2013 à 368 milliards d’euros fin 2014 ». Elle dénonce aussi les sous-budgétisations pour 2015, qui « peuvent déjà être identifiées sur les missions Défense et Enseignement scolaire ».
Toujours pour la Cour des comptes, « l’abandon de l’écotaxe poids lourds pose la question du financement des investissements en matière de transport ». Monsieur le secrétaire d’État, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur l’addition sans cesse alourdie du fiasco de l’écotaxe poids lourds, ou plus exactement de sa gestion par le gouvernement actuel ?

Combien cette affaire aura-t-elle coûté aux contribuables ? 1 milliard d’euros ? Beaucoup plus ? C’est un sujet que vous connaissez en tant que secrétaire d’État chargé du budget, mais aussi pour son implantation géographique. Il serait intéressant que vous précisiez le coût de l’incurie du Gouvernement dans la gestion de ce dossier.
Les remarques factuelles de la Cour des comptes doivent être prises au sérieux, car, oui, monsieur le secrétaire d’État, il existe un risque sur notre dette.
Mme la rapporteure générale souligne d’ailleurs dans son rapport la forte hausse des engagements hors bilan de l’État. Mais tous n’ont pas la même approche au sein de la majorité. Nous avons entendu certains nous expliquer en commission des finances que la notion de « hors bilan » n’avait pas de sens. Fort heureusement, Mme la rapporteure générale assume dans son rapport que ces engagements hors bilan existent et qu’ils augmentent lourdement.
Rappelons un certain nombre de données, monsieur le secrétaire d’État. Si les taux auxquels l’État emprunte devaient à un moment augmenter d’un point – ce n’est pas un scénario absolument impossible, même si évidemment nous ne le souhaitons pas –, le coût, pour la dixième année, serait de 15 milliards d’euros ; le coût cumulé, sur la période de ces dix années, serait de 100 milliards d’euros.
Mesurez la responsabilité qui est la vôtre, qui est la nôtre, dans les choix budgétaires que nous faisons. Des choix budgétaires mal maîtrisés, mal évalués, une mauvaise exécution budgétaire comme c’est le cas en 2014, auront nécessairement, à un moment, un effet sur les taux d’intérêt : 15 milliards la dixième année, 100 milliards sur l’ensemble de la période.
Monsieur le secrétaire d’État, ce sont des faits, des chiffres précis, simples, lourds de conséquences : en 2014 la dette a augmenté de 70 milliards d’euros, le déficit s’est aggravé de 11 milliards et les dépenses ont été masquées par un certain nombre d’artifices de gestion.
Mme la rapporteure générale a dit que d’autres majorités en ont parfois abusé. Ce n’est pas faux. Simplement, la situation s’aggrave. Et si je peux me permettre, les définitions s’aggravent aussi.
Peut-on discuter de la prise en compte des investissements d’avenir dans le périmètre d’évolution des dépenses ? C’est une bonne question que vous posez et vous avez raison de dire, madame le rapporteur général, qu’antérieurement, ces investissements d’avenir n’étaient pas davantage pris en compte. Mais celle que nombre d’entre nous avaient posée dès la mise en place des investissements d’avenir portait, d’une part, sur leur comptabilisation, et d’autre part, sur leur contenu.
Quand ce sont véritablement des investissements d’avenir, innovants, sur des dépenses qui ordinairement n’auraient pas été inscrites au budget de l’État, on peut critiquer la facilité de nomenclature comme on peut l’accepter. Lorsque très clairement, et le Gouvernement le reconnaît, ces investissements d’avenir se substituent à des dépenses budgétaires ordinaires, classiques, il n’y a aucune raison de les classer ainsi ni d’accepter que soit masquée de la sorte l’augmentation des dépenses de l’État.
La baisse des recettes est de 10 milliards d’euros. Pour tout vous dire, monsieur le secrétaire d’État, je ne veux pas condamner toute baisse des recettes. Lorsqu’elle fait suite au choix politique d’une réduction de l’impôt, c’est bien. On peut contester les modalités ou le choix stratégique de la technique du CICE, mais la baisse des charges supportées par les entreprises n’est pas condamnable en tant que telle : soyons cohérents avec nos propres analyses et nos propres propositions.
Dans ces 10 milliards, la baisse qui relève du choix politique de réduction de l’impôt nous va bien, mais vous le savez, cette baisse est davantage l’effet d’une faible croissance que d’un choix politique de baisse de l’impôt.
Alors, nous nous retrouvons avec les chiffres dénoncés par le président de la commission : les prélèvements obligatoires augmentent, passant de 44,7 à 44,9 %, tout comme les dépenses publiques, de 57 à 57,5 % du produit intérieur brut.
Ces débats ne sont pas uniquement techniques, même lorsqu’il s’agit du projet de loi de règlement. Notre collègue Cornut-Gentille a eu raison de rappeler l’importance que devrait avoir ce moment dans la vie parlementaire. Ce ne sont pas des débats purement techniques, ce ne sont surtout pas des débats rituels et nous vous rappelons, monsieur le secrétaire d’État, comme la réalité le rappelle à la Grèce actuellement, que l’intendance ne suit pas toujours.
Monsieur le secrétaire d’État, plus que jamais, il est impératif d’assainir les finances publiques, de maîtriser de manière plus rigoureuse les dépenses.
Je dois dire que le constat de la rapporteure générale du budget sur le fait que l’État ne pourvoie pas à tous les emplois qui sont inscrits a quelque chose d’un brin paradoxal.
Ce constat répond à ce que nous vous disons depuis trois ans : alors même que l’augmentation des effectifs n’est sûrement pas la réponse aux problèmes de la politique de l’éducation en France, nous n’avons de toute façon pas assez de candidats. Vous auriez dû nous écouter davantage il y a trois ans : nous vous l’avions dit.
La médiocrité de votre politique de l’éducation n’a en rien contribué à améliorer la situation et vous en faites, chers collègues, l’honnête constat : je vous en donne acte.
Oui, nous avons besoin d’une maîtrise plus rigoureuse des dépenses, parce que les baisses d’impôts que nous appelons de nos voeux doivent être financées.
Cher collègue Lefebvre, je vous transmettrai si c’est nécessaire nos analyses et précisions sur ce que pourraient être des baisses de dépenses, qui demanderaient du courage assurément, mais qui permettraient de parvenir, en répartissant les efforts, à financer et la baisse des déficits, en vue de mieux maîtriser la dette, et la baisse des impôts.
Nous souhaitons une plus grande maîtrise des dépenses pour permettre une baisse des impôts, au bénéfice de la liberté des personnes et du dynamisme des entreprises.
La maîtrise des finances publiques a aussi pour enjeux la souveraineté de notre pays et la croissance de notre économie.
L’intérêt de la France réside dans la cohérence de notre politique avec celles de nos partenaires européens : au sein de la zone euro, cela veut dire une politique économique commune.
Quand on n’est pas à l’aise avec cette logique et ce choix politique de la convergence, comme certains le disent violemment en Europe – en Grèce, par exemple –, ou moderato en France, y compris au sein de votre majorité, il y a alors un problème sur le choix même de l’euro.
Attention à la légèreté ! La Grèce fut pour le moins légère avec ses finances publiques. Elle exprime aujourd’hui un refus de la convergence des politiques économiques qui est, en toute cohérence, un refus de l’euro.
On ne peut pas avoir une chose et son contraire : une monnaie commune qui suppose une convergence des politiques économiques et le refus de cette convergence.
Je pense que de bonne foi, la grande majorité des parlementaires de la majorité, du groupe socialiste, estiment que la convergence est souhaitable et nécessaire. Mes chers collègues, il faut que vous assumiez cette position et que vous en assuriez la cohérence.
Le grand danger que le Gouvernement nous fait courir, c’est, à bas bruit, de mettre en danger cette convergence et, demain, la situation de notre pays. Méditons cette leçon. Ayons en tête, aujourd’hui plus que jamais, que de bonnes finances sont nécessaires à une bonne politique.
Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

Les excellents propos que nous venons d’entendre étaient peu laudatifs, mais ces débats permettent d’analyser la situation.
En commission, monsieur le secrétaire d’État, après votre présentation de ce texte, Mme la rapporteure générale a démontré avec ses tableaux que la dette pouvait légèrement augmenter, tout en croissant beaucoup moins que dans les années antérieures, et que cette dette revenait moins cher à l’État.
Vous m’excuserez d’avoir rêvé pendant quelques secondes d’un modèle économique qui permettrait à des organismes, je n’ose dire à des opérateurs,…

…à des organismes missionnés par l’État de construire des logements, de les rénover, de les réhabiliter.
Ces organismes ont ensemble une dette fort importante, de l’ordre de 140 milliards d’euros. Dans le cadre du modèle économique qui est le nôtre pour financer cette production qui sert notre économie, qui sert le lien social et en définitive la République, je m’imaginais ce que pouvait la loi votée par notre Parlement sur les taux d’intérêt pour la rémunération de l’épargne. Je le dis avec prudence, car je sais les échos qui vont me revenir, mais si, dans des fourchettes convenables ou dans un modèle légèrement revisité pour tenir compte de l’épargne populaire dont nous avons aussi besoin, les taux avaient suivi la même évolution que ceux dont a bénéficié l’État, je n’ose penser aux économies que cela aurait permis de dégager sur le remboursement de la dette et de réinvestir dans la production.
Investir dans la production, c’est faire revenir de l’argent dans les caisses de l’État. Vous allez me dire, monsieur le secrétaire d’État, qu’avec les différents taux de TVA, des efforts importants ont tout de même été faits : c’est évident.
Ces donneurs d’ordres dépensent chaque année, en investissements, environ 16 milliards et la production pèse pratiquement 12 milliards : on voit ce que cela peut représenter dans une économie de production qui est relativement exsangue.
J’ai aussi une question que j’avais posée à votre prédécesseur, qui est parti, un peu vite, vers d’autres responsabilités, plus importantes : je me permettrai de vous la poser, sachant que j’ai trouvé quelques éléments de réponse dans le rapport de Mme Rabault et dans ceux des rapporteurs spéciaux.
Les aides à la pierre, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement, représentent des sommes globalement supérieures à celles inscrites en loi de finances initiale. D’une façon tout à fait délicate, on parle de « fonds de concours » issus de caisses, comme la Caisse de garantie du logement locatif social, ou de fonds abondés par des taxes, voire des amendes, comme celles qui frappent les communes carencées.
On s’aperçoit que plus de 30 % des sommes inscrites par l’État en matière de logement proviennent, de gré ou de force, par des choix stratégiques, de ces fonds.
Je pourrais faire la même démonstration sur l’Agence nationale de rénovation urbaine et la politique de la ville, c’est-à-dire sur ces politiques grâce auxquelles le développement humain reste un tant soit peu d’actualité dans ce pays, car il me semble que selon les documents du Programme des Nations unies pour le développement, nous régressons dans ce domaine.
Je voudrais souligner le rôle du Crédit immobilier de France. Tout à l’heure, un de nos collègues, avec humour, parlait d’un commissaire européen que nous avons bien connu ici : il vous a laissé un cadeau, monsieur le secrétaire d’État. Pas aux salariés, qui ont été licenciés, même si on nous dit qu’ils ont bénéficié d’un traitement social de qualité.
L’extinction du CIF devrait rapporter en fin de parcours au moins 2 milliards d’euros à l’État, mais déjà, chaque année, ce sont 100 à 200 millions d’euros qui sont apportés au budget de l’État, lequel en a bien besoin.
Je constate qu’il est assez difficile d’identifier ces sommes. Elles peuvent venir contribuer à l’équilibre du budget ; elles peuvent aussi aller à ce pour quoi elles étaient destinées lorsque le CIF était en activité, c’est-à-dire à financer un fonds social à destination des personnes les plus fragiles et les plus en difficulté.
J’ajoute que, selon les documents budgétaires, les coûts de l’hébergement d’urgence atteignent des sommets, de sorte qu’il faut absolument faire quelque chose.
Mais il est regrettable que l’on oublie que faire suppose de proposer, de mutualiser, de prendre ses responsabilités. À cet égard, vous aurez remarqué que je n’ai jamais demandé de mesures nouvelles, jamais demandé que l’État donne plus. On ne lui demande pas plus. Au contraire, on contribue par notre activité à lui amener quelque chose.
Je souligne que les services de la haute fonction publique ne peuvent pas retarder la mise en oeuvre des accords passés car il s’agit d’une mutualisation de moyens financiers au bénéfice d’une politique voulue au plus haut sommet de l’État. Or aujourd’hui, on attend des réponses de la part de quelques fonctionnaires – tous d’ailleurs de grande qualité, y compris dans les cabinets ministériel – pour savoir si la loi SRU est appliquée, si les accords de mutualisation vont enfin être réalisés. Si c’est non, qu’on nous le dise. Mais le jeu de l’État depuis dix ans, est-ce de toujours siphonner et en signant seulement des accords ? Au passage, je constate qu’il n’y a pas eu besoin de siphonner pour que l’Agence de renouvellement urbain bénéficie d’enveloppes qui chaque année abondaient les crédits de paiement, jusqu’à hauteur de 100 millions d’euros. Certes, c’était 70 millions d’euros la dernière fois, mais nous étions en fin de parcours du premier plan de renouvellement urbain. Le deuxième semble également très difficile à mettre en oeuvre, et on comprend pourquoi. Mais il faut jouer la transparence, faire preuve de rigueur et que chacun y mette du sien. Il est indispensable que les opérations annoncées, que la cartographie des quartiers concernés, correspondent à une mise en oeuvre effective. Je n’insisterai pas plus sur les contributions apportées par ces fonds de concours, mais il serait souhaitable qu’elles soient annoncées de façon très transparente. Je pourrai parler de la contribution annuelle de la Caisse des dépôts et consignations, mais il est permis de s’interroger sur la part de ces fonds de concours qui sont gérés par elle – ou bien ce qu’il en reste – au bénéfice du modèle économique du logement locatif social.

Je voudrais simplement rappeler rapidement les questions à se poser s’agissant de l’inégalité dans la gestion de l’immobilier de l’État. Nous aurons d’autres occasions d’en parler, monsieur le secrétaire d’État, mais je veux dire solennellement, du haut de cette tribune, que la décote affectée à des biens de l’État peut être sujette à la contrainte de décisions municipales, qui ne relèvent donc pas du ministre en charge des domaines, mais des collectivités. Il ne faudrait pas que cela puisse apparaître comme du pillage. Je ferai remarquer que grâce au Conseil de l’immobilier de l’État, la cour d’appel de Lyon nous a donné raison plutôt qu’à une grande ville d’Auvergne. J’aimerai que ce discours soit bien entendu partout pour que les choses soient faites avec rigueur et qu’on ne vienne pas faire son marché pour des opérations qui, dans dix ans, permettront de faire des excédents qui tomberont dans l’escarcelle de la ville et non dans celle de l’État. Ce serait bien dommage. J’attire votre attention sur ce point, monsieur le secrétaire d’État.

La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, un certain nombre de ceux qui se sont exprimés nous ont déjà quittés, certainement trop impatients d’écouter les réponses du secrétaire d’État. D’autres réponses sur des points plus précis seront apportées dans le débat d’orientation des finances publiques de jeudi prochain. Je tiens à indiquer à M. Degallaix, qui vantait les mérites de la RGPP comme étant source d’économies, que deux parlementaires avaient essayé de voir quelles étaient les économies réalisées en dépenses de fonctionnement, et s’étaient aperçus que la majeure partie de ces économies était « mangée » par les mesures catégorielles – celles-ci étant parfois même plus importantes que les économies. Personne n’a mis en cause les chiffres produits à l’époque. Il est vrai que l’impact du nombre d’emplois sur les budgets n’est pas immédiat et pas forcément très volumineux dans les premières années, et que tout cela se cumule dans le temps. Mais ce n’est pas la politique du Gouvernement : la nôtre consiste à fixer certaines priorités et à réduire de façon considérable les mesures catégorielles. Les rapporteurs spéciaux auront l’occasion de s’exprimer sur le sujet. À propos des prélèvements obligatoires, le président Carrez – qui nous a quittés lui aussi – a évoqué l’élasticité : celle-ci a été de 1,1 en 2014, supérieure à ce que nous avions prévu, et c’est bien entendu l’une des causes du résultat un peu différent par rapport à nos prévisions. Mais je rappelle que c’est aussi la première année de baisse des impôts puisque c’est alors que le CICE a commencé a pesé plus lourdement sur nos comptes en termes de recettes et où la réduction exceptionnelle de l’impôt sur le revenu a été mise en place. Celle-ci se confirmera bien sûr dans le courant de l’année 2015, conformément à ce que votre assemblée a bien voulu voter.
Monsieur Alauzet, vous avez évoqué les hypothèses de croissance. Nous avons décidé de maintenir celle de 1 %. De plus en plus nombreux sont ceux qui la qualifient de trop prudente, le consensus s’établissant aujourd’hui autour de 1,2 % à 1,3 %. Mais comme le Gouvernement ne veut pas donner l’envie de dépenser l’argent que l’État n’a pas encore, il préfère conserver l’hypothèse de croissance de 1 %, qui lui apparaît prudente. Désormais, nous entrons dans un cercle plus vertueux que par le passé.
Je fais observer que la semaine dernière s’est produit un événement important dont personne n’a parlé à cette tribune : la Commission a accepté les propositions que nous lui avons transmises, début juin, en complément du programme de stabilité. Pendant six mois j’ai entendu, y compris à cette tribune, de la part d’un certain nombre de députés, notamment de l’opposition, que la Commission allait nous punir, nous sanctionner, nous mettre sous tutelle, et il y avait tous les jours des titres dans la presse, tous plus alarmistes les uns que les autres. Or la semaine dernière, presque personne n’a relevé que la Commission avait parfaitement accepté nos précisions et validé les mesures que nous lui avons transmises pour 2015. Elle sera bien sûr attentive à ce qui va se passer d’ici la fin de l’année, mais il n’y a pas lieu d’avoir d’inquiétudes particulières. Si les recettes ont baissé, monsieur Alauzet, c’est bien sûr en raison de la croissance, mais les recettes sont aussi, pour certaines d’entre elles, très fortement fonction de l’inflation. À cet égard, le principal événement de 2014 a été le très faible taux d’inflation, bien inférieur à ce que nous avions prévu. Il est d’ailleurs curieux que nombre de ministères dépensiers – je reprends avec cette expression mon rôle de méchant, celui du secrétaire d’État au budget – ne reconnaissent pas que la faible inflation et la baisse des prix de l’énergie leur ont plutôt facilité la tâche en 2014 et en 2015. C’est notamment le cas pour les ministères qui sont les plus consommateurs de produits liés à ces indices. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
M. Sansu, qui a dû, lui aussi, nous quitter – certainement pour d’impérieuses raisons –, a longuement évoqué la Grèce. J’aurais voulu lui demander quelle baisse de prestations notre pays a connue. Nous avons certes décidé de ne pas en augmenter certaines, mais jamais de les baisser. C’était pourtant d’autant plus ennuyeux que l’inflation était faible. Je l’invite à vérifier : par exemple, en matière d’assurance maladie, quels sont les déremboursements ? Il n’y en a pas eu. Au contraire, il y a eu plus de prestations. Il n’y a pas de comparaison possible avec la situation en Grèce. Quant à la comparaison des taux d’intérêt entre nos deux pays, elle me hérisse et j’y reviendrai.
Dominique Lefebvre, je vous remercie pour vos propos et je les relaierai auprès des équipes du ministère, je pense à celles de la direction générale des finances publiques, qui ont permis d’améliorer encore la qualité de présentation des comptes, ce qui est tout de même tout à fait remarquable. La Cour des comptes a ainsi supprimé vingt et une critiques, ce qui est considérable. Je m’en félicite comme vous, ainsi que les équipes concernées, dont certaines d’entre elles ont des membres ici présents.
Monsieur Mariton, vous pouvez toujours jouer à faire peur à tout le monde avec les taux d’intérêt, mais j’ai rappelé les niveaux de taux que nous avons intégrés dans notre trajectoire des finances publiques, soit 2,5 % en 2016, 3 % en 2017 et 3,5 % en 2018. Ce sont des taux très largement supérieurs à ceux constatés aujourd’hui. On n’est certes jamais à l’abri de pics, mais ceux-ci ne se répercutent pas sur l’ensemble de la dette. Vous savez comme moi comment fonctionne l’Agence France Trésor dans ses émissions de titres. Je viens de voir sur mon téléphone portable qu’aujourd’hui, l’obligation assimilable du Trésor à dix ans est à 1,21 %, le spread par rapport à L’Allemagne ne s’aggravant pas. Nous avons prévu pour cette année un taux moyen de 1,20 % alors même que nous avons bénéficié de taux très inférieurs depuis le 1er janvier, et d’ores et déjà émis plus de la moitié de ce qui a été prévu. Tout se déroule tout à fait conformément aux prévisions. C’est un point d’attention mais pas un point d’inquiétude. Le Gouvernement, a pris des marges de sécurité au cas où d’autres événements interviendraient, y compris au regard de ce que nous avons prêté à la Grèce. Je rappelle que le montant du prêt à la Grèce, en direct ou intermédié, notamment via le Fonds européen de stabilité financière, est déjà inclus dans la dette publique française, à hauteur de 40 milliards. Il y aura bien sûr des ajustements au cas où aucun accord ne serait trouvé et que la Grèce se révélerait défaillante dans ses remboursements. Une telle situation ne serait certes pas agréable, mais la plupart des autres pays d’Europe y seraient, eux aussi, confrontés, une grande partie de ces prêts ayant été conclus proportionnellement au poids économique des différents États.
S’agissant d’Ecomouv’, la situation est bien connue – peut-être devriez-vous demander à votre collègue Le Fur, qui appartient au même groupe que vous, de vous éclairer sur le sujet ? Je vous signale que c’est votre majorité qui avait décidé de créer cette taxe et en avait fixé les modalités de recouvrement, dans des conditions que je n’aurai pas la cruauté de rappeler. Nous en assumons quant à nous les conséquences, à savoir le versement de quelque 900 millions d’euros d’indemnités au total ; 500 millions ont déjà été versés en 2015, le reste le sera de façon étalée sur huit années, à raison de 50 millions d’euros par an, ce qui correspond bien au total de 900 millions d’euros, montant sur lequel tout le monde s’est mis d’accord – à contrecoeur pour certains, mais sans doute bien volontiers pour d’autres !
Quoi qu’il en soit, chacun devrait rester modeste dans ses propos. J’ai d’ailleurs cru percevoir, en creux, dans les vôtres une critique de la gestion financière de la précédente majorité. De fait, celle-ci nous a laissé quelques cadavres dans les placards : les refus d’apurements communautaires au titre de la politique agricole représentent plus de 1 milliard d’euros et les contentieux sur les OPCVM – organismes de placement collectif en valeurs mobilières – près de 5 milliards d’euros. Ce sont des dépenses que nous assumons au nom de la continuité de l’État, mais chacun pourra en tirer les conclusions qu’il souhaite.
M. Dumont a été prolixe sur un sujet qu’il connaît bien : le Crédit immobilier de France. Les revenus dégagés par l’État servent aujourd’hui principalement au financement de la garantie. Mais j’ai bien entendu vos interrogations : peut-être serait-il judicieux de faire un jour le point sur cette affaire, qui nous a beaucoup préoccupés et a certainement nourri quelques fantasmes. Il est toujours bon de faire le point et, maintenant que deux ou trois années se sont écoulées – puisque c’est à la fin 2012 que la décision a été prise –, je ne serais pas opposé à ce que nous examinions qui y a gagné et qui y a perdu.
Quant à vos allusions sur la rémunération du livret A, je les ai bien entendues. D’ailleurs, le Gouverneur de la Banque de France a lui aussi fait des commentaires sur le sujet. Le Gouvernement aura l’occasion de faire connaître sa position dans les prochains jours – mais vous comprendrez que le modeste secrétaire d’État au budget que je suis ne peut se permettre pas de faire ce soir une quelconque annonce sur le sujet, et cela d’autant moins que la question touche, d’une part, comme vous l’avez souligné, les organismes gestionnaires de logements sociaux et, d’autre part, les épargnants, particulièrement nombreux, puisqu’il s’agit du produit d’épargne populaire le plus…populaire.
Quant à l’immobilier de l’État, vous savez qu’il s’agit pour moi d’un sujet de préoccupation permanente : nous échangeons souvent sur ces questions, qui font elles aussi l’objet d’affirmations caricaturales, et souvent réductrices. Il convient de trouver le bon équilibre entre la préservation du patrimoine de l’État et la recherche de nouvelles ressources. J’ai, constitutionnellement, le devoir de préserver le patrimoine de l’État. La loi permet en effet un certain nombre de cessions dans des conditions particulièrement favorables, mais à condition de respecter des critères bien précis ; ces dispositions, qui visent à favoriser la cession du patrimoine immobilier de l’État à des fins de construction de logements sociaux, ont mis du temps à s’appliquer. En effet – vous avez évoqué certaines affaires, j’en ai moins même d’autres en tête –, on peut parfois avoir le sentiment que des intérêts privés, ou des intérêts publics différents de ceux de l’État – vous avez avec raison fait allusion à des collectivités ou à des organismes publics –, peuvent être en jeu. Il convient donc de se montrer vigilant et très scrupuleux quant au respect des critères relatifs au nombre de logements construits ou aux conditions financières des opérations.
Il importe aussi de savoir – et tel est le sens de l’allusion que vous avez faite – quelles sont les clauses de garanties pour l’État vendeur en cas de retour à meilleure fortune.
Je peux vous dire, sans trahir de secret, que le Gouvernement a demandé à une mission d’inspection de faire des propositions sur plusieurs points, notamment sur le rôle de certains organismes administratifs, comme France Domaine, la direction générale des finances publiques ou d’autres encore. Je pense que nous serons amenés à divulguer nos propositions dans quelques semaines, une fois qu’elles seront formalisées – ce qui n’est pas encore le cas. Cette question fait en tout cas l’objet de nombreux travaux, car il importe de libérer du foncier pour favoriser la construction, tout en veillant à préserver les intérêts de l’État propriétaire et à éviter que d’autres intérêts, qu’ils soient particuliers ou publics, en profitent de façon injuste.
Voilà les remarques que je voulais faire. Je remercie les orateurs pour la courtoisie et la qualité de leurs propos, ce qui est un gage de sérieux – mais je ne m’attendais pas à autre chose en cette fin d’après-midi !
L’article liminaire est adopté.

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014.
Le projet de loi est adopté.
La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à dix-huit heures quarante.
Accessibilité des établissements des transports et de la voirie pour les personnes handicapées et accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Accessibilité des établissements des transports et de la voirie pour les personnes handicapées et accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap

L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (nos 2840, 2892).

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, la mise en accessibilité de la ville, au sens large, et des transports est attendue à juste titre avec impatience par les personnes en situation de handicap et par leur famille.
Si elle l’est, c’est, d’abord, parce qu’elle constitue un objectif défini de longue date par les pouvoirs publics, ensuite, parce que rendre accessibles les épiceries, les mairies, les musées, les restaurants, les bus et les trains est un préalable à l’autonomie des personnes en situation de handicap, dans une société non seulement plus juste, mais aussi plus accueillante.
Il importe de souligner que ce texte concerne également d’autres publics : les femmes enceintes, les personnes âgées, les parents qui circulent avec une poussette, ainsi que tous ceux qui sont temporairement blessés. C’est dire son immense impact.
Il répond aussi aux engagements internationaux pris par la France en matière de lutte contre les discriminations à l’égard des personnes en situation de handicap. Ces engagements correspondent parfaitement à la définition de l’accessibilité précisée par la loi de 2005. Contrairement à celle du 30 juin 1975, qui restreignait la conception de l’accessibilité à la seule question du handicap moteur, celle du 11 février 2005 l’a étendue à tous les types de handicap, tout en adoptant une conception plus large des espaces et bâtiments à rendre accessibles.
En juin 2012, un rapport parlementaire dressant le bilan de l’application de la loi établissait un diagnostic sans appel : la date butoir du 1er janvier 2015 pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public – les ERP – ne pourrait être respectée puisque les deux tiers, voire les trois quarts des gestionnaires des établissements concernés ne s’étaient pas encore engagés dans cette démarche. Il importait donc de trouver des solutions à même de débloquer la situation, puis de soumettre ces solutions à la concertation.
C’est dans ce contexte que les documents de programmation pluriannuelle, les « Ad’AP » – agendas d’accessibilité programmée –, ont été imaginés, afin de pallier l’absence de cadres juridique, calendaire et opérationnel – autant d’éléments qui manquaient dans le dispositif prévu en 2005.
Pour garantir concrètement la mise en accessibilité des ERP, de la voirie et des transports, il est également apparu qu’une simplification des normes s’imposait. Il s’agit de prendre en compte à la fois la réalité du quotidien et la grande diversité des établissements concernés par la mise en accessibilité. Sur ce sujet, le pragmatisme impose par exemple de ne pas traiter de la même façon un grand complexe hôtelier et un petit hôtel, ou encore de ne pas traiter une épicerie classée en catégorie cinq, c’est-à-dire un établissement de petite envergure, comme un grand supermarché. L’ensemble de ces propositions ont été soumises à la fois aux associations d’élus locaux, aux associations de personnes handicapées, aux organisations professionnelles, aux grandes entreprises de transport ainsi qu’aux membres de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle.
Sur la base de ces discussions, présidées par la sénatrice Claire-Lise Campion, qui a fait un travail remarquable, le Gouvernement a fait le choix d’aller au plus vite et de demander au Parlement de l’autoriser à adopter par ordonnance des mesures de nature législative visant à préciser les obligations prévues par la loi de 2005 en matière d’accessibilité des ERP et des services de transport public de voyageurs, ainsi que les nouveaux délais permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité.
Il est maintenant du devoir du Gouvernement de revenir devant la représentation nationale afin d’obtenir la ratification de l’ordonnance qu’il a prise. Tel est l’objet du texte qui vous est soumis aujourd’hui.
Les sénateurs et les sénatrices l’ont déjà fait évoluer. Je veux citer certaines avancées qui me paraissent significatives.
Premièrement, les sénateurs et les sénatrices ont précisé et réduit, lorsque c’était nécessaire, la durée de prorogation des délais de dépôt des agendas d’accessibilité programmée pour les fixer à six mois en cas de rejet du premier agenda, à un an en cas de difficultés techniques avérées et à trois ans pour les structures en proie à des difficultés financières définies de façon très stricte par la réglementation. Je tiens à signaler qu’un formulaire CERFA a été mis en ligne au début de l’année sur le site accessibilite.gouv.fr. Il tient lieu d’engagement à l’exécution de l’Ad’AP, y compris pour les gestionnaires amenés à demander un délai pour son dépôt pour l’une des trois raisons que je viens d’énumérer.
Deuxièmement, le Sénat a également pris soin de ne pas bouleverser le texte pour ne pas placer les parties prenantes en situation d’insécurité juridique. Cette insécurité conduirait en outre à faire retomber ce mouvement de mise en accessibilité qui s’est enclenché depuis maintenant plusieurs mois – chacun et chacune a pu le constater dans son propre territoire.
Troisièmement, le Sénat a souhaité devancer les intentions du Gouvernement en ouvrant le service civique aux jeunes adultes en situation de handicap âgés de vingt-cinq à trente ans.
La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a réalisé sur le texte voté par le Sénat un véritable travail d’orfèvre, veillant à conserver les grands équilibres, tout en faisant en sorte de pousser plus avant certaines mesures et d’accentuer le caractère inclusif du dispositif. Je tiens tout spécialement à saluer l’implication et la rigueur de son rapporteur, Christophe Sirugue – la notion de rigueur, comme le travail d’orfèvre, cela vous va très bien, monsieur le rapporteur !
En ce qui concerne la préservation de l’équilibre général du texte, la commission a écarté les amendements qui remettaient en cause les règles à quelques mois de la date butoir de dépôt des Ad’AP, qui est le 27 septembre prochain. Cela aurait rendu l’information confuse, désorganisé l’instruction des dossiers et, finalement, démobilisé ceux qui, aujourd’hui, sont en train de s’organiser pour être prêts dans les temps impartis.
À l’initiative du rapporteur, mais aussi de Bernadette Laclais, de Véronique Massonneau et de Barbara Pompili, la commission a également supprimé la possibilité pour les gestionnaires d’ERP de bénéficier d’un crédit d’impôt, possibilité qui avait été introduite au Sénat contre l’avis du Gouvernement. Je suis particulièrement satisfaite de la suppression de cette disposition car je considère que donner une prime à ceux qui n’ont pas tenu compte de l’obligation de mise en accessibilité inscrite dans la loi de 2005 était un mauvais signal.
Quant aux avancées résultant de l’examen du projet de loi en commission, je note qu’elles procèdent d’une volonté de déplacer le curseur vers plus d’inclusion chaque fois que cela est possible et équilibré. Bien sûr, j’y suis particulièrement sensible. Ainsi a été introduite, à l’initiative du rapporteur Christophe Sirugue et de Lionel Tardy, une disposition visant à supprimer une distinction faite entre les élèves handicapés scolarisés à temps plein et ceux scolarisés à temps partiel. C’est effectivement un moyen de permettre à tous les jeunes en situation de handicap scolarisés de prendre le bus scolaire avec leurs camarades de classe s’ils le souhaitent.
Toujours dans le domaine des transports, la commission a souscrit à la proposition de Bernadette Laclais d’interdire à l’autorité organisatrice de transport de pratiquer pour le transport mis en place pour les personnes handicapées un tarif supérieur à celui applicable aux autres usagers.
J’ai également pris connaissance du compte rendu des débats que vous avez pu avoir en commission à propos de la formation des personnels en contact avec le public. Ce sujet est bien sûr essentiel, et plus encore pour l’accueil des personnes en situation de handicap psychique ou mental. Plusieurs amendements visant à développer ce type de formation ont été déposés pour être discutés en séance publique. Les deux amendements en ce sens présentés par le rapporteur ont la préférence du Gouvernement, notamment parce qu’ils précisent des obligations raisonnables pour les établissements recevant du public de catégories un à quatre, et je m’en expliquerai tout à l’heure. Ma position sur ce point est guidée, bien sûr, par un souci à la fois d’équilibre et d’efficacité.
Je vous présenterai enfin un amendement du Gouvernement visant à offrir une sécurité législative au registre d’accessibilité. Celui-ci correspond à une recommandation issue de la concertation menée par la sénatrice Claire-Lise Campion. L’objectif de ce registre d’accessibilité est que les exploitants d’ERP précisent les modalités retenues pour permettre à tous les usagers ou clients d’accéder, quelles que soient leurs difficultés, aux services et prestations délivrés. Il illustre parfaitement cette notion d’accessibilité universelle que nous appelons tous de nos voeux.
Pour conclure, je souhaite vous dire que le Gouvernement, apprécie le souci de responsabilité qui a guidé vos travaux sur ce projet de loi de ratification d’une ordonnance entrée en application depuis plusieurs mois. Les débats ont été nourris depuis l’adoption du projet de loi d’habilitation, il y a maintenant un an, et j’espère vous avoir convaincus qu’il est temps désormais de procéder à l’adoption la plus rapide possible du projet de loi de ratification afin de ne pas reporter plus loin la mise en accessibilité de notre société.
Mesdames et messieurs les députés, je compte sur vous !

La parole est à M. Christophe Sirugue, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, nous avons examiné le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 26 septembre 2014 en commission le 24 juin dernier. Ce texte avait été sensiblement modifié par nos collègues sénateurs et nous nous sommes efforcés de parvenir à un contenu acceptable par le plus grand nombre, acceptable en ce sens qu’il reconnaît l’importance de la mise en accessibilité, acceptable aussi en ce qu’il tient compte de contraintes importantes sur lesquelles je vais revenir. Je veux noter que nos travaux se sont déroulés dans une atmosphère constructive, et je tiens à en remercier l’ensemble des groupes, de la majorité comme de l’opposition.
Si des mécontentements demeurent, je voudrais rappeler que le projet d’ordonnance part du constat de la situation d’impasse dans laquelle se trouvait la société française. La loi du 11 février 2005 avait fixé des objectifs très ambitieux de mise en accessibilité universelle à l’horizon du 1er janvier 2015. Près d’un an et demi avant cette échéance, il nous a bien fallu constater que, malgré les progrès importants qui avaient été accomplis, grâce à cette loi, une grande partie de notre société ne pouvait plus prétendre être prête en temps et en heure – et je serais tenté de dire qu’il aurait même été facile de faire ce constat un peu plus en amont encore. Sans intervention législative, je veux le rappeler ici, notre société serait demeurée dans une situation de semi-conformité, exposée au risque permanent de batailles contentieuses, aussi attristantes qu’incertaines.
Face à cela, le Gouvernement a pris, de mon point de vue, les meilleures décisions possibles. Je le dis aujourd’hui après avoir beaucoup travaillé, avec mes collègues et avec le Gouvernement sur ce texte de ratification. Le calendrier extrêmement difficile rendait le recours aux ordonnances inévitable. Toutefois, le Gouvernement a veillé à associer les parlementaires en amont de leur rédaction, et je l’en remercie.
Ainsi, comme cela a été rappelé à l’instant par Mme la secrétaire d’État, notre collègue sénatrice Claire-Lise Campion a été chargée de conduire les travaux de concertation préparatoires à la demande d’habilitation. Ils ont notamment permis de définir des marges d’assouplissement de la législation, de prioriser nos objectifs et de définir des outils innovants de rattrapage de la mise en accessibilité, les fameux agendas programmés d’accessibilité, ou Ad’AP, pour les établissements recevant du public, ainsi que les schémas directeurs d’accessibilité-ADAP, ou SDA-ADAP.
Lors de l’examen du projet de loi d’habilitation, il y a tout juste un an, nous avons mené un dialogue fructueux avec le Gouvernement afin de soutenir sa démarche de réforme tout en affirmant notre vigilance sur certains points. L’ordonnance du 26 septembre 2014 a traduit l’esprit de l’habilitation. C’est ce qu’a constaté le Sénat, qui a adopté le projet de loi moyennant quelques amendements. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a salué la plupart de ces modifications, qui prévoient un meilleur encadrement des conditions de prorogation des délais de dépôt et de mise en oeuvre des Ad’AP et SDA-Ad’AP, l’attribution de l’intégralité du produit des sanctions liées à la mise en oeuvre des Ad’AP et SDA-Ad’AP au fonds d’accompagnement pour l’accessibilité universelle, le renforcement des obligations de formation, des mesures de simplification ou d’allégement de contraintes adaptées aux petites communes et l’extension jusqu’à l’âge de trente ans de la possibilité d’un engagement en service civique pour les jeunes en situation de handicap.
Cependant, afin de faire encore progresser ce texte, notre commission est également revenue sur deux dispositions adoptées par le Sénat.
À l’article 3, une disposition dispensait les bailleurs sociaux de certains travaux de mise en accessibilité dans les constructions neuves. Si je constate que certains souhaitent aujourd’hui la rétablir, je rappellerai que sa suppression a fait l’objet d’un consensus en commission et n’a soulevé aucune objection.
Nous avons également voté la suppression de l’article 9, qui prévoyait un dispositif fiscal d’engagement en faveur des ERP s’engageant dans les Ad’AP entre le mois de septembre 2015 et le mois de septembre 2016. Nous avons jugé cette disposition pour le moins injuste et inappropriée.
La commission des affaires sociales a également enrichi ce texte en prévoyant la possibilité de mettre en accessibilité les points d’arrêt de transport scolaire pour les élèves handicapés scolarisés à temps partiel et pas seulement à temps plein – j’ai vu, malheureusement, qu’un amendement revenait encore sur cela, mais nous en débattrons tout à l’heure. Nous avons également prévu que la validation des SDA-Ad’AP soit soumise à l’avis conforme des commissions consultatives départementales pour la sécurité et l’accessibilité. Et nous avons introduit, grâce à notre collègue Bernadette Laclais, le principe de non-discrimination tarifaire, dans un même périmètre urbain de transport, pour le transport à la demande.
Outre quelques ajustements rédactionnels, les échanges que nous avons eus en commission me conduisent à vous proposer de préciser encore ce texte sur deux points.
Premièrement, en ce qui concerne la formation, conformément à la loi d’habilitation, l’article 12 de l’ordonnance prévoit que les formations des professionnels en contact avec le public ou la clientèle incluent un volet relatif à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées. Nos collègues sénateurs ont ajouté une disposition selon laquelle les exploitants d’ERP proposent à leurs employés des formations similaires en formation continue. Nous avons souhaité renforcer ces dispositions en prévoyant une obligation de formation plus systématique pour les grands ERP. Ce sera l’objet d’un amendement que je vous soumettrai.
Deuxièmement, nous avons également souhaité avancer sur la question difficile de la mise en accessibilité des ERP situés dans des immeubles d’habitation. Le droit issu des ordonnances prévoit que le préfet pourra accorder une dérogation à l’exploitant de l’ERP dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires aura voté son refus d’autoriser les travaux. On comprend bien la nécessité de trouver le meilleur équilibre possible face à une situation complexe : la mise en accessibilité universelle est un impératif, mais le respect du droit de propriété aussi, et la loi ne saurait appliquer à des particuliers les obligations pesant sur des exploitants d’ERP. Le Sénat a donc avancé au mieux sur cette question en prévoyant que le refus de l’assemblée générale devait être motivé.
Sans prétendre remettre en cause cet équilibre, et conformément aux conclusions de la concertation, je vous proposerai un amendement visant à clarifier les possibilités de dérogation dans les situations où l’ERP prend en charge le coût des travaux.
Pour conclure, je souhaite rappeler la satisfaction que j’ai eue en tant que rapporteur à constater le climat constructif dans lequel nous avons examiné ce projet de loi en commission. J’insiste sur le travail important que nous avons engagé, avec le souci extrêmement fort d’entendre les revendications légitimes des personnes en situation de handicap, de leurs associations mais aussi des personnes dont la mobilité est réduite pour d’autres raisons que le handicap.
Les évolutions que nous proposons au travers de ce projet de loi de ratification ont pour ambition, non pas de parvenir à l’équilibre je ne saurais dire ce que recouvre exactement ce terme –, mais d’avancer. En effet, si nous restons figés sur des positions totalement compréhensibles, mais dont la faisabilité ou les calendriers renverraient leur application à plusieurs années, nous reviendrions, finalement, aux défauts de la loi du 11 février 2005. Nous avons collectivement le devoir de permettre l’application de ce texte avec la volonté de l’efficacité. C’est en tout cas ce que nous avons recherché dans le cadre de nos travaux.
Je forme le souhait qu’à la suite de la commission des affaires sociales, notre assemblée adopte ce projet de loi de ratification.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Véronique Massonneau, premier orateur inscrit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, la loi de 2005 inscrivait dans notre droit de bonnes intentions en faveur de l’accessibilité. Elles auraient dû se concrétiser cette année en totalité. Or, dix ans après, le compte n’y est pas et nous ne pouvons que constater l’inadéquation entre les ambitions et la réalité des moyens mis en oeuvre pour les atteindre.
Nous pouvons tout de même nous féliciter de la dynamique engagée en faveur de l’accès à tout et pour tous. Cependant, cette dynamique n’a pas été suffisante et il reste aujourd’hui encore beaucoup à faire. De ce constat, nous devons tirer les leçons : l’idéal déconnecté du réel conduit à l’échec. Une loi mal appliquée est souvent une mauvaise loi, et c’est bien aux parlementaires de remettre en question les objectifs de chaque texte qu’ils votent. De la réalité à l’idéal, il y a les moyens et la volonté. Je crois profondément que c’est cet équilibre qui doit nous guider dans nos travaux législatifs. Or, force est de constater qu’entre 2005 et aujourd’hui, on a parfois manqué de volonté et on n’a pas su ou pu dégager suffisamment de moyens.
Si l’inclusion des personnes en situation de handicap doit être une priorité pour notre société, elle doit se faire en toute conscience des possibilités de sa mise en oeuvre. Les ambitions démesurées ne conduisent nulle part, comme nous pouvons le constater, si ce n’est susciter de la frustration. Alors que les petites communes font face à des situations budgétaires souvent difficiles, alors que les petits commerces font face à la grande distribution, leur imposer des travaux aux coûts insoutenables n’améliore en rien la vie des personnes en situation de handicap : in fine, chacun est insatisfait et l’exaspération est d’autant plus grande. Cette situation amplifie la défiance envers les politiques, déconnectés de la réalité, pour les uns, impuissants à régler les problèmes, pour les autres.
Nous avons aujourd’hui la responsabilité de rectifier le tir, de proposer à chacun des délais convenables et réalistes afin que nos grandes déclarations dans cet hémicycle puissent vraiment se concrétiser dans la vie des personnes en situation de handicap. C’est ce que proposent ces ordonnances, qui nécessitent malheureusement mais nécessairement de prolonger certains délais de mise en accessibilité.
Chers collègues, vous l’avez certainement constaté comme moi, les associations de personnes en situation de handicap sont très mécontentes et, pour beaucoup, ne veulent pas de ces ordonnances. J’entends leurs critiques légitimes et comprends leur frustration. J’entends aussi les ERP, qui font état de contraintes importantes ; de fait, les procédures de dépôt des agendas d’accessibilité programmé – les Ad’AP – sont lourdes et parfois incertaines.
Nous devons malgré tout demeurer exigeants, ne pas rouvrir des délais interminables, ne pas céder aux dérogations systématiques. Nous avons la responsabilité de comprendre le quotidien des personnes en situation de handicap, les difficultés permanentes et inacceptables qu’elles rencontrent, qui les laissent en marge de notre société. Il nous revient de comprendre quels sont les moyens d’y remédier concrètement et réellement afin qu’au plus vite, chacun, handicap ou non, puisse se déplacer en transports en commun, aller à l’école ou à l’université, travailler, se divertir. Vivre, en somme. N’ajoutons pas au handicap l’exclusion sociale. Pour cela, il est temps de cibler notre action parlementaire.
Je tiens à souligner le bon travail qui a été mené en commission, avec quelques avancées notables, comme les Ad’AP obligatoires pour les transports en commun, et j’en profite pour saluer le travail et l’écoute du rapporteur. Nous attendons que cet examen en séance se poursuive dans le même esprit.
Au regard des précisions que je viens de vous exposer, les écologistes souhaitent que les dérogations soient le moins nombreuses possibles, et que soient mis en place un accompagnement et un soutien financier lorsque les travaux d’accessibilité sont trop lourds pour certains établissements. Les délais peuvent alors être prolongés modérément, choix préférable à une dérogation pure et simple, qui ne permettra jamais l’accès à tous. Pour ces raisons, je défendrai l’obligation d’avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité à l’égard des demandes de dérogation de mise en accessibilité préalablement à la décision du préfet.
Je souhaite conclure sur un message positif, en saluant les nombreuses initiatives en faveur de l’accessibilité qui ont néanmoins déjà été entreprises dans notre pays. Car si la loi de 2005 n’a pas rempli tous ses objectifs, ce serait une erreur de nier les efforts qui ont été faits par de nombreux Françaises et Français, particuliers, collectivités ou entreprises. Que notre action parlementaire de ce jour puisse les soutenir davantage et insuffler un nouvel élan en faveur de l’égalité envers nos concitoyens en situation de handicap !
Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste et sur quelques bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, le texte dont nous discutons fait suite à celui adopté le 10 juillet 2014. Il a pour objet de ratifier les ordonnances relatives à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. C’est la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » qui prévoyait cette mise en accessibilité, fixant la date butoir de cette mesure à 2015. Cette disposition est tout à fait essentielle pour que les personnes en situation de handicap puissent enfin, comme n’importe quel citoyen, circuler librement. J’ajoute que sont également concernées – vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État – les personnes âgées, accompagnées de jeunes enfants ou momentanément gênées.
En 2011, constatant le retard accumulé dans les travaux de mise en accessibilité, notre groupe politique avait présenté dans cet hémicycle une proposition de résolution invitant le Gouvernement français à prendre des décisions pour permettre la mise en oeuvre d’une réelle politique d’accessibilité universelle, en conformité avec ses engagements internationaux. Malheureusement, cette exigence n’a pas été entendue. Pire, les gouvernements de droite de l’époque ont laissé la situation se dégrader.
Nous étions en droit d’attendre que le nouveau gouvernement reprenne ce dossier en main et dégage des moyens pour le faire avancer. Mais hélas, le projet de loi du 10 juillet 2014 n’est pas venu soutenir un effort de mise en accessibilité. Il a, au contraire, entériné une situation difficile, réduit le niveau des exigences en termes d’accès aux transports et au bâti, et en a encore retardé la concrétisation, en même temps que le Gouvernement décidait de réduire de 11 milliards d’euros la dotation attribuée aux communes, leur interdisant, de fait, quelle que soit leur bonne volonté, de mettre en oeuvre concrètement les objectifs de la loi de 2005. C’est ce qui a motivé notre vote contre ce texte en première lecture.
C’est dans ce contexte de réduction drastique des moyens des communes que vous les invitez aujourd’hui, par cette ordonnance, à préciser, dans le cadre d’agendas d’accessibilité, les travaux pluriannuels de mise en conformité qu’elles envisagent ainsi que leur programmation financière. Autant dire que la situation actuelle va perdurer, que le retard ne sera pas comblé.
J’ajoute que, concernant les services de transport, l’ordonnance se contente d’aménager les points d’arrêt prioritaires, ce qui ne permettra pas à une personne en situation de handicap de se déplacer librement partout. De même, ce sont les parents d’élèves qui devront solliciter la mise en accessibilité des points d’arrêt proches du domicile et de l’établissement scolaire de leur enfant handicapé.
Ainsi, au nom du pragmatisme et de la réduction des crédits, c’est l’égalité de traitement des citoyens qui est mise en cause. De plus, du fait de la multiplicité des possibilités de prorogations des délais de dépôt et de réalisation, ainsi que des différentes possibilités de suspension, cet agenda d’accessibilité perd de son sens et de son efficacité.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui a émis un avis défavorable à ce projet d’ordonnance, avait dénoncé ces délais à rallonge. Je le cite : « Les délais envisagés – jusqu’à dix années supplémentaires – pour concrétiser une continuité de la chaîne de déplacement entre le cadre bâti, les transports publics, la voirie et les espaces publics – objectif initial de la loi du 11 février 2005 – sont inenvisageables après quarante ans d’attente pour une réelle liberté d’aller et de venir, droit constitutionnel fondamental. »
À ce problème de délais, vous ajoutez le renoncement à une accessibilité pleine et entière du cadre bâti. Ainsi avez-vous fait le choix de ne pas généraliser l’obligation d’installer un ascenseur dans les immeubles d’habitation collectifs. Cette obligation reste réservée aux immeubles de cinq étages et plus, quand la plupart des associations demandent qu’elle s’applique aux immeubles de quatre étages ou, évidemment, moins. Pour justifier ce choix, vous vous appuyez sur l’appréciation des professionnels de la construction. Ce sont donc les préoccupations économiques des promoteurs qui prévalent, plutôt que celles de la vie quotidienne des citoyens.
Dans le même ordre d’idées, l’ordonnance donne la possibilité aux copropriétaires d’un immeuble d’habitation de refuser la mise en accessibilité. Comment justifier le fait que les personnes en situation de handicap ne puissent pas accéder librement à un immeuble parce que les copropriétaires de cet immeuble n’ont pas souhaité effectuer les travaux ? Cela nous paraît simpliste et dangereux. Comment accepter que certains de nos concitoyens doivent renoncer à rendre visite à leurs proches quand ceux-ci habitent dans un immeuble de seulement trois étages, donc non soumis à l’obligation d’installation d’un ascenseur et, de ce fait, inaccessible ?
Toutes ces concessions, sous les prétextes les plus divers – certes, on sait que ce n’est pas facile, qu’il y a des obstacles – traduisent un manque de détermination très dommageable, car l’accessibilité n’est pas un luxe mais un préalable essentiel à la scolarisation, un préalable à l’accès au logement, à la culture, à l’obtention d’un travail, bref, à une vie citoyenne pleine et entière, comme l’indiquait d’ailleurs l’intitulé du texte de 2005 : « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
Avec cette ordonnance, vous avalisez, finalement, l’existence de catégories de citoyens n’ayant justement pas les mêmes droits, ce qui n’est pas acceptable. Vous suscitez la colère des personnes en situation de handicap et celle de leurs associations. Le collectif pour une France accessible, qui en regroupe de nombreuses, dénonce cette ordonnance, qui – je le cite – « a été profondément aggravée sur des points essentiels pour le plus grand intérêt des acteurs de l’immobilier, mais au mépris de l’intérêt général de la population. »
Nous ne pouvons nous résoudre à remettre en cause notre projet de société fondé sur l’égalité de tous les citoyens en matière de droits fondamentaux. Pour ces raisons, les députés du Front de gauche, qui ont voté contre la loi du 10 juillet 2014, voteront contre le projet de loi ratifiant l’ordonnance qui la met en oeuvre.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, voici plus de dix ans que la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a vu le jour. Cette loi indispensable, très attendue par les personnes handicapées, leurs familles et les associations, a suscité beaucoup d’espoir après des années de combat. En consacrant la notion d’accessibilité universelle, la loi du 11 février 2005 dite « loi handicap » a posé les fondements d’un changement d’état d’esprit dans notre société. Il s’agit de traiter l’accessibilité globalement, non seulement physique mais aussi à la vie en société dans son ensemble. Si les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, sont les plus concernées par ce sujet, toute personne confrontée un jour ou l’autre à des difficultés de déplacement, de manière temporaire ou durable, l’est aussi. En outre, au regard du vieillissement de la population, l’enjeu est considérable.
L’accessibilité ne doit donc pas être perçue comme une contrainte. Elle fait partie des éléments de fonctionnement d’une société inclusive laissant une place à chacun, attentive aux plus fragiles, prenant en compte leurs contraintes et considérant que leur différence est un apport pour toute la société et que nous sommes tous riches de cette différence. Malheureusement, dix ans après avoir été votée, force est de constater que la loi du 11 février 2005 n’a pas donné lieu aux avancées qu’elle laissait espérer ni bénéficié des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre, ce qu’on ne peut que regretter. De nombreux bâtiments publics ou privés recevant du public ne sont pas encore accessibles. De nombreux moyens de transport ne le sont pas davantage. Les voiries sont encore trop souvent dangereuses et l’accessibilité à la vie sociale et professionnelle, ou à l’éducation pour les plus jeunes, améliorable.
Comme l’ont montré nos débats, des avancées ont été réalisées par certaines collectivités ou par des enseignes bien souvent précurseurs au cours des dernières années. Je ne voudrais surtout pas que mes propos les découragent mais au contraire les encouragent à poursuivre. Pourtant, la semaine dernière encore, j’ai entendu un maire déclarer : « Monsieur le préfet, vous nous condamnez à l’accessibilité ! ». Immédiatement, M. le préfet a réagi avec détermination mais cet exemple montre incontestablement qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les travaux de notre collègue Claire-Lise Campion, à laquelle beaucoup d’entre vous ont rendu un hommage légitime, ont montré que seulement 15 % des travaux nécessaires étaient réalisés en 2012, soit trois ans avant l’échéance, en dépit de la dynamique engagée et des efforts consentis par certains maîtres d’ouvrage.
Le rapport intitulé « Réussir 2015 » qu’elle a remis en mars 2013 au Premier ministre Jean-Marc Ayrault a été suivi d’une large concertation dont sont issues des préconisations, en particulier les agendas d’accessibilité programmée permettant aux maîtres d’ouvrage de s’engager sur un échéancier de travaux et sur un calendrier de financement précis et l’adaptation des normes existantes dont certaines se sont révélées trop rigides ou trop peu pragmatiques et donc inopérantes. Bien évidemment, il n’était pas envisageable de renoncer au principe de la loi du 11 février 2005 mais il ne l’était pas davantage, comme l’a très bien rappelé notre rapporteur, de prendre le risque de la multiplication des contentieux et des condamnations pénales des entreprises, commerces et collectivités territoriales n’ayant pas rempli leurs obligations au 1er janvier 2015.
Dans ce contexte, la loi habilitant le Gouvernement à élaborer des mesures législatives de mise en accessibilité des établissements recevant du public a été adoptée. Cette loi du 10 juillet 2014 est allée au-delà des préconisations issues de la concertation en rendant les Ad’AP obligatoires alors qu’il était envisagé qu’ils demeurent facultatifs. Je salue avec gratitude l’engagement de notre rapporteur Christophe Sirugue sur ce point. Les ordonnances ont vu le jour le 26 septembre 2014. Les Ad’AP doivent donc être déposés dans les préfectures au plus tard le 27 septembre prochain et les demandes de dérogation devaient être sollicitées avant le 27 juin dernier.
Les ordonnances ont suscité un vaste débat à propos des délais de mise en oeuvre. Notons le travail positif accompli par le Sénat visant à bien encadrer la prorogation du délai de dépôt. Fixé par l’ordonnance à trois ans, il a été ramené à douze mois en cas de difficulté technique liée à l’évaluation après programmation des travaux et à six mois si un premier projet d’Ad’AP a été rejeté. Un délai de trois ans est accordé en cas de difficultés financières. Seule une décision expresse et motivée du préfet peut l’allonger. En aucun cas le maître d’ouvrage ne peut décider de son propre chef sans garde-fous de prolonger les délais. Ne pas déposer un Ad’AP expose à des sanctions financières, administratives et pénales, tout comme son non-respect après son dépôt. Tous les établissements recevant du public demeurent soumis à l’obligation d’accessibilité. Il y a là selon moi des points très positifs. Je vous remercie par ailleurs, madame la secrétaire d’État, de la mise en place de l’outil d’auto-diagnostic.
Comme ma collègue Véronique Massoneau, j’appelle votre attention, chers collègues, sur les dérogations que les communes sont susceptibles d’obtenir. Certaines prétendent déjà être dans l’incapacité d’agir. Il existe pourtant des critères. Il faut donc missionner clairement les préfets afin qu’ils répondent dans des délais ne permettant pas d’invoquer la règle selon laquelle le silence vaut accord.
Le Sénat a également introduit des points négatifs dans le texte présenté par le Gouvernement mais notre commission a eu à coeur de revenir à un texte plus équilibré dans le respect de la loi d’habilitation inspirée de la large concertation de l’hiver 2013. Elle a aussi cherché à améliorer le texte initial du Gouvernement. En voici quelques exemples, sans exhaustive. Notre rapporteur a suggéré la suppression du dispositif voté par le Sénat appliquant aux organismes et sociétés de logements locatifs sociaux des dérogations particulières de mise en accessibilité lors de la construction de maisons individuelles vendues en l’état futur d’achèvement.
Le groupe RRDP a suggéré de remettre en vigueur la conformité de l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, ce qui est une très bonne chose. J’ai proposé une disposition, qui a été acceptée, interdisant aux autorités organisatrices de transports d’appliquer aux personnes handicapées un prix supérieur à celui appliqué aux autres voyageurs. Il s’agit là d’une question de principe et de justice. Pas de double peine ! Si l’on veut bien regarder les choses avec un peu de distance et ne pas se cacher derrière son petit doigt, ce n’est que justice ! La prise en charge par la collectivité de ces services est souvent dérisoire au regard des montants qu’elle consacre à la charge de l’AOT pour les autres usagers. Il me semble néanmoins que le débat est susceptible d’améliorer l’article 4 en limitant les motifs que les assemblées générales de copropriété peuvent invoquer pour refuser la mise en accessibilité des parties communes.
À l’heure où nous allons adopter le texte, je mesure l’attente des personnes touchées par un handicap et de leurs familles, en souhaitant que ce texte donne lieu rapidement à des avancées positives et directes. Je mesure aussi la détermination qu’elles exigeront des maîtres d’ouvrage. La démarche proposée est la seule susceptible d’aboutir à une avancée pragmatique et concrète sans rogner sur l’ambition initiale car elle seule nous permet d’avancer vers l’accessibilité universelle sans nier les difficultés et en proposant des solutions encadrées dans le temps et des moyens pour les lever. C’est la raison pour laquelle je vous invite, chers collègues, au nom du groupe socialiste, républicain et citoyen, à vous inscrire dans la dynamique proposée par le Gouvernement et par notre rapporteur, en soulignant l’implication de l’un comme de l’autre pour arriver à un résultat et à des solutions équilibrés.
Certains doutent de la portée, dans la durée, du texte sur lequel nous devons nous prononcer. Beaucoup diront qu’il ne va pas assez loin, d’autres qu’il va trop loin. La grande difficulté était justement de parvenir à un consensus acceptable par tous afin de continuer d’avancer. Je crois que nous avons réussi. J’espère néanmoins que chacun se prononcera ici sans retirer quoi que ce soit des points positifs issus des débats du Sénat ou de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et en adoptant les quelques améliorations suggérées par les amendements supplémentaires proposés par les différents groupes visant à améliorer encore la qualité de vie des personnes handicapées, à leur donner plus d’autonomie et plus d’espoir dans leurs possibilités de réaliser leur projet de vie et à faire évoluer le regard de la société sur les personnes porteuses d’un handicap.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 26 septembre 2014 et la décision du Gouvernement de procéder par voie d’ordonnance découle d’une constatation, celle de l’impossibilité dans laquelle se trouvent les collectivités territoriales, les services de l’État, les entreprises, les professions libérales, les artisans et les commerçants de mettre en oeuvre au 1er janvier 2015 les dispositions de la loi du 11 février 2005, loi que l’actuelle majorité n’avait d’ailleurs pas voté à l’époque en prétendant qu’elle n’allait pas assez loin. J’ai la conviction, au contraire, qu’elle constitue une immense avancée et qu’elle a créé une véritable prise de conscience de l’impérative nécessité de reconnaître aux personnes handicapées tous leurs droits, ceux de tout citoyen, et de leur offrir toutes les capacités d’en jouir quel que soit leur handicap.
La loi de 2005 a donné lieu à d’immenses progrès, notamment l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire et la création de nombreux postes d’auxiliaires de vie scolaire dont nous savons que les fonctions doivent encore être stabilisées et pérennisées. On lui doit également la création de nombreuses places d’accueil pour les personnes les plus lourdement handicapées. Néanmoins, de trop nombreuses personnes handicapées sont encore privées de solution d’accueil. Des efforts restent à faire sur tous les points. La loi de 2005 a aussi fait progresser l’aménagement de la voirie et du cadre bâti. Il faut souligner ici les efforts consentis par les élus locaux afin d’améliorer l’accessibilité. De nombreux diagnostics d’accessibilité comportant la définition d’un taux d’accessibilité et la description des moyens pour tendre vers une accessibilité optimale et d’importants travaux ont été réalisés par les élus locaux.
Néanmoins, la loi ayant été promulguée le 11 février 2005 et mise en oeuvre dans les collectivités à partir de 2007 ou 2008 par le recours à des cabinets spécialisés pour établir les diagnostics d’accessibilité et à des travaux gigantesques avec des moyens financiers de plus en plus restreints et des normes d’accessibilité souvent trop contraignantes, la date du 1er janvier 2015 prévue par la loi pour la mise en accessibilité complète de la voirie et du cadre bâti devenait impossible à respecter. En raison de ce constat, le Gouvernement propose un projet de loi procédant selon vos propres termes, madame la secrétaire d’État, d’« un équilibre faisant de l’accessibilité un processus réellement irréversible tout en évitant que des contraintes insupportables pèsent sur les collectivités territoriales et les acteurs du monde économique ».
Nous approuvons la recherche d’un tel équilibre grâce auquel sera poursuivie une politique d’accessibilité, mais sous une réserve. Un principe, selon nous, doit rester incontournable. Le principe édicté par la loi du 11 février 2005 permet à toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature de leur handicap, mental, physique ou sensoriel, qu’il touche des enfants, des familles, des personnes âgées, des publics nouvellement arrivés sur notre territoire ou des personnes en situation d’illettrisme, d’accéder en toute autonomie à la cité quel que soit le lieu où ils se trouvent.
Toute entorse à ce principe aurait pour conséquence immédiate de décrédibiliser totalement la politique en faveur du handicap. Malheureusement, madame la secrétaire d’État, votre projet comporte de nombreuses entorses souvent inacceptables pour les personnes à mobilité réduite : j’y reviendrai dans quelques instants.
Pour pouvoir poursuivre leur politique en faveur de l’accessibilité, les acteurs ont besoin de temps. À ce sujet, la mise en place des agendas d’accessibilité programmée, les Ad’AP, me paraissent de nature à répondre à cette double préoccupation de rendre publique la volonté des acteurs de parvenir à l’accessibilité tout en s’engageant dans la réalisation d’un programme sur trois, six ou neuf ans, en fonction de l’ampleur des travaux à réaliser.
Je partage également, monsieur le rapporteur, votre amendement, déposé et adopté en commission des affaires sociales, visant à revenir sur la décision du Sénat d’exclure du droit à la mise en accessibilité les points d’arrêt des transports pour les enfants scolarisés à temps partiel.
Je comprends tout à fait les difficultés financières que cela peut poser aux autorités organisatrices de transport ou aux départements, qui conservent, à ce jour encore, la charge du transport scolaire. Je ne vois cependant pas ce qui peut justifier une telle différence de traitement entre un enfant scolarisé à temps partiel et un enfant scolarisé à temps plein.
Les dispositions adoptées par le Sénat visant à revenir sur une partie des obligations de mise en accessibilité des logements par les bailleurs sociaux – pour les logements neufs dont ils se portent acquéreurs – me paraissent constituer un net recul du processus visant à l’accessibilité universelle. Si la commission des affaires sociales a également corrigé ce point, la limitation de l’obligation de réaliser des ascenseurs aux seuls immeubles neufs dits « R + 4 », c’est-à-dire aux immeubles de cinq étages, me parait très contestable.
Un autre point, dont Mme Laclais a parlé, emporte mon approbation : je partage son souci concernant les transports dédiés aux personnes handicapées, qui ne doivent pas faire l’objet, à l’intérieur d’un même plan de transport urbain, d’une tarification supérieure à tout autre réseau de transport.
Enfin, madame la secrétaire d’État, vous avez simplifié certaines normes d’accessibilité par voie réglementaire. À titre d’exemple, la loi de 2005 prévoyait que toutes les entrées des établissements publics soient accessibles à tous. S’il s’avère impossible de réaliser des travaux sur l’entrée principale compte tenu de leur coût excessif, vous leur donnez la possibilité d’une seconde entrée répondant à la condition d’accessibilité. Autre exemple significatif, dans les hôtels, plutôt que d’exiger qu’il soit possible de faire le tour du lit avec un fauteuil roulant, il suffira qu’un seul côté du lit offre la largeur nécessaire.
Je suis le premier à reconnaître que l’excessivité tue l’efficacité et que notre objectif doit rester l’accessibilité universelle.
Mais certains points de la loi ne manquent pas de m’inquiéter et soulèvent également les protestations des associations. Je pense principalement aux transports en commun.
La loi de 2005 prévoyait que la chaîne du déplacement devait être organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité. Or l’ordonnance du 26 septembre 2014 a supprimé les mots : « dans sa totalité ». Ce qui veut dire, et vous l’avez d’ailleurs très clairement indiqué, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, que certains points d’arrêts ne seront pas aménagés aux normes d’accessibilité.
Comment seront définis ces points ? Est-ce en fonction de la fréquentation ? Une personne à mobilité réduite d’un secteur rural ou peu fréquenté aurait-elle moins de droits qu’une personne d’un secteur plus urbain ?
Ce point constitue pour nous une entorse grave au principe d’accessibilité universelle et un très mauvais signal adressé à l’ensemble des acteurs.
Je comprends la nécessité d’être pragmatique, comme les difficultés techniques et financières que cela engendre. Nous maintenons cependant que c’est un objectif vers lequel il nous faut tendre.
De même, j’entends bien les difficultés rencontrées par les petites communes, c’est-à-dire les communes de moins de 1 000 habitants, pour réaliser leur plan d’accessibilité. Elles ont besoin d’être aidées financièrement et techniquement mais l’absence d’obligation de mise en oeuvre d’un plan d’accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics ne doit pas les exonérer de leurs obligations dans ce domaine.
Enfin, et c’est un point crucial, les trop nombreuses dérogations envisagées dans le cadre de la mise en accessibilité du cadre bâti, notamment dans les copropriétés, nous laissent craindre une trop grande facilité à renoncer à la mise en accessibilité.
Je ne comprends toujours pas, madame la secrétaire d’État, malgré les réponses que vous nous avez apportées en commission, comment l’administration pourra faire face à l’accumulation des demandes de dérogation qui vont lui être adressées dans les semaines à venir.
À titre d’exemple, dans mon département, seuls une dizaine de dossiers ont été déposés à ce jour, alors que 40 000 sont attendus. Faute de pouvoir les traiter dans les délais impartis, nous redoutons l’absence de réponse de l’administration et donc l’approbation tacite de ces demandes de dérogation.
C’est là toute la faiblesse de votre projet et je crains, malheureusement, que toutes les dispositions n’aient pas été prises pour éviter cela.
De nombreux établissement risquent, de ce fait, de rester encore inaccessibles pour des décennies. Cette faiblesse, l’accumulation des motifs de dérogation – murs porteurs, refus de la copropriété, trottoirs insuffisamment larges et j’en passe – crée aussi une inégalité vis-à-vis de tous ceux qui ont été exemplaires en matière d’accessibilité depuis la loi de 2005.
Enfin, nous savons que de nombreuses mesures ont été ou vont être prises par voie réglementaire : nous ne pouvons pas forcément les contrôler alors qu’elles nous semblent constituer un recul de l’accessibilité universelle. Je pense notamment à tout ce qui concerne la définition des seuils d’accès aux logements et à l’accessibilité dans les logements.
Madame la secrétaire d’État, la loi de 2005 devait être adaptée. La proposition que vous nous faites nous paraît, sur certains points, répondre à cette attente. Mais elle est aussi, aujourd’hui, vécue comme un net recul par un très grand nombre d’associations ou de personnes à mobilité réduite.
Elle est même parfois vécue comme une renonciation à ce droit fondamental, cette liberté essentielle de toute personne : pouvoir se déplacer en toute autonomie.

Aussi, madame la secrétaire d’État, nous voulons insister auprès de vous pour que votre proposition puisse être accompagnée de points d’étapes sur l’avancement de la mise en accessibilité.
Avec mes collègues du groupe Les Républicains, nous attendons de vous que vous nous rassuriez sur les moyens mis en oeuvre pour l’application de ce texte.
Nous voulons insister sur la nécessaire mobilisation de tous sur cet objectif d’accessibilité universelle afin que plus jamais nous n’ajoutions à la souffrance du handicap l’humiliation de l’impossibilité de se déplacer en toute autonomie.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la politique publique en faveur des personnes souffrant de handicap, qui est au coeur de l’exigence de cohésion sociale et de solidarité nationale chère au groupe de l’Union des démocrates et indépendants, a été initiée par la loi d’orientation du 30 juin 1975.
Traduction de cette exigence, le principe d’une mise en oeuvre progressive de l’accessibilité du cadre bâti et des transports a été consacré par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ses articles 41 et 45 prévoyaient en effet un délai de dix années pour la mise en oeuvre de l’accessibilité du cadre bâti comme de l’ensemble des services publics de transport collectif.
Pour la première fois, une loi définissait, de manière précise, des objectifs et des délais pour faire de l’obligation de mise en accessibilité une réalité.
L’année 2005 a ainsi constitué le point de départ d’une véritable dynamique permettant de mobiliser notre société tout entière autour d’une exigence de cohésion sociale : éliminer l’intégralité des barrières susceptibles d’entraver l’accomplissement personnel et professionnel des personnes handicapées.
Elle a surtout contribué à faire évoluer les mentalités car l’accessibilité ne constitue pas seulement une réponse aux difficultés de déplacements des personnes handicapées : elle doit également permettre de préparer la France au défi du vieillissement de sa population et de la perte d’autonomie.
Pour autant, force est aujourd’hui de constater que, malgré l’engagement de l’ensemble des acteurs publics ou privés, les délais fixés par la loi du 11 février 2005 ne pourront être respectés : la France ne sera pas au rendez-vous du 1er janvier 2015 prévu par la loi.
En effet, en dépit d’une véritable dynamique, de nombreux retards ont été constatés. Ils sont principalement dus à une évaluation imparfaite du coût des travaux nécessaires, à une mauvaise appréciation des délais nécessaires à la réalisation de l’ensemble de ces travaux, à la complexité des règles à respecter et à un manque d’harmonisation des pratiques des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité.
Pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants, il serait inutile et improductif de pointer du doigt les défaillances des uns ou des autres. Un temps précieux a déjà été perdu depuis la loi de 2005 et la seule exigence à laquelle nous devons désormais répondre est la poursuite des efforts engagés.
Telle était la vocation de la loi du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, que notre groupe a soutenu.
Cette loi prévoit la création d’un nouvel outil de pilotage : l’agenda d’accessibilité programmée – l’Ad’AP – qui permettra à un propriétaire ou à un exploitant d’obtenir un délai supplémentaire pour la mise en accessibilité, dès lors qu’il s’engage sur un plan de travaux pluriannuels de mise en accessibilité ainsi que sur leur programmation financière.
La mise en place de cet outil ne signifie pas, à notre sens, l’abandon des objectifs fixés par la loi de 2005. Au contraire, il permet de définir rapidement de nouvelles modalités de mise en oeuvre de cette loi afin de donner des perspectives réalisables au chantier de la mise en accessibilité, tout en prenant mieux en compte les difficultés qui ont pu être rencontrées.
À cet égard, n’oublions pas que cet outil doit permettre de décrire précisément les travaux pluriannuels de mise en accessibilité d’un ou plusieurs établissements ou installations.
L’Ad’AP précisera également la programmation des financements associés et la durée de réalisation de ces travaux, qui pourra varier selon la catégorie de l’établissement, sa fréquentation, ainsi que les caractéristiques du patrimoine que le propriétaire ou le gestionnaire d’établissements ou d’installations prévoira de mettre en accessibilité.
N’oublions pas non plus que, sans dépôt d’un Ad’AP, le non-respect de l’échéance du 1er janvier 2015 sera, sauf dérogation validée, toujours passible des sanctions pénales prévues par la loi de 2005.
En outre, des sanctions financières graduées sont également prévues en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre de l’agenda.
Pour autant, comment se satisfaire du fait que les échéances fixées par la loi n’aient pu être respectées ? Comment ne pas regretter d’avoir été amenés à légiférer de nouveau ? Cet écueil n’aurait-il pas pu être évité en adoptant une méthode différente, avec des rendez-vous réguliers impliquant l’ensemble des acteurs engagés au service de la mise en accessibilité ? Ne pouvait-on pas anticiper les difficultés qui sont survenues et définir des solutions consensuelles pour y répondre plus rapidement ?
Nous devons être conscients qu’en repoussant les délais de mise en accessibilité, nous donnons l’impression aux personnes handicapées, à leurs proches ainsi qu’aux associations qui les soutiennent, que la dynamique engagée en 2005 subit un coup d’arrêt.
Parce qu’elle précise les modalités concrètes du report de l’objectif de 2005, l’ordonnance que ce projet de loi vise à ratifier ne fait malheureusement qu’amplifier ce malaise, et ce d’autant plus que la rédaction de l’ordonnance aurait, je le crois, pu retranscrire plus fidèlement l’esprit de la loi du 10 juillet 2014.
Nous avons néanmoins conscience que parvenir à un point d’équilibre parfait entre les inquiétudes des personnes handicapées et la prise en compte des difficultés de la mise en oeuvre de l’accessibilité était compliqué.
En tant que maire, je pense tout particulièrement aux collectivités territoriales qui font sur le plan financier des efforts réguliers et conséquents, alors même que la dotation globale de fonctionnement diminue de manière drastique.
Je crois qu’en définitive, la méthode définie par la loi du 10 juillet 2014 et la rédaction de cette ordonnance constituent sans doute un moindre mal pour éviter deux écueils majeurs : le statu quo, qui aurait inévitablement entraîné une judiciarisation à outrance, et l’abandon pur et simple de l’objectif de mise en accessibilité.
Nous sommes toutes et tous convaincus qu’il est impératif de préserver la dynamique et de poursuivre les efforts engagés autour de l’objectif de mise en accessibilité tout en adoptant une approche pragmatique. Le législateur avait, en 2005, fixé des objectifs ambitieux.
Nous ne devons pas y renoncer, même si l’échec collectif que nous devons assumer aujourd’hui nous force à légiférer de manière nécessairement insatisfaisante.
Tel est, je crois, l’esprit de cette ordonnance qui, en dépit de ses imperfections regrettables, vise bel et bien à poursuivre l’effort de mise en accessibilité universelle, qui est l’objectif que nous avons toutes et tous en partage.
Aussi notre groupe soutiendra ce projet de loi car nous estimons que, quarante années après la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, il est plus que temps de mettre en oeuvre des solutions concrètes et réalistes pour faire de l’accessibilité une réalité.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, quand les actes du quotidien des personnes en situation de handicap s’apparentent – comme c’est le cas en France – à de véritables parcours du combattant, c’est que nous avons échoué à bâtir la société inclusive que nous invoquons tous, régulièrement, sur ces bancs.
Cet échec, nous en portons tous la responsabilité, individuellement et collectivement. Je ne m’étendrai pas sur le manque de places en structures d’accueil, sur les difficultés à mettre en place l’école inclusive ni sur les défis à relever pour accéder à un emploi ou pour le garder quand on naît – ou devient – handicapé.
Restons-en à la question de l’accessibilité, qui nous occupe à travers ce projet de loi de ratification, et dont il y a tant à dire.
Quarante ans après la première loi d’orientation en faveur des personnes handicapées, dix ans après la loi du 11 février 2005 et neuf ans après la signature de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, le constat est affligeant. Seraient accessibles seulement 15 % des établissements recevant du public, moins de six écoles primaires sur dix, 40 % des collèges, 20 % des lycées. Quant aux transports, maillon essentiel, seules 42 % des lignes de bus seraient accessibles aux handicapés moteurs.
Pourtant, rappelons-le, l’accessibilité universelle doit être une priorité. Il y va de l’égalité dans l’accès à la vie sociale, économique, politique et culturelle. Il y va de l’égalité réelle entre les citoyens, entre tous les citoyens, principe absolu pour une démocratie soucieuse de l’intérêt général et d’un vivre ensemble qui fait tant défaut aujourd’hui.
Si le délai de dix ans fixé par la loi du 11 février 2005 pour rendre accessibles les administrations, les commerces, les écoles, les habitations, les transports et la voirie n’a pas été suffisant, c’est bien le volontarisme des uns et des autres qu’il faut interroger.
Aujourd’hui, nous avons donc la responsabilité de faire mieux, et, surtout, de faire en sorte que cette accessibilité universelle devienne réalité, d’où le long travail de concertation qui a été mené et qui a abouti à un équilibre délicat, fragile, mais non moins essentiel.
Il faut en effet entendre aussi les difficultés financières de certains commerces ou des petites communes, qui sont particulièrement prégnantes en cette période de réduction de leurs dotations budgétaires. C’est pourquoi il faudra s’assurer que les dispositifs d’accompagnement financier, notamment via la Caisse des dépôts, soient facilement mobilisables.
Mais l’argument financier ne doit plus conduire à retarder encore des travaux dont l’utilité, pour tous, est indéniable. C’est aussi le but des agendas d’accessibilité programmée, qui doivent mettre en place et planifier dans le temps un système de financement adéquat pour les travaux à mener.
Les différents outils proposés ici doivent permettre d’aboutir, enfin, à cette accessibilité universelle. Qu’il s’agisse des Ad’AP, des PAVE ou des SDA, ces outils sont souvent présentés comme le point manquant de la loi de 2005. Ce sont eux qui vont permettre que les choses changent, enfin.
Gageons qu’il ne s’agit pas là d’un voeu pieux, car nombre de dispositions font craindre ici le pire.
Le tissu associatif est très critique, on l’a déjà dit, dans la façon dont cette ordonnance décline les grands principes sur lesquels il y avait eu un accord lors des concertations.
Le collectif pour une France accessible, qui a été reçu par le groupe d’études que je préside, n’a pas caché sa déception, parlant même de recul par rapport aux positions adoptées par le Parlement en 2014. Je partage leur point de vue. Nous sommes aujourd’hui trop loin du point d’équilibre initialement trouvé.
Quelques points notamment sont cruciaux : l’accessibilité des transports, qui se limiterait aux seuls points prioritaires alors que c’est bel et bien l’ensemble de la chaîne des déplacements qu’il faut rendre accessible, dans un souci de continuité ; les délais supplémentaires pour le dépôt des Ad’AP et SDA, qui donnent l’impression de sans cesse remettre à plus tard cette accessibilité ; les dérogations sans justification pour les copropriétés ou encore celles accordées de facto du fait de l’impossibilité pour l’administration de traiter dans le temps toutes les demandes, notamment pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, soit tout de même près de 80 % d’entre eux. Il faut aussi aller plus loin en ce qui concerne le besoin de formation spécifique, initiale et continue, pour les personnels en contact avec le public dans les ERP.
Comme le volontarisme de tous les acteurs, publics comme privés, doit commencer par celui du législateur, nous espérons que ce débat sera l’occasion de revenir sur ces différents reculs.
Pour que nos différences soient vues et vécues comme une force et non comme un obstacle, pour que chacun trouve sa place dans notre société, soyons exemplaires dans nos votes et commençons par rendre notre société réellement accessible à tous.
Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste et du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le principe de la généralisation de l’accessibilité des bâtiments et des transports aux personnes handicapées avait été fixé pour 2015, soit dix ans après le vote de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette loi, utile et juste, avait comme intérêt de joindre la question des transports à celle de l’urbanisme, de la voirie et des ERP. Elle prend en compte également les différentes contraintes liées aux différents handicaps, qu’ils soient physiques, mentaux, sensoriels ou psychiques.
Malheureusement, la loi n’a pas été soutenue sur le plan politique comme elle aurait dû l’être ces dernières années. Ce constat est confirmé par le rapport « Réussir 2015 » de la sénatrice Claire-Lise Campion publié en 2013.
En effet, si de récentes améliorations ont été soulignées, il ne faut pas pour autant oublier la réalité des chiffres. En 2015, seules 42 % des lignes de bus sont accessibles aux handicapés moteurs. En matière de logement, les opérations de rénovation urbaine ont détruit 90 000 logements dans de grands immeubles pour les remplacer par de plus petites structures dépourvues d’ascenseurs. Enfin, en matière d’accessibilité des écoles publiques, l’Association des paralysés de France recense, pour les handicapés moteurs, moins de six écoles primaires sur dix accessibles, seulement 40 % des collèges, et l’estimation tombe à 20 % pour les lycées, comme vient de le souligner Mme Pompili.
Or l’accessibilité des lieux publics est un enjeu essentiel pour notre société. De nombreux maires l’ont bien compris. Les associations d’élus, notamment l’Association des maires de France, que nous pouvons remercier, ont entamé un long processus d’information et d’accompagnement des élus faisant preuve de volontarisme sur le sujet, et je tiens à saluer l’engagement et la pédagogie dont a fait preuve Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l’accessibilité, qui a fait un gros travail auprès des élus de notre territoire.
Avancer sur l’accessibilité, c’est avancer sur le vivre ensemble et je peux vous assurer que, pour les élus locaux, aller sur ces sujets et traiter les questions de handicap de manière transversale dans leurs politiques locales est une préoccupation quotidienne.
Cependant, tout cela a un coût financier élevé pour les collectivités. À titre d’exemple, la mise en accessibilité d’un arrêt de bus s’élève à 15 000 euros. Si l’on veut intervenir sur tous les arrêts importants, c’est lourd.
Compte tenu des réalités financières des collectivités locales, il n’est pas toujours possible de réaliser les travaux nécessaires en temps et en heure. C’est d’ailleurs pour cette raison que la sénatrice Claire-Lise Campion a proposé de poursuivre une démarche réaliste et efficace en ciblant les priorités, en s’engageant concrètement sur la mise en place de ces agendas d’accessibilité programmée et en modulant les délais de réalisation. Autrement dit, il s’agit de se donner un délai supplémentaire certes, mais de l’utiliser à bon escient pour avancer réellement.
Pour finir, je souhaite insister sur la qualité du dialogue entre les différents acteurs. Chacune des associations de personnes handicapées s’est montrée d’une grande disponibilité et a fait preuve d’une grande patience lors des différents échanges, d’une grande compréhension, en restant toujours constructive. Les associations d’élus et les décideurs politiques ont également oeuvré dans le bon sens, et je veux vraiment saluer l’action de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre d’alors, qui a relancé la dynamique. Ils ont su se mobiliser pleinement pour écouter chacune des demandes et être capables de proposer dans cette ordonnance des actions concrètes et adaptées aux besoins. Sans cette concertation massive et constructive entre les élus et les associations, ce projet de loi n’aurait pas été d’une aussi grande qualité et d’une aussi grande pertinence.
L’accessibilité est un domaine dans lequel se joue la crédibilité d’engagements forts en faveur d’une société plus solidaire. C’est un domaine complexe, doté de nombreuses règles techniques, touchant à ce qui fait la vie de tous les jours pour plusieurs millions de nos concitoyens.
Alors, si l’ordonnance de ratification de la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 a été publiée le 26 septembre 2014, il nous appartient aujourd’hui de la ratifier.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en 2005, le législateur entendait poser le principe d’accessibilité comme une réponse universelle, permettant d’assurer l’accès de tous à tout.
Cette question est importante car près de 40 % de nos compatriotes estiment avoir rencontré au moins une difficulté de mobilité dans le cadre de leur vie quotidienne, 6 millions de personnes seraient concernées par une limitation de leur autonomie, personnes âgées, personnes handicapées, personnes momentanément accidentées, dont 594 000 se déplacent en fauteuil roulant.
L’article 41 de la loi du 11 février 2005 prévoyait que tous les locaux d’habitation, lieux de travail et établissements recevant du public, les ERP, existants devaient respecter au plus tard en 2015 les exigences d’accessibilité.
Certaines collectivités ou organismes, cela a été souligné à plusieurs reprises, ont bien avancé et ont relevé très rapidement le défi en faisant preuve d’une grande responsabilité. Je voudrais d’ailleurs rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont su mesurer l’importance de cet engagement. Il faut aussi reconnaître que d’autres n’ont cependant toujours rien fait.
Les disparités territoriales demeurent par conséquent très fortes. Cette situation ne peut durer plus longtemps, et il devient urgent de répondre aux obligations législatives.
Le rapport « Réussir 2015 » de la sénatrice Claire-Lise Campion, qui a réalisé un travail remarquable, a permis de jeter les bases des Ad’AP, les agendas d’accessibilité programmée, nouvelle approche de l’accessibilité qui impulse une autre vision de cette ambition. Il met en exergue les lacunes de 2005 qu’il nous appartient de combler : absence d’évaluation du coût des travaux, mauvaise appréciation des délais, manque d’accompagnement des propriétaires et complexité des règles, absence de financement de la loi.
Il est impératif de sortir de cette impasse. À la suite de ce rapport, le Gouvernement a lancé, d’abord avec Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, une grande concertation de 140 heures pour que 2015 soit non pas une année blanche mais une année permettant d’engager une stratégie innovante, efficiente et efficace, en instaurant et en rendant obligatoire les agendas d’accessibilité programmée. Ce travail s’est poursuivi sous la houlette du Premier ministre, Manuel Valls, qui a rappelé également les obligations.
Aujourd’hui, lorsque l’on parle d’efficience, d’innovation et d’efficacité, nous voyons bien qu’il faut absolument relever le défi pour que notre société, enfin, entre dans une dynamique de mise en accessibilité.
La stratégie est innovante, parce que les AD’AP permettront de penser différemment nos villes, nos chaînes de déplacement, les lieux d’accueil et, plus généralement, l’urbanisme. Elle est efficiente, parce que l’accessibilité sera enfin garantie dans les prochaines années, quelle que soit la situation de handicap ou de perte d’autonomie, et profitera donc à tous, les plus jeunes et les aînés. Elle est efficace, parce qu’il s’agit d’une programmation réelle, financée, rendue obligatoire et irréversible. Il était important de rappeler que la loi ne pouvait plus être contournée et qu’il convenait de fixer des règles intangibles pour lancer ce chantier de rénovation des équipements publics et privés.
Tous les acteurs vont donc s’engager sur un calendrier précis et chiffré des travaux. L’accessibilité est enfin au coeur du débat public. Nous devons ici faire preuve de responsabilité.
Je tiens à souligner la détermination et le volontarisme politique du Gouvernement après le comité interministériel du handicap de septembre 2013, confirmé par la conférence nationale du handicap en décembre 2014. Je veux saluer aussi le travail de notre rapporteur, qui, depuis plusieurs mois, a permis de faire évoluer ce texte.
Conformément à la Constitution, nous devons désormais ratifier l’ordonnance du 26 septembre 2014. Cependant, madame la secrétaire d’État, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, s’il s’agit bien d’une base d’engagement indispensable, nous devons rester d’une extrême vigilance sur les suites qui seront données pour réaliser concrètement les objectifs fixés par la loi et par les Ad’AP. Dans chaque département, nous devrons nous assurer que les règles soient respectées, sous le contrôle de l’État.
À mon tour, comme notre collègue, je souhaite que nous puissions prévoir des étapes d’évaluation pour vérifier ensemble que les mesures se concrétisent réellement. Il s’agit de répondre aux attentes des associations, qui expriment des inquiétudes légitimes sur ce sujet. Nous devons veiller à faciliter concrètement le quotidien de millions de personnes. Je mesure comme vous l’attente immense de nos concitoyens. Ce texte permet de lever un premier obstacle, mais il devra être suivi d’un certain nombre de mesures et de points d’évaluation pour nous assurer que nous respectons bien les objectifs de la loi. C’est une nouvelle vision pour notre société, qui se doit aussi de respecter l’esprit des conventions internationales.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cinq minutes, c’est le temps de parole que j’ai pour vous donner le sentiment qui est le mien quant au projet de ratification de l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité. Cinq minutes : il en faut parfois le double à une personne en situation de handicap moteur ou sensoriel pour accéder à un établissement recevant du public, monter une marche ou pousser une porte. Le moindre geste anodin du quotidien devient alors un parcours du combattant.
Quand certains ne voient dans l’accessibilité qu’un amas de normes et de complexité, je veux, pour ce qui me concerne, rappeler deux choses. D’abord, il n’y a pas de caprice en la matière, mais bien une réalité, que la ratification prochaine de cette ordonnance vient rappeler. Les gestionnaires d’établissements recevant du public ont eu dix ans, depuis le 11 février 2005, pour agir et se mettre aux normes d’accessibilité. Dix ans plus tard, devant les contentieux qui se profilaient, il a bien fallu trouver une solution.
Ensuite, la question de l’accessibilité, dans sa dimension universelle, est un enjeu de développement durable et d’aménagement du territoire. En effet, elle dit beaucoup de ce que nous voulons pour nos villes et nos villages dans un futur proche : des environnements où chacun trouve sa place, respecte l’autre et l’écoute, quels que soient sa spécificité, son mode de déplacement ou sa vitesse. Tout le monde doit pouvoir cohabiter de façon durable. C’est une des exigences pour faire s’exprimer la part de citoyenneté qui réside en chacun de nous.
D’ailleurs, dans son observation générale relative à l’article 9, le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies rappelle que : « La Convention relative aux droits des personnes handicapées fait de l’accessibilité l’un des principes fondateurs – une condition préalable essentielle de la jouissance effective par les personnes handicapées, sur la base de l’égalité des différents droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. L’accessibilité doit être envisagée dans le contexte de l’égalité et de la non-discrimination. »
Sur le fond, je félicite notre rapporteur, Christophe Sirugue, pour la volonté de dialogue qui l’a toujours animé sur ce dossier – je crois que les associations le savent bien.
Je souhaite également relever plusieurs points de satisfaction. Premièrement, s’agissant des précisions apportées sur la formation des personnels accueillant des personnes en situation de handicap dans les ERP, au-delà de tous les cadres juridiques que nous pourrons mettre sur pied, rien pourtant ne remplacera la sensibilisation, afin de faire évoluer les comportements.
Deuxièmement, l’obligation faite aux commissions communales d’accessibilité de tenir une liste à jour des ERP accessibles ou des ERP ayant déposé une demande d’Ad’AP est une nécessité, afin de pouvoir suivre l’avancée réelle et effective de la mise en accessibilité. Chacun se souvient que l’absence totale de suivi dans la mise en oeuvre de la loi de 2005 avait constitué justement l’un de ses points noirs.
Troisièmement, l’obligation pour une copropriété de motiver son refus de travaux. Il y avait clairement là un nid à contournements de la loi, comme nous le rappelle dans son avis rendu en mai 2015, sur le présent texte, le défenseur des droits.
Quatrièmement, l’obligation d’établissement de plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics – PAVE – pour les communes de plus de 1 000 habitants. Le relèvement du seuil était, je crois, nécessaire pour ne pas ajouter à l’inquiétude de nos petits villages qui ont déjà fort à faire financièrement. Je rappelle, cependant, que l’accessibilité est globale. Ainsi, il n’est interdit à personne d’envisager, malgré tout, des travaux de moindre ampleur, comme des bandes podotactiles ou une signalisation spécifique.
Cinquièmement, sur la question spécifique des transports, je sais gré à M. le rapporteur d’avoir, à l’article 5 bis, prévu que les représentants légaux des enfants pourront se faire assister des équipes des MDPH en vue de l’établissement des dossiers de mise en accessibilité des points d’arrêt. Il ne faut pas laisser les parents affronter seuls les problèmes. Par ailleurs, je me félicite que l’accessibilité de ces mêmes points d’arrêt ne soit plus seulement obligatoire lorsque la scolarité est à temps complet. Étant donné, en effet, que 10 % à 15 % d’élèves suivent une scolarité à temps partiel, beaucoup d’entre eux auraient de fait été exclus du dispositif, ce qui est bien évidemment contraire à l’esprit de l’habilitation que nous avons votée l’année dernière.
Pour commencer mon intervention, je vous parlais des cinq minutes, et parfois bien plus, qui sont nécessaires pour franchir des « montagnes ». Pour la conclure, je reviens à cette question du temps qui est, décidément, un facteur bien particulier pour toute personne en situation de handicap qui nous invite à le considérer, car il pose un problème au quotidien. C’est la raison pour laquelle, bien qu’elle puisse paraître imparfaite sur certains points, cette ordonnance constitue une opportunité que nous ne pouvons rater. Nous avons pris le temps qu’il fallait pour la concertation. Il était nécessaire. Il nous faut maintenant accélérer et concrétiser nos propositions.

La discussion générale est close.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente :
Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance no 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures cinq.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly