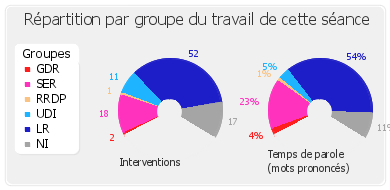Séance en hémicycle du 23 mai 2013 à 9h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche (n°s835, 1042, 983, 969).
Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de sept heures et seize minutes pour le groupe SRC, dont 180 amendements restent en discussion, dix heures et dix-neuf minutes pour le groupe UMP, dont 176 amendements restent en discussion, deux heures et cinquante-quatre minutes pour le groupe UDI, dont 55 amendements restent en discussion, une heure et quarante-neuf minutes pour le groupe Écologiste, dont 80 amendements restent en discussion, une heure et trente-cinq minutes pour le groupe RRDP, dont 32 amendements restent en discussion, une heure et vingt-deux minutes pour le groupe GDR, dont 13 amendements restent en discussion, et quarante minutes pour les députés non inscrits.

Hier soir, nous avons terminé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.
La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Madame la présidente, mesdames, messieurs, je vous remercie tout d'abord pour la qualité de vos interventions dans la discussion générale, qui faisait d'ailleurs écho à celle des débats en commission. Ils nous ont tenus presque deux nuits et nous ont permis d'avancer ensemble sur ce projet de loi, qui, pour la première fois, réunit enseignement supérieur et recherche, effectivement indissociables.
Je remercie Patrick Bloche, le président de la commission des affaires culturelles, et Vincent Feltesse, son rapporteur, pour la qualité de leur travail et la façon dont ils ont animé les débats, dans le respect des opinions de chacun. Je souhaite que notre discussion se poursuive dans cet esprit.
Hier, notamment dans la motion de rejet, j'ai entendu pas mal de contradictions.
On a prétendu que le projet était vide. Je pense que c'est une projection de ce que souhaite faire l'opposition puisqu'elle a déposé un grand nombre d'amendements de suppression. Si elle veut supprimer des articles, cela veut dire que le projet n'est pas vide et que nos propositions la gênent. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'a pas envie qu'il y ait un projet de loi, j'y reviendrai.
Certains d'entre vous ont critiqué une régionalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche et, deux phrases plus loin, la recentralisation. Là, j'aurais besoin d'un cours de géopolitique ou de décentralisation sur le pouvoir donné aux territoires parce que c'est tout de même un petit peu compliqué.
Peut-être fallait-il au contraire se réjouir de l'équilibre établi entre la la dynamique et de la spécificité des écosystèmes et la nécessité de revenir à un État stratège, un État qui ne se contente pas de réguler – ce qui n'était même pas le cas dans le quinquennat précédent – mais mène une action visible à l'international, en Europe et, surtout, au niveau national ; bref, un État qui prend en compte la dynamique des territoires tout en donnant les grandes orientations. Et c'est bien un projet de loi d'orientation que je vous présente.
J'ai entendu aussi beaucoup de nostalgie. Outre le fait que la nostalgie n'a jamais été un moteur pour l'avenir et que l'université et la recherche ont tout de même besoin d'une vision d'une projection dans l'avenir, cette nostalgie se teintait, notamment lors de la présentation de la motion de rejet, d'une autosatisfaction que je m'explique mal.
En effet, rappelons – Alain Claeys l'a esquissé – quelle était la situation du ministère lorsque j'ai pris mes fonctions.
Il y avait une impasse financière de 400 millions d'euros…
…dont, comme l'a notifié la Cour des comptes, 156 millions non budgétisés pour le dixième mois de bourse, ce que vous avez omis de rappeler hier. Ce dixième mois a pourtant été mis en valeur, annoncé, et annoncé encore, mais il n'a jamais été budgétisé correctement.
Mme Pécresse a avancé que l'Agence nationale de la recherche serait privée de 160 millions. Il y a là une confusion. D'abord, nous avons réinscrit 75 millions en crédits pérennes pour la recherche fondamentale qui en avait été privée. Le reste correspond à des ponctions faites les années précédentes sur les crédits récurrents de l'université pour pouvoir s'acquitter de ce dixième mois de bourse, qui n'a jamais été budgétisé correctement.
Il a donc d'abord fallu boucher les trous.
Les projets internationaux, comme c'était indiqué pudiquement dans le budget prévisionnel de 2013, faisaient l'objet de rebonds. S'agissant de 60 ou 80 millions d'euros, sur plusieurs projets, ce serait tout de même un gros rebond ! Disons plutôt que c'est un grand trou financier.
Tout cela a été signalé par la Cour des comptes, je ne m'appesantirai donc pas, mais il faut être conscient de la situation que nous avons trouvée.
Une confusion a aussi été entretenue sur l'augmentation de 25 % du budget des universités, et selon les orateurs, on a entendu parler de 9 milliards, de 15 milliards, avec une envolée à 20 milliards. En réalité, vous avez surestimé l'augmentation des budgets du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une telle augmentation aurait fait plaisir à tout le monde ! Je n'ai aucune envie de dénigrer qui que ce soit ou de faire preuve d'un esprit dogmatique ou sectaire : tout ce qui vient abonder les crédits des projets de l'enseignement supérieur et de la recherche est bienvenu. Seulement, pendant la législature précédente, en tant que députée je l'avais signalé à maintes et maintes reprises avec mes collègues, on additionnait les choux et les carottes, c'est-à-dire les crédits budgétaires propres du ministère avec d'autres, comme ceux de l'opération campus.
Mais pour cette dernière, sur les 5 milliards annoncés, toujours recyclés mais jamais distribués, lorsque je suis arrivée à ce ministère, cinq ans après l'annonce de ces plans, 153 millions d'euros seulement avaient été distribués au titre des crédits d'études. Pas un permis de construire n'avait été déposé, pas une pierre, pas un logement étudiant n'avait démarré, pour une raison très simple, c'est que les collectivités territoriales avaient été boutées hors du tour de table de la gouvernance alors même qu'elles ajoutaient un milliard d'euros à ces 5 milliards d'euros.
Nous avons remis en route les opérations campus, en fluidifiant les procédures, en abandonnant notamment toute idéologie sur le partenariat public privé, le dispositif juridique ayant totalement bloqué la procédure. Nous les avons réellement engagés sur le terrain, parce que nous avons besoin d'avoir des logements étudiants et de réhabiliter les bâtiments universitaires dégradés. Tout cela est possible grâce au fait que 60 % des projets sont repassés en maîtrise d'ouvrage publique, que la Caisse des dépôts permet d'avoir de nouvelles procédures beaucoup plus fluides, qu'il y a une bonne relation entre les sociétés de réalisation et les collectivités territoriales, celles qui aménagent sur le terrain. Bref, nous avons un État qui prend à la fois le meilleur du jacobin et le meilleur du girondin au profit d'un élan national.
Vous ajoutiez de même aux crédits budgétaires du ministère ceux prévus pour les grands investissements d'avenir. Mais tous les instituts de recherche technologique étaient au point mort. Nous avons débloqué la situation sauf pour l'un d'entre eux, incompatible avec les règles de l'Europe, qu'on n'avait pas prises en compte, au profit de la dynamique du territoire.
Enfin, dans ce budget vous incluiez également les dépenses fiscales et le crédit d'impôt recherche. Nous avions mis en place ce dernier il y a une quinzaine d'années. Vous avez élargi son assiette en 2008. Nous l'avons maintenu pour l'élargir et l'orienter davantage vers les PMI-PME et les entreprises de taille intermédiaire. Nous avons ajouté 200 millions d'euros pour l'innovation, tout en rétablissant le statut de la jeune entreprise innovante, que vous aviez escamoté au cours de la dernière législature et qui bénéficie particulièrement à toutes les entreprises des biotechnologies, qui ont besoin de temps pour avoir un retour sur investissement.
En additionnant ainsi les crédits récurrents, ceux qui servent vraiment à alimenter les projets de moyen et long terme, et les crédits extrabudgétaires, on arrivait effectivement à l'augmentation que vous mettiez en avant. J'ai décidé de laisser les crédits extrabudgétaires de côté et de ne retenir dans les comparaisons que ce qui fait le socle réel des financements de ce ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire les crédits budgétaires. En 2011, ils ont augmenté de 1,1 %, ce qui est un peu moins valorisant pour mes prédécesseurs. En 2012, ils ont augmenté de 1,5 % et, en 2013, de 2,2 %. Nous voyons donc bien qu'en dépit d'un contexte budgétaire contraint, nous avons non seulement maintenu mais augmenté l'effort.
Nous avons voulu le faire porter en priorité, comme dans ce projet de loi, sur la réussite des étudiants, et la partie dévolue aux aides sociales aux étudiants et à l'aide au logement pour notre opérateur, le CNOUS, a augmenté de 7,4 %.
Tels sont les chiffres réels, validés, confortés, un rapport de la Cour des comptes remettra prochainement les pendules à l'heure, je crois, et invitera à davantage de modestie.
En ce qui concerne la résorption de la précarité, comme il ne s'agit pas ici d'une loi de programmation, les 5 000 emplois qui seront créés au cours de ce quinquennat ont été inclus dans les 60 000 emplois créés par la loi de programmation sur la refondation de l'école de la République.
Ils ont également été confortés par une loi de finances pluriannuelle votée le 28 décembre dernier. Pour les trois ans à venir, il y aura bien 1 000 emplois créés par an, que le ministère a voulu cibler sur ce qui est sa priorité, la résorption de l'échec en licence et la réussite étudiante.
La précarité s'est beaucoup développée sous le quinquennat précédent, en raison d'une frénésie d'appels à projets, par l'ANR, ou encore sur les investissements d'avenir, par exemple. Vous avez parlé hier de « bureaucratisation » ; il se trouve que, dans le cadre d'un rapport pour l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, j'ai fait le compte : ce sont une trentaine d'acronymes, pour la plupart correspondant à de nouvelles entités juridiques, qui ont été créés sous le précédent quinquennat. Je ne pense pas que cette « stratification géologique », pour reprendre l'expression de Jean-Yves Le Déaut, premier vice-président de l'office, contribue à la dynamique et au nouvel élan que nous voulons donner à notre recherche et à notre enseignement supérieur.
Cette précarité est donc liée au remplacement de crédits récurrents par des appels à projets de façon tout à fait déséquilibrée. Il n'y a rien d'idéologique dans mes propos ; les appels à projets ne me font pas peur, mais il ne faut pas, surtout dans un milieu où le moyen et le long terme sont si importants, déséquilibrer subitement les procédures, en passant de crédits récurrents au recours exclusif ou presque à des appels à projets.
Il était donc urgent de rétablir un équilibre, de mettre fin à l'inflation des CDD ; nous l'avons fait. Ce n'est pas dans la loi mais mon ministère a engagé cette action. Nous nous sommes engagés à titulariser 2 100 personnels des universités par an, de façon à résorber l'ensemble des postes précaires évalués à 8 400. Cela concerne souvent des techniciens, que l'on oublie fréquemment lorsque l'on parle des personnels des universités et des organismes de recherche, alors qu'il n'y a pas de manipulations possibles sans eux. Bien souvent, ce qu'on réalise en laboratoire dépend aussi de leur compétence, et nous ne pouvons continuer à les faire aller ainsi de CDD en CDD, de projets en projets. Quand le projet se termine, il n'y a plus de techniciens, et l'on se rend compte que le laboratoire ne tourne plus, que l'on a ainsi perdu tout le savoir capitalisé des années durant. C'est surtout vrai pour les petits laboratoires, qui ne peuvent compenser une perte de techniciens ayant ces expertises spécifiques.
J'évoque ces 2 100 titularisations par an, même si ce n'est pas dans le projet de loi, car il est important d'exposer le cadre général de notre action. La loi n'est pas bavarde ; elle se cantonne à son domaine, défini constitutionnellement. Elle reprend les préconisations du rapport des assises, de celui de Jean-Yves Le Déaut, ainsi que de ceux des rapporteurs, au premier rang desquels Vincent Feltesse, sans sortir du domaine législatif, car nous voulons être efficaces le plus rapidement possible ; nous avons déjà engagé les actions qui ne relèvent pas du législatif.
En ce qui concerne les organismes de recherche, nous avons là aussi commencé d'agir, depuis le conseil d'administration du 14 novembre dernier. Nous avons demandé à l'Agence nationale de la recherche, recentrée sur ses missions, j'y reviendrai, de définir des programmes pluriannuels au profit des projets de recherche fondamentale, pour éviter de demander à nos chercheurs d'inventer des livrables, qu'ils ne peuvent anticiper ; la recherche fondamentale étant par essence exploratoire, elle comporte des risques et ne peut pas non plus préjuger des applications, qui ne sont pas prévisibles. Nous avons donc obtenu de l'ANR qu'elle remette en place des programmes pluriannuels.
Nous lui avons aussi demandé, et son conseil d'administration l'a voté, d'inscrire un plafond à l'embauche des CDD pour tous les appels à projets. Nous avons en outre redirigé, comme je l'ai dit, un peu plus de 70 millions d'euros des appels à projets vers des crédits récurrents pour les laboratoires, afin de permettre à la recherche fondamentale de retrouver son rythme et une certaine sécurité pour les projets de long terme. Ces projets sont souvent à l'origine de progrès dans les connaissances, qui font évoluer une société, la tirent vers le haut et redonnent du lustre à un pays, ce dont nous avons bien besoin, après dix ans de confusion. Ils rendent également possibles des innovations de rupture ayant un retour sur investissement plus important que les innovations incrémentales issues d'autres types de recherche ou de transferts.
Un agenda social s'ouvre avec les organismes, à qui nous avons demandé de maintenir un équilibre entre l'embauche, l'ouverture de postes pour les jeunes chercheurs, notamment pour permettre aux « post-doc » d'avoir un débouché et une insertion plus rapides que ceux qui s'offrent à eux aujourd'hui, et la titularisation des personnes aujourd'hui « trimbalées » de CDD en CDD.
S'agissant de l'université, si l'on veut exposer clairement la situation, il faut regarder l'historique. Au ministère, j'ai en permanence dans mon bureau un grand tableau Excel. Pardonnez-moi pour la publicité, ce n'est pas un logiciel libre, mais ce tableau a le mérite de bien montrer, université par université, l'évolution du budget, fonds de roulement et trésorerie, depuis le passage en RCE – responsabilités et compétences partagées. Toutes les universités, depuis qu'elles ont acquis cette autonomie opérationnelle, consomment leurs fonds de roulement et ont une trésorerie qui se dégrade. Pourquoi ? Parce que la loi LRU était une grande loi de transfert de la masse salariale vers les universités sans aucune anticipation de l'évolution,…
…par exemple du compte d'affectation spécial « Pensions », ni aucune prise en compte du GVT. Cela a d'ailleurs été dénoncé avec une grande fermeté, monsieur Hetzel, par les présidents d'université eux-mêmes, que vous avez si élégamment désignés hier, dans une lettre rendue publique dès le mois de janvier 2009. Il fallait un peu de temps pour observer l'effet du passage en RCE. Je tiens ce tableau Excel à votre disposition : il est très parlant. Le rouge gagne petit à petit les universités. Le compte n'y était pas au moment du transfert. Voilà pour la réalité des chiffres, incontestable, factuelle, nullement dogmatique ou idéologique.
Au passage, je dirai gentiment à l'une de vos collègues, qui a eu l'air de penser, hier soir, que la gauche ne connaissait pas les entreprises, contrairement à la droite, que j'ai travaillé quelques années en entreprise, dans une start-up, et que j'ai présidé un pôle d'innovation. Nous avons les uns et les autres des expériences de gestion, nous rencontrons tous des entreprises. Cette vision d'une gauche archaïque est révolue : nous avons nous aussi conscience que l'emploi se crée dans les entreprises.
Un point sur la réussite en licence et les raisons pour lesquelles ce projet de loi en fait une priorité ; et tout d'abord quelques chiffres. Au terme de la première année de licence, 43 % des étudiants passent en deuxième année, 28,4 % abandonnent et 25,5 % redoublent. Ce sont les chiffres les plus mauvais en Europe, pour des pays comparables. Seulement 33 % des étudiants français atteignent la licence en trois ans, 40 % en trois et quatre ans cumulés, contre 60 % en Allemagne, dans des filières non sélectives – il faut toujours comparer ce qui est comparable.
Face à ces chiffres, nous avons fixé des objectifs ambitieux : amener 50 % d'une classe d'âge à un diplôme du supérieur, contre 43 % aujourd'hui, et même seulement 37 % pour les « bac plus trois », c'est-à-dire si l'on n'inclut pas les titulaires de BTS ou de DUT.
Un plan, c'est vrai, a été lancé par mes prédécesseurs, plan de 730 millions d'euros pour la réussite en licence ; il a eu pour résultat un recul de 5 % de la réussite. Pourquoi ? En regardant ce plan de près, on voit qu'il n'y avait pas d'indicateurs, pas de traçabilité, qu'aucun contrat ne liait les universités à l'État. Quand on accorde 730 millions d'euros d'argent public, la moindre des choses est tout de même d'établir un certain nombre d'indicateurs, de préférence avec l'ensemble de la communauté éducative, pour mesurer ensemble la progression. Là, aucune traçabilité n'était prévue pour ces 730 millions d'euros.
Nous avons donc dû regarder de façon quelque peu aléatoire, avec la Conférence des présidents d'université, que je remercie de sa coopération, à quoi cet argent avait servi. La situation des universités se dégradait tellement qu'il a très souvent servi à poser des rustines, dans des premiers cycles détériorés pour les raisons que j'ai dites. Voilà pourquoi ce plan n'a pas donné les résultats attendus. D'où le fléchage des 5 000 postes qui seront créés pendant ce quinquennat, en priorité sur la réussite en licence.
La première des choses, quand on veut favoriser la réussite en licence, c'est, cela a été dit, l'orientation. Cela suppose tout d'abord un niveau qui soit le plus homogène possible en premier cycle de licence. Pour cela, il ne faut pas que l'on ait ensemble des titulaires de bacs pro et techno, qui sont là par défaut, et des titulaires de bacs généraux, davantage formés aux méthodes de l'université. Il ne faut pas non plus que l'étudiant découvre l'université tout à coup lorsqu'il y arrive. Il convient donc de mettre en place le dispositif « moins trois plus trois », ainsi que l'orientation prioritaire des bacs pros et technos dans les filières STS et les DUT. Il faut accompagner tout cela, mais cela ne sert à rien d'affoler les communautés éducatives. Aujourd'hui, les bacs techno ont 9,5 % de réussite en licence, à comparer avec la moyenne de 33 %, et 68 % de réussite dans les IUT, contre une moyenne comprise entre 72 et 74 %.
On voit donc bien qu'ils sont naturellement faits pour aller en IUT. Les bacs pro ont quant à eux 3,5 % de chances de réussir leur licence.
Ces étudiants, à l'université, rendent la partie difficile aux enseignants. Je ne les dénigre pas, je ne porte aucun jugement sur leur intelligence ; simplement, ils n'ont pas été formés pour prendre des notes, pour accéder à un enseignement plus conceptuel. Il faut donc absolument les orienter de façon adaptée. C'est ce que nous proposons, en lien, comme nous le verrons, avec des quotas fixés dans chaque académie par les recteurs, avec les responsables des établissements, des quotas qui prendront en considération les spécificités des territoires et des domaines d'enseignement.
Il existe d'importantes différences dans ce domaine : j'ai des chiffres qui – vous le verrez au cours du débat – sont assez étonnants.
Pour donner à ces étudiants toutes les chances de réussir, pour revenir à des pourcentages de réussite et d'insertion plus satisfaisants, au moins comparables, dans un premier temps, aux normes européennes, nous voulons doubler l'alternance. Certaines universités françaises sont aujourd'hui à 20 % d'alternance. C'est donc possible. Cela leur permettra de s'ouvrir de façon opérationnelle, concrète, pas du tout idéologique ou dogmatique, ni incantatoire, sur le milieu socio-économique. Je crois qu'on rapproche davantage par les projets que par les incantations.
Nous voulons également lancer un grand plan du numérique qui permettra un accompagnement plus personnalisé. Si, aujourd'hui, les bacs S avec mention vont dans les IUT, pour ensuite, utilisant les passerelles, revenir à la qualité de l'enseignement universitaire, qui est réelle, depuis le premier cycle, c'est parce que cela rassure les jeunes et les familles de recevoir un accompagnement plus personnalisé. Il faut donc trouver les moyens de développer cet accompagnement personnalisé à l'université.
Vous avez évoqué les moyens. Nous avons conclu il y a un mois, à Strasbourg, une convention avec la Caisse des dépôts et consignations, qui nous accompagnera à la fois pour le logement étudiant, le lancement d'un plan du numérique, le transfert et l'alternance.
Nous allons également « environner » – pardonnez-moi le néologisme – le dispositif d'admission post-bac, pour remédier au foisonnement, au maquis, à la confusion des formations. Ce n'est pas le contenu des formations qui pose problème, car la diversité est au contraire une très bonne chose, mais il faut mieux les définir, les regrouper par domaines. Je vous invite à consulter le site internet de l'Université de Bourgogne : elle a organisé les entrées de ses formations par grands domaines. C'est lisible, pour les familles et les jeunes, quelles que soient leurs origines sociales, mais aussi pour les employeurs, ce qui est important pour l'insertion professionnelle de ces jeunes, à laquelle nous sommes tous très attachés.
La simplification se fait de façon concertée, sans porter atteinte aux disciplines, en lien avec les branches disciplinaires, les conseils licence et les conseils master, afin de rendre notre offre plus visible et plus lisible. Il est tout simplement scandaleux en effet d'avoir aujourd'hui, dans un service public de l'éducation, anté-bac ou post-bac, des coachs privés qui doivent prêter main forte aux familles qui ont les moyens de les rémunérer, pour pouvoir s'y retrouver dans le système APB. Nous allons « environner », mettre en place ce continuum bac -3, bac +3 et former.
Dans une enquête sur laquelle je reviendrai au cours du débat, il apparaît que les familles et les jeunes demandent simplement que des enseignants du supérieur viennent expliquer au lycée l'organisation, les modalités et les attentes du supérieur pour éviter ce grand trou noir, cette grande rupture, qui mène aujourd'hui tout droit à l'échec. Il conviendrait d'accompagner cela d'une présentation des métiers par les professionnels eux-mêmes, puisqu'ils sont les mieux placés pour ce faire, et de présenter de préférence les métiers qui sont aujourd'hui en tension : par exemple, l'informatique, pour éviter que ne se déploient en parallèle des formations privées dont nous avons pu voir les problèmes de pérennité, il y a quelques années, à Marseille, avec les formations à la vente de Bernard Tapie. Je refuse que l'on engage des jeunes dans des formations parallèles, sans garantie de pérennité ou d'accréditation : il s'agit d'une fausse bonne idée.
Concernant les formations médicales – je pense à la PACES, la première année communes aux études de santé –, nous avons mis en place des expérimentations, sur lesquelles nous reviendrons dans le cours des débats. Cela ne suffit pas. Nous sommes très fermes, une nouvelle fois, à l'égard des formations parallèles qui essaient de profiter du désarroi des jeunes, qui ont connu des échecs, et de leurs familles. Ce sont en effet aussi des échecs psychologiques, car en général on ne se dirige pas vers les études médicales sans une vocation : les 80 % de jeunes qui « restent sur le carreau » ont donc un deuil de vocation à faire. Nous voulons mettre fin à ces formations parallèles auxquelles je ne ferai pas le plaisir de les nommer. Elles ne sont même pas accréditées dans notre pays et elles mènent les jeunes tout droit vers une énorme duperie. C'est pourquoi nous avons déposé plainte avec énergie, comme l'ont fait mes homologues en Italie et dans d'autres pays européens.
Nous avons engagé dans le même temps une réflexion avec Marisol Touraine, car avec la télémédecine, l'e-médecine, lemaintien à domicile, la possibilité de soigner à domicile des maladies chroniques dans des conditions psychologiques et d'environnement plus favorables, les métiers comme les missions des professionnels de santé vont évoluer. Or le rôle de l'Université et de l'enseignement supérieur et de la recherche est d'anticiper les mutations et les changements. C'est pourquoi nous avons engagé cette réflexion de fond qui accompagnera les expérimentations décidées dans la loi.
J'ai entendu parler de sélection. Permettez-moi de vous faire part de mon étonnement. Je regrette qu'elle ne soit pas là pour entendre les propos qu'elle a tenus le 29 juin 2007, mais je cite Valérie Pécresse qui, hier, préconisait la sélection : « La sélection à l'entrée de l'Université, cela s'appelle le baccalauréat. » Elle ajoutait qu'il doit donc y avoir une place à l'Université pour chaque bachelier. Je cite également le précédent Président de la République dans un discours tenu à l'Université d'été des Jeunes populaires le 9 septembre 2006 : « Je ne veux pas installer une sélection qui ne serait que le paravent d'une politique malthusienne qui réserverait les études supérieures à une toute petite fraction de la jeunesse. » Cela se passe de commentaire. Tout le monde a le droit d'évoluer, mais il faut assumer les changements.

Écoutez Mme la ministre, mes chers collègues, vous interviendrez dans le débat.
Il est toujours difficile d'être mis face à ses contradictions,…
…je comprends votre perplexité et votre gêne.
En ce qui concerne l'organisation territoriale, vous en avez beaucoup parlé hier et vous avez parlé d'organisation bureaucratique. Après un quinquennat au cours duquel des élus, que j'espère responsables, ont créé une trentaine d'acronymes et d'entités juridiques nouvelles dans un paysage qui était déjà culturellement et historiquement morcelé, je trouve qu'il est assez audacieux de venir nous parler de bureaucratisation, quand on l'a soi-même mise en place et que l'on a contribué à la complexifier encore.
Nous proposons, pour un pays de la taille du nôtre, une trentaine de regroupements qui seront des regroupements extrêmement souples. Le statut d'EPCSCP, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, permet toutes les configurations, contrairement au quinquennat précédent – et j'ai vécu cette expérience comme élue de terrain – où l'on nous affirmait notre autonomie tout en nous refusant toute initiative adaptée au terrain ou à l'écosystème. L'État n'accompagnait pas, il avait « lâché l'affaire », mais il continuait à interdire. Au lieu d'accompagner les spécificités des écosystèmes, il les interdisait systématiquement. Aussi devions-nous tous rentrer à marche forcée dans la formidable chaussure de la fusion – y compris entre les deux tours des élections, ce qui n'est assurément pas la meilleure période.
Nous proposons dans ces communautés, dans ces regroupements, une vraie liberté et une vraie autonomie pour les territoires. Nous pourrons combiner la fusion, pour ceux qui y sont prêts, avec l'association – terme que nous avons préféré à « rattachement », car il n'implique pas de hiérarchie – au bénéfice de projets communs. Ce terme d'association paraît davantage adapté à la culture universitaire. Tout cela pourra se faire au sein d'une même communauté, capable ainsi d'élaborer une stratégie qui sera accompagnée par l'État et qui devra s'inscrire dans des orientations rappelées par celui-ci. Cela s'appelle la coopération et elle me semble, dans un pays comme le nôtre, davantage adaptée que la compétition entre sites que l'ancienne majorité avait instaurée.
Cette compétition avait empêché, par exemple, un prix Nobel comme Albert Fert, qui travaillait avec un établissement lorrain, de signer un appel à projets commun. Son université parisienne avait avancé en effet qu'il ne pouvait pas signer avec le laboratoire avec lequel il coopérait, parce qu'elle risquait d'être pénalisée dans l'appel à projets auquel elle souhaitait répondre. Voyez à quel degré d'absurdité nous étions arrivés ! Aussi rétablissons-nous l'esprit de coopération, qui est consubstantiel à la collégialité et à la culture de l'Université, sans qu'il nuise à l'émulation et à l'excellence. L'excellence doit être partout : elle est une exigence. Nous devons avoir la même exigence d'excellence pour la mise en place des Écoles supérieures du professorat et de l'éducation, pour celle d'un BTS et d'une filière dans les IUT ou pour celle d'une filière à l'Université. L'excellence doit tous nous guider à l'Université et dans l'enseignement supérieur, vous le savez.
Hier, nous avons beaucoup parlé des conseils académiques. Je rappelle tout de même que Philippe Aghion, que vous connaissez bien et que vous avez cité, préconisait lui-même ces conseils académiques dans le rapport qu'il avait rendu et qu'il trouvait que c'était un beau modèle.
Pour avoir siégé pendant plus de dix ans de façon tout à fait opérationnelle dans diverses structures – grand établissement, à la présidence d'un institut d'administration des entreprises, dans des PRES ou dans des conseils d'administration d'université – je peux dire, sans idéologie mais avec pragmatisme, à quel point la formation, la vie étudiante, qui contribue à la réussite des étudiants, ou la pédagogie et ses innovations, étaient souvent absentes de conseils d'administration surchargés.
L'idée est, comme au fondement de toute démocratie, de séparer les pouvoirs : le conseil d'administration s'occupe des grandes orientations stratégiques et, d'un autre côté, les acteurs concernés s'occupent eux de la vie académique, de la formation et de la science. Ce ne sera pas une usine à gaz. Si nous avons élargi les conseils académiques, c'est parce que nous voyons bien que des réformes décidées d'en haut, de façon assez dogmatique comme cela s'est passé dans le précédent quinquennat, n'ont aucun effet sur le terrain quand les acteurs ne se les approprient pas. C'est un moyen également de participer sur le terrain.
Nous ne voulons pas non plus déstabiliser la gouvernance des conseils d'administration et les présidents d'universités : c'est pourquoi nous leur faisons confiance. Ce sont donc bien les conseils d'administration qui décideront de la gouvernance de ces conseils académiques. Ils pourront, contrairement à ce que vous avez dit dans l'opposition, être présidés par le président du conseil d'administration. Ce conseil pourra désigner l'un de ses vice-présidents pour présider le conseil académique, ou une personnalité extérieure. Nous nous faisons confiance et nous leur faisons confiance pour prendre des décisions de gouvernance qui seront adaptées à leur écosystème.
C'est cela l'autonomie : faire confiance aux sites et non pas seulement la proclamer. Il a d'ailleurs été dit hier que la loi LRU a été « proclamée ». Vous avez fait un beau lapsus, puisqu'elle a été proclamée sans être mise en pratique. On proclamait l'autonomie, mais on la refusait aux acteurs de terrain : ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous voulons concilier un État stratège et des territoires dont la spécificité et la dynamique doivent être stimulées et reconnues.
Nous avons aussi instauré la parité, mais nous y reviendrons, car j'ai vu en commission que la parité, dans l'opposition, ne vous agréait pas. Cela me paraît pourtant essentiel que l'Université et la recherche, qui doivent se trouver à l'avant-garde de l'évolution d'une société et qui ont produit nombre d'études sur le genre et les causes de l'absence de parité, soient à la pointe dans ce domaine.
S'agissant de la recherche, je n'en dirai ici que quelques mots puisque nous y reviendrons. Nous pouvons être fiers de notre recherche fondamentale. Nous n'avons pas à rougir, mais bien au contraire à être fiers de nos médailles Fields, de nos prix Nobel ou de nos lauréats du conseil européen de la recherche. Mais nous devons aussi être conscients que notre recherche ne se transforme pas suffisamment en emplois. Il ne s'agit pas d'imposer le transfert, comme je l'ai entendu dire, à toute la recherche, y compris à la recherche en sciences humaines et sociales, qui parfois peut être transférée à des collectivités territoriales – par exemple, il est très utile d'avoir des études sur la politique de la ville ou sur la sécurité, lorsque l'on s'occupe de politiques publiques. Ce lien, là encore, doit être renforcé. Mais il ne s'agit pas de contraindre des disciplines qui, à l'évidence, ne sont pas concernées par le transfert.
Ce transfert se fera quand il est possible, comme nous l'avons précisé dans un amendement. Il n'est pas normal d'accepter plus longtemps que nous soyons la sixième puissance scientifique du monde, mais que nous occupions entre la quinzième et la dix-huitième place, selon les critères retenus, pour l'innovation. L'innovation, c'est l'emploi. 80 % des emplois créés aujourd'hui en Europe viennent de l'innovation. Il est essentiel d'améliorer ce processus de transfert. Or ce n'est pas une technostructure au nom évocateur de « société d'accélération du transfert de technologies » qui va suffire : encore une fois, il faut l'« environner ». Aussi avons-nous pris un certain nombre de dispositions sur lesquelles nous reviendrons dans l'étude du texte.
Il s'agit également de s'occuper des sciences humaines et sociales et des disciplines rares. Nous avons découvert en lançant une mission dans notre ministère qu'il n'y avait aucun outil statistique : ils avaient disparu. Les sciences humaines et sociales et les disciplines rares n'étaient plus en effet dans les préoccupations de ce ministère.
Nous devons donc commencer par reconstituer les outils statistiques, ce qui est tout de même extraordinaire, pour mener une évaluation et dessiner une cartographie des sciences humaines et sociales et des disciplines rares dans ce pays. Nous annoncerons à la rentrée un plan en faveur des sciences humaines et sociales et des disciplines rares, qui sera aussi bénéfique aux étudiants qu'aux chercheurs.
Venons-en aux docteurs. C'est l'un des scandales de notre enseignement supérieur que son plus haut grade soit traité de cette façon : aussi bien en terme d'insertion que de reconnaissance dans les conventions du privé ou dans la haute administration. Le combat n'est pas facile ; il existe des problèmes de quotas, d'accès aux concours ou de corps qui font valoir leurs droits. Nous sommes cependant tout à fait déterminés et les contacts que j'ai avec les directeurs des écoles doctorales sont finalement beaucoup plus ouverts qu'on ne peut l'imaginer. C'est pourquoi je pense que nous réussirons à faire des propositions intéressantes, qui me paraissent indispensables.
Nous sommes très en retard, mais heureusement – et cela fera la transition avec le débat suivant –41 % d'étrangers viennent enrichir les rangs de nos docteurs, en particulier dans les disciplines scientifiques et essentiellement en provenance des pays francophones. Nous n'avons pas suffisamment de docteurs. Un grand plan d'insertion des doctorants, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, sera mis en place. Là encore, il faut faire beaucoup de pédagogie, car les formations à l'Université ont été lourdement dénigrées. Il nous faut les requalifier à leur juste valeur. La valeur en effet y existe bien, tout comme la créativité et la qualité qui y est plus que présente et qu'il faut faire reconnaître davantage tant dans le secteur privé que le secteur public. Nous vaincrons les résistances qui ont été encouragées et consolidées au cours des six dernières années.
En ce qui concerne la recherche, nous retrouvons la voie d'un État stratège parce que notre politique en la matière était devenue illisible. En effet, la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation, telle qu'elle était conçue par mes prédécesseurs, était un copier-coller provenant des différentes alliances et d'autres organismes, avec des experts qui se superposaient à leurs collègues, mais jamais à aucun moment les responsables des alliances, nous ont-ils expliqué, n'étaient réunis par le ministère pour mettre en place une stratégie commune de recherche. C'était pourtant une bonne initiative de votre part, je vous le dis, mesdames, messieurs les députés de l'opposition, que de regrouper ce mikado complexe en alliances thématiques mais, malheureusement, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée et de faire une déclaration à la presse, il faut ensuite savoir mettre en mouvement ce qui est mis en place, et cela n'a pas été fait. C'est bien dommage. J'ai engagé ce travail il y a neuf mois et, au niveau de l'Europe, nous avons lancé, avant-hier, l'agenda stratégique de la recherche « France-Europe 2020 », et je proposerai d'ici le troisième trimestre de cette année un agenda tout à fait détaillé et dont les grandes orientations sont déjà définies. C'est absolument indispensable. Nous avons pris du retard : l'Allemagne et le Royaume-Uni l'ont élaboré, le Japon a lancé le programme Rebirth, destiné a provoqué un rebond aussi bien de confiance qu'en matière scientifique et de transfert vers l'économie et de création d'emplois dans ce pays durement éprouvé par la catastrophe de Fukushima. Ce que vous n'avez pas fait, nous le faisons, dans un style certes moins déclaratif, plus discret – c'est pourquoi cela vous échappe quelque peu –, mais néanmoins beaucoup plus efficace, sur le moyen et le long terme, pour l'emploi, pour l'élévation de la connaissance et surtout son partage.
J'ajoute que nous ne nous défaussons pas sur des agences. Ainsi, l'Agence nationale de la recherche n'est pas le programmateur ou le stratège de la recherche par défaut, elle a été recentrée dans ses missions. Certes, elle porte le même nom qu'auparavant, mais elle est revenue à ses missions initiales, celles d'un opérateur des programmes de recherche.
Elle a été tout à fait en accord avec ce recentrage sur ses missions initiales. Il n'est jamais bon qu'une agence se substitue à un ministère ou à une assemblée parlementaire. Nous sommes dans un pays démocratique ; nous n'avons pas à tout déléguer aux agences, chacun son métier : l'agence fait son métier d'opérateur, les élus doivent faire leur métier de politique et l'assumer, ce que je fais avec l'agenda stratégique de la recherche.
Je voudrais terminer par l'international. Cela fera le lien avec l'article 2 à propos duquel j'espère un débat serein parce que chacun doit respecter les opinions de l'autre. Je pense d'ailleurs qu'il est préférable d'avoir un tel débat dans une enceinte démocratique plutôt que par articles de presse et par personnalités interposés que chacun pourrait se jeter à la figure. Lesdites personnalités varient dans leurs préconisations, mais je tiens à souligner que l'on voit bien la différence entre celles qui se sont exprimées, souvent issues des sciences humaines et sociales, et qui ne sont pas du tout concernées par le sujet, et les scientifiques qui, eux, participent depuis longtemps à des conférences internationales.
La défense de la francophonie, c'est bien entendu une des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il ne s'agit pas seulement de la défense de la langue, parce que la francophonie ne se réduit pas à un langage. J'ai eu l'occasion d'en discuter récemment avec le secrétaire général à la francophonie, l'ex-président Abdou Diouf, et nous partageons la même vision, non réductrice, de la francophonie : ce n'est pas seulement une langue, c'est aussi une culture au sens large et le partage de valeurs. Il me paraît en ce sens essentiel d'élargir la base de la francophonie, mais encore faut-il sauvegarder les liens qui nous unissent aux pays historiquement francophones, peut-être en les repensant dans une perspective plus égalitaire.
La France accueille 290 000 étudiants, dont il faudrait soustraire les 50 000 qui ont passé leur baccalauréat dans notre pays et ne viennent pas en raison de l'attractivité de nos universités mais parce que leurs parents sont déjà installés chez nous. Au passage, je précise que nous nous situons au cinquième rang des pays d'accueil, et pas au troisième comme je l'ai entendu hier – c'était vrai dans le passé, nous avons même été au deuxième rang, et j'expliquerai tout à l'heure les raisons de cette évolution. Parmi ces 290 000 étudiants, 55 % viennent d'Afrique. Au-delà des proximités culturelles et des responsabilités qui nous incombent pour des raisons historiques et géopolitiques, ce continent peut être aussi un levier de développement pour l'Europe. En effet, il a aujourd'hui une croissance annuelle supérieure à 5 % et offre un potentiel de jeunes, un potentiel d'enthousiasme qui souvent nous manque. Il faut absolument conforter notre base d'accueil des étudiants en provenance de l'Afrique. Pour y parvenir, on doit être davantage présents dans ces pays. La Chine est aujourd'hui presque davantage présente que nous en Afrique subsaharienne, et c'est dommage. Pour cette raison, avec Yamina Benguigui, les acteurs de terrain et les autres ministres concernés, j'ai engagé une action extrêmement volontariste à destination de ces pays. Il ne s'agit pas de les inviter établissements, mais de favoriser un climat d'échange. Ainsi, le premier ministre de l'enseignement supérieur que j'ai rencontré après ma prise de fonction a été M. Daoudi, lors de mon voyage au Maroc.
Il est absolument francophone familialement, vous le savez, monsieur le député. M. Daoudi m'a dit que son gouvernement aimerait créer des formations françaises au Maroc et que son pays serve de voie de passage vers l'Afrique subsaharienne. Nous avons engagé ce processus parce que nos relations avec ces pays doivent être davantage égalitaires. Nous ne sommes plus dans la même situation que la génération précédente : aujourd'hui, nous avons autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous, nous sommes dans une situation gagnant-gagnant. La France établit des structures de coopération avec l'université internationale de Rabat et tous les acteurs concernés, dont la conférence des présidents d'université et Canal France International, sont extrêmement présents dans ces formations. C'est extrêmement bénéfique et cela nous permettra de conserver des relations étroites avec les pays francophones afin que les 230 millions à 270 millions de francophones, peut-être 750 millions à un milliard d'ici quelques dizaines d'années, continuent non seulement à parler français mais à ressentir une proximité avec notre pays. La francophonie, je le redis, ne se réduit pas à la langue. Je tiens à ces relations, elles sont consubstantielles aux missions de l'université française et j'ai à coeur de les développer tout en les inscrivant davantage dans l'axe européen. L'Europe de la Méditerranée est une notion importante, laissée quelque peu à l'écart jusqu'ici,…
…et je me bats pour un ERASMUS de la Méditerranée.
Mais de telles actions ne suffisent pas. L'Allemagne, qui était très en retard en termes d'accueil d'étudiants étrangers, est passée devant nous. Si nous sommes passés progressivement du deuxième rang au cinquième rang, c'est bien parce que nous avons raté quelque chose avec les pays émergents. La question est extrêmement pragmatique. Je pense à l'Inde : ce pays d'un milliard d'habitants compte soixante millions d'informaticiens, des jeunes viennent se former massivement dans les universités anglo-saxonnes. Certains disent pourtant être attirés par la culture française et prêts à apprendre notre langue, mais l'obstacle linguistique dans les disciplines scientifiques, économiques et commerciales les empêche de venir. Au nom de quoi nous priverions-nous de leurs talents et des perspectives que nous offrent les contacts avec ces étudiants indiens ? Au nom de quoi priverions-nous nos étudiants de contacts avec des étudiants indiens, brésiliens, coréens ou indonésiens, qui aujourd'hui ne viennent pas à cause de l'obstacle de la langue ?
Il ne s'agit pas des étudiants des disciplines littéraires ou en sciences humaines et sociales car eux apprennent la langue française, mais des étudiants des disciplines scientifiques. Ce sont surtout les experts des sciences humaines et sociales qui interviennent sur ce sujet alors que les scientifiques connaissent bien davantage le problème.
Quand on a une balance du commerce extérieure qui plonge dans des abîmes abyssaux et qu'on a laissé depuis quinze ans se développer des filières tout en anglais dans les écoles où l'on forme les élites sans que personne ne pense à s'en offusquer, au nom de quoi refuser les contacts avec des étudiants des pays émergents aux jeunes issus de milieux plus modestes…
…qui ne possèdent pas les mêmes codes sociaux, qui n'ont pas eu la chance de faire des séjours linguistiques à l'étranger et d'acquérir une culture internationale à travers leur réseau relationnel alors qu'ils en ont besoin pour leur insertion professionnelle ? Ils auront avec eux des contacts d'abord affectifs et culturels, et plus tard professionnels aussi bien dans le domaine de l'échange de connaissances que dans celui du développement économique.
Non, je ne mélange pas tout. Je raconte la vie comme elle est. La vraie vie, ce n'est pas une posture, c'est la réalité vécue par les jeunes.
Exclamations sur les bancs des groupes UMP et UDI.
Interrogez les jeunes autour de vous, ils vous diront exactement la même chose.
Nous allons ainsi élargir la base de la francophonie.
Nous avons convergé en commission pour arriver à formaliser sous forme d'amendements ce que je comptais faire passer par des circulaires d'application parce que cela ne relève pas du législatif. Je l'ai accepté parce que j'ai entendu ce qui s'est dit et j'ai bien vu qu'il fallait rassurer tout le monde. Il ne s'agit pas d'avoir un débat de posture aussi binaire, un de ces débats qu'on aime tant dans notre pays pour éviter de se poser les vrais problèmes et les vraies questions. Il fallait apaiser le débat. Après la circulaire Guéant que nous avons abrogée, et c'était une mesure de salubrité publique,…
…il ne faut plus que nous contribuions à donner de notre pays une image étriquée, de repli sur lui-même. Je veux donner de la France une image de confiance dans ses valeurs et dans sa culture pour qu'elle puisse accueillir des jeunes qui aujourd'hui ne viennent pas chez nous et avec lesquels nous pourrons partager notre culture et notre langue comme des amendements le prévoient.
Ce partage ne s'effectuera pas dans le cadre de formations intégralement en anglais alors qu'on les laisse passer depuis quinze ans de façon totalement hypocrite.
Nos établissements de l'enseignement supérieur doivent donner l'exemple : est-il tolérable que certains d'entre eux, en infraction avec la loi Toubon, dispensent depuis quinze ans des formations tout ou partiellement en anglais sans que personne ne s'en offusque ? Il est vrai que cela ne concerne qu'une élite et c'est pourquoi on ne dit rien.
« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe SRC.
Est-il tolérable que ces établissements contreviennent totalement à la loi ? Cela est antinomique avec leur vocation de formation. Nous allons donc traiter ce problème de façon encadrée. Ce sera de nature à apaiser le débat. Je ne refuse pas la discussion et je vous invite, mesdames, messieurs les députés, à l'entamer de façon sereine, ouverte et partagée, à l'image de ce qu'a toujours été notre université et notre pays, un pays d'universalité et des Lumières et non pas un pays de peur et de repli sur lui-même.
Applaudissements nourris sur les bancs des groupes SRC et RRDP.

J'appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, pour soutenir l'amendement n° 343 .

Il s'agit d'un amendement rédactionnel à l'article 1er bis, lequel garantit que le service public de l'enseignement supérieur s'applique sur l'ensemble sur l'ensemble du territoire.
L'amendement n° 343 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 1er bis, amendé, est adopté.

De nombreux orateurs sont inscrits sur l'article 2.
La parole est à M. Pouria Amirshahi.

Je ne sais pas si la pédagogie est l'art de la répétition, mais je vais rappeler les éléments sur lesquels reposent les inquiétudes mais aussi la passion du débat sur cet article, dont certains ont voulu qu'il soit retiré, et d'autres complété et précisé. Pour ma part, j'étais ouvert aux deux solutions.
Je reviens sur nos inquiétudes.
En premier lieu, je crois que l'attractivité de nos universités n'a pas tant été affaiblie par un défaut de maîtrise de l'anglais que par une politique migratoire un peu paranoïaque dont la circulaire Guéant était le symbole le plus détestable. Heureusement, elle a été abrogée.

Il faut répondre aux deux ambitions qui ont été fixées dans le projet de loi : l'attractivité des universités françaises ; un meilleur apprentissage des langues. Si l'on avait pris le temps, peut-être aurait-on pu poser les sujets et les enjeux de manière un peu plus sereine.
Il est tout à fait possible d'améliorer l'attractivité des universités françaises auprès des jeunes issus de pays émergents non francophones. Cet objectif est atteignable si l'on donne aux jeunes qui apprennent le français comme deuxième langue vivante – rappelons que le français reste la deuxième langue étrangère enseignée dans le monde – un prolongement universitaire en France, en langue française. Il y a de nombreux jeunes en Chine, en Corée, en Inde, au Brésil et en Turquie qui maîtrisent le français ou désirent le maîtriser. Ils sont susceptibles, étant par ailleurs brillants dans tous les domaines – scientifique, économique et autres –, de poursuivre leurs études en langue française en France.
Ce n'est pas du tout antinomique avec le deuxième volet, présenté par Mme la ministre : le renforcement de notre capacité en matière d'apprentissage des langues. De ce point de vue, la France et d'autres pays européens sont en retard. Si nous voulons faire en sorte que les jeunes Français puissent maîtriser beaucoup mieux les langues étrangères – c'est indispensable et cet objectif a été rappelé par Mme la ministre –, il faut se fixer une autre ambition.
D'abord, il faut déployer nos efforts en amont de l'université. Ensuite, il faut préférer le plurilinguisme au « tout anglais » car c'est cela la modernité : l'espagnol, l'arabe et le chinois sont des espaces linguistiques très importants. Enfin, il faut renforcer Erasmus. Au lieu d'investir dans la rémunération de certains professeurs anglo-saxons, ne pourrions-nous pas mettre cet argent dans des bourses Erasmus afin d'aider nos jeunes à voyager et à faire leurs études en immersion, pour être capables de bien maîtriser les langues ?
La formule employée hier par Jean-Pierre Dufau, suggérant de mettre cet article entre parenthèses pour avoir un débat apaisé, était très intéressante. Pour ma part, j'ai expliqué d'emblée que cet article me posait un problème s'il était maintenu en l'état. En revanche, s'il était complété par des articles précisant les limites, le périmètre, les nécessités et les impératifs pédagogiques justifiant l'ensemble de ces dispositifs, ce serait de nature à rassurer ceux qui, dans le milieu universitaire et dans le monde de la francophonie, ont ressenti quelque émoi à la lecture de cet article.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, l'article 2 étend des exceptions.
Il ne s'agit donc de généraliser l'enseignement en langue étrangère dans l'enseignement supérieur. Et je tiens à insister sur ce point précis car je m'associerai à tout amendement discuté ici, qui renforcera cet aspect.
Il y a trois manières de voir et d'interpréter cet article, qu'il s'agit de distinguer.
La première interprétation que l'on peut faire est celle relative à l'attractivité internationale de nos universités et de leurs formations. Notre ministre est revenue sur cet aspect, il n'est donc pas forcément nécessaire de le faire à nouveau, car ses ambitions sont plus que louables, elles sont vivement souhaitées.
Deuxièmement, la vision relative à la francophonie et à la place de notre langue dans le monde. Là aussi, mon ami et collègue Pouria Amirshahi a expliqué son point de vue, et je partage en partie ses craintes, même si cela ne m'amène pas à tirer les mêmes conclusions.
Enfin, une troisième interprétation – peut-être est-ce la plus importante mais la moins débattue – vise l'intérêt des étudiants eux-mêmes. Car c'est bien d'eux dont il s'agit avant tout.
Avec cette loi, les étudiants pourront étudier en langue étrangère. Je suis convaincue, peut-être parce que j'aurais aimé bénéficier de cette possibilité, que cela est une bonne chose. De très nombreux pays offrent déjà cette possibilité et s'il doit y avoir un aspect positif à la mondialisation, c'est bien cette nouvelle capacité qu'ont les peuples à pouvoir communiquer entre eux, à échanger, à tisser des liens, à apprendre les uns des autres.
Mais une fois dit cela, je tiens à appeler votre attention sur deux éléments.
Si heureusement la loi française ne permet pas qu'il y ait une sélection à l'entrée de l'université, cet article, à terme, ne pourra-t-il pas être l'un des critères déterminants de l'admission des étudiants ? D'ailleurs, ne sera-t-il pas, avant d'être un critère objectif, un élément dissuasif de l'orientation et donc décisif pour qu'un étudiant, se sentant plus ou moins de capacité en langues étrangères, poursuive ou non ses études dans une formation qu'il souhaite pourtant ?
Avec l'article 2 en l'état, rien, en théorie, ne permettra d'interdire à une université de dispenser intégralement ses formations en langues étrangères. Rien ne permettra de limiter le fait que cela soit dès la première année ou de manière inadaptée aux étudiants.
Cette question nous invite à une seconde réflexion. Sommes-nous prêts ? Est-ce que nos étudiants ont le niveau pour aborder une formation entièrement en langue étrangère aujourd'hui ? Malheureusement, et je crois ne pas être la seule, loin de là, à en être absolument attristée, je crois que non.
Le vote de cet article invitera donc le Gouvernement à investir vite et de manière considérable. Il devra investir non seulement dans une remise à niveau de nos étudiants actuels mais aussi dans la qualité et la quantité des cours de langues étrangères dans les établissements scolaires du premier et du second degré afin de mieux préparer les futurs bacheliers à ce type de disposition.
C'est donc avec raison que je voterai pour cet article de loi mais avec autant d'empressement que je voterai les amendements qui limiteront son extension et garantiront une bonne application pour nos étudiants.

Madame la ministre, il serait tentant de commencer par donner une note à votre discours, même s'il semblerait que vous n'y soyez pas favorable. Je me contenterai donc de cette appréciation : un peu long, beaucoup d'erreurs et peut-être quelques oublis.
L'une des erreurs est de vous réjouir d'avoir un budget formidable. Si vous retirez les pensions, votre budget est alors moins élevé que celui de 2012. Vous avez effectivement fait moins d'efforts.
Cela dit, tout n'est pas mauvais, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour ma part, je suis favorable à ce qu'il y ait une instillation des langues étrangères. Dans certaines disciplines – surtout dans le domaine scientifique, pardonnez-moi de prêcher pour ma paroisse –, il est tout à fait indispensable que l'on puisse attirer des étudiants étrangers.
Désolé de parler de moi, mais j'en ai fait l'expérience car j'ai un service en Chine où j'enseigne en qualité de bénévole
Sourires sur plusieurs bancs du groupe SRC.

J'ai fait venir en France des Chinois qui ne parlaient pas notre langue et nous avons pu leur faire un enseignement en anglais dans le service. Que s'est-il passé au bout de quatre ans ? On parle français dans le service de Shanghai, et c'est cela qui est extraordinaire. Si on leur avait dit qu'on ne leur parlerait qu'en français et qu'ils ne pourraient venir que s'ils parlaient notre langue, ils ne seraient jamais venus.

À l'inverse, les enseignants et les chercheurs français publient en anglais. Pourquoi ? C'est dramatique, mais nous ne sommes pas assez crédibles.
Pour autant, tout ne doit pas être en anglais. Il faut que les étudiants qui viennent en France aient des cours en anglais, certes, mais aussi qu'ils apprennent le français.
Il faudrait aussi deux choses. Premièrement, il faudrait que l'anglais et les langues étrangères soient enseignés beaucoup plus tôt…

…sinon les étudiants seraient sélectionnés dans les universités en fonction de leur niveau en langues. Ils ne parlent pas anglais ? Ils ne peuvent entrer à l'université. Il faudrait effectivement faire beaucoup plus d'efforts. Nous sommes le peuple qui parle le moins de langues étrangères et ce n'est pas acceptable alors que nous menons une guerre économique qui se double d'une guerre scientifique, la première étant soutenue par la seconde : pour exister, nous sommes forcés de publier en anglais.

Attendez, on ne peut pas non plus, sous prétexte qu'il y a une bonne mesure, voter pour toutes celles qui sont mauvaises !

J'aurai d'autres sujets de satisfaction avec certaines mesures de ce texte, pas avec toutes malheureusement.
Deuxièmement, il faut parfois faire venir certains des meilleurs enseignants du monde. Faites venir des Américains, des Chinois, payez-les ! Ils feront des cours soit en anglais soit en français, mais au moins que cette université soit attractive par l'enseignement, par les professeurs et par les débouchés. Alors, je suis d'accord avec cette disposition,

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, l'article 2 participe d'une vision stratégique et d'une action offensive du Gouvernement sur la diversité linguistique et la francophonie.
La France doit s'ouvrir davantage au plurilinguisme. Le développement des cours en langues étrangères dans nos universités procède de cette logique, dans la continuité de la loi sur la refondation de l'école qui a fait une priorité de l'apprentissage d'une langue étrangère dès le plus jeune âge et de la stratégie de développement des filières internationales et bilingues dans nos écoles.
Cet article concourt à l'attractivité de nos universités et permettra un rapprochement avec des universités étrangères et européennes. Dans les zones transfrontalières notamment, l'assurance de pouvoir dispenser des enseignements multilingues est importante.
Il constitue également une véritable avancée pour les étudiants français qui ne seront plus obligés de s'offrir, pour ceux qui le pouvaient, des séjours à l'étranger pour apprendre une autre langue. Cet article participe ainsi à la démocratisation de l'accès aux langues étrangères et il permettra à nos étudiants de partir mieux armés sur le marché de l'emploi, face à la concurrence internationale dans un monde globalisé où la maîtrise des langues étrangères représente un véritable atout.
Elle représente enfin un élan important pour la diversité linguistique qui est à mon sens la meilleure arme pour la promotion de notre langue dans le monde. Nous ne pouvons pas nous recroqueviller sur nous-même et agir seuls et de manière défensive.
L'amendement de Patrick Bloche, que j'ai cosigné et qui a été adopté en commission, permettra d'amener un plus grand nombre d'étudiants vers notre langue. Des étudiants étrangers non francophones pourront se former dans nos universités et bénéficier ainsi d'un apprentissage en français qu'ils n'auraient jamais obtenu dans un autre pays.
Je soutiens donc avec force cet article pour le rayonnement de la France dans le monde et la promotion de notre langue.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, cet article 2 est particulièrement important.
Une bonne maîtrise des langues étrangères est indispensable dans le contexte actuel de la mondialisation. Ne pas parler anglais ferme de nombreuses perspectives professionnelles. Je comprends donc parfaitement qu'on veuille intensifier les cours de langues à l'université.
Mais cet article, en proposant que les cours soient partiellement dispensés en langue étrangère, va trop loin. Certains étudiants étrangers ne maîtrisent pas bien la langue de Molière lorsqu'ils arrivent en octobre dans nos universités. Pourquoi ne cherchez-vous pas plutôt à les encourager avec des systèmes de binômes ou de tutorat, par exemple ?
Si nous ne profitons pas de ces années qu'elles passent dans nos écoles pour transmettre aux élites des autres pays notre langue et notre culture, alors nous allons à très brève échéance vers la fin de la francophonie, ce qui serait un désastre culturel et économique.
Si notre pays rayonne aux quatre coins de la planète, c'est parce que le français y est parlé. La francophonie est un espace de soixante-dix-sept nations où nous serons plus de 800 millions de locuteurs en 2050.
Alors mes chers collègues, ne cédons pas à la facilité. Si nous adoptons cet article, nous désespérerons tous ceux qui défendent la langue française et la francophonie dans les pays amis et dans les instances internationales.
L'enseignement en anglais dans les universités françaises serait perçu comme une forme d'abandon de l'exception culturelle et linguistique que notre pays revendique pourtant à raison avec force, notamment auprès des instances européennes.
Même dans vos rangs, cet article est décrié. Mme Yamina Benguigui, votre ministre déléguée à la francophonie, a dit devant la mission parlementaire sur la francophonie, le 9 avril, qu'elle était d'accord avec notre collègue Pouria Amirshahi qui s'est prononcé contre cette disposition.
Alors, madame la ministre, acceptez la suppression de cet article.

Pour ma part, je pense que l'on mélange en permanence deux débats. Le premier est celui de l'attractivité de nos universités vis-à-vis des étudiants étrangers ; le second est celui de l'enseignement des langues aux étudiants français.
Nos échanges sont très intéressants à cet égard : nous partons toujours de l'attractivité pour en venir à la capacité de nos étudiants à maîtriser les langues. Je voudrais que nous séparions ces deux débats. Si nous les lions comme vous le faites, cela va conduire à ce qui s'est passé dans certaines universités d'Europe du nord et en Allemagne : faire basculer entièrement en anglais des licences et surtout des masters. C'est déjà le cas à Strasbourg notamment où dix matières sont enseignées totalement ou partiellement en anglais. Dans les universités allemandes, dans celles des Pays-Bas, ce sont maintenant plus de la moitié des masters – la totalité à l'université de Maastricht – qui sont enseignés en anglais. Voilà vers quoi nous allons !
Que l'on ne nous dise pas que c'est tout à fait exceptionnel, que cela ne concernera que les étudiants étrangers ou certains programmes. En réalité, on le sait très bien, les universités ont conclu de très nombreuses conventions dans le monde. Souvent, elles ne sont pas actives, mais elles existent, et elles pourraient être invoquées pour faire basculer des masters en anglais. Et puis, il suffit d'invoquer le programme européen Erasmus pour, tout simplement, pouvoir ouvrir n'importe quel cours en anglais, faire basculer n'importe quel cours en anglais.
Si la question, pertinente, de l'ouverture à l'international de nos universités, de leur attractivité est un point de départ, le point d'arrivée sera donc le basculement de masters entiers, d'universités entières, dans l'anglais. C'est ça, la vérité !
Cela nous expose à trois dangers.
Tout d'abord, tous les pays qui l'avaient fait regrettent aujourd'hui ce choix, parce qu'il a forcément des conséquences sur le niveau de l'enseignement. Comment voulez-vous qu'on enseigne d'une façon aussi précise dans une autre langue que dans sa propre langue ? Comment voulez-vous que l'on soit aussi pédagogue ? Et, puisque l'on parle d'inégalités entre les étudiants, nous allons en créer une, entre ceux qui, maîtrisant la langue, pourront recevoir la totalité du contenu de l'enseignement, et ceux qui n'en seront pas capables.
D'ailleurs, de grands pays comme l'Allemagne et la Chine sont en train de revenir sur l'enseignement en anglais dans leurs universités. Je vous invite à lire une recommandation, qui date du mois de novembre 2011, de l'équivalent allemand de notre conférence des présidents d'université. Cette instance dit : « Stop ! Revenons à l'enseignement en allemand, et faisons en sorte de promouvoir non pas le tout-anglais mais le multilinguisme. »
C'est précisément cela, le vrai sujet ! Il ne faut pas caricaturer les positions des uns et des autres, et je ne prétends pas qu'il ne faut pas enseigner l'anglais dans nos universités, je ne prétends pas qu'il ne faut pas apprendre l'anglais à nos étudiants, bien évidemment. Je me bats en revanche contre cette idée qu'il n'y aurait d'avenir, pour l'université française, que dans le tout-anglais, que dans le basculement de masters en anglais.
J'en viens à une autre conséquence, et il faut aborder ce sujet de manière dépassionnée. Quand on adopte un texte, il faut considérer le texte lui-même et le signal que l'on envoie. En l'occurrence, quel est celui-ci ? D'un côté, la France se veut le défenseur de l'exception culturelle, du multilinguisme et du multiculturalisme, mais, de l'autre, nous renonçons nous-mêmes au caractère universel de notre langue et au multilinguisme. Nous-mêmes, nous cédons à cette mode du tout-anglais. C'est extrêmement grave, et c'est d'ailleurs ainsi que les choses sont perçues dans une grande partie du monde. Notre débat de ce matin n'est pas suivi qu'en France, il l'est aussi à l'étranger, et il désespère ceux qui se battent en faveur de la francophonie ou du français dans le monde. Oser nous dire qu'on va défendre la francophonie en anglais, très franchement, ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas très crédible.
Il y a aussi la question, tout simplement, de l'avenir de la langue, dont Michel Serres a vraiment très bien parlé. Aujourd'hui, dans nos universités, on va enseigner, on va chercher, on va réfléchir uniquement en langue anglaise. C'est extrêmement grave, car cela signifie que des domaines entiers, techniques, scientifiques, ne seront plus pensés que dans une autre langue que la nôtre. Nous n'aurons plus les mots en français ! Cela a d'ailleurs déjà commencé dans un certain nombre de domaines. J'appelle votre attention sur ce point.
On peut bien évidemment publier en anglais – on peut aussi publier en français ; il y a quand même encore un certain nombre de publications en français, mais elles disparaîtront peut à peu si on ne les défend pas – mais gardons, en tout cas, le français comme langue d'enseignement et comme langue de travail, sauf dans le cadre d'accords exceptionnels, de conventions très particulières. Doyen pendant dix ans de la faculté de droit de Boulogne-sur-Mer, j'ai créé un master transmanche à l'université du Kent à Canterbury, j'ai établi une coopération avec le Boston College aux États-Unis, j'ai fait venir des professeurs anglais et américains et il y a eu des cours en anglais dans mon université, mais c'était dans un cadre extrêmement ciblé, et il y avait des cours français et des cours anglais.

Non, c'est faux, parce que votre exception n'en est pas une ! En réalité, les conventions internationales et les conventions européennes sont telles que ce sont tous les cours que vous pouvez faire basculer dans l'anglais, et non pas des programmes très particuliers, très précis,…

…comme ceux auxquels faisaient allusion Bernard Debré.
On le voit bien, puisque vous passez d'une idée à l'autre, et que vous annoncez qu'on apprendra l'anglais à nos étudiants en leur faisant cours en anglais ; cela a été dit par plusieurs d'entre vous. Vous passez donc immédiatement de conventions internationales tout à fait ciblées, à propos desquelles nous pourrions être d'accord avec vous, à des masters entièrement en anglais. Vous glissez systématiquement d'une idée à l'autre.
Renseignez-vous : n'importe quelle université a des dizaines de conventions internationales, et les programmes Erasmus concernent tous nos cours, dans toutes nos universités. La limite que vous fixez n'en est donc, en réalité, pas une.
Pour conclure, je veux simplement vous lire une lettre d'un professeur de Sidney : « Au seuil du jour fatidique où le sort de l'article 2 de la proposition de loi de Mme Fioraso sera décidé, permettez-moi d'exprimer » – il le dit en français, parce qu'il a appris le français, qu'il aime le français et la France – « ma consternation à la possibilité que l'emploi de l'anglais soit généralisé et encouragé dans l'enseignement supérieur en France. » Parce qu'il s'agit bien de cela ! Il ne s'agit pas de quelques conventions internationales ciblées, il s'agit d'encourager et de généraliser l'enseignement de l'anglais en France.

« Plus qu'un crime, c'est une erreur. Cette prétendue réforme est inspirée par des considérations purement commerciales mais elle ne manquera pas de se retourner contre ses auteurs. Les étudiants désireux de poursuivre des études en anglais » – c'est un professeur établi en Australie qui nous le dit, parce qu'il fréquente ces étudiants – « finiront inévitablement par se tourner vers des pays de langue anglaise plutôt que vers une France dont l'anglophonie sera toujours forcément de seconde classe.

« Personne en Australie, même la majorité monolingue, ne comprend cette réforme : elle est contreproductive et humiliante non seulement pour la France mais aussi pour les francophones et les francophiles du monde entier. Je vous conjure d'y renoncer. »
C'est signé Ivan Barko, professeur à l'université de Sidney.
Sourires.

Vous ne voulez pas les écouter, vous ne voulez pas les entendre, restez donc entre vous. Vous ne voulez pas entendre la vérité, regarder la réalité et voir la portée de votre réforme.

Non, ce n'est pas moi, mais peut-être qu'elle se trouve dans le dialogue et dans l'écoute réciproque. Or je n'ai pas l'impression, aujourd'hui, d'être réellement entendu par certains d'entre vous, encore que je sois persuadé que vous soyez un certain nombre à vous poser des questions quant à la portée réelle de cet article 2. Ce qu'il faut, c'est un grand débat. Suspendre l'examen de cet article 2, le mettre entre parenthèses. Ayons un vrai débat sur la question de l'attractivité de nos universités, sur les raisons pour lesquelles on n'attire plus un certain nombre d'élites des pays francophones, qui vont se former aux États-Unis. Pourquoi donc le font-elles ? Croyez-vous vraiment que les élites de l'Afrique francophone choisiront la France plutôt que les États-Unis si nous décidons d'enseigner en anglais ? Non. Elles maîtrisent déjà notre langue.
La question de l'attractivité des universités excède donc largement celle de la langue. Il y a des freins à l'accueil des étudiants étrangers en France. Peut-être l'attractivité de l'université française est-elle aujourd'hui insuffisante. Vous posez bien le problème, ce sujet justifie un vrai débat, mais la réponse que vous y donnez n'est pas la bonne. Ce n'est pas en basculant dans l'anglais que l'on rendra l'université française plus attractive, notamment vis-à-vis de ces élites d'un certain nombre de pays francophones,…

…c'est en défendant le multiculturalisme et le multilinguisme, en le défendant en France mais également à Bruxelles.
Regardez de près les programmes Erasmus qui existent aujourd'hui. Vous vous apercevrez qu'ils ne sont pas conçus pour promouvoir l'apprentissage d'autres langues. En réalité, la mobilité telle qu'elle a été conçue en Europe conduit au tout-anglais. Il faudrait une réorientation de la politique française en matière d'attractivité de nos universités et d'accueil des étudiants étrangers, il faudrait aussi réorienter la politique européenne. Umberto Eco le disait : la langue de l'Europe, c'est la traduction, ce n'est pas l'anglais. Comment défendrons-nous demain le français comme langue de travail à Bruxelles si nous cédons nous-mêmes, en France, dans nos universités au tout-anglais ?

Il y a là une espèce de schizophrénie : d'un côté, nous voulons défendre le français à Bruxelles, défendre l'exception culturelle ; de l'autre, nous cédons à cette mode de l'anglais dans nos universités.
Je vous en conjure donc : mettons entre parenthèses cet article 2, et ayons un vrai débat de fond sur la question de l'enseignement des langues à nos étudiants en France, sur la question de l'attractivité française. Ne prenons pas la décision que vous suggérez de prendre, ne votons pas ce texte ; ce serait un très mauvais signal pour la francophonie dans le monde.

Avant de donner la parole à Mme Bechtel, je vous rappelle, mes chers collègues, que, dans le cadre du temps programmé, chaque orateur s'exprime aussi longtemps qu'il le souhaite dès lors que cela n'excède pas le temps imparti à son groupe, et le temps restant à chaque groupe est précisé à chaque début de séance.
La parole est à Mme Marie-Françoise Bechtel.
Sourires.
Sourires.

Ayons l'obligeance d'écouter Mme Bechtel, mes chers collègues. Elle seule a la parole.

Je regrette que M. Fasquelle, après avoir essayé de jeter une certaine clarté dans le débat, en distinguant justement la question de l'apprentissage des étrangers dans une langue étrangère en France et celle de l'ouverture à des étudiants français d'une maîtrise des langues étrangères, soit tombé ensuite dans une véritable confusion, en parlant notamment d'Erasmus, qui est précisément l'un des rares dispositifs par lesquels l'Europe offre du multilinguisme,...

…mais je ne veux pas développer ce point.
Je comprends aussi l'opposition, qui ne cesse d'accuser la majorité de frilosité et d'archaïsme, soit prise à contre-pied par cette mesure et que, d'une certaine manière, elle le vive mal.
Il faut raison garder, et cela vaut pour tous ceux qui veulent intervenir dans ce débat, y compris par voie de presse.
Tout d'abord, de quoi s'agit-il exactement ? Selon les dispositions initiales du texte amendé par la commission, le texte dont nous sommes saisis, il s'agit bien de proposer à des étudiants étrangers une part d'enseignement dans une autre langue que le français, avec l'obligation – peut-être pas encore suffisamment sanctionnée dans l'attribution du diplôme – d'apprendre également le français. Cette langue, nous le savons tous – c'est évident, alors ne nous voilons pas la face –, ce sera d'abord l'anglais, en raison de sa position dominante et aussi des possibilités matérielles des universités ; cela pose d'ailleurs la question du niveau auquel cette dérogation doit être ouverte.
Le souci de l'attractivité justifie-t-il cette volonté d'introduire une part mesurée – j'y insiste : c'est une part mesurée, même si je souhaite pour ma part amender le texte – d'enseignements en langue étrangère dans les enseignements ouverts aux étudiants étrangers ? Je crois que, si on a une vision réaliste de l'attractivité, c'est le cas.
Tout d'abord, cela ne porte pas atteinte à la francophonie. Celle-ci est une projection de la France, de sa langue et de ses valeurs vers l'extérieur. Je puis témoigner, pour avoir un temps circulé dans de nombreux pays, que nos attachés linguistiques, nos Alliances françaises, sont extrêmement dynamiques en ce domaine. La francophonie est donc un autre sujet.
Comme l'a très bien dit quelqu'un tout à l'heure, lorsque nous faisons venir des étudiants étrangers en France, ceux-ci participent, dans la vie quotidienne, à la langue française, à la culture et aux valeurs françaises. Ils sortent en ville, ils ont des amis, des petites amies et des petits amis, ils prennent le bus, ils mangent dans les restaurants, ils discutent avec leur logeuse. En bref, ils baignent dans la culture française, et c'est bien là un prolongement de la francophonie.
L'attractivité doit être envisagée d'une manière réaliste, et la ministre a rappelé que nous sommes au cinquième rang. Il est juste de souligner que le premier problème qui se pose en cette matière est celui du visa. Je ne citerai qu'un chiffre : il y a aujourd'hui 800 000 Russes francophones, de bons francophones, et quelques milliers de visas sont délivrés. Un grand nombre de Russes francophones sont en attente de visa, et non pas d'enseignements en anglais ou en russe dans les universités française.

Il n'en reste pas moins, à mes yeux, un élément d'attractivité qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer. Je veux témoigner que le système marche, et qu'il marche bien à partir du master.
Lorsque je dirigeais une grande école de la République, j'avais instauré l'équivalent de masters 2 – cela ne s'appelait pas ainsi car l'ENA n'est pas une université –, de niveau professionnalisant donc, en matière, notamment, de contrôle des finances publiques, de gestion de crise, de droit européen appliqué. Je l'avais fait dans des cycles proposés en chinois et en arabe pour commencer, avec l'idée de continuer, notamment, avec des cycles en russe et en espagnol ; mes successeurs l'ont d'ailleurs fait.

Ces cycles marchaient très bien, même si ce n'est pas tout à fait comparable, car une partie d'entre eux étaient des cycles courts de six mois. Nous avions cependant aussi des cycles longs d'un an, dans le cadre desquels des personnes qui n'étaient pas exactement des étudiants se formaient à la langue et aux valeurs françaises, tout en pouvant suivre des enseignements de master pointus, sur des questions pour lesquelles la tradition administrative française leur apportait quelque chose.
Je ne serai pas longue, madame la présidente. J'ai déposé un amendement visant à encadrer un peu plus ce système. Je sais que chacun d'entre nous proposera un dispositif de son cru ! Celui que, pour ma part, j'appelle de mes voeux, ne comprendrait pas trop de mesures d'encadrement de rang législatif. Nous mesurons mal, dans cet hémicycle, les potentiels effets pervers de telles mesures. En revanche, si nous renvoyions au pouvoir réglementaire le soin de définir – après concertation, bien entendu – les conditions dans lesquelles un accès mesuré pourrait être ouvert, un dispositif équilibré pourrait rapidement être mis en place.

Madame la présidente, madame la ministre, pour ne pas utiliser le temps réservé à mon groupe, j'ai l'intention de retirer l'amendement n° 536 que j'ai déposé sur cet article 2, et qui doit être discuté tout à l'heure.
Nous assistons à l'un de ces faux débats qui ont malheureusement trop souvent lieu dans cet hémicycle. Alors que des centaines de milliers d'étudiants échouent à l'université, on se concentre sur un problème loin d'être majeur pour l'université française.
Plusieurs députés du groupe UMP. À qui la faute ?

Pour répondre brièvement à nos collègues de l'opposition, je dirai premièrement que la France croit à l'universalité de sa langue. Deuxièmement, la France croit au multilinguisme.

Mais si, mais si ! Vous n'avez pas, monsieur Fasquelle, le monopole de la francophonie ou du multilinguisme !
Ces exceptions à la loi Toubon se justifient pour plusieurs raisons. Un débat similaire a déjà eu lieu dans cet hémicycle à propos du droit des brevets au niveau européen : cela fonctionne mieux depuis que nous avons modifié la législation applicable en la matière. Le débat qui a lieu aujourd'hui n'est pas très éloigné de celui-ci.
Certains collègues ont déposé des amendements pour défendre leur point de vue, selon lequel l'usage d'une langue étrangère doit être réservé à des cas exceptionnels, justifiés par des considérations pédagogiques. Mais il faut d'abord attirer les étudiants étrangers dans notre pays ! Vous parliez tout à l'heure de signal : l'exemple même d'un mauvais signal, c'est la circulaire Guéant ! Dire que les étrangers n'ont plus le droit de rester dans notre pays, que l'immigration est un problème, voilà le mauvais signal !
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et RRDP.

Le mauvais signal, ce n'est pas la question de la langue, c'est de ne pas attirer des étudiants étrangers.
Deuxième point : il faut continuer à apprendre le français. Comme Yves Durand le disait, la loi sur la refondation de l'école l'a déjà indiqué : dès l'école primaire, d'autres langues seront enseignées, et il faut continuer à le faire dans le secondaire. Un des problèmes de la France réside dans l'impréparation de ses étudiants à l'anglais. Nos étudiants parlent mal anglais : c'est un des sujets que vous avez abordé, madame la ministre.
Troisième point : comme le disait très bien Marie-Françoise Bechtel, il ne s'agit pas que de l'anglais.

Il s'agit aussi de l'allemand, de l'espagnol, du chinois, et de toutes les autres langues.

Je suis élu d'une région frontalière, la Lorraine. Les universités de cette région coopèrent avec des universités allemandes, comme celle de Sarrebruck, et organisent par exemple des cotutelles de thèses. Il est évident que l'on doit pouvoir parler allemand et français, et éventuellement anglais ou d'autres langues, dans ces universités !
Le projet de loi soumet l'usage de l'anglais à un certain nombre de conditions, qui seront peut-être précisées tout à l'heure. Pourtant, certains ont prétendu qu'il est mauvais d'introduire l'anglais à l'université, alors que cette langue est déjà utilisée dans un certain nombre de grandes écoles de notre pays.

Quelle hypocrisie ! L'élite a droit à l'anglais, et l'université n'y aurait pas droit ? C'est une inégalité !
Applaudissements sur divers bancs des groupes SRC et RRDP.

Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur Fasquelle : pour ce qui est de votre analyse du multilinguisme et de l'universalité de la langue française, nous ne sommes pas très éloignés. Mais ce que vous avez dit à un moment donné, à savoir que l'on doit utiliser uniquement le français dans les universités françaises, témoigne à mon avis d'une vision trop étroite de l'usage de notre langue.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Je n'ai jamais dit cela ! C'est une caricature, et vous le savez très bien !

Je suis heureux de voir que nous nous acheminons vers la fin du débat sur l'article 2. De mon point de vue, ce débat a pris des proportions exagérées : c'est surréaliste !

Il faut revenir au texte même du projet de loi, qui élargit les exceptions prévues au principe de l'enseignement en français. Il s'agit en somme d'aligner ces possibilités d'exception sur le régime applicable aux langues régionales.

Aux termes de l'article 2, le régime applicable aux enseignements en langues étrangères sera identique au régime applicable aux enseignements en langues régionales.

Franchement, on parle du caractère audacieux de cette réforme, mais il n'y a que M. Fasquelle – qui a une phobie de l'étudiant étranger, et qui, en fin de compte, ne fait que recycler la position de la majorité précédente à propos des visas délivrés aux étudiants – pour imaginer le pire de cette prétendue dérive.
Protestations sur les bancs du groupe UMP.

Bien sûr ! Mais on ne vous a pas entendu à propos de la circulaire Guéant…
Vives protestations sur les bancs du groupe UMP.

Mes chers collègues, seul M. Mandon a la parole. Un peu de calme, s'il vous plaît ! Monsieur Mandon, merci de poursuivre.

Je vais même réveiller un peu plus mes collègues de l'opposition, en leur disant que je pense que ce débat est un débat de divertissement, qui vise à faire oublier les vrais problèmes de l'université française.
« Bravo ! » et applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Depuis 2005, notamment, de moins en moins de bacheliers poursuivent des études supérieures. Si nous consacrions moins de temps à débattre d'un sujet en fin de compte extrêmement limité et plus à des sujets comme celui de l'échec des étudiants, peut-être nos collègues de l'opposition auraient-ils des comptes à rendre. Or c'est ce qu'ils veulent soigneusement éviter !
Protestations persistantes sur les bancs du groupe UMP.

Sur quel article du règlement votre intervention se fonde-t-elle, monsieur le député ?

L'article 58, alinéa 1, madame la présidente.
Notre collègue s'est exprimé en toute liberté. Notre groupe est d'ailleurs extrêmement attaché à ce que ses membres puissent donner leur avis sur cette question. La manière dont, à l'instant même, ont été interprétés les propos de M. Fasquelle, est honteuse !

Un de nos collègues a prétendu que M. Fasquelle a une phobie de l'étudiant étranger.

De tels propos ne sont pas dignes de cet hémicycle, surtout quand on sait comment Daniel Fasquelle s'est battu, alors qu'il occupait les fonctions de doyen dans une université, pour conclure des accords avec des établissements étrangers et développer le rayonnement à l'étranger de l'université française.

J'espère que notre collègue Thierry Mandon présentera ses excuses à Daniel Fasquelle.
suite

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, était-il judicieux d'intégrer le problème de l'enseignement en anglais dans l'enseignement supérieur à ce projet de loi ? Était-il judicieux de l'aborder dès l'article 2 ?

La majorité suscite ainsi une polémique qui lui permet de masquer les vraies conséquences de ce projet de loi, qui constitue une véritable régression, en termes de performance, pour nos universités. Là où il y avait de la souplesse et de l'autonomie, il y aura désormais de la rigidité et du centralisme étatique.
L'égalitarisme à marche forcée ne permet malheureusement pas la réussite et la compétitivité. Les réponses aux problèmes de l'université devraient au contraire permettre l'innovation et la créativité. Il faut une démarche partenariale, une synergie autour de projets innovants, entre l'université, le monde des chercheurs, les centres de recherche publics et privés, et les entreprises.
Il est évident que ce projet de loi ne se résume pas à la légalisation de l'enseignement en anglais dans nos universités, qui inquiète légitimement le monde de la francophonie. Sans être aussi catégorique que mon collègue Daniel Fasquelle, je pense que les cours en français doivent être la règle, et qu'à partir du master, notamment dans certaines disciplines scientifiques, technologiques ou économiques, certains cours peuvent être dispensés en anglais.
Le vrai problème – cela a été souligné – est celui du multilinguisme. À l'université, l'apprentissage ou le perfectionnement des langues vivantes – et pas seulement de l'anglais…

…– doit être offert à l'ensemble des étudiants. De ce point de vue, le programme Erasmus obtient des résultats remarquables.
L'attractivité, l'excellence et la performance de nos universités – et de notre enseignement supérieur en général – passent aussi par des examens et des concours, qui doivent être maintenus en langue française. Les étudiants étrangers venant en France, à défaut d'être francophones, sont francophiles, et par là prêts à faire des efforts pour travailler en français. La langue française est langue officielle du Conseil de l'Europe, et du Comité international olympique. Elle est au service du monde, de la liberté, et de nos étudiants.

Pour conclure, permettez-moi de poser la question suivante : était-il judicieux de légiférer sur ce sujet ? Ne valait-il pas mieux faire confiance aux présidents d'université ?
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, je demande un rappel au règlement sur le fondement de l'article 58 alinéa 1 de notre règlement. M. Mandon vient de gravement déraper…

Monsieur Fasquelle, il s'agit d'un fait personnel, qui relève de l'article 58 alinéa 4 du règlement. Vous aurez donc la parole à la fin de la séance.

Monsieur Fasquelle, vous aurez la parole pour revenir en fin de séance sur cet incident.
La parole est à M. le rapporteur.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, je me permettrai de consacrer quelques minutes à ce débat qui a occupé la commission une heure et demie sur dix-sept heures de travaux. Contrairement aux propos tenus par les uns et les autres, je pense qu'il y a là un vrai problème, qu'il s'agit d'un vrai débat. Derrière les enjeux soulevés par ce débat, il y a la question de la langue française, celle de l'ouverture des universités au monde, et enfin celle de notre dynamisme.
Il s'agit d'un vrai débat, car il a permis à chacun d'entre nous de découvrir un certain nombre de réalités. Pour moi, il est assez naturel qu'un certain nombre de cours soient dispensés en langues étrangères. D'un autre côté, je suis parfois surpris que certaines grandes écoles – y compris celle dont je suis issu, HEC – dispensent l'intégralité de leurs cours en langues étrangères. Ce sujet a émergé : je ne le trouve pas inintéressant.

Ce débat est révélateur : il peut permettre l'apparition de points de convergence. J'ai récemment discuté de ces questions avec Antoine Compagnon, Alain Rey et Abdou Diouf. Nous sommes entre gens de bonne compagnie,…

…et discutons d'un sujet important : celui de la France, et de sa langue si particulière. Nous savons qu'il y a un lien indissociable entre le français, la République, sa littérature, et le rayonnement de la France à l'étranger.
La difficulté de ce débat vient de ce qu'il présente quatre aspects différents. Je les mentionnerai tous, mais ne m'attarderai que sur un seul de ces aspects.
Premier point : l'avenir de la langue française. Je ne rentrerai pas dans la discussion sur les prises de position de Claude Hagège et de Bernard Pivot. Est-elle menacée ? D'une part, je n'ai pas la compétence nécessaire pour répondre à cette question, et d'autre part je ne suis pas sûr qu'il soit lieu de la trancher dans le cadre de ce débat.

Je ne prétends pas à l'omniscience. Je pense simplement qu'il faut creuser ces questions. Monsieur Myard, si nous voulons avoir un vrai débat sur le sujet du rayonnement de notre pays, il nous faut échanger des arguments de manière pertinente et courtoise. Il convient donc de ne pas couper la parole aux orateurs !

Bien sûr, nous sommes d'accord. Nous restons toujours respectueux, nous !

Second point : la question de la francophonie. J'ai bien pris note des interrogations que cette réforme a suscitées dans le monde de la francophonie. Comme je l'ai dit en commission, je ne suis pas moi-même inquiet quant à son développement, pour une raison assez simple : la démographie du continent africain lui permettra de se développer si nous l'accompagnons de manière pertinente.
Au-delà de cette question, et sans citer de faits précis – un discours prononcé en un certain lieu, une certaine circulaire – je ne suis pas sûr qu'au cours des dernières années, le discours tenu par la République Française à l'égard de nombreux pays africain ait été un discours d'ouverture et de solidarité. Les signaux envoyés à certains pays que nous connaissons bien, comme l'Algérie – que je connais plus particulièrement – ont été bien plus négatifs que celui de l'article 2.
Troisième point : le problème de la maîtrise des langues étrangères en France. Ce problème prend sa source bien en amont de l'université : il débute en classe maternelle et à l'école primaire. Avec la loi sur la refondation de l'école de la République, nous essayons de renforcer l'enseignement des langues dès l'école primaire. Il y a, là aussi un échec collectif : en moyenne, les élèves qui passent le baccalauréat ont reçu environ sept cents heures de cours de langues étrangères. Or je ne suis pas sûr que le niveau moyen des lycéens français en langues étrangères soit suffisant – nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet.
J'en arrive à un point sur lequel je concentrerai mon propos, la façon dont nous procédons pour accueillir un maximum d'étudiants étrangers dans les universités françaises. Aujourd'hui, nous comptons 12 % environ d'étudiants issus de pays étrangers dans l'enseignement supérieur et la recherche et plus de 40 % en doctorat. Comment pouvons-nous consolider cette situation ? Selon le rapport du Secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, auquel je vous renvoie, la France régresse : elle est en cinquième position, alors qu'elle était encore récemment en troisième, voire en deuxième position. Quant aux nationalités des 288 000 étudiants présents dans notre pays, si l'on relève qu'il s'agit d'abord des Marocains, ensuite des Chinois – ce qui est normal, car c'est un grand pays –, des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, des Camerounais puis des étudiants européens, certains continents et pays ne sont pas représentés au sein de l'enseignement supérieur de notre beau pays ! Comment y remédier ? Même s'il convient, dans un premier temps, de dispenser des cours en langues étrangères, cette difficulté ne peut se résoudre que par ce biais. Ainsi, le projet de loi prochainement porté par le ministre de l'intérieur avec la collaboration de Mme Fioraso traitera de la question, à mon avis essentielle, des visas. Il conviendra aussi de régler le problème des conditions d'accueil et des droits d'inscription, sujet sur lequel des amendements ont été déposés et que nous aurons donc examiner, sachant que les conditions de vie dans les résidences étudiantes sont également à prendre en considération.
Je tiens, au risque d'être un peu long, mais c'est parfois le rôle du rapporteur, à vous donner lecture de cet article 2. Le projet de loi disposait : « Des exceptions peuvent également être justifiées par la nature de certains enseignements lorsque ceux-ci sont dispensés pour la mise en oeuvre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen. » Non seulement la commission a ajouté à cette phrase les mots « –et pour faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues », mais le travail accompli a encore enrichi cet article.
Le premier ajout est le suivant : « Dans ces hypothèses, les formations ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère. » Tel était l'objectif de l'amendement de M. Rudy Salles, amendement qui, pour moi, n'est pas totalement anodin. Il n'est pas question que tous les cours soient dispensés en langues étrangères. Nous devrons, d'ailleurs nous interroger sur les formations dispensées entièrement en étranger dans les établissements d'enseignement supérieur, afin d'avoir une vision globale – ce qui est compliqué puisque le ministère de la recherche n'a pas la cotutelle de l'ensemble desdits établissements : quelle est la réalité et cette mesure est-elle une bonne solution ?
La suite de l'article 2 a ensuite été rédigée en ces termes : « Les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française. » Il est en effet totalement exclu que ces étudiants arrivent en France sans avoir reçu une heure de cours en Français.
Nous sommes même allés encore plus loin, sous l'impulsion de notre président de commission et grâce à l'appui de Mme la ministre puisque nous avons obtenu que la fin de l'article soit ainsi précisée : « Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme. » Ce n'est en effet pas forcément le cas aujourd'hui.
À l'occasion de ce débat, nous avons donc soulevé un vrai sujet, découvert une réalité et fixé des bornes. Nous sommes par conséquent toutes et tous conscients de la réalité des enjeux. Nous avons toutes et tous compris que, s'agissant de la francophonie et des signaux que nous adressons au reste du monde, nous devons probablement faire preuve de davantage de vigilance. Quelques amendements ont été adoptés en ce sens. Mais il y a, parallèlement, la politique globale du Gouvernement envers la francophonie. Nous avons toutes et tous compris que, bien sûr, nous devons ouvrir nos universités tout en défendant notre langue française. Comme certains d'entre vous, j'interviens à Columbia et je sais que l'on n'est pas toujours aussi à l'aise en anglais qu'en français quand on dispense un cours.
Permettez-moi d'ailleurs de vous donner le fond de ma pensée : je trouve, parfois, ridicule que certains enseignants français soient contraints de donner leurs cours en anglais lorsqu'il s'agit de matières spécifiques comme le droit.

J'ai en tête des exemples d'amis qui enseignent dans des grandes écoles et qui, d'une année à l'autre, ont dû dispenser leurs cours de droit dans un anglais qu'ils ne maîtrisaient pas !
Fallait-il inscrire cette mesure dans la loi ? Peut-on ne pas se poser la question de l'ouverture de l'université à l'international, lorsque l'on discute d'un projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche ? Parce que la loi Toubon de 1994 n'est pas respectée, il faudrait ne pas s'embêter avec ce sujet ? Tel n'est pas ma conception de la loi.
Dernier point, pouvons-nous aller encore plus loin dans la discussion parlementaire ? Nous avons déjà fait évoluer les choses en commission. Ainsi avons-nous examiné deux amendements que je trouve assez structurants. Un troisième amendement a été proposé, tendant à ce que l'enseignement en langue étrangère soit lié à un intérêt pédagogique. Après discussion, j'en ai déposé un autre, similaire, qui a reçu l'avis favorable de la commission.
Le sujet étant lié à la francophonie, d'autres députés tels que Jean-Pierre Dufau et Pouria Amirshahi, ont appelé à ce titre à la vigilance. J'ai parlé à cet égard avec Abdou Diouf vendredi dernier. Selon lui, les francophones ont parfois le sentiment que les Français sont celles et ceux qui sont les moins attachés à la langue française.

Tel est d'ailleurs le message qu'il a adressé lors de sa première rencontre avec François Mitterrand en 1984 au Sommet de la francophonie – argument auquel nous avons, comme Mme la ministre, été sensibles. Je suis, prêt à cet égard à retirer mon amendement pour permettre à un député identifié au monde de la francophonie de porter cette proposition.
Nous avons donc eu, me semble-t-il, un bon débat lors de l'examen de ces amendements et je ne doute pas que cela va continuer. C'est, en effet, un vrai sujet parce qu'il traite de la France, de sa langue et de son rayonnement. Cet article 2 est donc un bon article qui deviendra excellent après le débat parlementaire !
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, vous avez indiqué, après l'intervention de notre collègue Daniel Fasquelle, qu'en application de l'article 58, alinéa 4, de notre règlement, notre collègue pourrait s'exprimer en fin de séance. Nous y comptons bien.

Toutefois, en raison de cet incident, je demande, au nom de mon groupe, une suspension de séance de cinq minutes.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.
Article 2
La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à onze heures vingt-cinq.

Bien que M. le rapporteur se soit exprimé, je souhaiterais revenir sur le travail en commission.
J'avais, pour ma part, déposé un amendement tendant à supprimer cet article 2. Je me félicite, toutefois, des différents amendements adoptés par la commission et de l'ouverture dont a fait preuve M. le rapporteur.
La défense de la langue est celle de notre culture, de notre histoire. Par conséquent, maintenir la langue française comme le vecteur premier de l'enseignement est nécessaire. Cela dit, gardons ce débat au niveau qu'il mérite et ne mélangeons pas tout. Faire rayonner la langue française, c'est permettre à des femmes et à des hommes de faire rayonner, en s'exprimant dans d'autres langues, notre culture, nos idées, notre recherche et notre innovation technologique. La question du rayonnement de la langue française passe donc également par un apprentissage d'autres langues tout au long de la scolarité. Des individus qui ne maîtrisent pas d'autres langues se renferment automatiquement et ne peuvent pas porter le rayonnement de notre langue et de notre pays. Il ne s'agit donc pas simplement de l'apprentissage de l'anglais.

Nous parlons sans cesse des pays émergents, de la mondialisation. Ouvrons l'enseignement à d'autres langues…
Sourires.

…et ne nous limitons pas simplement à l'anglais, à l'allemand ou aux autres langues européennes ! Enseigner d'autres langues dès l'école élémentaire, c'est donner aux jeunes la chance d'une meilleure scolarité. On le voit chez les enfants bilingues, avec qui, lorsque l'on soutient leur bilinguisme dès la maternelle, on obtient des résultats remarquables. Faire rayonner le français passe donc par l'enseignement d'autres langues à nos enfants, tout au long de leur scolarité.
Un mot ensuite sur l'attractivité de nos universités. Elle est liée à la qualité de nos établissements et de notre recherche, sujet sur lequel va porter le reste de nos débats. Elle dépend également de la qualité de l'accueil des étudiants étrangers, que j'évoquais hier à propos d'étudiants du Mozambique. L'accueil, c'est d'abord évidemment les visas – et l'on sait à quel point la France s'est refermée ces dernières années, alors que tant de jeunes ont envie de venir étudier dans notre pays –, mais ce sont aussi, sur le plan social, les bourses, le logement et l'accompagnement, par exemple sous forme de tutorat, tous soutiens qui peuvent justement permettre aux jeunes étrangers de se trouver bien dans notre pays. Enfin, il faut que ces jeunes qui viennent étudier en France puissent, s'ils le souhaitent, travailler un temps dans notre pays et transformer leur visa étudiant en visa de travail.
Quant à la francophonie, c'est un sujet dont je me suis beaucoup occupée comme ministre de la jeunesse et des sports sous le gouvernement Jospin. Pour de nombreux pays, la francophonie représente, au-delà de la langue, un espace international permettant de développer des coopérations et d'accroître leur influence au niveau mondial. Appartenir à la francophonie n'empêche pas forcément de voir reculer l'usage du français à la vitesse grand V, car le développement de la langue française dépend surtout du rôle que peuvent jouer les pays francophones sur la scène internationale dans le domaine des droits de l'homme, de l'éducation, du développement économique et social. Il ne suffit donc pas de défendre la langue pour permettre son rayonnement et pour élargir la francophonie : c'est en jouant tout notre rôle en matière de coopération en général.
Cela étant dit, je me félicite de l'ouverture faite par M. le rapporteur.

Je voudrais revenir sur les propos tenus tout à l'heure par Thierry Mandon, qui nous a dit trois choses fort intéressantes : d'abord que ce débat était une tempête dans un verre d'eau ; ensuite qu'il s'agissait d'un débat de divertissement ; enfin, il a agressé notre collègue Daniel Fasquelle, considérant qu'il avait la phobie des étrangers.
« Mais non ! » sur les bancs du groupe SRC.

Je voudrais donc demander au porte-parole du groupe socialiste si les quarante députés socialistes qui partagent l'analyse de Daniel Fasquelle en ayant cosigné un amendement d'un membre de leur groupe mènent un débat de divertissement, ont la phobie des étudiants étrangers et déclenchent une tempête dans un verre d'eau !
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Un peu de cohérence, monsieur le député !
Sur le fond du dossier, il ne faut pas, en premier lieu, confondre la langue et la francophonie. La francophonie en effet ne se résume pas à la langue ; c'est aussi une culture et des valeurs. Un étudiant étranger qui vient étudier en France en repartira, même s'il a étudié en anglais, empreint de la culture française et de nos valeurs, qu'il pourra ensuite diffuser dans son pays d'origine.
En second lieu, nous parlons ici d'attirer des étudiants non francophones. Le rapporteur a rappelé les chiffres : aujourd'hui, la majorité de nos étudiants étrangers sont originaires de pays francophones. Si nous voulons participer à la mondialisation de l'enseignement supérieur, il nous faut attirer des étudiants originaires de pays non francophones, notamment des pays émergents en pleine expansion économique comme la Russie, la Chine le Brésil ou l'Inde, les fameux BRIC – et je ne parle pas ici de notre ministre du commerce extérieur…
Sourires.

Pour attirer les étudiants originaires de ces quatre pays, il est nécessaire que nous dispensions une partie de notre enseignement en anglais.
Regardons enfin ce que dit l'article 2. Il parle, d'une part, d'un enseignement partiellement dispensé en langue étrangère, et qui ne concerne, d'autre part, que certains cursus. À aucun moment il n'est question de généraliser l'usage de l'anglais. C'est la raison pour laquelle je soutiens cet article 2, même si je regrette profondément les propos caricaturaux de M. Mandon.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

La parole est à M. Olivier Véran, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.

Madame la ministre, mes chers collègues, je dois vous faire une confidence : il m'arrive de donner quelques cours en langue étrangère. Je ne suis pas le seul. Selon l'Institut national des études démographiques, 25 % de nos universitaires donnent des cours en langue étrangère – surtout en anglais, mais pas seulement.
Je dispense encore quelques cours en français dans les amphithéâtres de la faculté de médecine de Grenoble, et c'est normal. Dans le secret des stages en revanche et lorsque j'accueille dans mon service hospitalier des étudiants suédois, allemands ou argentins, il m'arrive de communiquer avec eux en espagnol ou en anglais, et de leur faire rédiger en anglais des observations pédagogiques ou des études de cas, qu'ils présentent ensuite à l'oral. Suis-je en marge de la loi ? Mets-je en danger la francophonie ? Je n'en suis pas sûr.
Je m'inspire en cela de mon expérience comme étudiant. J'ai bénéficié en effet, à la fin des années quatre-vingt-dix, d'un programme d'échange avec la Catalogne, qui n'est pas le dernier pays à défendre sa langue. Lorsque je suis arrivé dans les amphithéâtres de Reus, au sud de Barcelone, ne parlant pas un mot de catalan mais avec quelques notions de castillan et d'anglais, j'ai demandé, avec les autres étudiants français, à ce que les cours se fassent en castillan ou en anglais, histoire de nous laisser le temps de nous habituer à la langue et de comprendre ce dont on parlait, ce qui n'a posé aucun problème aux enseignants. J'ai également suivi un master à Sciences-Po à la fin de mes études de médecine, dans lequel certains cours étaient dispensés en anglais, parce que des intervenants ou des étudiants étrangers y participaient.
Il ne s'agit pas ici de faire de la « real-linguistique », mais nous devons tenir compte des progrès de la mondialisation et de la multiplication des revues à fort impact qui ont fait considérablement évoluer l'enseignement. Je répète qu'un quart de nos universitaires admettent donner des cours en langue étrangère.
C'est une chance, car tout doit être fait pour attirer les étudiants étrangers… et les garder. Jean-Yves Le Déaut a parlé tout à l'heure de la suppression de la circulaire Guéant ; il fallait évidemment la supprimer ! L'ouverture aux langues étrangères participe de la même logique, et l'article 2 n'entend pas généraliser leur usage mais entériner dans l'université un usage déjà légal dans les grandes écoles.
En conclusion, la francophonie ne se résume évidemment pas à l'enseignement en français. Je citerai à cet égard le canadien Gilles Vigneault, grand défenseur de la langue française, pour qui la francophonie, « c'est le pays de l'intérieur. C'est le pays invisible, spirituel, mental, moral, qui est en chacun de vous. »
Ce pays, mes chers collègues, nous devons le faire découvrir au plus grand nombre. Nous devons le faire partager. Les étudiants étrangers sont et seront nos meilleurs ambassadeurs. Il faut nous donner les moyens de les accueillir dans les meilleures conditions.
Je voulais préciser les raisons qui nous font aborder cette question à l'article 2. Nous suivons tout simplement l'ordre du code de l'éducation, dans lequel cette question figure avant celle des missions.
Il ne s'agit nullement, bien au contraire, d'occulter le reste de la loi, et je me suis suffisamment désolée, voire désespérée, de ce que, ces quinze derniers jours, on n'ait parlé que de ce seul article 2 et non des soixante-huit autres, qui me paraissent d'égale importance. C'est pourquoi je me réjouis de la qualité de nos échanges, sereins malgré la passion qui nous anime parfois.
Quant à la circulaire Guéant du 31 mai 2011, j'ai décidé de son abrogation, car elle a été extrêmement fâcheuse pour l'image de notre pays, et je m'explique mal qu'on l'ait si peu dénoncée. Il s'agit en effet d'une décision qui a véritablement désorienté les communautés francophones et étrangères, notamment au Canada, tant elle était contraire à l'image d'universalité et de diffusion des valeurs et de la culture attachée à notre pays.
Il nous faut revenir à ces valeurs et, comme l'a dit Marie-George Buffet, nous devons renforcer l'attractivité de notre pays en améliorant l'accueil des étudiants étrangers et en développant les coopérations que nous nouons avec les pays francophones, dans les domaines sportif, culturel, éducatif ou économique, aspects que nous avons sans doute trop négligés jusqu'alors.
Pour améliorer l'accueil des étrangers, nous avons proposé, Manuel Valls, Laurent Fabius et l'ensemble de nos collègues concernés, la délivrance de visas pluriannuels, et nous travaillons avec les consulats pour faciliter l'obtention des visas, ce qui est une condition primordiale au bon accueil des étrangers.
De la même manière, si Manuel Valls et moi nous sommes rendus récemment à la Cité internationale universitaire, c'est pour témoigner de notre détermination à améliorer et réhabiliter les logements destinés aux étudiants étrangers. Nous devons disposer de davantage de ces logements, notamment en région parisienne, pour accueillir les étudiants étrangers dans les meilleures conditions possibles. Il n'est pas normal en effet que nos étudiants soient aujourd'hui mieux accueillis en Corée que ne le sont les étudiants coréens chez nous.
Je vous remercie de nouveau pour la qualité de nos débats et vous encourage à les poursuivre avec la même sérénité, la même sincérité et la même conviction. Je me réjouis que nous nous acheminions vers une solution apaisée. Évitons les brouillages et la confusion ; l'universalité suppose avant tout la confiance.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Nous en venons aux amendements à l'article 2.
Je suis saisie de trois amendements de suppression de l'article, nos 22, 31 et 296.
La parole est à M. Jacques Myard, pour défendre l'amendement n° 22 .

Ce débat n'a rien de polémique, c'est un débat de fond. Pour rebondir sur les propos du rapporteur pour avis, je tiens à signaler que, si les Catalans veulent bien que notre ambassadeur s'adresse à eux en français, ils refusent de l'écouter s'il parle castillan. C'est dire à quel point la Catalogne est fière de sa langue ! Il faut voir la réalité en face car elle est explosive à terme.
Contrairement à ce que vous prétendez, cet article n'ouvre pas l'université, il la ferme sur ce sabir parlé aujourd'hui un peu partout, que l'on présente comme le deus ex machina, et qui n'est en réalité qu'une conception mercantile de la langue imaginée pour vendre des cacahuètes. Vous occultez le fait qu'une langue sert aussi à forger des concepts. C'est grave.
L'on nous dit que les grandes écoles pratiquent ainsi, mais c'est proprement lamentable. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui les chercheurs, pour obtenir des subventions de l'Agence nationale de la recherche, doivent s'y prendre en anglais ! Mais où allons-nous ? Quel est ce peuple qui a honte de sa propre langue, qui n'est pas capable de continuer à forger des concepts comme il l'a fait pendant des siècles, en particulier dans les matières scientifiques, et qui s'en remet totalement à une langue étrangère ? Un peuple qui parle petit à petit une autre langue étrangère est un peuple qui perd son identité et qui appauvrit le système. Il faudrait tout de même le savoir. Vous mettez en place un processus d'appauvrissement, rien d'autre.
Moi aussi, je parle anglais à peu près couramment.

Je parle aussi allemand et je me suis mis à d'autres langues, comme l'arabe, qui est très belle, ou le chinois et le russe dont je maîtrise quelques rudiments – je ne le dis pas par vantardise, mais pour vous montrer que je suis bien conscient de la nécessité de s'ouvrir au monde. Il ne s'agit pas en effet de se replier sur soi. Je suis national, donc international, comme le rappelait d'ailleurs Blum. À cet égard d'ailleurs, je suis, depuis quelques jours, assailli par les médias anglo-saxons qui rigolent bien : qui sont ces Français, se demandent-ils en effet, qui ont honte de leur langue ? Si vous en doutiez, souvenez-vous alors, madame la ministre, des accords Blum-Byrnes. Je le rappelle pour ceux qui ne s'en souviendraient pas : ils ont été signés en 1946 alors que la France était en faillite et réclamait de l'argent aux Américains. Qu'ont imposé ces derniers en contrepartie ? Que leurs films soient projetés dans les salles françaises parce qu'ils savaient pouvoir s'appuyer sur leurs moyens culturels pour élaborer une stratégie d'influence. Et aujourd'hui, c'est nous qui nous mettons au service de cette influence !
Madame Buffet le disait à juste titre, il y a d'autres langues, mais je voudrais ici publiquement remercier la CGT qui a su faire perdurer la langue française dans tout le bloc soviétique.
Rires et exclamations sur les bancs des groupes GDR et SRC.

Lorsque je me suis rendu en Azerbaïdjan voilà quelques années, j'ai pu écouter des membres de l'académie des sciences prononcer en français un discours scientifique mieux que je ne l'aurais fait moi-même.
En enfermant l'université et les grandes écoles dans une structure mentale qui n'est pas la nôtre, nous commettons une faute stratégique. C'est la raison pour laquelle je défendrai la suppression de cet article.

Je me suis déjà exprimé tout à l'heure sur l'attractivité de nos universités et l'apprentissage des langues. Je n'y reviendrai pas mais je voudrais dire un mot de la francophonie et de l'impact que peuvent avoir des dispositions de ce type sur l'enseignement dans l'espace francophone.
Il faut tout d'abord comprendre que la francophonie n'est pas mécaniquement vouée à intégrer 800 millions de personnes dans le monde en 2050. Sait-on seulement qu'au Niger, lorsque le Président de la République Mahamadou Issoufou veut engager une politique d'éducation obligatoire des filles et des garçons de trois à seize ans mais que les moyens ne suivent pas pour construire des écoles et faire venir des enseignants formés, ce ne sont pas des écoles républicaines, des écoles mixtes où l'enseignement serait dispensé en français qui se construisent, mais des madrasas – et pas des plus sympathiques, si vous voyez ce que je veux dire. Les enjeux de la francophonie sont aussi d'ordre géopolitique et stratégique.
De même, s'il est vrai que la francophonie, ce n'est pas que la langue, c'est d'abord la langue. Bien sûr, les valeurs sont importantes mais si l'on compare le degré de démocratisation des pays selon leur langue, les plus avancés démocratiquement ne sont pas forcément ceux qui ont adopté la langue française, comme en témoigne l'exemple de l'Afrique.
Prenons donc garde à cette idée que la langue française porterait en elle un génie démocratique plus avancé que d'autres ; je n'en suis pas sûr.
En revanche, cette langue est un facteur de rapprochement entre les peuples et les cultures francophones dans le monde entier, et même avec certains pays non francophones où, comme en Russie, un grand nombre de jeunes veulent apprendre la langue française. De ce point de vue, il est très important de mener une stratégie qui s'articule autour de deux aspects, le multilinguisme d'une part, car la modernité aujourd'hui, c'est l'arabe, l'espagnol, le chinois, le français,…

…et la consolidation de l'espace francophone d'autre part. Si nous voulons peser davantage, mieux réguler les espaces linguistiques au sein de cette mondialisation qui parfois percute les identités, imaginons un Erasmus francophone, créons un passeport économique et culturel de la francophonie qui permette aux étudiants, aux chefs d'entreprise, aux diplomates, aux chercheurs, aux artistes, d'intégrer des parcours de mobilité.

Je sais bien que tel n'est pas l'objet précis de l'article 2 mais nous avons eu, et j'en remercie le rapporteur, ce débat passionnant, sans doute disproportionné par rapport à l'ensemble de l'édifice que nous présente la ministre aujourd'hui, mais qui a son importance et qui révèle beaucoup de la stratégie que nous devons mener en ce domaine.
Nous devrions dans les prochaines semaines, les prochains mois, engager une vraie réflexion stratégique sur cette question. Pour ma part, je m'y emploierai dans le cadre de la mission d'information sur la francophonie dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur.

La parole est à M. Daniel Fasquelle pour soutenir l'amendement n° 296 .

L'on nous dit que ce débat est inutile, que c'est une tempête dans un verre d'eau, mais je constate tout de même qu'aussi bien en commission qu'ici dans l'hémicycle, des amendements ont permis de faire progresser ce texte. Ce débat était donc utile, et l'on ne peut pas dire qu'il ne s'agisse pas d'un beau débat. Traiter de l'attractivité de notre université, de la place de notre langue dans l'université française, de la francophonie, ce n'est pas du temps perdu.
Je me félicite du ton juste que le rapporteur a adopté. Nous devons nous écouter les uns les autres mais je voudrais simplement pointer nos points de désaccord.
Le premier concerne la portée réelle de cette réforme. L'on nous dit qu'elle ne concernera que quelques étudiants étrangers et quelques programmes, en nous présentant d'ailleurs des exemples personnels de programmes mis en place pour attirer les étudiants étrangers en provenance de tel ou tel pays. Dans le même temps, l'on nous cite l'exemple des grandes écoles. M. Le Déaut ne comprend pas, ainsi, pourquoi l'on ne calquerait pas, en la matière, les universités sur le modèle des grandes écoles, sauf que 80 % des écoles de commerce ont basculé en tout ou partie dans l'anglais. Il en va de même des écoles d'ingénieurs. L'on ne peut pas prétendre d'un côté que la mesure sera limitée dans les universités et de l'autre vouloir imiter les grandes écoles qui ont généralisé l'usage de l'anglais. Le vrai sujet est là. Où sont les limites et jusqu'où irons-nous ?
L'on nous dit qu'il y aura des exceptions, mais je n'y crois pas un seul instant. Je le répète, non seulement les universités ont signé beaucoup de conventions internationales, mais de toute façon le programme Erasmus permet, quand un étudiant étranger arrive dans une université, de lui ouvrir tous les cours. En réalité, votre exception n'en est pas une et vous ouvrez tous les cours.
Si, avec le mot « partiellement », une précision utile a été apportée par Rudy Salles, ce mot, dans le cadre du programme Erasmus, se rapporte à l'ensemble des cours délivrés dans un département ou une faculté. Votre limite n'en est pas une, croyez-moi. Si en plus, calquant les grandes écoles, vous voulez former les étudiants français à l'anglais en enseignant en anglais, vous ouvrez une porte sur des risques d'excès et d'abus, tels que nous avons pu les connaître dans d'autres pays. Les grandes écoles ne sont pas le seul exemple : des universités françaises ont déjà engagé ce processus – à l'université de Strasbourg, dix masters sont ainsi en train de basculer dans l'anglais. Je pourrais aussi vous parler des pays du Nord, ou même de l'Allemagne qui revient sur cette dérive.
Notre autre point de désaccord porte sur la politique européenne. M. Mandon considère que la politique européenne est formidable, qu'Erasmus a permis le multilinguisme. Non, malheureusement. Que se passe-t-il aujourd'hui ? c'est vrai, l'on incite les étudiants à la mobilité mais ils vont dans d'autres pays où ils reçoivent des cours en anglais. Entre 2001 et 2003 – je n'ai pas de chiffre plus récent – sur les 400 000 étudiants qui ont bénéficié de ce programme, seuls 3000, dans le cadre des crédits européens, ont reçu un enseignement dans une autre langue que leur langue maternelle. C'est bien la preuve, et je rejoins en cela M. Pouria Amirshashi, que l'Europe, aujourd'hui, ne promeut plus les langues étrangères.
L'Europe de la mobilité étudiante est un formidable outil pour promouvoir le développement de l'anglais dans nos universités. C'est tout de même paradoxal ! La France doit se réveiller, s'ouvrir au monde.

Nous devons enseigner évidemment l'anglais dans nos universités, nous devons signer des conventions précises pour pouvoir accueillir des étudiants de pays non francophones, mais dans le même temps, nous devons militer en faveur de l'apprentissage d'autres langues que l'anglais pour développer le multilinguisme et le multiculturalisme. Là est le fond du dossier. Nous devons trouver la bonne voie et le bon équilibre et surtout ne pas envoyer de mauvais message.
Ce débat a eu lieu en partie mais nous ne sommes pas allés au bout. Un certain nombre de limites restent à poser plus clairement malgré les amendements des uns et des autres. C'est pourquoi je soutiens cet amendement de suppression en souhaitant que nous puissions débattre sereinement, sans insulte, sur le fond, de l'attractivité de nos universités et de la place du français dans nos universités. Ayons ce beau et grand débat, mettons cet article et nos passions de côté et travaillons tous ensemble. Nous pouvons trouver un accord parce que nous aimons tous l'université et la langue française. Prenons le temps de mener une vraie réflexion sur ce sujet qui le mérite.

Avis défavorable, mais je tiens à apporter certaines précisions.
Monsieur Myard, l'accord Blum-Byrnes a été signé dans un contexte particulier, à partir du traité de Versailles de 1919, quand la question des réparations de l'Allemagne aux pays qui ont gagné polluait tout l'entre-deux-guerres. En 1946, lorsque les négociations s'ouvrent entre les États-Unis et la France autour de la question du remboursement de notre dette, les États-Unis acceptent de l'annuler en échange de contreparties. Ils ne demandent pas à l'époque que les films soient diffusés en anglais. En 1939, juste avant la guerre, une loi avait interdit totalement le cinéma américain sur le territoire hexagonal.

D'ailleurs, quelques mois après, nos prédécesseurs créent le Centre national de la cinématographie avec une certaine efficacité. La défense de l'exception culturelle française est donc ancienne et je suis fier des accords Blum-Byrnes portés par Léon Blum.
S'agissant par ailleurs de la francophonie, je l'ai déjà dit, tout ne peut pas être dans la loi, il existe d'autres vecteurs. La francophonie est un véritable enjeu comme l'ont prouvé le Président de la République et le Premier ministre en plaçant une ministre déléguée à la francophonie, et comme en témoigne le travail des parlementaires, sachant que la ministre elle-même est souvent amenée à défendre les intérêts des grands établissements d'enseignement supérieur français à l'étranger. Chaque fois qu'elle se déplace avec le Président de la République, des conventions sont signées, et nous prenons nous-mêmes de nombreuses dispositions en faveur de la francophonie.
Le débat a eu lieu, il se poursuivra et nous amenderons encore. Je demande dans ces conditions à M. Amirshahi de retirer son amendement.
Enfin, monsieur Fasquelle, nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation de la loi : non seulement l'article 2 est de portée limitée, mais notre travail de législateur a permis de faire évoluer la situation.
Même avis que celui de la commission.

Compte tenu des propos de notre rapporteur et de la position de Jean-Yves le Déaut – qui, je n'en doute pas, sera suivi –, je retire l'amendement n° 31 ,…

…d'autant que les amendements suivants, qui font état de considérations d'ordre pédagogique de nature à sécuriser un peu plus ces dispositions, seront, je n'en doute pas, adoptés.

Je profite de mon intervention pour le dire, je souhaite que l'apprentissage des langues étrangères en France, notamment de l'anglais, puisse se faire en systématisant la version originale sous-titrée !
L'amendement n° 31 est retiré.

Je reviens sur l'amendement défendu par M. Fasquelle – qui, pour les radicaux, n'a pas la phobie de l'étudiant étranger.
Hier, j'ai salué Jacques Toubon devant le Palais Bourbon – nous avons quelque accointance puisqu'il est lyonnais. Je me disais en le voyant que, depuis 1994, le législateur n'avait rien fait. Il s'est appuyé sur cette loi qui interdisait tout cours et tout examen dispensé en langue étrangère, puis on a laissé faire.
Tout à l'heure, monsieur Fasquelle, vous interpelliez la ministre sur le thème : « Vous n'avez qu'à faire respecter la loi ! » De votre côté, qu'avez-vous fait pendant dix ans ? Avez-vous fait respecter la loi ?
Nos collègues, M. le rapporteur d'abord, puis Jean-Yves Le Déaut, ont parfaitement résumé la situation : l'évolution fait qu'aujourd'hui, dans les grandes écoles et à l'université, il faut s'adapter à la venue des étudiants étrangers et, surtout, ne pas créer d'inégalités entre ceux qui suivent la filière des grandes écoles et ceux qui choisissent l'université.
Grâce à l'article 2 qui parle bien d'« exceptions », nous réparons les erreurs dues au laisser-aller du législateur pendant des années. C'est pourquoi, monsieur Fasquelle, les radicaux s'opposeront à votre amendement.

Je souhaite bien faire comprendre au rapporteur que nous ne sommes pas dans un monde de Bisounours,…

…mais dans un monde où l'on avance en subissant un matraquage de stratégies d'influence. Aujourd'hui, les affrontements ne sont plus interétatiques – la dissuasion nucléaire calme le jeu – mais répondent à une stratégie d'influence transnationale. Ce sont les esprits qui sont en cause.
Lorsque vous servez la soupe de cette manière à une puissance économique bien supérieure à la nôtre, vous affaiblissez notre compétitivité stricto sensu. Il faut se défaire de l'idée qu'en ayant des cours entièrement en anglais – comme dans les grandes écoles, ce qui est parfaitement imbécile ! – on va accélérer la compétitivité française. Car pour pénétrer le marché chinois, ce n'est pas avec un sabir que vous allez y arriver, mais en apprenant le chinois, de même que c'est en arabe que vous pénétrerez le monde arabo-musulman, et en espagnol l'Amérique latine. Il y a un moment où il faut savoir dire « non ». Seul l'esclave dit « oui » et vous vous placez dans cette position.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Je faisais référence à Antigone, et si, au passage, vous vous êtes reconnu, monsieur Le Déaut, ce n'est pas de ma faute !
Sourires.

Laissez-moi vous donner des exemples de ce qui se passe dans les instances internationales.
Lorsque je négocie le bannissement des armes chimiques et que je fais alors des propositions en français, immédiatement le secrétariat se débrouille pour les traduire en anglais tandis que l'on me demande d'intervenir en anglais. Eh bien je dis « non ! » et nous revenons à la langue française.
Lorsque le juge grec est arrivé à la Cour de justice des Communautés européennes, il ne parlait pas français. Nos juges lui ont simplement demandé de s'y mettre. Et il s'y est mis ! Étrange, n'est-ce pas ? Voilà ce qui se passe quand on adopte une position ferme ! Lorsqu'on accueille des étudiants étrangers, faisons leur suivre une formation linguistique accélérée : ils s'y mettront. C'est aussi simple que cela.
Mais si, à chaque fois, vous baissez pavillon, vous perdez la bataille de la stratégie d'influence et vous vous mettez dans une position de faiblesse.
C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, je ne retire pas cet amendement. Je le maintiens !

Nous sommes un peu hors sujet, mais je tiens, madame la ministre, à revenir sur ce que vous avez dit en commission, à savoir que le français était en position de force. Malheureusement non ! Si le français était en position de force, nous n'en parlerions pas ce matin.
Je siège au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Je suis effondré de voir à quel point notre langue recule dans une institution dont le siège est à Strasbourg.

Nous avons même dû protester en recevant le gouverneur général de la Banque centrale européenne, car M. Trichet, alors qu'il est français, venait s'exprimer devant le Conseil de l'Europe en anglais,…

…alors que les deux langues officielles sont le français et l'anglais. De même, il est de plus en plus difficile de trouver des rapports en français, ce qui est aussi le cas aux Nations unies où le français est pourtant langue officielle. Dire que le français est en position de force, c'est être complètement à côté du sujet.
J'ajoute que, cette année est un peu particulière puisque la France accueille les Jeux mondiaux de la francophonie.

Il faut donner un signal fort pour montrer à quel point nous sommes attachés à la langue française.
Quand nous allons au Québec, nous sommes surpris de voir la mobilisation des Québécois pour défendre la langue française, eux qui se sentent cernés par l'anglais.

Or lorsqu'ils viennent en France, ils ont, eux, l'impression que nous avons déjà tout bradé ! C'est la raison pour laquelle je demande que nous réfléchissions bien à l'occasion de ce débat sur l'article 2 du projet de loi dont nous pouvons comprendre un certain nombre de fondements.

Bien sûr, nous sommes favorables à accueillir des étudiants étrangers, à leur donner les cours dans la langue qu'il faut. Mais nous sommes aussi attachés à ce que ces étudiants apprennent le français afin d'être ensuite des ambassadeurs du français et de la culture française.

Malheureusement, votre projet, madame la ministre, est faible dans ce domaine. Nous l'avons amendé, mais cela ne suffit pas. Il faut aller plus loin, mais nous ne sentons pas chez vous cette volonté.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.
L'amendement n° 536 est retiré.

Ainsi que je l'ai indiqué, je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 284 .
L'amendement n° 338 est retiré.

La parole est à M. Pouria Amirshahi, pour soutenir l'amendement n° 283 .

Je serai bref, car nous sommes plusieurs à vouloir nous exprimer sur la même problématique.
Il s'agit d'encadrer strictement l'introduction d'enseignements dispensés partiellement en anglais et en certaines langues étrangères dans le cadre d'accords internationaux – ce qui est déjà prévu par les dispositions Toubon.
L'idée est de préciser les conditions dans lesquelles une nouvelle dérogation au principe de l'enseignement en langue française est concevable et surtout de préciser le terme « nature » qui figure dans le texte initial en parlant d'« impératif pédagogique » afin de mettre en avant le lien manifeste existant entre le contenu de ce qui est enseigné et la langue dans laquelle cet enseignement est dispensé.

Peut-être pourriez-vous présenter en même temps l'amendement n° 284 qui est très proche, monsieur Amirshahi ?

Dans ce cas, je vais d'abord demander l'avis de la commission sur l'amendement n° 283 .

La parole est donc à M. Jean-Pierre Dufau, pour présenter cet amendement n° 284 .

À ce stade du débat, je voudrais remercier et féliciter le rapporteur pour son écoute et pour la synthèse qu'il a faite de nos débats en commission et dans l'hémicycle.
Le débat était nécessaire et il fait apparaître deux points de vue, parfois de façon excessive puisque c'est un domaine dans lequel le sentiment l'emporte quelquefois sur la raison. Rousseau disait : « Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit ».

Il faut donc y penser chaque fois que l'on balance entre ce qui est raisonnable et ce qui est sentimental.
À propos de l'attractivité qui est l'un des points essentiels de ce texte sur l'enseignement supérieur, il faut le dire simplement : l'abrogation de la circulaire Guéant est la meilleure réponse pour améliorer l'attractivité de l'enseignement supérieur, et je m'étonne parfois que ceux qui ont pu soutenir cette circulaire plaident aujourd'hui en faveur de l'attractivité de notre enseignement supérieur.

Qu'y a-t-il donc dans cette circulaire pour que tout le monde en parle ?

Par ailleurs – mais peut-être me suis-je trompé –, j'ai cru percevoir des contradictions dans l'argumentation de M. Feltesse. Tantôt l'anglais était extrêmement préjudiciable et il fallait s'en méfier, tantôt la situation actuelle était telle qu'elle était devenue irréversible. Je l'avoue, j'étais un peu perdu !
S'agissant de notre amendement, la volonté, qui nous est commune, est d'encadrer au maximum les conditions dans lesquelles les enseignements dans des langues étrangères pourront se faire pour les étudiants étrangers. Il ne s'agit pas de généraliser ce dispositif, mais d'en conserver le caractère exceptionnel : des exceptions peuvent être « admises pour certains enseignements lorsqu'elles sont justifiées par des nécessités pédagogiques et que ces enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord ». Autrement dit, cet amendement, qui est de précision, introduit une condition supplémentaire pour pouvoir dispenser un enseignement dans une langue étrangère.
Un autre débat portait sur la francophonie, laquelle mérite effectivement de faire l'objet d'un vrai débat.
Je dirai amicalement à notre collègue Rudy Salles que sa remarque sur le Conseil de l'Europe et tout à fait juste. Mais si le français n'est pas respecté en tant que langue officielle, ce n'est pas une question de droit, mais de coutume.
En revanche, il est nécessaire d'avoir une réflexion spécifique et approfondie sur la francophonie, de prendre des initiatives en la matière et d'avoir une autre attitude à l'égard des États francophones. Bref, il faut relancer le débat sur la francophonie, dans un esprit constructif et – monsieur Myard – offensif, de façon à rendre à nouveau la francophonie moderne et adaptée au monde dans lequel nous vivons.
Il faut dépasser nos apparentes contradictions pour dire oui au projet qui nous est présenté, par souci de réalisme et dans un cadre strictement défini. En revanche, nous prendrons tout le temps nécessaire pour relancer l'action en faveur de la francophonie, et nous serons sans doute un certain nombre à soutenir ces initiatives. Personnellement, je m'y engage et je ferai des propositions en ce sens.

Nous partageons avec notre collègue Dufau le souci de défendre la francophonie. La langue française n'est pas menacée en droit, dit-il. Soit. Le français est langue officielle des Nations unies, du Conseil de l'Europe, des Jeux Olympiques et de nombreuses organisations internationales. Cela remonte à loin, lorsque le français pouvait s'imposer comme langue officielle : si on devait réécrire aujourd'hui les statuts de tous ces organismes, nous aurions bien plus de mal à imposer le français comme langue officielle !
J'évoquerai un exemple qui m'a beaucoup frappé. J'ai participé à une commission du Conseil de l'Europe siégeant à Budapest. Nous avons auditionné une représentante de la Croix-Rouge qui, bien que portant un nom français, a fait un exposé d'une heure en anglais. Je l'ai interrompue pour lui dire : « Madame, quelque chose m'échappe : vous êtes française, vous parlez devant le Conseil de l'Europe dont le français est langue officielle et vous vous exprimez en anglais. Ou bien vous avez honte de votre langue, ou bien quelque chose ne va pas. » Et elle de me répondre : « Mais monsieur, j'ai appris de cette façon. J'ai appris à travailler en anglais, je ne travaille donc qu'en anglais. » Voilà le problème !

Si on habitue les jeunes étudiants à ne s'exprimer qu'en anglais, on encourage ce genre de situation qui m'a beaucoup frappé, peiné et révolté. C'est la raison pour laquelle j'affirme qu'il y a un grand danger.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Je ne veux pas faire durer le débat, car il nous faut maintenant parvenir à une solution. J'ai le regret de dire à mon collègue Dufau, avec lequel j'ai entretenu un dialogue amical et fructueux à ce sujet, que la notion de nécessité pédagogique ferme la porte à l'attractivité. Elle est valable pour les étudiants français apprenant les langues étrangères, mais pas pour attirer des étudiants étrangers car cela se fera sans nécessité pédagogique précisément mais pour d'excellentes raisons d'attractivité. Je crains donc, mon cher collègue, que votre amendement ne nous mette dans des difficultés supplémentaires. J'en ai quant à moi proposé un qui renvoie au pouvoir réglementaire, dont nous parlerons ensuite. Je crains beaucoup votre amendement, mon cher collègue.

On nous parle, dans les jeux d'influence qui se jouent, de compétitivité. Je puis vous dire, madame Bechtel, que si vous voulez accroître la compétitivité de la France, il faut commencer par réfléchir aux enjeux monétaires – vous le savez mieux que moi. C'est là qu'un problème de compétitivité se pose, davantage que dans l'attrait linguistique.

Tout le reste est du pipeau, je vous le dis comme je le pense !
Ce qui est certain, c'est que l'amendement relatif aux nécessités pédagogiques qui nous est présenté renvoie aux fameux « professeurs visiteurs », dont il est normal et même nécessaire qu'ils dispensent un cours de littérature anglaise en anglais, arabe en arabe, chinoise en chinois, etc. Cela n'a rien de choquant et c'est tout à la gloire de l'université française. Ce qui me choque en revanche, et qui est contre-productif pour la maison France en termes économiques, c'est cette espèce de maladie consistant à vouloir s'exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre et qui véhicule des concepts réducteurs qui ne sont pas les nôtres. On en vient véritablement à la trahison des clercs, bien connue et défendue par quelques littérateurs français.
À l'évidence, nous allons aujourd'hui à l'encontre de notre intérêt économique, politique, diplomatique et sociologique. Je vous mets en garde, comme je l'ai fait hier à la tribune, vous êtes en train de provoquer un retour de boomerang violent, car les querelles linguistiques sont les pires qui puissent être dans l'Europe que nous connaissons ! Vous êtes en train de nourrir un ressentiment qui dépasse les petits cénacles professoraux des grandes écoles qui n'y connaissent rien car ils sont enfermés dans leur autisme et ne regardent pas ce qui se passe dans le monde ! Je soutiens l'amendement !
Sourires.
L'amendement n° 283 n'est pas adopté.

La parole est à M. Pouria Amirshahi, pour soutenir l'amendement n° 282 .

C'est un amendement qui est simplement destiné à préciser les limites et les conditions de l'accord. Il est satisfait par la précédente intervention de M. le rapporteur, je le retire donc.
L'amendement n° 282 est retiré.

Nous venons d'avoir un débat passionné. L'article 2 comporte selon moi deux sujets importants qu'il ne faut pas superposer. Le premier vient d'être évoqué, c'est la question de l'attractivité de nos établissements français d'enseignement supérieur. Il en est un deuxième, lui aussi lié à une problématique linguistique, c'est celui de l'employabilité et de la formation de nos étudiants français.
L'Alsace, que je connais bien, compte aujourd'hui 60 000 personnes qui travaillent de l'autre côté du Rhin.

Non, pas en anglais, nos travailleurs frontaliers s'expriment bien sûr le plus souvent en allemand. Nous avons aujourd'hui l'occasion de pérenniser les échanges transfrontaliers, c'est pourquoi il est important qu'un certain nombre d'enseignements professionnels puissent être assurés non pas uniquement en langue française, mais aussi parfois en allemand. Les échanges montrent d'ailleurs que nos étudiants ont un déficit en la matière. Même s'il existe des cours en allemand de grande valeur, on se heurte aujourd'hui une limite de nature législative très simple : il est possible d'avoir un enseignement d'allemand économique mais il est impossible d'avoir un cours d'économie directement en allemand.
C'est pourquoi certains de mes collègues et moi-même présentons un amendement qui vise à favoriser l'insertion professionnelle et l'employabilité dans une optique d'ouverture linguistique et d'amélioration du niveau linguistique de nos étudiants destinés à un certain nombre d'univers professionnels.

Avis défavorable. Je considère que nous avons trouvé un point d'équilibre sur l'article 2.
Même avis.

Je ne peux que déplorer une telle issue. Nous avons certes trouvé un équilibre, très largement lié à des problématiques internes au groupe SRC, mais il en est un plus large qui n'a pas été trouvé. L'avis défavorable n'apporte pas en effet de réponse à la question que j'ai posée et qui est pourtant essentielle : nos débats n'abordent pas, au-delà de déclarations incantatoires, le sujet de l'insertion professionnelle. Dès que l'on arrive véritablement au coeur du sujet, que l'on fait des propositions pour améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle, nos amendements sont balayés. J'espère que par la suite les choses seront différentes.
L'amendement n° 126 n'est pas adopté.

Les deux amendements suivants, nos 15 et 16, ont été déposés par M. Cinieri. Peut-être pourriez-vous les défendre en même temps, mon cher collègue ?

Bien volontiers, madame la présidente.
L'article 2 prévoit de dispenser des cours en langues étrangères dans nos universités. Il n'est pas précisé quelles seraient ces langues, mais on se doute bien que l'anglais sera dominant. La rédaction de cet article est particulièrement floue, en particulier la deuxième phrase. Dire que les formations peuvent être assurées « partiellement » en langue étrangère me semble une formulation trop vague. C'est pourquoi je propose de remplacer « partiellement » par « exceptionnellement ».
Même avis.

La parole est à Mme Marie-Françoise Bechtel, pour soutenir l'amendement n° 525 .

Je propose de compléter l'alinéa 2 par une phrase relative aux étudiants français, beaucoup plus précise et restrictive que l'amendement présenté par M. Hetzel. En effet, les exceptions prévues par le texte ne précisent pas leur situation. Or il peut être intéressant d'ouvrir dans certaines limites un enseignement en langue étrangère aux étudiants français afin d'ajouter à la qualité de leur formation et de faciliter leur insertion professionnelle.
Ainsi, l'incitation à suivre ces enseignements ne devrait commencer selon moi qu'à compter de l'année de master 2, de manière à permettre aux étudiants d'anticiper sur la valorisation de leurs travaux de recherche pour ceux qui suivent des masters de recherche et d'améliorer l'offre et la qualité de leur stage professionnel pour ceux qui suivent des masters professionnels.
La précision sur ces points ne me semble pas aller de soi dans le texte du Gouvernement, c'est pourquoi il me semble intéressant de présenter un tel amendement.

Nous avons émis un avis défavorable. D'une part, nous pensons que l'article 2 répond à cette préoccupation ; d'autre part nous suivons une logique de maintien de l'autonomie des établissements et un tel degré de subtilité ne doit pas figurer dans la loi.
L'amendement n° 525 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

La parole est à Mme Marie-Françoise Bechtel, pour soutenir l'amendement n° 528 .
L'amendement n° 528 est retiré.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, si les amendements précédents ont permis une avancée importante, je vous demande de m'accorder quelques minutes pour vous présenter cet amendement qui est soutenu par cinquante députés de la majorité.
Nous disons oui à des cours dispensés en anglais ou dans une autre langue étrangère afin que notre pays reste à la pointe des savoirs et de la recherche, et oui à l'ouverture de tels cours à tous les étudiants, mais l'apprentissage de la langue doit se faire bien en amont, dès l'école, comme le prévoit la loi Peillon. Telle est la condition de la mise en place de cette vraie mesure sociale. Nous disons également oui à l'accueil du plus grand nombre d'étudiants étrangers auxquels on saura proposer autre chose que McDo et Disneyland : qualité d'hébergement, découverte de notre culture et maîtrise de notre langue.
En revanche, nous disons non aux velléités de transformer la langue française en langue morte. Elle reste le ciment de notre société, la raison de l'exception culturelle et le ferment de la francophonie. Nous disons également non à l'uniformisation des cerveaux et à la soumission d'une culture à une autre, celle des États-Unis aujourd'hui, de la Chine, du Brésil ou d'Amérique du sud demain.
Nous proposons donc d'insérer trois précisions dont certaines viennent d'être entérinées. Le décret en Conseil d'État fixant les modalités de l'enseignement en langue étrangère manque toujours. Nous souhaitons la formulation d'un objectif de promotion de notre langue à l'étranger et du rappel que le français doit être la langue de l'enseignement, des concours et des examens.
Ainsi, notre amendement affirme que notre langue doit être encore plus vivante et attractive et qu'elle est notre fierté au même titre que notre pays et ses valeurs. Comme l'a écrit La Fontaine, « Gardez-vous […] de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents : un trésor est caché dedans ».

Avis défavorable compte tenu des amendements précédents et je demande à Sophie Dessus de bien vouloir retirer son amendement.
Je me permettrai juste de répondre à M. Myard. Si l'amour de la langue va de pair avec celui de l'histoire et de la littérature françaises, faire allusion à La trahison des clercs, titre d'un ouvrage de Benda, dreyfusard connu, publié à la fin des années 1920 dans un contexte particulier, pour illustrer un propos sur l'influence française, voilà quelque chose qu'on ne peut pas se permettre.

Nous n'en sommes pas là ! Il s'agit d'éviter que la langue française soit foulée aux pieds !
Même avis, en réaffirmant l'attachement du Gouvernement à défendre la francophonie. J'en profite pour dire que celle-ci est aussi un combat au sein des instances européennes.
Je rappelle que mes collègues et moi-même avons réussi à convaincre nos homologues européens que le programme Erasmus devait conserver son nom, et non pas devenir Yes Europe, comme le souhaitait l'allemande Doris pack – même David Willetts, le ministre anglais de la recherche, a dit « no » à Yes Europe, ce dont nous nous réjouissons. Ce combat que nous avons mené, chacun d'entre nous doit s'en sentir porteur.

Compte tenu des explications de Mme la ministre, je retire mon amendement, madame la présidente.
L'amendement n° 265 est retiré.

Je veux répondre à notre rapporteur – qui ne peut être que compétent, puisqu'il est rapporteur. Lorsque j'ai cité La Trahison des clercs, tout à l'heure, c'est à dessein que je n'ai pas cité le nom de l'auteur. Ce qui m'importe, c'est l'expression – la trahison des clercs –, qui correspond parfaitement à la situation en matière de défense de notre langue, à tous les niveaux de l'État.
Ainsi, vous avez des fonctionnaires qui se sentent obligés de répondre en anglais aux télégrammes qu'ils ont reçus rédigés dans cette langue, sans même demander une copie en français, alors que notre langue est une langue de travail. Vous avez un patron du MEDEF qui s'exprime en anglais, provoquant l'ire du Président de la République de l'époque. Vous avez un président de la BCE qui ne s'exprime qu'en anglais alors que, je le répète, le français est une langue de travail. Toutes ces situations constituent autant de trahisons des clercs qui, plutôt que de défendre notre langue, lui causent un tort considérable.
Je demande à nos ingénieurs, qui sont des scientifiques et des gens rationnels, d'utiliser leur langue, notre langue, qui n'est pas une langue morte. Il faut absolument que l'on continue à faire progresser les concepts scientifiques – en mathématiques et en physique notamment – en français. Il ne s'agit pas d'exclure les autres, mais d'exister par nous-mêmes, et c'est une solution d'avenir !

Alors que nous débattons de la langue française et de la francophonie dans le cadre de l'article 2, on peut légitimement s'interroger sur l'absence de la ministre chargée de ces questions.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Notre groupe s'interroge : faut-il y voir un exemple de la trahison des clercs dénoncée par Jacques Myard ?
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

L'amendement de Mme Dessus est repris, madame la présidente. Je ne vois pas comment on pourrait s'opposer à l'objectif poursuivi par cet amendement, qui est de promouvoir la langue française à l'étranger tout en répondant à l'impératif de prévalence du français sur les autres langues dans les enseignements et examens ayant lieu en France.

Mme Dessus a vu juste, et je tiens à la féliciter pour son amendement, d'ailleurs cosigné par un très grand nombre de socialistes, qui selon toute évidence, vont maintenant trahir leur engagement en ne votant pas un amendement qu'ils avaient pourtant signé. Je suis curieux de voir si quelques-uns, au moins, auront le courage de lever la main pour voter leur propre amendement !

Cela fait maintenant deux heures que nous débattons de l'article 2, alors que la plupart d'entre nous souhaiteraient passer à la suite du projet de loi. Certes, ce dont il est ici question est important, mais je veux tout de même dénoncer l'hypocrisie ambiante.

Comme nous le savons tous, les cours en anglais existent déjà, et les doctorants étrangers en France ont déjà la possibilité de rédiger leur thèse en anglais.

Bien sûr ! Alors, il faut laisser faire ! C'est la politique au fil de l'eau !

En réalité, il ne s'agit que de mettre en conformité avec la loi ce qui se pratique déjà.
Le rapporteur a évoqué son expérience des études à l'étranger, qui donne un exemple de l'ouverture vers laquelle nous tendons.

…et je peux vous dire qu'il est heureux que j'aie eu la possibilité de suivre d'abord des cours en anglais, avant d'être capable, trois ans plus tard, de suivre les cours directement en suédois. C'est ce que nous souhaitons pour tous les étudiants étrangers en France, qu'ils soient brésiliens, américains ou de toute autre nationalité : qu'ils puissent terminer leurs études dans leur langue d'origine avant de se mettre progressivement à la nôtre – ils seront ensuite nos meilleurs ambassadeurs.

Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un problème de moyens. On a évoqué les conférences et tables rondes où chacun s'exprime en anglais. La raison en est bien simple : c'est que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une traduction simultanée – et, la plupart du temps, les universités et les laboratoires préfèrent mettre ailleurs l'argent dont ils disposent, comme on nous l'a dit lors des auditions. Pour pallier le manque de moyens, on est bien forcé de recourir au système D, en l'occurrence le fait que tout le monde s'exprime dans une même langue, l'anglais, ce qui est bien pratique. Si nous souhaitons tous protéger la langue française…

…nous souhaitons également avoir une ouverture sur le monde, disposer de la liberté de publier et de travailler dans le monde entier. C'est ce que nous permet aujourd'hui la langue anglaise, comme toutes les langues étrangères. Ce n'est pas parce qu'on va apprendre une ou deux langues supplémentaires que l'on va supprimer le français : en réalité, c'est un ajout permanent.

Si vous parlez trois ou quatre langues, voire plus, monsieur Myard, tant mieux pour vous, mais justement : essayons de faire en sorte que cela soit possible pour tout le monde ! S'ouvrir à l'anglais, c'est bien le minimum que l'on puisse faire en 2013 !
Applaudissements sur quelques bancs du groupe SRC.

Les choses sont claires, madame la présidente : Mme Dessus, auteure de cet amendement, l'a retiré.

Il est repris, effectivement. Aussi, je rappelle à Rudy Salles ce que nous avons expliqué tout à l'heure, à savoir que la promotion de la francophonie, un objectif que nous partageons tous, fera l'objet d'un débat spécifique, lors duquel, je l'espère, nous aurons l'occasion de nous retrouver.
Pour ce qui est de la reprise de l'amendement n° 265 , nous voterons contre.
Rires et exclamations sur les bancs du groupe UMP.
L'amendement n° 265 n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.

La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l'amendement n° 136 rectifié , portant article additionnel après l'article 2.

L'amendement n° 136 rectifié porte sur les droits d'inscription en France des étudiants étrangers. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, lorsque nous avons étudié le budget 2013 relatif à l'enseignement supérieur et la recherche, qu'une fois le compte d'affectation spéciale « Pensions » neutralisé, ce budget était en recul par rapport au budget 2012. De toute évidence, la question du financement de notre enseignement supérieur, une question importante, se pose.
Les finances publiques étant ce qu'elles sont, la plupart des pays de l'OCDE actuellement attractifs en matière d'enseignement supérieur sont des pays pratiquant des droits d'inscription élevés, notamment en ce qui concerne les étudiants non-ressortissants de l'Union européenne. Si l'on veut concilier les besoins financiers de nos établissements d'enseignement supérieur avec le développement de leur attractivité, il est plus que jamais nécessaire de se demander si le contribuable français doit systématiquement financer l'inscription des étudiants étrangers. Pour nous, il est clair que non : les étudiants venant de pays étrangers doivent assurer eux-mêmes le financement de leurs études.
Notre amendement n° 136 rectifié a pour objet de permettre aux établissements d'enseignement supérieur de décider librement, par délibération de leur conseil d'administration, de la mise en place de droits d'inscription d'un montant plus élevé pour les étudiants étrangers, hors Union européenne. Je précise qu'afin de maintenir notre stratégie nationale spécifique de coopération avec certains pays, il suffira de mettre en place un système de bourse pour compenser ces frais. Grâce à cet amendement, nos établissements d'enseignement supérieur disposeront de moyens plus importants pour développer leur activité et donc pour améliorer encore leur attractivité, leurs performances et leur excellence.

Nous avons déjà eu ce débat en commission, et Mme la ministre aura l'occasion de repréciser, dans quelques instants, les chiffres relatifs aux droits d'inscription.
Je veux revenir sur les propos récurrents de Patrick Hetzel qui laissent penser qu'avant, tout allait bien, et que maintenant, tout va être catastrophique – ainsi, il a commencé son intervention en affirmant que le budget de l'enseignement supérieur était en baisse. J'avoue ne pas voir où sont les éléments objectifs de la réussite de l'enseignement supérieur et de la recherche ces dernières années. Le taux de réussite en licence a-t-il augmenté ? Non, il a baissé. La situation financière des universités est-elle satisfaisante ? Non, 25 % d'entre elles sont en déficit. Nos établissements occupent-ils une meilleure place dans le classement de Shangaï – indépendamment de la valeur que l'on accorde à ce classement ? Je ne crois pas. La loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités a-t-elle été adoptée dans de bonnes conditions ? On peut se le demander quand on sait que Mme Pecresse a été nommée le 15 mai 2007, et la loi présentée le 4 juillet, à l'issue de cinq semaines de débat – ce qui paraît trop court. Pour autant, nous ne considérons pas que cette loi soit foncièrement mauvaise, puisque nous ne la remettons pas totalement en cause.
J'aimerais que, comme nous l'avons fait au sujet de l'article 2, nous arrivions à dépassionner le débat pour revenir sur des éléments objectifs. J'ai quelques inquiétudes quant au financement pérenne de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme j'aurai l'occasion de le redire plus tard. Cependant, je ne pense pas que l'augmentation des droits d'inscription des étudiants étrangers, déjà possible par dérogation, puisse constituer un véritable levier. Pour ma part, le débat ne saurait se limiter à cette seule question, et doit s'élargir. Je confirme donc l'avis défavorable de la commission.
En 2011, Laurent Wauquiez disait : « La proposition de Terra Nova d'augmenter les droits d'inscription est scandaleuse. »
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.
Je peux comprendre que tout le monde ne soit pas du même avis sur cette question, et même que les opinions puissent évoluer : aucun débat n'est tabou.
Cependant, il n'est pas inutile de regarder un peu les chiffres. Il y a actuellement 290 000 étudiants étrangers accueillis en France, dont il faut déduire les 50 000 qui vivent avec leur famille en France, ainsi que les étudiants européens et ceux accueillis dans le cadre d'accords bilatéraux, qui ne peuvent se voir appliquer une majoration des droits d'inscription. Au bout du compte, les étudiants pouvant faire l'objet de droits d'inscription majorés constituent une quantité marginale. Le sujet n'est pas tabou, je le répète, et nous en discuterons dans quelques semaines, dans le cadre du débat sur l'attractivité de notre pays, mais encore faut-il savoir l'aborder de façon, tout à fait objective.
Enfin, une circulaire de 2002 autorise déjà les universités qui le souhaitent à proposer des droits d'inscription plus élevés pour la faible quantité d'étudiants pouvant être concernés. Certains établissements le font déjà, en vertu du principe d'autonomie dont ils peuvent se prévaloir, à condition de pouvoir justifier de prestations clairement identifiées.
L'apprentissage du français en tant que langue étrangère, ou la formation linguistique accélérée, peuvent ainsi justifier de l'application de droits plus élevés. Les conseils d'administration de certaines universités ont donc pris cette décision, comme ils en avaient le droit. Ne faisons pas de cette question un débat tabou ou idéologique, a fortiori quand le champ d'application de la disposition proposée est, dans les faits, assez restreint.

Il me semble, madame la ministre – mais je peux me tromper – que Terra Nova est une organisation dont la sensibilité est plus proche de la gauche que de la droite.

J'éprouve donc quelques difficultés à suivre votre argumentaire ainsi que la citation que vous avez faite.
Par ailleurs, l'attractivité de nos universités réside aussi – même si on peut le regretter – dans le coût des études. Pour de nombreux étudiants étrangers, à tort ou à raison – je ne juge pas – une université qui ne coûte rien n'est pas une bonne université. C'est une réalité.
Enfin, monsieur le rapporteur, madame la ministre, je suis surpris par notre débat. En effet, nous avons décidé en commission, sur la proposition du rapporteur, la fin de la gratuité des classes préparatoires aux grandes écoles. Dorénavant, dans les lycées publics français, suivant la proposition du parti socialiste, il n'y aura plus de gratuité pour les classes préparatoires aux grandes écoles – et cela concerne, bien évidemment, les Français.
En revanche, pour les étudiants étrangers, on n'augmente pas les frais universitaires. La cohérence de ce raisonnement m'échappe : alors que le parti socialiste propose la fin de la gratuité pour les classes préparatoires, rien n'est fait s'agissant des étudiants étrangers.

J'avoue être particulièrement surpris par l'incohérence des propositions du parti socialiste.

Je suis également surpris par les arguments qui ont été avancés. Comme vous l'avez dit à la fin de votre intervention, madame la ministre, le droit permet à l'heure actuelle d'exiger la perception de droits d'inscription spécifiques à condition qu'ils soient associés à des services supplémentaires. C'est extrêmement restrictif, et cela explique qu'un certain nombre d'universités peinent à augmenter les droits d'inscription des étudiants étrangers. C'est un vrai sujet.
Par ailleurs, vous le reconnaissez vous-même, madame la ministre, un certain nombre d'universités se trouvent en difficulté. C'est une simple constatation qui s'offre à nos yeux. Or une occasion se présente d'obtenir des financements supplémentaires. Certes, je suis le premier à reconnaître qu'une telle mesure ne résoudra évidemment pas tout, mais il s'agit néanmoins d'une occasion de faire évoluer le système. Je partage la remarque fort judicieuse qui vient d'être faite par Benoist Apparu à propos des étudiants étrangers.
Les chiffres que vous avez cités, madame la ministre, sont évidemment pertinents hic et nunc, aujourd'hui, à l'instant T. Or vous nous avez vous-même indiqué que, par l'article 2 de ce texte, vous souhaitiez développer l'attractivité de nos universités. Que n'augmentez-vous, alors, le nombre d'étudiants étrangers, en particulier ceux venant de sphères culturelles qui ne s'intéressent pas à la France ?
Un potentiel d'évolution existe bien, il faut le dire très clairement, permettant d'accroître significativement notre attractivité : c'est une très bonne chose, tant il est important d'accroître notre attractivité dans le contexte de la mondialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Toutefois, est-il normal que, pour accroître cette attractivité, ce soit le contribuable français qui paie, alors que cela permettra sans doute d'attirer des étudiants d'origine extrêmement aisée, venant par exemple d'Asie du Sud-Est ? Est-il bien normal, je le répète, que le contribuable français finance les études du riche étudiant chinois ? C'est une vraie question, à laquelle, pour le moment, vous répondez : « Circulez, il n'y a rien à voir ».
On voit bien que vous ne voulez pas ouvrir les vrais débats ni aborder les vrais sujets. Votre projet de loi n'est pas un texte de programmation : nous n'évoquons pas les moyens. Nous souhaiterions le faire mais vous fermez la porte. Cela montre bien que vous ne voulez pas assumer un certain nombre de choses : c'est politiquement très clair.

Afin de préciser la cohérence de ma position, je rappelle que ce projet de loi relatif à la réussite étudiante et à l'organisation universitaire comporte certains points de convergence, que nous sommes d'ailleurs nombreux à approuver, entre universités et grandes écoles. Par conséquent, nous saisissons toutes les occasions de montrer l'existence de ce type de passerelles.
La question des droits d'inscription en classe préparatoire est symbolique, car les montants en jeu sont très faibles, mais, encore une fois, le symbole est très important.
Sur les aspects budgétaires, notre position est constante. Si ce n'est pas le moment idoine pour les évoquer, le débat ne peut pas être clos pour autant : tel est l'objet de l'amendement relatif au Livre blanc.
L'amendement n° 136 rectifié n'est pas adopté.
L'article 2 bis est adopté.

Mes chers collègues, M. Daniel Fasquelle a demandé la parole sur le fondement de l'article 58, alinéa 4, du règlement pour un fait personnel.
Vous avez la parole, mon cher collègue.

Monsieur Mandon a tenu ce matin des propos insultants, blessants, laissant entendre que j'avais la phobie des étudiants étrangers. Il est vraiment mal tombé : en effet, j'ai soutenu une thèse de droit comparé, j'ai mis en place plusieurs programmes internationaux et j'ai toujours été très attentif aux étudiants étrangers présents dans la faculté de droit que j'ai dirigée pendant dix ans. Certains d'entre eux, d'ailleurs, me doivent d'avoir pu soutenir une thèse et obtenir un doctorat.
La remarque de M. Mandon m'a profondément blessé, car, si je défends l'université et la langue française, il convient de ne pas caricaturer ma position, qui est beaucoup plus nuancée que ce qu'elle pouvait peut-être paraître aux prémices du débat.
En tout état de cause, je demande à M. Mandon de retirer ce propos qui est complètement décalé par rapport à l'ensemble de ma vie professionnelle et à mon engagement politique, et qui ne reflète absolument pas le sens de mon intervention en faveur de l'enseignement du français dans les universités et contre la généralisation des enseignements en l'anglais dans nos universités.

Je n'ai pas eu le temps, madame la présidente, de vérifier dans le compte rendu les propos exacts que j'ai tenus. Je ne crois pas avoir jamais cité M. Fasquelle et l'avoir mis en cause personnellement
(« Si ! » sur les bancs du groupe UMP.)
On vérifiera et, si tel était le cas, je corrigerai. Telle n'était pas, en tout cas, mon intention car je sais le travail qui est fait à Boulogne-sur-Mer.
Je n'ai évoqué que la crainte, existant chez certains, envers les étudiants étrangers : je ne voudrais pas que notre débat permette de donner à nouveau asile à cette crainte. Voilà le sens que je voulais donner à mon intervention, et sur lequel je ne reviens pas.
Si M. Fasquelle a été mis en cause de mon fait, quoique involontairement, je m'en excuse. S'il ne l'a pas été et qu'il l'a pris pour lui-même, telle n'était pas mon intention. En revanche, ceux qui craignent les étudiants étrangers rendent le pire des services à l'université française.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe UMP.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Suite du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures cinquante-cinq.
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Nicolas Véron