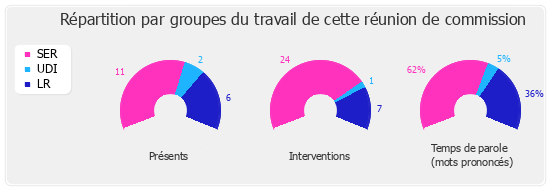Commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier
Réunion du 1er juin 2016 à 18h15
La réunion
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice.

Monsieur le garde des Sceaux, nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête. Nous achevons nos auditions par celles des membres du Gouvernement ; vous succéderont ainsi M. Le Drian, ministre de la défense, et, demain matin, M. Cazeneuve, ministre de l'intérieur.
Nous vous interrogerons bien entendu sur l'état du droit applicable et sur ce qu'il convient d'attendre des réformes intervenues récemment avec la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et celle, en instance de promulgation, relative au renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Nous sommes également désireux de vous entendre sur la coopération entre la justice et les services de renseignement, ainsi que sur le volet pénitentiaire, c'est-à-dire le suivi des personnes radicalisées au sein des établissements pénitentiaires, le rôle du renseignement pénitentiaire et les moyens techniques mis en oeuvre dans ces établissements : vidéosurveillance, brouillage des télécommunications…
Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle fait donc l'objet d'une retransmission en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale ; son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois sur le portail vidéo de l'Assemblée. Je vous signale par ailleurs que la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition. Nous avons en effet décidé que, d'une manière générale et lorsque cela ne soulève pas de difficultés pour les personnes entendues ou au regard de la confidentialité des informations recueillies, nos auditions seraient ouvertes à la presse, car nous devons mener cette enquête en toute transparence.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la justice, prête serment.)

Monsieur le ministre, vous avez pris vos fonctions le 27 janvier 2016, à la suite de la démission de votre prédécesseur. Vous n'étiez donc pas en fonction lors des attentats sur lesquels se penche notre commission. Cependant, tous les députés ici présents vous connaissent bien, puisque vous présidiez alors – et ce, depuis le début de la législature – la commission des lois de l'Assemblée nationale. Tous savent combien vous vous êtes personnellement engagé dans la discussion de chacun des textes de loi ayant renforcé la lutte contre le terrorisme. Tous connaissent également votre grande expertise en matière de renseignement, puisque vous êtes l'auteur, avec notre collègue Patrice Verchère, d'un rapport remarquable sur le sujet. J'ajoute que vous avez été, en tant que député, membre de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), qui a donné naissance à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), dont nous avons entendu le président, M. Delon. C'est dire combien vous êtes familier des préoccupations de notre commission d'enquête.
Mais vous êtes aujourd'hui responsable d'une politique pénale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Or, comme le Président de la République et le Premier ministre en ont eux-mêmes fait le constat, la frontière entre la criminalité de droit commun et le terrorisme est poreuse : la quasi-totalité des auteurs des attentats de 2015 avaient eu un parcours de délinquant.
Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui d'Amedy Coulibaly, l'auteur de l'assassinat d'une jeune policière et de l'attaque de l'Hyper Cacher. En 2001, le tribunal d'Évry l'avait condamné à trois ans d'emprisonnement puis, la même année, à quatre ans pour des vols aggravés, et il l'avait à nouveau condamné en 2002. En 2004, la cour d'assises des mineurs du Loiret lui avait infligé six ans de prison pour vol avec arme dans un établissement bancaire. Ensuite, le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné, en 2005, à trois ans pour vol aggravé et, en 2007, à dix-huit mois pour trafic de stupéfiants. Enfin, le 20 décembre 2013, il avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement, mais, par le jeu des réductions de peine automatiques, il s'est retrouvé en liberté sans avoir effectué toute sa peine. Quelle politique pénale entendez-vous mener à l'égard de ces récidivistes ? Certains dispositifs ont été renforcés par la dernière loi que nous avons adoptée, mais nous souhaiterions vous entendre sur la question des réductions de peine, qui est une des préoccupations exprimées par le parquet de Paris : doivent-elles s'appliquer de la même manière aux récidivistes et aux primodélinquants ?
Nous avons entendu l'ensemble des acteurs judiciaires : le procureur de Paris, les juges du tribunal correctionnel, ceux de la cour d'appel et de la cour d'assises spécialisée, ceux du pôle d'instruction antiterroriste, les juges d'application des peines et les responsables de l'administration pénitentiaire. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que la question des moyens de la justice est revenue de manière récurrente au cours de ces auditions. Puisque vous avez fait vous-même de cette question une priorité de votre action, peut-être pourrions-nous commencer par aborder ce sujet.
Je précise que nous avons prévu de vous interroger sur d'autres thèmes, notamment les moyens juridiques de la lutte contre le terrorisme, les personnes détenues radicalisées et le renseignement pénitentiaire. Mais peut-être pourriez-vous nous indiquer au préalable le nombre des personnes qui ont été condamnées ou qui se trouvent en détention provisoire pour fait de terrorisme et les moyens qui sont mis en oeuvre dans le cadre de leur détention par l'administration pénitentiaire.
Je vous remercie de votre invitation, à laquelle je réponds avec plaisir. Convaincu – et cela ne surprendra personne – que le Gouvernement doit être à la disposition du Parlement, je me dois d'être disponible et de vous répondre de manière précise et utile afin de contribuer à la réflexion de votre commission d'enquête. Celle-ci émettra certainement des préconisations auxquelles le Gouvernement sera d'autant plus attentif que ses travaux bénéficient, monsieur le président, monsieur le rapporteur, de votre expertise reconnue en la matière. Si, lorsque je la présidais, la commission des lois a pu travailler utilement, c'est précisément parce que nous avons su faire fi de nos divergences apparentes pour nous rassembler sur l'essentiel, et les sujets dont nous traitons aujourd'hui sont absolument essentiels.
Je veux tout d'abord saisir l'occasion que m'offre votre invitation pour remettre en perspective le modèle français de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, que l'on présente trop souvent comme une accumulation de textes qui seraient autant de réactions du pouvoir en place aux événements qui surviennent. Comme si nous n'avions pas construit une architecture cohérente et réfléchie pour, sinon éradiquer, du moins combattre ces phénomènes ! Or, il existe un modèle français dans ce domaine, modèle qui confie à l'autorité judiciaire un rôle très étendu, qui va de la prévention à la répression. Bien entendu, je vais répondre à vos questions, que je crois essentielles, sur ce que Gilles Kepel a appelé avec beaucoup de pertinence « l'incubateur carcéral », mais peut-être dois-je évoquer au préalable ce modèle français de lutte contre le terrorisme.
Jusqu'au début des années 1980, la France ne s'était pas dotée d'un dispositif spécifique en ce domaine. Certes, nombre d'infractions, notamment les attentats à l'explosif, relevaient de la compétence de la Cour de sûreté de l'État. Mais, en défendant sa suppression devant l'Assemblée nationale, le 17 juillet 1981, Robert Badinter avait souligné les difficultés que soulevait l'existence d'une telle juridiction – et si je l'évoque, c'est pour souligner que nous avons évité, depuis, de tomber dans les mêmes travers. En effet, dérogatoire au droit commun, la Cour de sûreté de l'État « [traduisait] une intrusion intolérable du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire » et constituait « une justice politique permanente d'exception » dans laquelle « les officiers jugent aux côtés de magistrats des accusés civils en temps de paix ».
La suppression de la Cour de sûreté de l'État n'a pas créé de vide juridique, puisque 75 % des procédures dont elle connaissait ont été transférées aux cours d'assises. Cependant, comme le reconnaît Robert Badinter dans ses mémoires, intitulés Les Épines et les roses, elle a révélé une carence du code pénal en matière d'enquête et de répression des actes de terrorisme. C'est pourquoi, à partir de 1981, en raison du renforcement de la menace, le Gouvernement a entrepris d'adapter l'arsenal répressif aux nécessités de la lutte contre le terrorisme.
Ainsi, à la suite de menaces proférées contre les jurés lors du procès des complices de Carlos, la loi du 21 juillet 1982 a créé les cours d'assises spéciales. Puis, la loi du 9 septembre 1986, inspirée par les juges Boulouque et Marsaud, marque un premier tournant en créant ce qui reste aujourd'hui l'incrimination pivot de la lutte antiterroriste, à savoir l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT), en prévoyant – et je dois souligner la pertinence de ce choix – la centralisation des poursuites à Paris et en créant des règles de procédure dérogatoires au droit commun, qu'il s'agisse des gardes à vue ou des méthodes d'enquête. Plus que le droit pénal lui-même, c'est en effet la procédure pénale qui, dans ce domaine, déroge au droit commun.
L'évolution se poursuit avec l'adoption, en 1994, du nouveau code pénal, qui entrera en vigueur deux ans plus tard. Celui-ci construit un dispositif autour de l'AMT, avec des règles spéciales de poursuite, d'instruction et de jugement applicables à la répression non seulement du terrorisme, mais aussi du trafic de stupéfiants et du proxénétisme. L'incrimination d'AMT permet, grâce à sa souplesse, de prévenir la survenance d'un attentat en aidant à appréhender, en amont, l'entente établie en vue de sa préparation.
Depuis lors, les textes se sont multipliés pour renforcer cet arsenal : lois du 15 novembre 2001, du 29 août 2002, du 9 mars 2004, du 21 juin 2004, du 23 janvier 2006, du 1er décembre 2008, du 14 mars 2011, du 14 avril 2011. Ces textes ont procédé à des ajustements de la loi fondatrice, sans modifier les équilibres fondamentaux. De fait, à l'exception de la loi du 13 novembre 2014, qui a créé le délit d'entreprise individuelle terroriste, les textes que je viens de citer ont précisé les règles de procédure pénale applicables à la poursuite et à la répression de ces infractions – qu'il s'agisse des techniques d'enquête, de l'instruction ou du jugement des infractions en matière de terrorisme –, avec le souci constant de moderniser et d'adapter l'arsenal répressif à l'évolution de la menace. Qui pourrait le déplorer ? Si nous n'avions pas modifié la loi de 1986, les services de police judiciaire et les magistrats instructeurs seraient aujourd'hui fort démunis.
Je ne crois donc pas que cette succession de textes législatifs soit un empilement incohérent. Ils s'inscrivent, au contraire, dans une logique qui a été définie il y a plusieurs années, si bien que, après une période de maturation bien compréhensible, l'architecture globale du système n'a guère évolué.
Outre cet appareil juridique, il faut souligner la pertinence de la centralisation des poursuites au parquet de Paris et de la spécialisation fonctionnelle parisienne. J'insiste sur ce point, car j'ai pu lire, ici ou là, que la tentation existait de créer un parquet national antiterroriste sur le modèle du parquet financier. C'est la plus mauvaise des idées ! L'organisation actuelle du parquet de Paris est en effet extrêmement pertinente parce qu'elle permet une spécialisation des magistrats et, grâce à la continuité de la structure, si ce n'est celle des hommes qui y servent, une bonne connaissance de la menace. Surtout, cette organisation a permis que, le soir du 13 novembre, les magistrats du parquet de Paris spécialisés dans l'antiterrorisme ne soient pas les seuls magistrats mobilisés. Ainsi, la procureure générale de Poitiers me confiait, vendredi dernier, lors d'un déplacement dans cette ville, que, ce soir-là, tous les parquetiers s'étaient déclarés disponibles. De même, le procureur de Paris a dit avoir pu compter sur la totalité des parquetiers à sa disposition.
Un parquet national antiterroriste ou une audience nationale s'inspirant du modèle espagnol nous priverait de cette capacité d'adaptation et de mobilisation des personnels en cas de crise, car le Gouvernement, quel qu'il soit, ne pourrait créer des postes pour les besoins de l'enquête. Parce que la menace est durable et que la gestion des ressources humaines est nécessairement tendue, notre modèle est bon.
Parallèlement, le dispositif de sécurité, comme les services de renseignement, de police judiciaire et les forces de sécurité intérieure, a été structuré afin de renforcer sa cohérence et son efficacité. La spécificité de la Direction de la surveillance du territoire (DST), à savoir sa double compétence administrative et judiciaire, a été confirmée lors de la création de la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), qui lui a succédé, puis de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), qui est le service pilote dans la lutte contre le terrorisme. Cette spécificité, qui se retrouve dans peu de services avec lesquels la DGSI est amenée à travailler, a largement démontré son efficacité.
Le système n'est évidemment pas parfait, mais il serait inopportun d'envisager de remettre en cause ce dispositif de prévention et de répression du terrorisme qui est solidement établi.
J'en viens maintenant à question de la radicalisation. Celle-ci est évidemment consubstantielle au terrorisme, mais on ne lutte pas de la même façon contre l'une et contre l'autre. La problématique de la lutte contre la radicalisation est en effet apparue plus récemment, de manière brutale et pour longtemps. Or, si cette lutte mobilise des moyens toujours plus importants, elle est encore relativement nouvelle pour le ministère de la justice et ses fonctionnaires.
Je vous signale à ce propos que le premier Plan de lutte antiterroriste (PLAT 1) s'est traduit, pour le ministère de la justice, par la création de 1 050 emplois – vous mesurez le choix que cela a représenté en cette période de discipline budgétaire – et l'allocation de 175 millions d'euros hors dépenses de personnels. Quant au PLAT 2, il prévoit la création de 2 530 emplois et l'octroi de près de 390 millions d'euros de crédits. Ces deux programmes créent ainsi près de 3 600 postes au profit du ministère de la justice. Quant au Plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme (PART), récemment annoncé par le Premier ministre, il aura des effets tout aussi positifs, même si je ne suis pas, aujourd'hui, en mesure de vous les présenter sous la forme de statistiques.
Grâce à ces moyens, le ministère a structuré des politiques de prise en charge des publics radicalisés ou en voie de radicalisation. Je n'évoquerai pas d'emblée l'administration pénitentiaire. Il est bien entendu légitime que je vous rende des comptes à ce sujet, sujet sur lequel je serai le plus précis et le plus exhaustif possible – même si je sais que vous avez déjà reçu la directrice de l'administration pénitentiaire, Isabelle Gorce –, mais je souhaiterais évoquer tout d'abord l'action de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui contribue à la prise en charge des publics jeunes et peut, à ce titre, jouer un rôle préventif déterminant.
La PJJ s'est vue dotée, le 1er avril 2015, d'une mission nationale de veille et d'information, soit un réseau de soixante-neuf référents – que j'ai d'ailleurs réunis à l'école de la PJJ, à Roubaix – présents sur l'ensemble du territoire. Ces référents « laïcité » ont pour fonction d'offrir aux professionnels une meilleure compréhension de ces enjeux, en particulier grâce à un plan de formation, et d'accompagner les établissements et les services dans la mise en oeuvre des orientations nationales en matière de respect de la laïcité – qui n'est jamais acquis et doit faire l'objet d'une vigilance particulière – et de la neutralité, notamment à travers l'élaboration des projets de fonctionnement. Les professionnels ont pu ainsi effectuer un repérage des difficultés, établir, en quelques mois, une cartographie des risques et améliorer leur évaluation et leur prise en charge des mineurs ainsi que l'accompagnement de leurs familles. L'hétérogénéité du public conduit à privilégier l'individualisation de la prise en charge, qui nécessite des moyens importants, lesquels devront sans doute monter en gamme, car la situation actuelle n'est pas tout à fait satisfaisante.
Il convient de mentionner également le dispositif des « unités dédiées » – expression discutable, car elle ne paraît pas suffisamment explicite – mis en place, de manière d'ailleurs très empirique, au sein de l'administration pénitentiaire. Nous avons peu de recul dans ce domaine, puisque la première de ces unités a été créée le 25 janvier dernier.
Ces structures ne concernent que les maisons d'arrêt ou les quartiers « maison d'arrêt » des centres pénitentiaires. Elles n'existent donc pas, pour le moment, dans les maisons centrales, ce qui est assez logique, eu égard à la faible proportion de personnes détenues condamnées pour des faits de terrorisme islamiste. Par ailleurs, l'affectation en unité dédiée est réservée aux hommes majeurs, qui constituent la population statistiquement la plus importante. J'ajoute que les personnes détenues et condamnées pour ces faits sont affectées en maison centrale.
Les unités dédiées, qui comprennent entre vingt et vingt-huit places, se trouvent dans les maisons d'arrêt de Fleury-Mérogis et d'Osny, en Île-de-France, ainsi que dans le quartier « maison d'arrêt » du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin. Deux autres structures, d'évaluation celles-là, ont été créées : l'une à Fleury-Mérogis, l'autre à Fresnes. Ces cinq structures accueillent aujourd'hui soixante-six personnes. Le personnel qui y est affecté est composé d'une équipe de surveillants qui se consacrent entièrement à ces structures, de conseillers d'insertion et de probation, et d'un binôme, formé par un psychologue et un éducateur, par établissement.
Au sein de ces unités dédiées s'appliquent automatiquement le principe de l'encellulement individuel et celui de la séparation des personnes prévenues et des personnes condamnées. Je précise que toute personne qui y est détenue est prise en charge dans le respect du régime ordinaire de détention, avec les mêmes droits et obligations que les autres détenus.
Il s'agit, j'y insiste, de structures expérimentales qui ne sont pas encore stabilisées au point de devenir un modèle. Je rappelle en effet qu'elles ont été créées pour répondre à un besoin, né dans une maison d'arrêt dont le directeur avait choisi de procéder à un regroupement des détenus radicalisés. Ce choix était discutable, et il a été légitimement discuté. En effet, la doctrine n'est pas la même dans tous les pays de l'Union européenne ayant une expérience en la matière : si les Anglais, par exemple, sont très réservés sur le principe d'un regroupement et d'une détention spécialisés, d'autres, en revanche, comme les Italiens, y semblent plutôt réceptifs. En tout état de cause, nous avons considéré que cette expérience méritait d'être tentée, car elle correspond à la nécessité de proposer une prise en charge adaptée des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation et de faire régner le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires concernés. De fait, à l'origine, le regroupement de ces détenus avait pour but d'éviter la dissémination des difficultés, voire leur prolifération ou le prosélytisme. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise solution. Je souhaite donc que cette expérimentation se poursuive et qu'elle donne lieu à une évaluation solide, ne serait-ce que pour savoir si la formation dispensée aux personnels, la disponibilité qui leur est garantie par l'administration et les moyens mis à leur disposition sont suffisants.
Actuellement, nous nous attachons à formaliser le cadre de cette expérimentation. Il s'agit de définir un ensemble d'outils, s'appuyant autant que possible sur le savoir-faire et les pratiques professionnelles existantes. En tout état de cause, et en dehors du dispositif des unités dédiées, il importe – et c'est un point non négociable – de limiter l'influence de ces personnes identifiées comme des « détenus particulièrement surveillés » – pour reprendre une catégorie déjà utilisée dans nos prisons – sur le reste de la population pénale et de prévenir les risques de troubles en détention. Ainsi les chefs d'établissement peuvent-ils prendre des mesures de gestion adaptées, telles que le placement en quartier d'isolement, une prise en charge individuelle ou l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Outre ces dispositifs, il faut souligner le travail accompli par les Services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), tant en milieu fermé qu'en milieu ouvert. Leur connaissance de la population pénale, leur professionnalisme et leur rôle premier traduisent les efforts déployés pour enrayer les phénomènes de radicalisation et pour accompagner les individus dans la société.
Je le répète, nous avons décidé, conformément aux annonces réalisées dans le cadre du Plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme, de procéder à une réelle évaluation du principe de ces unités dédiées et de leur fonctionnement. Une telle évaluation est nécessaire avant d'envisager l'extension du dispositif à un public plus large.
Par ailleurs – et cela concerne aussi bien la direction de l'administration pénitentiaire que la PJJ et les Services pénitentiaires d'insertion et de probation –, nous allons créer, au sein du ministère de la justice, un comité scientifique pour nous aider à bâtir une doctrine sur la prise en charge des individus radicalisés. Il réunira des chercheurs, des praticiens et des représentants des différentes directions du ministère. Ses missions seront d'évaluer, de coordonner et d'explorer : évaluer les dispositifs de prise en charge, les coordonner pour les harmoniser et explorer de nouvelles pistes.
Mais ces efforts d'évaluation seraient vains si l'on ne détectait pas les détenus concernés ; j'en viens donc à la question du renseignement pénitentiaire, qui est un des éléments importants du nouveau plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme. Ce sujet m'est un peu plus familier que d'autres, car j'y avais réfléchi en tant que parlementaire. Je remercie, du reste, la commission des lois d'avoir doté le ministère de la justice d'une base légale tout à fait satisfaisante, puisqu'un amendement au projet de loi relatif à la procédure pénale a fait du Bureau du renseignement pénitentiaire un membre éminent du deuxième cercle de la communauté du renseignement. Le Sénat a d'ailleurs suivi l'Assemblée sur ce point en complétant à son tour l'article 727-1 du code de procédure pénale, et la commission mixte paritaire a lissé les quelques éléments de discordance qui persistaient après la lecture du texte par les deux chambres.
Pour vous dire les choses simplement, je crois que tout est à faire dans ce domaine, tout ! Le renseignement pénitentiaire n'a en effet qu'une faible structuration au niveau de l'administration centrale de ministère de la justice aujourd'hui. Il existe des outils, des services, des bureaux, des personnels ; nous avons donc de quoi travailler. Mais tout reste à définir, qu'il s'agisse des nouvelles manières de travailler des personnels, de la formation dont ils ont besoin, des moyens humains, techniques et financiers qui doivent leur être alloués ou, surtout, de l'élaboration d'une doctrine.
Il m'est arrivé, au cours de ma vie de député, d'avoir accès, en tant que président de la délégation parlementaire au renseignement, à des documents produits par les services de renseignement ; j'ai donc une idée assez précise de ce que peuvent être leurs analyses. Or, depuis que j'ai pris mes fonctions Place Vendôme, il y a quatre mois, je n'ai jamais été destinataire d'un document à en-tête du renseignement pénitentiaire. Je n'ai donc jamais eu connaissance des réflexions de ce service. Non pas que les personnels n'en aient pas l'envie, mais, depuis la création, en 2002, du renseignement pénitentiaire par le directeur de l'administration pénitentiaire de l'époque, Didier Lallement, ce sujet a été géré de manière très empirique. La menace, du reste, n'était pas aussi intense que celle que nous subissons actuellement.
Aujourd'hui, la responsabilité nous incombe de doter réellement l'administration pénitentiaire d'un outil spécifique. Il ne s'agit pas de copier ce qui existe en milieu ouvert, car un service de renseignement opérant en milieu fermé nécessite évidemment des qualités différentes. Nous nous attelons donc à construire ce service avec rigueur et tempérance, en étant précautionneux, car nous touchons là à des choses essentielles.

Que l'on vous comprenne bien, monsieur le ministre : le ministre de la justice est-il destinataire des procès-verbaux ?
Non, je ne parle pas de procédure.

Le fait que vous n'ayez pas eu de tels documents en main ne signifie donc pas qu'il n'y ait pas eu de contacts directs entre le renseignement pénitentiaire et le renseignement.
Je vais préciser mon propos. Je m'attendais à ce que l'on me donne une analyse, par exemple, de la progression de la radicalité à l'intérieur des établissements pénitentiaires : le prosélytisme y est-il avéré ? Certains personnages sont-ils devenus des références ? Certains établissements sont-ils plus particulièrement affectés ? Des surveillants eux-mêmes – puisque j'avais été interrogé à ce sujet à l'Assemblée – sont-ils en voie de radicalisation ? Bref, j'avais besoin d'un élément de « climatologie pénitentiaire », et il me semblait logique que cela relève de la responsabilité du renseignement pénitentiaire. Or je n'ai rien vu de tel. Je ne dis pas que c'est bien ou mal ; je le constate.
Nous devons donc poursuivre la structuration d'un échelon central d'animation, d'orientation, de synthèse et de transmission de l'information, car cet échelon est actuellement beaucoup trop faible pour que l'on puisse dire du Bureau du renseignement pénitentiaire qu'il est un service de renseignement.
Les effectifs sont là, notamment grâce aux PLAT. Si l'on fait le compte des personnels de l'administration pénitentiaire qui, à un moment donné, discutent avec le renseignement pénitentiaire ou se voient confier cette tâche, marginalement ou à plein-temps, on arrive à un total de 389 personnes. Il ne s'agit pas d'équivalents temps plein travaillé : parmi ces personnes, on peut trouver un délégué local du renseignement pénitentiaire qui consacre, par exemple, 10 % de son temps au renseignement et un autre qui y consacrera 100 % de son temps.
Les effectifs sont donc importants, mais ils ont été utilisés, pour le moment, à l'échelon interrégional, et non à l'échelon central, de l'administration pénitentiaire. Chaque établissement comprend ainsi un référent en matière de renseignement. Il s'agit donc maintenant de créer la « tête » qui définit des orientations et réalise des synthèses. À cette fin, nous devons continuer de recruter des personnels, dont la qualité sera déterminante pour nous permettre de réaliser un bond qualitatif. Nous envisageons ainsi de recruter des personnels venant des services de renseignement du premier ou du deuxième cercle afin d'accélérer la transmission des savoirs. Je souhaite également que le service du renseignement pénitentiaire intègre l'Académie du renseignement, afin que les personnels bénéficient d'une formation et fassent partie de ses promotions. Enfin, pour que cet investissement initial ait des effets dans la durée, il nous faut parvenir à fidéliser ces personnels. Or c'est une gageure au sein de la pénitentiaire. Un chiffre témoigne de la volatilité de ses personnels : dans les trois années qui suivent la sortie de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, nous perdons 15 % des effectifs. On ne peut pas se contenter d'un tel constat ; nous devons trouver des solutions, en termes de statuts et d'indice, mais aussi du point de vue de l'intérêt de la tâche à accomplir.
L'inspection de l'administration pénitentiaire et l'inspection des services judiciaires – qui seront bientôt regroupées au sein d'une seule Inspection générale de la justice – mènent actuellement, au sein du ministère, un travail sur le renseignement pénitentiaire dont les conclusions me seront remises fin juin. Nous examinerons également les relations que le Bureau doit entretenir avec les services de renseignement du premier et du deuxième cercle. Actuellement, seuls deux protocoles ont été signés : l'un, en 2012, avec la DGSI, l'autre, en 2015, avec l'UCLAT. Il me paraît nécessaire d'en conclure d'autres avec le Service central du renseignement territorial, TRACFIN, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et même avec la DGSE. Par la suite, nous mènerons une réflexion sur les outils techniques dont a besoin le renseignement. Pour l'instant, en effet, la question du recueil des données, qu'il s'agisse du recours aux IMSI catchers ou aux interceptions, ne se pose pas. Elle ne se posera qu'une fois que nous nous serons dotés d'une doctrine, d'une formation et d'outils performants.

Je vous remercie pour cet exposé, monsieur le garde des Sceaux. Avant de laisser la parole au rapporteur, je souhaiterais vous poser une première question concernant le renseignement judiciaire. Les services de renseignement ont évoqué, au cours de nos travaux, un certain blocage des enquêtes. De fait, lorsque le renseignement apparaît au cours d'une enquête judiciaire, notamment une instruction, celle-ci étant couverte par le secret de l'instruction, les services saisis, tels que la DGSI, par exemple, ne peuvent pas partager ce renseignement avec d'autres services – cette question s'était posée aux Américains après les attentats du 11 septembre, et elle a été réglée. Je souhaiterais donc savoir si la Chancellerie mène actuellement une réflexion sur la manière dont, tout en respectant le secret de l'instruction, on pourrait éviter de freiner le renseignement en cas d'enquête judiciaire, ce qui est tout de même un comble.
C'est un sujet sur lequel je suis extrêmement prudent. Le principe, qui figure dans le code de procédure pénale, est celui du secret de l'enquête, et il ne s'agit pas de l'écorner. Cependant, je vois bien que cela soulève une difficulté. Sur ce sujet comme sur les autres, je n'ai aucun tabou : je souhaite que l'on pose le problème, que l'on examine les solutions possibles, les protections et les interdits. Nous avons créé, il y a peu de temps, le dossier distinct en matière de géolocalisation. Cet outil, qui permet à la fois d'agir et de garantir un certain nombre de secrets, peut prospérer, dans son principe. J'ajoute qu'il existe déjà des dérogations au principe du secret de l'enquête et de l'instruction en matière de procédures fiscales et douanières – cela est prévu dans un article du code de la sécurité intérieure. Et, récemment, nous avons créé la possibilité d'informer les administrations en cas d'infraction sexuelle.
Je ne suis donc pas hostile par principe à une évolution ; ce serait stupide et dogmatique. Mais je ne veux pas me précipiter : je sens bien qu'il y a des appétits. Il arrive même que des demandes masquent des fragilités d'organisation et que l'on explique d'éventuelles carences par un manque d'outils. Il faut toujours « balayer devant sa porte » avant de réclamer de nouveaux pouvoirs. Je n'ai pas reçu, à ce stade, en tant que garde des Sceaux, une demande explicite à propos d'un cas où le droit existant aurait été une entrave à l'action de tel ou tel service.

Cela nous a été présenté comme un véritable obstacle par les responsables des services du premier cercle. Cette question doit sans aucun doute faire l'objet d'une réflexion, et notre commission d'enquête vous fera certainement des propositions dans ce domaine.
En tant que garde des Sceaux, monsieur le président, je n'ai jamais reçu de demandes à ce sujet de la part de services du premier ou du second cercle.
D'où l'utilité de la séparation des pouvoirs.

Dans le prolongement de la question de M. le président, je souhaiterais évoquer le parcours de Samy Amimour. Celui-ci avait été auditionné par la DCRI en 2012, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Or les services de renseignement ont dû cesser de le surveiller à partir de sa mise en examen. Je souhaiterais avoir votre sentiment sur un tel paradoxe.
Par ailleurs, Amedy Coulibaly avait effectué de multiples séjours en prison, notamment à Fleury-Mérogis, où il fut le voisin de cellule de Djamel Beghal, et des écoutes téléphoniques réalisées en 2010 ont montré qu'il existait un lien fort entre les deux hommes. En outre, Coulibaly a été condamné pour avoir projeté l'évasion de Smaïn Aït Ali Belkacem, l'un des auteurs des attentats de 1995. Pourtant, à sa sortie de prison, il n'a été surveillé par personne : selon les services de renseignement que nous avons auditionnés, il n'apparaissait pas sur les écrans radar. Je souhaiterais donc connaître votre sentiment sur le rôle joué par le Bureau du renseignement pénitentiaire en 2010 et par la suite, car le parcours de Coulibaly soulève la question du lien entre l'administration pénitentiaire et la DGSI.
Enfin, les effectifs du renseignement pénitentiaire ont été largement renforcés au cours de l'année 2015. Par ailleurs, j'ai défendu, avec Philippe Goujon, un amendement, qui a été adopté, visant à intégrer le renseignement pénitentiaire au deuxième cercle de la communauté du renseignement. Que va-t-il se passer dans ce domaine dans les mois qui viennent ?
Entre 1999 et 2009, Coulibaly a été condamné six fois et il a fréquenté, au cours de ses errances pénitentiaires, cinq établissements différents : Melun, Fleury-Mérogis, Villejuif, Orléans-Saran… Votre remarque est tout à fait juste, monsieur le rapporteur ; elle pose la question de ce qu'est le renseignement pénitentiaire. Le bureau du renseignement pénitentiaire ne dispose ni de document ni de retour d'expérience sur le parcours de Coulibaly. D'où deux exigences. Tout d'abord, nous devons renforcer le lien entre le milieu pénitentiaire et le milieu ouvert, et c'est pourquoi je souhaite que des protocoles soient signés avec l'ensemble des services, notamment le service central du renseignement territorial. Celui-ci est certes, compte tenu de la répartition des tâches décidée avec la DGSI, un interlocuteur des délégués locaux du renseignement pénitentiaire, mais il n'a pas normalisé les attentes mutuelles et les processus. Car l'information peut être également préalable à l'incarcération : lorsqu'un individu est suivi, il est utile que l'administration pénitentiaire le sache.
Le parcours de Coulibaly démontre des carences de notre part ; il nous faudra y remédier.
En ce qui concerne le renseignement pénitentiaire, je ne suis en mesure de vous dire que ce que je suis capable de voir pour le moment. J'ai la volonté – et cela ne vous étonnera pas – que nous disposions d'un outil dans ce domaine. Mais j'attends les résultats du travail mené par l'inspection, qui nous aideront à baliser les différents domaines sur lesquels il nous faut progresser. À la rentrée, un décret doit nous permettre d'être intégré à la communauté du renseignement et nous devrions également disposer d'ici la fin de l'année des éléments d'application découlant des modifications du code de procédure pénale. D'ici à la rentrée ou au début de l'hiver, nous aurons donc l'outil issu des modifications que vous avez apportées au cadre législatif. Ensuite, il nous faudra structurer le renseignement pénitentiaire. Une fois l'outil construit au début de l'année 2017, nous pourrons alors nous poser la question des moyens.
Par ailleurs, je suis très attentif à la question de la rupture entre le moment où un individu est suivi par un service de renseignement dans le cadre d'une procédure administrative et le moment où il fait l'objet d'une procédure judiciaire. On ne peut pas, en effet, être suivi au plan administratif et au plan judiciaire pour le même motif : tel est le principe fixé par la loi sur le renseignement. Cet équilibre relève du droit au procès équitable. Toutefois, le service de renseignement en question peut suivre cet individu pour un autre motif. Je crois donc que cette rupture apparente n'est pas une réalité. Je ne pense pas qu'il y ait un vide. Vous savez, en outre, monsieur le rapporteur, que les techniques d'enquête sont beaucoup plus souples en matière judiciaire qu'administrative.

Amimour était également sous contrôle judiciaire. Or on a constaté que ces contrôles étaient assez aléatoires et que les remontées sur leur violation n'étaient pas toujours très bien respectées. Dès lors, ne faudrait-il pas renforcer le contrôle judiciaire des personnes mises en examen pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste ? J'ajoute que les renseignements turcs avaient averti les Français du passage du duo Mostefaï-Amimour en 2013, c'est-à-dire à une date où ce dernier était sous contrôle judiciaire.
Comment pourrais-je répondre non à votre question, monsieur le rapporteur ? Si vous me suggérez de renforcer les modalités du contrôle judiciaire, je ne peux qu'y être favorable. Ce n'est ni une question de volonté ni une question de droit ; c'est une question de moyens. Je compte beaucoup sur le Parlement à cet égard.

Monsieur le ministre, pourriez-vous dresser un bilan de l'intégration dans le code pénal des délits d'apologie du terrorisme et de provocation à la commission d'actes terroristes ? Concrètement, des personnes sont-elles poursuivies sur le fondement de cette incrimination et que deviennent-elles ?
On sait que ce type de publicité se fait notamment sur internet, et vous avez vous-même rédigé, en 2013, un rapport dans lequel vous abordiez la question de l'opportunité de fermer les sites concernés. Quant aux propos tenus sur les réseaux sociaux – Facebook, Twitter… –, s'ils relèvent bien du cadre légal lorsqu'ils sont publics, leur statut est plus difficile à définir lorsqu'ils sont prononcés dans le cadre de discussions privées. Quel est votre regard sur ces questions ?
Par ailleurs, le Premier ministre a évoqué, dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation, la création de centres spécialisés. Ces derniers pourront-ils être utilisés dans le cadre de procédures judiciaires, comme c'est le cas des centres éducatifs fermés, ou accueilleront-ils uniquement des individus volontaires ?
Enfin, les éducateurs spécialisés, en tant que travailleurs sociaux, sont liés par le secret professionnel, s'interrogent donc sur les échanges qu'ils peuvent avoir avec les services de sécurité, voire avec la justice. Les plateformes existantes fonctionnent plutôt bien, mais comment peut-on protéger ces personnels au niveau légal ?

Monsieur Cavard, nous avons fait le choix, vous le savez, de ne pas nous appesantir sur les phénomènes de radicalisation, qui ont été étudiés par la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes.

Certes, mais reconnaissez, monsieur le président, qu'il est difficile d'évoquer la lutte contre le terrorisme sans aborder ce sujet.
Pour conclure, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si le renseignement pénitentiaire est présent au sein de l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT).

J'ai été surpris que, au sein du tribunal de grande instance de Paris, un seul juge d'application des peines traite l'ensemble des affaires de terrorisme, quelles qu'elles soient. Je précise que, lors de son audition, ce magistrat semblait satisfait de cette situation et ne réclamait pas de moyens supplémentaires. Toutefois, le terrorisme basque ou corse et le terrorisme djihadiste, ce n'est pas la même chose. J'aurais donc souhaité connaître votre sentiment sur ce point.
Lorsque nous avons auditionné des juges antiterroristes, nous leur avons demandé s'ils avaient des relations suivies avec les services de renseignement extérieur. Or ils ont répondu par la négative. Ne serait-il pas utile que ces magistrats soient habilités secret-défense afin d'avoir accès aux documents classés et de savoir ce qui a précédé la judiciarisation ?

Même si l'affaire Merah est plus sérieuse que ce que l'on en a dit à l'époque, y compris après l'alternance de 2012, les attaques les plus importantes ont commencé en janvier 2015. Or vous nous dites, s'agissant du service de renseignement pénitentiaire – et il ne s'agit pas pour moi de vous mettre en cause –, que l'outil sera disponible dans le meilleur des cas début 2017. Certes, nous savons que l'idée même de renseignement pénitentiaire n'enthousiasmait pas votre prédécesseur, de sorte qu'un travail de persuasion et la construction d'un consensus ont été nécessaires. Mais il aura fallu attendre deux ans, et beaucoup de morts, avant qu'on admette qu'il ne serait pas mauvais de surveiller les personnes incarcérées, la prison étant, avec internet, un des lieux majeurs de radicalisation. Ce délai est-il raisonnable, du point de vue de la sécurité nationale ? Combien de cellules djihadistes, de Kouachi ou de Coulibaly, aura-t-on fabriquées pendant ces deux années ? Ni le Parlement ni l'exécutif ne semblent capables d'être à la hauteur de l'urgence. Ou bien l'on prend le terrorisme au sérieux, et on traite le problème maintenant, ou bien l'on attend que l'outil se mette en place. Je me permets de vous le dire, il faut agir beaucoup plus fortement !
Par ailleurs, la question soulevée par le rapporteur est fondamentale. Ainsi, il suffit qu'un terroriste, bien conseillé par un avocat, lui-même branché sur les réseaux terroristes, braque une station-service et soit mis en examen pour que sa surveillance par les services de renseignement s'arrête. C'est tout de même incroyable ! Et comment expliquer aux Français qu'un individu sous contrôle judiciaire puisse déclarer la perte de son passeport et en obtenir un nouveau auprès de la préfecture pour partir en Syrie ? Ce sont là des dysfonctionnements majeurs ! On ne peut pas se contenter de les constater, et nous comptons sur vous, car nous savons que vous êtes un homme efficace, pour y remédier. Je suis moi-même juriste, monsieur le ministre, et je suis conscient de ce qu'implique l'ouverture d'une enquête judiciaire. Mais, lorsqu'on est en guerre, on ne peut pas laisser un terroriste utiliser la procédure judiciaire pour échapper à la surveillance. Cela n'a aucun sens et nos concitoyens ne peuvent l'admettre !
Enfin, j'ai entendu les propos du Premier ministre au sujet du dispositif de déradicalisation qu'il est envisagé de créer. De tels dispositifs existent, notamment dans des pays arabes – j'ai moi-même pu visiter des centres de ce type en Arabie saoudite. Peut-être avez-vous mené une étude comparative, mais j'ai pu observer que la déradicalisation fonctionne avant la condamnation ou la détention. Une fois que les individus sont pris dans la machine judiciaire ou pénitentiaire, il est très difficile de revenir en arrière. Il me semble donc que, si l'on décide de faire un effort dans ce domaine, il faut travailler avec des imams, très en amont.

En tout cas, en ce qui concerne le renseignement pénitentiaire, il me semble que la réponse que vous nous avez faite, monsieur le garde des Sceaux, est très claire. On peut déplorer le retard pris, mais vous avez clairement affirmé votre volonté de créer un outil du renseignement pénitentiaire. Je vous invite cependant à relire le compte rendu de l'audition de la directrice de l'administration pénitentiaire : je ne suis pas certain que nous ayons entendu la même affirmation. Votre position nous rassure : encore faut-il qu'elle soit appliquée par la direction du ministère.
Je vous propose de répondre tout d'abord à l'ensemble des questions concernant le renseignement pénitentiaire, qui est un sujet passionnant. Aucun pays démocratique ne dispose d'un service de renseignement pénitentiaire.
Non ! Lorsque j'étais président de la commission des Lois, j'ai écrit aux ambassadeurs de tous les pays démocratiques – Australie, États-Unis, Israël, Nouvelle-Zélande… – parce que, dans ce domaine, le benchmarking était inexistant. Je n'ai pu trouver ni un ouvrage, ni une étude universitaire, ni même un article sur le sujet. J'ai fait cette recherche car j'estime que, si un système vertueux existe ailleurs, il n'est pas utile de s'épuiser à en inventer un autre. Quoi qu'il en soit, je tiens les réponses de ces ambassadeurs à votre disposition. Dans certains pays, il existe des départements, à l'intérieur de services, qui s'occupent de la pénitentiaire, mais il n'existe pas de services de renseignement comparables à ce qui existe pour le renseignement intérieur ou le renseignement extérieur. C'est un sujet nouveau, que nous devons traiter et pour lequel il y a évidemment une hésitation.
Au regard de ce qu'est selon moi un service de renseignement pénitentiaire, je considère qu'il n'en existe pas. Le mot « renseignement », du reste, n'est pas défini.. Il existe une collecte du renseignement dans l'univers carcéral – des personnels observent, constatent, recueillent de l'information –, mais je n'appelle pas cela du renseignement. Selon moi, celui-ci suppose une mise en perspective, une capacité de prévision, une anticipation, la compréhension de faits qui se sont déroulés…
Je ne mets la conscience professionnelle de personne en cause. Je considère, au contraire, que ces personnels sont extrêmement dévoués, car ils défrichent un domaine qui fait l'objet d'une forte attente sociale – les interrogations que vous avez formulées existent au-delà de ces murs. Mais on ne se décrète pas agent du renseignement : cela nécessite, en milieu ouvert, des années d'expertise. En milieu fermé, il convient tout d'abord de définir ce que doit être un agent du renseignement. Il est pour le moins délicat de désigner un surveillant, connu des détenus, agent du renseignement pénitentiaire.
Je préférerais vous présenter une synthèse du renseignement pénitentiaire sur le prosélytisme en prison, mais je n'en ai pas. Comme je n'ai pas été nommé pour faire des constats, nous allons agir dans ce domaine. Nous avons déjà fait beaucoup : les personnels sont présents, la motivation existe et, grâce à vous, les difficultés juridiques ont été aplanies. Il nous reste maintenant à agir.
Quant à la directrice de l'administration pénitentiaire – j'ai relu, hier, le compte rendu de son audition par votre commission d'enquête –, elle a évoqué les problèmes de remontée de l'information. C'est bien de cela qu'il s'agit. Lorsque je me rends dans le ressort d'un TGI, d'une cour d'appel ou dans un établissement pénitentiaire, je demande comment les choses se passent. J'ai rencontré récemment le directeur de la DGSI, Patrick Calvar, qui m'a dit que les relations entre son service et nos référents du renseignement pénitentiaire étaient bonnes, mais des lacunes demeurent, et je crois qu'Isabelle Gorce a été assez franche. Nous avons beaucoup à faire dans ce domaine.
M. Cavard m'a interrogé sur le délit d'apologie du terrorisme. Entre le 13 novembre et le début de l'année 2016, 472 procédures ont visé l'apologie du terrorisme, dont 149, qui visaient 151 auteurs, ne concernent que ces faits ; 71 % ont donné lieu à des poursuites devant les tribunaux correctionnels et, à ce jour, 34 personnes ont été jugées, dont 17 ont été condamnées à de l'emprisonnement ferme.
Le garde des Sceaux ne s'exprime pas sur les affaires en cours, monsieur le député.
Par ailleurs, aucun blocage judiciaire de site internet n'a été engagé, même si des centaines le sont au plan administratif – je crois à l'effet disruptif que peuvent avoir ces blocages.
En ce qui concerne le secret professionnel, les lois de 2007 ont créé des dispositifs de partage, lesquels sont limités à des personnes elles-mêmes soumises au secret. Je crois néanmoins que nous devons réexaminer cette question, compte tenu des nouveaux défis que nous devons relever. Je n'ai pas reçu de demandes de ce type, mais je n'y suis pas opposé par principe. Enfin, un directeur de service pénitentiaire a intégré l'UCLAT il y a déjà quelque temps, lorsque Christiane Taubira était ministre de la justice, mais l'UCLAT n'est pas une structure opérationnelle.
Monsieur Lamy, nous avons prévu d'alléger le travail du juge d'application des peines antiterroriste, car certains éléments, notamment l'apologie du terrorisme, ne relèvent plus de sa compétence. En outre, un second magistrat va être nommé au mois de septembre.

À ce propos, pourriez-vous répondre à ma question sur les réductions de peine automatiques dont continuent à bénéficier les condamnés pour fait de terrorisme ?
C'est un sujet que vous connaissez bien, monsieur le président ; nous l'avons évoqué chaque fois que votre assemblée a examiné un projet de loi touchant au code de procédure pénale. La question a été tranchée : il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire de faire évoluer la législation sur ce point.
Je vous donne l'état du droit actuel et la position défendue par le Gouvernement.

Mon autre question portait sur le secret-défense. Nous nous sommes en effet aperçus, lorsque nous avons auditionné les juges antiterroristes, qu'ils n'avaient pas de liens réguliers avec les services de renseignement, notamment le service de renseignement extérieur. Je sais bien que cela peut poser problème au regard de la séparation des pouvoirs, mais puisque les parlementaires membres de la délégation au renseignement y ont accès, ne pourrait-on pas habiliter secret-défense au moins certains juges antiterroristes ?
Les juges antiterroristes sont habilités secret-défense du fait de leurs activités. Du reste, lors de l'examen du projet de loi sur le renseignement, nous avions discuté de la question de savoir s'il fallait habiliter les structures ès qualités, ce que nous avons fini par faire pour certains magistrats du Conseil d'Etat. Toutefois, ces magistrats n'ont pas besoin de tout connaître.

Quand j'étais au parquet antiterroriste, nous avions une habilitation de fait : nous avions accès à des informations provenant des services de renseignement, DGSE ou DST, mais sans passer par un système d'habilitation contraignant, lequel pourrait, du reste, être considéré comme contraire à la séparation des pouvoirs.
Je précise que des enquêtes sont réalisées en vue de l'habilitation.

On peut imaginer en effet que, lorsqu'un magistrat du siège est désigné juge antiterroriste, sa hiérarchie s'est au préalable informée sur sa fiabilité.

Je souhaiterais revenir sur le problème des téléphones en prison. Lorsque j'avais interrogé votre prédécesseur sur ce point, elle m'avait indiqué que plus de 20 000 téléphones avaient été saisis en l'espace d'un an, ce qui est colossal. Or il est indispensable que les détenus radicalisés ou condamnés pour terrorisme n'aient pas de téléphone ou, s'ils en ont un, qu'ils soient écoutés. J'ai cru comprendre, du reste, que certains services mettaient des téléphones en circulation pour pouvoir les écouter. Aujourd'hui, des technologies permettent de savoir, pour chaque cellule, si un téléphone s'y trouve et, si tel est le cas, de l'écouter. Bien entendu, il faudrait utiliser un tel système pour tous les détenus, mais ce n'est pas possible, faute de moyens. Cependant, aujourd'hui, nous sommes en guerre et les détenus radicalisés doivent être une priorité.
Par ailleurs, un jour ou l'autre, les détenus radicalisés qui se trouvent dans les différentes « unités dédiées » seront libérés. Ne pourrait-on pas leur imposer le port d'un bracelet électronique ? Je sais que cela peut être contraire à certains principes, mais avons-nous réellement le choix ?
Enfin, nous avons assisté, ces derniers jours, sur internet, à des débordements antisémites invraisemblables suite à un article que Martine Gozlan a consacré dans Marianne au dernier film d'Yvan Attal. Quels moyens a-t-on de lutter contre de tels débordements ?
S'agissant des brouilleurs, il en existe 804 dans les établissements pénitentiaires, ce qui signifie que 53 % d'entre eux en sont équipés. Toutefois, la technologie de la plupart de ces brouilleurs est obsolète, puisqu'ils ont été majoritairement conçus pour brouiller la 2G. Il est donc prévu – des crédits ont été programmés à cet effet – d'acheter des brouilleurs de nouvelle génération. Je précise, du reste, que les systèmes les plus performants sont installés en priorité dans les unités dédiées que j'ai évoquées tout à l'heure, mais à peine les nouveaux appareils seront-ils déployés que l'on passera à la 5G, et nous nous retrouverons dans la même situation qu'aujourd'hui.
Il existe plusieurs techniques de brouillage. Nous avons ainsi expérimenté, à Osny, un brouillage chirurgical qui peut cibler une cellule, par exemple. On peut également installer un brouillage aérien, avec une antenne centrale, mais, si l'établissement se trouve dans une zone très urbanisée, les riverains vont immédiatement protester.
Quoi qu'il en soit, je rappelle que le principe est l'interdiction des téléphones en prison. Or 30 000 téléphones ou éléments de téléphones ont été saisis par la DAP l'an dernier. J'ai d'ailleurs invité les deux commissions des lois à m'accompagner lors d'un déplacement pour que nous sachions ce que sont ces téléphones, qui sont beaucoup plus petits et discrets que ceux que vous et moi utilisons. J'ai ainsi découvert la technique dite du « Big mac », qui permet de faire entrer ces téléphones en prison. Elle consiste à placer trois ou quatre téléphones entre deux grosses éponges entourées de ruban adhésif et à jeter le tout par-dessus le mur d'enceinte de la prison.
Tout cela était dans la presse, monsieur le président, et il faut dénoncer ces pratiques.
Nous allons expérimenter, dans un établissement de la Meuse, me semble-t-il, l'équipement de chaque cellule d'un téléphone filaire qui pourra donc être écouté. Ainsi tout téléphone portable perdra de son intérêt pour ceux qui veulent en faire un usage légitime, notamment le maintien des liens avec leur famille. Par ailleurs, plutôt que de les brouiller, il serait plus utile de détecter ces téléphones. Nous avons actuellement un dialogue compétitif avec des entreprises, afin de trouver des réponses techniques à nos besoins dans ce domaine, besoins que nous avons précisément identifiés.
J'en viens à la question des aumôniers. Au 25 mai 2016, les aumôniers musulmans agréés pour intervenir en détention étaient au nombre de 222 – ils étaient 200 au début de l'année. Chaque PLAT a prévu des capacités de recrutement. Évidemment, ils doivent être formés et nous avons un regard sur leur recrutement et leurs conditions d'exercice. Par exemple, tous ne sont pas indemnisés à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Or, si nous menons avec eux un travail au long cours, il ne faut pas négliger cette forme de fidélisation. Leur formation est actuellement assurée par les directions interrégionales de l'administration pénitentiaire.
Pour le reste, monsieur Habib, on peut partager votre avis sur beaucoup des points que vous avez évoqués, mais il convient d'appliquer la loi. Or, à ce stade, les modalités auxquelles vous avez fait référence ne sont pas vraiment légales.

Il est de notoriété publique que l'autorité judiciaire, notamment le parquet de Paris, mais aussi celui de Bruxelles, a rencontré des difficultés en raison de la relation par la presse d'un certain nombre d'informations capitales pour l'enquête, voire pour la sécurité des otages. Une réflexion est-elle en cours à la Chancellerie pour que la presse soit tenue de garder le secret pendant un certain temps, comme c'est le cas, me semble-t-il, en Grande-Bretagne ? C'est une véritable aspiration de l'autorité judiciaire, qui ne nous a pas caché son irritation face à la fuite d'éléments de l'enquête.
Il m'est en effet arrivé d'avoir des conversations à ce sujet. J'ai même lu des articles évoquant la réticence des autorités belges à procéder à des transferts par crainte que cela n'entraîne des perturbations. Je sais également les solutions auxquelles aspirent ceux qui souhaitent remédier à cette situation ; je ne les crois pas, en l'état, très praticables. Le problème est extrêmement complexe et, pour le moment, nous n'avons pas de piste de réponse.

Cette question nous paraît vraiment importante. Nous avons du reste auditionné les organes de presse ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Manifestement, l'autorité judiciaire et la presse elle-même sont désireuses qu'au moins une charte, ou un protocole, permette de réguler leurs relations lors de moments critiques, d'autant que l'information est désormais continue et instantanée. Sans revenir sur les faits qui ont suscité cette réflexion, je rappellerai que, en Belgique, la révélation d'une information a précipité la perquisition à Forest et a donc eu une incidence sur le déroulement de l'enquête.
Certains éléments devraient nous inciter à l'optimisme, monsieur le président. Après les débordements que nous avons constatés après l'attentat contre Charlie Hebdo, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé une quarantaine de rappels à l'ordre aux différentes chaînes de télévision, lesquelles paraissent avoir retenu la leçon, car nous n'avons pas eu à déplorer les mêmes excès lors des attentats du 13 novembre. La presse s'est en effet comportée de manière beaucoup moins critiquable lors de ces événements. Il n'empêche que, en dehors des périodes de haute intensité, cette course à la révélation peut perturber le cours des enquêtes, ce qui est évidemment regrettable.

Le procureur de la République de Paris nous a alertés sur le fait qu'il était de plus en plus souvent confronté à des mineurs très radicalisés et que les prisons ou les centres éducatifs fermés n'étaient pas les structures les plus adaptées. Quelle est la réflexion du ministère sur la prise en charge des mineurs radicalisés ?
Par ailleurs, la détention de Salah Abdeslam se déroule dans des conditions assez inédites, puisqu'il est placé sous vidéosurveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à mettre en oeuvre ce dispositif, et celui-ci présente-t-il toutes les garanties juridiques nécessaires ?
Il est légitime que vous évoquiez ce sujet, mais il est très sensible. J'ai en effet pris la décision de placer la personne détenue sous vidéosurveillance, d'abord dans un souci de protection de la personne elle-même. Cette vidéosurveillance impliquant l'enregistrement de données personnelles, j'ai saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour solliciter son avis sur la durée de leur stockage et les conditions de l'enregistrement. La CNIL a rendu un avis positif, et je ne verrais d'ailleurs que des avantages à ce que cet avis soit publié. Je vais prendre l'arrêté qui donnera sa base juridique à cet enregistrement. Celui-ci doit être extrêmement précis et entouré d'un certain nombre de garanties. Le caractère exceptionnel du dispositif est évident. Le texte devrait correspondre à la fois aux aspirations de la CNIL et à celles qui relèvent de ma responsabilité.
Quant à la question des mineurs, il s'agit d'un sujet en devenir, car, si ce que je peux en lire est exact, les nombreux mineurs – autour de 400, dit-on – présents sur le théâtre irako-syrien sont susceptibles de revenir sur le territoire national. Aujourd'hui, seuls huit mineurs sont placés en détention pour des mises en examen liées au terrorisme. Notre réflexion est donc, pour l'instant, embryonnaire sur ce sujet. Je suis, par exemple, très prudent sur l'intérêt d'un regroupement, dans leur cas.
Par ailleurs, on observe une augmentation des signes de radicalisation en milieu ouvert. Personne ne nie la réalité du problème. Nous essayons donc d'anticiper avec la PJJ, qui a pris beaucoup d'initiatives, notamment en s'informant sur ce qui peut se faire dans d'autres pays. De nombreux travaux existent, qui circulent au sein de l'administration et dont nous essayons de nous inspirer.

Monsieur le garde des Sceaux, le directeur général de la sécurité intérieure nous a annoncé le retour éventuel, peut-être précipité, d'un nombre sans doute important d'individus partis pour la Syrie. Il serait lié au fait que l'État islamique voit son territoire se réduire peu à peu. La Chancellerie réfléchit-elle à une modification de la législation ou à une nouvelle législation plus imaginative concernant ces individus ? Je pense également aux mineurs. Vous avez supprimé le tribunal correctionnel pour mineurs – même si je sais que, sur ce point, votre réflexion n'est pas très éloignée de la mienne. Soit. Mais imaginez, si vous deviez envisager des poursuites à leur égard, la réaction du juge pour enfants face à des enfants qui, à dix ans, ont déjà manié la kalachnikov et tiré sur leurs voisins…
En ce qui concerne les majeurs, de deux choses l'une : soit on n'a rien contre eux, et ils vaqueront à leurs occupations, soit ils tombent sous le coup de l'association de malfaiteurs terroriste, mais celle-ci est difficile à établir. Je vais peut-être choquer, mais ne pourrait-on pas imaginer une solution analogue à celle qu'ont choisie les Américains ? Je ne pense pas forcément à Guantanamo, mais le Homeland Security envisage d'envoyer systématiquement en prison, sans qu'ils passent par la case « liberté conditionnelle », tous ceux qui rentrent de Syrie – ce qui les dissuadera peut-être de rentrer, du reste. Imaginez-vous une autre forme de délit, voire de crime, pour « pénaliser » systématiquement les individus qui rentrent de Syrie ? Certes, ils ont pu y faire la plonge ou y être garagistes ou ambulanciers, mais c'est tout de même peu vraisemblable…

Monsieur Marsaud, il me semble que, depuis 2012, le fait de se rendre sur un théâtre extérieur est une infraction.

Certes, mais les individus sont immédiatement remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ce n'est pas une véritable répression. Or il s'agit de protéger l'ordre public.
M. Marsaud plaide ici, comme il l'a fait lors d'un récent débat, en faveur de la création d'un délit de séjour. Je me dois donc de lui rappeler que son amendement n'a pas été adopté, et je ne peux qu'exposer les arguments que je lui avais opposés lors de cette discussion : ma conviction – mais M. Marsaud est un orfèvre en la matière et c'est avec prudence que j'engage la controverse avec lui – est que l'AMT est suffisamment souple pour couvrir ce type de risques.

Je souhaiterais clarifier un point, monsieur le garde des Sceaux. Une information est parue dans la presse selon laquelle la Place Beauvau aurait expliqué l'interruption, fin 2013 et en juin 2014, de la surveillance téléphonique dont faisaient l'objet les frères Kouachi par le fait que la CNCIS – dont vous étiez membre, en tant que député – n'avait pas autorisé sa prolongation. Or vous avez publié un communiqué dans lequel vous avez formellement démenti cette information. Pourriez-vous le confirmer devant la commission d'enquête ?
Je n'ai pas publié de communiqué, pour une raison très simple : les travaux de la CNCIS, comme ceux de la CNCTR, qui lui a succédé, sont couverts par le secret-défense.
Je me rappelle ce que j'ai fait, monsieur le président. J'ai repris la position que le président Delarue avait exprimée publiquement dans un communiqué qu'il avait signé : il y a eu une discussion au sein de la CNCIS et nous avons effectivement pris la position publique que vous venez de rappeler et qui était conforme à ce que nous avions vécu.
Le communiqué du président Delarue dit tout ce qu'il y a à dire sur cette question.

En ce qui concerne le centre de déradicalisation dont le Premier ministre a annoncé la création, ceux qui y séjourneront seront-ils volontaires ou certains pourraient-ils y être obligés par une procédure judiciaire ?
Le Premier ministre a en effet annoncé l'ouverture prochaine d'un centre de déradicalisation. Ce projet est en cours de discussion : locaux, personnel, public accueilli… Le ministère de la justice ne serait concerné que si ce centre devait accueillir les personnes sous main de justice.
Pour le moment, ce centre accueillerait plutôt des personnes volontaires, et non des personnes sous main de justice. Je ne peux pas vous en dire plus. En revanche, je peux vous indiquer que 317 procédures judiciaires ont été ouvertes à propos de retours de Syrie ; 263 sont encore en cours. Ces procédures ont donné lieu à la mise en examen de 259 personnes, dont 163 sont en détention provisoire.

Monsieur le garde des Sceaux, la commission d'enquête vous sait gré de lui avoir consacré ces deux heures très riches et vous remercie pour la très grande clarté et la franchise de vos réponses.
Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense.

Nous vous remercions, monsieur le ministre de la défense, d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en oeuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015.
Nous achevons notre travail avec l'audition des membres du Gouvernement. Nous venons d'entendre le garde des sceaux et nous entendrons demain le ministre de l'intérieur. Avec vous, monsieur le ministre de la défense, nous allons nous intéresser aux aspects militaires de la lutte contre le terrorisme aussi bien sur les théâtres d'opérations extérieurs, avec notamment la conduite de l'opération Chammal, qu'en France, avec l'opération Sentinelle, et bien sûr aux moyens budgétaires, humains et matériels, dégagés par l'État. Nous allons également aborder les questions relatives au rôle du renseignement militaire et à la coopération et à la coordination entre ce dernier et les autres services de renseignement.
Nous vous entendrons avec d'autant plus d'intérêt après avoir auditionné les responsables, placés sous votre autorité, des forces armées et du contre-espionnage. Nous avons notamment reçu le gouverneur militaire de Paris et des militaires de l'opération Sentinelle ; mais nous avons également eu l'honneur d'auditionner le général Pierre de Villiers, chef d'état-major, ainsi que le général Pierre Sauvegrain, sous-directeur de l'anticipation opérationnelle de la gendarmerie nationale, et le général Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire (DRM).
Une première série de questions tournera autour de notre présence militaire au sein de la coalition dans la zone irako-syrienne notamment. Nous vous interrogerons ensuite sur le rôle de la force Sentinelle.
Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale ; son enregistrement sera également disponible pendant quelques mois et je vous signale que la commission pourra décider de citer dans son rapport tout ou partie du compte rendu qui sera fait de cette audition. Nous avons en effet décidé que, d'une manière générale, et quand cela ne soulèvera pas de difficulté pour les personnes entendues ou au regard de la confidentialité des informations recueillies, nos auditions seraient ouvertes à la presse, car nous devons mener cette enquête en toute transparence.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête, je vous demande de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, prête serment.)
Je vous remercie de m'avoir invité dans le cadre de vos travaux. Avant de revenir sur les conséquences des attentats de 2015 en termes de capacités et d'action, je souhaite évoquer la situation antérieure afin de vous livrer quelques observations sur le débat qui avait alors cours sur le contre-terrorisme et sur les menaces.
La menace terroriste avait en effet déjà été identifiée en 2008 comme « majeure » dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Ce statut de la menace terroriste a été confirmé dans le Livre blanc de 2012, après des discussions portant essentiellement sur la réalité de l'affaiblissement d'Al-Qaïda, sur le fait de savoir si la menace identifiée en 2008 était toujours aussi forte. Il y a été répondu par l'affirmative et cela bien avant l'émergence fulgurante de Daech avec la prise de Falloujah, au début de 2014, et celle de Mossoul, au printemps de la même année. La gravité de la situation au Sahel avait déjà largement sensibilisé la commission du Livre blanc et en 2008, et en 2012 au moment de la préparation de la loi de programmation militaire (LPM) pour 2013. Le contre-terrorisme était dès lors déjà une priorité impliquant l'octroi de moyens supplémentaires.
Dès lors, quand je suis devenu ministre de la défense, en harmonie avec les préconisations du Livre blanc et en application des dispositions prévues par la loi de programmation militaire, avant même les événements en question, j'ai été amené à engager un certain nombre de programmes de renforcement du renseignement, en particulier en matière capacitaire. J'ai donc décidé de renforcer des programmes d'investissements, tels ceux liés à la stratégie des drones – qui avait suscité de longues discussions, voire des affrontements. Nous avons ainsi acheté des drones Reaper aux États-Unis, puisque les nôtres avaient un caractère intérimaire. J'ai également fait inscrire dans la loi de programmation l'acquisition de drones tactiques – c'est désormais chose faite – et pris des initiatives avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne afin d'engager un programme visant à élaborer une nouvelle génération de drones européens pour l'horizon 2025.
La nécessité de renforcer nos capacités de renseignement impliquait la modernisation de nos dispositifs d'interception et d'observation dans le domaine satellitaire. Le renseignement d'intérêt militaire bénéficiera rapidement de la livraison des satellites CSO (composante spatiale optique) du programme MUSIS (Multinational Space-based Imaging System), et de la réalisation du système satellitaire d'écoute CERES (capacité de renseignement électromagnétique spatiale) qui sera opérationnel en 2020.
À cette augmentation des moyens capacitaires s'est ajouté un renforcement des moyens humains : la loi de programmation militaire initiale avait prévu une augmentation de plus de 1 000 postes rattachés au ministère de la défense, personnels directement liés au renseignement ou à la cyberdéfense, qu'il s'agisse de spécialistes indispensables à ces nouvelles capacités, de linguistes, d'interprétateurs d'images, de spécialistes de capacités critiques pour la détection...
J'ajoute que l'engagement du ministère de la défense dans la lutte contre le terrorisme s'est aussi traduit, avant même le 7 janvier 2015, par un effort sur le terrain des prérogatives juridiques offertes aux services de renseignement. En effet, la LPM de décembre 2013 comporte déjà des dispositions renforçant l'accès des services de renseignement du ministère de la défense à certains fichiers, notamment de la police administrative ou judiciaire ; elle prévoit en outre un régime d'accès des services de renseignement aux données de connexion détenues par les opérateurs de télécommunication, la création en France du fichier PNR (Passenger Name Record) ou encore la protection des systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale contre la cybermenace.
Tout ce que je viens de rappeler montre bien à quel point nous étions déjà conscients de la menace terroriste, même si, depuis les attentats de 2015, la donne a complètement changé.
En ce qui concerne l'évolution de la situation depuis ces événements, je vous ferai part de plusieurs observations, en commençant par le déploiement des militaires sur le territoire national, pour en venir ensuite aux théâtres extérieurs.
Contrairement à ce que j'ai pu lire, ce n'est pas la première fois que nos armées se voient confier des missions de protection sur le territoire national : c'est une réalité ancienne et clairement exprimée dans tous les livres blancs successifs depuis 1972 ; elle fut accentuée dans celui de 2008, qui crée le contrat opérationnel de déploiement de 10 000 hommes sur le territoire, et consolidée dans celui de 2013. En effet, les trois grandes priorités stratégiques du ministère de la défense – dissuasion, intervention, protection – sont étroitement complémentaires et la protection reste première dans notre stratégie de défense et de sécurité nationale, même si la projection extérieure a constitué un axe d'effort majeur depuis la fin de la guerre froide. Par conséquent, la protection de la nation contre toute menace de nature militaire ou susceptible de porter atteinte à la continuité des institutions est sans conteste une mission prioritaire des forces armées.
J'entends y insister parce que, dans les scénarios d'emploi des armées qui sous-tendent les préparatifs des livres blancs de 2008 et 2013, le risque d'une combinaison de menaces visant la France ou l'Europe, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du territoire, est considéré comme le plus important et le plus exigeant en termes de capacités à déployer. Les événements de janvier et novembre 2015 nous ont tragiquement rappelé la pertinence de ce travail d'anticipation.
Dès les premières heures de la crise du 7 janvier, j'ai donc ordonné le renforcement des détachements Vigipirate. Je rappelle que, puisque nous nous trouvions pendant la période des fêtes, le dispositif était activé, mais pas à son « plafond » puisque mobilisant de 700 à 800 personnels militaires. J'ai dès lors décidé de le déployer à son maximum avec l'engagement de 1 100 personnels afin de soulager l'effort des forces de sécurité intérieure. Il s'agissait d'assurer une présence plus visible et plus rassurante pour nos concitoyens, en particulier sur les sites de transport des grandes villes.
Compte tenu de l'analyse de la menace, c'est une décision d'activation du contrat de protection lui-même, à son plus haut niveau, qui a été prise par le Président de la République le 12 janvier et afin de montrer que nous avions vraiment changé de perspective, que nous dépassions le cadre du dispositif Vigipirate, l'opération Sentinelle a été décidée. C'était un signal politique fort de la part du chef des armées et la Nation a compris que le péril terroriste, militarisé à l'extérieur de nos frontières, pouvait la frapper en son coeur, et que la réponse devait être à la mesure de sa dangerosité : une réponse forte, déterminée et cohérente.
La mobilisation du ministère de la défense et des armées a été, pendant ces heures dramatiques, exemplaire. En moins de soixante-douze heures, en effet, 10 000 militaires ont été projetés sur tout notre territoire, à la disposition du ministre de l'intérieur et, à travers lui, des préfets de zone de défense, pour ce qui a constitué la première véritable opération intérieure de l'armée professionnelle. C'est de cette manière que l'opération Sentinelle a vu le jour : elle a été conçue dès ses premières heures, non plus comme un complément d'effectifs de Vigipirate, mais bien comme une opération en soi de protection sur notre sol, en complément de l'action des forces de police et de gendarmerie. Il va de soi que cette opération militaire s'insère dans la manoeuvre globale de sécurité intérieure pilotée par le ministre de l'intérieur et qu'en aucun cas nos forces ne peuvent intervenir sans une réquisition du ministre ou de son représentant.
La prolongation de ce premier dispositif et son organisation ont ensuite été confirmées par le chef de l'État au cours d'un conseil de défense d'avril 2015. Face au développement de la menace terroriste militarisée, le contrat de protection a été précisé et redéfini, avec une capacité cette fois permanente d'engager 7 000 hommes des armées dans la durée, et jusqu'à 10 000 pour un mois. Cette redéfinition, jointe au constat de nos fortes sollicitations en opérations extérieures, a conduit à la décision d'augmenter, par rapport aux prévisions de la LPM, de 11 000 hommes la force opérationnelle terrestre (FOT) qui passera de 66 000 à 77 000 hommes. À cette occasion, j'ai précisé qu'il s'agissait bien d'une seule et même armée : nous n'avons pas retenu les propositions d'armée à deux vitesses, l'une territoriale, l'autre de projection, qui eût été la source de trop de complexité, d'iniquité et, éventuellement, de gaspillage.
L'opération Sentinelle s'est depuis lors continûment adaptée, dans une logique de protection prioritaire des personnes et avec une volonté de souplesse et de dynamisation accrues de nos dispositifs – moins de gardes statiques et, progressivement, plus de patrouilles – articulés avec ceux du ministère de l'intérieur.
Au lendemain des attentats du 13 novembre, la mobilisation des armées s'est de nouveau confirmée avec le redéploiement – en application du nouveau contrat opérationnel – de 3 000 soldats en trois jours, dont 1 000 dès les deux jours qui ont suivi les événements. Là encore, la mobilisation dans l'urgence a été totale, jusqu'à la mobilisation des hôpitaux des armées. Je tiens à signaler que nous avons, dans le même temps, renforcé l'ensemble de nos postures de sécurité du territoire national, tant aériennes, maritimes que de cyberdéfense, qui peuvent tout autant faire l'objet d'attaques terroristes.
Une telle évolution appelait un recadrage de la doctrine d'emploi des armées sur le territoire national ; c'est ce qui a été fait, conformément aux conclusions du conseil de défense d'avril 2015, à travers l'article 7 de la LPM actualisée du 25 juillet. Le rapport relatif aux conditions d'emploi des armées sur le territoire national a été présenté au Parlement et a donné lieu à deux débats très riches, à l'Assemblée et au Sénat, les 15 et 16 mars derniers.
Ce rapport présente le cadre d'ensemble dans lequel nous menons nos opérations intérieures et les évolutions qu'il a connues depuis les attentats du 7 janvier. Il tire les conséquences de l'évolution des menaces et de leur confrontation avec les savoir-faire spécifiques de l'armée professionnelle : réactivité et disponibilité permanentes ; centralisation des forces ; maîtrise des armes de guerre ; capacité de planification complexe et multi-milieux ; mobilité et aéromobilité, pour ne prendre que les exemples les plus marquants.
En outre, le rapport met en place la posture permanente de cyberdéfense ainsi que les principes des contrats capacitaires du service de santé ou de celui des essences. Il donne également une nouvelle impulsion à l'emploi de nos réserves militaires. C'est bien tout le champ de nos opérations de protection intérieure qui a été revisité à cette occasion et adapté à la situation que connaît le pays.
Il décrit également le cadre juridique applicable à l'emploi des armées sur le territoire national, et notamment à l'emploi de la force par nos militaires. À ce titre, je souligne que le régime de la légitime défense, qui est celui qui, à titre principal, régit l'emploi de la force par les policiers comme par les militaires réquisitionnés pour agir sur le territoire national, constitue un cadre adapté à la situation. On a pu notamment mesurer ces derniers mois – par exemple à Valence ou lors de la neutralisation d'un individu qui s'attaquait à un commissariat parisien – qu'il permettait de prendre en compte la spécificité du métier des forces de l'ordre et qu'il ne constituait pas un facteur d'inhibition dans l'usage des armes.
Reste que le rapport discuté en mars dernier par le Parlement relève aussi le grand intérêt que présentent les dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article 51 de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, votée définitivement le 25 mai. Ces dispositions ont pour objet de prendre en compte le cas particulier d'individus engagés dans des périples meurtriers, dont il convenait de permettre qu'ils puissent être empêchés d'agir alors même que la condition d'immédiateté de la riposte qui caractérise le mécanisme de la légitime défense ne serait pas respectée. Pour dire les choses plus clairement, le Gouvernement a entendu permettre la mise hors d'état de nuire d'individus auteurs d'homicides et s'apprêtant à en commettre d'autres alors même que, au moment précis où ils seraient mis hors d'état de nuire, ils ne seraient en train de menacer des vies humaines. Ce nouveau régime d'excuse pénale pour usage de la force s'applique indistinctement aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers et aux militaires réquisitionnés, comme à ceux qui sont engagés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Les conditions en sont précises et permettent d'écarter tout reproche de création d'un quelconque permis de tuer. En revanche, il s'agit d'un régime qui devrait éviter toute inhibition inutile dans l'usage des armes et inviter les autorités judiciaires à poursuivre dans la voie d'une prise en compte accrue de l'inévitable spécificité de l'usage de la force par les forces de sécurité intérieure, quelles qu'elles soient.

Le point que vous venez d'évoquer est très important pour la commission et je souhaite que nous nous y arrêtions un instant.
Nous nous sommes longuement interrogés sur le rôle de la force Sentinelle le 13 novembre, à l'occasion de l'attaque contre le Bataclan. Des militaires membres de ce dispositif sont venus en renfort des forces d'intervention de la sécurité intérieure pour sécuriser les périmètres extérieurs, mais sans jamais engager le feu.
La question s'est posée d'une meilleure coordination des forces de sécurité intérieure et de la force militaire, et vous évoquez à ce sujet, monsieur le ministre, l'inhibition qui prévalait jusque-là dans l'usage du feu.
J'ai au contraire évoqué un cadre juridique ne constituant pas un facteur d'inhibition, monsieur le président.

En effet, mais j'évoquais la situation antérieure.
Je rappelle que l'un des terroristes avait ouvert le feu, avec sa kalachnikov, à l'extérieur du Bataclan, dans le passage Saint-Pierre-Amelot. Or les hommes de la brigade anticriminalité (BAC), arrivés les premiers sur les lieux, n'étaient pas équipés pour riposter à une kalachnikov. Notons qu'ils le seront désormais puisque le ministre de l'intérieur a revu ses doctrines d'emploi et fait équiper et former les BAC et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG-Sabre). Mais au moment des faits, la BAC ne pouvait intervenir davantage. L'un des policiers a appelé l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) pour demander si les militaires, alors au nombre de huit et porteurs de FAMAS, pouvaient engager le feu ; il lui a été répondu par la négative : les militaires ne pouvaient qu'assister et non intervenir directement. Le secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de la police nationale nous a même révélé qu'un policier avait demandé à un militaire de lui prêter son FAMAS : il a essuyé un refus catégorique.
Au vu de ce que vous venez de nous expliquer concernant le nouveau cadre juridique de l'article 51 de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, et compte tenu du nouveau régime, élargi, de la légitime défense qui s'applique aussi aux militaires de l'armée, dans une situation telle que celle du Bataclan le 13 novembre dernier, les militaires seraient-ils aujourd'hui amenés à engager le feu aux côtés des forces de sécurité intérieure ?
La question est très importante et lancinante, les victimes et leurs familles se demandant pourquoi la force Sentinelle, qui était présente, n'a pas participé directement à la neutralisation du terroriste qui se trouvait dans le passage Saint-Pierre-Amelot. La nouvelle doctrine d'emploi apporterait-elle des réponses différentes en matière de collaboration entre les forces de sécurité intérieure et les forces militaires ?
Si les militaires ne sont pas intervenus dans les circonstances que vous évoquez, ce n'est pas pour un motif juridique. Je vais rappeler les faits tels qu'ils m'ont été rapportés par les autorités militaires et dont je n'ai pas de raison de douter.
Dans tous les cas de figure, c'est sur réquisition du préfet de police – approuvée par le ministre de l'intérieur – que se déploient les unités de l'opération Sentinelle. C'est dans ce cadre que certains membres du 1er régiment de chasseurs, se trouvant dans le XIe arrondissement et y percevant une situation anormale, ont pris l'initiative de se mettre à la disposition des forces de sécurité intérieure. Ce groupe de huit militaires a donc rejoint le secteur du Bataclan à vingt-deux heures et est entré immédiatement en contact avec les policiers de la BAC. Tout au long de la soirée, et en étroite coordination avec les forces du ministère de l'intérieur, placés sous l'autorité du préfet de police, nos soldats ont contribué à la sécurisation de la zone en appuyant et en protégeant les interventions des forces de sécurité, mais aussi en portant secours aux victimes.
Il n'y a en effet qu'une chaîne de commandement – hier comme aujourd'hui, comme demain. Dans le cadre d'une opération extérieure, elle est placée sous l'autorité militaire ; à l'intérieur, conformément à la loi, les militaires sont en revanche sous la responsabilité du ministère de l'intérieur.
Quatre soldats ont été positionnés par les forces de police au passage Saint-Pierre-Amelot pour sécuriser les groupes d'intervention spécialisés de la brigade de recherche et l'intervention (BRI). Ils ont reçu l'ordre oral de neutraliser, le cas échéant, un terroriste qui sortirait du Bataclan.
Je réponds à présent plus précisément à votre question sur le refus du « prêt » du FAMAS. Je rappelle très fermement un principe de base : prêter son arme est contraire à tout règlement d'engagement de nos forces en opération. Jamais un soldat engagé sous le feu – et c'était le cas ce soir-là – ne se sépare de son arme, sinon c'est toute sa plus-value militaire qui s'effacerait. J'ajoute que de telles armes automatiques, conçues pour neutraliser un adversaire, ne se manipulent pas aisément – même pour un professionnel des forces de l'ordre – à moins d'être entraîné.
Ensuite, nos militaires ne sont pas intervenus à l'intérieur du Bataclan parce que tels n'étaient pas les ordres donnés par les responsables de la sécurité intérieure ; or, j'y insiste, il ne peut y avoir qu'une seule chaîne de commandement. En outre, ces soldats appartiennent aux forces conventionnelles de l'armée de terre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés aux interventions avec prise d'otages, et c'est encore plus vrai lorsque de telles interventions ne sont en rien anticipées – comme c'est le cas lors des opérations extérieures où les interventions sont exécutées dans le respect des règles de l'emploi de la force pour neutraliser un ennemi repéré, identifié et circonscrit ; contexte dans lequel, souvent, interviennent également des forces spéciales avec l'appui de forces conventionnelles. Ainsi, à Bamako, à Ouagadougou ou à Grand-Bassam, les forces spéciales de l'armée ont été soutenues et sécurisées par des forces plus classiques.
En revanche, nos soldats sont rompus aux missions de contrôle de zone, de sécurisation des périmètres, à l'appui de forces spécialisées, comme je viens de le souligner ; or c'est bien cette mission qui leur a été dévolue ce soir-là par l'autorité compétente, et il importait qu'ils répondent à ses ordres. Aussi étaient-ils en situation, si un terroriste sortait du Bataclan, d'agir sans état d'âme et sans inhibition.

Si, demain, des militaires participant au dispositif Sentinelle étaient amenés à être primo-arrivants sur le théâtre d'une prise d'otages ou d'une tuerie de masse, pourraient-ils être des primo-intervenants ?
Je ne l'exclus pas. Mon seul souci, dans ce type de situation, c'est l'unité de commandement, faute de quoi on risque une très mauvaise gestion de crise.
Ils n'ont pas été requis, mais se sont eux-mêmes rapprochés du lieu, parce qu'ils ont pris contact avec les autorités des forces de sécurité intérieure qui se trouvaient sur place.

Je reviens à ma question : des militaires de l'opération Sentinelle pourraient-ils, le cas échéant, être primo-intervenants ?
Oui, s'ils sont en état de légitime défense…

Non, pas en cas de légitime défense. Par exemple, s'ils patrouillent et voient qu'on exécute des gens…
C'est l'état de nécessité qui, dans ce cas, prévaut, bien sûr. La loi énumère les cas dans lesquels ils interviennent : légitime défense, état de nécessité, périple meurtrier.

Dans des endroits confinés, la question de l'armement se pose : le FAMAS est-il adapté ? Dans un rapport du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), déclassifié à ma demande, daté du 17 février 2016 et portant sur l'engagement des armées sur le territoire national, une réflexion est préconisée, à la page 17, sur le principe d'une double dotation : fusil d'assaut et pistolet automatique. Armer ainsi « systématiquement au moins tous les chefs d'équipe […] offrirait […] une possibilité supplémentaire de graduer une éventuelle riposte ». Quel est l'état de la réflexion du ministère sur cette double dotation ?
Pour les interventions en milieu confiné sur le territoire national et en cas de prise d'otages, il existe des unités très spécialisées, que les soldats de l'opération Sentinelle peuvent appuyer et sécuriser.
En ce qui concerne l'armement, je rappelle un principe majeur : celui d'une seule et même armée. Ce principe est d'autant plus important que, désormais, nous sommes confrontés à des risques de tueries de masse. Nous avons en effet changé de registre, y compris par rapport à l'affaire Merah, puisque nous nous trouvons face à des attaques de type commandos. L'unité des forces armées composées de militaires habitués à intervenir en opérations extérieures et en opérations intérieures contre une menace de plus en plus militarisée est, d'une certaine manière, une bonne chose pour la cohérence de l'action, mais nécessite le maintien du maniement d'armes de guerre. Nous pouvons donc envisager l'hypothèse que vous mentionnez, mais, fondamentalement, le maniement de l'arme de guerre est le même qu'il s'agisse d'opérations extérieures ou d'opérations intérieures, puisqu'il est destiné à sécuriser et à appuyer l'action des unités d'intervention.

Au Bataclan, nous sommes à la fois confrontés à une prise d'otages et à une tuerie de masse, ce qui ne revient pas au même.

Tout à fait. Le rapport que vous nous avez remis sur les Conditions d'emploi des armées lorsqu'elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, précise, pages 30 et 31, concernant les règles d'emploi de la force, que « pour les soldats engagés dans une opération intérieure, si de fortes présomptions permettent d'établir que des vies humaines sont menacées, que la mise à exécution de la menace est imminente et que les moyens de dissuasion mis à la disposition des militaires autres que les armes à feu ont été épuisés ou sont inopérants, il est permis de faire usage des armes à feu dans le cadre de la légitime défense et de l'excuse de nécessité définis aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal ».
Sommes-nous bien d'accord sur le fait que ces conditions d'emploi permettraient aujourd'hui à nos soldats d'intervenir immédiatement dans un contexte de tuerie de masse – afin d'empêcher que de nouvelles personnes ne soient tuées ? Il ne serait donc pas nécessaire d'attendre que le préfet de police, par exemple, donne des instructions ?
L'application du texte que vous venez de citer va dans ce sens, sachant que la légitime défense ne vaut pas que pour soi, mais aussi pour autrui.
Ce qui importe par-dessus tout, vous me pardonnerez de me montrer répétitif, c'est l'unité de la chaîne de commandement, ce qui n'est pas contradictoire avec ce que vous dites, monsieur le député.

Précisément. On a toutefois pu constater en la matière certaines lourdeurs – en l'occurrence policières, certes.
En l'occurrence, la présence de ces huit soldats était, d'une certaine manière, aléatoire. Ils constatent une agitation, se rendent sur place et se mettent immédiatement – avec raison – sous l'autorité de la BAC. C'est leur rôle.

Vous soulignez l'importance, monsieur le ministre, qu'il n'y ait qu'une seule autorité. Cela signifie-t-il donc, par exemple, que des militaires primo-arrivants devraient demander l'autorisation d'intervenir ?
Le texte que vient de citer M. Lamy permet l'intervention des primo-arrivants. Encore une fois, tout dépend des circonstances, je ne peux pas imaginer tous les scénarios. Reste que, aussitôt après une primo-intervention éventuelle, les militaires doivent être placés sous l'autorité de la cellule de crise du ministère de l'intérieur.

Vous avez évoqué, monsieur le ministre, la manoeuvre globale de sécurité intérieure sous l'autorité du ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des préfets. Pourriez-vous nous indiquer comment et pourquoi les réquisitions des soldats de l'opération Sentinelle ont évolué au cours des derniers mois ? Nous sommes passés d'une approche statique à une approche plus dynamique.
L'opération Sentinelle a connu deux temps : la mise en place du contrat opérationnel, puis son approfondissement après le conseil de défense du mois d'avril 2015. Il s'agissait au début de rassurer la population en protégeant certains lieux, ce qui a été réalisé rapidement sur réquisition du préfet de police. Au fur et à mesure que s'étendait la présence des soldats de l'opération Sentinelle en France et plus particulièrement dans la région parisienne, les patrouilles se sont faites plus dynamiques, afin de mieux répondre aux préoccupations de sécurité – même si la population ne l'a peut-être pas perçu immédiatement ainsi – ; en effet, il valait mieux que les soldats patrouillent, sauf exception. Et c'est le cas de 80 % des militaires participant à ce dispositif en région parisienne. Il a fallu du temps et faire preuve de pédagogie, mais cette dynamique correspond beaucoup mieux à la vocation des forces armées et donne à la population un plus grand sentiment de sécurité. L'Euro 2016 fera peser de nombreuses contraintes sur l'organisation que le préfet de police de Paris doit mettre en place, mais on en reviendra ensuite à cette bonne logique.

Quand le dispositif de l'opération Sentinelle s'arrêtera-t-il ? Pouvons-nous nous permettre de mobiliser ainsi autant d'hommes pendant un long temps ? Certes les soldats engagés dans cette mission alterneront missions extérieures et protection de sites, mais ils ont avant tout été formés pour faire la guerre et seraient peut-être utiles à une éventuelle opération extérieure supplémentaire, si l'on ne veut pas dégarnir les opérations extérieures en cours. Où en est la réflexion à ce sujet ? On a un temps évoqué la création d'une garde nationale, l'utilisation de la réserve... Ces forces, qui interviennent en complément des forces de sécurité intérieure, ne pourraient-elles être remplacées, à terme, pour la garde de bâtiments, par des forces plus spécialisées ? Ainsi nos soldats pourraient-ils mieux s'entraîner et participer à des interventions correspondant à leur mission véritable.
Que dit la loi ? Concernant le territoire national, les armées doivent pouvoir mettre en oeuvre un contrat opérationnel qui prévoit la mobilisation, au minimum, de 7 000 hommes en permanence et de 10 000 au plus pour une durée de un mois, contre la menace terroriste. La loi ne prévoit donc pas de terme. Aussi nous faut-il intégrer cette nouvelle donne dans nos dispositifs de formation, de renouvellement et de recrutement. C'est pourquoi la force opérationnelle terrestre va passer de 66 000 à 77 000 hommes. Et, puisque nous devons faire face à ce qu'on peut assimiler à des actes de guerre, il faut que ces militaires agissent à la fois en opérations extérieures (OPEX) et en opérations intérieures (OPINT), et donc qu'ils acquièrent les compétences et les réflexes qui conviennent. Chaque opération intérieure fait l'objet d'une formation spécialisée, même en période de grande tension, comme celle que nous vivons depuis les événements de 2015.
Le recrutement des 11 000 soldats a commencé en 2015 et se poursuit en 2016, si bien que, une fois formés aux actions spécifiques d'OPEX et d'OPINT, on peut considérer qu'on parviendra au niveau normal de la force opérationnelle terrestre à l'été 2017.
Dans le même temps, j'ai décidé de renforcer les réserves qui passeront de 28 000 à 40 000 hommes d'ici à la fin de la LPM, c'est-à-dire d'ici à 2019. À la fin de l'année, sur les 7 000 soldats que comporte au minimum le dispositif Sentinelle, quelque 500 proviendront des réserves, contre moins de 300 au début de l'opération, et j'entends que nous parvenions au chiffre de 1 000 permanents rattachés à des unités. Il s'agit ainsi d'assurer une cohérence plus globale débouchant ensuite, éventuellement, sur une territorialisation. En attendant, nous allons devoir poursuivre nos efforts : discuter avec les organisations professionnelles, avec les collectivités locales pour améliorer le fonctionnement et l'engagement de cette réserve. Bref, le processus est en cours et il est plutôt bien accueilli, et ma volonté en la matière est partagée par le chef d'état-major des armées : nous sommes convaincus que nous atteindrons l'objectif.

La commission d'enquête comprend bien l'utilité des militaires déployés et pas seulement dans une optique statique, puisqu'ils sont susceptibles de se retrouver en situation. Se pose néanmoins à leur égard la question de la formation. Ainsi, le primo-arrivant au Bataclan, et qui y est entré, était un commissaire de police. Imaginons que les primo-arrivants soient des soldats de l'opération Sentinelle. Sont-ils capables d'entrer dans un lieu ? En effet, si, d'habitude, il s'agissait d'abord de fixer les malfaiteurs, puis de laisser agir des équipes spécialisées comme le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), il est ici question, pour le primo-arrivant, d'intervenir directement. Nous avons bien compris que des évolutions étaient en cours concernant les procédures, mais le grand public pourrait trouver surprenant que des hommes lourdement armés se rendent sur un théâtre et s'arrêtent à la porte.
Je veux bien répéter ce que j'ai déjà indiqué : la question, pour moi, n'est pas d'être primo-arrivant, mais d'être primo-compétent. Quand vous vous trouvez dans un lieu clos, à tel moment, il vaut mieux que ce soient des forces spéciales qui interviennent plutôt que l'unité de l'armée de terre qui a une vocation de sécurisation de zone. C'est aussi une question d'appréciation du chef, même s'il est primo-arrivant. Dans le contexte d'une opération extérieure, la question est réglée par le commandement militaire ; dans celui d'une opération intérieure, à moins d'être primo-arrivant, ce sont les forces de sécurité intérieure qui décident.
Le chef local, celui qui se trouve sur place.

Sauf qu'ici il est question du territoire national et que des innocents sont en train de se faire tuer.
C'est à ce moment qu'il faut apprécier si l'unité en question a la capacité d'opérer ou s'il faut attendre du renfort pour agir.

Le commissaire de la BAC qui, lui, est entré au Bataclan avec son arme de poing ne s'est pas posé ce genre de question philosophique. Il s'est dit : je suis policier, j'ai une arme, des gens sont en train de se faire tuer, j'entre. Et, s'il est certain qu'il n'a pas respecté la procédure habituelle, sans doute a-t-il sauvé des vies.

Monsieur le ministre, j'ai beaucoup d'estime pour vous et pour le travail que vous avez accompli au ministère de la défense. Cependant, je suis en désaccord total avec vous, depuis le début, quant à l'utilisation de l'armée pour des missions de contre-terrorisme sur le sol national. Vous faites fausse route. Si le chef d'état-major des armées et si le chef d'état-major des armées de terre vous ont rejoint, c'est pour de tout autres raisons que celles que vous invoquez ici, c'est-à-dire, essentiellement, pour des raisons budgétaires. Au-delà de ces raisons d'opportunité, c'est une faute contre l'armée que de la mobiliser pour des missions de police qui ne correspondent pas à son métier. Vous ne pouvez pas prétendre, comme je l'ai entendu plusieurs fois dans votre bouche, que le soldat qui était hier à Gao, qui est aujourd'hui à Kandahar et qui sera demain en Syrie, pourra aussi s'occuper de la place de la Madeleine ou de la rue des Martyrs. Ce n'est tout simplement pas possible. D'abord, si vous le faites circuler dans les rues de Paris ou de Bordeaux, équipé pour la guerre, vous le privez d'entraînement opérationnel. Ensuite, vous l'affectez à une mission qu'il ne peut pas remplir.
La commission d'enquête revient d'un voyage très instructif en Israël où, je crois, l'on a une certaine expérience de la lutte antiterroriste puisque le terrorisme sévissait dans cette région avant même la naissance de cet État. Qu'y avons-nous constaté ? Que l'armée ne s'occupe pas du tout de la question : ce sont des forces spécialisées de la police, des gardes-frontières qui luttent contre le terrorisme. Les forces militaires, elles, font la guerre. On ne peut pas mélanger les genres. On ne peut pas avoir des soldats pourvus d'armes longues automatiques dans les rues de Paris : ils ne font que servir de cibles. Ils ne sont en outre d'aucune efficacité parce qu'ils ne sont pas formés pour appréhender une situation comme celles que nous évoquons, ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas l'instinct policier. Vous ne pouvez pas demander à un soldat qui, demain, va aller faire la guerre à Gao de faire la police à Roissy – c'est impensable. D'ailleurs, à l'aéroport de Lod, à Tel-Aviv, vous ne verrez pas un seul soldat : les forces de protection sont composées de policiers en civil.
Bref, je le répète, vous faites fausse route. Vous êtes en train d'appauvrir notre armée, de lui donner des missions impossibles. La solution passe par un meilleur entraînement des forces de police de base ; il faut en outre travailler avec des forces dédiées à ce type de mission. Étudiez-vous d'autres hypothèses ou vous enferrez-vous dans le discours selon lequel le même soldat doit accomplir deux missions totalement différentes ?
Nous sommes en effet en désaccord sur ce point. Le contrat opérationnel n'est pas nouveau : il figurait dans tous les livres blancs depuis 1972, et même si, à l'époque, il portait un autre nom, en 2008 on parlait bien de contrat opérationnel.
Je ne vois pas comment les Français pourraient comprendre que nos forces armées interviendraient à Kidal et pas sur le territoire national lorsque celui-ci est victime d'attentats terroristes. D'autre part, pour votre information, les Italiens, les Espagnols, les Britanniques viennent de prendre les mêmes options que nous – certes avec des variantes en matière de réquisition, de mobilisation, de liens avec le ministère de l'intérieur ; mais les options sont identiques. Les Britanniques sont même venus observer chez nous notre manière d'agir – j'ai eu à ce sujet des discussions avec mon homologue Michael Fallon depuis les attentats. Cette posture n'est donc pas propre à la France. Nous venons d'entamer la préparation opérationnelle, mais il y avait urgence ! Qu'auraient dit les Français si nous leur avions répondu que, à cause de la préparation opérationnelle, nous ne pouvions pas assurer la sécurité du territoire national ? S'il est vrai que, en 2015 et 2016, cette préparation a été réduite, elle est de nouveau plus importante, puisque nous avons recruté pour atteindre les objectifs fixés par la loi.
Je sais bien que je ne parviendrai pas à vous convaincre, monsieur Lellouche, mais au moins vous aurai-je donné une explication. N'oubliez pas non plus notre stratégie concernant les réserves et celle de la territorialisation à partir du régiment.

Nous avons passé plus d'une heure sur l'opération Sentinelle. Je vous propose de passer à l'action de nos forces à l'extérieur.

Comment envisagez-vous, monsieur le ministre, l'évolution du coût global des actions antiterroristes dans le Sahel et au Levant ? Pensez-vous que les moyens engagés, à terme, suffiront ? Il va en effet falloir que nous adaptions notre présence et notre action face au terrorisme qui évite le combat et s'étend vers des pays voisins, privilégiant des cibles qui sont pour l'heure peu ou pas défendues. Il va également falloir que nous répondions à l'évolution catastrophique de la région du Sahel : la croissance démographique, l'évolution économique et une certaine forme de radicalisation nous conduisent à revoir nos modes opératoires. De quelle manière anticipez-vous ces questions ?
Par ailleurs, vous avez évoqué le renforcement de la coopération internationale en matière de renseignement, notamment au Levant. Nos alliés américains disposent, avez-vous déclaré au cours de différentes auditions, de nombreuses capacités dans cette zone. Pouvez-vous, ici aussi, nous en dire un peu plus ?

J'en reviens à l'opération Sentinelle sur laquelle, je l'ai dit en séance publique, je reste très réservé en ce qu'elle mobilise nos troupes pour des missions qui devraient être attribuées aux forces de l'ordre et de sécurité : les militaires ont d'autres tâches à accomplir. Toutefois, dans le cadre fixé et que vous venez de rappeler, monsieur le ministre, si des militaires étaient appelés à intervenir davantage en cas d'attentat, de tuerie de masse, quels moyens et quelles dispositions sont prévus en matière de préparation, d'entraînement, pour éviter des dommages collatéraux qui pourraient être très lourds ? Quelles modalités nouvelles peuvent être prises en termes de coordination ? Quid de l'unité de commandement si les militaires sont primo-arrivants ? Comment les acteurs coordonnent-ils leur action ?
Du point de vue de la préparation militaire à ces nouvelles missions dévolues au dispositif Sentinelle, j'ai lu dans la presse que vous aviez mené une opération expérimentale d'entraînement en Isère. Préfigure-t-elle une évolution de doctrine qui consisterait à définir les conditions d'une intervention plus importante des forces armées en cas de nouvel attentat ?

Les forces armées ont une obligation de résultat : celle de remplir le contrat opérationnel si les autorités politiques – en l'occurrence le Président de la République – le demandent.
La présente commission d'enquête a en particulier pour vocation de faire des propositions à court, moyen et long terme. Seriez-vous opposé, à terme, à une montée en puissance des forces de sécurité intérieure de façon à réserver, précisément, la mise en oeuvre du contrat opérationnel pour des opérations ponctuelles ? On pourrait dès lors très bien comprendre que, dans le contexte de grandes manifestations comme l'Euro 2016, un sommet de chefs d'État, le tour de France, on mobilise 7 000, voire 10 000 hommes, de façon à assurer la sécurité des opérations et celle des frontières.

Pensez-vous, monsieur le ministre, que le cadre juridique d'intervention des services de renseignement est désormais stabilisé ? Nous y avons beaucoup travaillé ces dernières années. Or il ressort de diverses auditions que certains services s'interrogent sur leur incompétence lorsqu'une matière est judiciarisée : le directeur général de la sécurité extérieure (DGSE) nous a lui-même indiqué qu'il s'interrogeait sur sa capacité d'intervention lorsqu'une personne était mise en examen. En effet, le respect des droits de la défense s'oppose à ce que les services de renseignement « tracent » un individu faisant l'objet d'une procédure judiciaire. Aussi nous interrogeons-nous sur le cadre juridique en vigueur et sur l'éventuelle nécessité de créer un régime permettant aux services de renseignement d'entrer dans cette matière.

Cette question relève plus spécifiquement des procédures judiciaires et du garde des sceaux, auquel nous avons posé la question tout à l'heure. La demande vient néanmoins, également, de la DGSE qui se trouve là face à un obstacle juridique de nature à constituer un frein au renseignement.
Mme Dumas m'a interrogé sur les coûts. L'actualisation de la loi de programmation militaire a permis une augmentation, sur l'ensemble de l'exercice, de 3,8 milliards d'euros. Ensuite, le surcoût, pour l'année 2015, des opérations intérieures a été de 174 millions d'euros et de 650 plus 450 millions d'euros pour les opérations extérieures. Ce surcoût a été entièrement couvert par le dispositif de mutualisation applicable en fin d'exercice. Nous avons aujourd'hui les moyens de remplir les engagements prévus par la première actualisation de la LPM et les moyens de respecter la décision prise par la suite de renoncer à toute forme de déflation des effectifs militaires.
Pour répondre aux questions de M. Laurent et de M. Lamy sur l'opération Sentinelle, je répète qu'une préparation systématique des unités destinées aux opérations intérieures est prévue : préparation au combat, à la maîtrise, au sang-froid, à l'usage de l'arme…
Pour ce qui est de la coordination : il s'agissait de la première opération aussi massive ; aussi nous a-t-il fallu organiser en des matières aussi concrètes que le logement et la nourriture, mais aussi harmoniser le commandement. J'ai pu observer que, en région parisienne, à la relation directe entre le gouverneur militaire et le préfet de police, se sont ajoutées des relations d'échanges du commandement beaucoup plus proches du terrain. À Paris, nous avons divisé l'opération Sentinelle en trois groupements tactiques afin d'obtenir une bien meilleure opérabilité. Chaque groupement est commandé par un colonel représentant généralement l'unité la plus nombreuse sur le territoire concerné, ce qui rend beaucoup plus facile l'acte de commandement. Le groupement étant en relation avec les autorités des forces de sécurité intérieure voisines, tous se voient régulièrement et, de ce fait, leur complémentarité est particulièrement efficace, s'inscrivant dans la dynamique déjà évoquée.
Monsieur Lamy, la loi prévoit que 7 000 soldats sont mobilisables en permanence et 10 000 pour un mois. Il est évident qu'ils ne sont mobilisés qu'en cas de menace. L'Euro 2016 figurait parmi vos exemples ; je choisirais plutôt pour ma part le risque d'un attentat pouvant nous conduire, pour assurer la sécurité, à mobiliser les 7 000 soldats prévus, ou 5 000 si la menace est moindre. Il ne s'agit donc pas d'une force de présence permanente.
Monsieur Larrivé, aucun écho ne m'est pour l'heure parvenu de la DGSE, ni de la DRM, ni de la DPSD. Au contraire, le cadre juridique en vigueur – à l'élaboration duquel vous avez contribué – nous convient assez bien. Il faut attendre que l'ensemble des procédures se mette en place afin que nous en vérifiions la réalité et l'efficacité. En tout cas, pour l'instant, nous avons singulièrement progressé. Je suis convaincu que plusieurs des attentats qui ont été déjoués n'auraient pas pu l'être si l'on n'avait pas appliqué certains des dispositifs prévus par la loi relative au renseignement.
Pour ce qui concerne l'opération Minerve, qui s'est déroulée fin avril dans la région de Grenoble, elle nous a permis de vérifier l'efficacité d'un engagement coordonné de l'armée de terre et de la gendarmerie en vue d'une manoeuvre de sécurité publique. Nous avons ainsi pu élaborer des procédures et des modes d'action en commun et élaborer les modalités de la préparation opérationnelle. Ce dispositif, utile, sera sans doute suivi d'effet. Cette opération a montré en tout cas l'agilité, la réactivité de nos forces et notre capacité à travailler ensemble.
L'opération Chammal, au Levant, a commencé le 19 septembre 2014 – soit avant les attentats – à la demande du gouvernement irakien. Notre dispositif comprend des moyens aériens comme des moyens maritimes, des instructeurs présents en Irak au profit des forces de sécurité irakiennes et des peshmergas. La coalition qui organise l'intervention en Irak a été formée au moment du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à Newport, également en septembre 2014.
Après les attentats du 7 janvier 2015, le groupe aéronaval, avec le Charles de Gaulle, a été déployé du 23 février au 17 avril dans le golfe arabo-persique. Avec une trentaine d'aéronefs à bord, sa présence a multiplié par trois le dispositif aérien français engagé au Levant. Puis, avec l'accumulation de renseignements sur les filières djihadistes au départ de Syrie et à destination de la France, le Président de la République a pris la décision, au début du mois de septembre 2015, d'autoriser les vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie, et, trois semaines plus tard, d'y autoriser les frappes.
Après les attaques du 13 novembre 2015, le Président de la République a donné l'ordre d'intensifier les frappes et de planifier, au sein de la coalition, des interventions notamment sur Mossoul et Raqqa en vue d'éradiquer progressivement Daech. Cela s'est traduit, en particulier pour nos propres forces, par le retour du groupe aéronaval dans le Golfe arabo-persique, du mois de novembre 2015 au mois de février 2016. Lors de cette mission, nos avions ont effectué un total de 532 sorties et jusqu'à 18 par jour durant les phases d'intensification, pour un total de 102 frappes en Irak et en Syrie contre Daech, et une trentaine de missions de reconnaissance qui ont permis la constitution de 1 000 dossiers de renseignement au profit de la coalition.
J'appelle votre attention sur le fait que la France est le seul pays, avec les États-Unis, à déployer la totalité des moyens nécessaires aux opérations de la coalition en Irak, puisque nous disposons à la fois de moyens aériens, de moyens maritimes, de moyens de renseignement et des outils de formation des forces irakiennes ou des forces peshmergas.
C'est sans doute la première fois que je le dis ainsi, car je suis d'un naturel prudent, mais je considère aujourd'hui que Daech est nettement sur le recul. Nous menons en ce moment une opération à Falloujah, ville située au bord de l'Euphrate à cinquante kilomètres au sud-ouest de Bagdad, et qui devrait tomber après des combats qui risquent d'être assez durs. Or je rappelle qu'il s'agissait de la première ville prise par Daech : c'est dire l'importance symbolique de l'action en cours. Le régiment le plus performant de l'armée irakienne – formé dans la banlieue de Bagdad par des instructeurs français –, l'Iraqi ounter-Terrorism Service (ICTS), est à la manoeuvre. Cette unité, forte de différents appuis, devrait reprendre Falloujah.
Au Nord de l'Irak, nous sommes en train de préparer l'attaque de Mossoul. Les combats visant à reprendre Qayyarah se déroulent en ce moment et mettent les peshmergas – avec la formation et l'appui, entre autres, de militaires français – directement aux prises avec Daech. J'ai eu l'occasion d'aller sur le front, il y a très peu de temps, pour me rendre compte de cette action déterminante. Daech recule d'autant plus que les frappes successives effectuées par la coalition commencent à toucher cette organisation au coeur, en particulier ses ressources pétrolières et les centres de raffinerie qu'elle pouvait contrôler et dont les revenus permettaient de payer les combattants étrangers. J'ai été surpris de constater, lors de mon dernier déplacement, que mes interlocuteurs évoquent déjà l'après-Daech. Or ces préoccupations sont nouvelles. En Irak, Daech a perdu à peu près 40 % de son territoire, et ce mouvement se poursuit.
En Syrie, la situation est plus complexe. Une action significative est menée en ce moment même sur Raqqa ; les opérations se déroulent plutôt bien, même si la ville ne devrait pas être prise immédiatement. Je rappelle au passage que ces reconquêtes ne sont pas simples : Mossoul compte tout de même 2 millions d'habitants et Raqqa 300 000 – avec de nombreux combattants français. Raqqa est le lieu de formation de tous les groupes terroristes qui peuvent intervenir à partir de la Syrie. Les forces démocratiques syriennes (FDS) ont tout récemment engagé une opération contre cette ville.
J'appelle particulièrement votre attention sur la zone de Manbij. Deux zones kurdes forment la frontière avec la Turquie ; l'une, assez longue, s'étend vers l'Est et rejoint le Kurdistan irakien, l'autre, plus courte, court vers l'Ouest. Des opérations ont commencé avant-hier dans le secteur de Manbij – où se trouvent de nombreux combattants étrangers, dont des Français –, point central pour fermer le corridor qui mène vers la Turquie. Si les forces démocratiques syriennes, à la fois arabes et kurdes, arrivent à prendre l'ensemble de ce corridor, la frontière sera entièrement fermée.
Grâce aux actions simultanées sur Raqqa, sur Mossoul et sur Falloujah, à quoi il faut ajouter désormais celle menée sur Manbij, grâce à la présence russe à Palmyre, Daech sera complètement encerclée, ce qui provoquera des événements intéressants. Pour la première fois, mon regard est relativement optimiste concernant le Levant.

Merci, monsieur le ministre, de nous apporter la primeur de ces éléments d'information, car nous ignorions l'état d'avancée de nos forces dans les zones que vous avez mentionnées et qui peut en effet laisser espérer tôt ou tard la chute de Daech.
Je prends néanmoins des précautions. Je donne d'ordinaire ce genre d'informations aux commissions de la défense de l'Assemblée et du Sénat, généralement à huis clos. Même si la présente audition ne se déroule pas à huis clos, je puis néanmoins me permettre de me montrer, pour la première fois, relativement positif concernant la suite. Cela ne signifie pas que nous devions relâcher notre effort, au contraire, car, quand Daech se sentira acculé, ses réactions risquent d'être encore plus fortes et la pacification ne sera donc pas immédiate. Mais tel est le sens dans lequel évolue la situation, avec une diminution du nombre de combattants étrangers – dont on évaluait le nombre, dans cette zone, à 15 000, alors qu'ils ne seraient plus désormais qu'environ 12 000 sur quelque 35 000 combattants.
J'en viens à la situation en Libye. Ce territoire sans État unifié est le point de convergence de nombreux problèmes : il est à la fois une zone refuge pour les groupes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) au Sahel, une zone de déploiement de Daech – à Syrte notamment –, une zone de trafics et le point de passage des migrations. Il faut savoir que la présence de Daech dans la région de Syrte est significative, à raison de 3 500, voire 4 000 combattants, qui pour la plupart ne sont pas passés par le Levant et qui n'étaient pas là il y a un an et demi.
En outre, la situation politique est compliquée. La communauté internationale a désigné M. El-Sarraj comme premier ministre. Celui-ci a eu le courage de s'installer à Tripoli, mais il peine à unifier politiquement le territoire puisque le parlement officiel de Tobrouk n'a toujours pas investi le gouvernement d'union nationale. La communauté internationale soutient l'initiative, notamment en la personne du représentant de Ban Ki-moon, M. Kobler, avec qui j'ai d'ailleurs pu m'entretenir de la situation hier à Paris. La difficulté est la lenteur avec laquelle M. El-Sarraj avance depuis qu'il s'est installé à Tripoli, cependant que des combats ont lieu à l'Est impliquant les forces du général Haftar, soutenu par l'Égypte et par les Émirats, forces qui sont en train de reprendre Benghazi à Daech et d'engager une offensive par le Sud-Est sur le territoire pour l'heure tenu par cette organisation ; tandis que, de l'autre côté, les milices de Misrata ont entamé elles aussi une action militaire contre Daech. Il n'est pas aisé de coordonner l'action de ces forces qui ont le même adversaire, d'autant qu'entre celles de Haftar et celles de Misrata, on note des tensions, voire des échanges de feu.
Notre objectif est le rétablissement de l'État libyen, de sensibiliser tous nos partenaires pour que le premier ministre ait l'autorité nécessaire pour coordonner l'action de son pays, en particulier sur le plan militaire. Ensuite, il nous faut contenir Daech en soutenant les efforts de contre-terrorisme de l'Égypte et de la Tunisie en particulier. Enfin, nous devons tâcher d'empêcher les migrations à risque – il ne faudrait pas que ces migrations permettent à Daech de se reconstituer militairement et financièrement. Si elle devenait opérationnelle, la mission Sophia, diligentée par l'Union européenne, constituerait un bon moyen d'enrayer ce processus. L'inquiétude est donc plus marquée dans cette région, mais des solutions pourraient se profiler si, d'aventure, l'autorité de M. El-Sarraj était respectée et reconnue, et si les efforts menés par les uns et les autres à cette fin étaient couronnés de succès.

Merci, monsieur le ministre, pour ces informations importantes et qui laissent un espoir, même si, comme vous l'avez souligné, il convient de continuer de faire preuve de prudence.
Tout au long de nos travaux, nous nous sommes demandé pourquoi les troupes occidentales ou, parmi elles, les troupes françaises, n'intervenaient pas au sol.

Vous avez indiqué que Daech avait perdu 40 % du territoire qu'elle avait conquis en Irak. Avez-vous les chiffres concernant la Syrie, où l'on évoque 15 à 20 % de perte ?
Ni le président ni moi-même ne sommes membres de la commission de la défense. Les informations que vous nous avez données sur l'Irak et la Syrie sont encourageantes, mais pensez-vous que les frappes aériennes sont suffisantes pour éradiquer Daech ? Ne va-t-il pas falloir, à un moment ou à un autre, aller au sol ? C'est toute la complexité géopolitique de cette intervention… Si toutefois nous en restons aux frappes aériennes, à quelle échéance pensez-vous que nous viendrons à bout de Daech ? Vous avez en effet mentionné que, plus Daech va être acculé, plus cette organisation risque de frapper notre territoire.
Ensuite, des frappes sont-elles envisagées en Libye ? Comment nous préparons-nous pour faire face à l'inquiétude dont vous avez fait part à la fin de votre propos ?
Enfin, je souhaite connaître votre sentiment sur le fonctionnement de la cellule Hermès : est-il optimal, au bout d'un peu plus d'un an, ou existe-t-il encore des marges de progression ?

Je souhaite vous interroger sur le traitement réservé à ceux qu'on n'appellera pas « soldats », mais « terroristes armés ». Dès lors qu'on ne considère pas ces combattants comme formant une armée régulière, sont-ils déférés vers d'autres services, sont-ils appréhendés par nos militaires comme des soldats, bien que nous les considérions comme des terroristes ?
Je commencerai par répondre à cette dernière question. Il y a un droit international et, lorsque des terroristes sont capturés par nos forces, ils sont remis aux autorités locales : ils sont faits prisonniers et sont transférés aux tribunaux locaux. Le seul cas connu est celui du Mali où le président est élu au suffrage universel et où la justice fonctionne, malgré, parfois, des délais. Je me suis moi-même rendu compte de la situation en allant à Gao où étaient emprisonnés provisoirement les intéressés et pour m'assurer qu'ils seraient bien transférés aux instances concernées.
J'en profite pour répondre à une question qui ne m'a pas été posée. J'ai souvent lu que nous essayions de prendre des combattants français pour cibles, au cours de nos interventions aériennes, soit à Raqqa, soit dans la zone de Manbij. Non. Il n'y a pas d'identification préalable : nous frappons l'ennemi qui est Daech et dont les combattants sont de toutes les origines.
Je n'affirme pas que Daech sera bientôt éradiquée – la suite sera même compliquée ; reste que, depuis trois semaines, la conjonction des événements nous pousse à un certain optimisme.
J'en viens à la question du rapporteur : il ne faut pas envoyer de soldats au sol, ni en Libye ni au Levant. Notre rôle est de faire en sorte que les territoires concernés disposent de forces que nous formons, que nous aidons à manoeuvrer, auxquelles nous livrons éventuellement du matériel ; de faire en sorte que ces territoires se libèrent par eux-mêmes. Le précédent en Irak n'a en effet pas donné de bons résultats et, si nous nous substituions aux forces locales, ce serait ingérable. Aussi nous revient-il de former les forces locales et, par des frappes, non seulement d'accompagner leurs opérations, mais aussi d'agir préventivement en détruisant des centres de commandement, des centres d'entraînement, des lieux de ressource – si bien que Daech en vient, si vous avez lu les dernières dépêches, à anticiper ses propres difficultés dans ses déclarations publiques, ce qui est une grande nouveauté.
Il convient, en Syrie, de renforcer les frappes et l'accompagnement. En Libye, nous faisons d'abord du renseignement ; ensuite, nous avons pour tâche de répondre à ce que le premier ministre El-Sarraj demande à la communauté internationale, qu'il s'agisse de sa sécurité ou de la formation de ses troupes ; enfin, les Nations-Unies doivent pouvoir réagir assez rapidement à une proposition en cours de discussion au sein du Conseil de sécurité, proposition lancée par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni – qui est à la manoeuvre –, visant à faire en sorte que l'opération Sophia, qui vise à interdire le trafic d'armes et à empêcher les passeurs de faire leur commerce en Méditerranée, soit possible. Nous sommes prêts, à cette fin, à engager des bâtiments. J'ajoute qu'en Libye a cours un trafic d'armes très important qui traverse la Méditerranée et que nous devons enrayer. Là non plus notre présence au sol n'est pas la bonne solution. À la différence de la Syrie et de l'Irak, nous avons affaire, en Libye, à un gouvernement reconnu, que nous souhaitons renforcer et qui peut du reste faire état lui-même de demandes particulières pour assurer son autorité.
En ce qui concerne l'opération Hermès, elle fonctionne bien. L'ensemble de nos services se retrouvent pour obtenir des informations en temps réel. Cette expérience très utile n'avait encore jamais été menée. J'ai eu l'occasion de me rendre sur place à plusieurs reprises pour voir comment les opérations se déroulaient, et j'ai pu constater qu'il s'agissait d'un très bon système. Une autre cellule de fusion de services de renseignement – DGSE, DGSI et autres –, la cellule Allat, fonctionne elle aussi très bien. Le travail entre services de renseignement est difficile parce que chacun a son pré carré, ses réseaux, ses compétences, mais, pour ce qui me concerne, j'ai constaté la bonne coordination des trois services de renseignement qui dépendent de mon autorité, la nouveauté étant l'élargissement de la coopération aux autres services de renseignement, qui, honnêtement, se passe de mieux en mieux.
J'ajouterai, pour ce qui est des relations avec les autres pays en matière de renseignement, que, très vite après les attentats, nous avons passé un accord avec les États-Unis. Je puis affirmer qu'aujourd'hui règne une vraie transparence, comme jamais auparavant, à la fois dans le domaine du renseignement, mais aussi dans le domaine militaire. J'ai pu moi-même le constater en me rendant dans les salles d'opération.

On a le sentiment d'une rivalité accrue entre Al-Qaïda et Daech. Dès lors, Al-Qaïda – et AQMI en particulier – représente-t-elle pour vous une inquiétude grandissante ? Les intérêts français à l'étranger sont-ils davantage menacés ? AQMI sera-t-elle, à terme, selon vous, capable de frapper notre territoire ?
Il faut être très vigilant. On parle plus souvent de Daech que d'Al-Qaïda ; or cette dernière est présente en Syrie par le biais de Jabhat al-Nosra. Il ne faudrait pas que le retrait de Daech, qu'on sent poindre, suscite des allégeances à AQMI de la part de groupes qui retrouveraient un autre destin. Al-Qaïda est présente au Mali de manière significative. Ce réseau a été très touché par nos opérations.
Reste que, par rapport à celle de 2013, la situation est très différente. En 2013, il s'agissait d'une opération visant à transformer un État en sanctuaire terroriste, notamment par le regroupement de katibat. Grâce à l'opération Serval, cette stratégie a échoué, permettant la restauration de la démocratie et l'organisation d'élections. Néanmoins, les terroristes ont changé de posture et nous avons désormais affaire à des groupes plus petits, moins militarisés – contrairement à Daech – et pratiquant un terrorisme « classique » avec l'emploi de kamikazes. Les attentats de Bamako, Ouagadougou et Grand-Bassam, avec l'utilisation régulière d'engins explosifs improvisés (EEI) contre nos propres forces – trois de nos soldats en sont morts récemment –, ont montré que la pratique avait changé, une pratique en outre beaucoup plus difficile à repérer.
Dans le cadre de l'opération Barkhane, nous avons coordonné nos actions contre le terrorisme avec les pays du G5 Sahel – Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Face à ce nouveau risque, nous devons maintenir un effort militaire singulier pour empêcher que cette logique ne produise des effets aussi insupportables que ceux produits par Daech.
Il convient par ailleurs que les autorités politiques maliennes fassent en sorte que les accords politiques d'Alger qui concernent en particulier les groupes armés signataires, à savoir les combattants non terroristes, soient respectés de part et d'autre. Il s'agit notamment de hâter la mise en place de l'opération « Désarmement, démobilisation, réintégration » (DDR). Nous appelons en permanence les parties à y oeuvrer, faute de quoi on court le risque d'une porosité entre les groupes armés signataires et les groupes armés terroristes chapeautés essentiellement par le groupe Al-Mourabitoune, dirigé par un Algérien résidant en Libye, Mokhtar Belmokhtar, et qui est en train, avec Iyad Ag Ghali, de reprendre une forme de coopération qui ne me paraît pas des plus encourageantes – aussi mon sentiment sur cette situation-ci est-il plus négatif.

Nous tenons vraiment, monsieur le ministre, à vous remercier de nous avoir consacré du temps, de nous avoir donné toutes ces informations qui seront utiles à notre commission d'enquête.
Je tiens par ailleurs à vous faire part de l'hommage de la commission à nos troupes pour leur travail remarquable.
La séance est levée à 20 heures 10.