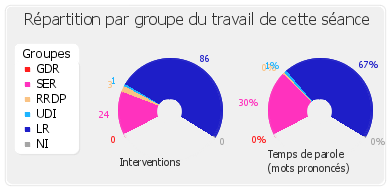Séance en hémicycle du 10 mars 2015 à 21h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.


Cet après-midi, l’Assemblée a commencé d’entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.
Je vous informe qu’à la demande de la commission, les amendements nos 685 , 404 , 560 et identiques, et 825, portant articles additionnels après l’article 3, seront examinés demain dès la reprise de la séance à l’issue des questions au Gouvernement. Nous reprendrons ensuite le cours normal de nos travaux.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Bernadette Laclais.

Madame la présidente, madame la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, messieurs les rapporteurs, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chers collègues, comment aborder la fin de vie alors que chacun d’entre nous qui en parle ne l’a pas, par essence, vécue jusqu’au bout ? Mais nous en avons souvent fait l’expérience, aux côtés des proches, la redoutant pour eux comme pour nous-mêmes. C’est une expérience personnelle intime qui peut modifier notre regard et, en tant que parlementaires, nous devons la dépasser.
Les différentes représentations sociales et culturelles de la fin de vie montrent à quel point l’appréhension peut en être multiple et complexe. Elles traduisent notre conception de la vie et des valeurs qui sous-tendent notre société. Nous devons aborder ce sujet avec modestie, humilité, dans la complexité des différents parcours de vie, dans la diversité et surtout le respect des prises de position et des convictions des uns et des autres.
Nous n’avons pas à commenter, et encore moins à caricaturer, des positions qui peuvent nous paraître excessives ou timorées. Chaque avis mérite écoute et échanges. Je m’étonne cependant que certains considèrent que ce texte n’apporte rien alors qu’il contient au contraire des avancées indéniables, mais mesurées. Nous pouvons remercier les rapporteurs, car chaque terme a été pesé et soupesé.
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis 1999, avec la loi de 2002, puis celle de 2005. Mais il demeure dans notre pays une insupportable distorsion entre les textes et la réalité, et le phénomène prend de l’ampleur : une personne sur trois, en France, traverse une fin de vie dans la souffrance et ne bénéficie d’aucun traitement sédatif ou antalgique.
Force est de reconnaître que les inégalités face à la fin de vie reflètent les inégalités sociales et les inégalités territoriales du pays. Chacun pressent bien qu’une nouvelle étape doit être franchie.
Devant cette situation, le Président de la République a fait le choix, que je salue, d’un débat approfondi et de la recherche d’un rassemblement sur un sujet pour lequel nos concitoyens attendent que nous mesurions nos propos et que nous ne donnions pas l’image d’une assemblée déchirée. Nous sommes, je le crois, à la hauteur de cette attente.
Je veux donc remercier nos deux collègues, Alain Claeys et Jean Leonetti, pour avoir recherché dans leur proposition les points d’équilibre et de rassemblement, sans avoir jamais renoncé à faire avancer l’égalité pour un droit à mourir dignement et avec la volonté de ne renoncer ni à leur personnalité ni à ce qu’ils sont.
Votre proposition de loi a plusieurs mérites et permet d’enregistrer deux avancées majeures. Elle place tout d’abord le patient au coeur du dispositif. Nos concitoyens, en effet, veulent être entendus, ils ne veulent pas souffrir, ils veulent une fin de vie apaisée. La proposition de loi avance sur ces trois points. Elle renforce la valeur des directives anticipées et la place de la personne de confiance, elle admet aussi une sédation profonde et continue jusqu’au décès, qui permet de soulager sans chercher à hâter la fin.
Cette disposition serait-elle une hypocrisie du législateur ou encore une fuite du soignant voulant éviter l’accompagnement du mourant ? Non bien sûr. Ce doit être le fruit d’une réflexion et d’une décision communes, et un aboutissement lorsque tous les traitements et les soins palliatifs ne peuvent plus soulager la douleur physique et la souffrance psychique, jugées insupportables. Le même droit est reconnu aux malades hors d’état de manifester leur volonté lorsqu’ils ont exprimé cette demande dans leurs directives anticipées.
Nos débats au cours de ces dernières semaines ont bien mis en évidence la nécessité de renforcer les soins palliatifs, tant au sein des établissements de santé et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD – qu’à domicile, et de développer la formation des soignants. Sur ces deux sujets, madame la ministre, vous nous avez assurés de votre volonté d’avancer. Je suis donc certaine que vous serez attentive à nos amendements et je vous en remercie.
Les soins palliatifs sont là, bien sûr, pour soulager la souffrance, mais sont aussi pour les malades un changement de regard sur la dignité de leur propre fin. Chacun d’entre nous, sur ces sujets, s’exprimera en conscience. Chacun d’entre nous a le droit, et sans doute même le devoir, de douter. Il est normal que ce texte soit débattu. J’entends ceux qui voudraient que nous allions plus loin et, au nom de la liberté, demandent de choisir le moment où ils partiront, mais j’entends aussi ceux pour qui la liberté est de pouvoir changer d’avis, partir entourés d’affection, délivrés de la souffrance physique et qui souhaitent que la mort survienne sans que personne ne le décide à leur place, au moment où elle doit intervenir, sans intervention d’un tiers.
Le présent texte garantit la protection des plus fragiles, des plus vulnérables, et prévient tout risque d’excès dont on ne peut jamais dire à l’avance qu’il existe ou n’existerait pas.
Pour toutes ces raisons, je souscris à cette proposition de loi, en espérant que le débat nous permette encore de l’améliorer mais sans la dénaturer, parce que je crois qu’elle peut constituer le point de rassemblement que nous pouvons espérer et que nous devons rechercher sur un tel sujet.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, penser la fin de vie nous amène à la redoutable question du rapport de l’homme à la souffrance et à la douleur, pour soi et pour autrui. Que de questions sur le sens de la vie et de la mort ! La fin de vie est un temps hors du temps qui n’a plus de mesure, trop court pour certains, car on ne veut pas se séparer, trop long pour d’autres puisque la mort est certaine et qu’il faut en finir. La question de sens ou de l’absence de sens de ces derniers moments de vie nous interpelle. Il n’y a pas d’idéal de bonne mort car chaque mort est unique, qu’elle soit paisible, ou dans la douleur et l’angoisse.
Nos concitoyens expriment de plus en plus souvent la volonté d’être maîtres de leur vie et de leur mort, et déplorent une mort de moins en moins humaine, de plus en plus distante, loin de chez soi, loin des siens, à l’hôpital le plus souvent. Ils veulent être entendus et vivre leur fin de vie dans la dignité.
La loi Leonetti du 22 avril 2005 interdit à juste raison toute obstination déraisonnable et respecte le double objectif de "non-abandon" et de "non-souffrance", qui est au coeur de la problématique de la demande de mort. Votre texte, chers MM. Claeys et Leonetti, affirme que dans les moments les plus difficiles, la qualité de vie, oserais-je dire la qualité de mort, prime sur la durée de vie.
On pouvait penser que la médecine palliative, une médecine comme les autres, avec les mêmes critères, l’excellence, la compétence, l’efficacité, prendrait le relais de la médecine curative. Quelle déception !
Nous attendions que les soins palliatifs se développent, mais depuis 2012, il n’y a pas de nouveau plan. Seules 20 % des personnes concernées peuvent y accéder. Les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, les lits identifiés de soins palliatifs dans nos hôpitaux sont insuffisants et les inégalités sociales et territoriales sont criantes.
Les soins palliatifs sont particulièrement importants car ils visent non seulement à soulager la douleur, à apaiser la souffrance physique, mais prennent aussi en compte la souffrance psychologique, sociale, spirituelle, et permettent de soutenir les familles. Je rends d’ailleurs hommage à tous les professionnels de santé, aux bénévoles qui accompagnent les malades et font oeuvre admirable d’humanité et de fraternité.
Une nouvelle loi n’a de sens aujourd’hui que si nous développons les soins palliatifs dans les hôpitaux et les EHPAD et la formation des médecins et des soignants, si nous aidons mieux celles et ceux qui veulent accompagner leurs proches en fin de vie.

J’insisterai d’ailleurs sur l’hospitalisation à domicile, un formidable outil pour accompagner les personnes jusqu’à la fin de leur vie puisque 81 % des Français veulent passer leurs derniers instants chez eux. Faisons-en une priorité nationale, décidons sans attendre des objectifs et donnons-nous les moyens de les atteindre, madame la ministre, car nous avons un grand défi à relever.
Le texte de 2005 mettait l’accent sur le devoir des médecins envers les malades et la présente proposition de loi donne aujourd’hui de nouveaux droits aux malades. Les professionnels de santé en sont les garants mais le périmètre de ces droits demeure toutefois incertain. Comment définir les mots « dignité » et « apaisement » ? Peuvent-ils tout justifier ? Certainement pas. Et dans quelles conditions ?
Quant aux directives anticipées, elles permettront au malade de préciser sa volonté sur sa fin de vie, prévoyant le cas où il ne serait plus capable de s’exprimer. Ce n’est donc plus un souhait, mais désormais une volonté contraignante pour le médecin. Encore faut-il que ces directives ne privent pas la personne d’une chance d’améliorer un jour son état de santé. Ne faudrait-il pas d’ailleurs leur fixer un temps de validité, afin que chacun soit obligé de se reposer au cours de sa vie un certain nombre de questions avant de renouveler sa volonté ? Je crois sur ce sujet beaucoup au pacte de confiance qui lie le médecin et le patient. Le dialogue et la concertation sont indispensables. J’attache aussi beaucoup d’importance au statut du témoignage de la personne de confiance et de la famille. La mort doit être un moment qu’il faut préparer, puis vivre et partager avec ses proches.
Vous créez un droit à la sédation profonde jusqu’au décès, avec pour but de soulager le malade en situation de souffrance insupportable, en phase avancée ou terminale. Une telle disposition appelle toutefois à la vigilance dans sa mise en oeuvre.
On peut aussi s’interroger sur l’article 3 du texte et cette phrase : « À la demande du patient (…) de ne pas prolonger inutilement sa vie ». Comment définir ce mot « inutilement » ? Comment juger si une vie est utile, et jusqu’où ? L’utilité d’une vie est-elle le critère de dignité de la vie humaine ?
On peut aussi s’interroger sur l’alimentation et l’hydratation, qui constituent dans ce texte un traitement. Un débat peut avoir lieu sur ce sujet.
Gardons, chers collègues, la volonté de respecter l’équilibre trouvé dans ce texte. N’allons pas vers une aide médicalisée active à mourir et regardons les dérives qui se produisent en Belgique et aux Pays-Bas. La promotion du suicide assisté comme de l’euthanasie n’est pas souhaitable. Elle introduirait une confusion dangereuse entre soigner et faire mourir, contraire à la déontologie médicale. Il deviendrait alors incohérent de réanimer dans les services d’urgence les personnes qui ont tenté de mettre fin à leur vie, et on pourrait craindre que cette évolution conduise à éliminer avec leur consentement les personnes les plus fragiles.
Notre responsabilité est extrême, chers collègues. Nous sommes tous marqués par la mort d’un proche, d’un ami, que nous avons accompagné. Il est légitime que nous ayons des visions différentes de la mort, mais restons fidèles aux valeurs que porte ce texte, celles qui peuvent réunir plutôt que diviser, en affirmant ce droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir, et ce droit donné à chacun d’être respecté dans ses volontés.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP et du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, avec la proposition de loi présentée par Alain Claeys et Jean Leonetti, nous sommes amenés à nous prononcer sur une question de société. Comment notre société traite-t-elle les personnes en fin de vie ? Quels droits garantit-elle aux malades ? Mais bien au-delà d’une question de société, c’est une épreuve personnelle à laquelle chacun sera confronté dans sa vie, qu’il s’agisse de lui-même, de sa famille ou de ses amis.
C’est un fait : s’il est question de choix de société, il est aussi question d’intime et d’inconnu. Personne ne peut avoir de certitude inébranlable avant d’affronter la fin de sa vie. Personne ne peut planifier froidement le moment où ses derniers contacts avec l’autre seront conjugués et subordonnés à la souffrance.
Parce qu’il s’agit d’une épreuve face à laquelle chacune et chacun d’entre nous réagit à sa manière, nos concitoyens n’attendent pas de nous un choc exacerbé entre deux positions qui seraient caricaturales : d’une part, ceux qui voudraient médicaliser et légaliser un droit au suicide et d’autre part ceux qui voudraient que la vie ne tienne aucun compte de souffrances insupportables. Ce que nos concitoyens attendent, c’est que nous leur apportions de nouvelles garanties contre des conditions de fin de vie trop souvent inhumaines.
La première garantie, c’est le développement et l’égalité d’accès aux soins palliatifs.

La fin de vie est en soi une épreuve suffisamment difficile pour qu’elle ne soit pas alourdie par le mal mourir. Le développement de la médecine ne doit pas être destiné à accroître le nombre de jours de souffrance. Mais il ne doit pas non plus amputer la personne malade de derniers instants, lorsque ceux-ci peuvent être apaisés.
La seconde garantie, c’est le respect de la parole et de la situation du malade. C’est le sens du droit à la sédation profonde et continue proposé dans le texte, avec des garde-fous : pour que le traitement cesse, il faut que le malade subisse des symptômes réfractaires et que toute obstination soit déraisonnable ; pour qu’une décision définitive soit prise, il faut que le pronostic vital soit engagé à court terme ; et dans tous les cas, les directives anticipées du patient doivent être respectées, dans le cadre reconnu par la loi.
Je veux le dire ici, il ne s’agit en aucun cas d’un droit au suicide assisté ! Le suicide assisté n’est pas un progrès, ni un nouveau droit, ni une garantie contre le mal mourir ! Ce n’est pas une valeur, ni de gauche, ni de droite.

Les garanties sont dans l’équilibre que nous proposent Alain Claeys et Jean Leonetti.

Notre assemblée s’est honorée, dans des moments illustres de son histoire, à refuser que la justice puisse s’exprimer par la peine de mort. Aujourd’hui, même si la loi qui nous est présentée n’est pas appelée à avoir la même importance fondamentale dans l’histoire de notre pays, nous devons refuser d’elle qu’elle valorise la mort.

Ce que la loi doit valoriser, c’est le droit à une vie digne jusqu’au dernier instant.

Je souhaite que, dans le débat que nous aurons article par article, nous gardions à l’esprit ces préoccupations générales qui me paraissent indépassables. Ce ne sont pas des positions tranchées, mais c’est bel et bien le consensus qui doit nous permettre d’avancer vers de nouveaux droits.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC et du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous abordons l’examen de la proposition de loi de MM. Claeys et Leonetti relative à la fin de vie. Je voudrais m’associer aux félicitations qui leur ont été adressées pour le travail qu’ils ont entrepris. Qu’il s’agisse de la bioéthique ou de la fin de vie, ils ont fait preuve d’une grande exigence dans les travaux qu’ils ont conduits, cherchant avant tout à rassembler, tout en étant exhaustifs. Je veux également souligner la grande cohérence de leurs positions. S’il peut exister des divergences de vue, il n’en demeure pas moins qu’il faut respecter le travail qu’ils accomplissent l’un et l’autre depuis plusieurs années sur ces sujets.
Quel est notre état d’esprit vis-à-vis de ce texte ? D’abord, nous voulons faire preuve de la plus grande prudence. La fin de vie renvoie chacun d’entre nous à des expériences personnelles, au sein de notre famille ou auprès d’amis. Elle renvoie aussi aux conceptions et aux convictions que nous pouvons avoir, par rapport à la personne et à la société, que nous devons respecter.
Ensuite, nous devons nous tenir à un objectif de clarté. Il ne s’agit pas de chercher à tout dire dans la loi, d’épuiser tous les sujets. Un texte législatif ne pourra pas prévoir toutes les situations et ne pourra pas codifier toutes les hypothèses. Mais nous devons clarifier nos intentions et nos objectifs. Or, à ce stade, le texte comporte plusieurs ambiguïtés. Les amendements que nous avons été plusieurs à déposer ne visent pas à nous opposer de manière systématique, mais à clarifier certaines questions pour lever toute ambiguïté.
S’agissant d’abord des soins palliatifs et plus largement de la culture palliative, des discours ont été tenus, gouvernement après gouvernement ; des propositions de loi favorables à l’euthanasie et d’autres qui y sont opposées ont été présentées ; tous prônent le développement des soins palliatifs.
Oui ou non, allons-nous véritablement promouvoir les soins palliatifs et, au-delà, une véritable culture palliative dans notre société ? Peut-on tolérer que 80 % de nos concitoyens qui ont besoin de soins palliatifs n’en bénéficient pas, véritable scandale, selon les propres mots du Comité consultatif national d’éthique ?
Nous attendons un engagement ferme de la part du Gouvernement, non dans les discours mais dans une politique…

…visant à faire reculer les inégalités dans les territoires par le biais d’un plan de développement des soins palliatifs et d’une culture palliative. Cela passe par la formation initiale et continue des personnels soignants ainsi que par une conception de la médecine qui unifie le curatif et le palliatif. Nous attendons des gestes forts qui permettent de traduire cette volonté que nous partageons tous.
S’agissant ensuite de la sédation profonde continue, on sait que la pratique de la sédation existe, mais qu’elle peut présenter un risque, si elle était généralisée et insuffisamment encadrée, de conduire à une euthanasie déguisée. La proposition de loi prévoit trois cas, dont le deuxième nous inquiète particulièrement : celui de la sédation profonde continue avec arrêt des traitements en cas de maladie incurable mais sans que le pronostic vital ne soit engagé, et ce jusqu’au décès.
Si cela peut s’entendre dans certains cas, le risque d’un basculement vers l’euthanasie déguisée existe. Il faut le dire clairement. Certains se déclarent favorables à l’euthanasie, mais ceux qui y sont opposés doivent pouvoir s’assurer qu’il n’y a pas d’ambiguïté permettant une dérive conduisant à l’euthanasie.
Enfin, s’agissant des directives anticipées, autant on peut comprendre que celles-ci puissent éclairer les décisions du médecin et de l’équipe médicale, autant il faut être attentifs à ne pas les sacraliser. N’entrons pas dans un système déshumanisé. Avec la proposition du Gouvernement d’un registre national informatisé des directives anticipées, nous ne sommes pas très éloignés du Meilleur des mondes : les directives anticipées s’imposeraient sans aucune considération des situations particulières, notamment de la nécessité du dialogue entre le médecin et le patient…

Un de nos collègues affirmait qu’avec ce texte, on basculait du médecin vers le patient. Mais justement non ! Il ne faut pas basculer, il faut en rester au dialogue entre le médecin et le patient.

Je conclus en m’inquiétant des propos du Premier ministre, repris par Mme la ministre, qui parlait de nouvelle étape et du rapporteur Alain Claeys, qui parlait de nouveau pas franchi. Qu’entendent-ils par ces termes ? Vers quelle nouvelle étape allons-nous ? Nous serons quant à nous très vigilants et les amendements que nous défendrons viseront à éclairer ce débat.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que les temps de parole ont été décidés par les groupes et que chaque orateur dispose de cinq minutes. Vous ne pouvez pas vous permettre de déborder systématiquement.

Il n’y avait rien de désobligeant dans ma remarque, madame la présidente.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la question de la fin de la vie est éminemment personnelle. Elle renvoie chacun à son vécu et à celui de ses proches, à des histoires personnelles la plupart du temps douloureuses. Il n’y a pas de vérité absolue.
Nous légiférons pour les patients avant tout. Si, comme je l’espère, nous votons cette proposition de loi, nous leur ouvrirons des droits nouveaux. Ce point peut nous paraître à juste titre évident, mais ne banalisons pas l’évidence. Ouvrir des droits nouveaux est toujours un acte fort, qui mérite le respect. Je tenais à le dire ici avec solennité et fraternité.
Soyons réalistes : nos concitoyens souhaitent avant tout mourir dans l’apaisement, conformément à leur volonté, accompagnés jusqu’au bout, soulagés de leurs souffrances, et surtout en restant le plus possible maîtres de leur vie.
L’ouverture de ces droits nouveaux, qui revient aussi à « faire du droit », était devenue nécessaire, pour des raisons déjà parfaitement démontrées par les précédents orateurs : les effroyables inégalités qui existent entre les Français en fin de vie, à domicile, en établissement hospitalier ou en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les inégalités aussi selon les territoires, la cellule familiale et amicale et les moyens matériels, les inégalités enfin dans les pratiques médicales, les formations, la disponibilité des soignants.
Quels seront ces droits ? L’accès à une sédation en phase terminale ; le caractère contraignant des directives anticipées ; l’élargissement de l’accès aux soins palliatifs.
Le plus important à mon sens est d’offrir aux patients une palette de solutions de soins et de prises en charge de la fin de vie la plus large possible, pour que chaque cas, unique, trouve la solution la plus adaptée.
Dans cet éventail, une nouvelle possibilité est ouverte : la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à l’arrêt des traitements de maintien en vie, pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui ne veulent plus souffrir ni prolonger artificiellement leur vie.
Je sais que pour rédiger l’article 3, vous avez dû, messieurs les rapporteurs, soupeser chaque mot pour créer un équilibre subtil. Laissez-moi vous témoigner mon profond respect pour ce travail d’expertise et d’humanisme.
Ce dispositif n’est pas une aide active à mourir, il n’y a aucun geste visant à administrer la mort au patient. Il s’apparente plus à un droit à dormir avant de mourir pour ne pas souffrir, comme l’a souligné M. Leonetti, dans le respect du pacte de soin qui lie le patient et son médecin ou ses soignants. Je sais que beaucoup ici auraient souhaité aller plus loin encore. Je considère pour ma part que la solution retenue est respectueuse et bienveillante, et surtout consensuelle.
Ce droit s’accompagnera du respect pour chaque patient, et jusqu’au bout, de son autonomie de pensée, de parole, puisque sa vie n’a de sens que reliée au monde.
À côté de ce droit, le caractère contraignant des directives anticipées et la possibilité de nommer une personne de confiance sont deux avancées majeures. Il faudra s’assurer que les acteurs s’en saisissent – patients et, surtout, médecins.
Le médecin, et particulièrement le médecin traitant, se doit de prendre toute sa place, d’informer et de renseigner ses patients, qu’ils soient déjà atteints par la maladie ou en bonne santé. Je me réjouis que ce principe ait pu être voté en commission.
Enfin et surtout, ce texte aurait peu de sens si nous n’insistions pas, une nouvelle fois, sur l’importance du droit aux soins palliatifs. Je tiens ici à saluer ces services qui aident jusqu’au bout les malades à vivre aussi activement que possible et qui assurent les soins pour maintenir une certaine qualité à cette vie qui prend fin – en un mot : qui sauvegardent la dignité et soutiennent les entourages des patients.
Notre priorité est de faire cesser toutes ces situations d’indignité, d’isolement et de dénuement qui entourent trop souvent la fin de vie des malades. Ces derniers sont parfois également handicapés, souvent âgés, mais on oublie souvent qu’il y a aussi des personnes jeunes qui ont du mal à mourir. Pour cela, il est impératif de rendre réellement accessible ce droit aux soins palliatifs reconnu depuis quatorze ans, y compris à domicile. C’est la volonté de la grande majorité des malades, mais sa réalisation est loin d’être généralisée.
L’annonce récente par le Président de la République de la mise en place de modules d’enseignement spécifiques consacrés à l’accompagnement des malades dans les formations médicales et paramédicales est en ce sens une initiative salutaire, qu’il faudra garantir et amplifier. Je salue également l’ajout consistant à faire rédiger par les agences régionales de santé un bilan annuel de la politique de développement des soins palliatifs sur chaque territoire.
Ce texte a vocation à nous rassembler au-delà de nos postures politiques. La loi ouvre des droits et respecte la volonté et la dignité de chacun dans cette circonstance si intime qu’est la fin de sa vie. Elle réussit à concilier la compassion et la raison. En un mot, elle fait preuve d’une infinie sagesse, d’humanité et de progrès. Nous ne pouvons que nous en porter garants.
Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe SRC.

La question qui nous réunit aujourd’hui est une question délicate, qui nécessite beaucoup d’humilité et qui suppose de rester apaisé, à l’écoute de l’autre et de ses souffrances. Méfions-nous des coups de projecteur braqués sur telle ou telle situation individuelle que l’on voudrait généraliser, car chaque vie est singulière.
Cela étant, nous voici au pied du mur : faut-il revoir la loi Leonetti, dont je salue ici l’auteur ?
Pour ma part, je reste très attaché à cette loi de 2005, loi d’équilibre qui autorise déjà la sédation sous certaines conditions et reconnaît déjà les directives anticipées, même si ces dernières restent méconnues – à peine 2,5 % de nos concitoyens y auraient recours. Dix ans après son adoption et à la lumière des débats que nous avons menés ici les 21 et 29 janvier, il ressort très nettement que tous les aspects de cette loi ne sont pas encore totalement assimilés et qu’il reste du chemin à faire pour qu’elle produise ses effets.
La priorité doit être d’aller vers les soins palliatifs. Nous avons noté ces dernières années certains progrès, le nombre d’unités par exemple est passé de 90 à 122, mais c’est encore largement insuffisant. Huit de nos concitoyens sur dix n’ont pas accès à ces soins palliatifs et la moitié seulement de ceux qui auraient besoin d’y recourir peuvent le faire effectivement.
Au-delà des unités fixes qui restent à développer et des milliers de lits nécessaires clairement identifiés, même si les chiffres des estimations varient, il faudrait parvenir au doublement des équipes mobiles, en lien notamment avec les équipes d’hospitalisation à domicile – HAD. Des infirmières de nuit doivent aussi être recrutées, car certains établissements, notamment de nombreux EHPAD, n’assurent toujours pas, la nuit, un service satisfaisant.
Il faut aussi des moyens supplémentaires en faveur de la formation, tant initiale que continue, afin que les professionnels de santé, et pas seulement les médecins, puissent s’approprier cette culture des soins palliatifs. Seules des mesures incitatives fortes, à la hauteur de nos attentes, pourraient permettre cette acculturation de l’ensemble du monde médical et médico-social aux pratiques palliatives, qui doit être impérativement renforcée. La Cour des comptes a du reste souligné, voilà encore quelques semaines, les disparités territoriales, qui demeurent très fortes, et le besoin d’un plan spécifique.
Je souhaitais développer tous ces aspects dans un certain nombre d’amendements mais cet après-midi, vers 16 heures 30, il m’a fallu me rendre à l’évidence : l’article 40 de la Constitution est passé par là et je ne pourrai pas les défendre. J’invite donc très humblement le Gouvernement à les reprendre, ce qui sera l’occasion de rappeler que notre société est solidaire jusqu’à la fin de la vie et n’abandonne pas celui ou celle qui souffre. Nous devons avoir, à l’instar du Plan cancer, qui est bien identifié et qui a traversé le mandat de plusieurs présidents et premiers ministres, un plan ambitieux pour les soins palliatifs.
Bien évidemment, tout en saluant le travail intense accompli par nos deux co-rapporteurs, j’ai conçu moi aussi, en abordant le texte plus en détail, des interrogations sur certains points, comme les directives anticipées. Celles-ci ne sont certes pas une nouveauté et il faut les promouvoir. Il faut parler de sa mort, car il importe que l’entourage sache ce qui devra être fait, même si Éros est plus sexy que Thanatos et que l’on évoque certains sujets plus volontiers que certains autres. Mais faut-il pour autant rendre ces directives opposables et écarter le médecin ? N’oublions pas l’ambivalence du malade et sa hiérarchie des priorités, qui évolue forcément avec le temps et qu’il faut prendre en compte.
Sur la sédation profonde, enfin, il faut continuer à nous interroger. J’espère que les débats permettront de lever un certain nombre d’interrogations pour éviter au texte de glisser vers une forme d’euthanasie déguisée. Prenons garde de ne pas glisser vers un droit général, qui pourrait assez rapidement être qualifié par la suite de droit fondamental. Nous n’en sommes pas là, mais il ne faut pas que nous franchissions cette ligne jaune.
Je m’inquiète en effet lorsque j’entends le Premier ministre, qui a été en son temps rapporteur d’un autre texte, nous dire qu’il ne s’agit ici que d’une première étape. J’espère que les étapes suivantes ne seront pas une euthanasie active et la reconnaissance du suicide assisté. Restons la main tremblante en la matière. Messieurs les rapporteurs, nous avons besoin d’explications, afin de pouvoir mieux nous y retrouver. Ce sera l’objet de l’examen des amendements.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous sommes saisis relève de ce qu’il y a de plus profond dans l’humanité et dans le droit. Dans l’humanité, car la conscience et l’expérience de la finitude sont indissociables de notre condition. Dans le droit, car le devoir du législateur, en démocratie, est de combattre les inégalités – oui, le mal mourir est encore trop présent dans notre pays – et de répondre aux aspirations des citoyens pour qu’ils soient au coeur des décisions qui les concernent quant à la fin de vie, qu’ils souhaitent apaisée.
La question que nous abordons, à la fois universelle et individuelle, appelle humilité et volonté. L’une et l’autre commandent de rendre effectives et possibles les avancées réelles et les droits essentiels contenus dans le texte dont nous débattons.
Des travaux de grande qualité, denses et respectueux, en ont éclairé la rédaction. Je pense, pour m’en tenir aux plus récents, à l’avis du Comité consultatif national d’éthique de juin 2013 et, bien sûr, au rapport que nos collègues Claeys et Leonetti ont remis au Président de la République à la fin de l’année dernière.
Trois principes orientent la proposition de loi qui nous est présentée : garantir à chaque personne, lorsqu’elle achève sa vie, d’être entendue et de voir son choix jusqu’au bout respecté – c’est un principe de liberté. Veiller à ce que les personnes en fin de vie, quels que soient le territoire où elles résident, leurs ressources et l’affection dont elles souffrent, puissent accéder aux mêmes soins – c’est un principe d’égalité. Apaiser et épargner la souffrance physique et psychologique des personnes en fin de vie – c’est un principe de fraternité. Liberté, égalité, fraternité, disais-je : oui, ce texte s’inscrit dans ce qui fonde notre République.
Il constitue une réforme ambitieuse, en commençant par organiser mieux le recueil et la prise en compte des directives anticipées qui, alors qu’elles doivent exprimer la volonté de la personne quant à sa fin de vie, sont aujourd’hui, et c’est, comme l’ont souligné plusieurs de nos collègues, un euphémisme, peu connues, difficiles d’accès et mal appliquées.
Il est proposé qu’elles soient juridiquement contraignantes et qu’elles s’imposent au médecin en charge du patient. Nous sommes nombreux, dans cet hémicycle et dans le pays, à le demander de longue date. Elles seront « révisables et révocables à tout moment » et, si elles sont absentes, la volonté du patient pourra être portée par un proche qu’il aura préalablement désigné par écrit. Comme vous le rappeliez, madame la ministre, la Haute autorité de santé et le Conseil d’État fixeront un cadre à leur rédaction et l’accès à ces directives sera facilité par une mention inscrite sur la carte Vitale ou, car l’évolution des technologies le permet, par un registre national automatisé si l’amendement que défendra le Gouvernement est adopté. Les directives anticipées seront ainsi claires pour chacun, patients comme soignants. C’est un progrès majeur.
Autre avancée : l’affirmation de l’indispensable égalité face à la fin de vie. Comme l’a rappelé Alain Claeys en commission avec justesse et avec force, nous sommes profondément inégaux face à la mort. Ainsi, seulement 20 % des patients qui devraient bénéficier des soins palliatifs y ont effectivement accès. En son article 1er, le texte dispose que « toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit ».
Au cours de notre discussion, nous débattrons notamment d’un amendement du groupe SRC visant à assurer la remise au Parlement, chaque année, d’un rapport évaluant précisément l’application de la présente loi, ainsi que le développement et le déploiement des soins palliatifs dans notre pays.
En appui des changements législatifs, le chef de l’État a annoncé, pour conforter ce déploiement, un plan triennal, lancé dès cette année. Une place centrale doit être donnée à la formation des professionnels de santé en la matière, professionnels dont il faut du reste souligner encore une fois l’engagement dévoué.
Enfin, ce texte renforce le droit des malades à être entendus, avec le droit ouvert à la sédation profonde continue jusqu’au décès, prévu à l’article 3, comme cela a été rappelé au début de notre discussion. Cette sédation pourra également être mise en oeuvre dans le cas où une personne souhaite arrêter les traitements qui la maintiennent en vie, afin de ne pas prolonger artificiellement la vie d’un patient qui ne le souhaiterait pas face à une maladie incurable. Elle s’accompagnera du respect, jusqu’à la dernière heure, de l’autonomie de décision du patient, par le biais, s’il ne peut s’exprimer, de ses directives anticipées. C’est une évolution décisive pour les patients et pour les soignants.
Mes chers collègues, cette proposition de loi marque une avancée dans le droit de chacune et chacun à être écouté et bien accompagné à la fin de la vie. Le débat sur le sujet se prolongera nécessairement dans l’avenir mais nous avons, ensemble, avec ce texte, la possibilité de faire progresser les conditions de fin de vie de milliers de nos concitoyens. C’est le sens de la proposition de loi que nous examinons : une nouvelle avancée du droit, une exigence d’égalité, de solidarité et de citoyenneté.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en France, faute d’un accès suffisant aux soins palliatifs et en dépit des progrès des dernières années, on continue trop souvent de « mal mourir ».
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, grâce au remarquable travail de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, a donc pour objet de compléter les acquis de la loi Leonetti du 22 avril 2005. Elle marque un progrès équilibré entre des avancées individuelles et des garanties contre d’éventuelles dérives, notamment le risque d’une euthanasie déguisée. Cependant, certaines conditions doivent encore être réunies pour réussir sa mise en oeuvre.
Il s’agit tout d’abord d’avancées individuelles. Deux nouveaux droits sont créés en faveur des malades en toute fin de vie : le droit d’accéder à la sédation profonde et continue jusqu’au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme et le droit de voir ses directives anticipées devenir plus contraignantes pour l’équipe médicale, sous certaines conditions.
La reconnaissance de ces nouveaux droits parachève, selon l’exposé des motifs des rapporteurs, « cette longue marche vers une citoyenneté totale, y compris jusqu’au dernier instant de sa vie », marche entamée par la loi du 4 mars 2002 et celle du 22 avril 2005, que j’ai déjà évoquée.
Ces avancées répondent mieux aux préoccupations des acteurs de la fin de vie : le droit du malade à disposer de lui-même, alors qu’il est confronté à la question existentielle des conditions de sa fin de vie, est mieux préservé par la proposition de loi ; le soignant, confronté à la question éthique de sa pratique clinique, disposera quant à lui des outils et des consignes pour préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’au décès du patient.
Ensuite, cette proposition de loi comporte des garanties contre d’éventuelles dérives. Non seulement elle exclut l’euthanasie, mais encore elle s’intègre pleinement dans la culture palliative issue des pratiques d’accompagnement et de soin. Le champ d’application de la sédation profonde et continue jusqu’au décès est limité. Celle-ci reste un traitement exceptionnel, réservé au malade atteint d’une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court terme et souffrant de symptômes physiques ou psychologiques réfractaires, qui ne peuvent donc être soulagés autrement.
Ce traitement exceptionnel a vocation à soulager et non à tuer. Seul un soulagement de la souffrance est recherché, excluant donc la provocation intentionnelle de la mort. Il s’agit de dormir avant de mourir, pour reprendre l’expression employée par Jean Leonetti, et de dormir plutôt que de souffrir.
Le caractère contraignant des directives anticipées n’est pas absolu. Le médecin peut décider de ne pas les appliquer, en cas d’urgence vitale ou si elles sont manifestement inappropriées. Dans ce cas, il demande l’avis d’un autre médecin et doit motiver sa décision.
Plusieurs conditions me semblent devoir être réunies pour réussir la mise en oeuvre de ce texte. À la mi-février, j’ai organisé en Loir-et-Cher, avec Jean Leonetti, que je remercie encore d’être venu dans notre département, une concertation sur les enjeux législatifs de la fin de vie réunissant plus de 250 participants, d’abord dans un centre hospitalier, puis avec de nombreux membres de professions de santé. Les principales interrogations ont porté sur la culture et les moyens nécessaires pour permettre le développement des soins palliatifs, lesquels ne sont accessibles qu’à 20 % de ceux qui en ont besoin.
Je veux mentionner ces interrogations car elles sont importantes pour notre débat. Il faut espérer, madame la ministre, que le plan triennal dont vous avez annoncé les grandes lignes tout à l’heure, apportera les réponses indispensables.
Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour dégager les moyens budgétaires du développement des soins palliatifs ? Envisage-t-il, par exemple dans le cadre de la prochaine loi de santé, d’intégrer les actes d’accompagnement dans la tarification médicale de la politique de soin ?
Comment le Gouvernement compte-t-il mieux promouvoir la culture palliative hors de l’hôpital ? Prévoit-il d’inclure dans la formation des étudiants en médecine un enseignement obligatoire sur le traitement de la douleur, ainsi que de mettre en place une formation continue dédiée à ce sujet pour les médecins en exercice ? Envisage-t-il de développer la présence d’infirmiers palliatifs dans les EHPAD médicalisés ? Enfin, plus globalement, quand le Gouvernement fera-t-il de la culture palliative une cause nationale prioritaire ?
Pour conclure, je crois que cette proposition de loi apporte des réponses satisfaisantes à la lancinante question de l’amélioration des conditions de fin de vie et du droit de ne pas souffrir avant de mourir, tout en restant maître de la fin de sa vie. Un équilibre est trouvé entre les valeurs de liberté et les valeurs tout aussi fondamentales de protection des plus vulnérables, nul ne pouvant enlever la vie à un autre, comme l’a rappelé Jean Leonetti. Mais ce texte d’équilibre n’aura sa pleine efficacité, j’en suis convaincu, que si nous savons accomplir la véritable révolution culturelle du soin palliatif.
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes UMP et SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le sujet dont nous débattons aujourd’hui est délicat et sensible puisqu’il relève du plus intime : notre fin de vie. La présente proposition de loi, fruit d’un consensus entre deux rapporteurs de sensibilités politiques différentes et dont je salue le travail, permettra, j’en suis convaincu, de recueillir l’assentiment du plus grand nombre.
Ce texte ouvre un nouveau droit pour les citoyens : celui d’une fin de vie digne et apaisée. C’est une avancée importante dont nous pouvons et devons être fiers. Il met le patient au coeur de la décision, en rendant les directives anticipées opposables aux médecins. Les malades deviennent ainsi maîtres de leur fin de vie. C’est une avancée majeure. Jusqu’ici, les directives anticipées étaient peu connues et peu utilisées par les Français, une des raisons invoquées étant leur caractère consultatif. Cela devrait évoluer.
Je considère ce libre choix comme fondamental. Qui d’autre que l’individu lui-même doit pouvoir choisir la façon dont il compte terminer sa vie ? Le malade est au coeur de notre nouvelle loi. Permettons-lui de choisir pleinement les conditions de sa fin de vie. Avec Jean-Louis Touraine et plus de 120 collègues, nous proposerons un amendement permettant au patient d’avoir un choix réellement ouvert, comprenant, s’il le souhaite, l’assistance médicalisée active à mourir.
Il ne s’agit pas de la substituer à la sédation profonde qui est prévue dans le texte ; il ne s’agit pas non plus de l’imposer à qui que ce soit : il s’agit simplement de proposer une voie supplémentaire, un choix plus large afin que, encore et toujours, le patient puisse réellement choisir entre l’ensemble des moyens qui s’ouvrent à lui.
Les Français sont très nombreux à réclamer que la loi autorise les médecins à mettre fin sans souffrance à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables. Cette demande est légitime et c’est notre devoir de législateur que d’ouvrir et d’encadrer les possibilités de choix.
Chacun ici connaît des histoires dans son entourage, chacun a sa propre expérience. Il n’est pas question ici de légiférer pour des cas individuels ou de personnaliser le débat, mais il est essentiel que chaque citoyen puisse trouver dans la loi le moyen qu’il souhaite pour terminer sa vie dignement.
La sédation profonde et continue, prévue dans cette proposition de loi, est une option que certains voudront choisir. Mais pourquoi l’imposer comme seule alternative ? Pourquoi refuser cette même liberté à ceux qui voudraient bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir, c’est-à-dire partir au moment où ils le décident ?
Ma conviction la plus profonde est que l’assistance médicalisée active à mourir est un choix tout aussi raisonnable qu’un autre et que nous n’avons pas de jugement à porter sur les décisions de chacun. Notre rôle de législateur est d’assurer aux patients que leur choix sera respecté et de l’encadrer légalement pour éviter les dérives. C’est une question de liberté individuelle : nous ne voulons rien imposer, mais simplement autoriser.
Plusieurs États ont déjà mis en place un dispositif comparable à celui que nous proposons. Je suis élu dans une circonscription, le Benelux, où ce débat a été tranché il y a bien longtemps. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont mis en place une aide active à mourir depuis plus de dix ans.

Ces lois n’ont jamais été remises en cause, témoignant de l’adhésion de la population. Ces expériences doivent nous inspirer et nous rassurer.
En outre, vous le savez tous, l’euthanasie se pratique aujourd’hui, en France comme à l’étranger. Mais encore faut-il avoir la possibilité de trouver un médecin ou un proche qui accepte de pratiquer l’acte, aujourd’hui illégal sur notre territoire ; ou bien avoir les connaissances et les moyens de partir s’installer en Belgique ou au Luxembourg pour préparer sa fin de vie, ces pays n’acceptant pas l’euthanasie pour les personnes qui n’ont pas suivi un cheminement avec le médecin ; ou encore d’avoir les moyens de partir en Suisse pour un suicide assisté, dont le coût total revient à près de 10 000 euros.
Oui l’euthanasie existe pour les Français, mais pas pour tous. Alors arrêtons l’hypocrisie ! Cessons de tolérer ces inégalités ! Une assistance médicalisée active à mourir, légale et encadrée en France, vaut mieux que des pratiques non encadrées ou des départs à l’étranger.
Je vous demande solennellement, chers collègues, au-delà de vos propres convictions, de permettre simplement à chaque citoyen de choisir librement de sa fin de vie. Cette proposition de loi est un pas en avant important pour les patients, elle les met au coeur de la décision. Aussi, franchissons ensemble cette étape supplémentaire, au nom de l’égalité, au nom de la liberté de choix, au nom de la dignité, afin que ce texte devienne la grande avancée sociétale que souhaitent nos concitoyens.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je n’ai ce soir que des doutes et une profonde réticence à voter ce texte, en pensant à toutes ces expériences que j’ai accumulées à titre personnel, durant de longues années dans des services hospitaliers. J’ai été pris d’un grand vertige lorsque, externe en réanimation cardiaque, j’ai eu soudain, une nuit, à trois heures du matin, le pouvoir de redonner artificiellement naissance et continuité à une vie.
Cette crainte, cette peur de l’hubris m’a toujours accompagné, comme m’a toujours accompagné ce doute, que je porterai jusqu’à la tombe : ai-je bien fait de réanimer ou non un être improbable, issu d’alcoolisme foetal, avec un réseau veineux particulier sur un abdomen tendu et un crâne en forme d’oeuf ? Était-ce à moi de décider ou pas, ayant prêté le serment d’Hippocrate ? L’équipe s’attendait à ce que je prenne la décision de maintenir la vie ; ai-je bien fait ? Je n’en sais rien.
Mes chers collègues, nous vivons dans une société tout à fait paradoxale, une société incapable de donner un espoir à notre jeunesse, qui fuit nos partis politiques traditionnels – nous verrons les résultats des élections dans deux semaines, une société de vieux qui se soucie uniquement de la fin de vie, en ne parlant que par euphémismes. Plus personne ne parle de la mort !

Plus personne ne parle des expériences réelles ! Nous ne parlons que de décès, d’euthanasie, de suicide assisté et bientôt même, si le sujet n’était pas si sérieux, nous parlerions du sexe des anges.
Madame la ministre, le texte précédent était un texte équilibré. Dans une grande société, une société qui veut continuer à porter une espérance et une vie, en particulier pour les générations futures, on donne la confiance à celui ou celle qui est censé détenir un savoir et une connaissance, en l’occurrence le médecin.
Ce médecin n’est pas isolé ou tout-puissant, comme je le lis dans le texte. Il faut connaître, dans d’autres domaines, la grande difficulté que certains praticiens ont à faire admettre des soins, dans certaines pathologies psychiatriques, à leurs patients et aux familles, pour comprendre que ce libre arbitre est parfois bien illusoire et qu’il peut ouvrir à bien des dérives, comme les pays du Nord les connaissent – ces pays du Nord puritains, que j’entends souvent citer en exemple mais qui, en réalité, ont voulu donner la possibilité à toute personne désireuse de se suicider de voir un confrère psychiatre pour que celui-ci l’autorise, en bonne santé mentale, à porter atteinte à ses jours !
Madame la ministre, quelle est cette société que vous voulez, qui témoigne de la défiance pour ceux qui connaissent, qui savent et qui, au bout de longues études, ont la mission de porter sur leurs épaules le bien et le mal d’une société et de prendre très jeunes, en équipe, la responsabilité de décisions dont ils ne sauront jamais, jusqu’à leur fin humaine, s’ils ont bien fait ou non de les prendre ?
Quel est ce texte que vous nous proposez qui, impératif, continue à saper l’autorité – parce qu’il s’agit bien d’une autorité, fondée sur un savoir et une connaissance – du praticien ?
Quelle est cette société normative que vous voulez ? Nous avons entendu cet après-midi qu’il y aurait des formulaires pré-imprimés, administratifs. Quelles sont ces sociétés qui ont du mal à comprendre la complexité ? Madame la ministre, chaque vie, chaque mort est unique. J’entends ici qu’il faudrait normaliser, équilibrer, égaliser : mais nos vies sont profondément inégales ! C’est ce qui fait leur richesse ! Et nos morts sont profondément inégales, c’est ce qui fait toute leur richesse !
Depuis des années, des décisions sont prises dans des services hospitaliers, par des gens plus ou moins jeunes, toujours en équipe : c’est cela la réalité !
Exclamations et « Ce n’est pas le sujet ! » sur les bancs du groupe SRC.

Madame la ministre, votre loi est inutile, et vous avez fait tomber les masques.

C’est une proposition de loi ! Le texte est présenté par les rapporteurs !

En demandant des rapports annuels, vous progressez de plus en plus sur le chemin de la marchandisation du corps humain, qui sera bientôt le chemin de l’autonomisation de la mort et du décès.
Je finirai par un exemple : quel aurait été le sort de cette femme dans le coma, morte récemment, mère d’une amie, qui s’est réveillée et qui a pu dire au revoir à sa fille ? Quel aurait été le schéma pour cette femme si votre loi avait été appliquée ?

Vous savez bien que cette proposition de loi est un faux nez utilisé par le Gouvernement !

Madame la ministre, votre loi démagogique semble faire plaisir à une partie de l’opinion mais n’aborde pas les questions profondes. La loi précédente était sage, il n’y avait aucune raison d’en produire une nouvelle. C’est pourquoi je voterai contre.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, nous abordons ce soir un phénomène universel, dans le sens où il advient à tous et en tout temps. C’est aussi un fait divers, on l’a encore constaté ce matin, qui, s’il se produit chaque jour, n’en reste pas moins à chaque fois une tragédie et une souffrance, pour les familles mais aussi pour ceux qui sont dans cette phase agonique, et c’est ce que nous voulons combattre ce soir.
Je voudrais tout d’abord vous remercier l’un et l’autre, messieurs les rapporteurs, vous qui, de sensibilités politiques différentes, avez su faire preuve d’une compréhension mutuelle assez rare pour être soulignée. C’est elle qui vous a permis de cheminer, sans fuir les peurs, les doutes, les passions, les questionnements philosophiques et spirituels. Vous avez su au contraire les confronter pour créer les conditions d’un dépassement nécessaire, alors que nous avions déjà légiféré sur cette question il y a quelques années.
L’enjeu est de poser des règles et des principes généraux qui permettent d’appréhender la dimension existentielle, singulière et unique de toute fin de vie.
Reconnaissons d’emblée les limites de l’exercice législatif, qui ne peut borner la multiplicité des situations, des émotions, des perceptions particulières de la souffrance, de la douleur et d’une finitude qui n’appartient qu’à nous.
Je ne reviendrai pas longuement sur les avancées contenues dans ce texte, et qui ont déjà été exposées : le droit à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, mais aussi des directives anticipées rendues plus contraignantes pour le médecin et encadrées. Surtout, il affirme la primauté de l’avis de la personne de confiance dans les cas où les patients ne sont plus conscients. Il est important en effet d’imaginer ce qui peut se passer dans des cas imprévus, dont l’actualité récente nous fournit des exemples – je pense notamment à l’accident survenu à un pilote automobile fameux. Nous avons tous en tête des exemples de personnes privées du jour au lendemain de toute possibilité d’exprimer la moindre volonté.
Ce texte est donc incontestablement une avancée par rapport à la loi de 2005, qui constituait déjà un progrès.
Nous ne pouvons pas pour autant nous satisfaire de la situation de notre pays en termes de mise en oeuvre de la législation existante, alors que 80 % de ceux qui devraient bénéficier de soins palliatifs n’y ont pas accès. C’est la raison pour laquelle je suis résolument et prioritairement favorable à la mise en oeuvre des droits existants, souvent inappliqués, au développement des équipes mobiles à l’hôpital, à domicile et dans le secteur sociomédical, ainsi qu’à la plus large formation des soignants, ce que le Gouvernement entend mettre en place dès 2015, à l’inverse de ce qu’a semblé dire l’orateur précédent.
Régis Aubry, président de l’Observatoire national de la fin de vie, le dit à sa manière : notre retard dans ce domaine est moins structurel que culturel. La France dispose d’un nombre suffisant d’infrastructures hospitalières – je crois que personne n’en doute dans cet hémicycle. Ce qui manque, c’est la compétence palliative, parce que les médecins n’y sont pas préparés et que notre société ne l’a peut-être pas encore acceptée.
Faisons en sorte d’appliquer les lois existantes, et continuons de progresser, même si cette proposition de loi n’épuise évidemment pas tous les sujets, et notamment la question du « mal mourir » ou celle de la mort dans la dignité. C’est sans doute une avancée trop timorée aux yeux de ceux qui, voyant plus loin et allant plus vite, préconisent une exception d’euthanasie ou l’aide active à mourir. Celle-ci est une étape supplémentaire, déjà franchie par des États plus avancés de ce point de vue, mais plus petits, dont les populations sont souvent plus attentives et plus structurées, et dont les équipements hospitaliers permettent de telles pratiques.
Je comprends ce point de vue, d’autant que mes convictions n’en sont pas très éloignées. Pourtant, si ce texte doit permettre de faire utilement un pas de plus, je voterai cette loi en l’état, avec ses insuffisances, avec ses espérances, avec le sens des valeurs humanistes et la clarté de ma conscience, avec discernement. Pas au-delà, pas en deçà, juste ce texte-là. Lao Tseu n’enseignait-il pas que « le but n’est pas seulement le but mais le chemin qui y conduit » ?
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme d’autres orateurs avant moi, c’est avec beaucoup d’humilité que j’aborde cette crainte que nous avons tous de notre fin de vie.
Madame la ministre, permettez-moi, en tant qu’élu de Saint-Malo où François-René de Chateaubriand a vécu de longues années, de redire, après vous, ses mots : « L’homme n’a qu’un mal réel : la crainte de la mort. Délivrez-le de cette crainte, et vous le rendez libre. »
Comme tout homme, je souhaite partir sans souffrir, sans m’en rendre compte et, bien sûr, le plus tard possible. Est-ce que, face à la douleur, à l’angoisse de l’au-delà, à la perte d’autonomie, je ne demanderai pas à en finir ? Est-ce que, confronté de nouveau à l’agonie douloureuse d’un proche, je ne demanderai pas à ce qu’on mette fin à ses souffrances ?
Je n’ai presque que des incertitudes à opposer à ces questions, mais j’ai néanmoins une certitude : nous ne pouvons pas demander à un médecin d’utiliser ses compétences pour abréger la vie. La médecine n’est pas un bien de consommation dont le patient pourrait user à sa guise, même au prix de demandes réitérées.
Depuis 1999, trois lois réglementent la fin de vie des patients. La dernière, la loi Leonetti, respecte deux principes fondamentaux : le refus de l’acharnement thérapeutique et l’interdiction de provoquer la mort. Cette loi de 2005 insiste sur la place centrale des patients. Elle ouvre de nombreuses alternatives adaptées à chacune des situations rencontrées par les médecins. Elle nous a permis de trouver un juste équilibre qui nous est envié par de nombreux pays. Alors pourquoi vouloir légiférer une quatrième fois ?
Vous nous répondez que la loi de 2005 est trop peu connue et pas assez appliquée. C’est sans doute vrai et toutes les enquêtes d’opinion le démontrent. Mais pourquoi cette nouvelle loi serait-elle plus appliquée ?
Les débats auxquels j’ai participé ont fait naître chez moi une autre interrogation : jusqu’à quand la prise en charge médicalisée de la fin de vie est-elle un mode d’apaisement des souffrances respectueux de l’autonomie des personnes ?

À partir de quand la stratégie mise en oeuvre conduit-elle inexorablement à la mort ? En d’autres termes, quand passe-t-on du palliatif à l’euthanasique ? La frontière est loin d’être facile à déterminer. C’est pour moi toute la question à laquelle il va nous falloir répondre au cours de ces débats.
Cette proposition de loi introduit une nouveauté : la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Plusieurs études démontrent que quand les recommandations de bonnes pratiques publiées en 2009 par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs sont respectées, la sédation ne précipite pas la mort. Son but doit être de diminuer ou de faire disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient.
Mais pourquoi une sédation deviendrait-elle systématiquement profonde et continue alors que d’autres modalités de sédation sont possibles ou légitimes ? Pourquoi la sédation profonde et continue s’accompagnerait-elle nécessairement de l’arrêt de tout traitement de maintien de vie, de l’arrêt, chez le patient sédaté, de traitements tels que la nutrition et l’hydratation ? Je ne suis pas médecin mais je comprends mal comment, chez des patients en fin de vie, l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation ne serait pas un élément d’inconfort, engageant parfois le pronostic vital.
Inscrire une telle solution dans la loi ne serait-il pas un moyen de permettre à des personnes qui ne sont pas en fin de vie d’exiger l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation, l’arrêt de tout traitement dont elles seraient bénéficiaires ?
Le deuxième apport fondamental de la loi réside dans une formulation plus précise de ce que peuvent être les directives anticipées et leur opposabilité au corps médical. Cette proposition soulève deux interrogations. La première concerne le corps médical : jusqu’où le médecin devra-t-il respecter cette volonté ?

Lui seul est capable d’apprécier le caractère inéluctable de l’évolution de la maladie du patient. Dès lors, que devra-t-il faire si le patient lucide exige le respect de sa volonté alors même que le caractère inéluctable de sa maladie n’est pas constaté ?
Ma deuxième interrogation porte sur la portée de directives écrites lorsque le patient était bien portant : quelle sera leur validité au moment où son état nécessitera des décisions d’arrêt de traitement ?

Il est difficile en cinq minutes d’exprimer tout ce que suppose cette proposition de loi, toutes les réflexions qu’elle peut induire dans l’esprit de chacun.
Nous pouvons tous nous rejoindre sur la nécessité d’assurer à tous un égal accès aux soins palliatifs, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui alors que la loi de 2005, adoptée à l’unanimité, le prévoyait explicitement. Atteindre cet objectif nécessite un engagement fort et continu de notre part.
Une seconde position devrait nous rassembler : la mission du médecin consiste à tout faire non seulement pour guérir les malades, mais aussi pour soulager la douleur.
Je crois en votre sincérité, chers collègues Leonetti et Claeys, quand vous affirmez que la sédation profonde est un soin d’apaisement. Je m’opposerai en revanche à toutes les dérives visant à faire de ce texte un texte euthanasique.
Que nos collègues médecins me permettent de citer ces phrases du serment d’Hippocrate : « Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Ce sont elles qui me serviront de guide tout au long de nos débats.
Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous avons eu en commission des débats que je qualifierai volontiers de dignes et apaisés, parce que le sujet le mérite. Le texte qui nous est proposé aujourd’hui respecte, à quelques détails près, l’architecture voulue par nos deux rapporteurs.
La proposition de loi que nous examinons serait la traduction fidèle de l’engagement no 21 du Président de la République visant à faire évoluer la loi de 2005 ? Certains le disent, d’autres le contestent. Doit-on se satisfaire du point d’équilibre trouvé dans l’article 3, lequel fera, à n’en pas douter, l’objet de longs débats ? Certains le pensent, d’autres pas. Je lui consacrerai mon intervention.
Mérite-t-il la place la place cardinale qu’on lui attribue ? Je le crois et je m’appuierai pour le démontrer sur la lecture de ses deuxième et troisième alinéas.
Un patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, qui présente une souffrance réfractaire à l’analgésie, peut demander, pour éviter toute souffrance et ne pas prolonger inutilement sa vie, la mise en oeuvre d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie.
Notre lecture de cet article doit être particulièrement attentive car tous les mots comptent, y compris ceux qui apparaîtraient insuffisamment précis. La demande est désormais exprimée par le patient lui-même : c’est un changement radical, même si c’est de façon très encadrée.
Pour bien appréhender la sédation profonde et continue, il faut d’abord se rappeler la définition qu’en donne le groupe de travail « sédation en fin de vie » de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs. La sédation est définie comme la prescription d’agents psychotropes destinée à pallier chez un patient donné les symptômes réfractaires aux traitements standards. On parle de la sédation profonde comme d’un état d’inconscience et de la sédation continue comme d’une altération de la conscience maintenue jusqu’au moment du décès.
Si l’on considère que cette sédation telle que définie s’accompagne de l’arrêt des traitements – le troisième alinéa de l’article 2 qualifie à juste titre la nutrition et l’hydratation artificielles de traitements et non pas de soins – on prend pleinement conscience de la portée de cet article.
Certains, au nom de la liberté du patient de décider pour lui-même des conditions de sa fin de vie, trouvent que la proposition de loi ne remet pas en cause le statu quo et regrettent l’absence de l’euthanasie dite active et du suicide assisté. Les adversaires du texte, quant à eux, ont une lecture diamétralement opposée et dénoncent la porte ouverte à l’euthanasie. Ces positions sont l’une et l’autre respectables.
Avec plus d’une centaine de députés socialistes, avec nos amis écologistes et radicaux, j’ai cosigné un amendement qui nomme clairement les choses en parlant d’une « aide active à mourir ».
Tous les éléments que j’ai cités plus haut caractérisent cette réalité, mais sans le dire. On aide un patient qui sollicite un médecin, l’équipe soignante agit et le patient va mourir, d’épuisement, de mort naturelle liée à sa maladie ou du fait des thérapeutiques mises en oeuvre. Qui peut affirmer détenir la vérité ? Chaque histoire de fin de vie sera donc singulière, même si le cadre tracé est extrêmement strict.
Restent à mon avis deux interrogations qui méritent le débat. La première, c’est l’intentionnalité. Dans le texte, elle n’existe pas, les apparences sont sauves et le médecin, préservé. La clause de conscience s’applique donc de plein droit : elle n’a pas besoin d’être rappelée. Ma lecture est qu’il s’agit d’une pure fiction.
La seconde, c’est la durée de l’agonie. Selon le Comité consultatif national d’éthique, elle pourrait se prolonger de quelques heures à quinze jours. Je ne sais pas. C’est pourquoi je soutiens un amendement d’exception d’euthanasie pour tenter de répondre à des situations insupportables, notamment pour l’entourage.

Cette proposition qui date des années 2000 a été faite par le Comité consultatif national d’éthique et a été reprise dans ses conclusions par la conférence citoyenne sur la fin de vie.
Je crois qu’il faut sortir d’une position jésuitique. Un rapide survol d’une partie des messages déposés sur la plate-forme de l’Assemblée m’a montré la violence des mots utilisés : on parle de « violation des droits de l’Homme », de « régression de civilisation », de « solution finale »… Je crois vraiment qu’il faut qualifier davantage cet article 3 en parlant d’aide active à mourir.
Je termine en disant que c’est bien un nouveau droit que nous souhaitons ouvrir et pas seulement un nouveau modèle de soins. Là se situe la ligne de partage.
Si je reconnais les avancées réelles de ce texte, si je les préfère à un équilibre fragile et déjà contesté par les tenants de la loi Leonetti originelle, je crois que les Français sont prêts à aller plus loin : il nous appartient simplement de le décider.
Vifs applaudissements sur de nombreux bancs des groupes SRC, écologiste et RRDP.

Ce débat montre clairement qu’il n’y a pas consensus entre nous. Ce n’est pas uniquement un débat de convictions personnelles, c’est aussi l’affirmation de visions et de choix politiques différents.
Le débat, à dire vrai, n’est pas d’une absolue clarté. Certains nous disent, pour défendre le texte, qu’il ne change pas grand-chose ; d’autres nous disent, également pour le défendre, qu’il ouvre des droits nouveaux. Nous avons même entendu le Premier ministre, cet après-midi, déclarer qu’il constituait « une étape nouvelle ».
Une telle ambiguïté devrait appeler une sorte de principe de précaution politique, consistant à ne pas adopter un texte soutenu de cette manière.
Certains admettent que nous ayons des convictions personnelles, mais considèrent qu’elles ne seraient que des exceptions au consensus. Nous voyons que tel n’est pas le cas dans cet hémicycle : praticiens hospitaliers, autorités religieuses, citoyens de différentes origines nous montrent que le débat est complexe et varié.
Au demeurant, c’est une loi qu’on nous demande de voter : le débat n’est donc pas celui de la conscience personnelle. Au bout du compte, il s’agit de choix politiques et, là encore, j’appelle à un choix politique de précaution.
Il y a tout de même un sujet de consensus entre nous : le développement des soins palliatifs. C’est le résultat de la très riche réflexion que, depuis des années, conduit Jean Leonetti. Il y a là, madame la ministre, de véritables choix politiques, sur lesquels vous pouvez bénéficier d’un large consensus : des choix budgétaires, des choix d’organisation, des réponses à des carences anciennes… Ce n’est pas là affaire partisane, je vous l’accorde. Alors, madame la ministre, faites ce choix politique.
L’ambiguïté demeure quand on cherche à comprendre la raison d’être de ce texte. On comprend qu’il s’agirait de couvrir des choix faits, des risques pris par les médecins. On couvre des praticiens, mais on s’inquiète aussi à la lecture des réactions et commentaires de certains.
Notre inquiétude à nous aussi doit être prise en compte. L’alinéa 3 de l’article 3 a été évoqué, qui envisage la sédation pour le patient atteint d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé et qui présente une souffrance réfractaire à l’analgésie. Mais que les rapporteurs m’autorisent à dire mon inquiétude à la lecture de l’alinéa suivant : elle serait possible aussi « lorsque la décision du patient, atteint d’une affection grave et incurable, d’arrêter un traitement, engage son pronostic vital à court terme. »
Si je lis bien cette disposition, chers collègues, il s’agit d’arrêter un traitement parce que le pronostic vital de la personne est engagé. Mais la loi ne dit rien sur l’état du patient avant même l’arrêt du traitement !

C’est l’arrêt du traitement qui crée les circonstances justifiant la sédation. Nous nous approchons là très dangereusement de l’euthanasie. L’alinéa 3, c’est autre chose. Mais l’alinéa 4, comment ne pas appeler cela de l’euthanasie ?
Mes chers collègues, vous êtes habités par l’idée qu’il faut toujours faire un pas de plus. Mais quel pas ? Dans une société malheureusement rétive au risque, quand il y a des opportunités, pourquoi prendre le risque de ce texte aujourd’hui ? Je crois que ce n’est pas heureux et qu’il reste beaucoup à faire : vous l’avez dit, madame la ministre, et les rapporteurs en sont conscients. Le texte comporte un certain nombre d’affirmations intéressantes sur le développement des soins palliatifs. Il faut rappeler aussi la nécessité du colloque entre le patient et le médecin, qui ne peut être résumé dans la loi.
La loi ne peut pas et la loi ne doit pas tout écrire pour ces circonstances extrêmes. Je crois que ce texte n’a pas de réelle justification aujourd’hui.
Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’histoire législative française montre que les lois sociétales exacerbent les passions, clivent souvent le pays le temps des discussions à l’Assemblée nationale. Ensuite, elles alimentent aussi des rancoeurs souvent contraires aux principes philosophiques et religieux de ceux qui les entretiennent.
Pourtant, au fil du temps, force est de constater qu’aucune de ces lois, comme celle autorisant l’IVG par exemple, n’ont été supprimées. Nous venons même, s’agissant de cette dernière, de la faire progresser, malgré des tentatives de remise en cause. Il faut être persévérant, écouter, expliquer sans relâche, discuter et remettre sans cesse son ouvrage sur le métier pour faire aboutir ce que l’on pensait ne jamais obtenir.
Ces lois exacerbent les passions et au final laissent peu de place à la raison. Dans ce texte sur la fin de vie, il ne faut pas que l’essentiel de la discussion se résume à opposer « subir » à « choisir ».
Nous devons partir du constat que les Français meurent trop souvent mal. Il existe encore des disparités importantes sur notre territoire, disparités imputables à de nombreuses causes : des moyens financiers limités, l’absence de formation des équipes soignantes, des inégalités sociales et le désarroi des familles.
La loi Leonetti de 2005 avait amélioré cette situation, mais pas suffisamment. C’est pour cela que le Président de la République avait proposé, dans son vingt-et-unième engagement, d’apporter une amélioration au droit de mourir sans souffrance et dans la dignité, tout en accordant des droits aux patients.
En premier lieu, ce texte donne au malade le droit de décider d’accepter ou non des soins pour le maintenir en vie. Le patient aura aussi la possibilité de demander l’enclenchement de la sédation profonde et continue pour accompagner l’arrêt des traitements jusqu’à son décès. Et si le malade n’est pas conscient, il aura pu désigner une personne de confiance dont le statut sera enfin reconnu et qui le représentera le moment venu.
Ce texte n’est pas celui que j’aurais voulu voir aboutir. Je me sentais plus proche de la proposition de loi Massonneau et, dans la discussion générale de la proposition Leonetti d’avril 2013, j’avais émis le souhait que nous allions jusqu’à reconnaître aux Français le droit de choisir le moment de leur mort lorsqu’ils sont atteints d’une maladie incurable.
Mais du chemin reste à parcourir : il faut former les équipes médicales, faire évoluer le droit français et bien sûr les mentalités. Personne ne détient la vérité dans ce domaine, je suis certain qu’elle se construit tous les jours.
Alors je soutiendrai cette proposition de loi, parce qu’elle permet une avancée importante pour les personnes en fin de vie atteintes d’une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, qui ont la volonté d’éviter toute souffrance et de ne pas prolonger, selon elles, inutilement leur vie.
L’expérience de la vie, une forme de pragmatisme et la nécessité d’une décision apaisée me conduisent à préférer une amélioration de la situation plutôt qu’un entêtement à vouloir à tout prix obtenir ce que je souhaitais. Je laisserai mon égoïsme à la porte de l’hémicycle si cela peut permettre aux Français d’améliorer leurs conditions de mort, car c’est ce qu’ils souhaitent ardemment obtenir.
À ce stade, je formule deux voeux. Le premier est qu’au cours des discussions, nous puissions faire évoluer le texte et que, s’il n’y a pas de consensus, il soit adopté en l’état.
Le second tend à ce que cette fin de vie puisse être réétudiée assez rapidement, au cours de la prochaine législature, afin que les Français puissent avoir le choix de mourir librement, sans souffrance et dans la dignité.
Je remercie Alain Claeys et Jean Leonetti, qui ont réussi, avec l’aide de tous les groupes de travail, à rédiger un texte qui se rapproche des attentes des citoyens. Cette proposition de loi démontre aussi la capacité de la représentation nationale à faire fi des divergences inhérentes aux partis pour exprimer la volonté des Français dans ce domaine.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Il est loin le temps où Stendhal écrivait « Puisque la mort est inévitable, oublions-la. » Depuis plus d’une décennie, le moment et la manière de mourir font débat dans nos sociétés occidentales. Récemment, le contrôle de sa propre mort a émergé comme une revendication, faisant dans le même mouvement appel à un droit à l’accompagnement au moment de la mort.
Stade ultime de la vie avant la mort, l’agonie elle-même, longtemps considérée comme une étape naturelle, a peu à peu été perçue comme une souffrance lorsqu’elle durait. Ainsi, la fin devenue inéluctable d’une vie, jusque dans ses derniers instants, peut-elle être associée désormais à une souffrance qu’il convient de soulager par tous les moyens. C’est l’objet du projet de loi : soulager les souffrances lorsqu’elles sont insupportables, lorsqu’elles sont incurables, avant qu’elles ne durent.
Certains se mobilisent pour un droit à faire cesser les souffrances avant même qu’elles ne s’installent. C’est un questionnement tout aussi légitime, mais différent de celui qui nous réunit. Les partisans nombreux du libre choix de sa mort ont-ils un temps d’avance sur le droit à venir, ou attendent-ils une réponse à leur propre interrogation que le droit ne saurait fournir, en tout cas aujourd’hui ?
Que répondre à cette dame âgée qui m’a interpellé dimanche sur le marché pour me dire son souhait de mourir chez elle, le jour où elle aurait décidé d’en terminer avec une vie devenue trop longue à ses yeux ? Et ce bien qu’elle n’ait, elle-même, aucun scénario précis la concernant : juste le souhait de pouvoir, si la situation se présentait, choisir sa mort.
« Choisir sa mort », c’est une expression assez étrange, tant il est difficile de concevoir qu’on puisse souhaiter ce qui relève de l’inconnu.
Il faut dire que de tels sujets ne sont pas simples, tant ils nous renvoient à nos peurs les plus profondes : notre propre fin et celle de ceux qui nous sont chers. Il est difficile dans ces conditions de faire oeuvre de raison, tant la mise à distance est malaisée. Ils nous renvoient aussi à notre philosophie de la vie.
Pour certains, toute discussion sur ce sujet se heurte au caractère inviolable de la vie humaine. Pour d’autres, c’est l’exercice éclairé de son libre arbitre qui fait de l’être humain une exception dans le règne du vivant et lui permet de choisir quand et comment il cesse d’être au monde.
À cet égard, la démarche initiée par le Président de la République et conclue par Alain Claeys et Jean Leonetti m’a semblé tout à fait adaptée à la situation et aux enjeux, la recherche d’un consensus me paraissant la meilleure des solutions possibles dès lors que l’apaisement est compatible avec le progrès.
Il serait d’ailleurs péremptoire ou naïf d’affirmer ici que ce débat sera clos par l’adoption d’un seul texte de loi. Les avis sont et resteront très partagés sur la question, ne nous y trompons pas.
Toutefois, l’exagération ne doit pas avoir sa place : l’objet du texte de loi Claeys-Leonetti n’est pas d’instaurer un « droit à tuer », contrairement à ce que disent certains, mais d’accompagner la fin de vie dans des conditions de grande humanité, et de créer de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie de manière à éviter ou à abréger des souffrances, physiques, psychiques, devenues insupportables et qu’on ne saurait soulager.
Étant médecin, je me sens finalement mal à l’aise au moment d’intervenir dans ce débat que doivent s’approprier, selon moi, non pas les experts ni les professionnels mais avant tout les citoyens, quoique les soignants, parce qu’exposés régulièrement à la souffrance, à la fin de vie, à la mort, y aient toute leur place.
J’ai interrogé ma propre pratique de soignant, moi qui suis neurologue et qui ai été confronté à des situations de fin de vie difficiles : survenue brutale d’un handicap suite à un accident vasculaire cérébral, survenue progressive d’un handicap cognitif dans le cadre de démences, annonce de diagnostics de maladie neurodégénérative au pronostic désastreux… En lisant la proposition de loi, ce sont à ces souvenirs que j’ai fait appel, ainsi qu’aux échanges fournis que j’ai eus avec nombre de médecins, d’infirmières, d’aides-soignantes.
Avec des directives anticipées, avec la possibilité nouvelle de proposer à un patient une sédation profonde, terminale, les choses auraient-elles été différentes ? Oui, sans conteste. Auraient-elles été plus faciles ? Au moment de choisir d’arrêter un traitement, de suspendre la vie, rien ne saurait relever de la facilité.
J’ai aussi entendu ceux qui rappellent que la pratique existe dans les hôpitaux et qu’il suffit de continuer à fermer les yeux : à quoi bon une nouvelle loi, nous disent-ils ? Je crois sincèrement que c’est faire fi de la violence que représente pour le professionnel comme pour le parent le fait de devoir assumer, en prenant le risque de la culpabilité et du refoulement, un geste qui coûte déjà tant et qui, même s’il repose sur l’amour et la compassion, demeure une transgression.
Les soignants et les familles pâtissent réellement du recours insuffisant aux directives anticipées, indispensables pour leur permettre d’entendre et de respecter en toute situation la volonté exprimée par les patients eux-mêmes. Il peut être si dur d’exiger des familles qu’elles se prononcent pour leur proche ! Songez au cas du prélèvement d’organes, en cas de mort cérébrale : alors que la quasi-totalité des Français se disent prêts à donner leurs organes si la situation l’indique, nombre de familles refusent de prendre la décision pour leurs proches le moment venu.
Enfin, le droit à des soins palliatifs en toutes circonstances ne doit pas rester un voeu pieu mais doit devenir opposable. Vous avez annoncé un grand plan pour l’accessibilité aux soins palliatifs, madame la ministre, et c’est une excellente nouvelle. Le développement des soins palliatifs dans les établissements de santé mais aussi en équipes mobiles est une priorité. C’est aussi la demande des soignants, dont le dévouement et l’engagement sont remarquables.
Parce que les directives anticipées constituent pour leurs signataires l’assurance qu’à aucun moment leur parole et leur capacité de choisir ne leur seront ôtées, parce que la sédation profonde, terminale, est une réponse aux situations de souffrance qui peuvent accompagner certaines maladies incurables, ce projet de loi constitue une avancée majeure qu’il nous faut saluer et que, pour ma part, je voterai.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

La discussion générale est close.
La parole est à M. Alain Claeys, co-rapporteur de la commission des affaires sociales.

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la ministre, chers collègues, en quelques mots seulement, je souhaite remercier l’ensemble des personnes qui sont intervenues au cours de cette discussion générale.
Elle a été utile pour montrer que nous partageons plusieurs constats. Ainsi, il existe une inégalité en fin de vie et devant la mort. Chacun l’a dit avec ses mots. Il en a été de même s’agissant des soins palliatifs et de l’insuffisance de la formation.
Mais nous sommes aussi animés par une volonté politique commune, monsieur Mariton, quelle que soit notre place dans l’hémicycle : il s’agit tout simplement de faire reculer ces inégalités.

Je crois que personne, ici, ne saurait rester sourd à ce que nous disent nos concitoyens. Les douleurs sont parfois insupportables et l’indifférence est parfois au rendez-vous de la fin de vie. Nous devons y répondre, quels que soient les progrès apportés par les lois de 1999 et 2002 et celle de Jean Leonetti, en 2005.
Nous devons maintenant franchir une nouvelle étape, sans rompre l’équilibre existant depuis 1999. Tel est l’enjeu auquel nous sommes confrontés.
Pour répondre très clairement à certains de nos collègues, je pense que cette ambition et cette volonté politiques sont partagées. Si tel n’était pas le cas, ce serait une faute vis-à-vis de nos concitoyens. Dès lors, il est évident et logique de débattre de cette proposition de loi que nous portons avec Jean Leonetti.
Cette proposition de loi repose sur deux piliers. Tout d’abord, les directives anticipées, sur lesquelles nous reviendrons longuement. La plupart d’entre vous considèrent qu’il s’agit d’une avancée importante, qui accorde aux malades une nouvelle liberté et un nouveau droit. Mais certains ouvrent aussi un débat que nous ne devons pas négliger ou balayer d’un revers de main : celui du dialogue singulier qui doit exister à tout moment entre le patient, l’équipe de soins, le médecin et la famille. Je crois que ce dialogue est indispensable, mais qu’il doit avoir lieu à travers ce nouveau droit. Il n’y a ni antinomie ni opposition entre les deux, nous aurons l’occasion d’y revenir.
Deuxième pilier : la sédation profonde et continue. L’un de nos collègues a ici utilisé le mot malheureux d’hypocrisie. Il n’y en a pas ici. Chacune et chacun s’exprime en toute clarté et je n’ai pas le sentiment que Jean Leonetti et moi-même, avec ce texte, ayons fait preuve d’hypocrisie. Quel est son objet ? C’est simple : il s’agit de permettre une fin de vie apaisée et d’empêcher des souffrances insupportables. Voilà quel est notre choix.
Nous n’avons pas fait un autre choix qui aurait été possible : accorder le droit de donner la mort. Nous ne l’avons pas fait mais je respecte ceux qui, à travers leurs amendements, proposent d’autoriser le suicide assisté ou l’euthanasie. Nous aurons l’occasion d’en débattre, mais notre choix n’a rien d’hypocrite.
Volonté politique commune, désir d’avancer, constat partagé, efforts en faveur des soins palliatifs, y compris sur le plan de la formation : le débat va maintenant s’ouvrir autour des directives anticipées et la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Je vous remercie.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

La parole est à M. Jean Leonetti, co-rapporteur de la commission des affaires sociales.

Je m’associe bien entendu aux propos d’Alain Claeys. Le large consensus qui règne autour des soins palliatifs a été évoqué, quels que seront nos choix à venir. Je rappelle que le présent texte, et en particulier son article 3 concernant la sédation profonde et continue jusqu’au décès, est validé par tous les présidents des sociétés françaises de soins palliatifs. Il s’agit d’un copier-coller des bonnes pratiques des soins palliatifs en cas de douleurs ou de souffrances réfractaires lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.
Il est donc difficile de prétendre que les soins palliatifs doivent être développés partout et de considérer que la pratique qui en relève et que promeut ce texte ne doit pas l’être.

J’appelle donc l’attention de chacun et je vous invite à approfondir le sens de chaque mot. Je suis d’ailleurs d’accord avec ceux qui ont estimé que, derrière chacun d’entre eux, il y a un acte, lequel doit être pesé et expliqué pendant le débat. Mais je rappelle, pardonnez-moi de le dire comme cela, que le dispositif prévu à l’article 3 relève des soins palliatifs. Je rappelle aussi que l’on ne peut à la fois se plaindre de l’inapplication des lois antérieures et les oublier.
Depuis 2002, et non 2005, les malades ont le droit d’arrêter des traitements même si cela met leur vie en danger. Chaque médecin, dans l’exercice de son métier, a dû gérer des moments aussi difficiles que, par exemple, la demande d’un patient d’arrêter un respirateur artificiel.
Nous savons fort bien que le dialogue singulier évoqué par Alain Claeys est indispensable. Et pourtant, ce patient a bien le droit de demander cet arrêt ! Et si c’est le cas, procéderons-nous comme dans la médecine archaïque, autoritaire, paternaliste d’il y a trente ans, en disant que oui, nous allons arrêter, mais qu’il va souffrir et étouffer ? Non ! Le devoir de solidarité, qui n’est pas un acte euthanasique, consiste à respecter la liberté et l’autonomie du patient tout en protégeant sa vulnérabilité. Cet acte, à mes yeux, n’est pas euthanasique mais fraternel à l’endroit de quelqu’un qui a décidé d’interrompre un traitement de survie ou qui a refusé son application.
Revenons aux textes antérieurs dont celui-ci constitue peut-être une synthèse – je songe au droit aux soins palliatifs pour tous, au droit à la sédation lorsque la douleur est insupportable, au droit d’arrêter les traitements même si cela met en jeu le pronostic vital.
Je reconnais l’intelligence malicieuse de M. Touraine lorsqu’il assure ne pas proposer l’autorisation de l’euthanasie et du suicide assisté mais simplement une « étape supplémentaire » qui « pourrait s’insérer » dans le texte « sous la forme d’un alinéa qui »… Mais nous sommes là pour nous dire les choses : si la lettre de mission du Premier ministre avait compris le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté, nous ne serions pas deux sur ce banc, aujourd’hui, pour rapporter ce texte et celui-ci, probablement, serait donc différent.
Un choix a été fait, nous avons essayé et nous essaierons de l’assumer jusqu’au bout, conjointement, avec Alain Claeys.
J’ai bien vu, après chaque orateur, que lorsqu’une partie de l’hémicycle applaudissait, l’autre restait silencieuse. Je vois bien que nos points de vue, qui sont absolument légitimes, divergent encore beaucoup.
Je me souviens de nos discussions en 2005. Avec le temps, forcément, on a tendance à embellir l’histoire, on songe au beau consensus qui régnait au sein de l’hémicycle, à ces 577 députés qui votent… Mais certains disaient qu’il ne s’agissait que d’une étape, que l’on irait plus loin, alors que d’autres considéraient que l’on avait déjà été trop loin et qu’il fallait arrêter !
Je sais bien que ces divergences existent au sein de l’hémicycle, en particulier au moment crucial où chacun considère que franchir une étape législative ensemble revient à faire preuve d’efficacité pour nos concitoyens. Cela n’enlève rien à ce que nous croyons, cela ne nous fait pas renier nos espérances, dans un sens ou dans un autre.
C’est pourquoi nous commençons ce débat dans un esprit d’ouverture et avec une volonté d’explication. Mais je rappelle aussi que l’équilibre est fragile. Si l’on vidait ce texte de son sens, si l’on supprimait les droits des malades qui existent déjà, pourquoi légiférer ? Et si l’on devait basculer dans la promotion de l’euthanasie ou du suicide assisté, là encore l’équilibre serait rompu. Je le dis très sincèrement et sans vouloir influer sur qui que ce soit.
Si le texte basculait dans un sens ou dans un autre, ni M. Claeys, je pense, ni moi-même ne pourrions en être rapporteurs, car il serait dénaturé et n’aurait plus le sens que nous lui avions donné.
Je le dis très amicalement à M. Touraine, et il le sait : son amendement n’apporterait pas une modification superficielle au texte, mais le transformerait. Si tel devait être le cas, il n’aurait pas fallu que nous allions jusqu’au bout ensemble pour essayer de répondre très pragmatiquement à la souffrance que les personnes en fin de vie éprouvent encore dans notre pays.
Le débat est ouvert. J’ai entendu les engagements de la ministre et du Président de la République. Nous devons respecter cet équilibre, promouvoir la culture des soins palliatifs à travers la formation des médecins et franchir cette étape législative qui constitue aussi un signal et un symbole : dans notre pays, la souffrance est interdite en fin de vie et en phase terminale. Je vous remercie de votre attention.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et du groupe UMP.

J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles de la proposition de loi.

De nombreux orateurs sont inscrits sur l’article 1er. Je serai vigilante sur le temps de parole, de façon que tous ceux qui le souhaitent puissent s’exprimer.
La parole est à M. Nicolas Dhuicq, pour deux minutes donc et pas davantage.

On nous dit qu’il s’agit d’assurer l’égalité d’accès aux soins. Mais quel intérêt y a-t-il à adopter une nouvelle loi, s’il suffit d’avoir des moyens et la volonté politique ? S’il faut assurer l’égalité d’accès aux soins, c’est bien que la politique du Gouvernement, et peut-être les politiques menées antérieurement, ont échoué à le faire.
Ce texte témoigne par ailleurs d’une dérive vers une société normative, dans laquelle il faudrait absolument que nous pensions de la même façon, que nous consommions les mêmes choses, que nous menions les mêmes vies, et que nous ayons la même mort. Pour ma part, je revendique la capacité pour les individus, qu’ils soient soignants ou patients, d’avoir accès au colloque singulier. Je voudrais également rappeler que, depuis des lustres, les médecins qui prêtent le serment d’Hippocrate appliquent en leur âme et conscience les principes qui viennent d’être évoqués.
Pour nombre d’entre vous, je l’entends bien, cette loi est un pas vers une normalisation de la société. Il s’agit, au mieux, d’une loi inutile.

Nous entamons, avec cet article 1er, l’examen d’une proposition de loi qui suscite beaucoup d’attention parmi nos concitoyens, chacun ayant été ou pouvant être confronté à une situation de fin de vie, et projetant dès lors ses craintes, ses angoisses et ses souhaits. Ce débat doit, selon moi, viser à apaiser et à rassembler les Français et la représentation nationale, la fin de vie et la mort n’étant – on l’aura bien compris – ni de droite, ni de gauche. Je tiens, à cet égard, à saluer le travail commun de nos co-rapporteurs, et particulièrement l’engagement constant, depuis plus de dix ans, de Jean Leonetti sur ce sujet. Ce texte s’inscrit dans le prolongement d’autres lois et ne doit donc pas viser une rupture, mais d’abord une consolidation des dispositifs existants.
Tel est, de mon point de vue, l’objectif de cet article 1er qui, tout en réaffirmant le droit des patients, distingue les traitements et les soins et précise qu’un arrêt de traitement n’entraîne pas nécessairement un arrêt des soins, notamment palliatifs. Je regrette néanmoins que le simple fait d’examiner un nouveau texte risque de diviser à nouveau notre pays, alors que nous avons besoin d’un consensus et d’une convergence d’énergie pour relever ce qui constitue selon moi le vrai défi, à savoir allouer de réels moyens humains et budgétaires au développement indispensable des soins palliatifs. Dès lors que nous convenons ensemble que le mal mourir est encore une réalité dans notre pays, il nous appartient, à l’occasion de l’examen de ce texte, de nous interroger sur les causes, les obstacles et les freins à la mise en oeuvre de textes déjà adoptés, mais trop peu appliqués.
Je voudrais saluer, madame la ministre, l’annonce et le principe de ce plan triennal, dont je suis impatient de connaître le détail et les modalités.
Vous l’aurez compris : vous aurez une très large majorité, dès lors qu’il sera question du développement des soins palliatifs en France.

Les arbitrages budgétaires vous permettront-ils d’augmenter la formation des acteurs sur le terrain et de réaliser la révolution culturelle qui s’impose ? Aurez-vous les moyens de combler le déficit de lits ? Conforterez-vous les acteurs qui, sur le terrain, se battent quotidiennement d’une manière admirable pour ajouter de la vie au temps qui reste ?

L’article 1er est anodin. Il est effectivement important de distinguer le traitement et les soins – encore que nous autres, médecins, sommes appelés des soignants et pratiquons des traitements…
Je voudrais surtout appeler votre attention sur le dernier alinéa de cet article : « Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. » Quand, au juste, la fin de vie commence-t-elle ? Les malades d’Alzheimer, qu’on a tendance à oublier, ont parfois une fin de vie très longue. Est-elle digne ?

Oui, car la dignité, c’est le regard des autres, notre regard de bien portants sur ceux et celles qui souffrent.

Alors, faisons bien attention : il est vrai que toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, mais c’est en la regardant de façon digne qu’on lui rend sa dignité.
Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe UMP.

Notre priorité, à travers ce projet de loi, est d’épargner la souffrance aux personnes en fin de vie, de faire en sorte qu’elles soient bien accompagnées et écoutées, et de répondre aux incertitudes des familles. Tout l’enjeu consiste à trouver le juste équilibre entre la liberté du patient et de la famille et la responsabilité du médecin. L’un des volets de ce projet de loi, et non des moindres, est d’assurer le développement de la médecine palliative, car notre pays a pris un retard considérable dans ce domaine.
Dans la plupart des situations de fin de vie – 64 % des décès sont dus aux suites d’une maladie – une prise en charge en soins palliatifs est nécessaire. Grâce à la précédente majorité, la situation s’est améliorée, avec les effets du programme national, mais le recours à ces soins est encore limité. La politique des soins palliatifs reste insuffisante et très inégale sur l’ensemble du territoire.
Je voudrais évoquer le cas douloureux de l’une de mes administrées, dont le mari est décédé dans des souffrances atroces il y a trois mois. Elle m’a écrit les mots suivants : « Il a vécu le martyre, tant il a souffert. Je vous précise, madame le député, qu’il n’y avait aucune pompe à morphine dans le service, ce qui l’aurait soulagé de ses souffrances. » Et cette dame d’ajouter humblement : « Je souhaiterais connaître votre avis sur ces maltraitances qui existent dans les centres hospitaliers. Trouvez-vous cela normal, à notre époque ? Ne peut-on soulager ces mourants qui sont en phase finale ? Que de douleur physique, morale, lorsqu’ils luttent contre la mort ». Et de conclure : « Je ne peux oublier ces images traumatisantes. Je suis comme mon fils : marquée à vie. »
Dès lors, la priorité était-elle vraiment d’écrire une nouvelle loi pour respecter l’engagement no 21 du Président de la République ? Ou bien n’est-elle pas plutôt d’appliquer les lois de 1999 et de 2005 ?
Restons vigilants ! Ne focalisons pas nos débats sur la question de l’euthanasie, qui est un choix largement minoritaire, et concentrons-nous sur ce qui constitue une urgence absolue, à savoir traiter la douleur et la souffrance des patients en fin de vie.

L’article 1er souligne l’importance de la dignité et de l’apaisement dans la fin de la vie, ce qui est une bonne chose. Néanmoins, l’expression « toute personne a droit à » me laisse un peu perplexe. Sans vouloir lancer un débat sur les « droits à », je voudrais savoir ce qui se passera lorsque la dignité de la fin de la vie et l’apaisement ne seront pas assurés. Quelle est exactement la portée de cet alinéa ?
Il est bon de rappeler combien la dignité et l’apaisement dans la fin de la vie sont importants – c’est une évidence, mais il est bon de rappeler certaines évidences. Pour autant, je ne comprends pas ce que signifie la notion de « droit à » – et son introduction dans le dispositif législatif me paraît grave.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, certes, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui marque un grand progrès dans le droit des patients en fin de vie : la volonté du patient est respectée, grâce à la reconnaissance des directives anticipées, et il a la garantie d’une mort apaisée et sans douleurs, grâce au droit à la sédation profonde et continue.
Pour autant, après de nombreux échanges, lectures et rencontres, je suis convaincue que cette proposition de loi laisse dans l’impasse nombre de situations : je pense aux personnes qui souhaitent, pour des raisons médicales ou personnelles, mettre fin à leur vie dans la dignité. Alors que s’ouvre le débat parlementaire en séance, il est indispensable que nos convictions personnelles puissent s’exprimer.
Sur ce sujet, comme sur les autres, je suis pour la liberté. Et la liberté, c’est le droit pour chacun de pouvoir choisir les conditions de sa propre fin de vie. Nous avons eu, dans de tristes circonstances, l’occasion de rappeler notre attachement à la liberté. Liberté d’opinion, liberté d’expression, mais aussi liberté de choix. Ce que je souhaite profondément, c’est ouvrir le champ des possibles. Nous avons su le faire sur d’autres sujets, pourquoi pas sur la fin de vie ?
L’euthanasie ou le suicide assisté, qui est pratiqué dans certains pays, comme l’aide active à mourir, sont des sujets essentiels, qui ne peuvent être éludés lorsqu’on débat de la fin de vie. Il faut que nous soyons capables, dans cet hémicycle, d’aller au bout de ces questions. Nous le devons à nos concitoyens, en particulier à tous ceux qui souhaitent décider du moment et de la manière dont ils veulent mourir.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, nous abordons un sujet terriblement important, parce que mourir, c’est terriblement important. Or nous avons à présent les moyens médicaux, avec la chimie, d’être terriblement bienveillants. Et la bienveillance est une chose que demandent tous ceux qui souffrent.
Auparavant, il y avait des mouroirs, où l’on visitait « les vieux ». Les vieux, c’est ceux qui allaient mourir. On venait les saluer et le corps médical les accompagnait, du mieux qu’il pouvait. On a oublié aujourd’hui que, pendant des millénaires, mourir signifiait souffrir. Nous avons désormais la possibilité d’apaiser cette souffrance, voire de la supprimer – y compris les souffrances psychologiques du dernier instant. Mais cet apaisement suppose l’intervention d’un tiers. Ce tiers – médecin, infirmière, soignant – est aussi une personne humaine, qui a son propre rapport à la vie. Et le droit d’actionner ce bras doit aussi être le fruit d’un dialogue.
Après la loi de 2005, nous avons veillé, avec les deux rapporteurs de cette loi, dont je salue le travail, à trouver un équilibre. Un équilibre subtil et qui me semble avisé, si l’on considère qu’une société n’est pas un conglomérat d’individus, mais aussi un corps, composé de personnes qui ont des choses en commun. Les articles de cette loi constituent un consensus subtil et délicat, pour avancer encore. Ils donnent au malade, à la personne en fin de vie, le droit et la possibilité d’être celui qui actionne et qui décide en confiance, avec son soignant. C’est cette confiance, à la fin de la vie, cet apaisement face à l’angoisse de la mort, que nous avons recherché dans cette loi.

Il y a dix ans, nous avons adopté à l’unanimité la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Cette loi avait constitué une avancée majeure en termes de reconnaissance des droits des malades en fin de vie. Elle avait clairement proscrit l’acharnement thérapeutique et reconnu le droit du malade, en lui permettant de refuser un traitement et de rédiger des directives anticipées, afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie. Pour autant, force est de constater que des difficultés demeurent : la douleur des patients n’est pas encore suffisamment prise en charge ; l’obstination déraisonnable demeure malheureusement une réalité en France, et l’accès aux soins palliatifs n’est pas toujours effectif.
Dans ces conditions, nous devons faire en sorte qu’il n’y ait plus ni souffrance, ni abandon, ni acharnement. Si la loi du 22 avril 2005 a permis d’apporter un certain nombre de réponses à ces questions, des zones d’ombre subsistaient néanmoins et justifiaient la réflexion menée par Jean Leonetti et Alain Claeys. Le texte dont nous débattons aujourd’hui est le fruit de cette réflexion : il est issu à la fois de l’expérience de nos deux rapporteurs et d’un processus de concertation minutieux, avec la mission confiée au professeur Didier Sicard, la réflexion demandée au Comité consultatif national d’éthique et une large consultation citoyenne.
Cette proposition de loi, dont j’estime qu’elle fait preuve d’une sagesse salutaire, renforce le droit des patients sans heurter inutilement les consciences. Elle rappelle que dix ans après l’adoption de la première loi Leonetti, celle-ci reste mal connue et peu appliquée. On continue, bien souvent, à mal mourir en France, dans des conditions douloureuses ou dégradantes, et c’est à cela qu’il importe, me semble-t-il, de remédier. Ce texte devrait pouvoir y contribuer.

Madame la ministre, mes chers collègues, le débat dans cet hémicycle est délicat pour nous, car il fait écho à nos histoires personnelles. Délicat également pour ceux qui nous écoutent ou nous lirons, car ils peuvent se sentir incompris ou mal compris.
Tous, nous avons à l’esprit un ami ou un parent qui a eu une fin de vie douloureuse ; mais tous aussi nous connaissons de belles histoires de retrouvailles inattendues, de pardons demandés et accueillis. Il est donc particulièrement important que le respect prévale dans nos débats, même si bien évidemment nous ne serons pas tous d’accord.
On nous demande l’égalité face à la fin de vie. Pourquoi pas ? Malheureusement, elle n’est qu’utopique. On meurt à des âges différents, dans des conditions différentes, plus ou moins entouré, plus ou moins préparé. La seule égalité, c’est que nous mourrons tous.
L’enjeu de cette proposition de loi – et je veux saluer le travail de Jean Leonetti et Alain Claeys – est d’accepter le laisser mourir sans permettre le faire mourir. Mais je regrette qu’au lieu de promouvoir la loi de 2005 pour qu’elle soit mieux appliquée et mieux connue, on décide d’en repousser les limites.
Chaque vie vaut la peine d’être vécue, chaque personne doit être respectée quel que soit son état de santé ou de dépendance. Toute souffrance doit être soulagée. Une jeune femme dont l’enfant était condamné à court terme rappelait dans un livre poignant une citation du médecin et académicien Jean Bernard : « Quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, ajoutons de la vie aux jours ». Cette phrase illustre bien ce que sont les services de soins palliatifs. Celui qui meurt a besoin d’affection, de douceur, de compréhension et de soulagement.
Il y a évidemment des cas particuliers qui ne peuvent pas être pris en charge dans le cadre de la loi Leonetti de 2005. Mais la loi est faite pour dire la norme générale et s’appliquer à tous, pas à des exceptions.
Un mot enfin pour les soignants qui se dévouent pour accompagner les personnes en fin de vie. Leur présence indispensable aux côtés des familles est précieuse et le texte qui sortira de cet hémicycle ne doit pas aller contre leur conscience et leur liberté.

Madame le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, n’ayant pas eu l’occasion de m’exprimer pendant la discussion générale, je vais essayer de partager avec vous quelques réflexions d’ensemble sur ce texte et reviendrai plus précisément sur l’article lors de la discussion des amendements.
Je partage l’ensemble des réflexions formulées au cours de la discussion générale sur le caractère au fond assez inutile de ce texte. Je fais partie de ceux qui pensent que la loi de 2005 était un point d’équilibre, certes imparfait. Nous savons où se situaient ses zones d’ombre et ses imperfections. Mais je constate que ces zones d’ombre ne disparaissent pas dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui.
L’article 1er, en particulier, prévoit la suppression de certaines dispositions. C’est notamment le cas de la référence pourtant très utile à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, qui mentionne explicitement les soins palliatifs. Lorsque le praticien ne sait plus à quel saint se vouer, le texte actuel du code de la santé publique lui enjoignait de recourir à ce type de soins. Cette référence disparaît, c’est dommage car il n’y avait pas d’utilité particulière à l’effacer à ce stade.
Au cours de la discussion générale, ce texte a été présenté par ceux qui le soutiennent comme un équilibre entre deux points antinomiques. Il ne faut pas confondre l’équilibre et l’ambiguïté. Je ne pense pas que ce texte soit équilibré, et la discussion dans l’hémicycle aujourd’hui, demain et peut-être après-demain, le montrera. Je crois que ce texte est ambigu car sur certains points – pas nécessairement à l’article 1er, mais plutôt aux suivants – il recèle des dangers. C’est pourquoi je proposerai avec certains de mes collègues la suppression de certaines de ses dispositions.

Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, le débat qui va nous occuper jusqu’à demain soir est d’importance. Il traverse notre société au gré des parcours, des âges, des expériences. Il nous concerne tous, d’une manière ou d’une autre, et c’est l’honneur de notre Parlement que d’être capable de le tenir pour avancer sur cette problématique.
Je tiens d’ailleurs à saluer le travail commun réalisé par nos collègues Jean Leonetti et Alain Claeys. Tout l’enjeu est de savoir comment nous avançons. Ce premier article, qui redéfinit les rapports entre les patients et le corps médical, est bienvenu. Les rôles et les droits de chacun doivent en effet être mieux encadrés. Le patient doit être placé au coeur du processus, quelles que soient nos positions. La proposition de loi de Mme Massonneau, examinée il y a quelques semaines, ainsi que la présente proposition de loi l’ont bien pris en compte.
La difficulté à définir la fin de vie s’accompagne souvent de la réticence des services à la reconnaître. L’annonce faite au malade et l’accompagnement des proches ne sont pas systématiquement envisagés, et les personnels n’ont pas toujours le savoir-faire ou la volonté nécessaire. Par conséquent, les droits du malade en fin de vie sont difficiles à exercer.
Cet article prévoit notamment, pour faire suite aux travaux de la commission, un meilleur apaisement de la douleur. C’est une nécessité, car elle est souvent assez mal prise en compte. D’ailleurs, ce débat nous amène à nous demander jusqu’où aller dans les soins, nous y reviendrons un peu plus tard. Pour ma part, je refuse toute souffrance ou tout acharnement. En cela, la référence introduite à l’alinéa 10 du présent article au droit à une fin de vie digne et apaisée est une avancée importante que je tiens à saluer.

Mes chers collègues, je ferai deux observations et une proposition. Ma première observation est que cette loi s’inscrit dans la voie ouverte par la grande loi Kouchner de 2002 qui a donné pour la première fois des droits aux malades. C’est ici le droit à une fin de vie digne et apaisée qui est en train de s’écrire.
Ma seconde observation est qu’avant d’atteindre cette ultime limite qui nous fait vaciller, soit par la sédation profonde et continue conduisant à un sommeil dont on ne se réveillera pas, soit par l’aide active à mourir que nous propose Jean-Louis Touraine, il importe que cette loi éclaire d’une exigence et d’une volonté, nouvelles et fortes, la prise en charge palliative des malades.
Nous savons tous, ici et ailleurs, que cette prise en charge est très insuffisante, qu’elle creuse un profond sillon d’inégalité entre les territoires et entre les gens. Nous savons tous que moins de la moitié des médecins prétendent bien connaître les dispositifs législatifs de fin de vie et que la barrière entre soins curatifs et soins palliatifs n’est pas un leurre. Nous savons tous enfin, et cela a été dit à la tribune ce soir, que les produits pour calmer la douleur la plus réfractaire existent, mais que leur développement comme leur usage est, d’une manière tout à fait injustifiée, très limité.
Alors, à côté de ces interrogations majeures autour du dernier geste, il nous faut nous engager résolument dans le chemin de la non-souffrance en utilisant tous les progrès de la recherche, et en ayant obligation de les proposer au malade où qu’il se trouve : à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement accueillant les personnes âgées ou handicapées.
Ma troisième observation est en fait une proposition afin de donner une reconnaissance législative aux référents en soins palliatifs, médecins et aides-soignants, qui sont actuellement prévus dans les établissements de santé par une circulaire de 2007. Il faut que ces référents constituent un recours, une écoute possible pour tout malade en souffrance, qu’il soit à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un EHPAD. Il nous faut imaginer des recours vers des « sachants », comme autant d’utiles soutiens tant pour les malades que pour les équipes médicales.
Des amendements seront défendus en ce sens, afin d’étendre le rôle de ces référents et d’imposer leur mise en place par la présente loi, et non plus en vertu de la simple circulaire de 2007. Ce problème majeur l’exige.

Madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous réunit ce soir a pour but de contenter une partie de la majorité qui réclame une avancée vers l’aide à mourir. C’est donc un texte éminemment politique. Or pour moi comme pour beaucoup de nos concitoyens, il n’y a nul besoin de légiférer à nouveau sur ce sujet. D’ailleurs, on légifère beaucoup trop dans notre pays.
La loi Leonetti du 22 avril 2005, qui a été adoptée à l’unanimité, devait déjà permettre à tous de mourir dans la dignité, selon l’expression tant galvaudée par certaines associations. En effet, cette loi centrée sur l’accompagnement de la personne permet déjà le respect de la dignité humaine en interdisant l’acharnement thérapeutique, en autorisant l’arrêt des traitements dans certains cas et en prônant le développement des soins palliatifs.
On nous dit qu’elle n’est pas assez connue et pas assez appliquée. Certes, mais alors au lieu de légiférer à nouveau sur ce sujet d’une grande complexité, que le Gouvernement agisse pour la faire connaître et pour développer les soins palliatifs.
Tous les Français souhaitent mourir dans de bonnes conditions, sans souffrir et bien entourés. Or il est choquant que seuls 20 % des personnes en fin de vie puissent bénéficier des soins palliatifs dans notre pays. Il n’est pas normal que ces soins soient si mal répartis sur notre territoire, en particulier au détriment des territoires ruraux. Il n’est pas normal que les soins palliatifs à domicile soient si peu développés alors que beaucoup d’entre nous préfèrent mourir chez eux plutôt qu’à l’hôpital. Il n’est pas normal que la grande majorité de nos soignants ne soit pas formée au soulagement de la douleur, alors que tant de progrès ont été faits dans ce domaine.
Ce gouvernement a donc déjà toutes les armes législatives pour permettre à chacun de mourir dans la dignité. En revanche, il faut qu’il développe les soins palliatifs, qu’il forme mieux les médecins et tout le personnel médical. Cela représente un coût, certes, mais cela devrait être une priorité. Notre priorité à tous devrait être le respect de la vie, de son début à sa fin ultime. La vie, et les événements tragiques nous le montrent chaque jour, est ce que nous avons de plus cher.

Madame la ministre, je suis également de ceux qui regrettent la disparition, à l’article 1er de cette proposition de loi, de la référence aux soins palliatifs qui existait à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Il faut la réintroduire expressément. Cela avait d’ailleurs été approuvé à l’unanimité dans la loi Leonetti de 2005.
Nous savons tous ici que les exigences de cette loi n’ont pas été respectées et que trop de nos concitoyens, en fonction de l’endroit où ils meurent, à domicile ou à l’hôpital, à Paris, dans les grandes villes ou dans de plus petites villes de province, ne disposent pas d’un égal accès aux soins palliatifs, à ces soins d’apaisement à un moment crucial de leur vie.
Vous nous l’avez dit, madame la ministre, le Président de la République a demandé qu’une formation aux soins palliatifs et aux soins d’apaisement soit introduite dans le cursus des étudiants en médecine. C’est une bonne chose, mais il faut aller plus loin et assurer la formation initiale et continue de tous les personnels soignants, y compris les infirmières et aides-soignantes. C’est la condition d’un égal accès aux soins palliatifs.

Mes chers collègues, je vais apporter un point de vue dissonant par rapport à certains des orateurs qui se sont exprimés avant moi. Je pense qu’il s’agit d’un texte équilibré, et que les rapporteurs ont fait leur possible pour trouver un point de consensus sur un sujet extrêmement compliqué.
Les amendements que j’ai cosignés à cet article 1er concernent les soins palliatifs. À la question de savoir si nous avons peur de la mort et quelle mort nous voulons, nous répondons de manière très diverse. Certains d’entre nous appréhendent cette échéance, d’autres sont capables de rédiger de manière très claire leurs directives anticipées. Nous avons tous des approches philosophiques, humaines, et peut-être même sociologiques, différentes sur cette question.
En revanche, s’il existe bien un point de consensus, c’est sur la souffrance. Les gens n’ont pas nécessairement peur de mourir, mais ils ont toujours peur de souffrir. Nous sommes tous en accord sur le fait que si abréger la vie est en soi un sujet clivant, abréger la souffrance fait consensus, et nous devons chercher des points de consensus. C’est pourquoi j’ai proposé, avec d’autres collègues, que soit martelée la notion de soins palliatifs et même, de manière plus générale, la culture palliative, de laquelle me paraissent relever les dispositions prévues aux articles 3 et 4 de cette proposition de loi, notamment sur la sédation. Cela vient enrichir le texte sans en perturber les équilibres.
Certains de mes collègues ont regretté que cet article 1er ne fasse pas explicitement référence aux soins palliatifs. Il faudrait surtout rendre cette notion opérationnelle par rapport au système actuel, de manière à permettre une fin de vie que je qualifierai, plutôt que de « digne et apaisée », de sans souffrance et apaisée, parce que tel est le désir véritable de nos compatriotes.

Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, que nous disent nos concitoyens ? Que nous apprennent les derniers moments de nos proches ? Deux choses qui, loin d’être contradictoires, sont complémentaires.
Ils disent non à l’acharnement thérapeutique, non à la douleur inutile, non à l’excès de technique, non à l’isolement que cette technicité accroît encore.
Ils nous demandent aussi de les protéger, de les défendre, de défendre les plus fragiles.
Ils nous demandent de ne pas tomber dans la logique stoïcienne de celui qui veut décider du lieu, de la date et des modalités du terme de sa vie, de celui qui prétend décider seul de tout. Notre tradition occidentale, en particulier judéo-chrétienne, est contraire à cette éthique quasi-prométhéenne de l’autonomie : au contraire, elle a toujours privilégié l’éthique de la vulnérabilité.
Toute personne humaine est digne – le professeur Debré le disait très justement tout à l’heure à propos des malades d’Alzheimer. La vulnérabilité et la fragilité, en particulier celles de la personne handicapée, du vieillard grabataire ou de l’agonisant, sont au coeur de cette dignité. Je persiste à penser que le degré de civilisation d’un pays s’apprécie au regard de la place faite aux plus faibles.
À cet égard, la vraie priorité n’était pas de modifier la loi Leonetti, qui correspondait, me semble-t-il, à un équilibre tout à fait intéressant, mais de lancer un véritable plan, de façon à ce que notre pays rattrape le retard qu’il connaît depuis trop longtemps dans le domaine des soins palliatifs.
C’est sur ces questions-là que j’insisterai tout au long de notre débat.

De la discussion générale ressort bien sûr la nécessité de traiter la souffrance et la douleur en fin de vie, mais aussi celle de développer la culture des soins palliatifs et les établissements qui les dispensent.
Les questions que je vais formuler s’adressent à Mme la ministre, qui pourrait très utilement prendre quelque temps pour détailler ce qui a été esquissé tout à l’heure. Au-delà des mesures présentées par le Président de la République, certaines précisions seraient de nature à éclairer la représentation nationale.
Quid de la formation initiale et continue des médecins et des soignants en général ? Quid des lits supplémentaires identifiés soins palliatifs – LISP ? Combien y en a-t-il, et comment prévoyez-vous de les développer dans le cadre d’un plan triennal ou sur quelques années ? Quid du développement des équipes mobiles ? Quid des équipes d’hospitalisation à domicile ? Quid des moyens des EHPAD et de la présence d’infirmières et d’aides-soignantes dans ces établissements, y compris la nuit ? Quid de la tarification à l’activité dans les hôpitaux, la fameuse T2A, qui n’est pas très favorable au développement des soins palliatifs ?
Des réponses à ces questions simples, précises, permettraient d’éclairer la représentation nationale et de juger de votre volonté réelle d’élaborer un vrai plan en faveur des soins palliatifs, à l’instar du plan Cancer. De façon plus générale, quid des moyens humains et des moyens matériels ? Donnez-nous les éléments qui permettront de mener à bien votre ambition, afin que nous puissions, en toute sincérité et en toute humilité, juger de ce grand plan qui serait enfin annoncé et qui permettrait enfin de promouvoir réellement la loi Leonetti et les soins palliatifs, et donc de mieux traiter la fin de vie dans notre pays.

Je veux dire d’emblée que je voterai ce texte s’il n’est pas trop amendé, s’il n’est pas dénaturé, s’il reste proche de ce qu’il est aujourd’hui. Il est le fruit d’un équilibre et apportera quelque chose à notre société.
Pour ma part, je me suis posé deux questions. Impose-t-on quoi que ce soit à qui que ce soit ? Non. Ouvre-t-on des droits à des citoyens, à des individus libres ? Oui : on leur ouvre un droit supplémentaire. Certains pourraient en souhaiter davantage, d’autres trouvent que c’est déjà trop, mais c’est le citoyen qui choisit : là est l’essentiel.
La douleur est encore trop fortement présente dans nos hôpitaux, parce que nous n’avons pas, dans notre culture, le souci de l’apaiser, parce que nous n’avons pas assez formé le corps médical et les soignants, et parce que nous avons eu une mauvaise approche de ce sujet depuis trop longtemps. Nous devons conduire une politique publique très forte visant à apaiser la douleur.
Par ailleurs, j’ai le sentiment que nous faisons fausse route sur un point. Nous devons bien sûr développer les soins palliatifs, si notre pays en a les moyens – la politique hospitalière est aussi soumise à des contraintes budgétaires –, pour assurer la justice entre nos concitoyens et répondre à un besoin de santé publique. Cependant, même dans un service de soins palliatifs, la question de la fin de vie se posera : ce n’est pas parce qu’une personne est bien soignée, mieux encadrée et rassurée qu’elle ne se posera pas la question qui nous préoccupe tous. Le développement des soins palliatifs est une nécessité de santé publique, mais elle n’est pas la réponse à la question que nous nous posons.

Je ne dirai que quelques mots sur cet article 1er, qui procède à la réécriture de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique en précisant les droits des malades en fin de vie et les devoirs des médecins à l’égard de ces patients.
Certaines formulations et dispositions juridiques nécessitent une expertise ou un éclairage particulier. Par exemple, l’alinéa 10 dispose : « Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. » Qu’est-ce que la fin de vie ? Qu’est-ce qu’une fin de vie digne ? Qu’est-ce qu’une fin de vie apaisée ? Ce même alinéa dispose également : « Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » Là aussi, nous créons des devoirs qui devront être jugés et dont le non-respect devra être sanctionné. Tout cela suscitera de nombreuses interrogations juridiques.
J’en viens à une lacune de cette proposition de loi : l’expertise juridique préalable du Conseil d’État n’a pas été réalisée. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles le Gouvernement et les auteurs de ce texte, qui en sont les rapporteurs, ont choisi la voie de la proposition de loi qui permet d’échapper à l’avis du Conseil d’État. Sur un texte aussi important, aussi sensible, qui porte sur un sujet de société, il est dommage que nous ne disposions pas de l’expertise juridique du Conseil d’État.
Avec vingt-sept collègues, nous avions proposé au président de l’Assemblée nationale de soumettre pour avis cette proposition de loi au Conseil d’État, comme le permettent le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution…

…et l’article 4 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il y a d’ailleurs un précédent : suite au dépôt de cinq propositions de loi d’origine sénatoriale sur le même sujet, le président du Sénat Jean-Pierre Bel avait saisi le Conseil d’État, qui s’était alors prononcé dans un avis du 7 février 2013.
Il nous semblait normal que le président de l’Assemblée nationale use de ce pouvoir et demande au Conseil d’État un avis qui serait très utilement venu éclairer nos débats, qui sont avant tout d’ordre juridique. Malheureusement, le président de notre assemblée n’a pas souhaité donner suite à notre demande d’expertise juridique.

Nous allons maintenant passer beaucoup de temps sur certains amendements ; si nous avions disposé de cette analyse juridique préalable, nous aurions peut-être pu gagner du temps. Encore une fois, je regrette que la procédure choisie ait court-circuité l’avis du Conseil d’État.

Je souhaite revenir à l’examen de l’article 1er de cette proposition de loi, et donc du fameux article L. 1110-5 du code de la santé publique que nous allons modifier. Il s’agit de donner aux patients les soins les plus appropriés, de les faire bénéficier des connaissances médicales actuelles et de ne pas leur faire courir de risque. L’alinéa 10 dispose que « toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée » et que « les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ».
Je ne voudrais pas que cet article 1er prête à confusion : nous ne discutons pas d’un texte relatif aux soins palliatifs. De façon très amicale, je dénonce même les propos du rapporteur Leonetti, qui a affirmé que nous étendions le recours aux soins palliatifs.

Je ne me reconnais pas là. Je reconnais évidemment le manque de soins palliatifs en France et les inégalités territoriales existantes, mais la présente proposition de loi ne prévoit absolument pas de remédier à ces problèmes.
J’aimerais que nous en restions au contenu de ce texte, qui constitue une avancée en créant un nouveau droit, et que nous arrêtions d’évoquer la fiction – j’ai utilisé ce terme tout à l’heure – selon laquelle ce texte ne viserait qu’à l’extension du recours aux soins palliatifs. Ces derniers sont nécessaires, mais ce n’est pas l’esprit du texte.

Ce n’est pas ma lecture de la proposition de loi – je ne crois pas que la majorité d’entre nous, en tout cas du côté gauche de notre hémicycle, la lisent de cette manière.

Je rappelle d’abord que la loi du 22 avril 2005, qui paraît merveilleuse dix ans après son adoption, n’a pas été soumise à l’examen du Conseil d’État.

À l’origine, il s’agissait d’une proposition de loi rédigée au sein de notre assemblée. Un texte peut donc survivre à l’absence d’examen par le Conseil d’État !

S’il vous plaît, monsieur Breton ! Le débat nécessite de s’écouter les uns les autres !

Alain Claeys et moi-même avons participé, à Lille, à un colloque co-organisé par le Conseil d’État. Tous les dispositifs du texte ont été validés, au moins officieusement, par le Conseil d’État.
Je veux expliquer pourquoi on ne retrouve pas dans le nouvel article L. 1110-5 du code de la santé publique l’ensemble des éléments qui figuraient dans l’article initial. Pour des raisons de clarté et de lisibilité, nous avons souhaité éclater cet article, créé en 2002 et modifié en 2005, en plusieurs articles. La référence aux soins palliatifs, qui existait dans l’article initial, figure désormais dans le nouvel article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, créé par l’article 2 de la proposition de loi ; c’est pourquoi elle est absente de l’article 1er.
Je réponds par la même occasion à M. Sebaoun : si l’article 1er ne fait pas directement référence aux soins palliatifs, c’est parce qu’il est plus large. Il s’agit d’un article chapeau qui dispose que les professionnels de santé doivent mettre en oeuvre tous les moyens médicaux et techniques à leur disposition pour respecter le droit de toute personne à une fin de vie digne et apaisée, que ces moyens soient curatifs ou palliatifs.
Tout à l’heure, monsieur Sebaoun, je n’ai pas voulu dire que cette proposition de loi était relative aux soins palliatifs. J’ai simplement dit que la sédation était conforme aux recommandations de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs – vous l’avez souligné vous-même. Dans une tribune parue dans Le Monde, le président et tous les anciens présidents de cet organisme ont approuvé l’ensemble du texte. Cela ne veut pas dire que cette proposition de loi concerne les soins palliatifs : ne pensez pas que je dis des choses différentes !
Pourquoi instaurons-nous un droit à une fin de vie « digne et apaisée » ? Certains ont affirmé que ces adjectifs renvoyaient à la personne. Je suis de ceux qui pensent que la dignité est inhérente à l’humanité : elle concerne donc les circonstances dans lesquelles on se trouve. Si tout le monde est digne à la fin de sa vie, il y a dans notre pays des circonstances qui ne sont pas dignes pour permettre à des gens de partir de manière apaisée et digne. Ce n’est pas eux qui ne seraient pas dignes, mais les circonstances. Nous devons nous efforcer à satisfaire ce droit. Quant à l’adjectif « apaisé », il renvoie aux souffrances physiques et morales, au sens large – pas uniquement la douleur. Ainsi, nous souhaitons instaurer un droit à une fin de vie digne, c’est-à-dire dans des circonstances dignes, et apaisée, c’est-à-dire sans souffrances physiques ni morales.
Effectivement, cet objectif est beaucoup plus large que le développement des soins palliatifs. C’est la raison pour laquelle l’ensemble de ces éléments ne figurent pas à l’article 1er : la référence aux soins palliatifs se trouve à l’article 2, et une partie de l’actuel article L. 1110-5 du code de la santé publique figure à l’article 4. L’article 1er est un article chapeau relatif à l’ensemble des objectifs poursuivis ; les différents dispositifs sont ensuite déclinés et clarifiés article par article.

À ce stade de nos discussions, je veux vous faire part de mon étonnement. Nous allons sans doute passer de longues heures à essayer, dans un débat très conceptuel, de faire en sorte que chacun des mots utilisés garde tout son sens. Or nous ne mettons pas tous la même chose derrière les mots. Alors que la question des soins palliatifs fait l’objet d’un consensus général, personne ne s’interroge sur les définitions, les limites, les concepts. Si les soins palliatifs étaient généralisés dans notre pays, nous n’aurions sans doute pas ce débat aujourd’hui.
Certains affirment que cette proposition de loi ouvre des droits nouveaux. Je voudrais en être sûr, à ce stade du débat.
Il me semble que nous allons abondamment conceptualiser le débat, mais quelles garanties avons-nous qu’avec cette nouvelle loi, les Français pourront réellement mourir de manière digne et apaisée ? Quelles garanties avons-nous ?
Nous ne sommes pas parvenus à atteindre cet objectif dans la loi précédente – cette loi généreuse et merveilleuse que tout le monde loue aujourd’hui, qui employait presque les mêmes mots, à peu de choses près.
Quelles garanties avons-nous donc que grâce à cette loi que nous voudrions voter, les Français pourront bénéficier partout, jusque dans les coins les plus reculés du pays, de services de soins palliatifs qui leur permettront de mourir de manière digne et paisible ? Nous aimerions croire tous ces mots dont nous allons débattre durant de longues heures. À ce stade, donnez-nous simplement la garantie que nous pourrons mourir dignement et paisiblement !

Cet article 1er est important car il se situe dans le droit fil de la loi Leonetti de 2005, qui instaure un certain équilibre, mais aussi parce qu’il complète l’article L. 1110-5 du code de la santé publique en précisant que « toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée », que « les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » et que les patients ont droit à ce que leurs souffrances soient apaisées autant que possible, y compris au moyen de soins palliatifs.
M. Dord en parlait voici un instant et la Cour des comptes a noté les carences bien connues de la France en matière de soins palliatifs, d’où le fait que d’après les études, elle se classe 24e en matière de « qualité de la mort ». Hélas, la France n’a pas fait de la démarche palliative une réelle priorité de santé publique, contrairement à d’autres pays, notamment anglo-saxons, où elle est beaucoup plus développée. De ce fait, la situation de la fin de vie en France se caractérise par d’importantes disparités : seuls 20 % de la population peuvent accéder aux soins palliatifs, comme cela a déjà été indiqué.
J’ai eu l’occasion de rencontrer les équipes soignantes de Marseille, notamment en soins palliatifs : elles se plaignent d’être très isolées, souhaitent que tout soit fait pour soulager la douleur des malades et pour leur assurer une réelle qualité de vie sans en hâter le terme ni la prolonger par des thérapeutiques inappropriées, et s’opposent naturellement à ce que l’on puisse donner la mort par suicide assisté, ce qui leur paraît tout à fait inacceptable dans notre société. Il faudrait donc renforcer les soins palliatifs, domaine dans lequel hélas la France ne brille pas.

Permettez-moi simplement de répondre à M. Dord : nous pouvons avoir ce débat à perte de vue. Il ne s’agit pas d’une proposition de loi sur les soins palliatifs, et pourtant ce sujet est au coeur de notre discussion ce soir.
M. Dord nous demande quelles preuves nous pouvons apporter.

Les praticiens se sont exprimés sur cette proposition de loi. Il se trouve que ce sont les responsables des sociétés de soins palliatifs depuis plusieurs années. Or, ils disent deux choses.

Tout d’abord, les deux droits nouveaux que nous proposons avec Jean Leonetti ne vont pas, comme certains d’entre vous en ont exprimé la crainte, à l’encontre des soins palliatifs mais bien au contraire, ils obéissent à la même logique. Il ne s’agit pas d’acteurs politiques mais de responsables…

Permettez : ces responsables sont extrêmement attentifs à l’évolution des soins palliatifs et font cette analyse, que je livre au débat. Peut-être estimez-vous qu’ils racontent n’importe quoi.

Pour ma part, je ne le pense pas. Cet article 1er détermine le cadre du dispositif. L’expression de « soins palliatifs », quant à elle, est renvoyée à l’article 2. En tout état de cause, ces nouveaux droits qu’ouvre la proposition de loi s’inscrivent dans une perspective de soins palliatifs ; il n’existe aucune opposition de ce point de vue.

Ceux qui défendent les soins palliatifs en France ont écrit une tribune dans le quotidien Le Monde pas plus tard qu’hier pour indiquer que cette proposition de loi constitue une avancée.

J’entends tout à fait les arguments de nos deux rapporteurs sur cet article 1er, et je vous avoue m’inquiéter des amendements visant à le supprimer, car il recadre parfaitement les intentions des auteurs de cette proposition de loi. Je ne vois pas ce qui pourrait, dans sa rédaction, susciter des inquiétudes, bien au contraire : il me semble très utile de rappeler au début du texte que « toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée » – M. Leonetti vient d’expliquer en quoi cela consiste – et que « les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté ».
Il sera largement question des soins palliatifs à l’article 2 ; en revanche, puisqu’il existe un consensus autour du fait que notre pays accuse un retard inadmissible en ce domaine, il me semble que nous devrons batailler davantage pour demander à Mme la ministre des garanties sur un accès effectif aux soins palliatifs. Elle a évoqué un plan triennal : nous aimerions avoir des réponses précises sur les garanties et les moyens financiers qui seront dévolus au développement de ces soins.

Nous en venons à l’examen des amendements, en commençant par les amendements de suppression. Compte tenu du nombre d’orateurs qui se sont exprimés dans la discussion générale et sur l’article premier, je vous propose de donner la parole à un orateur pour et un orateur contre chaque amendement.
Je suis saisie de plusieurs amendements identiques, nos 60 , 132 , 221 , 373 , 454 , 758 et 861 .
La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 60 .

Je trouverais regrettable que nous ne puissions pas défendre les amendements que nous avons déposés, sauf à ce que l’on veuille court-circuiter le débat, madame la présidente.

N’interprétez pas mon propos, monsieur le député : je viens d’indiquer que j’appellerai naturellement tous les amendements et que tous leurs auteurs pourront les défendre ; en revanche, sur chacun d’entre eux, je ne donnerai la parole qu’à deux orateurs au plus, l’un pour et l’autre contre, comme le prévoit notre règlement.

J’en viens donc à cet amendement de suppression : il ne porte pas tant sur le contenu de cet article 1er que sur son principe. Il n’est pas nécessaire d’adopter une nouvelle loi.
Même si elle n’était pas parfaite sur le plan juridique, puisque le Conseil d’État n’avait pas donné son avis et que trois ans après son adoption en 2005, des demandes de révision étaient déjà formulées, c’est surtout en termes de mise en oeuvre pratique que la précédente loi devait être améliorée, et non pour son contenu.
En réalité, c’est la proposition no 21 du candidat François Hollande qui a ouvert la boîte de Pandore : aujourd’hui, on se sent obligé d’honorer cette promesse électorale imprudente par une proposition de loi.
Les amendements de suppression que nous avons déposés sur chacun des articles du texte visent à indiquer qu’il n’est pas nécessaire d’adopter une nouvelle loi. Appliquons déjà la loi de 2005 : cela implique une volonté politique des gouvernements – l’actuel comme les précédents. La priorité accordée aux soins palliatifs ne doit pas se limiter à un simple affichage lors de discours, mais donner lieu à une véritable politique de promotion et de développement de ces soins. Or, nous en sommes très loin. Nous attendons toujours la réponse de Mme la ministre pour savoir quelles actions concrètes engagera le Gouvernement pour développer ces soins et comment il entend résorber les inégalités territoriales en la matière.
Tel est l’objet de cet amendement.

Cet article 1er, tout comme ceux qui suivent, est inutile, parce que cette loi n’apporte rien par rapport à la loi de 2005.

La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l’amendement no 132 . Je rappelle que vous disposez de deux minutes.

En m’interrogeant sur l’article 1er, je m’interroge sur l’ensemble du texte. Je disais tout à l’heure que la prise en compte de la vulnérabilité et de la fragilité étaient des éléments essentiels pour apprécier le degré de civilisation d’un pays. Dans ces conditions, un certain nombre de dispositions figurant dans ce texte m’inquiètent, soit parce qu’ils préparent d’autres évolutions – on a parlé de loi « étape » – soit parce qu’ils sont inquiétants en eux-mêmes.
Ma première inquiétude a trait aux directives anticipées. Avec la loi Leonetti, nous avions, me semble-t-il, trouvé un bon équilibre. Je crains que nous ne le rompions, tout d’abord parce que l’on abandonne l’idée selon laquelle ces directives doivent obligatoirement être réexaminées par leurs auteurs tous les trois ans, ensuite et surtout parce que l’on transforme ces directives en autant d’obligations pour le médecin, qui devient l’exécutant d’une décision prise bien plus tôt et sans dialogue entre le médecin et le malade. Enfin, on rompt le pacte de confiance qui doit exister entre l’un et l’autre.
D’autre part, ces directives deviennent en réalité un formulaire – c’est d’ailleurs le terme que Mme la ministre elle-même utilise. Il faudra donc remplir ce formulaire et y cocher des cases : tout cela nous éloigne de l’humanité qui devrait guider l’ensemble de nos décisions.
La deuxième ligne jaune sur laquelle je tiens à insister concerne l’assimilation de l’alimentation et de la ventilation à des traitements. J’estime qu’une telle assimilation est redoutable. En transformant le fait de s’alimenter ou de respirer en traitements, on suppose que ceux-ci peuvent être interrompus pour donner la mort. À mon sens, je le répète, cette évolution est redoutable et j’espère que nos débats contribueront à l’éviter.

Je défendrai cet amendement de suppression dans le même esprit que MM. Breton et Le Fur. La loi du 22 avril 2005 a constitué une avancée indéniable pour la reconnaissance des droits des malades en fin de vie. Faut-il aller plus loin en ouvrant de nouveaux droits pour ces personnes ? Je ne le pense pas.
En effet, il faut bien reconnaître que le « service après-vote » de la loi Leonetti n’a pas été très performant, ni pour le grand public ni pour la communauté médicale. Les dispositions légales de cette bonne loi sont demeurées insuffisamment connues. La formation des médecins n’a pas été au rendez-vous, et la rédaction de directives anticipées par les patients est restée marginale. Aujourd’hui, 80 % des personnes qui pourraient bénéficier de soins palliatifs ne meurent pas dans des conditions dignes.
La loi Leonetti devait donner lieu à un bilan tous les deux ans ; il n’en a rien été, et c’est bien dommage. Aussi, le fait de vouloir aller plus loin peut comporter des risques et le mieux peut devenir l’ennemi du bien.
Je m’inquiète également de la déclaration du Premier ministre, qui comme vous, madame la ministre, a confirmé aujourd’hui, lors des questions au Gouvernement, que cette proposition de loi n’était qu’une étape ; une étape vers quoi ?
Ce texte doit refuser clairement toute administration délibérée de la mort sous quelque forme que ce soit. Nous ne voulons ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, ni suicide assisté ; en revanche, nous voulons des traitements antidouleur et la prise en compte, comme le souhaitent la plupart de nos concitoyens, du besoin d’être accompagnés et soutenus pour vivre nos derniers instants.
Enfin, il me semble aussi indispensable de maintenir en toutes circonstances la relation de confiance entre soignants et soignés.

La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 373 .

Cet article 1er instaure une nouvelle architecture des droits principaux de la personne malade et comporte un certain nombre d’éléments sur lesquels nous reviendrons – comme la notion de dignité, par exemple, sur laquelle il est nécessaire de bien s’entendre.
À ce stade, il me semble important de rappeler la nécessité des soins palliatifs. C’est ce que vise à mettre en relief cet amendement de suppression. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il saisir l’occasion de l’avis qu’il doit donner sur ces amendements pour nous communiquer les éléments détaillés de ce plan qui s’annonce ambitieux – c’est en tout cas notre souhait.

Loin de clarifier quoi que ce soit, cet article 1er nous fait au contraire entrer dans le flou. Cet espace d’incertitude relève de la gestion des soignants, dont c’est le métier et la responsabilité – car si certains ont choisi le rôle de médecins et de soignants, c’est bien pour porter ces décisions sur leurs épaules avec leurs équipes et pour assumer cette part d’incertitude inhérente à toute décision humaine. Or, à force d’introduire dans la loi tant de variété et tant de variables, nous entrons dans le flou. Qu’est-ce qu’une vie digne et apaisée selon cet article 1er ? Je n’en sais rien. J’en ai bien une idée, mais elle n’est pas nécessairement partagée par l’ensemble des soignants et des patients eux-mêmes.
Je crains une dérive normative. Dans notre société moderne, nous avons beaucoup de mal à affronter les vraies difficultés. Nous n’utilisons pas le mot « mort », lui préférant celui de décès, et nous parlons sans cesse par euphémismes. C’est une société incapable de se projeter vers sa jeunesse, et nous en verrons encore une fois le résultat à l’occasion des élections qui auront lieu dans deux semaines. Car lors des précédentes élections, tous les partis politiques qui sont représentés ici ont été désertés par la jeunesse.

Pourtant, nous continuons à parler de fin de vie.
Quelle est cette société qui veut l’apaisement ? Lutter contre la douleur, tous les médecins le font depuis la plus haute Antiquité, en fonction de leur époque, en fonction de la société à laquelle ils appartiennent et de la culture qui est la leur. Il était plus sage, encore une fois, de conserver la loi dans sa rédaction actuelle. Ce texte n’apporte qu’une complexité inutile.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 758 .

Au risque de susciter à nouveau la jovialité de son auteur, je préférais la formulation de l’article L. 1110-5 initial à celle-ci. C’est la raison pour laquelle je soutiens cet amendement de suppression.

Non, monsieur le rapporteur, hélas d’ailleurs, ce n’est pas de la simple nostalgie… Je regrette la disparition dans cet article du code de la santé publique de la référence aux soins palliatifs, au traitement de la douleur et à un certain nombre d’autres éléments. Nous les retrouvons un peu plus loin dans le texte, mais il n’est pas neutre que ces notions ne figurent pas dans son article princeps si je puis dire. Cela prive le texte de sa portée générale et fait qu’il n’encadre pas l’ensemble du dispositif comme il le devrait.
Si vous le permettez, madame la présidente, je voudrais faire part de ma réflexion aux rapporteurs. Le deuxième alinéa de la nouvelle rédaction de l’article L. 1110-5 étant plus général que le premier, je plaiderais volontiers pour qu’ils soient inversés. La phrase « Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. », a une portée plus universelle que ce qui figure au premier alinéa, qui est plus concret. C’est peut-être une simple question de forme, mais écrire le droit du général au particulier me semble plus pertinent. Cette modification pourra être apportée au cours de la navette parlementaire.

Je reprends à mon compte la question posée aux rapporteurs et au Gouvernement quant à la portée juridique précise du dernier alinéa, question qui vaut d’ailleurs pour tout exemple de droit-créance. Quelle est au fond la portée juridique de cette phrase : « Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée » ?
À la droite de cet hémicycle, nous sommes plutôt défavorables à la notion de droit-créance, de « droit à ». Il ne s’agit pas de donner une leçon sur ce qui nous occupe ce soir, mais il y a là une interrogation très concrète, qui rejoint celle de Dominique Dord sur l’évolution et le renforcement de l’action publique dans le domaine des soins palliatifs.
Ce texte va-t-il améliorer concrètement la situation pour nos concitoyens, ce qui suppose une action résolue en faveur des soins palliatifs, ou instaurer un droit-créance, ce qui alors soulève de nombreuses interrogations et ne correspond pas exactement à la vision qui est la nôtre de l’action publique.

La parole est à Messieurs les rapporteurs pour donner l’avis de la commission sur ces amendements de suppression.

La parole est à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes pour donner l’avis du Gouvernement.
J’émets un avis défavorable à ces amendements de suppression, qui, je dois le dire, m’étonnent beaucoup. En effet, depuis le début de ce débat, une discussion se fait jour pour déterminer si ce texte s’inscrit strictement dans une approche palliative de la fin de vie. Nous avons entendu des points de vue différents sur ce point. À l’évidence, ce texte ne se résume pas à l’amélioration, la mise en place ou l’approfondissement d’une démarche palliative. Je le dis très clairement. S’il s’agissait simplement de développer les soins palliatifs, nous n’aurions pas besoin d’une nouvelle loi.
Le plan de développement des soins palliatifs, dont j’ai indiqué les grandes orientations, ne s’inscrit pas dans un cadre législatif : il s’appuiera sur des dispositifs réglementaires de différente nature. Il nécessitera notamment, pour son volet formation, de dispositions émanant du ministère de l’enseignement supérieur. Mais nous ne sommes pas dans cette démarche-là.
En revanche, cet article 1er définit le cadre de la mobilisation de différents acteurs pour faire en sorte que les personnes en fin de vie puissent ne pas souffrir, et avoir une fin de vie digne et apaisée.
Vous nous interrogez, monsieur Mariton, sur la notion de « droit à ». Mais renversons la proposition : aujourd’hui, et vous avez été très nombreux à le dire sur tous les bancs, certains de nos concitoyens s’inquiètent de la manière dont seront pris en charge leurs proches en fin de vie. Ils se demandent parfois pourquoi un proche n’a pas pu bénéficier de tel ou tel protocole de soins ou être pris en charge dans des conditions plus conformes à la dignité de la personne. D’où la nécessité de mobiliser l’ensemble des acteurs du soin, ainsi que du secteur social et médico-social, pour mettre en place ce qu’attendent nos concitoyens.
Cela dit, cet article 1er est le plus proche d’une démarche de soins palliatifs. Vous qui souhaitez en rester à une démarche strictement liée au développement des soins palliatifs, s’il est un article que vous ne devriez pas contester, c’est bien celui-ci. Il est normal qu’il y ait débat à propos de l’article 3 pour savoir si nous en restons à l’approche qui est celle du droit actuel ou s’il convient de franchir une étape nouvelle. Je peux comprendre cette interrogation et admettre qu’il y ait des points de vue différents. Mais l’article 1er ne vise qu’à préciser les choses. Il pose un cadre et répond à ce qui devrait nous rassembler, à savoir la volonté d’apaiser, d’éviter la souffrance et de faire de la dignité et de la liberté des individus le cadre du déploiement des politiques publiques en ce domaine.
Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable à cette série d’amendements de suppression.

Les amendements proposés par nos collègues font référence à l’engagement no 21 pris par le candidat Hollande pendant la campagne présidentielle. Je pense que ce lien est assez ténu car depuis que cet engagement a été pris, deux ans et demi de consultations ont eu lieu, généralement auprès de personnalités dont on savait qu’elles étaient hostiles à l’assistance médicalisée à mourir – le professeur Didier Sicard, puis le Comité consultatif national d’éthique, qui avait déjà statué trois fois auparavant, avant une prétendue « conférence de citoyens », à savoir dix-huit personnes sélectionnées par l’IFOP, et enfin M. Leonetti, que j’estime beaucoup mais dont je sais qu’il est tout à fait hostile à une aide active à mourir.

Cette référence à l’engagement no 21 n’a finalement pas lieu d’être. Mais peut-être cet article n’est-il pas clair et convient-il de reprendre la phrase qu’aimait François Mitterrand : « On ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment »…

Je suis étonné de la réponse de Mme la ministre. Elle nous dit que cet article concerne les soins palliatifs alors qu’y est précisément supprimée la référence aux soins palliatifs, tels que définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique.
Par ailleurs, notre collègue Gosselin a été très clair : assez des discours sur les soins palliatifs ! Nous voulons savoir, au-delà des mots, quels sont les actes et les engagements, notamment en termes de moyens, budgétaires et humains, et d’organisation, pour développer les soins palliatifs et promouvoir la culture palliative.

Un mot pour préciser ma pensée à l’intention de M. Claeys. Je ne suspecte pas du tout le contenu du texte d’être antinomique avec la notion de soins palliatifs. La question que je me pose, sur ce texte qui me convient plutôt bien, comme me convenait plutôt bien la loi Leonetti de 2005, est la suivante : quelle garantie avons-nous que derrière les mots et les concepts, des droits nouveaux seront effectivement donnés à nos concitoyens, de façon qu’ils puissent mourir de manière digne et apaisée ?
Mme la ministre nous parle d’un plan. Je fais confiance à ce plan, néanmoins tout cela reste creux. En général, quand on crée un droit, on prévoit aussi une sanction en cas de non-respect de ce droit.

Si aucune sanction n’est prévue ou si le plan n’est pas à la hauteur, ce qui a été le cas en 2005, ce ne sera plus un droit nouveau mais un voeu pieu.

La réponse de Mme la ministre est édifiante. Elle montre bien le malentendu qui existe dans l’esprit de quelques-uns…

…qui sont encore disposés à voter ce texte convaincus qu’il concerne les soins palliatifs, alors qu’il constitue une étape supplémentaire vers ce que certains appellent de leurs voeux, à savoir l’euthanasie, et les alinéas 9 et 10 sont emblématiques de ce malentendu.
S’agissant des patients, je ne sais pas définir clairement ce qu’est une fin de vie « digne et apaisée ». Je peux en avoir une idée, mais celle-ci n’a pas de valeur universelle.
Et surtout, nous constatons que l’on cherche à être impératif à l’égard des médecins, accusés d’être tout-puissants, de décider toujours seuls dans leur coin, alors même que l’essence de leur métier consiste à travailler en équipe. C’est la noblesse de son métier pour le médecin que de porter sur ses épaules certaines décisions, cette part d’incertitude, entre l’ombre et la lumière, dans les décisions que nous sommes toutes et tous amenés à prendre au cours de nos carrières. Notre société devient extrêmement paranoïaque et de plus en plus procédurière. On y a de plus en plus recours à la justice, pour n’importe quel acte, si bien que dans certaines disciplines, on a maintenant du mal à recruter des praticiens tant ils craignent de se voir intenter un procès au cours de leur carrière – je pense aux obstétriciens en particulier.
Les alinéas 9 et 10 de l’article 1er révèlent d’emblée la position des auteurs du texte. Il serait raisonnable que les rapporteurs acceptent de les supprimer, ce qui rétablirait un relatif équilibre.
Avis défavorable.
L’amendement no 456 n’est pas adopté.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit la suppression de l’alinéa 2 de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui dispose que les actes [de prévention, d’investigation ou de soins] ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ; lorsque les soins paraissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que de prolonger artificiellement la vie, le médecin doit se référer à l’article L. 1110-10 du même code qui prescrit les soins palliatifs. Ce que nous demandons par cet amendement est que l’on continue de faire référence aux soins palliatifs dans le nouvel article L. 1110-5, de façon que cette possibilité ouverte aux médecins soit maintenue.

La parole est à M. Philippe Meunier, pour soutenir l’amendement no 593 .

Nous sommes toujours dans le cadre de l’article 1er. L’amendement consiste en une petite suggestion de correction. Je nourris moi aussi des inquiétudes au sujet de la définition d’une fin de vie digne et apaisée. Qui pourrait être contre ? Sur tous les bancs de l’hémicycle, nous sommes évidemment favorables à ce que nos compatriotes connaissent une fin de vie digne et apaisée. Mais nous sommes législateurs et non incantateurs. Il faut donc, dès lors que nous accordons un « droit à », c’est-à-dire un droit-créance, garantir à nos compatriotes ce droit à une fin de vie digne et apaisée. Je peux imaginer ce qu’est une fin de vie digne, notre collègue Debré a expliqué tout à l’heure qu’elle est définie par le regard de l’autre.
Mais une fin de vie apaisée, comment l’État pourrait-il la garantir ? Il pourrait garantir des moyens dont on a d’ailleurs du mal à percevoir la qualité et la quantité nécessaires, mais imaginer qu’il puisse garantir un droit à une fin de vie digne et apaisée est invraisemblable et pas tout à fait responsable. Qui exercera ce droit ? Qui demandera des comptes à l’État et comment celui-ci pourra-t-il garantir juridiquement une fin de vie apaisée ? Enfin, je tiens à faire part de mon inquiétude à propos de l’expression répétée par M. le Premier ministre cet après-midi et par de nombreux collègues ce soir selon laquelle la proposition de loi constituerait une étape. Vers quoi ? En fait, on le sait très bien : vers le suicide assisté et l’euthanasie dont nous ne voulons pas.

La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 863 .

Certes, comme le disait tout à l’heure Mme la ministre, il ne s’agit pas d’un texte sur les soins palliatifs, mais il s’agit bien d’un texte sur les malades et la fin de vie, donc aussi les soins palliatifs, lesquels sont tout de même intimement liés au texte dont nous discutons ce soir et forment avec lui un bloc. Évoquer les soins palliatifs et leur développement n’a donc rien d’aberrant. Je réitère donc tout simplement et sans aucune acrimonie ma demande. Prenez un peu de temps, madame la ministre, pour présenter le plan du Gouvernement !

Vous affirmez, à juste titre du reste, qu’il échappe à la compétence du législateur et à la représentation nationale. Nous n’aurons donc pas à en débattre. Dès lors, prenons quelques minutes, si vous le voulez bien, pour en faire une présentation un peu développée, ce qui nous fera gagner bien des heures pour la suite des débats, je vous l’assure. L’amendement est défendu.
Avis défavorable.

Je veux bien être de bonne volonté mais il faudrait tout de même répondre !

Nous considérons que la dignité est intrinsèque à la personne et n’est pas mise en cause par quiconque. Nous souhaitons simplement que les conditions du terme de l’existence soient les mieux définies possibles. Tel est l’objet de l’amendement.

Il va dans le même sens que l’amendement no 313 . Les actes de soin et de soulagement doivent être accomplis, quel que soit le moment de la vie, dans le respect de l’intégrité et de la dignité des personnes et pas seulement en fin de vie. Certains diront que cela va de soi mais cela va encore mieux en le disant !

Il propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 10 à deux niveaux. Il précise tout d’abord que le droit d’être soigné, apaisé et respecté ne s’applique pas simplement à la fin de la vie dont on ne sait qu’a posteriori qu’elle l’est. Nous proposons donc l’expression « jusqu’à sa mort ». Ce droit, pourquoi en disposer uniquement dans les derniers instants de sa vie ? Dès lors que l’on s’inscrit dans une logique de droit-créance, en l’occurrence celui d’être entouré et apaisé, il s’applique à tous les soins à moins qu’on ne définisse des critères justifiant pourquoi il s’applique particulièrement à la fin de vie et pas avant.
Deuxièmement, le texte qui nous est proposé prévoit que « toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée ». J’approuve la distinction opérée tout à l’heure par notre collègue Leonetti selon laquelle la dignité est intrinsèque à la personne et que ce sont les circonstances en elles-mêmes qui peuvent être dignes ou indignes. Néanmoins, on peut s’interroger sur la définition de la dignité des conditions de fin de vie. Nous proposons donc une rédaction selon laquelle « toute personne a le droit d’être soignée, apaisée et respectée dans son intégrité et sa dignité », dont je rappelle qu’elle lui est intrinsèque, ce qui dispense de la définir, y compris dans les conditions de soin. Tel est le sens de l’amendement no 555 .

La parole est à M. Philippe Meunier, pour soutenir l’amendement no 595 .

Il est défendu également sur la base de l’excellent argumentaire de mon collègue Breton.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 819 .

La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 897 .

Nous sommes face à une contradiction méritant une explication. En effet, on ne peut imaginer que l’adjectif « digne » dans l’expression « fin de vie digne » qualifie la personne. Il qualifie les circonstances de la fin de vie. La préoccupation de nos collègues me semble donc satisfaite par le texte tel qu’il est rédigé.
Je les renvoie par ailleurs à leur interrogation. Lorsque l’on rédige un texte de loi, on énonce des grands axes que l’on décline ensuite dans les articles successifs afin de définir concrètement la façon d’atteindre l’objectif global. En l’espèce, nos collègues sont d’accord avec l’objectif global consistant à défendre l’intégrité et la dignité de la personne. Les explications données sont de nature à les satisfaire. Vous savez comme moi, chers collègues, qu’un texte en débat à l’Assemblée nationale vaut aussi par la discussion dont il fait l’objet. Évoquer « une fin de vie digne » ne peut en aucun cas signifier que la personne pourrait être indigne. L’expression ne porte pas sur la personne mais sur les circonstances dans lesquelles se déroule la fin de vie. Je pense donc très sincèrement que le texte répond aux inquiétudes de nos collègues.
Avis défavorable.

Je remercie M. le rapporteur de sa réponse mais ce n’est pas celle que nous attendions. Du moins ne répond-elle pas, me semble-t-il, à la question soulevée par les amendements. À la lecture du texte des amendements, je ne comprends toujours pas pourquoi M. le rapporteur y est défavorable. On cherche en effet pour cette partie du texte des formulations à caractère général, comme d’ailleurs vous l’avez dit tout à l’heure, monsieur le rapporteur, et comme Mme la ministre l’a également expliqué tout à l’heure en défendant l’article. La formulation proposée ici est d’une certaine manière plus large et plus universelle que celle de votre texte. Dès lors, pourquoi vous gêne-t-elle ?

Vous affirmez qu’il faut définir un cadre général et rappeler les principes, selon vos propres termes à quelque chose près. Notre formulation ne devrait absolument pas vous gêner et vous devriez être d’accord avec les amendements. Voilà ce que je ne comprends pas.

La parole est à Mme Barbara Pompili, pour soutenir l’amendement no 518 .
Avis défavorable.

Je m’associe à l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement car l’amendement prévoit que toute personne a « droit au respect de son choix de fin de vie ». Il importe que nous soyons réunis le plus largement possible sur ces bancs pour le refuser car il propose une vision de l’autonomie complètement illimitée et donc contraire au principe de dignité. Il importe que nous soyons tous réunis pour refuser dès l’article 1er des conceptions abstraites affirmant des libertés théoriques contraires en pratique à la dignité et à l’exercice concret de la liberté de chacun. Je souhaite que nous refusions à une large majorité le « droit au respect de son choix de fin de vie ».

Je ne comptais pas prendre la parole à ce stade du débat car nous discuterons du choix de fin de vie demain après-midi mais je refuse d’entendre dire que dignité et choix de sa fin de vie sont antinomiques.

C’est exactement le contraire ! La dignité, c’est aussi le choix de sa fin de vie, c’est pourquoi nous souhaitions le préciser ! Je prends note de l’avis défavorable dont l’amendement fait l’objet mais nous aurons l’occasion d’en discuter de manière plus approfondie demain.
L’amendement no 518 n’est pas adopté.

Selon le philosophe Paul Ricoeur si cher à notre ministre de l’économie, la notion de dignité renvoie à l’idée que « quelque chose est dû à l’être humain du fait qu’il est humain ». La dignité est donc liée à la personne elle-même et non à un état de vie. Tel est également le sens de l’amendement no 321 que mon collègue médecin Élie Aboud et moi-même avons déposé. Selon nous, et M. le rapporteur Leonetti sera d’accord avec nous, toute personne mérite un respect inconditionnel, quels que soient son âge, son sexe, sa santé physique ou mentale, sa religion et sa condition sociale. Par conséquent, limiter la notion de dignité à la situation de fin de vie est une erreur.

La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 375 .

L’amendement est défendu. J’insiste auprès de Mme la ministre qui ne fait pas écho à ma demande, pour la dernière fois ce soir par courtoisie mais en ne doutant pas que la nuit fournira l’occasion de préparer des éléments de réponse pour demain, afin qu’elle présente un peu plus en détail le plan de développement des soins palliatifs et de la culture palliative. Il s’agit vraiment d’un point essentiel, vous l’avez bien compris, madame la ministre.

Il s’inscrit lui aussi dans le débat sur la dignité, non sur sa définition car il s’agit de quelque chose qu’on ne peut définir, du moins l’exercice est-il très difficile, mais sur ce qui est lié la notion de dignité. Celle-ci est liée intrinsèquement à la personne. Si on l’associe à la fin de vie, on aura beaucoup de mal à définir ce qu’est une fin de vie digne ou pas ainsi que les critères à retenir puis à appliquer en pratique. Selon nous, les conditions et les circonstances de la fin de vie peuvent être conformes ou non à la dignité de la personne, laquelle en elle-même ne se discute pas. C’est pourquoi nous proposons la suppression du terme « digne » de l’alinéa 10 de l’article 1er.

La parole est à M. Philippe Meunier, pour soutenir l’amendement no 594 .

Il serait bon de vous entendre, madame la ministre, ce qui nous éviterait de monter en ligne sur tous les amendements et permettrait de gagner du temps.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 739 .
Avis défavorable. Je ne peux que redire ce que j’ai déjà dit lors de ma présentation initiale cet après-midi. J’ai indiqué qu’un plan en faveur des soins palliatifs était en cours d’élaboration. Je ne peux pas vous dire quel en sera le point d’aboutissement, car ce plan n’est pas encore achevé. Je vous ai indiqué quatre principes, que je veux bien répéter.
Premièrement, ce plan vise à développer une offre palliative, en particulier à domicile, parce qu’il existe une demande forte pour que ces soins soient disponibles à domicile et pas seulement en établissement.
La deuxième orientation consiste à développer les soins palliatifs et la culture palliative en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les personnes hébergées dans ces établissements ont en effet moins accès que d’autres à ces soins palliatifs. Cela suppose que des actions spécifiques soient menées.
Le troisième élément que je vous ai indiqué est que nous travaillons à l’élaboration de références communes pour l’ensemble des professionnels de santé. C’est notamment la mission de la Haute autorité de santé, qui travaille actuellement à l’élaboration de ce que certains appellent des outils ou, plutôt, des référentiels communs, pour faire en sorte que, si une personne doit passer du domicile à un hôpital, ou d’un hôpital à une maison de retraite, il n’y ait pas de rupture dans la prise en charge et le déploiement des soins palliatifs.
Le quatrième volet de ce plan consiste à former l’ensemble des professionnels de santé, et pas seulement certains d’entre eux. C’est à cela que travaille le ministère chargé de l’enseignement supérieur. Nous avons déjà eu l’occasion d’annoncer que, dès la prochaine rentrée universitaire, il y aurait des modules de formation pour l’ensemble des étudiants dans le cadre des études de santé.
Ce plan sera annoncé et mis en place. Je veux vous dire, monsieur le député Gosselin, qu’il ne s’agit pas, de ma part, d’échapper au contrôle parlementaire. Ce n’est pas parce que des propositions se font ou des décisions se prennent dans un cadre réglementaire qu’elles échappent au contrôle parlementaire.
Je peux prendre très simplement l’engagement devant vous que, lorsque ce plan sera finalisé, je viendrai le présenter, par exemple devant la commission des affaires sociales. Cela me paraîtrait une façon tout à fait positive d’avancer, de manière transparente, dans l’intérêt commun.

Merci, madame la ministre, d’avoir reprécisé un certain nombre d’éléments, mais nous nous posons toujours des questions concernant le calendrier et la traduction financière des moyens qui seront dévolus aux soins palliatifs. En effet, on l’a bien vu, on le reconnaît les uns et les autres, le manque de moyens a pour conséquence le fait que les soins palliatifs sont loin d’être proposés dans toutes les régions de France. Vous nous dites que vous y travaillez. Dont acte, mais un calendrier est-il fixé ? Est-ce prévu pour 2015 ? En trouvera-t-on une traduction dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale ou dans un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale ? Telles sont les questions qui se posent. Ce texte intéresse les Français, qui attendent des précisions.

Je vous remercie, madame la ministre, de ces éléments supplémentaires de précision, qui reprennent un certain nombre de grands principes, mais nous avons besoin d’informations supplémentaires. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit par notre collègue Le Callennec. Une présentation devant la commission des affaires sociales sera assurément utile, mais, compte tenu du débat que nous tenons actuellement et de la proximité de l’examen du projet de loi santé, je m’étonne que l’on ne dispose pas de plus d’éléments. Ce n’est pas par hasard, en effet, que le débat sur la fin de vie a lieu actuellement ; c’est la conséquence du calendrier arrêté par le Gouvernement.

La date était prévisible et prévue. Le débat sur le projet de loi santé va également avoir lieu à une date choisie par le Gouvernement. L’une ou l’autre voie pouvait être empruntée. Aussi je m’étonne que l’on ne dispose pas de plus d’éléments aujourd’hui, même si je prends acte de votre réponse. Il ne s’agit pas pour moi de vous faire un procès d’intention, mais je trouve étonnant que l’on n’ait pas plus d’éléments à ce stade. Ce n’est pas très rassurant. Comme on nous a déjà fait des promesses qui n’engageaient que ceux qui les écoutaient, c’est-à-dire la représentation nationale, les malades ou les professionnels de santé, vous comprendrez que je sois un peu dubitatif.

Nous avons vu les difficultés qu’il y a définir une fin de vie digne, et on peut s’interroger sur les conséquences qui pourraient en découler. Aussi proposons-nous, par cet amendement, de remplacer le mot « digne » par le mot « entourée ». Pourquoi ? Parce que, dès lors que l’on s’emploie à définir le droit à une fin de vie, il est important de souligner la dimension relationnelle. On sait que beaucoup de personnes en fin de vie connaissent une situation d’isolement, de solitude, et il est important d’affirmer la nécessité que la fin de vie soit entourée. Aux côtés du mot « apaisée », le terme « entourée » serait beaucoup plus concret que celui de « digne ».

Le vrai drame de notre société est, bien souvent, la solitude, l’isolement, tant durant la vie que, de manière plus cruelle encore, au terme de l’existence. C’est pourquoi nous souhaitons insister sur la nécessité des relations sociales. Le terme « entourée » nous semble avoir toute sa place à cet endroit du texte. Cela peut avoir des traductions très concrètes, et je voudrais d’ailleurs rendre hommage à tous les professionnels qui entourent les personnes en fin de vie ; je pense non seulement aux médecins et aux infirmières, mais également, pour citer une catégorie que l’on oublie trop souvent, les aides-soignants et, en particulier, les aides-soignantes. Bien souvent, au terme de l’agonie d’une personne âgée, c’est une aide-soignante qui lui tient la main au petit matin. D’autres personnes entourent le malade en fin de vie, à commencer par les membres de la famille. Quelle place l’hôpital fait-il à la famille ? Il est vrai que des progrès ont été accomplis, en particulier pour les familles qui accompagnent des enfants, qui peuvent aussi arriver au terme de leur vie. Mais, dans bien des endroits, la famille n’a pas sa place, ou semble exclue de tout cela. Je souhaiterais donc que le rôle des familles qui accompagnent un parent soit très explicitement reconnu.
D’autres personnes interviennent, comme les aumôniers, souvent laïcs, désormais. Je voudrais aussi insister sur le rôle des visiteurs des malades. Voilà une catégorie dont je n’ai pas entendu parler depuis le début de nos débats et qui, pourtant, est essentielle. Ils vont souvent vers celles et ceux qui sont seuls au terme de leur existence. On ne leur fait pourtant pas beaucoup de place, en règle générale, dans nos hôpitaux et nos EHPAD, alors qu’ils peuvent aussi jouer un rôle social essentiel.
Derrière le mot « entourée » se trouvent donc des réalités humaines. Je crois que c’est non seulement l’occasion de rendre hommage à toutes ces personnes, mais aussi de faire en sorte qu’une place véritable leur soit faite dans l’ensemble de nos institutions hospitalières et sanitaires.

Toute vie humaine est digne, et c’est bien notre regard qui confère la dignité à la personne en fin de vie. Cet amendement met l’accent sur la qualité des relations humaines dans ces moments difficiles, voire douloureux. L’alinéa 10 fait référence à l’engagement no 21 du candidat Hollande, qui souhaitait que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable puisse bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Aussi cet amendement a-t-il pour objet d’écrire « fin de vie entourée et apaisée » à la place de « fin de vie digne et apaisée ».

La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 372 .

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 764 .
Même avis.

Je ne crois pas du tout que la solution qui nous est proposée, en fait l’anesthésie, puisse procurer une fin de vie digne et apaisée, ni, encore moins, entourée, puisque le patient perdra conscience et ne pourra plus avoir la moindre communication avec son entourage familial. De plus, avec ce système qui fait cesser l’hydratation et la nutrition artificielles, l’agonie risque d’être lente et longue. Dans ces conditions, je crois que c’est un leurre que de parler, comme dans ce texte, de « fin de vie digne et apaisée ».

Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 556 , 596 , 820 , 898 , 62 , 134 , 223 , 371 et 765 , pouvant être soumis à une discussion commune.
Cette discussion commune comprend deux séries d’amendements identiques : d’une part, les amendements nos 556 , 596 , 820 et 898 , d’autre part, les amendements nos 62 , 134 , 223 , 371 et 765 .
La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 556 .

À partir du moment où l’on indique que « toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée », il faut être concret : je rejoins les propos de notre collègue Schwartzenberg quant aux interrogations que l’on peut nourrir sur les moyens utilisés, que nous examinerons notamment à l’article 3, qui traite de la sédation. En tout état de cause, cette intention de parvenir à une fin de vie digne et apaisée doit se traduire, à notre sens, par le développement de l’accès aux soins palliatifs – il ne faut pas en rester aux discours mais en venir aux actes et aux moyens, comme le disait tout à l’heure notre collègue Isabelle Le Callennec.
Il convient également sur ce plan de lutter contre les inégalités territoriales. Nous avons pu constater, à la lecture de cartes départementales ou régionales, des différences scandaleuses en termes de nombre de lits de soins palliatifs, tant au sein même des hôpitaux que dans les services d’hospitalisation à domicile. Je ne suis pas le premier à parler de scandale : le Comité national consultatif d’éthique lui-même affirmait dans son avis qu’aujourd’hui, l’offre de soins palliatifs dans notre pays constituait un véritable scandale. Depuis la loi de 2005, il était prévu un rapport en annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport n’a jamais été élaboré. Il a fallu un amendement de notre collègue Delatte pour que l’on s’impose de faire le point sur le développement des soins palliatifs. C’est pourquoi nous proposons de compléter la première phrase de l’alinéa 10, afin que toute personne ait droit, sur l’ensemble du territoire, aux soins palliatifs.

Monsieur Breton, puis-je considérer que vous avez également défendu l’amendement no 62 , qui est en discussion commune ?

La parole est à M. Philippe Meunier, pour soutenir l’amendement no 596 .

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 820 .

Monsieur Poisson, puis-je considérer que votre amendement no 765 est également défendu ?

La parole est à M. Philippe Gosselin, pour soutenir l’amendement no 898 .

Je veux rappeler quelques chiffres sur les inégalités d’accès aux soins palliatifs, qui constituent effectivement un vrai scandale : huit Français sur dix n’y ont toujours pas accès. Seul un patient sur deux souhaitant bénéficier de ces soins peut réellement en bénéficier. Il n’y a rien à ajouter. L’amendement est défendu.

Monsieur Gosselin, puis-je considérer que votre amendement no 371 est également défendu ?


Notre idée devrait être partagée par l’ensemble des parlementaires réunis ici ce soir : le fait de pouvoir bénéficier de soins palliatifs doit être rendu concret, objectif, cela doit être admis et constituer un droit opposable, un droit-créance. Nous souhaitons que cela soit très clairement inscrit dans le texte.
Notre pays a pris trop de retard en la matière. Nous manquons de 20 000 places. Cela est certes imputable à bien des gouvernements, mais aussi au vôtre, puisque vous êtes au pouvoir depuis deux ans et demi.
Prenons acte de ce retard et mobilisons-nous collectivement en déclarant l’accès aux soins palliatifs grande cause nationale, comme Philippe Gosselin, un certain nombre d’autres députés et moi-même le proposons, en inscrivant cette exigence explicitement dans le texte et en y allouant les moyens nécessaires. Madame la ministre, je suis très surpris que vous ne soyez pas plus explicite sur le plan dont vous nous parlez, au sujet duquel nous ne disposons ni d’éléments financiers, ni de calendrier, ni de perspectives concrètes.
Chacun admet que le retard est considérable, le présent texte concerne en partie ce sujet, et le Gouvernement reste silencieux, extrêmement flou, incertain. Nous souhaiterions obtenir des éléments précis et objectifs. Cette demande est également celle de nos concitoyens.

La Cour des comptes a souligné dans son rapport public annuel de 2015 que la prise en charge des soins palliatifs était toujours très incomplète. Je donnerai un exemple précis : sur 15 000 personnes décédées aux urgences en 2010, 7,5 % ont bénéficié de soins palliatifs alors que 66 % en auraient eu besoin.
De plus, il existe des inégalités importantes d’une région à l’autre en matière de soins palliatifs. L’écart est de 1 à 6 entre l’Auvergne et l’Île-de-France, par exemple. Des progrès ont été réalisés, mais ils demeurent insuffisants.
C’est pourquoi nous proposons dans cet amendement d’affirmer dès l’article 1er que toute personne doit pouvoir bénéficier de soins palliatifs.

Défavorable.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
La séance est levée.
La séance est levée, le mercredi 11 mars 2015, à une heure.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly