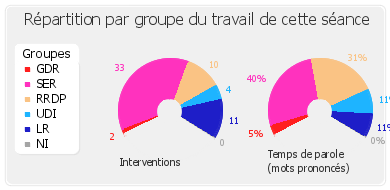Séance en hémicycle du 12 mars 2015 à 9h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.


La parole est à Mme Gilda Hobert, rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes ici rassemblés pour examiner une cause juste, celle de l’égalité de traitement – « égalité », ce mot de la devise de la République qui figure au fronton de nos écoles et dont nous devons nous rappeler sans cesse la valeur.
Au cours des récentes années, certaines communes n’ont pas hésité à arguer de leurs difficultés financières, souvent réelles il est vrai, pour restreindre l’accès des élèves au service de restauration scolaire. De manière parfaitement illégale et inacceptable, quelques-unes l’ont fait en discriminant délibérément les plus vulnérables, les enfants de chômeurs. Elles ont souvent invoqué à cet effet le motif fallacieux que les parents seraient prétendument « disponibles » pour fournir un déjeuner à la maison, en contradiction avec les démarches nombreuses et difficiles qu’implique la recherche d’emploi. Ces mesures stigmatisantes ne font qu’ajouter de l’exclusion à l’exclusion. La proposition de loi de M. Roger-Gérard Schwartzenberg vise donc à garantir une égalité par le droit d’accès de tous les élèves des écoles primaires à la restauration scolaire.
Rappelons que la mise en place de services de repas dans les écoles, bien qu’incombant aux communes, a un caractère facultatif sur lequel il n’y a pas lieu de revenir. D’ailleurs, 80 % des communes ont mis en place un système de restauration scolaire par école ou, dans certaines zones rurales, des cantines intercommunales.
Toutefois, selon l’auteur de cette proposition de loi, « la restauration scolaire n’est pas une compétence obligatoire des communes. Mais quand celles-ci en ont décidé la création, il s’agit alors d’un service public annexe au service public d’enseignement auquel s’applique le principe d’égalité. » Ainsi, cette proposition de loi vise à compléter le code de l’éducation par un nouvel article. Cet article fixerait, enfin par la loi, le droit d’accès à la cantine pour tous les enfants des écoles primaires, car il s’agit en effet d’un droit. Il fixerait d’autre part ce qui est déjà sanctionné par le tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi pour des faits de discrimination à cet accès.
« Le mot "progrès" n’aura aucun sens tant qu’il y aura des enfants malheureux », écrivait Albert Einstein. Nous n’avons pas le droit, mes chers collègues, de laisser hors de nos cantines des enfants sous de sombres ou discutables prétextes – qui tous revêtent alors un caractère discriminant. Nous avons le devoir de les traiter sans discrimination de quelque ordre que ce soit. La liste de ces discriminations, fixée à l’article L. 225-1 du code pénal, est claire et permet au juge administratif d’y recourir pour tous les manquements à chacun des principes énoncés.
Cette préoccupation n’est pas nouvelle et je me réjouis qu’elle fasse consensus dans notre assemblée.
Ces phénomènes discriminatoires sont d’ailleurs dénoncés dans divers textes qui, tous, réaffirment notre attachement à l’intérêt des enfants : d’abord la proposition de loi déposée en février 2012 par le groupe socialiste lors de la précédente législature, mais aussi le rapport du défenseur des droits, Dominique Baudis, qui dresse un bilan criant et, enfin, les décisions du juge administratif.
En cas de constat de discrimination, les parents se retrouvent souvent démunis et renoncent à toute poursuite. Les associations de parents d’élèves sont alors, heureusement, un maillon essentiel du recours des familles. Leur travail de relais et de médiation est, dans tous les temps de l’école, l’exemple même des aspects positifs de la co-éducation. Ensemble – école, collectivité locale, parents, associations –, on avance mieux et on participe à une école inclusive. Cette proposition de loi contribuera donc aussi à protéger les familles en leur donnant la possibilité de se reposer sur un dispositif clairement établi dans la loi.
Mes chers collègues, lors de l’examen en commission de cette proposition de loi, vous n’avez pas manqué de vous insurger contre toutes les formes de discrimination. Un enfant de chômeur se voit refuser l’accès à la restauration scolaire dans son école, au prétexte que son parent inactif pourrait se charger de son repas ? Inacceptable ! Un élève est « délicatement » invité à manger hors du cadre scolaire parce qu’il est porteur d’un handicap et que l’attention particulière et les aménagements que requiert ce handicap sont difficiles à gérer ? Révoltant ! Et il y a tant d’autres stigmatisations ou discriminations qui affectent parfois de manière indélébile nos jeunes pousses et leurs familles !
J’ai entendu certaines de vos inquiétudes à propos du risque de remise en cause des aménagements d’ordre social engagés par les communes, en particulier pour les enfants de familles en situation de fragilité. L’objectif de cette proposition de loi n’est nullement de contrevenir à ces avancées, bien évidemment !
De même, je voudrais préciser que, comme c’est le cas dans certaines communes, des moyens divers peuvent être mis en oeuvre pour faciliter l’accès de tous les élèves à la restauration scolaire sans qu’il soit besoin de construire des espaces. Double, voire triple service, optimisation ou réaménagement de l’espace, mobilier plus adapté… je sais les équipes municipales et les maires très inventifs et je ne doute pas qu’ils puissent s’adapter à ce principe égalitaire de droit d’accès. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de le voir en pratique quotidiennement dans des écoles de ma circonscription et je sais que nombre d’écoles et de maires de communes partout en France sont aussi attachés à le mettre en oeuvre.
Nous savons, et l’histoire nous l’a montré depuis la dernière partie du XIXe siècle, l’importance d’un repas pris à l’école. Les législateurs ont été amenés à se pencher sur la question. Les progrès qui ont suivi n’ont fait qu’étendre le champ des conditions d’accueil des élèves. En 2004, l’adoption du paquet « hygiène » par l’Union européenne a marqué une étape décisive dans la recherche de la qualité nutritionnelle. Les dispositifs ultérieurs n’ont fait que s’inscrire dans cette voie.
Comme il est important, pour un enfant, ce repas pris à la cantine, parfois son seul repas complet et équilibré ! Médecins, associations de parents d’élèves, de restauration scolaire, tous s’accordent à dire que l’attention d’un enfant qui a pris un repas équilibré, assis, tranquille, sera bien meilleure dans la suite de la journée. Ce repas a un impact sur la santé, mais aussi sur la scolarité de l’enfant.
Nous savons aussi l’importance de la pause méridienne en termes de socialisation, d’échange, de mixité sociale. Le continuum que représentent, dans une journée, les temps partagés de l’arrivée à l’école le matin jusqu’à la sortie, sans rupture, sont un gage d’harmonie et d’apprentissage du vivre-ensemble.
L’organisation des temps scolaires incombe aux communes. Un amendement adopté en commission a réaffirmé, en supprimant un alinéa, leur liberté d’organisation.
Madame la ministre, monsieur le président Schwartzenberg, monsieur le président de la commission des affaires culturelles qui n’a pu être parmi nous aujourd’hui mais que je tiens à saluer ici, mes chers collègues, je conclurai en invoquant la solidarité. À l’heure où près d’un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, à l’heure où la crise conduit de plus en plus de familles à connaître des périodes de chômage, ce mot doit prendre tout son sens. La solidarité n’est pas fractionnable, adaptable. Alors que les difficultés s’accroissent autour de nous, nous devons tout mettre en oeuvre pour la rendre effective, efficiente.
La solidarité n’est ni la pitié ni la charité. Elle se pratique, s’échange, se manifeste par sa tangibilité, sa réalité. Notre République doit entendre chacune et chacun, mais comment ignorer que certains ont davantage besoin d’attention que d’autres parce que la vie les a rendus plus vulnérables, parce qu’ils sont sans emploi, parce que ce sont des enfants, des jeunes qui, pour réussir leur scolarité, ont besoin que celle-ci se déroule dans des conditions correctes, voire optimales, et dans le respect de l’égalité de traitement ?
Dimanche dernier, à l’occasion de la réception à l’Élysée de « cent femmes qui font la France », le Président de la République a dit : « C’est l’égalité qui fait avancer notre société, qui donne des droits mais en même temps qui donne des chances. » Le Président de la République évoquait alors l’égalité entre les femmes et les hommes, mais la formule vaut évidemment pour les enfants, sans distinction sociale, sans discrimination aucune quant à la situation de leur famille.
Applaudissements sur les bancs des groupes RRDP, SRC et écologiste.

La parole est à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.
Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Schwarzenberg, la cantine occupe une place majeure dans la vie des enfants et dans leur quotidien à l’école. D’abord parce qu’elle assure une alimentation équilibrée ; alimentation qui, pour un enfant en âge scolaire, est essentielle à sa croissance, à son développement, à ses capacités d’apprentissage. Ensuite parce que c’est un lieu éducatif et de socialisation qui rythme de façon importante la vie collective au sein des établissements scolaires.
Pour les communes, le service de restauration scolaire est un service public facultatif, soumis au principe de libre administration des collectivités territoriales. Cela signifie que ce service public n’est pas obligatoire. On peut le déplorer, mais aujourd’hui, dans la contrainte que l’on connaît, généraliser l’accès à la cantine pour tous et le rendre obligatoire n’est sans doute ni souhaitable ni raisonnable. Il y va de la liberté des familles, il y va aussi de l’exercice décentralisé d’une compétence, donc d’une certaine conception des libertés locales selon laquelle les maires décident en responsabilité devant leurs administrés du niveau de service qu’ils offrent.
Un service de restauration scolaire n’est certes pas à la portée de toutes les communes qui comptent une petite école et souvent, des dispositions différentes ont été prises dans le consensus avec les familles. Il est vrai que je vante souvent l’intercommunalité – l’on peut me le reprocher – mais j’ai visité de ces petites cantines intercommunales, qui aujourd’hui, permettent à des enfants qui auparavant faisaient des kilomètres, de pouvoir manger sur place.
Nous ne voulons pas créer des problèmes là où il n’en existe pas. Il n’en demeure pas moins que le service de restauration scolaire répond à un besoin d’intérêt général et constitue une mission de service public. Si bien que lorsque le service de restauration existe au sein d’une école primaire, créé par une commune ou par une intercommunalité, les grands principes de notre modèle de service public que sont l’égalité d’accès, la neutralité, la laïcité et la continuité doivent être respectés et appliqués.
Oui, les communes disposent du droit de créer ou non ce service. Mais une fois le service créé, elles ne disposent pas d’un pouvoir souverain d’appréciation quant au droit d’y accéder. C’est ce qui est affirmé ce matin.
Le principe d’égalité interdit de traiter différemment des usagers placés dans une situation comparable. Aucune distinction ne peut être opérée entre eux, sur la base d’un critère prohibé – qu’il s’agisse de l’origine, de la situation de famille, de l’état de santé, de la situation de handicap ou encore de l’appartenance à une religion. Refuser l’accès à un service, en l’occurrence l’accès à la cantine, à un enfant, en vertu d’un de ces critères, constitue une discrimination régulièrement condamnée par les tribunaux administratifs de notre pays. Cette proposition de loi vise à mettre fin à ces dérives pour éviter les dérapages, épargner aux familles concernées les longues et fastidieuses démarches juridiques pour faire valoir leurs droits, éviter aussi d’impliquer les enfants qui, souvent, savent qu’il a fallu se déplacer, expliquer la situation et parfois, supplier.
Votre texte introduit expressément dans le code de l’éducation ce principe de non-discrimination pour l’accès à la cantine scolaire dans les écoles primaires, c’est-à-dire les écoles maternelles et élémentaires.
Aujourd’hui, de manière illégale et inacceptable, certaines communes n’hésitent pas à exclure de la restauration scolaire les élèves les plus vulnérables, au prétexte que l’un de leurs parents ne travaille pas. Ces enfants doivent pourtant être traités comme les autres, pour permettre à leurs parents d’effectuer des démarches, mais aussi pour être avec, et non à côté des autres.
Ces communes utilisent la tolérance introduite par le juge administratif, qui autorise les communes à limiter l’accès aux cantines lorsque leurs capacités d’accueil sont saturées. Mais dans ce cas, elles méprisent également les précisions très claires apportées par cette même jurisprudence sur la nécessité de conformité au principe fondamental d’égalité des usagers.
Cette pratique discriminatoire, indigne de notre République, ajoute de la précarité à la précarité, de l’exclusion à l’exclusion. Elle stigmatise les enfants de chômeurs et les prive d’un repas complet qui, parfois, est le seul de la journée. Elle met en difficulté ceux qui sont déjà dans des situations très délicates et pénalise les chômeurs dans leur recherche d’emploi, une recherche qui suppose d’accomplir de très nombreuses démarches et impose de se rendre mobile et disponible, parfois immédiatement.
Il est non seulement injuste d’exclure les enfants de chômeurs d’un service public mais aussi humiliant de considérer que le temps des chômeurs est moins précieux que celui des autres citoyens. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement partage l’objectif qui est celui du groupe radical, et qui fut, je tiens à le souligner, le mien, lorsque je signai une proposition de loi très proche au début de l’année 2012.
Avec cette proposition de loi, monsieur le président Schwartzenberg, vous souhaitez introduire dans le code de l’éducation un nouvel article, disposant que l’accès des élèves à la cantine est un droit, dès lors que le service est rendu. Vous précisez qu’il ne peut être établi aucune discrimination selon la situation de leur famille. Cette expression, qui recouvre la structure et la composition du foyer familial, la situation professionnelle des parents et la localisation de leur domicile, est à même de couvrir tous les cas déplorables que nous connaissons aujourd’hui. Elle permettra aussi, en consacrant les décisions du juge administratif, que les pratiques discriminatoires à l’égard des enfants soient plus efficacement sanctionnées, par le biais notamment du contrôle de légalité.
En précisant que ce droit est créé uniquement lorsque le service de restauration scolaire existe, votre proposition de loi garantit également que de nouvelles contraintes ne seront pas créées pour les communes. Le Gouvernement s’en félicite car, vous le savez, il s’efforce activement de réduire le poids des normes qui pèsent aujourd’hui sur les collectivités territoriales. Nous souhaitons que les communes, qui ont fait les efforts que l’on sait pour mettre en oeuvre la réforme des rythmes scolaires, ne soient pas à nouveau forcées de remettre l’ouvrage sur le métier. C’était le sens de l’un des amendements déposés par le Gouvernement en commission des lois. C’est avec satisfaction que nous avons constaté son adoption – enthousiaste ! (Sourires.) – par votre commission. L’adoption de cet amendement, ainsi que de celui précisant que les dispositions de votre texte ne s’appliquent qu’aux cantines des écoles primaires permet aujourd’hui au Gouvernement de se prononcer avec clémence à l’égard du texte.
Certes, comme pour toutes les propositions de loi, nous ne disposons pas de toutes les données permettant d’en évaluer les incidences, notamment en termes de coût. Mais nous pouvons nous engager à un travail entre les deux lectures, afin de prévoir des ajustements éventuels lors de l’examen du texte au Sénat.
Nous partageons votre ambition, celle de lutter plus efficacement contre les discriminations et de protéger les enfants des familles les plus précaires. Comme vous, nous ne pouvons plus accepter que des parents soient contraints de priver leurs enfants de cantine, alors qu’ils peinent déjà à boucler leurs fins de mois. Je sais que, comme moi, vous avez tous été confrontés à ces situations où nous nous sommes dit que la cantine était la garantie d’un repas chaud pour les enfants de ces familles en détresse.
Mesdames et messieurs les députés, avec cette proposition de loi, vous souhaitez réaffirmer avec force les grands principes de nos services publics. Il nous faut sans cesse les rappeler et mieux garantir leur effectivité. C’est pourquoi le Gouvernement soutient votre proposition de loi.
Il nous faut en permanence, chacun à notre niveau, redire la portée et le sens de ces grands principes. La continuité est la garantie que partout et sans interruption, l’intérêt général soit respecté. L’adaptation est l’assurance de répondre aux besoins évolutifs de nos concitoyens. L’égalité est la possibilité pour chacun, quelle que soit sa situation, d’accéder à l’ensemble des services publics. La neutralité est la garantie pour tous d’être traités de façon identique au sein de ces services publics. La laïcité est l’assurance de ne pas être discriminé, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance religieuse ; c’est un principe de concorde et d’inclusion, qui ne doit jamais être utilisé, ainsi que certains ont été tentés de le faire, comme un outil au service du rejet et du mépris de l’autre.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC, RRDP et écologiste.

La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg, premier orateur inscrit dans la discussion générale.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues – que je remercie d’être là un jeudi matin –, notre groupe a déposé la proposition de loi visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire pour mettre fin à une injustice d’autant plus préoccupante qu’elle concerne des enfants, c’est-à-dire des êtres vulnérables qu’il faut, au contraire, protéger contre les difficultés de la vie.
Comme l’a rappelé la ministre, il arrive périodiquement que des communes n’admettent pas tous les élèves à la cantine scolaire, en se fondant sur des critères variables – âge, lieu de résidence, activité professionnelle des parents, etc. Souvent, cette non-admission concerne les élèves dont au moins l’un des parents n’exerce pas d’activité professionnelle, dont on estime alors qu’il peut faire déjeuner son enfant. Ce refus d’accès concerne donc souvent des élèves dont l’un des parents au moins est au chômage, ce qui aboutit à discriminer, voire à stigmatiser des familles déjà en difficulté. Ce problème revêt une importance accrue avec le niveau très élevé du chômage – en janvier, on comptait en métropole près de 3,5 millions demandeurs d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité.
Souvent, les municipalités qui n’accueillent pas les enfants de chômeurs invoquent une prétendue liberté d’action des personnes au chômage. Pourtant, la recherche d’un emploi nécessite un investissement de temps et les chômeurs ont une obligation de disponibilité dans la recherche d’un travail, qui conditionne leur inscription ou leur maintien sur les fichiers de Pôle emploi.
Ce problème de l’accès sélectif aux cantines avait déjà retenu sous la précédente législature l’attention du groupe socialiste, radical et citoyen, qui rassemblait alors nos deux formations si proches. Celui-ci avait déposé le 7 février 2012, à l’initiative de Michèle Delaunay, que je salue tout particulièrement, une proposition de loi instaurant le droit à la restauration scolaire. Ce texte avait été signé notamment par plusieurs ministres de l’actuel Gouvernement, dont vous-même, madame la ministre, qui n’avez pas changé de position, ce dont je vous remercie très vivement.
Certes, la restauration scolaire n’est pas une compétence obligatoire, mais facultative, des communes. Notre proposition de loi maintient cette règle, sans la modifier. Elle n’impose aucunement la création de cantines là où il n’en existe pas, compte tenu des difficultés de certaines petites communes, souvent rurales, sachant en outre qu’il existe des possibilités de mutualisation.
En revanche, quand une municipalité a décidé la création d’une cantine, il s’agit alors d’un service public annexe au service public d’enseignement. Dès lors, la restauration scolaire est soumise au principe d’égalité, auquel le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle et qui implique notamment l’égalité des usagers devant le service public.
De même, Mme la rapporteure et Mme la ministre l’ont rappelé, la jurisprudence administrative est constante. Ainsi, le 16 novembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a jugé que « l’accès des élèves à la cantine scolaire […] ne peut être subordonné à la production par les parents d’attestations de travail. L’exigence de tels documents instaure une discrimination entre les élèves suivant que leurs parents ont un emploi salarié ou non. […] Elle porte ainsi atteinte au principe d’égalité entre les usagers du service public ».
Le 23 octobre 2009, le Conseil d’État, saisi par la FCPE du Rhône, a censuré la délibération du conseil municipal d’Oullins, qui avait modifié le règlement de la restauration scolaire – seuls les enfants dont les deux parents travaillaient auraient pu déjeuner à la cantine tous les jours, les autres n’étant accueillis qu’une fois par semaine. Pour le Conseil d’État, « cette délibération interdit illégalement l’accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l’objet du service public en cause ».
Face à cette jurisprudence constante, certaines municipalités invoquent la capacité d’accueil de leurs cantines, ce qui peut se comprendre. Cet argument est à examiner. Il serait concevable que l’État majore dans ce but précis la dotation des communes qui se trouvent dans cette situation. Mais il est possible d’accueillir un certain nombre d’élèves supplémentaires, sans avoir nécessairement à engager de dépenses significatives. Selon la FCPE et plusieurs cabinets de conseil en restauration scolaire, il n’y aurait guère de problème d’accueil qui n’ait une solution – le plus souvent des aménagements, et non des équipements nouveaux. Diverses solutions pratiques existent en effet, comme l’organisation de deux services au lieu d’un seul, la mise en place d’un self permettant une meilleure rotation des tables, ou l’adaptation du mobilier pour gagner de l’espace, sans oublier bien sûr les possibilités de mutualisation avec d’autres structures ou d’autres communes, qu’a rappelées Mme la ministre.
Malgré cela et en dépit d’une jurisprudence constante du juge administratif, des atteintes au principe d’égalité des usagers de la restauration scolaire sont périodiquement constatées dans plusieurs communes. Il importe donc que le législateur intervienne pour inscrire dans la loi les principes posés clairement par le juge, de façon à en assurer le caractère obligatoire. De la sorte, des familles, souvent démunies, n’auront plus à former de recours pour faire valoir leurs droits.
Dans son rapport de 2013, le défenseur des droits, Dominique Baudis écrivait : « Le défenseur des droits partage l’intention des propositions de loi déposées au Parlement en 2012 relatives à l’accès des enfants à la cantine [il s’agissait de la proposition de loi de Michèle Delaunay.] Et de poursuivre : « Il recommande que le service public de la restauration scolaire, dès lors qu’il a été mis en place, soit ouvert à tous les enfants dont les familles le souhaitent. »
Cette proposition de loi vise à compléter le code de l’éducation par un article établissant le principe d’un droit d’accès à la restauration scolaire afin que les élèves, sans distinction arbitraire, puissent bénéficier de ce service lorsqu’il existe.
Cet accès ne peut être conditionné par « la situation de leur famille », notion générique regroupant divers éléments, dont l’âge de l’enfant, l’exercice ou non d’une activité professionnelle par ses parents, leur disponibilité ou leur lieu de résidence.
En particulier, on ne peut admettre une distinction fondée sur la situation de demandeurs d’emploi des parents, qui séparerait les élèves les uns des autres au moment du déjeuner, mettant à l’écart les plus défavorisés. Il n’est pas possible de laisser des enfants de chômeurs à la porte des cantines scolaires et à l’écart de leurs camarades de classe. Le rôle de l’école n’est pas d’ajouter la difficulté à la difficulté mais d’accueillir chacun et de renforcer le lien social.
Par ailleurs, aux règles rappelées par le juge administratif s’ajoute naturellement l’article L. 225-1 du code pénal, relatif au délit de discrimination. Il sanctionne toute distinction opérée entre les personnes à raison de divers facteurs : origine, sexe, âge, état de santé, handicap, apparence physique, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.
Cette proposition de loi n’aborde pas la question de la tarification des cantines scolaires et n’établit donc pas de règle nouvelle à cet égard. Un grand nombre de communes appliquent déjà des tarifs dégressifs fondés sur le quotient familial.
Il serait souhaitable que davantage de municipalités encore décident d’appliquer ce système. Cette mesure de justice irait dans le sens de la loi d’orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, dont l’article 47 dispose que « les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau de revenu des usagers. »
Par ailleurs, il conviendrait d’envisager la gratuité de la cantine scolaire pour les enfants des familles très défavorisées, vivant sous le seuil de pauvreté.
Cette mesure serait cohérente avec notre histoire. En 1871, la Commune de Paris propose, parmi ses réformes, la gratuité de la cantine scolaire. En 1880, le Conseil municipal de Paris vote la création de cantines dans chaque arrondissement pour nourrir, aux frais de la Ville, les élèves des familles pauvres et en 1936, Cécile Brunschvicg s’attache à multiplier les cantines.
Aujourd’hui, notre pays compte 8 600 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, dont 2 700 000 enfants, c’est-à-dire un enfant sur cinq. L’UNICEF constate que la France, comme d’autres pays d’ailleurs, du fait de la crise, a vu augmenter son nombre d’enfants pauvres – ils sont aujourd’hui 440 000 de plus qu’en 2012, c’est-à-dire il y a quatre ans seulement.
Pour ces enfants très démunis, le seul vrai repas de la journée est souvent celui pris à la cantine scolaire. Personne ne peut rester indifférent devant une telle injustice, qui atteint les plus fragiles et les plus faibles.
Agir pour l’enfance pauvre, venir en aide aux plus vulnérables est un impératif éthique pour notre société car la République, c’est d’abord la solidarité et la fraternité.
Applaudissements sur les bancs des groupes RRDP, SRC, et écologiste.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, j’interviens à la place de ma collègue Brigitte Allain, retenue par des auditions dans le cadre de la mission d’information sur les circuits courts et la relocalisation des filières agroalimentaires, sujet lié à celui qui nous occupe aujourd’hui.
Pour le groupe écologiste, cette proposition de loi est une avancée importante et une nécessité face au refus de certaines communes d’accueillir tous les enfants à la cantine.
Pourquoi soutiendrons-nous cette proposition de loi ? En premier lieu, au nom du principe fondamental de l’égal accès de tous aux services publics et donc au nom de l’accès de tous les enfants à la restauration scolaire. Le combat pour l’égalité des droits est un engagement quotidien.
L’école doit, plus que jamais, incarner l’inclusion, l’égalité des chances, l’apprentissage de la solidarité, du vivre-ensemble et du respect de l’autre. Peut-on prendre le risque de priver un enfant de nourriture ? Que peut-on lui enseigner si ce besoin naturel de base n’est pas assouvi ? Comment un enfant peut-il ne pas ressentir l’injustice d’un tel rejet par une institution de la République ?
Nous soutiendrons aussi cette proposition de loi au nom du respect de la convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies en 1989 et qui consacre le principe de non-discrimination.
Oui, nous devons refuser toutes les discriminations, toutes les exclusions, qui sont des violences morales, subies avec plus d’acuité encore par les personnes les plus fragiles, comme les enfants.
Malheureusement, dans le monde aujourd’hui, 870 millions d’êtres humains souffrent de malnutrition. Pas moins de 79 millions d’Européens vivent en dessous du seuil de pauvreté et 16 millions dépendent de l’aide alimentaire.
Nous soutiendrons aussi cette proposition de loi car l’accès de tous les enfants à la restauration collective dès le plus jeune âge est un enjeu de santé public et d’égalité sociale. Le lien entre la qualité de l’alimentation à domicile et la catégorie socioprofessionnelle des parents est réel.
Les enfants issus des familles aux revenus modestes sont plus nombreux à souffrir de troubles de l’alimentation, comme l’obésité – 20 % d’entre eux sont touchés contre seulement 12% pour les enfants nés de parents cadres ou de professions intermédiaires, d’après les chiffres de l’Institut national de veille sanitaire.
Accompagnés par des politiques publiques, comme le programme national nutrition santé – PNS – et le programme national pour l’alimentation – PNA –, et dotés d’une forte volonté de progresser, les élus, directeurs et directrices d’école, intendants et parents d’élèves font évoluer les repas vers des assiettes plus équilibrées composées de produits de proximité et biologiques.
L’objectif d’introduire 20 % de produits biologiques dans la restauration collective, prévu par le Grenelle de l’environnement, n’est malheureusement pas encore atteint mais nous avançons, car les effets bénéfiques de ces produits sur la santé ne sont plus à prouver.
Ma collègue Brigitte Allain, qui travaille de longue date sur les enjeux liés à l’alimentation, a été récemment nommée rapporteure de la mission d’information sur les circuits courts et la relocalisation des filières agroalimentaires. À travers les nombreuses auditions qu’elle mène, elle a pu constater que les cantines peuvent devenir des lieux hautement éducatifs et porteurs d’enjeux forts sur l’éducation aux besoins nutritionnels, à la diversité, au goût mais aussi au civisme – apprendre à respecter son voisin de table, trier les déchets, ou encore ne pas jeter la nourriture pour ne citer que ces quelques exemples. N’oublions pas que 40 % de notre nourriture est jetée, taux qui atteint parfois 50 % dans la restauration collective.
Manger, partager les repas c’est aussi accéder à une culture. D’ailleurs, ces dernières années, des efforts importants ont été faits pour réintroduire l’art de la cuisine, des produits bio et de proximité dans la restauration hors domicile, notamment avec la reprise en gestion directe des cuisines.
Enfin, nous soutiendrons cette proposition de loi car, pour nous, dans un contexte de creusement des inégalités, la plus mauvaise des réponses est l’exclusion qui marque la défaillance des politiques.
Les quelques élus des collectivités locales qui refusent l’accès de tous les enfants à la restauration scolaire invoquent des raisons de bonne gestion budgétaire mais, plus grave, certains utilisent des critères de sélection.
Les familles dont l’un des parents est chômeur, selon eux, pourraient garder leurs enfants à domicile. Or, élever un enfant doit être conciliable avec l’accès à l’emploi, avec la formation, avec la participation à la vie citoyenne. C’est aussi une question d’égalité entre les hommes et les femmes car c’est encore, le plus souvent, la mère qui est concernée. Les enfants qui appartiennent aux milieux les plus fragilisés doivent avoir accès aux mêmes activités que leurs camarades plus chanceux.
De même, les enfants souffrant de troubles de la santé ou d’un handicap physique, mental ou psychique, qu’ils soient ou non soumis à l’observance d’un régime alimentaire, doivent pouvoir rester à la cantine avec leurs camarades.
L’école et le milieu périscolaire doivent être les lieux de l’inclusion, de l’égalité des chances, de l’apprentissage de la solidarité, du respect de l’autre dans ses différences, qu’elles soient physiques, culturelles, cultuelles ou d’origine.
De surcroît, ne pas permettre aux élèves handicapés de rester avec leurs camarades lors de la pause méridienne risquerait d’être un facteur favorisant leur déscolarisation.
L’un de nos amendements, d’ailleurs, vise à préciser ce point, pour qu’il ne soit plus permis d’exclure de la restauration scolaire, lorsque ce service existe bien entendu, les enfants en situation de handicap ou souffrant de troubles alimentaires. Le Conseil d’État ainsi que le défenseur des droits, à deux reprises, ont insisté sur cet impératif.
Proposée par le groupe RRDP, cette proposition de loi, qui donne la possibilité à chaque parent d’inscrire son enfant à une cantine, quelle que soit la situation des parents et de cet enfant, recueillera bien sûr le soutien des écologistes, même si en arriver à devoir prendre une loi pour rappeler le principe constitutionnel de « l’égal accès des usagers aux services publics » nous interroge sur la société dans laquelle nous vivons.
Applaudissements sur les bancs des groupes écologiste, RRDP et SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, vous nous proposez, chers collègues du groupe RRDP, de modifier le premier article du code de l’éducation portant sur l’obligation scolaire, article qui précise que « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, Français et étrangers, entre six et seize ans ». Votre proposition de loi touche à un article de loi fondamental pour l’avenir de nos enfants et les valeurs de notre République. Elle porte un objectif que nous pouvons tous et toutes ici partager, la lutte contre les discriminations dans l’accès à la restauration scolaire. Elle reste cependant au milieu du gué. Votre proposition rappelle une anomalie quelque peu oubliée : l’État, puis par délégation, les régions et les départements, ont la responsabilité d’assurer la cantine dans les collèges et les lycées mais l’État a laissé aux communes le choix de nourrir ou non les écoliers le midi !
Les communes ont largement assumé cette responsabilité. Ce débat nous permet donc de souligner le rôle des communes aux côtés de l’Éducation nationale dans la mise en oeuvre de la mission éducative de la République.
De la construction et de l’entretien des écoles aux centres de loisirs et centres de vacances, du périscolaire à la cantine, avec les personnels concernés, les élus locaux ont été et sont des partenaires essentiels, qui se sont très majoritairement engagés pour assurer l’éducation et le bien-être de tous les enfants de notre République.
Permettez-moi également de noter que la question de la restauration scolaire, et son évolution au fil du temps, est un révélateur de l’évolution de nos sociétés. Six millions de rationnaires dans le premier et second degrés, deux fois plus qu’en 1970, un succès qui n’est pas sans rapport avec l’évolution de la famille et le développement du salariat féminin, mais aussi, avec l’amélioration des prestations et le choix de nombreuses municipalités d’appliquer des tarifs dégressifs.
L’accès à ce service est pour beaucoup d’enfants un moment important, moment de convivialité, de plaisir, moment éducatif mais pour certains aussi l’occasion du seul vrai repas équilibré de la journée. Chacun a en mémoire ce chiffre, 18 % des enfants, presque un sur cinq, vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté dans notre pays !
Aussi, légiférer afin qu’aucune mesure discriminatoire prise par une municipalité ne puisse empêcher l’accès à ce service est justice et nous nous félicitons que votre texte y contribue. Comment, en effet, accepter que des enfants soient mis de côté, exclus, en raison du chômage de leurs parents ou de l’inactivité de l’un ou l’autre ? C’est une atteinte insupportable au droit des enfants mais également au droit d’accès des femmes au travail – on sait que la contrainte d’allers-retours du domicile à l’école pénalise la recherche d’emploi ou l’accès à une formation. Et on sait que le taux d’activité des femmes est plus faible dans les quartiers les plus populaires. On mesure ici la double peine qu’elles subissent.

D’où le bien-fondé de cette proposition de loi.
Toutefois, une fois cette loi adoptée, le droit à la restauration scolaire en primaire ne sera toujours pas inscrit dans les lois de la République. Vous assumez le choix de ne pas proposer qu’obligation soit faite aux communes ou aux intercommunalités de disposer en primaire d’une cantine scolaire. En n’instaurant pas cette obligation, vous n’engagez pas la responsabilité de l’État dans l’effectivité d’un droit à la restauration scolaire pour tous les élèves de primaire.
Nous allons certes aujourd’hui, en adoptant cette proposition de loi, agir utilement et efficacement contre des discriminations inacceptables mais sans pour autant assurer sur le sujet qui nous occupe l’égalité de traitement de tous les enfants de notre République. Bien sûr, créer un droit signifierait engagement de l’État et engagement de dépenses publiques supplémentaires, ce qui irait à l’encontre du dogme actuel de réduction des dépenses publiques. Pourtant, une telle dépense serait un investissement humain utile.
Il est d’ailleurs assez paradoxal que l’article 2 du texte propose d’augmenter la dotation globale de fonctionnement aux communes mettant fin à leurs pratiques discriminatoires, alors que votre majorité a décidé de diminuer de plus de trois milliards cette dotation, ce qui pénalisera y compris donc les communes vertueuses en matière d’accès à la restauration scolaire !
Chers collègues, en ces temps de crise de notre démocratie, nous devons être attentifs à la clarté de la loi et veiller à ce que chaque droit créé soit assorti de garanties concernant les moyens de son effectivité ; à défaut, la parole politique est inaudible.
Je prends donc votre proposition de loi comme un acte positif contre les exclusions dont sont victimes certains enfants et comme un appel à un retour au financement de politiques publiques ambitieuses et innovantes visant à répondre aux besoins essentiels, dont celui d’être bien nourri. La dépense publique est aussi un investissement. Il arrive que l’endettement consenti pour chercher, inventer, produire et répondre aux défis d’un développement durable et du progrès social soit un placement d’avenir.
Les collectivités locales sont à l’origine de 70 % des investissements engagés, qui peuvent concerner une cuisine centrale, la peinture d’un réfectoire ou encore le renouvellement de son mobilier. En répondant aux besoins des populations, les collectivités sont une source de développement économique. Aussi, j’espère que le groupe de travail créé après la rencontre entre le Premier ministre et l’Association des maires de France permettra de revenir sur la baisse des niveaux de la dotation globale de fonctionnement et d’accroître l’aide apportée aux maires bâtisseurs et aux acteurs de l’égalité territoriale.
Votre proposition de loi sur l’accès à la cantine conduit également à poser la question du coût de la restauration scolaire et de la possibilité pour une famille d’y inscrire ou non ses enfants. Certes, le code de l’éducation précise que le prix du repas à la cantine ne peut être supérieur à son coût réel. Cependant, des communes ne seront-elles pas amenées, faute de moyens, à augmenter les tarifs ? Des familles à faibles ressources pourraient ainsi être exclues de fait, sans que votre loi soit opérante. Ne faut-il pas envisager quelle mesure incitative pourrait être prise pour que se généralisent les quotients familiaux ?
En effet, nous ne pouvons – ce sera ma dernière remarque – accepter les inégalités territoriales et sociales au sein même du parcours scolaire, comme je peux encore le constater dans mon département, où la communauté éducative reste mobilisée pour exiger un nouveau plan de rattrapage en moyens pédagogiques et en enseignants.
Les objectifs de la loi de refondation de l’école visant à ce qu’il y ait plus de maîtres que de classes et à développer la scolarisation des enfants de moins de trois ans en maternelle se réalisent lentement. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, vingt-six classes accueillent des enfants de moins de trois ans sur 425 écoles maternelles, et trente-huit écoles primaires bénéficient du dispositif « Plus de maîtres que de classes » sur 440 établissements. Malgré l’augmentation du budget de l’éducation nationale, après des années de disette sous l’ancienne majorité, les moyens sont encore insuffisants et la question de l’égalité républicaine reste posée.
Nous voterons cette proposition de loi qui s’attaque clairement à une discrimination contraire aux droits des enfants, mais les députés du Front de gauche émettent ce vote positif comme un appel à une nouvelle mobilisation de la République pour l’éducation de ses enfants.
Applaudissements sur les bancs des groupes GDR, SRC, écologiste et RRDP.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, je tiens avant toute chose à excuser M. Patrick Bloche, président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, qui représente le président Bartolone à la mission de réflexion sur l’engagement citoyen et l’appartenance républicaine.
La proposition de loi qui nous est présentée lève le voile sur les pratiques scandaleuses qui ont cours dans certaines communes françaises et propose, pour y mettre fin, d’inscrire dans la loi le principe du droit d’accès à la restauration scolaire dès lors que ce service public facultatif est mis en oeuvre dans la commune, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales. Elle répond en cela à la demande de certaines associations de parents d’élèves, lasses de constater l’attitude de municipalités qui établissent des critères discriminants pour procéder à des sélections illicites, à l’image de celles qui refusent l’accès à la restauration scolaire aux élèves dont au moins l’un des parents est au chômage. Elle fait également suite au rapport de Dominique Baudis qui, en 2013, alors qu’il était défenseur des droits, recommandait que le service public de la restauration scolaire « soit ouvert à tous les enfants dont les familles le souhaitent ».
La liste des textes nationaux et internationaux prohibant ce genre de discriminations étant longue, j’appellerai simplement votre attention sur un point qui me tient particulièrement à coeur et pour lequel j’avais, avec le Conseil français des associations pour les droits de l’enfant, le COFRADE, demandé la création d’une mission interministérielle : je veux parler de la situation misérable dans laquelle se trouve un nombre toujours plus important d’enfants en France.
Comme on peut le lire dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, un enfant sur cinq vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Cela représente 440 000 enfants de plus qu’en 2008, date à laquelle s’est déclenchée la crise économique dont les effets se font encore ressentir aujourd’hui.
Pour ces enfants, le repas servi à la cantine est souvent le seul repas équilibré de la journée. Dans ma circonscription, j’ai eu connaissance de plusieurs cas dramatiques de ce genre, qui nous rappellent à quel point notre pays va mal. Réaliser des économies sur le dos des plus précaires, comme le font certaines municipalités, n’est pas seulement illégal : c’est une double peine, et c’est ce qui a motivé la rédaction de cette proposition de loi.
À notre époque, il n’est pas rare que des familles dans nos quartiers, dans notre rue, à proximité de chez nous, fassent le choix de ne plus partager qu’un seul repas par jour, car elles n’ont plus les moyens de se nourrir correctement. C’est une réalité trop souvent ignorée des proches, des enseignants, des travailleurs sociaux, des élus, et terriblement banalisée dans la société d’aujourd’hui. Il nous appartient de la prendre en compte quand ce sont les enfants qui en sont les premières victimes.
Ainsi, lorsqu’une famille sollicite le centre communal d’action sociale, le CCAS, pour une aide alimentaire d’urgence, et que le maire, qui préside le CCAS, demande à ses services d’examiner le dossier de plus près, il n’est pas rare que la famille en question ait à la même époque désinscrit son ou ses enfants de la restauration scolaire, et ce discrètement, par honte de devoir interrompre la fréquentation de la cantine par ses enfants dans le seul but de faire des économies. Dès lors, il arrive que le président du CCAS débloque une aide alimentaire d’urgence, qu’il accompagne par ailleurs d’une prise en charge gratuite pendant un, deux ou trois mois de la restauration scolaire pour les enfants de cette famille, même si celle-ci n’en a pas fait la demande. Est-ce de la bienveillance ? Est-ce de la gestion de proximité ? C’est en tout état de cause une mesure de protection sociale, et l’on voit bien là que ce service public facultatif n’a pas pour seule mission de proposer des repas ; au-delà, il vise à fournir régulièrement des repas équilibrés. Le service de restauration scolaire a donc une véritable fonction sociale.
Très souvent, la participation demandée aux parents est nettement moins élevée que le coût réel de fabrication des repas. Là encore, il est manifeste qu’il y a dans l’action publique une volonté d’accompagnement social. Par conséquent, le fait même de refuser un service public destiné à des enfants sous prétexte que l’un des parents serait au chômage est une aberration.
Sur un tel sujet, les questions éthiques sont évidentes, mais elles ne sauraient occulter un autre aspect du débat, plus pragmatique et qui n’en reste pas moins primordial : les difficultés financières auxquelles font actuellement face un grand nombre de communes. En effet, les municipalités ayant fait le choix de la compétence de restauration scolaire doivent aujourd’hui déployer des moyens financiers importants pour faire face à la demande, qu’il s’agisse de mettre en place un double service ou d’agrandir et de rénover des locaux anciens. Il faut louer les efforts des communes qui choisissent de mettre en oeuvre ce service public facultatif, en trouvant parfois des solutions qui rivalisent d’ingéniosité : ainsi, dans le 12e arrondissement de Paris, on transforme les préaux et autres espaces vacants en cantines éphémères.
Cela m’amène à appeler votre attention, madame la ministre, sur la nécessité de conserver aux communes des moyens qu’elles peuvent consacrer à leurs actions de proximité. À l’heure où l’on parle de plus en plus d’une dotation globale de fonctionnement territorialisée, l’inquiétude est grande. Si les communes étaient privées de tout ou partie de ces moyens, comment feraient-elles pour faire vivre des politiques publiques adaptées aux difficultés locales, car c’est bien de cela dont il s’agit ?

Lorsqu’un maire choisit de mettre en oeuvre un service public facultatif, c’est parce qu’il adapte le service public aux difficultés locales. Cela relève aussi du principe de libre administration des collectivités territoriales. Décider d’une baisse excessive, voire de la suppression de la dotation globale de fonctionnement pour les communes, réduirait peu à peu les maires à l’état de notaires chargés de la gestion des domaines relevant de compétences obligatoires et encadrés par des budgets si contraints qu’ils n’auraient plus de marge pour mener des politiques publiques de proximité, adaptées, innovantes, imaginatives et volontaristes.

Je sais, madame la ministre, combien vous êtes attentive à tous ces aspects ; c’est pourquoi je me permets de vous soumettre ces remarques à l’occasion de ce débat.
Dans sa version initiale, la proposition de loi précisait que le droit à la restauration concernait « le midi pour les jours scolaires », ce qui englobait le mercredi, alors même que toutes les collectivités territoriales n’ont pas créé de service ce jour-là. Lorsque la matinée du mercredi est consacrée à l’école, il arrive souvent que les communes n’aient pas prévu de restauration scolaire à midi. Les enfants qui, avant la réforme des rythmes scolaires, rentraient chez eux ce jour-là, continuent généralement de le faire. Ceux qui fréquentaient le centre de loisirs local peuvent, après la matinée d’école, rejoindre dans la plupart des cas ce centre sans hébergement et bénéficier de son service de restauration. Ce dispositif fonctionne plutôt bien et sans susciter de difficultés majeures.
C’est le cas par exemple de la petite ville de Tomblaine, dont je suis le maire. Si la proposition de loi imposait l’organisation d’une restauration scolaire le mercredi, le coût supplémentaire pour la commune pourrait être évalué à 180 000 euros par an. Certains trouveront que c’est peu, mais cela remettrait en question tout un équilibre budgétaire trouvé difficilement à la suite de la réforme des rythmes scolaires. Le Gouvernement a donc proposé un amendement visant à supprimer la disposition concernée, ce qui a permis de résoudre le problème.
Le groupe écologiste a présenté un amendement au titre de l’article 88 du règlement, qui a recueilli l’avis favorable de la commission. Il vise à permettre aux enfants en situation de handicap ou souffrant de troubles de santé – diabète, allergie ou intolérance alimentaire – de bénéficier de la restauration scolaire. Nous avons donné un avis favorable en commission, car cette disposition nous semble également très importante.
Toutefois, je souhaiterais à nouveau appeler votre attention sur un dysfonctionnement, madame la ministre. Un arrêt du Conseil d’État de 2011 explique clairement que l’accompagnement des enfants porteurs de handicap par des auxiliaires de vie scolaire, des AVS, doit être pris en charge par l’État au titre du temps périscolaire. Cet arrêt du Conseil d’État ayant été prononcé avant la réforme des rythmes scolaires, le Gouvernement en fait la lecture suivante : le Conseil d’État évoquait la pause méridienne pendant laquelle a lieu la restauration scolaire. Il faut pourtant savoir que cela ne fonctionne pas. Interrogé, le ministère de l’éducation nationale répond qu’il appartient aux parents d’enfants porteurs de handicap de solliciter la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, afin qu’elle prenne en charge l’AVS qui accompagnera l’enfant pendant la pause méridienne. Or, il arrive trop souvent que la MDPH n’accepte pas cette prise en charge ; les parents comme les communes ne trouvent alors aucune réponse acceptable. J’aimerais que le Gouvernement se penche sur cette question avant la deuxième lecture du présent texte.
Madame la ministre, le groupe socialiste, républicain et citoyen votera cette proposition de loi parce qu’elle est de bon sens, solidaire et humaniste. Elle n’entend pas ériger ce service public en compétence obligatoire mais vise à créer un droit à l’inscription à la cantine des écoles primaires pour tous les enfants scolarisés, lorsque le service existe. Il ne pourra donc être établi aucune discrimination selon la situation de la famille de l’enfant. C’est conforme au principe de continuité de l’école de la République et à l’approche républicaine du service public, puisque tous les enfants scolarisés sont à égalité de droits.
Enfin, s’agissant des discriminations dans les services publics, j’ajoute qu’il est probable que l’examen, dans les mois à venir, du projet de loi relatif à la déontologie nous donne l’occasion d’approfondir ce travail dans cette même optique afin de garantir une forme d’égalité réelle des droits sur le territoire national.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC, écologiste et RRDP.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi, présentée par le groupe RRDP, affiche le souci d’un accès de tous les enfants aux cantines scolaires. Elle est présentée comme une clarification de la jurisprudence sur les refus d’inscription de certaines communes dans les cantines qu’elles gèrent.
Ces dernières années et très récemment, quelques exemples médiatiques ont mis en avant les difficultés rencontrées par certaines municipalités en manque de places, mais aussi les réponses en effet contestables apportées par d’autres.
Revenons quelques instants sur les débats en commission des affaires culturelles et de l’éducation. Nous avons pris pour point de départ les situations d’exclusion ou de refus d’inscription à caractère discriminant que, de toute façon, personne ne songe à défendre ou à excuser. Or, dans la très grande majorité des écoles, l’accès à la restauration est réglé de façon responsable et respectueuse des situations des enfants et des familles.
Un collègue de notre groupe expliquait en commission qu’il avait décidé, dans les cantines de sa municipalité où il manquait de places, de privilégier justement les enfants dont un ou les parents étaient au chômage, ainsi que les enfants de familles en situation de précarité.
Il aurait été utile de mesurer le problème auquel on envisage d’apporter des solutions en identifiant les abus et les possibilités d’y mettre fin.
Nous avons également entendu que la cantine scolaire était pour les enfants un idéal absolu en termes de qualité de l’alimentation, d’apprentissage du goût, de variété des aliments, d’hygiène, voire qu’elle était un élément essentiel de leur socialisation. N’exagérons rien et rendons justice aux familles !
Admettons que les familles, dans leur très grande majorité, sont tout à fait aptes à apporter à leurs enfants une alimentation équilibrée et adaptée : on ne sert pas que des repas de chips à la maison ! Ce n’est pas nier pour autant que pour certains enfants, le repas à l’école est le seul repas équilibré de la journée. Mais nous sommes là dans le champ de l’action sociale, champ que n’investit pas cette proposition de loi.
Disant cela, je vais être un peu provocatrice, mais si l’école devait assurer tout ce qui peut apparaître comme nécessaire ou bienveillant pour l’enfant, pourquoi ne garantirait-elle pas aussi la qualité du sommeil, dont on sait qu’elle est quelquefois mise à mal ? Mais je m’égare…
J’en viens à la proposition de loi déposée par nos collègues du groupe RRDP, visant à créer un nouveau droit, qui appelle de notre part plusieurs observations.
L’article 1er dispose que « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon la situation ou de leur famille ». Cela pourrait se lire comme la possibilité de discrimination d’une autre nature que la situation de la famille. L’amendement proposé par notre collègue Barbara Pompili atténue cet effet, mais je ne suis pas sûre qu’il l’élimine.
Créer un droit à la restauration scolaire change la nature de ce service annexe à caractère facultatif, même si la restauration scolaire est aujourd’hui considérée comme une nécessaire adaptation aux évolutions de nos modes de vie. Il n’existe pas de service public de la restauration scolaire et nous savons pourquoi, comme nous savons pourquoi il n’existe pas de service public d’accueil du jeune enfant.
Créer un droit à la restauration scolaire suppose que le nombre de places à la cantine soit en rapport avec la demande, ce qui est souvent le cas mais, vous en conviendrez, pas partout. Il existe donc toujours dans le règlement de la restauration scolaire des critères d’accès. Mais tout critère de priorité, quel qu’il soit, ne pourrait-il pas être jugé discriminant ou injuste ? Et en l’absence de critères de priorité, la règle sera forcément, en cas de manque de places, l’ordre d’arrivée des enfants. Est-ce préférable ?
Si on suit votre logique, force est de constater que vous vous arrêtez au milieu du gué : vous affichez l’inscription à la cantine scolaire comme un nouveau droit, mais vous ne rendez pas obligatoire la création de ce service dans les écoles. Dans les établissements ne disposant pas de cantine, l’accès à la restauration scolaire sera donc un droit vain pour les enfants concernés !
En dépit de toutes vos bonnes intentions, ce texte pourrait avoir des conséquences néfastes. Quel choix fera l’élu qui se retrouvera devant un problème sans solution ?

Quant aux communes qui n’ont pas organisé de restauration scolaire, ne seront-elles pas tentées de ne surtout pas le faire en raison des nouvelles contraintes qui pèseraient sur elles de ce fait ?

Ce droit induit des charges, l’auteur de la proposition de loi en a d’ailleurs bien conscience puisqu’il prévoit que « les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence ».
On met à la charge des communes des obligations qui ne sont pas indolores. Notre rapporteur parlait de rajouter deux ou trois chaises : pas sûr que cela soit suffisant !

Dans de nombreux cas, cela exigera des travaux d’agrandissement ou d’adaptation, pour transformer un espace en self par exemple. Pourra s’ensuivre une augmentation du coût des repas et des charges de personnel, notamment dans le cas de prise en charge particulière pour les enfants handicapés ayant besoin d’être accompagnés et pour les enfants devant suivre un régime alimentaire spécifique. Et pourra même s’ensuivre, dans le cas d’une restauration scolaire intercommunale, une augmentation des frais de transport.
Nous parler de compensation alors que les dotations aux collectivités ont été drastiquement diminuées est un miroir aux alouettes, comme l’a été la compensation promise pour la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires...

Cette proposition de loi, pour nous, n’est qu’un texte d’affichage qui ne prend nullement en compte les réalités concrètes rencontrées par les municipalités, et nous n’avons aucun éclaircissement sur les modalités pratiques de son application. C’est pourquoi nous ne pourrons la soutenir dans sa rédaction actuelle.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, l’objectif poursuivi par cette proposition de loi visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire est au coeur de la vocation de l’école républicaine : inclure, intégrer, fédérer et naturellement garantir la réussite des élèves dans leur parcours scolaire et éducatif.
En effet, l’accès à la restauration scolaire occupe une place déterminante dans la vie scolaire de nos enfants. La cantine joue un rôle essentiel en contribuant à l’équilibre nutritionnel des enfants. Elle a de ce fait un impact décisif non seulement sur leur santé mais également sur leurs capacités d’apprentissage, de concentration et d’attention.
Dans le contexte de crise que notre pays connaît depuis plusieurs années, et plus particulièrement face à la hausse massive du chômage, de plus en plus de familles sont plongées quotidiennement dans la précarité et la détresse. Aujourd’hui, en France, ce sont 2,7 millions d’enfants, soit un enfant sur cinq, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Confrontés à la faim et souffrant de graves carences nutritionnelles, nombreux sont ceux dont les chances d’accomplir une scolarité normale et épanouissante sont menacées.
C’est pourquoi le repas quotidien servi à l’école, qui est parfois le seul repas complet et équilibré de la journée, ne peut pas, ne doit pas être négligé.
Refuser l’accès à la restauration scolaire, ce serait fermer les yeux sur le fait que, depuis la crise, 440 000 enfants ont basculé dans la pauvreté. Ces « enfants de la crise » sont les premiers exposés à la précarité, à l’échec scolaire, et plus tard au chômage. Ce serait ignorer que ce sont les plus modestes, déjà trop souvent délaissés par notre école, qui souffrent le plus des atteintes au droit d’accès à la restauration scolaire.
Certaines municipalités, pour diverses raisons, continuent d’en refuser l’accès à des enfants, bien que ce refus soit illégal. Dans la plupart des cas, les communes, confrontées à une situation financière très dégradée – vous le savez, madame la ministre, pour l’avoir souvent entendu lors des journées parlementaires – et souhaitant réaliser des économies, n’ont pas pleinement adapté leurs services à l’accroissement du nombre d’élèves dont les parents demandent l’inscription à la cantine.
Lorsqu’elles n’ont pas agrandi ou rénové leurs locaux, comme il aurait été nécessaire, ou lorsqu’elles n’ont pas mis en place un double service, il leur est difficile de faire face à l’afflux des demandes d’inscription.
Plus grave, certaines communes, heureusement peu nombreuses mais dont il a été question dans l’actualité récente, ont instrumentalisé, il n’est pas d’autre mot, la restauration scolaire, stigmatisant au passage certains de nos concitoyens, instituant des discriminations contraires au droit, que celles-ci soient liées à la situation professionnelle des parents, à l’âge des enfants ou encore à leur lieu de résidence. Ces choix politiques ont été systématiquement censurés par le juge administratif, qui veille au respect du principe d’égalité des usagers de la restauration scolaire.
Malgré cette jurisprudence constante, des atteintes à ce principe d’égalité sont encore à déplorer. On pourrait d’ailleurs se demander pourquoi il nous faut débattre d’une telle proposition de loi alors qu’il s’agit simplement d’appliquer le droit.
Le groupe UDI considère qu’il est nécessaire d’affirmer dans la loi que la restauration scolaire est un service public local. Dès lors, même s’il est facultatif, ce service public doit respecter ces grands principes que sont l’égalité d’accès, la continuité et la neutralité.
Il s’agit d’une recommandation du défenseur des droits, qui a récemment appelé à une clarification juridique de la situation afin « que le service public de la restauration scolaire, dès lors qu’il a été mis en place, soit ouvert à tous les enfants dont les familles le souhaitent ».
Les refus opposés soulèvent, selon nous, plusieurs problèmes graves. Tout d’abord au titre du principe d’égal accès au service public, auquel nous sommes tous fortement attachés, mais aussi du principe de non-discrimination à l’égard des enfants, et même de manière plus large, au titre des droits de l’enfant et de la défense de son intérêt supérieur.
Les enjeux à l’égard des parents, et plus particulièrement des femmes, sont également cruciaux, comme l’a excellemment démontré Mme Buffet, car l’impossibilité d’inscrire un enfant à la cantine peut avoir une incidence directe sur l’accès ou le retour à l’emploi.
Certaines communes, pour justifier leur refus d’accueillir des enfants à la cantine scolaire, arguent du fait que lorsque l’un des parents n’exerce pas d’activité professionnelle, il peut prendre en charge le repas de midi de son ou de ses enfants. Un tel raisonnement conduit à infliger une double peine aux personnes touchées par le chômage et dont la recherche d’emploi est entravée par le refus de l’établissement scolaire d’accueillir leur enfant à la cantine le midi. Nul n’ignore, en effet, que la recherche d’un emploi nécessite un investissement de temps et que les personnes en situation de chômage ont une obligation de disponibilité.
De même, lorsqu’un parent qui n’exerçait pas d’activité professionnelle souhaite retrouver un emploi et y parvient, il lui est souvent impossible de disposer du temps nécessaire pour faire déjeuner son enfant à midi, sans pour autant que l’établissement scolaire puisse accueillir immédiatement son enfant.
L’éloignement géographique entre le domicile et l’école peut également rendre très compliquée la prise en charge des enfants par leurs parents pour la pause méridienne.
Mais au-delà de la difficulté créée aux parents, le refus des établissements d’accueillir certains enfants à la cantine conduit à stigmatiser ces derniers, en les mettant à l’écart de leurs camarades de classe, alors même que les cantines scolaires sont un lieu irremplaçable de socialisation. Une telle situation ne peut être tolérée car elle pénalise en premier lieu ceux qui sont les plus vulnérables, au mépris de la vocation d’inclusion de l’école républicaine.
J’ajoute qu’au-delà de cette problématique de l’accès à la restauration scolaire, nous ne pouvons faire l’économie d’une réflexion plus large sur d’autres enjeux cruciaux. Je pense notamment à l’accueil des enfants handicapés, souffrant de troubles de santé, ou encore au respect du principe de neutralité. Car l’école de la République doit accueillir sur ses bancs tous les enfants sans aucune distinction de condition sociale, de conviction ou de confession.
C’est pourquoi le groupe UDI porte un regard très bienveillant, au-delà de votre clémence, madame la ministre, sur les objectifs poursuivis par cette proposition de loi, qui contribuera à consolider la place de l’école dans le projet républicain.
En revanche, il est évident que l’adoption de ce texte entraînerait des répercussions financières pour les communes en les obligeant à investir pour améliorer l’accès aux cantines scolaires.
Dans un contexte de baisse sans précédent des dotations aux collectivités locales, sur lequel nous ne cessons d’appeler l’attention du Gouvernement, et alors que l’État ne cesse d’imposer de nouvelles charges à ces dernières – je pense notamment à la réforme des rythmes scolaires – un tel effort ne sera pas soutenable pour de nombreuses communes.
En conséquence, nous ne pourrons soutenir cette proposition de loi sans un engagement très ferme du Gouvernement sur la manière dont cette charge nouvelle pourrait être compensée. Il serait en effet irresponsable de créer un droit sans prévoir les moyens, notamment budgétaires, de le rendre effectif. Si cette incertitude n’était pas levée, nous ne pourrions soutenir cette proposition de loi dont nous partageons pourtant l’objectif républicain.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, lors de la rentrée scolaire 2012, nous avons relevé que plus de soixante-dix collectivités, dont la mairie de Bordeaux, je dois le reconnaître, refusaient l’accès aux cantines scolaires à de nombreux élèves. Elles opéraient une sélection selon divers critères alors que la restauration scolaire doit être un véritable objectif de politique publique. L’un des critères d’admission était l’exercice par les deux parents d’une activité professionnelle. Logique en apparence, ce critère exclut de la cantine les enfants de chômeurs et de personnes sans emploi en supposant qu’elles sont en mesure de prendre en charge le déjeuner de leurs enfants. Non seulement une telle décision fait peser une charge supplémentaire sur des parents qui n’ont pas toujours les moyens financiers, la possibilité ni le temps de s’occuper de leurs enfants à midi mais elle stigmatise les enfants eux-mêmes en les privant d’un accès auquel ont droit leurs camarades de classe.
Elle les prive aussi bien souvent du repas complet, varié et équilibré qu’exige la circulaire ministérielle du 25 juin 2001, pris en outre dans des conditions socialisantes de partage, d’échange mais aussi d’ordre qui font partie intégrante de l’éducation, et ce malgré plusieurs décisions du Conseil d’État et des tribunaux refusant une telle sélection et réaffirmant le principe d’égalité de traitement des usagers des services publics. Une loi est donc nécessaire. Sous la précédente législature, les députés du groupe SRC s’étaient accordés sur un texte semblable en tous points à celui que nous examinons aujourd’hui instaurant un droit à la restauration scolaire. Avant son examen, nous avions bien sûr auditionné les fédérations de parents d’élèves et surtout les maires et leurs organisations représentatives. Certaines municipalités alléguaient le manque de place ou de personnel pour satisfaire ce droit mais en fin de compte moins de quarante communes étaient confrontées à de réelles difficultés, chiffre qui peut être mis en regard de la demande formulée à l’instant par le groupe UDI.
D’ailleurs, la contrainte force parfois l’imagination si celle-ci ne s’exprime pas spontanément. Des propositions positives ont été avancées comme la mutualisation de la restauration avec les maisons de retraite, laquelle s’inscrit dans le cadre des actions intergénérationnelles, dont l’utilité est reconnue tant pour les enfants que pour les personnes âgées. Un rapport a été remis au mois de juin 2014 à la ministre chargée du droit des femmes appelant l’attention sur le fait que cette discrimination pénalise les femmes au premier chef et doit donc être refusée. Tous ces arguments concourent à ce que nous nous réunissions autour du texte examiné aujourd’hui. Il s’agit non seulement d’un droit mais de l’affirmation du principe d’égalité qui n’a jamais été aussi nécessaire dans notre pays. N’oublions pas non plus qu’il s’agit d’une obligation féconde incitant à la recherche de solutions nouvelles, techniques comme à Bordeaux, ou sociales et intergénérationnelles. Nous voterons donc des deux mains, si j’ose dire, la proposition de loi et je remercie nos collègues du groupe RRDP de l’avoir déposée sur le bureau de l’Assemblée !
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et RRDP.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, il ressort des travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation que nos collègues, toutes tendances politiques confondues, semblent s’accorder sur le caractère parcellaire de la proposition de loi qui aurait dû aborder le sujet des cantines dans son ensemble. Je regrette pour ma part que le texte n’évoque ni la nutrition en termes qualitatifs ni les circuits courts permettant aux communes de limiter les coûts et aux enfants de mieux se nourrir. Je m’étonne en outre, chers collègues du groupe RRDP, que vous ne fassiez pas référence à la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt qui fait la promotion de l’approvisionnement local en matière de restauration collective. N’oublions pas en effet que le modèle alimentaire français est un bien collectif qu’il faut transmettre aux générations futures. Pour les Français, manger est un plaisir et un moment de partage conforme à des codes culturels tels que la convivialité, la diversité alimentaire et la structuration des repas en trois plats principaux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’UNESCO a inscrit le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l’humanité.
Assurer l’accès de tous à une nourriture de qualité en quantité suffisante, garantir la sécurité des aliments en favorisant la santé publique, maintenir des cultures culinaires et des liens sociaux, soutenir notre modèle agricole, nos industries agroalimentaires et nos emplois dans les territoires constituent autant d’enjeux sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux majeurs justifiant le renforcement de l’intervention publique en matière d’alimentation.
La restauration collective, qui représente trois milliards de repas servis chaque année, 73 000 restaurants et 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires, est devenue un enjeu alimentaire national. Grâce à elle, les enfants peuvent avoir accès à une alimentation de bonne qualité. Faciliter l’accès de la restauration collective publique aux productions issues des circuits courts est l’un des objectifs du Programme national pour l’alimentation. La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche prévoit par ailleurs l’introduction dans les repas de produits de saison, à faible impact environnemental ou sous sigles de qualité et d’origine. L’éducation alimentaire de la jeunesse constitue l’un des axes de la politique de l’alimentation. Votre proposition de loi visant à garantir l’accès à la restauration scolaire l’omet, chers collègues radicaux. C’est regrettable, car vous auriez pu faire vôtre, au nom de tous les enfants, la maxime d’Hippocrate : « Que ton aliment soit ta seule médecine » !

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, nous étudions aujourd’hui une proposition de loi de nos amis radicaux visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire. En pratique, nous parlons là d’interdire les discriminations d’accès à la restauration scolaire fondées sur la situation familiale de l’élève. Nous soutenons bien évidemment une telle initiative. J’entends parfois des arguments, certes jamais sur nos bancs, selon lesquels certains parents choisissent de ne pas travailler pour s’occuper de leurs enfants. Dès lors, réserver des places dans les cantines aux enfants dont les parents travaillent en priorité sur ceux dont un parent, souvent la mère d’ailleurs, a fait un tel choix, serait une mesure juste et équitable.
Mais qui peut croire que les enfants vivant dans ces familles sont ceux qui aspirent le plus à fréquenter les services de restauration scolaire ? Si ne pas travailler est un choix libre et volontaire de vie de famille, par ailleurs tout à fait légitime, il comprend alors, sauf cas exceptionnel, la volonté de ne pas bénéficier des services de restauration scolaire. A contrario, les personnes et les familles visées par les mesures prises dans certaines collectivités sont bien celles qui subissent l’absence d’emploi. Nous soutenons donc la proposition de loi car nous refusons de considérer qu’une situation de précarité comme le chômage constitue un élément de confort dans l’organisation de la vie de famille, celle des enfants en particulier.

Comme les chômeurs ne travaillent pas, ils ont tout le temps nécessaire pour s’occuper de leurs enfants dans la journée ! Allons ! Qui donc peut souscrire à un tel raisonnement qui ferait presque du chômage une chance ? Partir du principe qu’un chômeur a du temps libre tout au long de la journée et peut par conséquent s’occuper de ses enfants, c’est occulter les démarches nécessaires pour retrouver un emploi et bien souvent n’avoir jamais été au chômage ! Au-delà des parents et des conditions de retour à l’emploi, les premiers concernés par la proposition de loi, d’abord et avant tout, sont bien les enfants, comme l’ont dit avec force et raison nos collègues. Si les parents eux-mêmes ne sont pas en général responsables de leur situation, refuser l’accès à la restauration scolaire à certains enfants en raison de leur situation familiale revient à leur en imputer une part de responsabilité. Pis encore, cela consiste à leur infliger une double peine. Le chômage étant trop souvent synonyme de précarité, le repas pris à la cantine est parfois le seul repas équilibré à coût abordable dont bénéficient certains élèves, même si les enfants préfèrent parfois ne pas aller à la cantine, reconnaissons-le !

Et que dire de l’aspect symbolique d’une telle exclusion qui vient renforcer un sentiment souvent difficile à vivre pour bon nombre d’écoliers ? Les stigmatiser un peu plus en leur refusant un droit dont jouissent leurs camarades d’école dont les parents ont, eux, la chance d’avoir un emploi est tout bonnement inacceptable. Dois-je rappeler également que nous éviterons ainsi à des communes, donc à des collègues maires, de se voir inlassablement condamnées par la justice administrative jusqu’au Conseil d’État, comme l’a rappelé le président Schwartzenberg et comme le rappelle fort à propos votre exposé des motifs, chers collègues radicaux ? Ainsi, en adoptant la proposition de loi, non seulement nous faisons oeuvre d’égalité républicaine mais nous faisons progresser la sécurité juridique des communes !
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et RRDP.
Je remercie les intervenants. Les enfants aimeraient peut-être les écouter car c’est de leurs droits dont il s’agit ! Sur l’ensemble des bancs, tout a été très bien dit. Bien sûr, il existe une opposition mais je regrette toujours que l’on commence par évoquer les dotations et les difficultés des collectivités locales pour dresser des listes d’attente sur lesquelles on inscrira d’abord ceux qui travaillent et ensuite ceux qui sont au chômage. Il faut être très attentif à ce que vit et ressent un enfant. Il ne s’agit pas d’un jugement éthique mais d’un ressenti d’enfant qui le marque pour la vie. La République doit donc cesser de chercher des raisons, objectives ou non, et retenir ce principe. C’est, me semble-t-il, ce que Roger-Gérard Schwartzenberg et son groupe ont voulu rappeler. L’enfant a un ressenti et vit certains actes de sa vie comme un droit ou un déni de droit. Dès lors, le débat est quasiment clos, même si j’admets bien sûr tous les arguments. Il faut être attentif à cela, car c’est bien des enfants dont il s’agit.
Quant aux dotations des collectivités territoriales, j’aurais préféré ne pas les diminuer, comme tout ministre. Il faut faire attention, je le dis toujours, car cette diminution ne nous est pas imposée de l’extérieur. Nous sommes malheureusement face à une gageure car ne pas diminuer les dotations implique d’augmenter les impôts, ce qui est aussi un vrai sujet. Il faut faire attention car ce sont les mêmes personnes qui paient les impôts nationaux et les impôts locaux. D’ailleurs, cela nous amènera peut-être à nous pencher ensemble sur la part de la participation à la solidarité par le biais de la fiscalité des familles et des individus au niveau de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et au niveau de l’impôt local, où il existe en effet des injustices.
J’en viens à la DGF et aux communes. Je comprends que l’on puisse avoir peur de la DGF territoriale. De fait, nous devrons veiller à laisser une marge de manoeuvre aux communes. Je pense à une communauté de communes qui comprend huit communes et deux écoles, au sein de laquelle il a été très difficile de déterminer qui allait prendre en charge l’école, la cantine et les services périscolaires. Après des années – je dis bien des années – de débats, il a été décidé que les tâches – telles que la restauration, les plateaux sportifs, l’accueil – seraient réparties entre les uns et les autres. On aurait pu régler cela plus facilement si la compétence avait été attribuée à l’intercommunalité.
Il faut avoir à l’esprit que certaines intercommunalités prennent en charge des cuisines centrales et des écoles – nous ne vivons pas tous en zone urbaine dense. Il faudra donc réfléchir à cette question en ayant tous les cas de figure à l’esprit. Pour ma part, je ne clos pas le débat sur la DGF mais, au contraire, je l’ouvre. Pourquoi ? Parce que la coexistence de l’hyper-richesse et de l’hyper-pauvreté devient insupportable. On constate que, dans certaines communes, il n’y a pas de cantine, non pas parce que le maire s’y oppose mais parce qu’il n’en a pas les moyens Tout cela suscite des interrogations au regard du principe de l’égalité républicaine ; on reviendra d’ailleurs sur ces débats. J’ai entendu les arguments des uns et des autres mais, je le répète, c’est le début et non la fin du chantier.
Je vous remercie, les uns et les autres, de vos engagements. Parler des enfants, c’est partager un enthousiasme républicain, et il faut que l’on se dirige vers la création d’un service qui, certes, n’est pas un service obligatoire et n’entre ni dans les critères de dotations ni dans le cadre des transferts. Il faut que l’on réfléchisse non seulement aux recettes accompagnant les transferts de compétences mais aussi à celles issues de la fiscalité. Tout cela est affaire de choix politique. En effet, nous ne débattons pas tant, ici, de l’obligation de mettre en place tel ou tel service que de choix politiques. Dans le cadre des choix, on instaure une barrière – non pas une norme mais une barrière républicaine : en effet, le choix politique de créer un service public peut s’accompagner du choix politique de le rendre accessible à tous. Ce matin, pour ce qui est du service dont nous parlons, nous disons que le choix politique de le rendre ou non accessible à tous ne nous est pas offert, car c’est d’enfants qu’il s’agit : si le service est créé, il doit être nécessairement ouvert à tous.
Applaudissements sur les bancs des groupes RRDP et SRC.

J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles de la proposition de loi.

Le rapport du défenseur des droits de mars 2013 indique que le service public de la restauration scolaire doit être ouvert à tous les enfants dont les familles le souhaitent. Il relève un certain nombre de discriminations, notamment concernant les élèves souffrant de troubles de santé, comme le diabète, les allergies ou les intolérances alimentaires, alors même que ces phénomènes sont, hélas, de plus en plus nombreux, ce qui doit d’ailleurs nous interpeller quant à notre modèle de production agricole, très consommateur d’intrants, dont on connaît aujourd’hui les effets sur la santé.
Ce rapport met aussi en lumière les discriminations dont sont victimes les enfants en situation de handicap. Sur cette question, il me semble nécessaire de rappeler combien nous nous sommes battus, ici même, lors des débats sur la refondation de l’école, pour inscrire dans la loi les termes « école inclusive ». Or, les activités périscolaires, et donc la pause méridienne et la cantine, s’inscrivent dans le prolongement de ce service public de l’éducation. Le périscolaire relève donc du droit à l’éducation, qui doit être garanti à tout un chacun, quels que soient ses origines, son lieu d’habitation, ses revenus, son handicap ou ses éventuels troubles de santé liés à l’alimentation.
L’obligation d’assurer l’accès des élèves handicapés aux activités périscolaires, comme les cantines, n’est pas une requête nouvelle. Comme je l’ai dit tout à l’heure, le Conseil d’État et le défenseur des droits se sont déjà prononcés très clairement à ce propos. Par-delà l’aspect discriminant, il faut souligner que ne pas permettre aux élèves handicapés de rester avec leurs camarades lors de la pause méridienne risque de favoriser leur déscolarisation…

…notamment en raison de l’organisation et des trajets complexes induits par cette exclusion.
Aussi cet amendement a-t-il simplement pour objet d’inscrire dans la loi le fait que les élèves en situation de handicap, comme ceux souffrant de troubles alimentaires, doivent être accueillis à la cantine lorsque ce service existe. Aucune discrimination ne peut être permise.
Applaudissements sur les bancs du groupe RRDP.

Chère collègue, comme je vous l’avais dit en commission, je suis favorable à cet amendement. Vous entendez placer l’enfant au centre de cette proposition de loi et garantir l’accès à la cantine pour tous. C’est, à mes yeux, extrêmement important. Comme vous l’avez rappelé, le Conseil d’État a clairement indiqué, en 2011, que les élèves handicapés ont le droit à un accompagnement par un ou une auxiliaire de vie, y compris à la cantine. Auparavant, la circulaire du 8 septembre 2003 avait imposé que les cantines accueillant des enfants souffrant d’allergies et, plus généralement, de troubles de santé leur offrent des repas adaptés, ou autorisent ces élèves à venir avec un panier-repas.
Cela étant, il est vrai que votre proposition tendant à ce qu’il soit tenu compte de la situation de l’enfant est proclamative. Je la considère comme telle, et je vous confirme que j’y donne un avis favorable.
Ma position initiale consistait à dire que cet amendement était déjà satisfait par deux textes, en particulier celui de 2008, qui, à la suite de diverses adaptations du droit, avait proscrit très fermement toutes les discriminations, notamment en raison du handicap et de l’état de santé. Cet amendement est donc à mes yeux satisfait, et je serais tentée d’en demander le retrait, même si j’entends bien qu’il est proclamatif.
Je veux dire à Hervé Féron qu’il ne faut pas considérer que l’on a clos le débat sur l’accompagnement. Au sein des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, le financement de l’État atteint environ 30 % – il s’agit essentiellement du financement de personnels mis à disposition. Il faut que l’on détermine qui, de l’État ou des collectivités territoriales, doit financer le service de la cantine.
Avec Benoît Hamon, nous avions eu de longs débats sur les auxiliaires de vie scolaire et sur le fait que ces personnes deviennent titulaires d’un CDI de l’éducation nationale. J’avais une position un peu différente de la sienne. Je disais qu’il fallait prêter une attention particulière à l’école et au collège et qu’au niveau départemental, compte tenu des MDPH, l’État et le département auraient peut-être pu discuter de la prise en charge des auxiliaires de vie scolaire dans un certain nombre de cas, dont celui-ci. Je pense que le débat n’est pas clos. Si cet amendement est adopté, peut-être devrons-nous constater, après l’examen du texte au Sénat, qu’il est de nature strictement déclarative mais, après tout, la proclamation peut aussi donner un peu d’enthousiasme.
Applaudissements sur les bancs du groupe RRDP.

L’amendement étant satisfait, vous en remettez-vous à la sagesse de l’Assemblée, madame la ministre ? Est-ce bien cela ?
Oui, madame la présidente.

Mon intervention tiendra lieu d’explication de vote, puisque cet amendement permet de préciser les choses. Comme vous l’indiquiez, madame la ministre, le texte de 2008 contient déjà un certain nombre de dispositions. Néanmoins, le fait de prendre en compte non seulement la situation de l’enfant mais aussi celle de sa famille et, de surcroît, les troubles de santé comme le handicap, paraît une bonne chose. Notre groupe soutiendra donc cet amendement.

Je veux appuyer l’intervention de notre collègue Barbara Pompili. Comme vient de le reconnaître la ministre – je reconnais là sa sagesse – l’expression proclamative a son importance. Par ailleurs, à un moment où se tient un véritable débat sur l’accessibilité des établissements publics aux personnes handicapées, ce sera aussi un signal fort – c’est un ancien maire qui s’exprime – adressé aux communes pour qu’elles engagent les travaux permettant cette accessibilité, non seulement dans les établissements scolaires mais également dans toutes les installations, dont, naturellement, les restaurants scolaires.
Comme l’a évoqué la ministre, cela implique aussi la possibilité, pour les collectivités locales, de pouvoir prendre en charge des auxiliaires de vie scolaire. En effet, dans l’esprit, leur présence dans les lieux de restauration scolaire, ne pose, je pense, aucun problème à quiconque. En revanche, l’accompagnement est lourd, et les auxiliaires de vie scolaire affectés à l’établissement scolaire ne pourront pas prendre en charge les élèves jusqu’au restaurant scolaire.

Notons, d’ailleurs, qu’aujourd’hui – ce n’est pas une critique mais un constat –, nous ne voyons plus comme par le passé les enseignants accompagner leurs élèves avec autant d’enthousiasme au restaurant scolaire. Il appartient aux collectivités d’en assurer la responsabilité.
Quant aux problèmes soulevés par les allergies alimentaires, il s’agit d’un vieux débat ; nous avons été confrontés, à Lens, à un problème de cette nature. Soyons prudents quant aux risques de mise en cause des personnels par des parents. Il arrive en effet, malheureusement – on peut les comprendre, eu égard à leur peine – que les parents portent plainte contre des personnels qui ne sont pas formés au traitement des allergies. Cette proposition de loi appelle le renforcement de la présence de l’infirmière scolaire et du médecin scolaire au sein des établissements, et je ne doute pas que telle soit l’intention de la ministre de l’éducation.

Je voterai bien sûr en faveur de cet amendement, parce qu’il est des proclamations qui méritent de ne pas être tues. Je formulerai une courte remarque, liée à la prise en charge des auxiliaires de vie scolaire. L’arrêt du Conseil d’État de 2011 dit très clairement qu’il est de la responsabilité de l’État de prendre en compte les auxiliaires de vie scolaire sur le temps périscolaire, ce qui inclut la pause méridienne. J’entends bien que l’État n’est financeur qu’à hauteur de 30 % dans les MDPH, mais c’est le ministère de l’éducation nationale qui renvoie vers cette institution les parents des enfants porteurs d’un handicap. Il faudrait donc simplement appliquer l’arrêt du Conseil d’État et qu’en conséquence l’État prenne à sa charge les auxiliaires de vie scolaire le temps de la pause méridienne, ce qui ne devrait pas être d’un coût exorbitant.

Le groupe RRDP soutiendra bien entendu cet amendement, qui, de notre point de vue, ne présente pas seulement un caractère proclamatif. C’est en effet une question essentielle pour des dizaines de milliers de familles. La revendication contenue dans cet amendement est très claire et nous permettra de montrer aux jeunes enfants qui éprouvent des difficultés en la matière que leur droit est réaffirmé. Cela nous demandera d’assumer des responsabilités nouvelles. Il faudra aussi, madame la ministre, que l’État accompagne les collectivités territoriales. Il est en effet indispensable que l’État continue à faire preuve de solidarité envers les enfants porteurs de handicap, y compris pendant le temps périscolaire. C’est donc un amendement extrêmement important, et, au nom de l’ensemble du groupe, je remercie Mme Pompili de l’avoir présenté. Je suis très heureux que l’Assemblée nationale s’apprête à le voter unanimement.
L’amendement no 2 est adopté à l’unanimité.
L’article 1er, amendé, est adopté.
L’article 2 est adopté.
La proposition de loi est adoptée.
La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à onze heures vingt.


La parole est à M. Jacques Krabal, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

Madame la présidente, madame la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, mes chers collègues, cette deuxième proposition de loi du groupe RRDP vise à assouplir le mécanisme dit du « droit d’option départemental », modifié par l’article 3 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, qui permet à un département de quitter sa région d’origine pour rejoindre une région contiguë.
Je veux le dire ici avec force et détermination : non, cette proposition de loi n’a pas pour objet de remettre en cause le vote exprimé par la majorité gouvernementale il y a deux mois à peine. Il ne s’agit pas non plus de réengager une quelconque guerre, voire une guéguerre, pardonnez l’expression, au sein de notre assemblée ou dans les nouvelles régions. Il s’agit plutôt de prendre en compte les difficultés apparues dans le cadre des débats précédents et de les aborder avec sérénité.
Pourquoi réengager le débat alors que l’encre était à peine sèche, m’a-t-on demandé ? Parce que nous, législateurs, devons tendre vers des textes susceptibles d’être acceptés et partagés par le plus grand nombre de citoyens. Telle est la conception du groupe RRDP. Quand un texte, que son vote remonte à quelques jours ou à plusieurs années, peut être encore amélioré, pourquoi se priver de cette perspective ? D’autant qu’il s’agit ici non pas d’une révolution, mais bien d’une évolution à la marge, qui ne concernerait que quelques départements.
En effet, moins d’une dizaine d’entre eux seraient en réalité concernés par un éventuel rattachement à une autre région que leur région d’origine. Tout le monde pense, bien sûr, à la Loire-Atlantique, mais on peut également citer le Gard, la Lozère ou bien évidemment l’Aisne, que je connais particulièrement. Comme vous le savez, les populations de ces départements n’ont pas été consultées, pas plus que leurs élus d’ailleurs, sur le choix du rattachement de leur département.
Vous m’objecterez, à juste titre, que ce fut également le cas pour les autres. Cependant, puisque ces territoires silencieux semblent d’accord avec le texte proposé, sollicitons donc avec une autre méthode les seuls territoires où cela pose problème. En revanche, il faut oeuvrer sans chercher à imposer arbitrairement un choix plus qu’un autre. Pour ma part, je refuse en effet de faire à d’autres ce qui nous est fait. Pour éviter ces regroupements ou fusions arbitraires, sources de frustration et d’incompréhension, nous devons, nous, les élus, tout faire pour que la décision arrêtée puisse être acceptée. Et c’est grâce à la consultation tant des élus que des habitants concernés que nous y parviendrons.
Respecter la démocratie représentative, favoriser la démocratie participative sont les ingrédients pour retrouver la confiance de nos habitants. Faute d’avoir pris en compte ces deux éléments, le vote des élus ou le vote des habitants, cette loi sera telle qu’elle est à présent : entachée d’une forme de déni démocratique. Voilà pourquoi, afin de faire vivre plus fortement la démocratie, je vous enjoins à faire du droit d’option un véritable droit de choisir.
Il est encore temps, mes chers collègues : mettons de côté les postures, les petits calculs, soyons à l’offensive, car rien ne devrait nous arrêter quand il s’agit de faire progresser la démocratie, tellement malmenée aujourd’hui.
Cette proposition de loi a donc simplement pour ambition d’améliorer l’efficacité du mécanisme du droit d’option départemental, en remplaçant la condition de majorité requise, à savoir les trois cinquièmes des suffrages exprimés dans les trois assemblées délibérantes concernées, par la majorité simple. Elle fait ainsi confiance aux élus locaux.
Il faut en effet rappeler que si nous avons modifié la procédure de changement de région d’un département, introduite à l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales par l’article 27 de la loi du 16 décembre 2010, c’est parce que, en raison de sa complexité, cette procédure n’avait jamais été mise en oeuvre. Respectueux du droit comme nous le sommes, évitons de nous appuyer sur des miroirs aux alouettes, cela ne ferait qu’empirer les choses.
Pour mémoire, je vous rappelle que pour permettre à un département de rejoindre une autre région contiguë, le droit en vigueur impose trois conditions : l’inscription à l’ordre du jour du projet de rapprochement dans chacune des trois assemblées à la demande d’au moins 10 % de leurs membres ; une délibération concordante des trois assemblées concernées ; l’organisation d’un référendum dans le département et les deux régions concernées aboutissant à un accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des inscrits.
Cette procédure extrêmement lourde a été profondément modifiée à la suite de longs débats parlementaires à l’Assemblée nationale comme au Sénat, qui ont abouti à l’abandon de toute condition référendaire et à la subordination du changement de région d’un département aux délibérations concordantes des trois assemblées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. La majorité gouvernementale a notamment tenu à maintenir le consentement de la région de départ et a limité dans le temps cette nouvelle procédure, qui ne pourra être mise en oeuvre qu’entre le 1er janvier 2016 et le 1er mars 2019. Avant le 1er janvier 2016, c’est la procédure en vigueur qui s’applique.
Notre proposition de loi ne vise pas à remettre en cause cette nouvelle procédure, qui constitue un premier pas en avant. Comme je vous l’ai dit précédemment, ce n’est pas une révolution. Bien que je sois attaché à la démocratie participative et à l’initiative citoyenne, elle ne réintroduit pas de condition référendaire. En outre, elle maintient la nécessité d’obtenir l’accord de chacune des trois assemblées concernées, car il ne nous paraît pas raisonnable de faire l’impasse sur l’accord de la région de départ, touchée au premier chef par la modification des limites régionales résultant du droit d’option. Enfin, elle ne remet pas en cause le délai de trois ans prévu par loi du 16 janvier 2015, car il faut bien fixer une fois pour toutes les limites territoriales des futures régions françaises et veiller à ce qu’elles ne soient pas modifiées au gré des changements politiques locaux.
En revanche, conformément à de nombreux souhaits émis sur tous les bancs, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, notre proposition de loi vise à améliorer l’efficacité de cette procédure en simplifiant la condition de majorité requise, par le passage de la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés à la majorité simple. Cette simplification de la condition de majorité serait le signe d’un renforcement de la confiance accordé par le Gouvernement et le Parlement aux élus locaux pour assumer des choix importants. Ce droit d’option serait ainsi un vrai droit de choisir.
J’observe d’ailleurs que le Gouvernement s’est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet lors des débats parlementaires, s’en remettant sur tel ou tel amendement à la sagesse du Sénat ou de l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, avant de se rallier, en nouvelle lecture, à l’équilibre global du projet de loi auquel était parvenu le rapporteur. Toutefois, dans la mesure où notre proposition de loi ne remet pas en cause cet équilibre global, j’espère que la position du Gouvernement et de la majorité pourra évoluer.
En ce sens, je vous proposerai d’ailleurs un amendement qui vise à responsabiliser davantage les élus départementaux et régionaux en précisant que ce droit d’option ne pourra être exercé qu’une seule fois. Il s’agirait donc d’une évolution des limites régionales sans retour en arrière possible, décidée à la majorité simple dans chacune des trois assemblées délibérantes.
Ce droit d’option unique pourrait en revanche être mis en oeuvre sans limitation de durée, c’est-à-dire au-delà du 1er mars 2019, si les collectivités concernées ne l’ont jamais exercé. Cette proposition inciterait ainsi les élus à bien peser les avantages et les inconvénients d’une telle réforme territoriale, avant de pouvoir la mettre en oeuvre plus facilement que ne le prévoit la loi du 16 janvier 2015.
Je tiens également à vous préciser la philosophie qui guidera ma position concernant les autres amendements déposés sur cette proposition de loi, s’ils venaient à être débattus.
En premier lieu, il me semble totalement inopportun de soumettre à un référendum national un projet de rattachement d’un département à une autre région, car les enjeux liés à un tel rapprochement sont strictement locaux et concernent au tout premier chef les élus et les habitants des départements et régions concernés. Nous savons tous que dans les référendums nationaux, les électeurs ne répondent pas seulement à la question posée. Ce n’est pas le cas pour les consultations locales.
En deuxième lieu, je suis opposé à toute modification du dispositif adopté le 16 janvier 2015 consistant à supprimer purement et simplement la possibilité pour la région d’origine, souvent appelée région de départ, d’exprimer son avis sur le projet de raccrochement d’un de ses départements à une autre région, tant pour des raisons constitutionnelles que politiques. En effet, de tels amendements m’apparaissent incompatibles avec le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Je serais davantage favorable à l’instauration d’une procédure de consultation de la population dans le département envisageant le rapprochement avec une autre région, au besoin par le biais d’un référendum d’initiative citoyenne. Dans cette hypothèse, si la population concernée se prononce majoritairement en faveur du rapprochement, il me paraîtrait difficile pour la région d’origine de s’opposer à la volonté de ses propres citoyens. Il serait alors envisageable de ne la consulter que pour avis et de se passer de son consentement le cas échéant.
En dernier lieu, si le groupe socialiste et le Gouvernement s’opposaient à la poursuite du débat sur cette proposition de loi, ce qui n’est pas impossible, si la motion de rejet préalable était adoptée, je veux leur dire que ce n’est pas ainsi que nous réglerons ce qui n’est pas un problème personnel ni une question mineure, mais bien une question de fonctionnement de notre démocratie. C’est pourquoi il ne fait aucun doute que le sujet reviendra encore et encore sur les bancs de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
Comme l’écrivait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans la fable Le renard et le bouc : « En toute chose il faut considérer la fin ». Ne vous méprenez pas, mes chers collègues, la finalité de cette proposition de loi est d’améliorer le fonctionnement de la démocratie en prenant en compte l’avis des élus et des citoyens. Aujourd’hui, à la veille des élections départementales, face à la montée des populismes et de l’abstention, a-t-on bien pris en compte cette nécessité d’écouter d’avantage les citoyens ? N’ayons pas peur du peuple ! À force de ne plus écouter nos citoyens, ne soyons pas étonnés qu’ils ne nous entendent plus.
Applaudissements sur les bancs du groupe RRDP.

La parole est à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence du ministre de l’intérieur, qui est en ce moment même à Bruxelles pour la réunion du Conseil « justice et affaires intérieures. »
Le 15 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’essentiel des dispositions du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Le Président de la République l’a promulguée dans la foulée et la loi a été publiée dès le 17 janvier au Journal officiel de la République française.
La nouvelle carte, désormais composée de treize régions métropolitaines, contre vingt-deux auparavant, entrera donc en vigueur au 1er janvier 2016, comme prévu. Les prochaines élections régionales auront lieu en décembre 2015 et permettront d’élire les assemblées des conseils régionaux sur la base de ces nouvelles circonscriptions. Cette loi permet de franchir une nouvelle étape, historique, dans la réforme territoriale d’ampleur engagée par le Gouvernement. Je crois que nous pouvons tous être fiers du travail de coconstruction que nous avons réalisé et du résultat auquel nous avons abouti grâce à vos excellents travaux.
Tout au long de l’examen du projet de loi sur les régions, la volonté du Gouvernement a été de favoriser les fusions de régions, en proposant une nouvelle carte des régions, et de proscrire leur démembrement. Cette approche nécessaire n’interdisait bien sûr pas une forme de souplesse, mais je rappelle que le Président de la République a fait ce choix car nous sommes en période de crise, même si nous pensons en voir la sortie, et que démanteler les régions aurait pris une ou deux années de travail, voire un peu plus, afin de régler les transferts de ressources, de charges et d’emprunts par exemple. Conscient de ces difficultés, le Président de la République a préféré ne pas toucher aux anciennes régions. C’est pourquoi il a été choisi de procéder par fusions et rassemblements, mais sans démembrements.
C’est dans ce cadre que la question du droit d’option des départements souhaitant changer de région a occupé une place centrale dans les travaux de votre assemblée et du Sénat. Il fallait en effet trouver, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, le bon équilibre, un équilibre délicat, entre la nécessité d’assurer la stabilité du découpage résultant de nos travaux et celle de préserver la souplesse indispensable pour satisfaire certaines aspirations locales.
Supprimer l’obligation d’une consultation locale, qui supposait non seulement d’obtenir une majorité dans le cadre de trois consultations, mais aussi que soit satisfaite une condition de majorité qualifiée, constitue à cet effet un assouplissement très significatif, comme le rapporteur l’a expliqué. Un compromis a progressivement été dessiné sur cette question, et les positions défendues avec talent par beaucoup d’entre vous, pour certains en faveur de plus de souplesse encore, pour d’autres afin de renforcer les garanties de stabilité, montrent que c’est bien un point d’équilibre qui a été trouvé.
L’article 3 de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 prévoit en effet la possibilité pour un département de rejoindre une autre région. Cette modification se fonde, à partir du 1er janvier 2016 et jusqu’au 1ermars 2019, sur des délibérations concordantes du conseil départemental et des deux conseils régionaux concernés, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Vous proposez, monsieur le député Jacques Krabal, de revenir sur cette disposition régissant le droit d’option en substituant à l’exigence de majorité qualifiée celle de la majorité simple de chacune des trois collectivités concernées.
Le Gouvernement s’était engagé à ce que l’adoption du projet de loi sur les régions obéisse à une méthode claire : le débat et la recherche de consensus avec les parlementaires. Le ministre de l’intérieur avait, dès le mois de juin, affirmé son engagement à tenir deux lectures devant chaque chambre avant de convoquer la commission mixte paritaire.
L’Assemblée nationale s’est ainsi saisie à quatre reprises du texte. La question du droit d’option a été débattue lors de chacune des lectures devant le Parlement, pour aboutir au mécanisme que je rappelais assurant le juste équilibre que votre assemblée a défini entre la nécessité d’assurer la stabilité du nouveau découpage et celle de préserver la flexibilité indispensable pour satisfaire certaines aspirations départementales.
Je voudrais à cet égard remercier l’ensemble des parlementaires, ceux de la majorité comme ceux de l’opposition, qui se sont emparés du projet de loi avec passion et lui ont donné la forme et le contenu qui sont aujourd’hui les siens, notamment sur le droit d’option. Je remercie tout particulièrement le rapporteur Carlos Da Silva, qui a réalisé un travail absolument décisif. Une majorité s’est dégagée dans cette assemblée sur l’ensemble du texte, conditionnée notamment par la définition des modalités d’exercice du droit d’option. Vous comprendrez que moins de deux mois après la promulgation de la loi, et alors même que le droit d’option n’a pas été mis en oeuvre, nous ne souhaitions pas en remettre en cause la définition. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable à cette proposition de loi, et j’en suis désolée pour votre travail, monsieur le rapporteur.
Vous le savez, nous sommes en pleine période électorale dans les départements, qui ont maintenant des compétences affirmées puisqu’il y a un accord sur ce point entre le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Nous sommes aussi déjà entrés dans la préparation des élections régionales. Le débat doit rester derrière nous, même si vous avez raison : un débat démocratique n’est jamais définitivement clos.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour l’examen de la proposition de loi visant à assouplir le mécanisme dit du « droit d’option départemental » que Jacques Krabal a déposée au nom du groupe RRDP.
Vous le savez, les radicaux de gauche et apparentés se sont à de nombreuses reprises exprimés pour laisser aux départements la possibilité de choisir leur région de rattachement. En effet, suite à l’adoption de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, une nouvelle carte des régions a été établie, instaurant à compter du 1er janvier 2016 douze régions métropolitaines en sus de la collectivité territoriale de Corse.
Cinq régions restent inchangées : la Bretagne, le Centre, l’Île-de-France, les Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur. En revanche, sept régions sont créées, par fusion de régions existantes. Il en va ainsi de l’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, de l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, de la Bourgogne-Franche-Comté, du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, de la Normandie et enfin d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour ma part, j’ai toujours pensé que des rectifications marginales pouvaient concerner à la fois des départements que la fusion de régions marginalisait totalement, combat que mène mon collègue et ami Jacques Krabal pour l’Aisne mais qui est tout aussi compréhensible dans le Gard, dont l’économie est plus tournée vers le grand Avignon que Toulouse, mais aussi des départements victimes de rattachement aberrants sur le plan économique et historique lors de la création des régions. Je prendrai l’exemple des Hautes-Alpes, que je connais bien.
En effet, ce sont des géographes qui ont créé en France le découpage des régions, suivant le principe des « eaux pendantes ». Ainsi, le Dauphiné historique s’est vu amputer d’un de ses trois départements, les Hautes-Alpes, au motif que la Durance coulait vers la Méditerranée, sans que le géographe, qui était parisien, s’aperçoive au demeurant que d’autres rivières comme la Romanche ou le Drac étaient quant à elles des affluents de l’Isère. La Drôme et l’Isère se sont donc retrouvées en Rhône-Alpes et les Hautes-Alpes en PACA – le plus élégant acronyme de toutes les régions – leurs habitants découvrant au passage une culture bien atypique pour des alpins, et un accent et un langage qui relevaient, que mes collègues des Bouches-du-Rhône me pardonnent, de la nécessité de la traduction simultanée !
Sourires.

La justice ne s’y est d’ailleurs pas trompée, comme beaucoup d’autres services, en conservant son rattachement à la cour d’appel de Grenoble. Voilà donc un département qui dépend, selon l’administration, d’une région ou d’une autre, ce qui est assez étonnant. Plaisanterie mise à part, quelques années plus tard, il suffit de regarder l’état de l’unique route nationale entre les Hautes-Alpes et l’Isère, la RN 85 entre Gap et Grenoble, pour voir que le chemin de char qu’elle est devenue démontre l’abandon des politiques publiques sur un territoire qui aurait gardé sa cohérence en étant rattaché à la région voisine.
Nous pensions donc naïvement qu’au-delà des modifications de la loi du 16 janvier 2015, les erreurs géographiques, climatiques, économiques et sociales du découpage initial des régions auraient pu être corrigées. Elles le pourraient l’être si l’on assouplissait le droit d’option.
Or s’il est vrai que le mécanisme que nous proposons aujourd’hui ne trouve à s’appliquer à cette spécificité locale que je viens de décrire, il vise justement à éviter de fixer les choses, en permettant aux départements de choisir leur région de rattachement.
Si d’aucuns opposent à notre proposition de loi qu’elle intervient moins de deux mois après l’adoption de la loi de réforme des régions, j’objecterai qu’il apparaît nécessaire de légiférer dès maintenant, afin de ne pas créer des situations permanentes et des droits acquis pour les différents échelons. Comme l’a dit notre excellent rapporteur, ne vaut-il pas mieux éviter les erreurs avant que l’encre ne soit totalement sèche ?
Ainsi, l’objet de notre proposition de loi est d’assouplir le mécanisme dit du « droit d’option départemental », en permettant à un département de quitter sa région d’origine pour rejoindre une autre région contiguë, ceci en modifiant l’article 3 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
L’assouplissement vise à substituer à la condition des trois cinquièmes des suffrages exprimés un mécanisme de majorité absolue des suffrages, suffisant pour permettre à un département de changer de région. Mais cet adoucissement est limité, la majorité devant être recueillie dans les trois assemblées délibérantes, soit le département concerné mais aussi les régions de départ et d’accueil.
Nous sommes attachés à ce que la région de départ, qui est la collectivité la plus touchée par un changement de région du département, conserve le droit de donner son avis, mais dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ! De même, nous nous limitons au simple changement de région d’un département : nous ne souhaitons pas étendre le dispositif aux fusions de communes, départements ou régions.
Enfin, nous souhaitons que cette possibilité soit ouverte une seule fois, mais qu’elle ne soit pas nécessairement contenue dans un délai. Nous ne voulons pas permettre un va-et-vient continu du département d’une région à une autre, ceci afin d’assurer une stabilité des collectivités territoriales. Pour autant, nous pensons que ce droit d’option doit pouvoir intervenir après le 1er mars 2019. En effet, si nous considérons qu’un département doit pouvoir choisir librement sa région de rattachement, loin de nous l’idée de lui permettre de changer sans cesse de région au gré des fluctuations politiques. La stabilité administrative et territoriale est un élément nécessaire de l’organisation de la République, et nous y tenons. Toutefois, la négation de volontés locales n’est pas acceptable.
Ainsi, vous l’aurez compris, nous ne souhaitons pas remettre en cause tout l’équilibre de la loi relative à la délimitation des régions. Nous souhaitons simplement faciliter le choix des départements quant à leur région de rattachement.
Nous avons entendu la volonté du Gouvernement, par la création de grandes régions, de s’adapter aux réalités géographiques et à l’Europe des régions, ainsi que de limiter les dépenses publiques des collectivités territoriales. Mais le découpage suggéré par le Gouvernement se superpose au découpage territorial en prenant en compte les périmètres administratifs des régions existantes. Un autre découpage, plus satisfaisant, tenant compte des identités locales et de l’unité géographique des territoires concernés, aurait pu être retenu. La volonté d’encourager le vivre-ensemble des habitants d’un territoire favorise de fait un développement économique et humain renforcé, gage d’un territoire florissant à long terme.
Il apparaît également nécessaire de prendre en compte la volonté des habitants d’un territoire et de leurs représentants. Le rattachement à une région est un élément important de l’organisation politique et administrative, et le sentiment de rattachement des habitants d’un département à une région l’est tout autant.
On l’a rappelé, le Gouvernement n’a pas toujours été défavorable à ces propositions et s’en est remis à la représentation nationale pour faire droit aux souhaits de nos concitoyens. À différentes reprises, devant les deux assemblées parlementaires, le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, et le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale, André Vallini, en accord avec le Premier ministre, s’en sont remis à la sagesse des sénateurs puis des députés quant à la détermination de la majorité nécessaire et suffisante pour permettre à un département de choisir sa région de rattachement.

Nous allons de nouveau aborder ce débat dans notre hémicycle. Vous vous en doutez, les députés du groupe RRDP réitéreront leur demande si la présente proposition de loi ne connaît pas le succès escompté.
Pour toutes ces raisons et sans surprise, les députés du groupe RRDP voteront en faveur de la proposition de loi qu’ils présentent aujourd’hui. Au-delà, ils vous demandent d’entendre la voix de territoires entiers, départements souvent en marge du royaume, qui veulent être à la fois dans la nation française et dans la région qui correspond à leur histoire et à leur économie. C’est un droit de choisir que nous vous invitons à mettre en place, en espérant qu’il connaisse un sort meilleur que celui que nous prônions hier après-midi dans cet hémicycle.
Applaudissements sur les bancs du groupe RRDP.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, trois mois à peine après l’adoption définitive du controversé projet de loi relatif à la délimitation des régions, erreur manifeste que nous ne cesserons de dénoncer, nous voici donc saisis d’une proposition de loi relative au mécanisme du droit d’option, ou plutôt du droit de choisir, preuve que la loi du 16 janvier 2015 laisse certaines blessures dans de nombreux territoires.
Le dispositif du droit d’option avait été longuement débattu. Il s’agissait d’un des points les plus discutés il y a quelques semaines. Il s’est trouvé des députés sur tous les bancs pour réclamer qu’il soit assoupli, et non des moindres, puisque le président de la commission lui-même avait défendu l’instauration d’un droit d’option assoupli.

Il se dit même qu’un ancien premier ministre d’un département bien particulier était à la manoeuvre pour éviter que ce droit d’option soit un peu allégé, simplifié.
« Oh ! Non ! » et sourires sur les bancs du groupe RRDP et sur plusieurs bancs du groupe SRC.

N’est-ce pas… Mais cela laisse à penser qu’un déploiement d’énergie considérable en coulisses a finalement empêché que le peuple puisse tout simplement s’exprimer, le plus librement possible, dans un département. D’ailleurs, contrairement à ce que nous avons pu entendre lors de la réunion de la commission des lois la semaine dernière, certains candidats aux élections départementales défendent bien évidemment, dans leur programme de campagne, la réintégration de la Loire-Atlantique à la Bretagne. À l’invitation de l’association Bretagne réunie, des dizaines de binômes se sont engagés à demander l’organisation d’une consultation populaire par le département sur la question, ainsi que l’inscription à l’ordre du jour du conseil départemental de la demande de changement de région d’appartenance.

À l’impossible, nul n’est tenu, surtout au vu des verrous qui demeurent, dont le plus important est pour nous le droit de veto de la région de départ. Les futurs élus auront, à n’en pas douter, du pain sur la planche.

C’est ce qu’a bien compris la société civile qui, face au blocage institutionnel, a décidé de se prendre en main en organisant des votations citoyennes dans le département de la Loire-Atlantique et dans le reste de la Bretagne. Ainsi, à l’instigation de l’association Dibab – « Choisir », en breton – trois votations citoyennes ont déjà eu lieu, en attendant des dizaines d’autres, dans les communes de Saint-Viaud et Soudan, en Loire-Atlantique, et de Langouët, en Ille-et-Vilaine. Le taux de participation y fut de l’ordre de 20 %, ce qui est très élevé pour une consultation illégale, ou tout au moins non officielle. Certaines élections départementales, pourtant bien légales, ne voient parfois pas plus d’électeurs se déplacer !

On peut donc y voir l’expression d’un véritable sentiment populaire. Évidemment, les résultats de ces votations étaient de 75 % à 80 % pour la réintégration de la Loire-Atlantique à la Bretagne… Il y a donc un véritable décalage entre les verrous imposés par le droit d’option tel qu’il a été voté il y a trois mois et la volonté démocratique exprimée par les citoyens.
Ainsi, cette proposition de loi vise à supprimer la majorité des trois cinquièmes nécessaire à l’accord du département, de la région de départ et de la région d’arrivée, majorité qualifiée qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. C’est sur ce point que nos discussions s’étaient attardées, et il s’en est fallu de très peu pour qu’un certain nombre d’amendements la supprimant, notamment les miens, ne soient adoptés – à quatre voix près, pour certains !
Pour nous, le plus important était de faire sauter le droit de veto de la région de départ, qui rend totalement illusoire la mise en oeuvre de ce mécanisme.

Nous nous étions d’ailleurs interrogés sur la constitutionnalité de ce droit de veto. Dès lors, nous avons été fortement étonnés que l’UMP, au mépris de certains de ses membres qui se faisaient les hérauts de la défense du droit d’option, n’ait pas fait figurer dans sa saisine du Conseil constitutionnel les doutes sur la constitutionnalité de ce mécanisme qui s’apparente à une tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.
Contrairement aux communautés de communes, souvent citées en exemple, les départements ne se sont à aucun moment réunis pour créer une région. La région n’a jamais été un syndicat mixte de départements et de communes, ni a fortiori un établissement public de coopération interdépartementale.
Il n’y a strictement aucune raison de demander à une région d’émettre un avis sur le départ de l’un de ses membres, sauf à admettre le principe anticonstitutionnel que la région puisse exercer une tutelle sur une autre collectivité, en l’occurrence un département. Les départements n’ayant pas créé la région, la région ne peut empêcher une collectivité, autonome en vertu de la Constitution, de suivre sa propre voie, dans son ressort ou dans celui d’une autre région. Quelque louable que puisse être l’intention de notre rapporteur, dont je souligne la constance, lorsque l’on s’interroge sur le niveau de la majorité requise, simple ou des trois cinquièmes, on oublie l’essentiel : le sort des conseils généraux regarde soit le conseil général et ses habitants, soit le législateur, mais pas une région tierce.
Nous n’aurons donc pas de réponse précise à cette question, puisque l’UMP n’a pas saisi le Conseil constitutionnel et que ce dernier ne s’est pas auto-saisi sur ce point. Au passage, il s’en est fallu de très peu que l’ensemble de la loi de délimitation des régions ne soit jugée inconstitutionnelle : il aura fallu une contorsion du Conseil constitutionnel pour ne pas l’annuler, bien que j’eusse réellement contesté en séance l’interdiction de déposer en lecture définitive les amendements adoptés au Sénat. Mais le Conseil constitutionnel sait faire preuve de souplesse quand il le souhaite, les exemples de validation des comptes de campagnes d’anciens candidats à l’élection présidentielle sont là pour nous le rappeler.
En définitive, mes chers collègues, nous comprenons que le débat sur la question du droit d’option a déjà eu lieu, mais s’il revient aujourd’hui, c’est que rien n’a été réglé.

Loin du big-bang institutionnel auquel on veut nous faire croire, ce droit d’option ne concernerait qu’une demi-douzaine de départements.
Comme une motion de rejet préalable sera défendue tout à l’heure par le groupe SRC, je profite de cette discussion générale pour évoquer brièvement les amendements que nous aurions défendus.
Ainsi, nous aurions souhaité remplacer le droit de veto de la région de départ par une simple consultation pour avis de cette dernière, mais aussi mettre en place un mécanisme d’initiative populaire qui manque cruellement aujourd’hui.
Par ailleurs, un de nos amendements consistait à supprimer la date limite d’utilisation du mécanisme, fixée au 1er janvier 2019. La carte de nos collectivités ne saurait être figée une fois pour toutes. On peut d’ailleurs parier qu’en cas d’abrogation de cet article en 2019, une future majorité sera contrainte d’inventer un nouveau droit d’option, car il restera toujours des départements souhaitant un changement de région ou une fusion avec un département voisin. Vous pouvez d’ailleurs compter sur votre serviteur, s’il est encore là, pour déposer lui-même une proposition de loi sur ce thème !
Sourires.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues : nous sommes favorables à cette proposition de loi, même si son adoption ne réglerait pas le fond du problème puisqu’elle maintiendrait le droit de veto de la région de départ, en son temps dénoncé par le regretté Guy Carcassonne. Nous comprenons que nous ne pourrons y revenir aujourd’hui, mais nous continuerons, avec les associations et la majorité de la population derrière nous, d’essayer de faire sauter ces verrous institutionnels profondément jacobins.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RRDP.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes saisis d’une proposition de loi relative au droit d’option départemental. Après l’adoption de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, nous recommençons une nouvelle fois cette discussion. Si vous me passez l’expression, nous jouons les prolongations – on pourrait même dire que nous refaisons le match !
Exclamations sur les bancs des groupes SRC et RRDP.

Je savais bien que cela allait susciter des métaphores footballistiques !
Deux mois donc après le vote de la loi du 16 janvier 2015, après quatre lectures dans notre hémicycle et de très longs débats, il est paradoxal que notre assemblée se penche à nouveau sur cette question. Si je reconnais tout à fait que cette proposition de loi soit légitime, il n’en demeure pas moins que son adoption aurait pour inconvénient de jeter le trouble, de nous désavouer nous-mêmes, alors que la loi relative à la délimitation des régions a été adoptée par-delà les clivages.
Monsieur le rapporteur, votre approche est départementale. Uniquement départementale. Selon son intitulé, votre proposition de loi vise à « assouplir le mécanisme dit du "droit d’option départemental" ». À mon sens, il aurait été plus juste de parler du « droit d’option départemental dans la délimitation des régions ».
Vous avez dit que notre assemblée aurait pu adopter une autre méthode, notamment celle de Pierre Foncin, que vous citez, qui avait imaginé treize ensembles régionaux reposant sur les limites départementales à partir de critères purement géographiques et cohérents. À cet égard, vous estimez que la méthode retenue n’a pas pris en compte les identités locales. Oui, notre approche était quelque peu différente : nous avons voulu créer des régions de taille européenne, économiquement fortes, par un regroupement de régions existantes et un assemblage bloc par bloc.
Votre approche, qui consiste à opérer le regroupement à partir des départements, aurait pour inconvénient de déplacer le centre de gravité : les débats inutiles que vous dénoncez porteraient alors sur l’opportunité d’intégrer tout ou partie d’un département dans une nouvelle région. À titre d’exemple, vous parlez de la Vendée, un département que je connais particulièrement bien, qui aurait pu être rattaché à la Bretagne en même temps que la Loire-Atlantique chère à Paul Molac. Mais savez-vous que le Sud-Vendée est, historiquement, culturellement et géographiquement, davantage tourné vers le Poitou-Charentes ? En appliquant votre critère jusqu’au bout, il aurait fallu diviser la Vendée en deux : c’est inimaginable, impensable ! Que de débats inutiles sur la division vendéenne !

Aujourd’hui, deux mois après l’adoption de la loi relative à la délimitation des régions, vous voulez assouplir le droit d’option. Selon vous, l’assouplir, c’est faire passer les conditions de majorité des trois cinquièmes à 50 %. À cet égard, vous reconnaissez explicitement des décisions fondamentales du débat, telles les délibérations concordantes dans les trois assemblées – je reviendrai sur la notion de droit de veto ou de tutelle chère à Paul Molac – au nom du principe de libre administration et de consentement positif. Vous reconnaissez au demeurant que le rapporteur Carlos Da Silva avait fondamentalement raison lorsqu’il indiquait que l’avis des trois collectivités était nécessaire.
Vous souhaitez assouplir ce mécanisme parce que vous considérez que le droit d’option est quasiment impraticable. À cela, je réponds qu’il n’a quasiment jamais été pratiqué, en dépit des dispositions de la loi de décembre 2010.
La loi du 16 janvier 2015 a assoupli les conditions du droit d’option, Mme la ministre l’a rappelé, en supprimant les notions de référendum et de participation à 25 % – on a vu ce qui s’est passé en Alsace – qui constituaient effectivement un obstacle, je vous le concède. Elle a opté pour une majorité des trois cinquièmes, considérant qu’il fallait une majorité forte et claire. Nous n’avons pas peur du peuple ! Mais il faut une majorité forte et claire pour assurer une certaine stabilité et un large consensus local sur ces questions. Il faut également éviter les enjeux électoraux et d’opportunité. À cet égard, votre loi, madame la ministre, à quelques jours des élections départementales, s’inscrit dans ce débat.
Des délibérations concordantes sont nécessaires, principe que vous avez repris, et qui n’était pas partagé sur tous les bancs de cet hémicycle. Demander l’avis de la région de départ, ce n’est pas un droit de veto, mais le respect des engagements des politiques menées jusqu’alors, y compris les engagements financiers. Demander l’avis de la région de départ, ce n’est pas non plus une tutelle : dès lors que les départements ont travaillé ensemble dans une région, il semble logique qu’elle puisse émettre un avis sur le départ de l’un d’eux.
Le droit d’option actuel résulte d’un équilibre qu’il faut conserver. C’est précisément cet équilibre qui a permis l’adoption de la loi. Sa remise en cause serait une rupture qui relancerait toutes les supputations alors que nous devons passer à la mise en oeuvre et avancer.
Pour les raisons que j’ai évoquées, il convient donc de repousser cette proposition de loi. Nous avons fait preuve de sagesse et je vous invite, mes chers collègues, à poursuivre dans cette voie.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il peut paraître insolite qu’une élue de la métropole de Lyon, métropole qui a absorbé le département, prenne la parole sur cette proposition de loi. Mais n’est-ce pas affirmer que nous sommes d’abord députés de la nation ?

De quoi s’agit-il ici ? De revenir sur l’article 3 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions. En l’état actuel du droit, cette disposition permet une évolution volontaire de la carte régionale, entre janvier 2016 et mars 2019, dès lors qu’il existera un consensus local. Un département pourra donc changer de région durant cette période limitée. Voilà pour le principe.
Quant aux conditions pratiques, elles ont déjà rappelées par le rapporteur : le dispositif prévoit l’obligation que ce projet obtienne l’adhésion à une majorité des trois cinquièmes des suffrages du conseil du département concerné, ainsi que des conseils des deux régions concernées, celle de départ comme celle d’arrivée. En revanche, les collectivités n’auront plus l’obligation de soumettre cette modification à référendum, condition actuellement prévue par le code général des collectivités territoriales.
La proposition dont nous débattons ce matin propose de revenir sur les conditions requises de majorité : au lieu des trois cinquièmes, on exigerait des trois assemblées délibérantes concernées qu’elles valident le projet à la majorité simple.
Certes, ce n’est pas de très bonne pratique que de revenir sur une disposition législative extrêmement récente, votée en janvier de cette année. Mais ce ne serait pas la première fois : il n’y a qu’à voir le revirement de la majorité sur la clause générale de compétences des collectivités !

Et puis, à vrai dire, l’adoption de ces règles simplifiées de majorité, qui correspondent d’ailleurs à des amendements déposés par plusieurs députés UMP au cours des débats sur la délimitation des régions, serait simplement de bon sens.
Car tout est parti de la méthode de découpage des régions que nous a imposée le Gouvernement. Vous vous en souvenez, il a fallu établir une nouvelle carte à partir des régions existantes. Le Gouvernement n’a jamais cédé aux propositions des uns et des autres, toutes tendances politiques confondues. Nous avons dû fusionner certaines régions entre elles, pas plus, pas moins.
Évidemment, dans certains territoires, comme la Bretagne ou la Picardie, ce postulat de départ n’a pas convaincu. Alors, pour faire passer la pilule, le Gouvernement a agité le droit d’option, transitoire, du département, pour changer de région. Mais en assortissant ce mécanisme d’un accord à la majorité des trois cinquièmes des assemblées délibérantes, dont l’accord de la région de départ, la majorité s’est bien gardée que ce prétendu droit d’option soit rendu possible dans les faits !
En réalité, quoi qu’on pense du principe du droit d’option d’un département à changer de région, ce qu’il faut reconnaître, c’est que la loi telle que voulue par la majorité, et plus particulièrement le groupe SRC de l’Assemblée nationale, est hypocrite. Soit l’on est pour le droit d’option, et alors la majorité simple des trois assemblées délibérantes s’impose, ne serait-ce que de manière transitoire. Soit l’on est contre le principe, et alors il ne fallait pas voter l’article 3 de la loi relative à la délimitation des régions.
D’ailleurs, n’en déplaise au groupe socialiste qui a fait rejeter la proposition de loi en commission, le rapporteur a utilement fait remarquer, dans son rapport, que durant les débats en janvier 2015, le Gouvernement ne s’était pas montré hostile à cet assouplissement. Il s’en était remis à plusieurs reprises à la sagesse de l’Assemblée au cours de la deuxième lecture, bien qu’en dernière lecture il se soit finalement ravisé.
Je ne résiste pas à l’envie de citer Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, déclarant le 30 octobre 2014, au Sénat, « l’amendement no 122 vise à revenir à des conditions de délibération à la majorité simple lorsqu’il s’agit de se prononcer sur des regroupements dans le cadre de l’exercice du droit d’option. Le Gouvernement qui comprend cette volonté d’assouplissement, s’est exprimé par la voix du Premier ministre. Il a annoncé qu’il y avait sur ce sujet une possibilité d’ouverture. Je m’en remets donc, au nom du Gouvernement, à la sagesse du Sénat. »
Je crois ne pas avoir besoin d’en dire beaucoup plus. Cette proposition de loi telle qu’elle nous est présentée par le groupe radical n’est qu’une mise en cohérence de la majorité avec elle-même. C’est la raison pour laquelle le groupe UMP soutiendra cette initiative, tout en s’opposant, en revanche, aux amendements qui viseraient à assouplir davantage le droit d’option.
La règle de la majorité simple des assemblées concernées est un bon équilibre auquel il conviendrait de se tenir. C’est la raison pour laquelle le groupe UMP s’opposera aussi bien évidemment à l’adoption de la motion de rejet préalable.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi intervient deux mois après l’entrée en vigueur de la loi relative à la délimitation des régions et quelques jours après l’adoption en première lecture de la loi NOTRe.
De ces deux réformes, nous pouvions attendre beaucoup : un rapprochement entre régions et départements, une mutualisation accrue entre intercommunalités et communes, une redéfinition du rôle de l’État, une redistribution des moyens financiers alloués aux collectivités.
Force est de constater qu’il n’en est rien. Les réformes récemment entreprises n’ont fait qu’éloigner un peu plus notre pays de la décentralisation assumée et affirmée que nous appelons de nos voeux.
La pertinence des territoires doit reposer sur les pratiques des habitants, le fonctionnement des entreprises et des acteurs économiques, sur les projets qui façonneront l’avenir. La carte des régions aurait dû être élaborée en vue d’atteindre un maximum de complémentarité, de cohérence et d’efficacité économique au sein des futures régions.
Or la délimitation des régions a été imposée alors que nous ignorions la nouvelle répartition des compétences, sans tenir compte de ces critères et sans prendre en considération les spécificités de nos territoires. À des réponses diversifiées adaptées à chacun des territoires, le Gouvernement a, hélas, préféré l’uniformité.
Dans un tel contexte, apporter de la souplesse, donner une voix aux acteurs concernés, leur permettre de réviser la carte en vue d’entreprendre un redécoupage plus adapté aux réalités du terrain semble indispensable.
La carte de France n’a certes pas vocation à changer tous les matins, ni à chaque mandat. Mais il est vrai qu’au fil des années, des évolutions peuvent conduire à s’interroger sur une reconfiguration éventuelle. Une modification des limites territoriales peut s’avérer nécessaire pour mieux s’adapter aux réalités géographiques et à l’Europe des régions.
Si la carte doit pouvoir être révisée, dans quelles conditions et selon quelles modalités, madame la ministre ? Ces questions ont largement occupé nos débats sur la loi relative à la délimitation des régions.
Ainsi, la loi désormais en vigueur a introduit la possibilité, pendant une période limitée, entre 2016 et 2019, d’une évolution volontaire du rattachement de départements à une autre région contiguë. Cette évolution sera subordonnée à la condition de réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, sans condition référendaire.
Nos collègues du groupe RRDP proposent de substituer à la majorité des trois cinquièmes pour chacune des trois assemblées délibérantes, soit 60 % des voix, la majorité absolue, soit 50 % des suffrages exprimés.
Malgré des positions divergentes, entre un dispositif trop verrouillé dont la mise en oeuvre serait impossible et un assouplissement trop important qui nuirait à la stabilité des régions à l’avenir, il nous semble qu’un point d’équilibre a su être trouvé par l’ensemble des groupes de cet hémicycle. Ce point d’équilibre doit être préservé.
En effet, nous ne pouvons occulter le fait que le départ d’un département puisse déstabiliser sa région d’origine. Ce départ n’est pas une délibération ordinaire et sans conséquence, vous l’avez dit, madame la ministre. C’est la raison pour laquelle la majorité qualifiée, qui est tout de même une majorité légère, chers collègues RRDP, nous semble la plus adéquate en matière de droit d’option.
C’est d’ailleurs le principe de base qui s’applique aux intercommunalités : lorsqu’une collectivité quitte une intercommunalité pour une autre, l’accord des deux collectivités est requis. Cette évolution nécessite une décision des deux tiers des communes représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant au moins les deux tiers de la population.

Nous ne disons pas qu’il faut exiger les mêmes conditions s’agissant des régions et des départements, mais requérir une majorité absolue comme le préconise le texte de nos collègues RRDP aboutirait à un paradoxe : les départements pourraient changer de région selon des règles de majorité moindres que lorsqu’une commune veut quitter une intercommunalité.
Certes, les auteurs du texte n’ont pas retenu l’une des propositions faites lors de l’examen du projet de loi relatif à la délimitation des régions, à savoir permettre à la région de départ de s’opposer au projet de rattachement à la majorité des trois cinquièmes, ce qui aurait ainsi constitué un simple droit de veto. Il est nécessaire selon nous de conserver l’obligation d’un vote positif des trois assemblées délibérantes.
En revanche, la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés plutôt qu’une majorité absolue est une condition équilibrée. Nous ne pouvons pas dénier à la région d’origine le droit de se sentir concernée par le départ d’un département qui pourrait l’appauvrir ou la déstabiliser, ne serait-ce qu’au nom du principe essentiel de la solidarité entre les territoires.
Si le départ de départements pourrait ne pas avoir d’effets déstabilisateurs sur certaines régions, ce n’est pas le cas pour toutes. Nous devons donc envisager toutes les éventualités.
La stabilité, tant des intercommunalités que des régions, est la garantie de politiques publiques inscrites dans la durée. Dans le cas d’investissements lourds comme les investissements d’équipements souvent réalisés par la région, l’on n’emprunte généralement pas à cinq ou six ans, mais à quinze ou vingt ans. On ne peut donc pas considérer que la collectivité de départ n’est pas concernée au même titre que la collectivité éventuelle d’arrivée.
Nous ne pouvons pas courir le risque qu’il y ait à chaque échéance électorale un débat sur les délimitations des régions : cela reviendrait à instaurer une déstabilisation quasiment programmée à chacune de ces échéances politiques.
La majorité qualifiée vise à assurer un minimum de stabilité et de visibilité aux politiques d’investissement, qui sont par définition des politiques de long terme. Si l’on veut concilier la possibilité d’ajustement et une certaine stabilité, une décision d’une telle importance doit être prise à la majorité des trois cinquièmes. En effet, au lendemain de la modification du périmètre des régions, ces dernières ont avant tout besoin de stabilité. N’ajoutons pas à la confusion et aux bouleversements que vont subir les collectivités une instabilité qui n’améliorerait en rien la situation de nos territoires.
Dans le contexte actuel, l’urgence est aujourd’hui de constituer des régions telles qu’elles ont été choisies par la représentation nationale – des régions fortes, capables de conduire des politiques d’investissement préparant nos territoires aux enjeux stratégiques de demain.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UDI votera majoritairement contre cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral s’est vu consacrer seize séances publiques de travail parlementaire dans l’hémicycle, sans compter les heures en commission des lois et au sein des commissions saisies pour avis, notamment la commission du développement durable, ni celles, très nombreuses, passées par le rapporteur, M. Carlos Da Silva, à auditionner chacune des parties prenantes de la réforme – je pense notamment à l’Assemblée des départements de France, qui jamais n’a revendiqué un droit d’option dans les proportions proposées aujourd’hui par M. Krabal.
Or, quelques semaines à peine après l’adoption de cette loi, on nous demande de remettre l’ouvrage sur le métier. Le texte qui nous est proposé aujourd’hui nous propose en effet de revenir sur ces semaines de travail parlementaire et de discussions très approfondies sur le sujet, en remplaçant, pour la modification des limites régionales par le rattachement d’un département à une autre région, ce que nous appelons le « droit d’option », la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés par la majorité absolue.
Auparavant, une partie des discussions parlementaires sur la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles avait déjà été consacrée à la suppression de l’obligation de consultation référendaire. Bref, voilà déjà de longs mois que nous discutons de la même chose.
Ces débats, nous les avons menés longuement, sérieusement et en profondeur et nous avons pu balayer l’ensemble des situations qui se présentaient à nous dans ce domaine. La représentation nationale a tranché entre un vote à la majorité qualifiée ou à la majorité absolue dans le cas où un département voudrait quitter une région pour en intégrer une autre.
Le droit d’option existe. Je rappelle cette banalité car, à force d’entendre ou de lire certains, on pourrait penser qu’il n’aurait pas été consacré par la loi que nous venons à peine de voter ! Ce droit repose, comme l’ont rappelé de nombreux orateurs, sur un mécanisme équilibré et il a été considérablement assoupli pour être rendu pleinement effectif.
L’article 3 de la loi délimitant les régions, qui fait l’objet du texte que nous examinons aujourd’hui, aménage en effet ce droit d’option en assouplissant les conditions dans lesquelles les délimitations régionales pourraient évoluer, afin qu’un département puisse changer volontairement de région de rattachement. Il sera dorénavant nécessaire que ce projet obtienne l’adhésion du conseil départemental à une majorité des trois cinquièmes des suffrages, ainsi que des deux conseils régionaux concernés, afin de garantir que cette modification des limites régionales repose sur un large consensus.
C’est cette nécessité de trouver en la matière de larges consensus qui a guidé la décision du groupe SRC. Il ne serait pas admissible que la région de départ ne soit pas consultée, ne serait-ce qu’en raison des conséquences majeures que cette décision entraînerait pour elle, des exigences constitutionnelles et du principe de libre administration des collectivités territoriales. Le rapporteur de la loi, M. Carlos Da Silva, a eu largement l’occasion de le rappeler.
Sans aborder précisément les exemples qui ont été cités, je dois dire que j’ai toujours été sceptique quant au départ de certains départements. Je ne parlerai pas du département de l’Aisne, que je connais moins, mais je tiens à vous dire, monsieur Molac – et je ne m’exprime pas ici au nom du groupe SRC – que quand on est de gauche, on peut se demander ce que cela signifie que de vouloir faire la Bretagne à cinq, comme cela a souvent été proposé, et donc de faire sortir Nantes de l’actuelle région des Pays de la Loire. Que laisserait-on à cette région ? Quelle conception de la solidarité territoriale serait-ce là ? En constituant une région certes historique – je reconnais votre constance en la matière et je respecte les Bretons qui veulent constituer cette Bretagne à cinq – on créerait une région dotée de deux métropoles, Rennes et Nantes, et on amputerait l’actuelle région des Pays de la Loire de sa capitale et donc du levier de croissance essentiel qui permet ensuite la redistribution des richesses. En tant qu’homme de gauche, cela me pose question. Mais laissons là les exemples, car nous parlons ici de questions de principes.
Durant tout le débat, le rapporteur Carlos Da Silva a été clair sur ce sujet : le droit d’option pour les départements devait être simplifié. Il l’a été, sans toutefois être ouvert sans bornes. Si cette approbation doit se faire à la majorité des trois cinquièmes, ce n’est pas pour instaurer un verrou ou un droit de veto, mais pour éviter qu’une formation politique puisse à elle seule prendre une décision d’une telle ampleur, lourde de tant de conséquences pour les habitants, pour les institutions et pour les agents territoriaux, au moment même où, comme chacun peut le constater, tout l’édifice est en train d’évoluer assez profondément, qu’il s’agisse des édifices intercommunaux ou des édifices régionaux en formation.
Le travail parlementaire a pour but de trouver un point d’équilibre. Or, nous l’avons trouvé et le groupe SRC souhaite précisément que cet équilibre soit préservé.
Pour le dire simplement, une majorité des trois cinquièmes, c’est 60 % des suffrages. Or, on peut espérer que, dans la plupart des cas, malgré les modifications de la vie politique française, la majorité régionale bénéficiera de la prime de 25 % des sièges qui, comme c’est le plus souvent le cas aujourd’hui, lui donne plus de 60 % des sièges. En définitive, obtenir une majorité des trois cinquièmes dans la région concernée équivaut à obtenir une majorité simple dans une autre collectivité, où une telle prime ne s’applique pas.

Je vous le concède. Mais pour ce qui concerne en tout cas l’entité régionale, la majorité qualifiée n’est pas de 75 % des sièges : trois cinquièmes, cela fait 60 % ! Considérant donc que la liste majoritaire dispose généralement de plus de 60 % des sièges, la mesure proposée ne constitue pas le verrou que certains évoquent.
En tout état de cause, rien n’empêchera non plus les collectivités territoriales concernées de choisir volontairement de procéder à un référendum local décisionnel, et non pas consultatif, sur le fondement des dispositions de la Constitution telles qu’elles ont été révisées en 2003 et de la loi organique d’août 2004. Or, dans ce cas, ce sont bien des règles de majorité simple qui s’imposeront. En outre, la valeur juridique de ces référendums décisionnels emporte les mêmes conséquences que celles qu’aurait eue une délibération par la collectivité concernée.
Au bout du compte, en matière de droit d’option départemental, les choses sont donc très simples : il faudra convaincre une majorité de citoyens ou 60 % des élus des territoires concernés. Il serait pour le moins paradoxal que ceux qui nous disent que, de toute évidence, tel département devrait se situer dans une région plutôt que dans une autre peinent à convaincre 60 % des élus du territoire de la pertinence de cette option, alors même qu’ils affirment s’appuyer sur de larges majorités populaires ! Si l’application de ce droit d’option est si évidente dans l’Aisne ou en Loire-Atlantique, comment les élus concernés peineraient-ils à convaincre une majorité de citoyens, sur lesquels ils prétendent s’appuyer, ou 60 % des élus du territoire ?
Le droit d’option, c’est simple. Pour tout dire, en la matière, l’obstacle ne sera jamais juridique, mais tout sera affaire de conviction politique.

Je souhaite réagir brièvement à ce que je viens d’entendre. Pour ce qui est tout d’abord du calendrier, je précise que la niche du groupe RRDP ne se présente qu’une fois par an. Nous n’avons pas choisi qu’elle se situe la veille des élections départementales ! Le calendrier est ce qu’il est.
Quant au fait que nous ayons voté un dispositif voilà trois mois, je rappellerai après d’autres, sans vouloir refaire le match ou les débats, que la question du droit d’option a donné lieu à divers positionnements. Au-delà de ce que vient de dire M. Denaja, nous pensons qu’il y a possibilité de modification sans révolution.
Nous voulons, bien sûr, maintenir la stabilité : nous sommes responsables et vous n’avez senti ni dans l’intervention de M. Giraud ni dans la mienne l’ombre d’une volonté de déstabilisation. Il s’agit simplement de renforcer la décision des élus locaux et de prendre en compte l’avis de nos habitants, ce qui n’a été fait ni dans un cas, ni dans l’autre.
Loin de nous la volonté de dépecer les départements : nous ne voulons pas faire aux autres ce qu’on nous fait à nous-mêmes ! À cet égard, je me félicite de constater, au vu des débats en commission, l’évolution du groupe de l’UMP. Toutefois, la proposition ne fait certes pas l’objet d’un grand consensus et l’on voit bien que la position du groupe SRC n’évolue pas trop sur ce sujet, malgré, encore une fois, ce qui s’est exprimé par la voix des ministres ou de certains députés très représentatifs sur ces questions.
Nous avons là une occasion historique de faire progresser les choses. Si ce n’est pas le cas ce matin, nous y reviendrons. J’insiste, car ce n’est pas un problème personnel, ni le problème d’un département, mais un problème de démocratie. Je vous appelle donc à aller jusqu’à l’examen des amendements déposés sur ce texte.

J’ai reçu de M. Bruno Le Roux et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen une motion de rejet préalable déposée en application de l’article 91, alinéa 10, du règlement.
La parole est à M. Carlos Da Silva.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, voilà moins de deux mois, on l’a dit, que la loi relative à la nouvelle délimitation des régions, qui établit la nouvelle carte de notre pays pour les prochaines décennies, a été promulguée – c’était le 16 janvier dernier. Il y a donc moins de trois mois qu’elle a été adoptée par la majorité de notre assemblée, après des dizaines d’heures, peut-être plus, de débats parfois houleux, tardifs souvent, mais toujours passionnants.
Il faut d’ailleurs croire que nous avons passé de bons moments ensemble,…

…entre juillet et décembre 2014, pour que M. Jacques Krabal ait l’heureuse idée de nous réunir à nouveau aujourd’hui dans cet hémicycle…

…sur ce sujet passionnant qui, je le crois comme lui, engage notre pays pour longtemps.
Au-delà de ce clin d’oeil amical, mes chers collègues, je dois vous faire part de mon étonnement et de celui d’un certain nombre de parlementaires devant cette proposition de loi du groupe RRDP visant à assouplir le mécanisme du droit d’option départemental – étonnement relatif, toutefois, car je reconnais la constance et la détermination de M. Krabal sur ce sujet.
Nous avons eu l’occasion d’échanger à de nombreuses reprises dans le cadre de l’examen de la loi de délimitation des régions, en particulier au sujet de la vôtre, monsieur Krabal, la Picardie, et du département de l’Aisne, même si, comme vous l’avez rappelé à juste raison, cette proposition de loi ne concerne pas votre seul département ni votre seule région actuelle.
Si nous n’avons pu trouver d’accord sur l’intégralité des mesures adoptées dans ce texte, je salue toutefois la constance de votre engagement.
Mais revenons un instant sur la méthode qui a guidé nos travaux tout au long de ces débats. Votre exposé des motifs le rappelle d’ailleurs très clairement, monsieur Krabal : le Président de la République et le Gouvernement ont posé une méthode pour opérer ce nouveau dessin régional : une méthode simple, précise, rigoureuse, à savoir la prise en compte des périmètres des régions telles qu’elles existent actuellement.
Sans cela, et je l’ai dit à maintes reprises, aucune réforme n’aurait été possible : impossible car jamais nous ne serions parvenus à un accord majoritaire dans notre hémicycle ; impossible car la mettre en oeuvre aurait littéralement mis à bas quarante années ou presque de politique publique régionale cohérente. Aucune carte aussi équilibrée, aussi cohérente n’aurait été adoptée par un tel nombre de parlementaires.
Une très forte majorité de Françaises et de Français se sont d’ailleurs montrés favorables aux mesures engagées, à savoir la simplification et la clarification de l’architecture territoriale de la République. Trop longtemps, des rapports fort intéressants mais aussi l’immobilisme et le conservatisme de certains ont fermé la porte à toute véritable modernisation des institutions et des territoires, alors même que les Français y étaient prêts.
Nous pouvons être fiers du travail que nous avons réalisé et que nous mettrons en oeuvre dans le cadre la loi que nous évoquons ce matin, débattue au second semestre de l’année écoulée, mais aussi des lois portées par Mme la ministre Lebranchu, qui viennent compléter cette nouvelle architecture territoriale, cette nouvelle organisation et cette nouvelle répartition des compétences.
S’agissant de la possibilité offerte à un département de rejoindre une autre région, je pense que chacun sur ces bancs a encore en mémoire nos échanges. Pour reprendre les mots de François de Rugy, coprésident du groupe Europe Écologie-Les Verts, « Sur le fond, il s’agit toujours de savoir s’il y a une volonté commune des territoires, de leurs habitants et de leurs élus de travailler ensemble ».
Aussi, dès la mise en place de la nouvelle carte, ces conditions garantiront la possibilité pour une collectivité de décider de son avenir, tout en assurant une certaine stabilité à nos collectivités – indispensable, alors que s’opère la plus grande réforme territoriale de notre pays depuis les lois de décentralisation de 1982.
Il m’est apparu très rapidement au cours du travail que j’ai réalisé en tant que rapporteur de la commission des lois que ce sujet serait particulièrement sensible. J’ai donc essayé, modestement, de réfléchir à ce qui pourrait constituer un point d’équilibre en mesure de fédérer la majorité de notre hémicycle.
Je suis parti de l’audition des conseillers régionaux. Je rappelle que j’ai reçu et écouté au moins les quatre principaux groupes politiques de chaque assemblée régionale aujourd’hui existante. À chaque fois que j’ai parlé de ce que l’on appelle improprement d’ailleurs depuis le début de ce débat le droit d’option, je vous prie de croire qu’aucun conseiller régional d’aucune formation politique n’a souhaité qu’une telle liberté ne soit donnée aux départements composant sa région. Jamais, pas une seule fois, pas une seule sensibilité politique !
Mais, s’ils considéraient donc chaque fois, avec des arguments divers, que leur région devait rester telle qu’elle était, en revanche, un grand nombre d’entre eux trouvait tout à fait cohérent que tel ou tel département limitrophe la rejoigne, exemples à l’appui ! Cela crée une légère difficulté, vous en conviendrez… Je ne sais pas si elle est juridique, mais sur le plan des principes, dès lors que l’on refuse que les départements de sa propre région aient la liberté que l’on demande pour les autres, il devient particulièrement complexe de trouver un point d’équilibre ! Cet équilibre devait être trouvé entre eux, les conseillers régionaux actuels, et nous, qui sommes en constante relation avec eux et qui, pour certains d’entre nous, exerçons ce mandat.
J’ai aussi regardé de très près l’état du droit avant que ce projet de loi ne vienne en débat au Sénat puis au sein de notre hémicycle. Jusqu’ici, un sextuple accord était nécessaire : il fallait l’accord des deux conseils régionaux et du conseil départemental concernés, et il fallait que les citoyens soient consultés par référendum avec, à chacun des trois niveaux, un vote positif à plus de 50 %, représentant à chaque fois plus de 25 % des inscrits. J’en ai conclu la même chose : cela me paraissait impossible.
J’ai regardé ensuite comment cela se passait pour d’autres types de collectivités – afin de nous en inspirer sans pour autant rechercher une identité, mon cher collègue Molac – à savoir tout ce qui concerne l’intercommunalité.
Laissons d’abord de côté les métropoles et les communautés urbaines, car les communes et les villes qui en font partie n’ont aucune possibilité de les quitter : le verrou est donc, vous en conviendrez, assez définitif ! Pour une communauté d’agglomération ou une communauté de communes donc, il faut d’abord l’accord du conseil municipal concerné, mais également l’accord de la majorité qualifiée des deux communautés de communes ou d’agglomération, représentant à chaque fois deux tiers des communes et la moitié de la population ou la moitié des communes et les deux tiers de la population. C’est donc également particulièrement verrouillé.
En outre, je ne peux vous laisser dire, monsieur Molac, que toutes les communautés de communes et toutes les communautés d’agglomération se sont constituées sur une base strictement volontaire : la preuve en est ce qui est à l’oeuvre aujourd’hui en région Île-de-France dans les départements de grande couronne.
Alors que nous étudiions l’ensemble du texte, le point d’équilibre qui m’est apparu le plus juste consistait à proposer que nous supprimions la nécessité de recourir au référendum, qui semblait être une contrainte supplémentaire.
Je me permets de rappeler à nos collègues alsaciens, dont je regrette l’absence car ils ont beaucoup participé aux débats – n’est-ce pas, cher président de la commission des lois ? –…

…le référendum du 7 avril 2013, dont l’objectif était de créer une nouvelle collectivité territoriale unique par fusion de la région Alsace et des conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Pour l’emporter, le « oui » devait donc recueillir plus de 50 % des suffrages exprimés et au moins 25 % des voix des électeurs inscrits dans chacun des départements.
Or, ni la condition de double majorité, ni celle du quart des inscrits n’ont été remplies. Dans le Bas-Rhin, 67,5 % des suffrages exprimés étaient favorables à cette collectivité, mais ils ne représentaient que 22 % des inscrits. Dans le Haut-Rhin, les électeurs qui se sont prononcés à 44,02 % en faveur de cette collectivité ne représentaient quant à eux que 16 % des inscrits environ. Conséquence : cette consultation fut un échec. Cet échec, avec les nouvelles dispositions de la loi adoptée le 16 janvier 2015, ne sera évidemment plus possible.
Nous avons souhaité renoncer temporairement à la faculté du référendum, qui s’est alors révélée être un frein, en considérant qu’il fallait respecter les élus locaux et en tenant compte du fait que le législateur ne disposait pas en la matière de toute la connaissance nécessaire. Ainsi le recours au référendum sera-t-il suspendu pendant trois années une fois que les prochaines élections régionales auront eu lieu. Pourquoi à l’issue de ces élections ? Parce que cette mesure pourrait ainsi s’inscrire dans le cadre du débat politique préalable aux élections.
Lorsqu’un département souhaite changer de région de rattachement, l’accord de son conseil départemental ainsi que des deux conseils régionaux concernés sera requis. Pourquoi cette approbation devra-t-elle se faire à la majorité des trois cinquièmes ? Il ne s’agit ni d’apposer un verrou, ni d’opposer un veto, mais d’éviter qu’une seule formation politique ne puisse prendre la décision à elle seule, notamment dans les départements où les choses ont peu évolué malgré l’introduction du scrutin binominal avec une forme de prime majoritaire, à l’image de ce qui existe dans les conseils régionaux. Il s’agit que chacun puisse donner son avis.
En outre, cela n’aura échappé à personne, nous sommes en campagne électorale. Or, à deux semaines du premier tour, il ne me semble pas que la question du rapprochement d’un département et d’une région soit au centre des propositions de nombreux candidats. Il me semble même que cette question est, sauf peut-être l’exemple cité par Paul Molac, totalement absente des programmes des candidats, souvent très intéressants d’ailleurs, aux élections départementales. Nous verrons, monsieur Molac, combien ces candidats qui prônent le départ de la Loire-Atlantique des Pays de la Loire vers la région Bretagne actuelle récolteront de suffrages de nos concitoyens et concitoyennes de ce magnifique département.

J’ajoute que ce ne sont pas seulement des territoires qui souhaitent changer de région de rattachement, ce ne sont pas uniquement nos concitoyens qui, représentés par leurs élus départementaux et régionaux, font ce choix : ce sont aussi des collectivités constituées, qui ont travaillé pendant plus de trente années après que l’État a lui-même travaillé dans ces circonscriptions d’action régionale. Il m’est donc apparu que, bien qu’imparfait, bien que ne satisfaisant pas la totalité de notre hémicycle, le point d’équilibre auquel nous étions parvenus permettait d’avancer intelligemment.

Fallait-il permettre à un département de rejoindre une autre région que sa région d’origine ? La majorité d’entre nous a estimé que oui.
Sourires.

Fallait-il pour cela que les assemblées des collectivités concernées se prononcent par délibérations concordantes en faveur de ce mouvement ou, au contraire, qu’elles soient invitées à s’y opposer ? Nous avons estimé qu’il était préférable et plus logique de choisir la première option.
Le débat a eu lieu, les arguments des uns et des autres ont été entendus, les parlementaires ont tranché : nous devons constamment légiférer avec le souci de l’intérêt général, et il me semble, mes chers collègues, que le choix de cette majorité qualifiée est la garantie du respect de l’intérêt général. C’est la raison pour laquelle je demande le rejet préalable de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Dans les explications de vote sur la motion, la parole est à Mme Claudine Schmid, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Nous tenons à cette proposition de loi du groupe RRDP car il y est question de la démocratie, à laquelle nous sommes attachés, d’autant que le droit d’option n’est pas encore effectif. Les propos tenus par Mme Nachury en discussion générale valent défense du rejet de cette motion de rejet préalable.

Sur la motion de rejet préalable, je suis saisie par le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Arnaud Richard, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.
Sourires.

Merci ! J’aurai donc convaincu une partie du groupe socialiste !
Je constate tout d’abord que l’unité de la majorité n’a pas duré longtemps : le temps d’un apéritif ! Elle est déjà mise à mal ce matin, avant même le déjeuner. Voyez comme cela va vite !
Cette motion de rejet ne m’a pas convaincu, cher collègue Da Silva. Nous voterons contre cette proposition de loi mais, par respect pour l’expression démocratique, il me semble que cette motion de rejet n’est pas de bon aloi. Nous voterons donc contre, afin que le vote démocratique puisse s’exprimer ensuite.
Applaudissements sur les bancs du groupe RRDP.

Sans suspense, nous voterons contre cette motion de rejet, pour un certain nombre de raisons. Si vous avez eu raison de souligner qu’il y avait eu un petit assouplissement concernant le droit d’option, il reste néanmoins très insuffisant pour nous.
D’autre part, j’ai bien entendu les propos de M. Denaja sur le référendum : c’est une idée intéressante, sauf que quand l’ancien président du conseil général de la Loire-Atlantique, Patrick Mareschal, a demandé un tel référendum, le préfet ne l’a pas autorisé à l’organiser, au motif qu’un département ne pouvait pas décider des limites des régions.
J’aurais pour ma part aimé que ce référendum ait lieu.
Quant à la « métropolisation », accélérateur ou aspirateur, nous en reparlerons, mais je suis assez réticent face à tout ce qui est métropolisation.
Applaudissements sur les bancs des groupes écologiste et RRDP.

La parole est à M. Stéphane Saint-André, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

L’assouplissement du droit d’option départemental est un combat de longue date de notre collègue et ami Jacques Krabal, et ce combat est partagé par plusieurs de nos collègues sur tous les bancs de cet hémicycle. Il nous paraît en effet impensable de ne pas prendre en compte les volontés exprimées par les habitants d’un département et relayées par les élus locaux.
Nous l’avons déjà dit : nous ne souscrivons pas aux arguments selon lesquels la stabilité administrative et territoriale de nos collectivités risquerait d’être remise en cause par notre proposition de loi, et selon lesquels il faudrait laisser la loi du 16 janvier 2015 produire ses effets avant de légiférer de nouveau dans le même domaine. Il nous semble en effet essentiel de rectifier rapidement le mécanisme du droit d’option : ce que le législateur a fait, le législateur peut le défaire.
Je tiens à souligner que l’engagement du rapporteur n’est pas seulement celui d’un élu souhaitant faire droit à des spécificités locales et à la défense d’un territoire particulier : beaucoup de départements sont concernés. Ce à quoi notre rapporteur aspire, c’est surtout à assurer la victoire de la démocratie.
Vous l’aurez donc compris, le groupe RRDP votera contre cette motion de rejet préalable.

La parole est à M. Sébastien Denaja, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.

Pour être tout à fait clair, y compris pour ceux de nos collègues du groupe SRC qui font preuve d’un enthousiasme soudain pour cette question du droit d’option, je tiens à dire que le groupe SRC votera pour l’adoption de cette motion de rejet présentée par son président Bruno Le Roux !
Sourires.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants: 46 Nombre de suffrages exprimés: 46 Majorité absolue: 24 Pour l’adoption: 26 contre: 20 (La motion de rejet préalable est adoptée.)

L’Assemblée ayant adopté la motion de rejet préalable, la proposition de loi est rejetée. Il n’y aura pas lieu de procéder au vote solennel décidé par la conférence des présidents.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Proposition de loi relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation.
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures quarante-cinq.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly