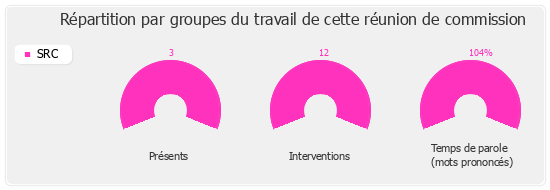Délégation de l'assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Réunion du 9 février 2016 à 17h00
La réunion
La séance est ouverte à 17 heures.
Présidence de Mme Catherine Coutelle, présidente.
La Délégation procède à l'audition de Mme Béatrice Bossard, magistrate, sous-directrice de la justice pénale générale, de Mme Ombeline Mahuzier, cheffe du pôle de l'évaluation des politiques pénales, et de M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale, de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, sur les violences faites aux femmes.

Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Mme Béatrice Bossard, sous-directrice de la justice pénale générale, accompagnée par Mme Ombeline Mahuzier, cheffe du pôle de l'évaluation des politiques pénales, et de M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale, de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.
Mesdames, monsieur, comme vous le savez, le récent procès de Jacqueline Sauvage a suscité un certain émoi dans notre pays. La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a longuement travaillé sur le sujet des violences faites aux femmes et pris part aux débats sur la première loi consacrée à cette question, loi qui a été adoptée en 2010 puis renforcée en 2014. Aujourd'hui, il s'agit, pour nous, non pas de préparer un nouveau texte, mais de nous interroger notamment sur les raisons pour lesquelles Jacqueline Sauvage n'a pas bénéficié d'un jugement plus clément. Certes, la légitime défense, telle qu'elle est définie dans le code pénal, doit répondre à des critères cumulatifs, critères qui n'étaient pas tous réunis dans le cas que j'évoque, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la stratégie de défense consistant à plaider l'acquittement. Quoi qu'il en soit, on a le sentiment qu'aucune main secourable ne lui a été tendue alors que différentes alertes avaient été lancées : tentative de suicide, signalements, fugue de ses filles, plainte de la voisine à l'encontre de son mari pour menaces de mort, classée sans suite par les gendarmes…
Peut-on modifier le code pénal pour prendre en compte de telles situations qui perdurent pendant des années et aboutissent à un acte dramatique, puisqu'il consiste d'une certaine manière à se faire justice soi-même en tuant un conjoint violent ? Il ne s'agit pas du tout pour nous, contrairement à ce que certains ont pu penser, de donner un permis de tuer, mais d'améliorer éventuellement les choses. Nous avons déjà entendu des magistrats, des avocats, des juristes, notamment Catherine Le Magueresse, qui a suivi l'ensemble du procès.
Par ailleurs, lors de l'audition des représentantes de l'association SOS les mamans, nous avons recueilli deux témoignages bouleversants de mères dont les enfants subissent des maltraitances reconnues et qui sont pourtant presque considérées comme coupables. Nous avons également connaissance du cas d'une mère qui n'est pas protégée alors que les violences sont avérées et que des plaintes ont été déposées auprès des gendarmes.

La loi du 4 août 2014 prévoit la formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels, notamment des magistrats, confrontés aux violences faites aux femmes. Qu'en est-il de cette formation aujourd'hui ?
La question des violences conjugales est, depuis dix ans, pour le ministère de la justice, une priorité de politique pénale. Un certain nombre de circulaires, de directives et de dépêches ont donc été diffusées auprès des procureurs de la République, qui sont mobilisés pour lutter contre ce fléau sur l'ensemble du territoire national, même si, bien entendu, tout n'est pas parfait.
Quel bilan pouvons-nous tirer de la loi du 4 août 2014 en ce qui concerne la formation des magistrats ? L'École nationale de la magistrature (ENM) mène une politique dynamique dans ce domaine, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue puisque les magistrats sont soumis à une obligation de formation tout au long de leur vie professionnelle. À ce titre, une palette de thèmes leur est proposée chaque année, parmi lesquels figure bien entendu celui des violences conjugales et des violences sexuelles.
Dans le cadre de la formation initiale, une session de deux demi-journées de conférences et de tables rondes a été organisée pour la promotion de 2015, en association avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). Ces thèmes sont également évoqués dans le cadre des enseignements fonctionnels, car on sait qu'en la matière, la coordination entre le parquet, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales est essentielle pour éviter la déperdition d'informations.

À ce propos, il semble qu'une telle coordination fait figure d'exception : elle dépend de la bonne volonté des magistrats. Ainsi, il arrive qu'un juge aux affaires familiales (JAF) en charge d'une instance de divorce n'ait pas connaissance de l'existence d'une procédure pénale pour violences et propose une médiation entre époux. De même, on nous a dit que lorsqu'une plainte a été déposée contre un des deux parents et que le juge pour enfants auditionne les enfants mineurs, ce dernier ne communique pas forcément son dossier au juge aux affaires familiales. On ne peut que déplorer une telle étanchéité.
De tels cas de figure peuvent en effet, hélas, se présenter. Toutefois, je rappelle qu'au sein du parquet, le substitut des mineurs, dont relève également le contentieux de la famille – ce qui traduit bien la volonté de développer une approche globale –, intervient à la fois dans le champ pénal et dans celui de l'assistance éducative. Il est donc l'interlocuteur privilégié et le partenaire de travail quotidien du juge des enfants. Ainsi, lorsqu'il a à connaître d'une situation de violences dans laquelle des enfants sont en danger, il transmet une copie de la procédure au juge des enfants pour éclairer celui-ci sur le suivi de la famille et les mesures à prendre. Cette transmission peut également se faire en cas d'instance de divorce. En tout état de cause, le lien entre le substitut des mineurs et le juge des enfants est bien présent dans les pratiques professionnelles.
Quant à la transmission d'informations entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, elle existe également. Mais – j'y reviendrai à propos de l'ordonnance de protection –, il convient sans doute d'élaborer une politique de juridiction afin de mettre en place ou d'améliorer les circuits de transmission des informations. Des progrès sont donc souhaités par le ministère dans ce domaine. Toutefois, dire que le cloisonnement est total serait une contrevérité. Un magistrat sait que les situations individuelles sont complexes, comprennent divers paramètres et que la réponse judiciaire, notamment pénale, doit, pour être efficace, tenir compte des différentes interventions de la justice.
N'oublions pas, au demeurant, que l'avocat est un acteur fondamental en la matière. S'il s'agit d'un avocat attitré, qui intervient à la fois au plan pénal et dans le champ des affaires familiales, la continuité de l'information est assurée. En revanche, il est vrai que, pour les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ou de la commission d'office, une déperdition d'information est possible. En tout état de cause, le conseil joue un rôle clé : il pourra, par exemple, porter à la connaissance du juge aux affaires familiales la plainte que sa cliente a déposée par ailleurs. De fait, le substitut aux affaires familiales ou des mineurs ne connaît pas forcément l'existence d'une éventuelle instance de divorce, et la copie d'une procédure pénale ne peut pas être transmise dans le vide.
Quoi qu'il en soit, le ministère de la justice travaille à l'amélioration des circuits d'information entre les différents acteurs judiciaires : JAF, juge des enfants, parquet, en la personne du substitut des mineurs ou du substitut chargé du contentieux de la famille, sachant qu'il s'agit souvent du même magistrat.
J'en reviens à la question de la formation. Dans le cadre de ce que l'on appelle les séquences transversales, c'est-à-dire lorsque les auditeurs de justice sont sensibilisés à la question de la médecine légale, par exemple, la situation des victimes de violences ou des mineurs victimes de sévices est abordée.
En ce qui concerne la formation continue, une session principalement consacrée aux violences conjugales est renouvelée chaque année depuis 2008. Cette formation de trois jours est ouverte à un large public. Ainsi, en 2015, elle a été suivie par 62 magistrats, 8 juges de proximité, 4 gendarmes, 5 policiers, 7 personnels de l'administration pénitentiaire et 3 membres de l'éducation nationale. En 2016, a été créée une session de formation particulière, dirigée par Mme Ernestine Ronai, qui est consacrée aux violences sexuelles. Par ailleurs, l'ENM permettra, chaque année, à un magistrat de bénéficier de l'enseignement dispensé dans le cadre du diplôme universitaire sur les violences faites aux femmes que délivre, à partir de cette année, l'université Paris 8.
Enfin, il convient de mentionner la formation déconcentrée, qui se cumule avec l'obligation de formation continue suivie à Paris. En effet, dans chaque cour d'appel, un coordonnateur régional de la formation peut prendre l'initiative d'organiser des sessions de formation. Ainsi, en 2016, une formation spécifique est consacrée à la présentation du dispositif « téléphone grave danger », pour permettre à chaque magistrat de se familiariser avec ce dispositif.

Avez-vous une estimation du nombre de magistrats qui ont suivi des sessions de formation continue consacrées à ces questions ?
La session organisée en 2015 a été suivie par 62 magistrats, et je rappelle qu'elle existe depuis 2008.
Oui. La formation est obligatoire, mais chaque magistrat formule chaque année quatre voeux, validés par ses supérieurs hiérarchiques qui s'assurent que ces voeux correspondent aux fonctions qu'il exerce.

Dans quelle mesure l'appareil statistique du ministère de la justice comporte-t-il des données sexuées ?
Les statistiques du ministère de la justice étant issues du casier judiciaire national, elles ne comportent de données sexuées que pour les personnes condamnées.

Ne serait-il pas possible de disposer de telles données pour les victimes ? Nous souhaiterions connaître, par exemple, le nombre de plaintes qui ont été déposées pour cyber-violences, le nombre de femmes concernées et celui des condamnations. Or, nous ne parvenons pas à obtenir une réponse précise sur ces différents points.
La véritable question est celle de savoir s'il est pertinent de comparer ces éléments, qui sont très différents. Les données concernant les dépôts de plainte sont collectées par le ministère de l'intérieur ; or, le ministère de la justice n'a pas accès à ces bases de données. Quant à ses propres statistiques, elles sont construites à partir du casier judiciaire national ou du logiciel d'enregistrement des procédures, qui reflètent l'activité réelle des juridictions. Ses données concernent donc les affaires transmises au parquet, qu'elles soient ou non poursuivies. C'est ainsi que nous avons pu vous indiquer quels étaient le nombre d'affaires de violences conjugales et la structure de la réponse des parquets : classement sans suite et motif de ce classement, poursuite et voies de poursuite... Ces données sont non seulement complètes et précises mais également fiables. On peut en effet disposer d'un appareil statistique ; encore faut-il savoir comment les données sont construites afin de déterminer si elles ont un sens par rapport au contentieux que l'on cherche à évaluer.
S'agissant du lien que vous établissez entre le nombre de plaintes et le nombre de condamnations, il ne peut être fait ni au niveau statistique, ni au niveau juridique. En effet, non seulement une plainte n'aboutit pas forcément à une condamnation – même si, en matière de violences conjugales, toutes les affaires sont en principe élucidées, puisque l'auteur est connu –, mais elle n'entraînera pas non plus systématiquement des poursuites, en raison d'un manque de preuves par exemple.
En ce qui concerne le suivi statistique, c'est-à-dire l'évaluation du nombre des plaintes reçues par les services enquêteurs et celui des affaires transmises aux parquets – et non celui des condamnations –, le service statistique du ministère de la justice participe avec celui du ministère de l'intérieur à un groupe de travail destiné à étudier notamment la manière dont le contentieux des violences conjugales est identifié par les policiers. Le ministère de l'intérieur dispose en effet, contrairement à celui de la justice, d'un système de comptage purement statistique, qui repose sur le logiciel de rédaction des procédures et sur des index statistiques remplis par les policiers eux-mêmes au moment où ils enregistrent une plainte. Ce faisant, ils précisent un contexte, qui ne correspond pas forcément à une infraction, dès lors que l'appréciation n'est pas portée par un magistrat. Ce système de comptage n'est donc pas parfaitement fiable. En effet, il se peut que, lors du dépôt de plainte, le policier qualifie les faits de violences sans retenir la circonstance aggravante, qui n'est pas requise à ce stade de la procédure, mais en précisant tout de même dans l'index statistique qu'il s'agit de violences conjugales.
Les statistiques du ministère de la justice et celles du ministère de l'intérieur sont donc parfaitement compatibles, leurs ordres de grandeur sont comparables. En revanche, elles ne sont pas construites de la même façon, car les outils, les méthodes et les ressources sont différents.

Avez-vous des données concernant le nombre d'affaires dans lesquelles les femmes ont pu bénéficier, au cours de la période récente, de la légitime défense ?
Hélas, nous ne pouvons pas non plus vous fournir de données dans ce domaine, dans la mesure où, lorsque la légitime défense, qui est une cause d'irresponsabilité pénale, est retenue, aucune condamnation n'est prononcée. Or, comme je vous l'ai indiqué, nous travaillons sur la base des statistiques issues du casier judiciaire national, donc des condamnations.
Je me permets de revenir sur la question du décompte des victimes, à laquelle je n'ai pas répondu. Les éléments inscrits au casier judiciaire sont définis par la loi. Or, ni l'identité des victimes ni leur nombre ne figurent parmi ces éléments, non seulement parce qu'il ne recense que les personnes condamnées et leur peine, mais aussi parce qu'on peut être condamné sans que la victime soit identifiée. Quand bien même celle-ci ne serait pas connue ou refuserait de déclencher le processus pénal, la justice passerait outre l'absence de plainte. C'est une des raisons pour lesquelles le recensement du nombre des plaintes n'est pas forcément pertinent. L'étude du nombre des victimes de violences conjugales ou sexistes relève donc davantage des enquêtes de victimation.

La loi du 4 août 2014 prévoit que la juridiction de jugement puisse prononcer le retrait de l'autorité parentale en cas de meurtre du conjoint ou d'un enfant. Cette mesure a-t-elle été souvent prononcée ?
Les statistiques du ministère de la justice ne pouvant être consolidées qu'une fois l'année écoulée et les condamnations inscrites au casier judiciaire, les données concernant l'année 2015 ne seront disponibles qu'à la fin de l'année 2016.

Quelle est la position du ministère de la justice sur, non pas le retrait – car c'est une décision grave –, mais la suspension de l'autorité parentale ? J'ai lu récemment un jugement dans lequel un homme violent a été condamné sans que l'autorité parentale ait été suspendue au motif que, s'il est un mauvais mari, il est un bon père. Les enfants sont pourtant les victimes directes ou collatérales des violences conjugales. Il nous est donc difficile de concevoir qu'un mauvais mari puisse être un bon père – cette distinction nous choque beaucoup. La Chancellerie recommande-t-elle d'aborder ce sujet dans le cadre de ses instructions concernant les violences conjugales ?
Dans ce type de contentieux, la charge émotionnelle est très forte, et le rôle du magistrat est de dépasser l'affect et de se prononcer au regard des éléments objectifs qui lui sont soumis, non seulement pour caractériser l'infraction mais aussi pour motiver une mesure aussi importante que le retrait ou la suspension de l'autorité parentale. En l'absence de tels éléments débattus contradictoirement, il peut être délicat de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale. En tout état de cause, je n'ai pas relevé, dans la circulaire de 2014, d'indications du ministère sur ce point. J'ajoute que la suspension de l'autorité parentale ne peut pas être automatique, en raison du principe de l'individualisation de la sanction. Pour qu'elle soit prononcée, des éléments attestant de la dangerosité d'un parent doivent rendre inenvisageable l'exercice de son autorité parentale.

Lors de nos auditions, plusieurs personnes se sont étonnées que l'article 221-4 du code pénal, relatif aux circonstances aggravantes du meurtre, fasse référence aux conjoints mais pas aux ex-conjoints.
On peut en effet penser, à la lecture de cet article, que la situation des ex-partenaires et des ex-conjoints n'est pas visée, mais il faut se référer à l'article 132-80 du code pénal, qui définit cette circonstance aggravante et dont le deuxième alinéa prévoit explicitement que celle-ci est constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire d'un Pacs.
Dans le cadre de mes fonctions, j'ai participé à l'élaboration de ces dispositions Le code pénal comporte une partie générale, qui comprend elle-même les dispositions générales relatives aux circonstances aggravantes, qu'il s'agisse de la préméditation ou des violences à caractère raciste et homophobe, par exemple. C'est dans ce cadre que l'article 132-80 définit la circonstance aggravante de l'infraction commise par un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un Pacs, en précisant bien que cette circonstance aggravante est également reconnue lorsque l'infraction est commise par un ex-conjoint, un ex-concubin ou un ex-partenaire lié par un Pacs. Lorsque la loi a été adoptée, des circulaires ont été adressées aux juridictions. Pour les magistrats, il n'y a pas de doute que les dispositions générales du code pénal s'appliquent de façon générale. En tout état de cause, nous n'avons pas jugé utile de le repréciser pour chaque infraction ; du point de vue de la légistique, cela me paraît cohérent.
Je vous donne un autre exemple. L'ancien code pénal fixait des peines minimales et maximales ; le nouveau code pénal prévoit, quant à lui, une peine de dix ans de prison ou de quinze ans de réclusion criminelle, par exemple : il est précisé, dans la partie générale, qu'il s'agit de maxima et que l'on peut descendre aussi bas qu'on le veut. Le code pénal doit donc être lu en tenant compte de sa partie générale, qui définit également les principes de responsabilité, notamment les causes d'irresponsabilité pénale, telles que la légitime défense, par exemple. Ainsi, l'article relatif au meurtre ne précise pas que celui-ci n'existe pas en cas de légitime défense.
Cela ne me choque pas car, du point de vue de la légistique, il importe que le code soit cohérent et ne se répète pas. Certes, l'accessibilité de la loi pour un particulier est relative, car la question est, hélas, extrêmement complexe. Mais il n'apparaît pas pour autant opportun de modifier les articles concernés pour y préciser que la circonstance aggravante est également constituée lorsque l'infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin. Il s'agissait, du reste, d'un point fondamental lors de l'examen du projet de loi : je me souviens d'avoir plaidé pour que cette précision soit explicitement mentionnée dans le texte, ce qui n'était pas le cas à l'origine.

Que pensez-vous de la possibilité de modifier l'article 221-4 du code pénal relatif aux circonstances aggravantes du meurtre pour y faire référence aux meurtres commis « à raison du sexe » ? À votre connaissance, le terme de « féminicide » est-il utilisé dans le vocabulaire juridique et administratif pour désigner le meurtre de femme ?
À ma connaissance, le terme de « féminicide » – dont je suppose qu'il est le pendant d'homicide – n'est pas usité dans le monde judiciaire. Au demeurant, le fait de donner la mort à autrui n'est pas qualifié d'homicide dans le code pénal ; celui-ci fait référence au meurtre, qui est une notion asexuée. Par conséquent, si la proposition de créer une infraction de féminicide procède de la volonté d'instaurer un parallèle avec l'homicide, elle ne nous paraît pas nécessaire, au regard des textes actuels. Dans le code pénal, le terme d'« homicide » est principalement utilisé à propos de l'homicide involontaire.
Sur le point de savoir si la création d'une nouvelle circonstance aggravante à raison du sexe présente un intérêt juridique, notre direction est réservée, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il existe d'ores et déjà un certain nombre de circonstances aggravantes qui sont de nature à répondre à ces situations factuelles. La première d'entre elles vient d'être évoquée, c'est celle qui est constituée lorsque le meurtre est commis par le conjoint ou l'ex-conjoint. La deuxième est celle qui s'applique au meurtre d'une personne motivé par le refus de celle-ci de contracter un mariage ou de conclure une union. La troisième est celle qui est prévue en cas de commission simultanée d'un viol et d'un meurtre. Il nous semble que ces trois circonstances aggravantes permettent de prendre en compte sinon toutes, du moins un grand nombre des situations de violences subies par les femmes.
Par ailleurs, il serait difficile de caractériser juridiquement en quoi le meurtre est aggravé à raison du sexe. De fait, l'objectif serait de protéger davantage les femmes battues par leur conjoint masculin, mais il ne serait pas forcément atteint car seraient également concernés les cas où une femme bat ou tue sa rivale, par exemple. La terminologie est trop large pour déterminer le type de situations concrètes auquel on se réfère.

Nous savons que la notion de féminicide est utilisée en Italie et, surtout, en Amérique latine et au Canada, où ont eu lieu des assassinats de masse visant des femmes parce qu'elles étaient femmes ; il s'agit bien de meurtres spécifiques. Je pense également – mais peut-être cette situation est-elle déjà couverte par une circonstance aggravante – aux meurtres liés au code d'honneur : un frère tue sa soeur parce qu'il considère qu'elle a sali l'honneur de la famille, par exemple. Selon nous, il s'agit d'un féminicide, dans la mesure où un garçon qui ferait la même chose ne risquerait pas d'être tué. Nous cherchons à savoir si cette notion serait opérante dans notre code pénal.
Le cas que vous évoquez, même s'il relève du même esprit, échappe en effet à la circonstance aggravante liée au refus de contracter un mariage. Mais il est important que le choix des mots ne laisse pas trop de place à l'interprétation afin que chacun sache quel type de comportement est visé. Or, le terme de féminicide dépasse l'acte d'un homme tuant une femme, soit dans un contexte conjugal ou intrafamilial – il s'agirait alors d'un « féminicide intime » –, soit en raison de convictions antiféministes.

On peut en effet penser aux meurtres des étudiantes de l'École polytechnique de Montréal, qui ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes. Il me semble qu'au cours de nos auditions, a été souligné le fait que figurent dans le code pénal, au titre des circonstances aggravantes, les infractions commises à raison de la race – alors que ce mot ne devrait plus être utilisé – ou de l'orientation sexuelle, et non celles commises à raison du sexe.
C'est en effet le cas. Il existe une interrogation légitime, depuis quelques années, sur la présence du mot « race » dans notre législation. Une proposition de loi a été votée par l'Assemblée nationale, initialement pour le supprimer, puis, sur la suggestion de la direction des affaires criminelles et des grâces, pour le remplacer par des expressions telles que « raisons racistes » ou « prétendue race », afin de réprimer le racisme sans pour autant donner le sentiment que l'on cautionne l'existence des races.
Pour revenir à la question du féminicide, je rappellerai un précédent qui doit nous amener à réfléchir ; je veux parler de celui qui concerne l'inceste. Un texte a en effet été adopté dont l'objet était d'inscrire l'inceste dans le code pénal, non pas pour sanctionner des faits qui ne l'étaient pas, mais pour qualifier les choses plus clairement. Or, la définition de l'inceste soulevait des difficultés telles que cette disposition a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel. Un nouveau texte sur la protection de l'enfance a depuis été voté, dont la partie relative à l'inceste – partie qui a d'ailleurs été adoptée conforme par le Sénat et l'Assemblée – ne pose plus, selon moi, de problèmes d'ordre constitutionnel. Il me paraît toutefois plus difficile, d'un point de vue juridique, d'aboutir à une définition du féminicide qui n'encourrait pas la censure du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, à chaque fois que l'on a rencontré des problèmes particuliers, par exemple celui des mariages forcés, on les a réglés en créant une circonstance aggravante. La question des crimes d'honneur peut se poser, mais il faut savoir exactement ce que l'on veut réprimer et la manière dont on veut le réprimer. La formule générale « à raison du sexe » n'est pas satisfaisante de ce point de vue. Prenons l'exemple du racisme : la circonstance aggravante est établie notamment lorsque des propos racistes ont accompagné des violences ou un meurtre. Si l'on suit la même logique, le meurtre commis par une femme qui tue sa rivale en proférant des insultes sexistes devrait être qualifié de sexiste. Or, cela n'a pas de sens. Le parallèle entre sexisme et racisme n'est donc pas opérant : on aboutirait à des situations absurdes, voire contre-productives.
Si une réforme doit intervenir, elle doit donc cibler de façon précise ce que l'on veut réprimer, étant observé que, dans le cas des crimes d'honneur, par exemple – qui sont a priori déjà aggravés par la préméditation et passibles, à ce titre, de la réclusion criminelle à perpétuité –, il n'y a aucune difficulté à ce que les cours d'assises prononcent le maximum des peines encourues. On peut donc prévoir une aggravation dans un souci pédagogique – ou d'affichage, diront certains –, mais elle n'est pas forcément indispensable d'un point de vue juridique. Sur ce point, la réflexion doit peut-être se poursuivre. En revanche, la circonstance aggravante de sexisme paraît complexe à mettre en oeuvre, de même que la notion de féminicide, qui peut avoir une utilité en sociologie mais qu'il est délicat d'introduire dans la loi, dès lors que doivent être respectés le principe de légalité des peines ainsi que la sûreté et la prévisibilité de la loi.
Certains observateurs peuvent estimer qu'un certain nombre de circonstances aggravantes manquent, mais n'oublions pas que les éléments factuels sont dans le débat judiciaire et que, dans le cadre du procès d'assises, le contexte dans lequel l'acte a été commis sera mis en évidence. Ces éléments seront pris en considération tant par le ministère public dans ses réquisitions que par la cour d'assises dans son verdict.
Sur la situation individuelle de Mme Sauvage, je ne me prononcerai pas. Mais, en tant que magistrat, je peux faire état des pratiques professionnelles. Or, les conditions du passage à l'acte sont exposées à la cour d'assises et aux jurés pour qu'ils puissent apprécier la gravité des actes commis et déterminer la peine qui sera requise et prononcée.

Quelles réflexions vous inspire la présomption de légitime défense ou la légitime défense différée, qui a été évoquée à l'occasion de l'affaire Jacqueline Sauvage ?
Pour que la légitime défense soit retenue, l'action doit être simultanée et proportionnée à l'attaque subie. Si elle est différée, elle n'est plus simultanée. Or, je rappelle que cette définition de la légitime défense n'est pas nouvelle : elle est inscrite dans les concepts fondamentaux du droit pénal français. À ce stade, pour la direction des affaires criminelles et des grâces, aucune réforme de cette notion n'est envisagée – le législateur appréciera. En tout cas, il semble complexe d'introduire la notion de différé, d'autant que se poserait la question de la proportionnalité d'une riposte différée.

Dans le code criminel canadien, la notion de légitime défense est extrêmement détaillée. Ces précisions vous paraissent-elles utiles ou nécessaires ?
La spécificité du droit canadien est liée à une décision de 1990 de la Cour suprême, qui a reconnu, dans l'arrêt « Lavallée », une sorte de légitime défense différée. Cette décision a fait l'objet de commentaires de la doctrine et de magistrats, notamment à propos de l'emprise qui était exercée sur la victime. On a notamment comparé sa situation à celle d'un otage régulièrement menacé de mort qui tuerait son ravisseur sans attendre que celui-ci tente effectivement de l'assassiner. Toujours est-il qu'une loi est intervenue suite à cette jurisprudence, non pas pour clarifier la notion de différé, mais pour fixer des critères de bon sens – qui, selon moi, relèvent de l'interprétation de la loi plutôt que de la loi elle-même – qui permettent d'apprécier la légitime défense.
Je précise que nous n'avons pas de statistiques sur l'application effective de cette jurisprudence de 1990. En revanche, dans une décision plus récente, qui date de 1998, la Cour suprême canadienne a validé l'hypothèse dans laquelle la femme avait été déclarée coupable mais très faiblement condamnée. Vous avez indiqué vous-même que vous ne réclamiez pas un permis de tuer. Or, la légitime défense, l'état de nécessité ou la contrainte sont des causes d'irresponsabilité pénale, qui entraînent l'acquittement de l'auteur des faits. D'un point de vue strictement juridique, la légitime défense est donc un permis de tuer. Dans l'affaire Sauvage, la question qui se posait était celle de savoir si elle devait être acquittée ou si elle devait être condamnée à une peine moins sévère. Vous avez dit vous-même que ses avocats avaient axé sa défense sur la demande d'acquittement au nom de la légitime défense, et non sur la reconnaissance de circonstances qui auraient justifié une peine moindre. Le choix de la défense n'est donc pas anodin, en l'espèce.
Il s'agit de savoir ce que souhaite le législateur dans un tel cas. Souhaite-t-il que la femme battue qui tue son mari soit considérée comme pénalement irresponsable – et alors il faut faire évoluer la notion de légitime défense, qui est vieille de deux siècles – ou souhaite-t-il qu'elle ne soit pas condamnée à une peine disproportionnée – et il faut envisager une autre solution ? J'ajoute que, dans l'affaire dont nous parlons, se posait la question de l'application de la circonstance aggravante liée au fait que Mme Sauvage avait tué son conjoint, alors même que cette circonstance aggravante a été créée pour protéger les femmes se trouvant dans sa situation.
Il me semble donc que la légitime défense ou d'autres causes d'irresponsabilité n'offrent pas une solution satisfaisante, que ce soit du point de vue juridique ou même du point de vue sociologique, car encourager ainsi une femme battue à se défendre seule en lui reconnaissant le droit de tuer son mari violent serait, pour l'État, un terrible aveu d'impuissance.

Disposez-vous d'éléments statistiques sur l'application de l'ordonnance de protection, qui semble disparate sur l'ensemble du territoire ?
Cette question n'est pas suivie par la direction des affaires criminelles et des grâces mais par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, laquelle nous a transmis à ce sujet un certain nombre de données que je vais vous livrer mais que je ne serai pas forcément en mesure de commenter.
Le nombre des demandes d'ordonnance de protection a augmenté de 55 % entre 2011 et 2014. Il ressort d'une mission d'évaluation menée par l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) et l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) que l'appropriation du dispositif par les magistrats connaît une réelle amélioration. Quant au taux de rejet des demandes, il s'établit entre 25 % et 27,9 % entre 2012 et 2014. Cette stabilité peut s'interpréter comme le résultat d'un positionnement pondéré et assez conforme à la mission du juge, qui doit évaluer s'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables à la fois la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.
Par ailleurs, la direction des affaires civiles et du Sceau nous indique qu'aucun service aux affaires familiales ne répond dans le délai de 72 heures qui avait été envisagé lors des débats parlementaires, puisque les décisions sont rendues dans un délai moyen de 37 jours. Un tel délai s'explique par les contraintes inhérentes à la procédure suivie, notamment la nécessité de convoquer les parties à l'audience pour respecter le principe du contradictoire. La convocation se fait en effet par lettre recommandée avec accusé de réception et par délivrance d'assignation.
Toutefois, un certain nombre de juridictions, soucieuses de réduire ces délais, ont développé de bonnes pratiques qui consistent, pour les tribunaux de grande instance, à se rapprocher des huissiers de justice pour faire en sorte que l'acte d'assignation soit signifié dans la journée. Une politique de juridiction est également mise en oeuvre pour renforcer l'articulation entre les procédures pénales et les procédures civiles, afin de prendre en considération l'ensemble du champ des violences conjugales et intrafamiliales et tenter de développer une approche globale.

Je m'étonne tout de même que le délai dont nous avions prévu qu'il serait de 72 heures soit en définitive de 37 jours ! Je rappelle que l'ordonnance de protection est une mesure de très grande urgence dont l'objectif est de sauver la vie de femmes en grave danger. Par ailleurs, et je vais peut-être commettre ici un crime de lèse-justice, je ne vois pas en quoi le principe du contradictoire devrait être respecté en l'espèce. Qui est coupable ? Qui est victime ?
Pour le savoir, un débat contradictoire est nécessaire.

Si une femme franchit le pas et demande une protection, c'est parce qu'elle estime que sa vie est en danger. Peut-être peut-on commencer par la lui accorder avant de déterminer si elle a raison ou tort. C'est ainsi que des femmes se font tuer ! Nous savions très bien, lors des débats parlementaires, que nous rencontrerions ce type de difficultés ; j'entends que le débat contradictoire est nécessaire, mais il me semble que tel n'est pas l'esprit de la loi.
Le contradictoire est en effet un principe général du droit et une obligation conventionnelle contenue dans la Convention européenne des droits de l'homme.

Encore une fois, l'ordonnance de protection doit permettre de protéger des femmes en danger de mort. Or, aujourd'hui, certains avocats nous disent qu'ils ne la demandent plus, précisément pour protéger leurs clientes.
Manifestement, le ministère de la justice ne se satisfaisait pas de ces délais. L'ensemble des mesures qui peuvent être prises dans les juridictions pour les réduire sont les bienvenues. C'est la raison pour laquelle certaines bonnes pratiques sont encouragées. Au demeurant, en cas de danger imminent, dès lors que des menaces ont été proférées, le pénal prend le relais. De fait, ces menaces, de même qu'un éventuel harcèlement, sont susceptibles de constituer une infraction, laquelle peut donner lieu à une enquête diligentée en flagrance. En tout état de cause, une situation de danger imminent fait l'objet d'une alerte telle que le procureur et le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie se contacteront pour que des dispositions soient prises, qu'il s'agisse de patrouilles autour du domicile ou de l'ouverture d'une enquête en flagrance, notamment pour caractériser les menaces rapportées par la victime. On ne détournera pas la tête : la protection des victimes est également au coeur de la mission du magistrat.
L'éviction du conjoint violent est au coeur de la politique pénale menée par la Direction des affaires criminelles et des grâces. Cette mesure, initiée il y a plusieurs années, est désormais bien inscrite dans les pratiques des magistrats. Elle est une réalité dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites en cas de classement sans suite, dans le cadre du contrôle judiciaire prononcé dans l'attente du jugement ou, après l'audience, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Une autre mesure a été adoptée dans le cadre de la loi 2014, qui est plus délicate à appliquer par les parquets ; je veux parler de la possibilité pour le procureur de la République de se prononcer sur la prise en charge des frais relatifs à l'entretien du logement conjugal. Selon les éléments qui nous ont été communiqués par les différents parquets, cette mesure n'est pas véritablement mise en oeuvre car les procureurs s'interrogent sur les modalités et la portée d'une telle décision ainsi que sur l'absence de recours.
Il s'agit néanmoins de remontées ponctuelles. La question des violences conjugales est une priorité de politique pénale, mais il est difficile pour la Direction des affaires criminelles et de grâces d'en connaître les contours. C'est pourquoi elle a proposé, et sa proposition a été acceptée, au conseil de la statistique et des études du ministère de la justice que cette question fasse l'objet d'une enquête nationale en 2016. Cette proposition, élaborée par Ombeline Mahuzier, qui pourra vous en dire plus à ce sujet, traduit notre volonté de comprendre et de disposer de données fiables qui nous permettront d'avancer. La question de l'éviction du conjoint fait d'ailleurs partie des thématiques prises en compte dans cette étude.
Ce que l'on appelle la mesure d'éviction au sens strict est assez peu prononcée. Pour les praticiens du droit, elle s'entend en effet davantage au sens large et regroupe toutes les mesures juridiques qui permettent d'obliger le conjoint violent à rester à distance de la victime. Or, jusqu'à présent, seules les évictions au sens strict étaient comptabilisées, ce qui ne nous paraît pas pertinent. Il en est de même pour l'ordonnance de protection civile, qui est en effet assez peu utilisée au regard du volume d'affaires pénales traitées parce que les premières mesures prononcées par les parquets et les juges en cas de danger sont des mesures pénales, plus efficaces. Dès lors, comptabiliser uniquement les mesures civiles en omettant l'ensemble du dispositif pénal, qui sera pourtant préféré pour des raisons d'efficacité, c'est étudier le phénomène sous un angle réduit et faire l'impasse sur l'évaluation du dispositif pénal.
C'est pourquoi nous avons proposé que ces procédures fassent l'objet d'une étude qualitative et quantitative. Ainsi la sous-direction des études et de la statistique du ministère de la justice doit mener une étude quantitative sur l'éviction du conjoint violent ou l'ordonnance de protection, au sens large : cette étude portera sur tous les cas dans lesquels une mesure a été prise pour évincer le conjoint, par exemple dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au plan qualitatif, une étude menée par l'université de Strasbourg en lien avec le ministère de la justice a permis un premier travail de défrichage sur le fonctionnement du dispositif civil. Nous allons donc utiliser cette base de recherche pour étendre l'étude à une appréciation qualitative de l'articulation du dispositif civil et du dispositif pénal.

Lorsqu'une mesure d'éviction a été prononcée, rien n'empêche le conjoint qui a été éloigné de revenir sans cesse. Comment fait-on appliquer concrètement cette mesure ?
Le comportement que vous décrivez est constitutif d'un autre délit, le harcèlement.

Mais le harcèlement peut avoir été constaté : dans le cas auquel je pense, la femme a reçu un nombre important de SMS en l'espace d'un mois. Et son cas n'est pas unique…
Je peux difficilement me prononcer sur la situation individuelle à laquelle vous faites référence, car je ne la connais pas. Mais je puis vous indiquer, pour connaître les pratiques professionnelles en ma qualité de magistrat, que le comportement du conjoint qui n'accepte pas une séparation, par exemple, et va suivre constamment son ex-conjoint, sans pour autant le menacer explicitement ni même prononcer une parole, est constitutif d'un harcèlement et que des condamnations sont prononcées de ce chef.
Je précise que le dépôt de plainte, qui n'est pas toujours facile, n'est pas exigé. En revanche, il faut que les faits soient portés à la connaissance des services d'enquête. Dès lors, s'ils sont susceptibles de constituer une infraction, le procureur de la République ou ses substituts en sont informés.

Ce n'est pas le dépôt de la plainte qui est difficile, c'est son enregistrement par les policiers ou les gendarmes. Que fait-on ?
Sur ce point, le ministère de la justice a donné des instructions très claires. On trouvera toujours une exception : dans un tel cas, il faut écrire au procureur de la République, en donnant son identité et ses coordonnées, afin de révéler les faits. Les délais seront peut-être plus longs, mais cette lettre sera traitée par un substitut et une enquête sera ouverte. En tout état de cause, les directives de la Direction des affaires criminelles et des grâces, qui figurent dans une dépêche de 2013 sont très claires sur ce point : le principe est le recueil de la plainte ; si la personne ne souhaite pas déposer plainte et préfère une main courante, des protocoles ont été conclus pour définir dans quel cadre ces mains courantes doivent être portées à la connaissance du procureur de la République et de son équipe, afin que chaque situation de violences puisse recevoir une réponse, qu'elle soit sociale ou pénale.

Je souhaiterais vous soumettre un autre cas. Si une personne a été écartée du domicile conjugal pour violences au motif qu'elle fait l'objet d'un internement d'office, et qu'ensuite soumise à une obligation de soins, elle est accueillie dans un service de désintoxication dont elle s'échappe régulièrement afin de harceler son conjoint. Les services de gendarmerie ou le procureur doivent-ils être informés de ses permissions de sortie et peuvent-ils l'entendre à cette occasion ?
Il m'est très difficile de vous répondre, car je ne connais pas la situation particulière que vous évoquez : il peut s'agir d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Les permissions de sortie sont délivrées par l'autorité médicale. Pour que l'autorité judiciaire en soit informée, il faut que cette hospitalisation intervienne au titre d'une injonction de soins en exécution d'une peine. Quant à l'addiction, elle ne fait pas, a priori, obstacle à une audition. Si cette personne est convoquée dans le cadre d'une enquête pénale et que l'enquêteur ou le magistrat a des doutes sur ses capacités à disposer de ses facultés mentales, le procureur ordonnera un examen psychiatrique avant de l'entendre.

Un magistrat référent en matière de violences commises au sein du couple a-t-il été désigné dans toutes les juridictions ?
Oui.

Nous vous posons cette question car, lors des débats préalables à l'adoption de la loi de 2010, l'hypothèse de la création d'une juridiction spéciale, réclamée par certaines associations, avait été évoquée, mais la majorité des députés n'y étaient pas favorables. Le magistrat référent peut-il être contacté ?
Oui. Il est d'ailleurs souvent en relation avec la déléguée départementale aux droits des femmes.

Nous vous remercions d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Je ne voudrais pas laisser croire que nous avons le sentiment que les choses n'avancent pas. J'ai suivi localement le circuit emprunté par les femmes victimes de violences et, partout, les associations d'aide aux victimes nous ont dit ressentir un changement depuis trois ans : la coordination des services s'est améliorée, la formation a progressé et l'on sait désormais poser aux femmes victimes de violences les questions qui les amèneront à se confier. Nous nous efforçons toujours d'améliorer la loi mais, sur le terrain, de manière générale, la prise en charge de ces femmes s'est améliorée.
La Délégation examine ensuite le rapport d'information sur les femmes et la lutte contre le dérèglement climatique qui fait suite au colloque organisé le 1er décembre 2015.

Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle à présent l'examen du projet de rapport sur « Les femmes et la lutte contre le dérèglement climatique ». Ce rapport regroupe trois éléments :
– le compte rendu des interventions des participants à un colloque intitulé : « Lutte contre le dérèglement climatique, les femmes en première ligne », une manifestation qui a été organisée par la Délégation aux droits des femmes, le mardi 1er décembre 2015, à l'Assemblée nationale ; ce colloque avait pour objet de sensibiliser l'opinion publique – quelques jours avant l'approbation du premier accord universel pour le climat, le 12 décembre 2015, lors de la réunion de la COP 21 à Paris – non seulement sur l'importance vitale qu'il y avait à conclure un accord international permettant de limiter la hausse des températures du globe au-dessous de la barre des 2 degrés, mais aussi sur le fait qu'il ne fallait pas méconnaître un élément essentiel dans ce combat : le rôle déterminant des femmes dans la lutte contre le réchauffement climatique ;
– une préface destinée à présenter ce compte rendu ;
– et enfin trois annexes qui correspondent elles-mêmes à :
un plaidoyer intitulé : « Les femmes actrices de la lutte contre le dérèglement climatique » ; il a été rédigé par un comité d'experts placé sous l'autorité de la présidente de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée, de son homologue de la Délégation aux droits des femmes du Sénat – Mme Chantal Jouanno – et de la présidente du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes – Mme Danielle Bousquet ;
un résumé de ce plaidoyer ;
et un appel intitulé « Soutenir les femmes face au dérèglement climatique : pourquoi nous nous engageons » ; cet appel a été formulé par les trois présidentes dans le prolongement du plaidoyer et il est accompagné de la liste des cent premiers signataires.
Le plaidoyer et l'appel ont été dévoilés lors d'une manifestation organisée le 16 octobre 2015 au Quai d'Orsay ; ils ont été remis par les trois présidentes au ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius ; à la ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Mme Marisol Touraine, et à la secrétaire d'État aux droits des femmes, Mme Pascale Boistard ; cette prise de position a permis d'expliciter et de compléter la position de la France, s'agissant du rôle et de l'importance des femmes dans la lutte contre le dérèglement climatique, dans les négociations.
J'en viens maintenant au contenu du rapport.
Comme vous le savez, les femmes, dans les pays en voie de développement, sont à la fois les premières victimes des changements climatiques et aussi les premières actrices pour lutter contre ces changements.
Compte tenu de ce rôle essentiel des femmes dans la lutte contre le dérèglement climatique, les observateurs et les associations féministes étaient très attentifs à ce que la COP 21– qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 – reconnaisse deux principes primordiaux pour les femmes du monde entier : l'égalité des droits avec les hommes et l'autonomisation dans la prise de décision.
Néanmoins, on doit observer qu'au moment où la COP 21 débute, le principe de l'égalité des femmes dans toutes les mesures concernant le climat – principe qui avait été clairement formulé dans une conférence préparatoire à Genève en janvier 2015 – n'est pas encore totalement acté.
À la faveur des deux consultations ministérielles informelles organisées par M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, la première au cours des 20 et 21 juillet et la seconde au cours des 6 et 7 septembre, pour accompagner le processus de négociation sur les principaux thèmes en discussion, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes figure dans le projet de document final pour la conférence de Paris. Toutefois, au moment où la conférence débute, ce principe reste écrit entre crochets dans les différentes publications de la COP, c'est-à-dire que les négociations ne sont pas totalement achevées.
Compte tenu de cette situation, la Délégation aux droits des femmes s'est efforcée de peser de tout son poids pour obtenir l'insertion dans l'accord final de la COP 21 du principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
D'où le plaidoyer (« Les femmes actrices de la lutte contre le dérèglement climatique »), l'appel et les actes du colloque – documents qui figurent en annexe de ce rapport.
Enfin, et c'est là le dernier point que je voulais développer devant vous, notre appel à la conscience internationale a permis d'adopter un certain nombre de dispositions qui figurent désormais dans le traité de Paris.
Ainsi, la mention des droits de l'Homme, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes figure dans le préambule de l'accord. De même, la notion de genre se retrouve dans plusieurs parties du texte (adaptation des pays et résilience aux changements climatiques, renforcement des capacités des États, transferts de technologie).
Cependant, d'autres dispositions – qui étaient aussi très favorables aux femmes – n'ont pu être traduites dans le droit international :
– on en reste, dans le préambule, à la notion vieillie des « droits de l'Homme », au lieu de parler résolument des droits humains ;
– la mention des droits humains et de l'égalité femmes-hommes n'a pas été retenue dans l'article 2 du traité qui définit les objectifs auxquels s'obligent les parties ;
– enfin, la mention de la prise en compte du genre dans la partie du traité consacrée aux financements publics n'a pas non plus été retenue.
Dans les années qui viennent, d'autres négociations internationales seront donc nécessaires pour compléter les acquis du traité. Par ailleurs, au moment du vote du budget, il faudra que nous nous efforcions d'orienter certains crédits liés à l'aide au développement vers le financement d'actions réalisées par des femmes.
La Délégation adopte le rapport d'information.
La séance est levée à 18 heures 45.