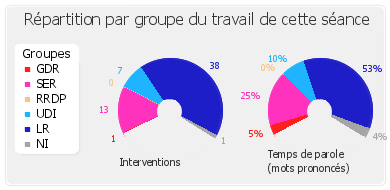Séance en hémicycle du 12 juin 2014 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à quinze heures.


La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, le texte dont nous débattons aujourd’hui intéresse les Français à double titre : tout d’abord, il concerne le permis de conduire et nous connaissons tous l’importance de cette épreuve car, pour beaucoup de jeunes, le permis n’est pas une simple autorisation administrative mais un passeport vers l’indépendance, la mobilité et souvent aussi vers l’emploi ; ce texte intéresse également nos concitoyens à un autre titre, plus tragique, car il vise à sauver des vies, ces vies qui, trop souvent encore, sont perdues dans des accidents de la circulation routière. Je profite de cette intervention, et le ministre de l’intérieur se joint à moi, pour adresser un message de prudence, notamment aux jeunes conducteurs : 20 % des tués sur la route ont entre dix-huit et vingt-quatre ans. En dix ans, le nombre de morts sur la route a été divisé par deux : 3 653 personnes ont trouvé la mort sur la route en 2012 contre 7 242 en 2002. C’est un progrès considérable ! Mais nous ne devons pas relâcher nos efforts, baisser la garde.
La proposition de loi présentée est empreinte de bon sens et constitue une brique supplémentaire dans le renforcement du cadre de la politique nationale de sensibilisation de la population aux risques de sécurité civile. C’est en ce sens que la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a rappelé dans son article 4, d’une part, le fait que « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile », et, d’autre part, qu’« en fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ».
Il s’agit donc bien ici de profiter de l’apprentissage du permis de conduire pour sensibiliser les candidats aux notions de secourisme. Le Gouvernement partage cet objectif et y contribue déjà très largement. En effet, il a été décidé de s’appuyer sur les établissements scolaires et sur les journées de défense et de citoyenneté pour prodiguer l’enseignement de telles notions. C’est donc en harmonie et en cohérence avec la loi de 2004 et les dispositifs existants que la présente proposition doit être étudiée.
La sensibilisation au secourisme relève d’une nécessité et du bon sens. Qu’un citoyen, confronté à une situation accidentelle, doive pouvoir mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde n’est pas en soi discutable. Mais il est également nécessaire que l’ensemble du dispositif ne constitue pas une contrainte supplémentaire pour les candidats. Je tiens à rappeler que l’obtention du permis de conduire est une épreuve longue pour les candidats : quatre-vingt-dix-huit jours pour repasser le permis de conduire aujourd’hui ! Nous ne pouvons encore allonger les délais. Pourquoi, par exemple, requérir de manière obligatoire qu’un jeune ayant souscrit un engagement citoyen auprès d’une association agréée de sécurité civile en secourisme ou bien comme sapeur-pompier volontaire soit contraint de suivre une sensibilisation à des notions qu’il connaît déjà ? La prise en compte d’acquis ou de diplômes doit constituer un atout pour les candidats, et éviter ainsi l’inflation du nombre d’heures d’enseignement.
Les accidents de la circulation présentent une traumatologie comparable à de multiples situations accidentelles. Ainsi, la prise en compte de notions générales en matière de secourisme et faisant l’objet de sensibilisations régulières tout au long de la vie, que ce soit dans le milieu scolaire, lors de la journée de la citoyenneté et de la défense, ou bien encore dans le milieu du travail, permet sans aucun doute d’acquérir les bons réflexes sans se limiter à une action en réponse à une situation contextualisée. Les bons réflexes s’apprennent de manière régulière. L’adaptabilité aux situations est une des caractéristiques du secouriste. Associer des actions à une situation les rend spécifiques, quand bien même elles ne le sont pas.
Pour réussir, les dispositions proposées ne doivent aucunement être perçues comme étant des contraintes. Il convient donc d’intégrer dans le dispositif, à la fois sur la forme et sur le fond, des éléments permettant de valoriser ce dernier. La simplification administrative fait partie d’une telle approche et est l’objet à ce titre d’une attention particulière.
Enfin, il est à noter que l’ensemble des dispositions prises, quand bien même elles iraient dans le sens de l’intérêt commun, doivent s’attacher au principe de réalité, à savoir que le nombre de candidats au permis de conduire est tel que les structures en mesure de les sensibiliser aux notions de secourisme ne disposeront pas des capacités de formation requises. Le secourisme est un domaine tellement noble qu’il ne serait pas concevable, alors que tout le monde s’accorde sur les objectifs du texte, de ne pas permettre sa mise en application simplement et rapidement. La capacité de sensibilisation au secourisme devrait théoriquement doubler si on s’en tient aux chiffres actuels de candidats se présentant à l’examen de conduite. Le respect d’une ligne d’enseignement généraliste, plutôt que l’apprentissage de gestes techniques devant des symptômes spécifiques et non exhaustifs, favorisera la prise en compte du principe de réalité. Une autre solution consiste à envisager un dispositif visant à renforcer le rôle des moniteurs d’auto-école dans ce domaine. Cela serait plus long qu’il n’y paraît, car nécessitant un peu de délai. De toute façon, nous ne devons pas favoriser l’allongement des délais d’obtention du permis de conduire. De même, les choix qui seront faits devront s’inscrire dans l’objectif d’accessibilité du permis à tous. Cela suppose un coût individuel non prohibitif pour le citoyen, et milite donc pour une prise en compte globale.
C’est pourquoi l’examen de la proposition de loi retient toute l’attention du Gouvernement.

La parole est à M. Bernard Gérard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, pour la deuxième fois durant la présente législature et dans le cadre de l’ordre du jour à l’initiative du groupe UMP, notre Assemblée est saisie de la question de la formation des futurs conducteurs aux premiers secours durant la préparation du permis de conduire. Travaillant à faire avancer ce dossier depuis de nombreuses années, je ne puis que m’en réjouir.
En octobre 2012, je défendais ici une proposition de loi visant à former aux cinq gestes qui sauvent après un accident de la route, dans le cadre de la préparation du permis de conduire. Le dispositif proposé alors avait été rejeté, à mon grand regret, par la majorité, celle-ci avançant des motifs juridiques et pratiques alors même qu’un consensus s’était dessiné sur la nécessité de mieux former nos concitoyens à ces gestes élémentaires. Savoir prévenir les secours, baliser les lieux afin de protéger les victimes, sauvegarder la vie des blessés, voire ventiler et comprimer les hémorragies, sont non seulement des gestes indispensables pour sauver des vies mais qui répondent aussi à une demande de nombre de nos concitoyens, souvent impuissants face à une scène d’accident, ne sachant de surcroît comment hiérarchiser les urgences. En effet, selon un sondage réalisé à l’initiative de la Croix-Rouge française, seuls 46 % des Français déclarent avoir bénéficié d’une formation aux premiers secours. En l’état actuel du droit, la connaissance des gestes de premiers secours n’est ni enseignée ni sanctionnée lors de l’examen du permis de conduire. C’est pour pallier cette carence que nous remettons donc l’ouvrage sur le métier, sachant que la formation aux premiers secours dans le cadre du permis de conduire recueille l’assentiment de 98 % des Français selon un sondage Opinion Way. Il faut donc avancer.
Seuls un volontarisme politique et des moyens dégagés pour le mettre en oeuvre ont permis d’obtenir des résultats en termes d’amélioration de la sécurité routière. Entre 2002, année où le président Jacques Chirac fait de la sécurité routière une de ses priorités, et 2013, le nombre de morts sur la route, vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, a diminué de plus de moitié : 3 268 morts ont été recensés l’année dernière contre 7 242 en 2002. Afin de poursuivre cet effort et d’améliorer la survie des victimes d’accidents ayant lieu en dehors de la circulation routière, notre pays doit élargir la palette de ses outils en combinant l’approche répressive à une démarche éducative.
L’obligation de formation aux premiers secours des futurs conducteurs, pratiquée dans de très nombreux pays européens, du Danemark à l’Italie en passant par l’Allemagne et l’Autriche, apparaît aujourd’hui comme un moyen qui a fait ses preuves pour réduire la mortalité sur la route en permettant aux personnes présentes sur place d’agir pour préserver la vie humaine en pareilles circonstances, en accélérant l’arrivée des secours et en favorisant, durant l’attente, la survie des blessés grâce à quelques réflexes simples. Plus de 50 % des victimes de la route succombent en effet dans les premières minutes suivant l’accident. Selon certaines estimations, entre 250 et 350 vies seraient sauvées chaque année si les accidentés pouvaient bénéficier de gestes de premiers secours pratiqués par un témoin. Rappelons aussi que plus de 70 000 blessés sont à comptabiliser sur l’année dernière.
Il n’existe aujourd’hui qu’un seul dispositif obligatoire de formation aux gestes de premiers secours à destination d’un public assez large. Cependant, l’obligation prévue par le législateur de former les élèves à cette attestation de prévention et secours civique de niveau 1 – PSC1 –, attestation délivrée après une formation de sept heures, est mal respectée : 20 % seulement des élèves de troisième sont formés chaque année, ce qui est regrettable et justifie qu’on propose d’accorder d’autres moyens à une formation de masse aux gestes de premiers secours.
Aussi, les propositions en faveur de l’intégration à l’examen du permis de conduire d’une formation aux premiers secours ont-elles été nombreuses depuis plusieurs années, émanant de personnalités diverses. Le principe a été acquis en 2003 dans une loi sur la sécurité routière… Onze années se sont écoulées sans qu’il soit mis en oeuvre ! Sur proposition du groupe UMP du Sénat, les 19 novembre 2013 et 30 avril 2014, à l’initiative des sénateurs Jean-Pierre Leleux et Jean-René Lecerf, rejoints par plusieurs de leurs collègues, a été débattu un dispositif similaire à celui que j’avais défendu en octobre 2012. Il prévoyait l’institution d’une troisième épreuve sanctionnant la connaissance des cinq gestes qui sauvent, précisément énumérés. En pratique, la participation à la formation, de l’ordre de quatre heures, et sa validation étaient prises en charge par les associations de secourisme, qui remettaient aux intéressés une attestation.
C’est alors que sur proposition de sa rapporteure, Mme Catherine Troendlé, la commission des lois du Sénat a retenu un dispositif simplifié par rapport à celui que j’avais proposé, prévoyant la formation et le contrôle des futurs conducteurs aux notions élémentaires de premiers secours dans le cadre des épreuves existantes. Cette solution évite tout surcoût, même modeste, pour les candidats, et permet au législateur de ne pas avoir à entrer dans le détail de mesures d’application relevant du pouvoir réglementaire. Elle prévoit que les futurs conducteurs devront être « formés aux notions élémentaires de premiers secours en cas d’accident de la circulation » : dans l’esprit de la rapporteure du Sénat, cela signifie que « pourrait être imposé aux auto-écoles d’apprendre aux candidats des comportements simples, à observer en cas d’accident de la circulation ». La solution proposée présente l’avantage de favoriser la généralisation, chaque année, d’une formation au profit de l’ensemble des candidats au permis de conduire. Cependant, je souhaite bien sûr que le contenu de cette formation, défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité routière, soit le plus ambitieux possible et développe une approche pratique allant au-delà de la seule alerte et de la protection des blessés : elle pourrait comprendre les gestes de secourisme recommandés par les autorités compétentes en matière de science médicale et d’accidentologie, telles que l’Académie de médecine.
Enfin, la présente proposition de loi prévoit que le contrôle de la formation à ces gestes de premiers secours est effectué dans le cadre de l’examen du permis de conduire. En effet, comme l’ont montré les auditions, le fait d’avoir suivi une telle formation peut avoir un effet indirect très positif en matière de sécurité routière, en induisant, notamment chez les jeunes conducteurs – les plus concernés –, un changement de comportement au regard de la prise de risque. C’est un élément dont on ne saurait sous-estimer l’importance : la présente proposition de loi est en mesure de favoriser un comportement de « conduite apaisée ».
Plus de 1,5 million de candidats se présentent chaque année à l’examen du permis de conduire. Il est évident que les connaissances acquises pourraient être réutilisées dans de nombreuses circonstances de la vie quotidienne, en cas d’urgence. Pourtant, elles restent spécifiques à la conduite.
C’est pourquoi j’ai déposé un amendement destiné à garantir que cette compétence ne soit pas uniquement théorique. Sans entrer dans le domaine réglementaire, nos débats peuvent clarifier le cadre général et préciser ce que doit recouvrir une formation aux gestes de survie. De ce point de vue, et comme cela a été envisagé au Sénat, je souhaite que des parlementaires soient associés à l’élaboration des décrets d’application. Tel était d’ailleurs le sens des propos tenus par M. Vallini au Palais du Luxembourg.
De nombreuses initiatives ayant été prises, sur tous les bancs des deux assemblées, pour mettre en oeuvre une formation de nos concitoyens aux gestes qui sauvent, chacun pourra admettre le bien-fondé de la démarche proposée. Il importe aujourd’hui, dans un esprit de consensus, de la faire aboutir dans les faits.
Mes chers collègues, je tiens ici à saluer le travail conduit au Sénat, qui a permis de lever les réserves émises à l’Assemblée en 2012. La rédaction qui en résulte constitue une avancée notable ; elle a d’ailleurs été votée à l’unanimité et a reçu un accueil très favorable du ministre. Je souhaite que ce dispositif soit accompagné de l’engagement formel du Gouvernement de mettre en place une formation pratique aux gestes de premiers secours.
Le 30 avril dernier, par la voix de M. André Vallini, le Gouvernement a pris, outre l’engagement de donner un avis très favorable au texte, celui de prendre les mesures réglementaires d’application au plus tard cet été, c’est-à-dire avant le 23 septembre. Or, lors de l’examen en commission, il a curieusement déposé trois amendements porteurs d’améliorations rédactionnelles, présentées comme marginales et donc loin d’être essentielles, mais dont certaines sont sources de confusion. Elles conduisent surtout à prévoir une seconde lecture au Sénat, si bien que l’entrée en application du texte ne pourra pas avoir lieu avant le mois d’octobre, soit bien après la date promise. Un tel report paraît incompréhensible alors qu’un consensus semblait s’être dégagé sur la rédaction du Sénat.
Pour l’éviter, je vous proposerai, par trois amendements acceptés ce matin par la commission réunie au titre de l’article 88 du règlement, de rétablir le texte adopté par le Sénat. La France est en effet déjà trop en retard par rapport à ses voisins européens, et les dispositions votées à l’initiative du Gouvernement paraissent superfétatoires au regard de l’objectif à atteindre : rendre nos concitoyens capables de sauver des vies en cas d’accident de la route.
Le sujet que nous abordons aujourd’hui est source d’unité et non de division. J’attends donc de la part du Gouvernement des précisions et des garanties sur sa réelle volonté de mettre en oeuvre la formation, et à quelle échéance. Vous comprendrez en effet que mon enthousiasme en la matière ait été quelque peu déstabilisé par sa position ambiguë. Je souhaite donc que nos débats, ainsi que la navette parlementaire, puissent lever ces ambiguïtés et permettre la mise en place, au bénéfice de tous, d’une formation pratique aux gestes de premiers secours.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que nous nous réunissons pour la deuxième fois en moins de deux ans pour parler du même sujet, j’espère, au nom du groupe UMP, que nous allons aboutir le plus rapidement possible, voire dès aujourd’hui.
On peut en effet regretter ce temps passé qui est en fait du temps perdu. Tout ça pour ça !, pourrait-on dire. Il y a dix-huit mois, le Gouvernement et sa majorité ont cherché, puis trouvé des arguments – pas tous non pertinents, certes – afin de renvoyer à plus tard l’adoption des dispositions proposées. Mais nos collègues sénateurs ayant repris l’initiative de Bernard Gérard, nous voici amenés à nous prononcer sur un texte qui ressemble beaucoup à celui qui aurait pu exister il y a dix-huit mois si nous avions fait alors le travail que vous proposez aujourd’hui.
Le Sénat s’est en effet saisi d’une proposition de loi pratiquement identique. Le résultat de son examen est un texte non pas édulcoré, mais plus léger, et peut-être moins sujet au reproche de contenir des dispositions d’ordre réglementaire. Or la même chose aurait pu être obtenue ici il y a dix-huit mois : ni le rapporteur, ni le groupe UMP n’auraient alors, je pense, refusé de modifier leur proposition de loi.
Pour autant, nous ne ressentons aucune acrimonie particulière ; nous voulons seulement avancer. Je veux d’ores et déjà saluer l’efficacité du travail accompli par notre rapporteur et la persévérance dont il a fait preuve.
Je rappellerai brièvement la nature de la proposition que nous avions défendue à l’époque et les raisons pour lesquelles son adoption avait été repoussée. Nous avions voulu être précis en prévoyant une troisième épreuve à l’examen du permis de conduire, dont une partie serait réellement d’ordre pratique, afin de préparer efficacement les candidats et de leur permettre de faire face à toutes les situations.
Mais le Gouvernement avait fait valoir que ces dispositions étaient de nature réglementaire et qu’un tel degré de précision risquait d’empêcher de faire évoluer l’enseignement des premiers gestes de secours en fonction des recommandations formulées par les spécialistes de la sécurité civile ou le corps médical. Il avait donc été décidé de repousser à plus tard l’adoption de la proposition de loi.
Dès lors que celle-ci nous revient après avoir été modifiée par le Sénat, on pouvait espérer qu’elle soit également adoptée par notre assemblée avant la fin de la session ordinaire. Or, à moins que les amendements du rapporteur – auxquels la commission, réunie ce matin au titre de l’article 88, a donné un avis favorable – ne soient adoptés, ce que je souhaite ardemment, nous n’aurons pas achevé ce soir la navette parlementaire, et il faudra remettre encore à plus tard l’aboutissement de ce travail. Pourtant, personne ici, pas plus qu’il y a dix-huit mois, ne prétend que cette proposition de loi n’a pas de sens ou manque de pertinence, ni qu’elle ne mérite pas de devenir une loi de la République.
Deux éléments, madame la secrétaire d’État, devraient vous inspirer tout à l’heure au moment de donner l’avis du Gouvernement sur les amendements du rapporteur. Le premier est que l’on estime aujourd’hui – personne ne conteste ce chiffre – à environ 9 ou 10 % le nombre de morts sur la route qui seraient encore en vie si les premiers gestes avaient été effectués de manière appropriée dans les premiers instants ayant suivi l’accident, au moment où ne sont encore présents ni les pompiers, ni la sécurité civile, mais seulement les éventuels passagers du véhicule ou d’autres conducteurs. Ce chiffre n’a rien d’anecdotique. Il recouvre une réalité qui pourrait concerner chacun d’entre nous et doit donc être pris au sérieux.
Le deuxième élément vise à répondre à l’argument selon lequel tout cela est bien beau, mais pas applicable. Que n’avons-nous entendu, de même, il y a une dizaine d’années, lorsque, partout en France, des défibrillateurs ont été mis à la disposition des sportifs ou des usagers des services publics ? Les maires et élus locaux, nombreux ici, se souviennent certainement des réactions de certains : installer ces appareils, c’est bien, disaient-ils, mais personne ne saura jamais s’en servir convenablement, et leur mauvais usage pourrait avoir des résultats inverses de ceux attendus.
Aujourd’hui, nous constatons qu’il n’en est rien. Il suffit, comme moi, d’avoir vu au moins une fois dans sa commune une vie sauvée par un non-spécialiste formé à l’usage de cet outil, pour se persuader que rien n’est jamais impossible.
Pour toutes ces raisons, madame la secrétaire d’État, le groupe UMP aura, sur cette proposition de loi, une attitude positive et prospective. Nous voterons en faveur du texte adopté par la commission des lois et modifié par les trois amendements présentés par notre rapporteur, ce qui permettrait d’adopter en termes identiques la proposition de loi issue du Sénat. Ainsi, nous disposerions dès ce soir d’une nouvelle loi utile et efficace. Elle serait d’une portée limitée, certes, mais pourrait être ultérieurement prolongée par des dispositions réglementaires, voire par un nouveau texte législatif.
Je souhaite donc, pour finir, entendre le Gouvernement répondre de manière claire – un avis favorable aux amendements que j’ai évoqués constituant à cet égard la meilleure réponse – à cette question : pourquoi a-t-il souhaité apporter à ce texte des modifications qui ne sont certes pas négligeables, mais dont on aurait pu se passer, ce qui aurait permis, dès aujourd’hui, d’adopter définitivement la proposition de loi ?
Nous devons poursuivre l’oeuvre engagée il y a un peu plus de dix ans à l’initiative du président Chirac, et qui a permis de sauver plus de 4 000 vies humaines par an, soit, en tout, plus de 40 000. Ce n’est pas rien ! Continuons donc à avancer. Grâce à vous, madame la secrétaire d’État – car je ne doute pas que vous répondrez positivement à notre demande –, nous disposerons ce soir d’une loi utile et efficace pour la sécurité de nos concitoyens.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comment sauver des vies sur la route ? Telle est la question qui nous interpelle tous, en tant que législateurs, en tant que citoyens, en tant que parents, et ce quelles que soient, sur les bancs de cet hémicycle, nos convictions politiques. Toute initiative parlementaire en ce sens ne peut donc qu’être saluée.
Pas une seule famille en France, hélas, n’est épargnée par ce fléau. Bien que la France soit passée, en 2006, sous la barre symbolique des 5 000 personnes tuées par an, la mortalité sur les routes est un sujet qui demeure très préoccupant. Encore aujourd’hui, les accidents font 100 000 blessés par an, 4 000 d’entre eux sont handicapés à vie, et près de 4 000 victimes perdent la vie. Au total, en quarante ans, plus de 380 000 personnes sont décédées des suites d’un accident de la route. Derrière ces chiffres, il y a des drames humains, des familles et des vies brisées à cause d’une conduite à risque, à cause d’une vitesse excessive ou tout simplement à cause d’une faute d’attention.
Il est heureux qu’une sonnette d’alarme ait été tirée ces dernières années. Reconnaissons-le, grâce à l’action des pouvoirs publics, le taux de mortalité sur les routes a diminué de façon importante en trente ans. Cette action, nous devons la continuer, et c’est ce que vise le texte que nous examinons, qui a pour objet d’inclure une formation aux gestes de premiers secours dans l’examen du permis de conduire.
À tout moment, en tout lieu, chacun d’entre nous peut être confronté à un accident de la circulation. Franchement, combien d’entre nous sauraient quelle attitude adopter ? Combien d’entre nous sauraient avoir les bons gestes, immédiatement, alors que la vie de la victime est en jeu ? Dans de pareilles circonstances, chaque geste compte, chaque minute qui passe est cruciale pour la survie de la victime.
La formation aux gestes de premiers secours a donc bien évidemment toute son importance.
Elle est pourtant insuffisamment diffusée au sein de la population et en particulier auprès des nouvelles générations de conducteurs. Bien que les jeunes Français soient obligatoirement initiés aux gestes de premiers secours notamment au cours de leur Journée défense et citoyenneté, anciennement Journée d’appel et de préparation à la défense, cette formation n’est tout au plus qu’une sensibilisation. Elle ne suffit pas à imprimer durablement ces gestes dans les habitudes et les réflexes des jeunes. Bien sûr, d’autres formations aux gestes de premiers secours existent, en particulier à l’initiative des pompiers ou encore d’associations telles que la Croix-Rouge ou la Fédération française de sauvetage et de secourisme, mais, malgré l’action que ces différentes structures ont engagée, cette sensibilisation aux premiers secours, loin de toucher les masses, n’est diffusée qu’auprès d’une part mineure de la population.
Cette proposition de loi, qui vise à étendre cette formation à la majorité de la population française, notamment aux jeunes, chez qui les accidents de la route sont la première cause de mortalité, est donc louable. Rappelons qu’en 2011 les 18-24 ans représentaient 22 % des tués sur la route.
Néanmoins, le groupe UDI s’interroge sur la pertinence de l’inclusion d’une telle formation dans l’évaluation du permis de conduire. En effet, tout d’abord, plus de 40 % des candidats échouant à leur premier passage de cet examen, l’ajout d’une évaluation sur les notions élémentaires de premier secours ne va-t-il pas rendre encore plus difficile l’obtention du permis de conduire ? Par ailleurs, cette nouvelle épreuve impliquerait d’embaucher de nouveaux formateurs et de mettre à disposition de ces derniers et des candidats des lieux spécifiques où enseigner et où passer les examens. Cela engendrerait des coûts supplémentaires, notamment pour les candidats, voire pour l’État, même si cette formation était, comme la proposition de loi le suggère, dispensée par l’intermédiaire des associations de secourisme déjà existantes et agréées. Or le coût final du permis de conduire s’élève en moyenne, aujourd’hui, à environ 1 400 euros.
Ces facteurs incitent, hélas, de plus en plus de Français à passer leur permis à l’étranger. La tentation est d’autant plus forte que le permis est pour beaucoup de travailleurs une nécessité, une condition préalable à l’obtention d’un premier emploi. En outre, de plus en plus, certaines personnes conduisent alors qu’elles n’ont pas le permis ou que leur permis a été suspendu. Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, environ 300 000 conducteurs auraient ainsi été dans l’illégalité en France en 2011.
Ces questions n’ont pas de lien direct avec la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, mais elles méritent d’être soulevées et, peut-être, débattues prochainement.
Pour en revenir à l’objet de ce texte, si intégrer cette formation dans l’examen du permis de conduire se révèle trop difficile, ne serait-il pas plus pertinent d’aménager une formation obligatoire de la même nature, dans le cadre des établissements scolaires par exemple ? Les collégiens sont appelés à obtenir durant la durée de leurs études leur attestation scolaire de sécurité routière. Il pourrait être envisagé de mener sur la même période la formation aux gestes de premiers secours, voire de l’inclure dans les conditions d’obtention de cette attestation. Une autre piste pourrait être de dispenser cette formation au secourisme au cours des années de lycée et de la sanctionner par une évaluation et l’obtention d’une attestation ou d’un diplôme.
Par ailleurs, il s’agit d’une mesure de nature réglementaire. La création d’une telle formation par le biais d’une proposition de loi n’est donc pas pertinente, même si l’objectif est louable.
Enfin, pour conclure, nous devons garder à l’esprit que le permis de conduire n’est pas un sésame à vie que l’on obtiendrait à dix-huit ans. Il n’est, en réalité, qu’une autorisation de conduire. Il ne constitue pas une garantie de sécurité, le taux de mortalité des jeunes conducteurs demeurant, hélas, très élevé.
Il est donc primordial que les titulaires du permis de conduire puissent prendre conscience des conséquences possibles d’une mauvaise conduite et se responsabiliser. C’est l’idée du continuum éducatif, formulée par la délégation à la sécurité et à la circulation routière : l’éducation à la sécurité routière se fait tout au long de la vie. Bien que la lutte contre la mortalité routière et la diminution du nombre de blessés graves constituent un enjeu capital et crucial et que l’intention de ce texte soit louable, pour l’ensemble des raisons évoquées, le groupe UDI s’abstiendra.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi fut l’occasion de riches débats et de diverses réflexions. Si les écologistes souscrivent à l’essentiel du contenu de ces considérations, l’examen de ce texte est l’occasion d’aborder un certain nombre de points positifs mais également de carences inquiétantes en France en matière de formation au secourisme.
Bien évidemment, et je pense que cela fait consensus, il est indispensable d’optimiser et d’encourager la formation de la population aux premiers secours. Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises lors des débats parlementaires, seuls 46 % des Français déclarent avoir bénéficié d’une formation aux gestes de première urgence. La France accuse ainsi un véritable retard dans ce domaine, puisque 95 % des Norvégiens et 80 % des Autrichiens ont bénéficié quant à eux d’une formation. L’enjeu est considérable : la Croix-Rouge française estime que 10 000 vies au moins pourraient être sauvées chaque année si la France se donnait les moyens de rattraper son retard. On ne rappellera jamais assez que, dans notre pays, les accidents de la vie courante provoquent chaque année 19 000 décès, principalement chez les enfants et les personnes les plus âgées. C’est la troisième cause de mortalité après les cancers et les maladies cardio-vasculaires.
Ces chiffres sont révélateurs de l’enjeu. Comme l’a déjà rappelé l’Académie nationale de médecine, le secourisme devrait être en réalité une véritable cause nationale. Les premières minutes qui suivent un accident sont en effet déterminantes pour réduire les conséquences de ce dernier. L’intervention du premier témoin, ou des premiers témoins, est cruciale pour la victime ; cet indispensable premier maillon de la chaîne de secours ne doit en aucun cas être sous-estimé. Le Centre d’analyse stratégique souligne notamment que, dans le cas d’un arrêt cardiaque, dispenser les bons gestes peut doubler, voire tripler, les chances de survie. Ce rôle vital est souligné par l’ensemble des publications internationales et spécialisées.
Ces différents éléments, rappelés par des institutions ou des associations, démontrent l’urgence d’une action ambitieuse en faveur de la formation aux premiers secours, et cela au-delà des simples automobilistes qui sont l’objet de la proposition de loi qui nous occupe aujourd’hui. L’école est certainement, à ce titre, le lieu le plus adapté pour dispenser ce type de formation, le secourisme étant par ailleurs une démarche de civisme et un formidable moyen de développer un esprit d’entre-aide et d’altruisme. Pour ces différentes raisons, les écologistes éprouvent le même regret que Catherine Troendle, qui rappelle dans son rapport pour le Sénat que seuls 20 % des élèves de troisième sont formés tous les ans, malgré l’existence d’un dispositif obligatoire de formation depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la loi du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité sociale. Être en capacité de former et de sensibiliser un nombre plus important d’élèves et de jeunes est un objectif prioritaire.
Par ailleurs, le groupe écologiste est convaincu que la formation aux gestes de secours devrait figurer, par étapes, tout au long de la scolarité. Comme le proposait mon collègue Paul Molac, le 11 octobre 2012 déjà, à l’occasion de débats relatifs à une proposition de loi visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident de la route, il suffirait de renforcer l’attestation scolaire de sécurité routière, obtenue au collège en cinquième et en troisième, qui est nécessaire pour se présenter au brevet de sécurité routière, puis au permis de conduire. Cette première approche pourrait ensuite être complétée au lycée. Nous aurions ainsi un parcours cohérent et articulé dans le temps. Un tel processus est d’ailleurs déjà mis en place dans la formation de certains établissements professionnels. Enfin, pour compléter le dispositif concernant les jeunes, la formation au secourisme lors de la journée défense et citoyenneté pourrait être également renforcée.
Nous devons également nous interroger sur la remise à niveau régulière des compétences acquises lors des formations ; vous avez raison, monsieur Habib : Les gestes de premiers secours nécessitent de la précision et de la réactivité, ce qui implique une mise à jour régulière des connaissances. Comment croire en effet que des personnes ayant bénéficié d’une formation pourraient encore maîtriser, des dizaines d’années plus tard, des gestes précis de manipulation sans une actualisation périodique ? L’école ou la formation au permis de conduire ne peuvent donc pas être les seuls lieux d’acquisition des compétences. L’intégration de la formation aux premiers secours dans les dispositifs de formation continue est donc essentielle afin que les personnes puissent bénéficier d’une formation tout au long de leur vie. Rappelons-le une nouvelle fois : si ce débat peut sembler peu passionnant, l’enjeu est considérable, c’est la survie de milliers d’êtres humains.
Le chemin à parcourir est donc encore long si nous souhaitons être exemplaires en termes de formation aux gestes de premiers secours. La mise en place d’une politique ambitieuse, cohérente et permettant aux individus d’être formés lors de toutes les grandes étapes de la vie est plus que jamais une impérieuse nécessité. Ce sujet est tout, absolument tout, sauf secondaire.
Nous regrettons que le texte qui nous est présenté aujourd’hui soit d’une portée limitée et assez modeste. Le groupe écologiste aurait été sensible à un texte qui permette de proposer des formations répondant à toutes les situations auxquelles les individus pourraient être confrontés et touchant un large public tout au long de la vie. Malgré tout, et en attendant la généralisation d’une formation destinée à l’ensemble des citoyens, cette proposition de loi va dans le bon sens. Le groupe écologiste le reconnaît, et il la votera donc.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous sommes amenés à discuter vise un objectif louable.
Au-delà de l’apprentissage de la conduite et du code de la route, c’est en effet de sécurité qu’il est question, de prévention et, pour ainsi dire, de vie. Objet de ce texte, la formation aux notions élémentaires de premiers secours dans le cadre de la préparation à l’obtention du permis de conduire apparaît, au premier abord, comme une idée intéressante.
Néanmoins, en l’état du texte issu des travaux du Sénat, mes interrogations initiales se sont muées en une certitude : Les dispositions de cette proposition de loi sont imparfaites et en décalage avec la formation à laquelle il est proposé de la raccrocher.
Il y a, à mon avis, trois raisons à cela.
La première est technique. Il faut bien en convenir, le processus d’apprentissage est déjà très long, trop long même. Aussi, y adjoindre un module supplémentaire pose sérieusement question. En pratique, dites-vous, monsieur le rapporteur, ce sont quatre heures qui seraient mobilisées. Nous devons donc intégrer dans notre réflexion cet aspect. Je tiens à rappeler que la préparation à l’examen du permis de conduire mobilise, avec les années, un temps de plus en plus important, de très longues semaines pour le dire simplement. Lorsqu’il faut repasser l’examen une ou deux fois, il n’est pas rare que le candidat n’obtienne le permis qu’au bout de deux ans, ce qui retarde d’autant la maîtrise d’une compétence indispensable à l’entrée dans la vie professionnelle. Disposons-nous de ce temps ? Je n’en suis pas sûre.
Ma seconde interrogation est d’ordre financier. Dans un contexte économique et social que chacun, ici, connaît, il me paraît difficile d’imaginer, compte tenu des contraintes financières des auto-écoles, que ces dernières acceptent de faire don de quelques heures de formation.
Ce n’est pas qu’elles ne le souhaiteraient pas, mais elles ne peuvent pas mobiliser leurs salariés pour cela sans menacer leur équilibre économique ; ne faisons pas semblant de l’ignorer. Le coût supplémentaire serait donc répercuté sur les élèves.
Chaque heure de formation doit être payée : il en découle un surenchérissement du coût du permis de conduire, qui est déjà extrêmement élevé pour les jeunes. Il en découle également une réorganisation pédagogique et matérielle des écoles de conduite.
Monsieur le rapporteur, vous avez dit lors des travaux de la commission des lois, que dans le cas où les auto-écoles ne seraient pas chargées de cette formation, la participation à la formation et sa validation pourraient être prises en charge par d’autres associations. Je veux bien prêter foi à vos propos, mais la question demeure : ces associations sont-elles capables d’assurer, chaque année, des milliers d’heures de formation ?
Au-delà du renchérissement du permis de conduire, il faut donc veiller à bien utiliser les moyens. Si nous nous engageons à mobiliser des ressources aussi colossales, utilisons-les pour aller au-delà d’un simple apprentissage des bases des premiers secours.
Cela m’amène, mes chers collègues, à vous faire part d’une troisième interrogation, qui touche à l’essence même de la formation aux premiers secours. Celle-ci doit bénéficier d’un nouvel élan, non seulement au moment de la formation initiale, mais aussi tout au long de la vie, car il est nécessaire d’entretenir ces acquis en permanence. Pour sauver encore plus de vies, nous devons nous saisir de cette question, et identifier les lieux d’apprentissage les plus propices pour chaque génération. Il peut s’agir des collèges, des lycées, des centres de formation d’apprentis ou des centres de formation continue. Donnons donc à la formation aux premiers secours ses lettres de noblesse en l’inscrivant dans le temps et le parcours de vie de nos concitoyens.
Mes chers collègues, je vous ai fait part de mes doutes sur la version de ce texte issue du Sénat. La réunion de la commission des lois du 4 juin dernier a permis, grâce à l’adoption des amendements proposés par le Gouvernement, de lever ces doutes et d’améliorer le texte, qui pourra ainsi être efficace et utile à la sécurité de nos concitoyens.
C’est le texte adopté le 4 juin dernier par la commission des lois qui emporte mon adhésion. C’est pourquoi le groupe socialiste invite à repousser les amendements de suppression déposés par M. le rapporteur…

…que nous avons examinés ce matin lors d’une réunion de la commission des lois tenue en application de l’article 88 du Règlement. Ces amendements, s’ils étaient adoptés, modifieraient en profondeur les dispositions de cette proposition de loi, et donc l’équilibre que nous avons réussi à trouver. Ils rendraient ce texte inadéquat. Comme je le disais en préambule, ces amendements mettraient les dispositions de cette proposition en décalage avec la formation à laquelle il est proposé de les raccrocher.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en l’état actuel du droit, la connaissance des gestes de premiers secours n’est ni enseignée ni évaluée dans le cadre de la préparation de l’examen du permis de conduire, même professionnel. L’objet de cette proposition de loi est de pallier cette carence et, d’une manière plus concrète, de contribuer à sauver des vies.
La moitié des victimes de la route décèdent en effet dans les minutes qui suivent l’accident. La survie des blessés les plus gravement atteints est donc liée à la rapidité de leur prise en charge par les services de secours. L’Organisation mondiale de la santé remarque ainsi, en 2005, que « même les systèmes de secours les plus sophistiqués et les mieux équipés ne peuvent pas grand-chose si les témoins sont incapables d’analyser le degré de gravité de la situation, n’appellent pas à l’aide et ne pratiquent pas les soins de base avant que les services de secours n’arrivent sur place. C’est encore plus manifeste dans les zones rurales. »
Le lien entre les témoins de l’accident et les services de secours est donc essentiel. Mais l’état de panique que peut susciter la survenance d’un accident conduit certains témoins à oublier les gestes essentiels qui consistent tout simplement à alerter les secours et à protéger le lieu de l’accident. En France, le niveau de formation aux premiers secours est faible et les dispositifs généraux de formation ne permettent pas de préparer efficacement les conducteurs à cette question. Aucune exigence de connaître les gestes de secourisme n’est imposée aux candidats au permis de conduire, même à ceux du permis de conduire professionnel.
Face à ce constat, de nombreuses initiatives parlementaires ont tenté de modifier l’état actuel du droit. La loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a ainsi créé une obligation de sensibilisation des candidats au permis de conduire à la formation aux premiers secours. Toutefois, en l’absence de décret d’application, cette obligation est restée lettre morte. Plusieurs propositions de loi ont été déposées afin d’imposer une formation pratique aux gestes de premiers secours lors du passage du permis de conduire. La dernière en date a été déposée le 23 août 2012 par notre excellent collègue Bernard Gérard, dont je salue la constance et l’engagement sur ce sujet, et qui est notre rapporteur aujourd’hui. Cette première proposition de loi a toutefois été rejetée le 11 octobre 2012.
Elle visait initialement à instaurer une troisième épreuve au permis de conduire, qui sanctionnerait une formation aux « notions élémentaires de premiers secours ». Cette formation était définie par le texte comme l’apprentissage de cinq gestes fondamentaux. Cette formulation posait deux types de difficultés pratiques.
En premier lieu, la création d’une épreuve supplémentaire spécifique est rapidement apparue comme impossible. D’une part, elle entraînerait nécessairement un surcoût, même faible, qui pèserait in fine sur les candidats au permis de conduire ; or le coût de la formation au permis de conduire est évalué en France à près de 1 500 euros, un montant qui se situe certes dans la moyenne européenne, mais qui reste très élevé. D’autre part, au regard des 900 000 candidats annuels, la création de cette épreuve saturerait les associations et les structures capables de délivrer cette formation. Elle conduirait nécessairement à un allongement très important du délai d’attente avant le passage du permis de conduire. Cela n’est pas envisageable, car on observe déjà une tendance à l’allongement de ce délai : de 86 jours d’attente en moyenne en 2012, il s’établit à environ 90 jours à 95 jours pour l’année 2013.
En second lieu, le fait de préciser dans la loi le contenu de la formation aux premiers secours était loin d’être évident. Les « cinq gestes qui sauvent » ont pu faire consensus au moment du lancement de ce programme dans les années 1970, mais aujourd’hui, il est préférable de laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir cette formation et de la faire évoluer en fonction des connaissances et des techniques nouvelles. Le Sénat a par conséquent adopté un amendement visant à reformuler l’article unique de la proposition de loi pour imposer non plus une épreuve spécifique, mais une formation obligatoire aux notions élémentaires de premiers secours en cas d’accident de la circulation. La connaissance des notions élémentaires des premiers secours sera bien évaluée, mais dans le cadre des épreuves existantes.
Cette rédaction simplifiée n’offre plus prise aux critiques relatives à l’ancienne version de la proposition de loi. Elle a été adoptée sans modification et à l’unanimité par le Sénat.

Dans la mesure où il n’existe plus d’obstacles juridiques et pratiques, il serait incompréhensible – j’en parlais avec Guillaume Larrivé il y a quelques instants – que cette proposition de loi ne soit pas adoptée par l’Assemblée nationale dans les mêmes termes que la version votée par le Sénat.

Dans ce contexte, les amendements rédactionnels adoptés en commission à l’instigation du Gouvernement n’apparaissent pas du tout pertinents. J’en appelle donc à la responsabilité de tous mes collègues ici présents pour que ce dispositif d’intérêt général, qui permettrait de sauver des vies, entre en vigueur le plus rapidement possible. Chers collègues, je vous invite donc à adopter la version du texte que nous a transmis le Sénat.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui est d’origine sénatoriale. Fortement inspirée par une proposition de loi de notre collègue Bernard Gérard, elle vise un objectif d’intérêt public, que chacun pourra saluer.
Au-delà des aspects pratiques – dispenser la connaissance des gestes de premier secours – ce texte a pour ambition de sauver davantage de vies. Les premières minutes sont en effet les plus déterminantes pour la survie d’une victime d’un accident de la route. Ce texte propose donc d’instaurer une formation aux notions élémentaires de premiers secours dans le cadre de la préparation à l’obtention du permis de conduire. Sur le principe, je ne pense pas que quiconque puisse y trouver à redire. Il s’agit dès lors d’examiner les modalités de mise en oeuvre de cette idée.
M. le rapporteur défend la version de ce texte issue des travaux du Sénat. Comme Marie-Anne Chapdelaine, je dois admettre que j’ai des doutes sur cette version de la proposition de loi. Ses dispositions sont perfectibles en plusieurs points. Je vous exposerai rapidement celles de mes interrogations que je veux apporter au débat.
Ma première interrogation est d’ordre institutionnel. Il m’apparaît toujours incongru que le législateur soit amené à légiférer pour contrebalancer le non-respect de la loi ! En effet, comme vous l’avez vous-même souligné en commission des lois, monsieur le rapporteur, il existe déjà un dispositif obligatoire de formation aux gestes de premiers secours à destination d’un public assez large. Le législateur a prévu une obligation de formation des élèves à l’attestation de prévention et de secours civique de niveau 1, attestation délivrée après une formation de sept heures, mais cette obligation est mal respectée : 20 % seulement des élèves de troisième seraient formés chaque année.
L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation dispose que « Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. » Cette proposition de loi revient donc à dire : « la loi n’est pas respectée, alors légiférons davantage ! ». Il me paraît hautement improbable que ce type de comportement, de la part du législateur, soit de nature à freiner l’inflation législative que l’on ne cesse de dénoncer par ailleurs, alourdissant d’autant de normes l’action aussi bien publique que privée dans notre pays.
Au-delà de cet aspect, il me semble que trois éléments doivent être soulevés dans le débat. Le premier est d’ordre technique : il s’agit de l’allongement du délai d’apprentissage que votre proposition ne manquera pas d’entraîner. Certes, ce délai d’apprentissage varie en fonction des candidats. Mais, lorsqu’un candidat doit repasser l’examen une ou deux fois, il n’est pas rare qu’il n’obtienne son permis de conduire qu’au bout de deux années, ce qui retarde d’autant la maîtrise d’une compétence aujourd’hui indispensable à l’entrée dans la vie professionnelle, particulièrement pour les territoires faiblement pourvus en réseaux de transport public. En pratique, quatre heures de plus seraient mobilisées au cours de la formation des candidats. Il est heureux que la version du texte qui nous est soumise ne prévoie plus de module spécifique, comme cela a été le cas un temps. Nous devons donc intégrer cet aspect dans notre réflexion.
Je souhaite soumettre un deuxième élément, d’ordre financier, à notre réflexion. Dans le contexte actuel, il est légitime de se demander comment seront répartis les coûts que cette nouvelle formation ne manquera pas d’engendrer. Chaque heure de formation doit être payée. Par qui ? L’auto-école ? Compte tenu des contraintes financières de certaines auto-écoles et du cadre très contraint dans lequel elles évoluent, cette hypothèse ne manquerait pas de soulever des difficultés qui pourraient remettre en cause les équilibres économiques actuels – je pense notamment aux petites structures, particulièrement en milieu rural ou périurbain, qui n’ont pas forcément les moyens de mettre en place ces formations. Quand bien même cette solution serait retenue, il y a fort à parier que les coûts induits seraient réintégrés dans les prix des auto-écoles et payés in fine par les élèves. Un renchérissement du coût du permis de conduire, déjà extrêmement élevé, notamment pour les jeunes, ne saurait être acceptable. Ce point a d’ailleurs été soulevé par les sénateurs ; certains d’entre eux ont estimé que le surcoût serait de l’ordre de 25 euros.
Lors de l’examen de ce texte par la commission des lois, vous avez suggéré, monsieur le rapporteur, que les associations de secourisme pourraient participer à la formation et à sa validation. Chacun appréciera la valeur de cette idée ; je m’interroge néanmoins sur ses conséquences financières, sans compter les difficultés d’ordre logistique et humain et les potentielles inégalités territoriales. Les dispositions de cette proposition de loi ne permettent pas de répondre à ces questions.
Troisième et dernier élément : nous devons adopter une vision globale de la question qui nous est posée. Comme je l’indiquais au début de mon intervention, il s’agit de préserver la vie de nos concitoyens autant que faire se peut ; l’enseignement des gestes de premiers secours y participe évidemment. Que les auto-écoles puissent être un lieu de formation est une bonne idée, sous réserve que les modalités de cette formation soient bien définies. Nous devons cependant aller plus loin pour garantir l’efficacité de cette formation. Ne devrions-nous pas adopter un dispositif qui permette à chacun, au-delà de la formation initiale, de bénéficier tout au long de sa vie de rappels réguliers, afin que la connaissance et la pratique des gestes de premiers secours soient les plus efficaces possibles ?
Telles sont, mes chers collègues, mes interrogations.
Le travail que nous avons accompli ensemble en commission a abouti à un dispositif plus clair et plus simple. Je souhaite donc que cette proposition de loi poursuive son chemin dans la procédure parlementaire, et je vous invite à la voter dans sa version adoptée par la commission des lois le 4 juin dernier, version enrichie par les amendements du Gouvernement.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

La discussion générale est close.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
La discussion générale a permis de dégager un certain nombre de points de consensus.
D’abord, nous nous accordons sur le constat des carences de la formation aux premiers secours : ces carences concernent à la fois le contenu de la formation et le nombre de personnes qui la suivent. En cherchant à remédier à cette carence par le biais d’une formation réduite aux principaux gestes, incluse dans l’examen du permis de conduire, nous risquons de ne pas développer le contenu de la formation aux premiers secours en même temps que l’accès à cette formation. C’est la crainte du Gouvernement. Pour cette raison, nous pensons que les dispositions issues des amendements gouvernementaux adoptés en commission des lois doivent être maintenues.
Ensuite, la priorité actuelle du Gouvernement est de réduire le coût du permis de conduire ainsi que les délais de passage de l’examen.
Dans ces conditions, la volonté, partagée par l’ensemble de l’hémicycle, de proposer une formation aux premiers secours doit s’inscrire dans le cadre d’une réforme visant à réduire les délais et les coûts, afin de rendre le permis accessible au plus grand nombre le plus rapidement possible, dans une perspective de justice sociale.

J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles de la proposition de loi.

La parole est à M. Bernard Gérard, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 2 .

Cet amendement a pour objet de compléter l’alinéa 2 par les mots : « en cas d’accident de la circulation ». Cette précision avait été supprimée par un amendement du Gouvernement.
Or, contrairement à ce qui a été dit, il est extrêmement important de préciser que les gestes qui sauvent sont, en matière d’accidents de la route, vraiment spécifiques : alerter les secours ne se fait pas de la même manière chez soi ou sur la route et baliser les lieux dans le cadre d’un accident de la route requiert une compétence particulière.
Il était donc tout à fait utile et intelligent de préciser que certains gestes de premiers secours étaient essentiels en cas d’accidents de la route. De surcroît, cela avait également un effet pédagogique, en incitant les conducteurs à adopter la conduite apaisée que nous appelons de nos voeux, compte tenu de l’importance et du nombre des accidents de la route.
Le Gouvernement demeure défavorable à une mesure qui consisterait à distinguer, parmi les notions de secourisme, celles qui s’appliquent au contexte particulier des accidents de la circulation. De fait, l’ensemble des mesures, des gestes et actions relevant d’une action de secourisme sont liés exclusivement à une analyse type de la situation à laquelle le secouriste est confronté.
De celle-ci découle la mise en oeuvre des notions élémentaires de secourisme adaptées à la symptomatologie de la victime. Telle est la philosophie qui prévaut dans l’enseignement général d’une discipline de ce type. Le choix qui a été fait, au niveau national, est de sensibiliser un nombre de plus en plus important de citoyens au domaine du secourisme, car tout le monde doit être acteur de sa propre sécurité.
C’est ainsi que des actions sont effectuées dans le cadre de l’éducation nationale, au sein des établissements scolaires ou encore, comme cela a été évoqué, lors de la Journée défense et citoyenneté. Les jeunes sont sensibilisés à la mise en oeuvre des notions élémentaires de secourisme. Le choix qui a été fait est bien de centrer cette sensibilisation au secourisme sur des actions générales.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L’amendement no 2 n’est pas adopté.

La parole est à M. Bernard Gérard, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1 .

Mon amendement vise à insérer, à l’alinéa 3, les mots : « théorique et pratique aux gestes de survie que constituent l’alerte des secours, la protection des lieux et le traitement de la détresse respiratoire et des hémorragies ».
La rédaction retenue par la commission des lois impose dorénavant que les candidats à l’examen du permis de conduire soient formés aux notions élémentaires de premiers secours. Le contenu de cette formation devant être fixée par voie réglementaire, il y a toutefois lieu d’en préciser le cadre général, c’est-à-dire de définir ce que l’on entend par « notions élémentaires de premiers secours ».
Les futurs programmes des épreuves des différents permis de conduire, qui devront être mis en conformité avec le nouveau référentiel, devront ainsi comporter l’apprentissage de ces notions.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Je saisis cette occasion pour préciser les mesures réglementaires, comme vous le souhaitiez tout à l’heure.
Le groupe de travail sur les délais d’attente aux épreuves du permis de conduire a récemment remis ses conclusions au ministre de l’intérieur, qui va prochainement annoncer des mesures pour mettre en oeuvre la réforme du permis de conduire annoncée par le Président de la République lors de son déplacement à Villiers-le-Bel, notamment pour rendre le permis plus accessible.
Dans ce contexte, le Gouvernement veillera à ne pas allonger les délais de formation ou réduire l’accessibilité du permis de conduire, quelle que soit la pertinence des intentions.
Au demeurant, les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ne sont pas habilités à dispenser des formations de secourisme, car ils n’en ont pas les compétences. Inscrire dans la loi, comme vous le proposez, une formation à des gestes de survie relatifs au traitement de la détresse respiratoire et des hémorragies supposerait donc de recourir à des intervenants extérieurs ou de former les enseignants de la conduite à ces gestes. Dans les deux cas, l’impact économique de la mesure n’est pas sans conséquence pour les candidats.
Au reste, les autorités médicales sont extrêmement partagées quant à l’opportunité de favoriser ce type d’intervention, dont les effets aggravent même parfois la situation de la victime.
En revanche, il est possible et souhaitable, dans le cadre de l’apprentissage de la conduite, de transmettre aux élèves des comportements simples à observer en cas d’accident de la circulation.
Ces comportements sont, pour l’essentiel, les suivants : savoir protéger les lieux d’accident, transmettre un message aux secours et évaluer sa compétence à accomplir un geste de secours si, et seulement si, on a été formé à cette fin.
Le nouveau programme de formation, le référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne, qui entre en vigueur le 1er juillet 2014, met l’accent sur la transmission de ces compétences. La vérification de leur assimilation pourra s’effectuer dans le cadre du permis de conduire, aussi bien au niveau du code que de l’épreuve pratique. Tel est le dispositif privilégié par le Gouvernement, qui peut, en outre, faire l’objet d’une mise en oeuvre très rapide.
Aller plus loin dans l’enseignement des gestes de secourisme pose non seulement la question de l’impact sur le coût de la formation, mais suppose surtout au préalable de recueillir l’avis des experts pour, si cela est possible, obtenir un consensus sur l’intérêt et l’innocuité de l’enseignement de tels gestes.
Ce débat pourrait parfaitement se tenir dans le cadre du conseil national de la sécurité routière, dont la commission « jeunes et éducation routière » s’est déjà emparée du sujet.
Sous réserve de l’accord du président du conseil national de la sécurité routière, M. Armand Jung, les parlementaires intéressés pourraient utilement être associés à ces débats. Le Gouvernement s’appuiera sur les conclusions du CNSR pour enrichir le contenu de la formation.

Madame la ministre, je voudrais vous poser une question, car il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lors de l’examen du texte au Sénat, le Gouvernement a fait connaître son souhait de voir la loi issue des travaux parlementaires entrer en vigueur dès cet été.
On comprend bien pourquoi : la circulation est beaucoup plus intense en été, et il est bon de prendre toutes les mesures permettant d’améliorer la prévention des accidents et des drames qu’ils provoquent.
Le Gouvernement a exprimé ce souhait au moment de l’adoption du texte par le Sénat. Aujourd’hui, vous persistez à vouloir maintenir les modifications que vous avez proposées à la commission et qu’elle a adoptées.
Ma question est simple : comment le Gouvernement va-t-il tenir l’engagement, pris devant le Sénat, de mettre en application dès cet été la présente proposition de loi, qui deviendra alors une loi de la République ?
L’amendement no 1 n’est pas adopté.

La parole est à M. Bernard Gérard, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 3 .

La situation est vraiment paradoxale, car le présent amendement a été adopté ce matin, lors d’une réunion de la commission tenue en application de l’article 88. C’est un rappel utile. Ainsi, le texte a été adopté à l’unanimité par le Sénat, modifié en commission des lois, puis rétabli dans sa rédaction initiale grâce à l’application de l’article 88, mais nous continuons de tergiverser, alors même que personne n’a émis aucun doute sur ce texte. M. Vallini lui-même a pris l’engagement de l’appliquer très rapidement.
Pour en finir avec ces arguties juridiques, le présent amendement vise à substituer aux mots « fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’examen du permis de conduire » les mots : « est sanctionné dans le cadre du permis de conduire », qui figuraient dans la rédaction initiale.
Vous ne faites que jouer sur les mots, en expliquant que le mot « sanctionner », terme terrible, va peut-être perturber nos jeunes amis qui passent le permis de conduire. Mais c’est du français ! Cela signifie que le passage de l’examen est approuvé officiellement, sur une base légale. Je ne vois pas en quoi ce terme pose problème, sauf à vouloir retarder les choses.
Votre rédaction est donc de pure forme et vient compliquer inutilement un texte que tout le monde attend de voir appliquer car des vies humaines sont en cause.
Avis défavorable. Je souhaite répondre à l’interpellation de M. Guy Geoffroy. Comme je l’ai dit tout à l’heure, le Gouvernement partage le constat de l’insuffisance du contenu et des difficultés d’accès à la formation aux premiers secours.
De surcroît, le Gouvernement est perplexe sur le dispositif consistant à cibler certains gestes dans le cadre d’une formation : ceux qui l’auraient suivi pourraient penser qu’il s’agit réellement d’une formation aux premiers secours, alors que, en réalité, elle n’en est pas une.
Comme je l’ai dit à l’instant, les professionnels et les médecins s’interrogent sur la pertinence d’une disposition amenant les conducteurs à croire qu’ils sont devenus subitement des secouristes, alors qu’ils ont juste appris quelques gestes.
Enfin, comme je l’ai dit à l’instant, le Gouvernement annoncera rapidement aux Français des mesures concernant la réduction des délais et du coût du permis de conduire. Nous assumons tout à fait cette position devant les Français. Ce sera l’occasion de préciser la place que prendra le sujet de l’accès au secourisme dans l’ensemble des formations.

Je remercie Mme la ministre d’avoir accepté d’apporter une réponse, mais je me vois contraint de lui dire qu’elle est insatisfaisante. Il n’existe qu’un seul gouvernement. Certes, il peut être représenté par un ministre au Sénat et par un autre à l’Assemblée nationale, lors de l’examen d’un même texte. Mais il s’agit bien du même gouvernement !
Or, aujourd’hui, le Gouvernement tient un propos complètement différent de celui tenu par son représentant lors de l’examen du texte au Sénat. Il avait alors pris l’engagement que le texte, voté à l’unanimité, serait mis en application dès cet été. Aujourd’hui, vous nous dites que cela ne sera pas le cas. Je prends acte du fait que le Gouvernement a changé d’opinion sur ce point.
L’amendement no 3 n’est pas adopté.
L’article 1 est adopté.

La parole est à M. Bernard Gérard, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 4 , qui vise à supprimer l’article.

Cet article est vraiment incompréhensible ; je souhaite donc le supprimer. En 2002, le Président de la République, M. Jacques Chirac, a fait de la sécurité routière l’une des priorités du quinquennat. Celui-ci a été marqué, en particulier, par l’adoption de la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.
L’article 16 de cette loi prévoit que « les candidats au permis de conduire sont sensibilisés [… ] aux notions élémentaires de premiers secours » dans le cadre de leur formation, et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ses modalités d’application.
Cet article était vraiment consensuel : il avait été issu de l’adoption d’amendements défendus par le député du Nord Patrick Delnatte, l’un de mes prédécesseurs, Francis Vercamer, membre du groupe UDI, Patrice Martin-Lalande, et René Dosière. Il y avait donc une unanimité pour le soutenir. Cependant, depuis 2003, aucun décret d’application n’a été publié, et ce n’est pas faute de temps !
Dans le cadre de la préparation de ce dossier, j’ai rencontré le délégué à la sécurité routière, qui m’a dit qu’un décret d’application était actuellement soumis au Conseil d’État – au bout de treize années. Et vous proposez maintenant de supprimer l’article 16 de la loi de 2003 ! C’est incompréhensible !
Je souhaite donc supprimer l’article 2. Je ne vois pas pourquoi nous devrions supprimer la seule oeuvre législative existante sur le permis de conduire.
Cela me donne l’occasion de répondre à l’argument qui m’a été opposé tout à l’heure, selon lequel nous ne devrions pas discuter de dispositions d’ordre réglementaire. Franchement, après avoir attendu pendant treize ans les décrets d’applications, il est du rôle du législateur de combler les carences du pouvoir réglementaire. Tel est l’objet du présent amendement.
L’article 16 de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière dispose que : « Les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de premiers secours. » Lors des débats à l’Assemblée nationale qui avaient conduit au rejet de la proposition de loi de Bernard Gérard visant à former aux cinq gestes qui sauvent face à un accident de la route lors de la préparation des permis de conduire, le précédent ministre de l’intérieur avait pris l’engagement de prendre le décret d’application de cette disposition.
C’est là le projet de décret sur lequel travaille la délégation à la sécurité et à la circulation routière et qui devrait être prochainement transmis au Conseil d’État. Le dernier alinéa de l’article L. 221-3 du code de la route dans sa rédaction issue de l’article 1er de la proposition de loi contient également un renvoi à la voie réglementaire.
Le texte de la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui, tel qu’il a été modifié par le Sénat, vise le même objectif que l’article 16 de la loi de 2003 tout en le renforçant. Si cette proposition de loi devait être adoptée, cela constituerait un doublon incompréhensible et contraire à l’objectif de lisibilité et de simplification du droit. L’abrogation de cet article est donc nécessaire pour clarifier la base législative des futurs textes d’application.
L’amendement no 4 n’est pas adopté.
L’article 2 est adopté.
(La proposition de loi est adoptée.

la proposition est adoptée à l’unanimité.(Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Vote sur l’ensemble
La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt-cinq.


La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie.
Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les députés, la protection de l’enfance, au sens de la convention internationale des droits de l’enfant adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1959, consiste à « assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui ».
Les États parties à la convention, dont la France, se sont engagés à veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que cette séparation ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’enfant.
Sous les auspices de la convention internationale des droits de l’enfant, la protection de l’enfance est une question délicate. La loi du 5 mars 2007, adoptée à l’unanimité, est pour nous un socle précieux. Modifier le régime juridique de la protection de l’enfance ne peut donc, je crois, se faire qu’avec prudence et dans le plus large consensus possible. Je ne pense pas que la proposition de loi discutée aujourd’hui réunisse ces critères. Le raisonnement poursuivi par les auteurs en première lecture peut paraître, à première vue, relever du bon sens.
Il ne résiste cependant pas à la confrontation à la réalité, celle de l’état du droit, du quotidien de l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance et, enfin, de l’intérêt de l’enfant.
C’est à travers ces réalités concrètes que je vous invite à envisager cette proposition de loi.
Aujourd’hui, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, de ne pas verser les allocations familiales au service de l’aide sociale à l’enfance – l’ASE – lorsque la famille participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou qu’il s’agit de faciliter le retour de l’enfant dans sa famille. Les allocations, relevant de la décision du juge, peuvent être ainsi une aide à la famille mais aussi un outil de responsabilisation.
De fait, lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, les parents conservent l’autorité parentale. Ils en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec le placement et disposent d’un droit de visite, voire d’hébergement. Dans de nombreux cas, et le juge est là pour tenir compte de ces situations, l’enfant confié revient en effet régulièrement chez ses parents, lesquels, tenus à l’obligation alimentaire, continuent d’engager des dépenses pour son entretien et son éducation.
Le placement, loin d’être permanent, est le plus souvent temporaire : il est prévu seulement pour deux ans, renouvelables, et 95 % des enfants placés ont vocation à revenir dans leur famille.
La CNAF comptabilise 50 941 familles dont l’un des enfants au moins est confié à l’aide sociale à l’enfance. Parmi ces familles, 27 945 d’entre elles maintiennent des liens affectifs avec les enfants et continuent de percevoir pour eux la totalité des prestations, y compris les allocations familiales, sur décision du juge des enfants ; 18 460 maintiennent des liens affectifs avec ces enfants et ne perçoivent plus les allocations familiales ; 4 536 ne maintiennent pas de liens affectifs et ne perçoivent plus les allocations familiales.
Ces statistiques montrent que les juges jouent bien leur rôle : ils attribuent les allocations familiales en fonction de la situation, au cas par cas. On ne peut donc affirmer que l’esprit de la loi n’est pas respecté.
Le versement des allocations permet à nombreux parents de participer effectivement à la prise en charge morale et matérielle de leur enfant et de préserver l’équilibre souvent fragile de la famille. Supprimer les allocations aboutirait alors à compromettre le paiement du loyer, des transports pour les visites, voire les repas de l’enfant passant un week-end au sein de son foyer.
Une grande partie des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance viennent en effet de familles en grande précarité économique, et le retrait systématique, ou encadré de manière excessive, sans contrôle réel et entier du juge, aboutirait inévitablement à empêcher tout maintien du lien entre les enfants et leur famille.
La défenseure des enfants, dans son rapport intitulé « Précarité et protection des droits de l’enfant », a rappelé la nécessité que les familles puissent disposer de ressources suffisantes pour maintenir des liens lors des rencontres avec leurs enfants. Elle a aussi appelé à continuer de mettre en oeuvre pleinement les principes de prévention et d’innovation de la loi du 5 mars 2007.
Le raisonnement des auteurs de la proposition de loi ne soutient ainsi pas la confrontation aux arguments de fait. Les deux articles de la proposition partent d’un diagnostic erroné et ne viennent que compliquer la tâche des juges.
L’article 1er de la proposition de loi introduit une limitation au maintien du versement aux familles à hauteur de 35 % du montant des allocations familiales. Il restreindrait le pouvoir d’appréciation du juge, contraint par ce seuil maximal, alors que les allocations familiales constituent, selon l’expression de l’association française des magistrats de la jeunesse et de la famille « un instrument de politique judiciaire » indispensable au travail de pédagogie que mène le juge avec les parents dans le but de remédier à leurs défaillances et de permettre, si les conditions sont réunies, un retour de l’enfant dans sa famille.
Le dispositif proposé à l’article 2 concernant l’allocation de rentrée scolaire viserait, lui, à supprimer, cette fois systématiquement, la marge d’appréciation du juge pour évaluer la pertinence du maintien de cette allocation.
Pour conclure, la protection de l’enfance est un sujet complexe. On ne peut agir dans l’intérêt de l’enfant qu’en tenant compte des réalités de chaque famille, en travaillant au cas par cas et en tenant compte de l’ensemble des adultes qui contribuent, autour de l’enfant, à établir des liens.
La protection de l’enfance nécessite des mesures de responsabilisation, de contrôle et d’encadrement. C’est le rôle des juges, en lien avec les services de l’aide sociale à l’enfance. Les juges des enfants prennent leur décision au cas par cas, au vu des éléments d’information émanant des services sociaux éducatifs dont ils disposent sur l’enfant et la situation de la famille.
N’ajoutons pas des normes aux normes, ne complexifions pas des dispositifs existants. Le dispositif actuel est équilibré au sens de la protection de l’enfance et c’est par ce seul prisme qu’il convient d’étudier la proposition de loi qui est soumise aujourd’hui à votre examen.
Nous sommes à la recherche constante d’un équilibre entre la protection de l’enfant, le respect de son intérêt et les droits et devoirs des parents. Si l’enfant est un sujet de droit, il nous faut construire une protection de l’enfance qui se traduise concrètement dans les politiques publiques menées sur les territoires.
L’enfance est une période majeure pour toute personne, et il nous appartient de mobiliser toutes nos compétences. J’en ai fait un axe prioritaire de mon ministère. Je n’ai donc pas pour projet de ne rien retoucher au régime législatif de la protection de l’enfance, mais je vous invite à le faire sereinement, dans le consensus et dans un cadre global qui ne peut être celui de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.

La parole est à M. Gilles Lurton, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a été rejetée la semaine dernière par la commission des affaires sociales à l’issue d’un débat animé, voire houleux, pendant lequel, à mon grand regret, il a été impossible de faire émerger un consensus.
Quel contraste avec les débats qui ont eu lieu au Sénat et qui ont permis une collaboration fructueuse entre les groupes UMP et socialiste sur la prise en charge des enfants confiés par le juge au service de l’aide sociale à l’enfance !
Quel contraste aussi entre le discours tenu ici, à l’Assemblée nationale, et la réalité quotidienne du terrain vécue principalement par les conseils généraux. N’est-ce pas le Président de la République lui-même, qui, le 22 octobre 2012, a exprimé à Claudy Le Breton sa bienveillance sur ce sujet ?
Cette réalité quotidienne, le Sénat dans son immense majorité en a pris conscience : une proposition, déposée à l’initiative de Christophe Béchu et de Catherine Déroche, a ensuite été modifiée en commission et reprend, in fine, les dispositions d’une proposition de loi socialiste déposée par le sénateur Yves Daudigny.
Cette prise de conscience, madame la ministre, repose sur un principe : les allocations familiales, et c’est bien leur objet, doivent permettre de subvenir aux besoins des enfants pour qui elles sont versées, et elles ne sauraient avoir d’autre vocation. C’est le sens même de l’article L. 521-2 du code de la Sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. »
Quand le juge décide d’un acte aussi fort que celui de retirer un enfant à sa famille pour le confier à l’aide sociale à l’enfance, c’est inévitablement qu’il existe un problème grave et que toutes les mesures sociales proposées en amont ont échoué. Il est donc essentiel de se poser la question du financement de la prise en charge de ces enfants.
Cet aspect du problème ne peut pas être balayé d’un simple revers de la main comme une préoccupation mesquine des conseils généraux alors que l’état de nos finances publiques est en permanence au coeur de nos débats.
J’ai entendu dire qu’il s’agissait de sommes dérisoires et que le Sénat aurait légiféré sans connaître la réalité des chiffres. Je peux néanmoins répondre que, d’après les données qui m’ont été transmises par la Caisse nationale d’allocations familiales, il s’agirait, au bas mot, de 2,5 millions d’euros par mois.
Au-delà des chiffres, est-il normal d’accepter que ces sommes puissent être utilisées par des parents défaillants, même si ces derniers ne sont pas nécessairement maltraitants, à d’autres fins que le bien-être des enfants auxquels elles sont pourtant destinées ? C’est bien là l’enjeu des débats que nous avons aujourd’hui et je regrette les caricatures qui en ont été faites.
En taxant cette proposition de loi de texte moralisateur, culpabilisant et stigmatisant pour les familles, votre majorité va à l’encontre du principe du versement des allocations familiales au service de l’aide sociale à l’enfance, principe introduit dans le code de la Sécurité sociale par une loi de 1986 présentée à l’époque par le gouvernement de M. Laurent Fabius. Les auteurs de la proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui, Christophe Béchu et Catherine Deroche, ne sont donc pas à l’origine de cette disposition. Bien au contraire, ils ont cherché à revenir à l’esprit initial du texte, pour lequel le maintien du versement des allocations familiales à la famille doit être une exception.
Nier ce principe, c’est sous-estimer l’importance, notamment symbolique, que représente la décision de maintien ou de retrait prise par le juge. Cette décision, je l’ai dit, intervient dans un contexte conflictuel, où l’enfant est considéré comme en danger et où le juge doit trouver les moyens d’imposer ses exigences à la famille en vue d’un retour le plus rapide possible de l’enfant dans son foyer.
Tel est, mes chers collègues, l’intérêt supérieur de l’enfant, celui qui m’a guidé dans toute ma réflexion. Protéger l’enfant et rechercher toutes les conditions pour lui permettre un retour au foyer, ce doit rester notre objectif ultime.
Il n’est donc pas question, comme je l’ai entendu, de punir les familles. Il est simplement question de trouver un juste équilibre entre un principe et une exception, entre juste allocation des ressources et préservation des liens familiaux, dans l’intérêt de l’enfant.
Je suis d’ailleurs convaincu que le maintien des liens matériels et affectifs entre la famille et l’enfant placé reste primordial. Le maintien des allocations familiales pour des ménages souvent en situation de grande précarité peut contribuer au maintien de ces liens, en permettant d’organiser un accueil temporaire, de participer à l’entretien de l’enfant, de garder tout simplement le budget familial à flot. C’est un fait incontestable.
Est-il pour autant dans l’intérêt de l’enfant que, dans la majorité des cas, 55 % pour être précis, la part des allocations familiales qui lui sont destinées soit maintenue au bénéfice de la famille sans aucun contrôle, la plupart du temps, sur leur utilisation ?
Les juges le reconnaissent eux-mêmes : si les allocations familiales constituent généralement un outil de négociation avec les familles lors du placement, la question de leur maintien ou de leur retrait n’est pas posée de façon systématique. La présidente de l’association française des magistrats de l’enfance et de la famille estime que les juges s’intéressent rarement à la gestion concrète des sommes ainsi laissées à la famille et ordonnent très peu de mesures d’aide à la gestion du budget familial.
Dans ce contexte, il est logique que les conseils généraux fassent valoir qu’ils pourraient, quant à eux, mettre à profit ces sommes pour des dépenses concrètes en faveur des enfants placés, avec, par exemple, une revalorisation des frais d’habillement ou de loisirs alloués aux familles d’accueil.
Il en est de même pour l’allocation de rentrée scolaire, qui, aujourd’hui, je le rappelle, est systématiquement versée aux familles, sauf dans une minorité de cas où les caisses d’allocations familiales, alertées par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’absence de tout lien affectif ou matériel entre les parents et l’enfant, en suspendent le versement.

Cela représente une économie avoisinant tout juste les 45 000 euros annuels. Il m’apparaît dès lors nécessaire de rétablir un équilibre qui, aujourd’hui, n’est plus assuré.

C’est à cet équilibre que je me suis efforcé de parvenir en soumettant à la commission des propositions susceptibles d’aboutir à un texte juste et opérationnel.
Pour parvenir à cet objectif, j’ai souhaité apporter à la proposition de loi issue du Sénat quelques modifications, d’une part, sur l’automaticité de la réduction à 35 % au plus de la part des allocations familiales versée à la famille au-delà des trois premiers mois de placement, et la même automaticité du versement à l’aide sociale à l’enfance de l’allocation de rentrée scolaire, et, d’autre part, sur l’impossibilité pour le juge de maintenir l’intégralité des allocations familiales, y compris pendant la première période d’observation de trois mois, prévue par un amendement du sénateur Yves Daudigny.
Le texte repose, en outre, s’agissant des allocations familiales, sur un mécanisme complexe et potentiellement coûteux à mettre en oeuvre, que ce soit pour l’administration de la justice ou pour les caisses d’allocations familiales. C’est ce qui m’a conduit à proposer à la commission des affaires sociales un certain nombre d’amendements susceptibles de nous permettre d’aboutir à un texte acceptable par tous.
Pour les allocations familiales, je propose tout d’abord de fixer à six mois la période d’observation, afin que sa fin coïncide avec une audience déjà programmée par le juge, ensuite, de permettre le maintien total ou la suppression complète des allocations familiales à la famille pendant ces six premiers mois et, enfin, de prévoir un réexamen de la situation à six mois et de donner au juge la possibilité de maintenir ou de supprimer les allocations à la famille, ou encore de décider de les répartir entre la famille et le service d’aide sociale à l’enfance sur la base d’un taux fixe.
J’avais proposé en commission de conserver le ratio initialement introduit par le Sénat, de 35 % pour la famille et de 65 % pour l’aide sociale à l’enfance, tout en étant ouvert sur la détermination d’un ou de plusieurs autres taux. Je proposerai, par voie d’amendement, que cette question soit tranchée par décret.
Quant à l’allocation de rentrée scolaire, il m’a semblé plus logique de revenir à l’esprit de la proposition de loi initiale de M. Béchu et Mme Deroche, qui renvoyait, comme pour les allocations familiales, à une décision du juge. L’automaticité d’un versement à l’ASE ne semble pas non plus se justifier dans la mesure où elle ne permet pas de tenir compte de l’implication de la famille dans le maintien des liens avec l’enfant.
Ces amendements ont cependant tous été rejetés en commission, en raison, essentiellement, de l’opposition de la majorité au texte qui nous était initialement soumis.
J’ai pourtant entendu dire, et ce pas plus tard qu’hier, lors de l’audition d’ATD Quart Monde, qu’il serait utile dans certains cas de permettre au juge de moduler la part des allocations familiales revenant à la famille et de répartir les sommes en question entre celle-ci et l’aide sociale à l’enfance.

J’ai relu, ce matin même, l’avis de la Défenseure des enfants, qui considère qu’il serait opportun de rappeler la possibilité pour le juge d’assortir sa décision concernant le versement des allocations familiales aux parents d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial, mesure éducative insuffisamment prononcée à l’heure actuelle et pourtant prévue à l’article 375-1-9 du code civil.
Comme à chaque fois que vous ne voulez pas adopter un texte de l’opposition, votre majorité propose de le renvoyer à un texte ultérieur. Cela a encore été le cas récemment lors de l’examen de la proposition de loi sur l’autorité parentale, au cours duquel, sur un amendement déposé par ma collègue Marie-Christine Dalloz, Mme Chapdelaine, tout en reconnaissant la réalité du problème, l’a renvoyé à l’examen de cette proposition.
Je serai pour ma part cohérent avec la position que j’ai défendue en commission et défendrai de nouveau devant vous, Mme la secrétaire d’État, mes chers collègues, la plupart des amendements précédemment déposés, sous réserve de quelques améliorations résultant des remarques émises par mes collègues lors du débat en commission.
En conclusion, je voudrais rappeler que le texte qui nous est soumis aujourd’hui a été adopté à la quasi-unanimité du Sénat, avec 329 voix pour, dont 123 du groupe socialiste, y compris la vôtre, madame la secrétaire d’État, et seulement seize voix contre. Ces chiffres relèvent d’un constat partagé : « Les prestations familiales doivent permettre de subvenir aux besoins des enfants pour qui elles sont versées. Les objectifs sont la cohérence et l’équité. Le sujet n’est pas de donner aux départements quelques ressources complémentaires, il n’est pas non plus de sanctionner, il relève d’une meilleure justice sociale. » Ces propos ne sont pas de moi, mais de notre collègue sénateur socialiste, membre de la majorité gouvernementale, Yves Daudigny.

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est temps que le Parlement s’attache à corriger une situation scandaleuse et inéquitable. Dans notre pays, un peu moins de 150 000 enfants sont placés dans les services de l’aide sociale à l’enfance, gérés par les conseils généraux. Pour ces enfants, les départements prennent le relais des familles, totalement,…

…et assument, en lieu et place des parents, l’ensemble des responsabilités et des frais liés à l’exercice de la parentalité.

Les dépenses sociales des conseils généraux consacrées à la famille et à l’enfance sont très élevées et en constante progression ; elles nous imposent une gestion plus efficiente. En effet, elles représentent le troisième poste de l’action sociale départementale, en moyenne nationale. La croissance de ces dépenses est particulièrement soutenue depuis quelques années, reflétant le coût de l’ensemble des actions menées par les services départementaux d’aide sociale à l’enfance.
Cette proposition de loi soulève la question du bénéficiaire des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire lorsque l’enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance sur décision du juge. Les conseils généraux paient les établissements scolaires et les familles d’accueil qui les reçoivent, financent les frais de scolarité, les déplacements, les activités culturelles ou sportives, les vêtements, la cantine, et j’en passe. Pourtant, alors que les familles n’ont plus aucune charge, elles continuent, dans leur immense majorité – 85 à 90 % des cas –, de percevoir la totalité des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire.
L’article L. 521-2 du code de la Sécurité sociale est très clair : il dispose que la part des allocations familiales due à la famille pour un enfant confié au service d’aide sociale à l’enfance est versée à ce service. C’est la loi.

Depuis l’entrée en vigueur du décret 86-838 du 6 juillet 1986, le versement des allocations familiales tient compte de la situation concrète de l’enfant et doit en principe s’effectuer au profit, non plus de la famille, mais du service de l’aide sociale à l’enfance.
J’ai entendu Mme la secrétaire d’État dire que seuls 5 % des enfants confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance le sont définitivement. Donnez-moi le chiffre de reconduction tous les deux ans ! En réalité, le juge ne décide pas de confier un enfant l’ASE ad vitam æternam ; il revoit le dispositif tous les deux ans, ce qui explique largement le chiffre de 5 %. Si l’on prenait en considération le taux de reconduction des enfants à l’ASE, le chiffre serait bien différent, je vous l’assure. Or c’est ce chiffre qu’il faut considérer.
Le même article L. 521-2 réserve la possibilité pour le juge de décider de maintenir le versement des allocations à la famille. Les exceptions sont devenues la règle. Le principe établi à l’origine n’est plus appliqué qu’à la marge. C’est la jurisprudence qui l’a voulu ainsi. Quand la jurisprudence fait la loi, il y a dysfonctionnement de nos institutions.
Dans la majorité des cas, la famille continue de percevoir l’intégralité des allocations, y compris l’allocation de rentrée scolaire. Sur le plan des principes, il est difficilement concevable que des familles qui n’assument plus la charge effective, quotidienne, permanente d’un enfant continuent de percevoir l’intégralité des allocations familiales, au même titre que les familles dont les enfants ne sont pas placés. C’est une question de justice et d’équité. Vous êtes de fervents défenseurs de la justice,…
Pas vous ?

…je ne comprends pas votre opposition à ce texte.
Cette proposition de loi poursuit un double objectif : revenir à la volonté initiale du législateur – les allocations familiales doivent bénéficier à la personne, physique ou morale, qui assume la charge effective de l’enfant –, et laisser la possibilité au juge de maintenir la part d’allocations dues au titre de l’enfant placé à la famille, tout en l’autorisant à la répartir entre celle-ci et l’aide sociale à l’enfance.
Cette proposition de loi prévoit ainsi, à son article 1er, d’une part, de favoriser le bénéfice des allocations familiales au service qui prend en charge l’enfant placé, à savoir le service d’aide sociale à l’enfance, en supprimant la saisine d’office du juge, et, d’autre part, de laisser le juge décider, après saisine du président du conseil général, soit du versement de la totalité de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant placé, comme la loi le prévoit, soit d’une répartition de cette part entre la famille et l’ASE. À son article 2, le texte prévoit d’octroyer le versement de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide sociale à l’enfance au titre des enfants qui lui sont confiés.
Comment peut-on imaginer que des parents qui ont un droit de visite d’une journée par mois – je connais de nombreux cas – et n’assument rien, continuent de percevoir l’intégralité de l’allocation de rentrée scolaire ? Si cela ne vous choque pas, il y a vraiment un problème.

Ce n’est pas de la caricature. Écrivons la loi telle qu’elle doit s’appliquer.
Mes chers collègues, il n’est pas éthique qu’une famille qui assume pleinement ses enfants soit placée sur un pied d’égalité avec une autre dont un ou plusieurs enfants sont placés par l’ASE en famille d’accueil ou en établissement. Il n’est pas éthique non plus que l’allocation de rentrée scolaire continue d’être versée à la famille, alors même que c’est le département qui supporte la totalité des dépenses de scolarisation de l’enfant. Il est scandaleux que des allocations familiales soient versées à des parents maltraitants, violents,…

Si les enfants sont placés, c’est aussi parce que les familles sont en grande précarité !

…ou se désintéressant complètement du sort de leurs enfants placés, et dépensant pour leur propre compte, et non pour leurs enfants, l’argent ainsi versé.
D’après la Caisse nationale des allocations familiales, en 2011, l’allocation de rentrée scolaire a bénéficié à 2,8 millions de foyers, pour un coût de 1,49 milliard d’euros. L’an dernier, son montant s’est élevé à 300 euros en moyenne et elle a été versée aux parents de 4,8 millions d’enfants. En l’état d’actuel du droit, cette allocation, destinée uniquement à couvrir les frais de rentrée scolaire à la famille, continue d’être entièrement versée à la famille, alors même que le département supporte la totalité des dépenses liées à la rentrée scolaire des enfants, qui sont dans ce cas les enfants du département. Comment justifier une telle situation quand l’enfant n’habite plus chez lui et est pris en charge par les services de l’ASE ?
Cette proposition de loi n’est pas la première tentative de réforme du dispositif. Des députés UMP ont déposé en 2011 une proposition de loi tendant à ce que toutes les prestations familiales et non les seules allocations familiales soient versées à l’ASE en cas de placement de l’enfant. Des amendements allant dans le même sens avaient été votés par le Sénat lors de l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 ; ils ont toutefois été supprimés par notre assemblée au motif qu’il s’agissait d’un cavalier législatif. Le Conseil constitutionnel a censuré pour les mêmes raisons les dispositions qui figuraient dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011. Il est nécessaire de trouver un véhicule législatif adapté. Ce véhicule législatif est le texte que nous examinons aujourd’hui.
Plus récemment, le sénateur PS Yves Daudigny, qui a travaillé sur un texte quasiment identique, a amendé la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui. Je tiens à ajouter que cette question a fait l’objet très récemment d’amendements que j’ai déposés à l’occasion de l’examen inachevé de la proposition de loi socialiste sur l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant.
Je ne comprends pas la position de la majorité. Le groupe socialiste ne souhaite pas adopter le texte en l’état puisqu’il a demandé un vote solennel, qui devrait avoir lieu dans la semaine du 17 juin. Ce texte a été adopté à la quasi-unanimité au Sénat. Il a, je tiens à le préciser, été voté par Mme Rossignol, alors sénatrice, aujourd’hui secrétaire d’État à la famille, aux personnes âgées et à l’autonomie. Pourquoi s’oppose-t-elle aujourd’hui à ce texte qu’elle a voté il y a quelques semaines au Sénat ? Pourquoi ce changement brutal de cap et d’avis ? Votre nouveau et soudain statut de membre du Gouvernement, madame la secrétaire d’État, justifie-t-il ce renoncement à faire avancer des mesures de justice sociale ? Pourquoi la majorité s’arc-boute-t-elle sur une position contre-productive ? Pourquoi avance-t-elle des arguments qui ne tiennent plus ?
Ces sommes qui devraient être reversées aux services d’aide sociale à l’enfance sont nécessaires, plus encore en cette période de restriction budgétaire. Les besoins de financement des conseils généraux pour remplir leur mission de protection de l’enfance vont croissant, ils suivent la hausse du nombre de placements. L’augmentation du nombre d’enfants accueillis par l’ASE est régulière, que ce soit sur décision administrative ou judiciaire : en 2006, on en dénombrait 141 407, en 2010, on en comptait 148 442.
Enfin, l’argument de la précarisation des familles avancé par la majorité est infamant et faux. Il est infamant parce que la maltraitance, la négligence ou la carence dépassent largement les besoins financiers. On n’achète pas ainsi la bonne conscience !

Il est faux parce qu’il n’y a précarisation que si l’équilibre d’un budget est menacé. Or il ne s’agit pas de réduire les ressources de familles continuant de payer des charges. En pareil cas, oui, il y aurait précarisation.
Le texte que nous vous soumettons prévoit juste que, dès lors qu’il y a absence de charges, il est logique qu’il y ait une absence de ressources. Mes chers collègues, cette proposition de loi n’est pas un texte partisan ; il s’agit d’un texte de bon sens qui a pour seule ambition de renforcer la cohérence d’ensemble de l’aide sociale à l’enfance. Le dispositif proposé ne réduit en rien les moyens consacrés à l’éducation des enfants confiés à la puissance publique. Ce texte instaure au contraire la justice et l’équité entre les familles sans toucher aux droits de l’enfant, auxquels nous sommes attachés. C’est pour cette raison que le groupe UMP le soutient.
Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et UDI.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à l’enfance, lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge, est examinée aujourd’hui par notre assemblée. Cette proposition de loi poursuit une triple exigence de cohésion sociale à laquelle le groupe UDI est particulièrement attentif : prévenir les difficultés que les parents peuvent rencontrer dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives ; accompagner et soutenir les familles ; mais, plus encore, protéger et prendre en charge les enfants, en particulier les plus fragiles. Avec cette proposition de loi, adoptée de manière consensuelle par le Sénat, le groupe UMP pose la question aussi simple qu’essentielle du bénéficiaire des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, sur décision du juge.
Je souhaiterais, en premier lieu, que nous puissions toutes et tous ici présents partager un constat : la législation prévoit que les allocations familiales soient versées à la personne physique ou morale qui assume la charge effective et permanente de l’enfant, donc au service de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il assume pleinement les frais inhérents à l’éducation de l’enfant. Ce principe simple connaît toutefois une exception, car le juge peut en effet décider d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure de placement judiciaire, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter son retour dans le foyer familial. Pourtant, force est de constater que l’exception est devenue la règle. L’intention initiale du législateur n’est, en pratique, plus respectée. En effet, 85 à 90 % des familles continuent de percevoir tout ou partie des allocations familiales et l’intégralité de l’allocation de rentrée scolaire, alors même qu’elles n’assument plus la charge de l’enfant.
Dès lors, la proposition de loi soumise à notre examen propose de mettre fin à ces dérives en poursuivant trois objectifs. Premier objectif : affirmer de nouveau la volonté initiale du législateur, à savoir que les allocations familiales bénéficient à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de l’enfant, en l’occurrence l’aide sociale à l’enfance lorsque celui-ci est placé. Deuxième objectif : laisser la possibilité au juge de maintenir la part d’allocations dues au titre de l’enfant placé à la famille, tout en l’autorisant à répartir cette part entre celle-ci et l’aide sociale à l’enfance. Troisième et dernier objectif : étendre ces dispositions à l’allocation de rentrée scolaire, laquelle est aujourd’hui entièrement versée à la famille, alors que les départements supportent la totalité des dépenses liées à la scolarisation des enfants qui leur sont confiés.
L’examen du texte au Sénat a permis d’atteindre un meilleur équilibre encore, en rétablissant la saisine d’office du juge et en posant le principe selon lequel le maintien de la part des allocations dues au titre de l’enfant placé ne peut être que partiel. Cela permettra dès lors au juge de répartir cette part entre la famille et l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, les familles qui maintiennent un lien moral ou matériel avec l’enfant pourront, à l’appréciation du juge et au regard des circonstances propres à chaque cas particulier, continuer à bénéficier d’une partie des allocations familiales. Vous le voyez, mes chers collègues, l’équilibre entre l’intérêt de l’enfant et le respect de la volonté éducative des parents est pleinement respecté. Ne nous y trompons pas et ne tombons pas dans les postures : il ne s’agit pas ici de pénaliser plus encore des familles que la vie a fragilisées,…

…abîmées, parfois détruites, mais seulement et uniquement de parvenir à un équilibre entre la préservation des liens familiaux et une allocation juste et efficace des ressources.
Il s’agit, mes chers collègues, d’une question d’équité et de responsabilité. Cette proposition de loi vise uniquement à ce que les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire bénéficient à ceux qui assurent l’entretien effectif des enfants, selon le principe « aucune charge, aucune ressource ». Ne voyez pas dans ce principe une volonté moralisatrice…

…ou une attaque déguisée contre les familles les plus modestes. Je veux vous dire mon sentiment avec gravité : refuser de soutenir ces mesures de bon sens, ce serait alimenter les fantasmes sur l’assistanat et la fraude, qui vont faire voler en éclat la solidarité spontanée de la nation tout entière vis-à-vis des plus fragiles. Ce serait générer inutilement des crispations et un sentiment profond d’injustice qui poussent la France à se réfugier dans le vote extrême.

Je veux également souligner que cette proposition de loi participe à une saine gestion des finances publiques. Or, nous le savons, les finances des conseils généraux sont exsangues. Les départements ne peuvent plus assumer des missions aussi essentielles, aussi exigeantes sans disposer des moyens indispensables pour les mener à bien. Ne permettons pas ces dérives car, en définitive, elles remettront en cause, tôt ou tard, notre capacité à venir en aide aux plus faibles.
Mes chers collègues, je vois un dernier intérêt à cette proposition de loi. Son adoption constituerait, selon moi, un acte de reconnaissance de l’action des services sociaux départementaux dans l’accompagnement, la prise en charge et l’éducation des enfants.

Pour conclure, je voudrais vous faire part d’un regret : que l’examen de cette proposition de loi ne nous ait pas permis de nous attarder sur les conditions de l’exercice de la mission d’assistanat familial. En effet, cette profession supporte une très lourde responsabilité, celle d’assurer le quotidien de la vie d’un enfant en l’entourant de soins et en lui procurant la sécurité nécessaire à son épanouissement, en lieu et place de parents momentanément défaillants ou empêchés, et ce, en tenant compte de sa personnalité, de son âge, de sa psychologie et de son passé. L’accompagnement des assistanats familiaux dans l’exercice de leurs missions, leurs conditions de rémunération, les modalités de révision de leur agrément, les échanges qu’ils ont avec les services d’aide à l’enfance auraient été des sujets majeurs qui auraient pu être abordés pour leur offrir une place de choix dans le dispositif de protection de l’enfance.
Pour le groupe UDI, il s’agit d’un des points majeurs qui pourraient être examinés dans une approche globale de la législation sur la protection de l’enfance. En effet, mes chers collègues de la majorité, le débat sur cette proposition de loi ne saurait exonérer le Gouvernement et la représentation nationale d’une approche globale de la législation en ce domaine. Cessons de légiférer par petites touches, petits pas après petits pas !

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, même s’il eût été pour nous plus pertinent et constructif de légiférer de manière globale, pour améliorer la protection de l’enfant, le groupe UDI soutiendra cette proposition de loi qui permettra de mettre fin, de manière pragmatique, à des iniquités majeures et de renforcer la protection de l’enfant.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi du groupe UMP a pour objectif de limiter l’accès aux allocations familiales et à l’allocation de rentrée aux familles dont l’enfant a été confié au service d’aide à l’enfance. Elle a été rejetée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. C’est heureux, car nous pensons que ce texte est néfaste.
Sous couvert de bon sens ou de bonne gestion des conseils généraux, il stigmatise en réalité les familles, quelles que soient les causes du placement, alors que l’on constate une augmentation du nombre de placements d’enfants hors de leur famille pour des raisons liées à une très grande précarité. Ajouter cette peine supplémentaire à ces familles-là ne fait qu’aggraver leur situation.
Cette proposition de loi est d’autant plus étonnante que la législation traite de la question des allocations familiales en cas de placement d’un enfant. L’article L. 521-2 du code de la Sécurité sociale précise que « la part des allocations familiales dues pour l’enfant placé est versée au service qui le prend en charge. Toutefois, le juge peut décider de maintenir le versement à la famille notamment pour faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ». Ce texte permet des décisions judiciaires équilibrées et adaptées aux situations. D’ailleurs, le maintien des allocations aux familles est loin d’être automatique. Si l’on se fie au chiffre de la caisse nationale d’allocations familiales, le versement des allocations est maintenu à la famille dans 56 % des cas. Il s’agit de décisions réfléchies et la pratique n’ignore pas l’esprit de la loi. Avec cette proposition de loi, vous semblez douter de la qualité des travaux des magistrats. Nous réaffirmons ici que les juges sont les mieux placés pour prendre ces décisions. Ce sont les seuls, avec les travailleurs sociaux, à connaître l’histoire et le contexte familial. Dans le domaine de l’aide sociale, il est nécessaire de tenir compte de chaque situation. Il s’agit de décider au cas par cas, et c’est le rôle du juge.
De façon générale, votre proposition est quelque peu bancale. À la lecture des rapports, on perçoit que le raisonnement ne tient pas toujours. Par exemple, avant son rejet par la commission, la proposition de loi prévoyait de maintenir, au maximum, 35 % des allocations aux parents. Ce chiffre ne trouve pas vraiment d’explication. M. le rapporteur à l’Assemblée nationale a indiqué à la commission des affaires sociales que ce plafond provenait de la proposition de loi d’Yves Daudigny, mais nous n’avons pas eu plus d’explications. Pourquoi l’avoir repris ? Pourquoi plafonner le versement et ne pas laisser le juge libre de déterminer lui-même une répartition des allocations entre la famille et le conseil général si cela s’impose ? Nous restons sur notre faim concernant le chiffre de 35 %. Par contre, la justification du principe de modulation de l’allocation versée aux familles figure dans le rapport de Mme Deroche. Cette modulation constituerait, selon elle, une incitation pour les familles, car « en cas de retour dans la famille, elle retrouvera l’entier bénéfice des allocations familiales ». Cela laisserait supposer que ces familles seraient animées par cet intérêt financier et qu’il faudrait donc récompenser ou sanctionner leur comportement en agitant la menace de la suppression des allocations.
Pour les allocations de rentrée, vous êtes allés encore plus loin, puisque vous nous proposez d’écarter totalement le juge. Les allocations seraient ainsi directement versées au conseil général sans que personne n’ait son mot à dire, quels que soient la durée ou le mode de placement. Peu importe si les familles doivent acheter des cahiers, des stylos ou des livres au retour de l’enfant dans son foyer. Sachant que le versement de ces allocations est soumis à un niveau de ressources, il est évident que les familles qui reçoivent des allocations de rentrée en ont impérieusement besoin. L’école est une porte ouverte vers un autre avenir, et c’est encore plus vrai dans ces familles. En fait, la proposition qui nous est soumise s’inscrit dans une démarche qui est, que vous le vouliez ou non, moralisatrice, bien loin de celle qui a présidé à la création des allocations familiales : la solidarité. Nous pensons que les familles dont les enfants sont placés pour des raisons liées à la pauvreté ou à la maladie doivent être soutenues dans cette période de crise. Elles n’ont pas besoin qu’on les pointe du doigt ou qu’on les fragilise ; au contraire, elles ont besoin que la République les protège davantage.
Nous le répétons, à l’heure où la crise fait des ravages, ce type de mesure pourrait plonger de nombreuses familles dans un dénuement encore plus grand, alors que nous voulons favoriser les conditions d’un retour dans le cadre familial dès que cela est possible. La loi actuelle précise d’ailleurs que le juge peut maintenir les allocations aux familles pour deux raisons : lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ; en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. Le maintien des allocations est donc un moyen de permettre aux familles de recevoir leurs enfants à certaines périodes, comme pendant les vacances, et de construire les conditions d’un retour au foyer. Laissons le juge et les travailleurs sociaux construire des solutions adaptées.
Pour autant, le chapitre n’est pas clos. Autant la double peine pour les familles ne peut tenir lieu de politique familiale, autant il est indispensable pour les collectivités territoriales et leurs services sociaux de disposer de moyens supplémentaires pour bien remplir leur mission au service des citoyennes et des citoyens. Prendre dans la poche des plus démunis n’est pas la solution, comme ne l’est pas non plus la baisse des dotations d’État à l’égard des collectivités qui ont à faire face à une augmentation de leurs dépenses, notamment sociales.
Cela nous invite à nous poser la question des ressources pour les allocations familiales. La question des allocations va revenir sur le devant de la scène avec le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2014. Qu’adviendra-t-il de ces allocations, sachant que le Gouvernement nous annonce une baisse drastique des cotisations famille ? Dès 2015, pour les entreprises éligibles à la réduction Fillon, le taux de cotisation patronale d’allocations familiales sera réduit de 1,8 point pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC ; puis, en 2016, cette réduction s’appliquera à l’ensemble des salaires inférieurs à 3,5 SMIC. Ces allégements représentent plusieurs milliards d’euros. Que va-t-il se passer pour toutes les familles concernées ? Ces questions devront être résolues dans d’autres textes. Concernant celui-ci, vous l’aurez compris, les députés du Front de gauche ne cautionneront pas la logique qui est portée par votre proposition de loi et nous voterons contre.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la présente proposition de loi, issue des travaux du Sénat, organise le versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au département quand un enfant a été placé. Le « bon sens » invoqué à l’origine par les sénateurs est le suivant : comme le département assumerait toutes les charges, il devrait percevoir les ressources. Malheureusement, ce « bon sens » n’est qu’une illusion. Je vais m’attacher à le démontrer car cela justifie, à mes yeux, de rejeter la proposition.
Ce « bon sens » n’est qu’une illusion, car il repose sur une extrapolation de cas particuliers sans rapport avec l’ensemble des situations judiciaires et familiales.
Certes, il existe des cas particuliers scandaleux. Mais les contre-exemples plaidant pour le maintien des allocations familiales et de l’ARS à la famille sont plus nombreux. Je pourrais citer les placements à cause d’un logement trop petit pour la taille de la famille et qui ne durent que le temps de trouver un logement social. Je pourrais citer les placements lorsqu’un parent isolé malade doit suivre, pour un temps, un traitement ou une cure précis.
Aujourd’hui, l’Assemblée nationale doit se prononcer en connaissant la réalité judiciaire. Et cette réalité vient contredire les propos tenus lors des débats au Sénat. Il est faux de dire que les juges maintiennent systématiquement le versement des allocations aux familles. Les auditions ont permis de montrer que sur les 50 000 familles dont un enfant est placé, 22 000, soit 43 %, ne perçoivent plus les allocations familiales. Force est donc de constater que les juges font leur travail d’expertise et d’appréciation. Ils n’appliquent pas des décisions automatiques et formatées. mais prennent en compte la réalité de chaque famille. Ce sont eux qui doivent décider du maintien ou non des allocations familiales. Comme l’a recommandé le défenseur des droits dans son rapport sur les droits de l’enfant pour 2011, il faut « organiser l’implication et la participation effectives des parents » et « anticiper la fin du placement ». À ce titre, les juges, les travailleurs sociaux aussi bien que la Défenseure des enfants témoignent que les allocations familiales sont des outils de négociation avec les familles, des leviers pour retisser le lien entre l’enfant et la famille et responsabiliser les familles.

Telle est la réalité judiciaire.
Aujourd’hui, l’Assemblée nationale doit aussi se prononcer en connaissant la réalité familiale. Et cette réalité vient, là encore, contredire les propos tenus lors des débats au Sénat. Il est faux de dire que le département supporte toutes les charges. Dans la réalité, il ne les supporte ni entièrement, ni de façon continue. En effet, 95 % des enfants placés ont vocation à revenir dans leur famille, ce qui signifie que leurs parents ont des droits de visite. Ces derniers continuent donc à engager des frais pour leurs enfants. Ils demeurent aussi dans le même logement avec les mêmes charges fixes.
Si l’on veut rétablir un bon exercice de l’autorité parentale dans l’esprit de la loi de 2007 relative à la protection de l’enfance, les parents doivent pouvoir continuer à participer aux achats pour leur enfant. Les vêtements sont particulièrement importants, mais aussi les transports lors des droits de visite pendant la durée du placement, les activités partagées de loisirs ou la réorganisation matérielle de l’appartement en vue du retour. Ce qui vaut pour les allocations familiales vaut également pour l’ARS. Son versement automatique au département aurait pour seule conséquence d’évincer les parents, sans jamais les aider à prendre conscience de leur responsabilité.
La proposition qui nous est soumise aujourd’hui est donc inutile, motivée essentiellement par un souci d’économie, et elle ne sert pas l’intérêt de l’enfant.
Elle est d’abord inutile puisque, comme je l’ai dit, l’article L. 521-2 du code de la Sécurité sociale prévoit déjà que le juge peut décider le maintien des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
Ensuite, cette proposition de loi est motivée par un souci d’économie en faveur des départements. Les sénateurs ayant participé aux débats ont ainsi extrapolé des montants d’économies pour les services des départements que d’ailleurs, souvent, ils présidaient, sans opérer aucune consolidation nationale.
Ce souci d’économie se lit surtout à l’article 2 relatif à l’allocation de rentrée scolaire. En effet, cet article ne concerne pas seulement les enfants placés sur décision du juge, comme le laisse penser le titre de la proposition de loi, mais tous les enfants confiés aux services du département, y compris donc ceux placés à la demande des familles qui veulent maintenir un lien avec leur enfant, et auxquelles, si ce texte était adopté, l’ARS serait quand même supprimée !
De plus, l’ARS étant une aide attribuée sous conditions de ressources et en fonction du nombre d’enfants à charge, quel pourrait bien être le sens des « conditions de ressources » pour une institution publique comme le département ? Il résulterait des dispositions de cet article 2 qu’une somme lui serait versée sur la base des revenus d’une famille !
D’autres difficultés devraient être surmontées. Par exemple, comment garantir que les recettes nouvelles pour les départements seront bien fléchées vers les seuls enfants pour lesquels ils les reçoivent ?
Enfin, cette proposition de loi ne sert pas l’intérêt de l’enfant. Comme je l’ai indiqué, les allocations familiales sont, pour les services sociaux et les juges, des outils de dialogue avec les familles qui veulent continuer à exercer leur autorité parentale et maintenir un lien avec leur enfant.
Ce lien suppose qu’elles disposent de quelques ressources. En effet, les familles concernées sont souvent en situation de précarité et parfois composées de parents isolés. Rappelons que 80 % des enfants placés viennent de familles en grande précarité économique. Dans son rapport de 2010, intitulé « Précarité et protection des droits de l’enfant », la Défenseure des enfants préconisait qu’en cas de placement, il fallait même aller au-delà de la loi actuelle et « garantir le maintien automatique des allocations familiales lorsque les revenus des parents sont en-dessous d’un certain seuil, afin de ne pas laisser ce maintien à la seule bonne volonté du juge et de la CAF et que les parents puissent disposer de ressources suffisantes pour maintenir des liens lors des rencontres avec leurs enfants. »

Ce n’est pas moi qui le dis.
Est-il opportun de discuter d’une telle proposition de loi dans la période de difficultés économiques que nous traversons ? N’y a-t-il pas un risque de vases communicants ? Ce qui sera supprimé du côté des allocations familiales sera demandé, de l’autre, aux centres communaux d’action sociale ou devra être compensé par le revenu de solidarité active, le RSA.
Le transfert intégral de l’ARS serait injuste si le placement intervient pour une courte durée. En effet, une fois l’enfant revenu, la famille ne percevrait pas l’allocation alors qu’elle aurait à assumer des frais scolaires, car tous les frais ne sont pas engagés au premier jour de classe ! Cette proposition de loi fragiliserait donc les familles qui se retrouveraient avec l’autorité parentale et toujours moins de moyens pour l’exercer et qui, même avec un enfant en moins, devraient pourtant faire face à des charges fixes.
Le placement est la solution la plus coûteuse. Il serait donc utile de travailler sur des alternatives comme le développement de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
Par ailleurs, une évaluation de la loi de 2007 relative à la protection de l’enfance est conduite par les inspections des ministères des affaires sociales et de la justice. Ses résultats devraient nous permettre de faire évoluer notre droit.
De l’Union nationale des associations familiales, l’UNAF, à ATD Quart-Monde, en passant par les représentants des juges et la défenseure des enfants, toutes les personnes auditionnées ont émis un avis négatif sur cette proposition de loi ou formulé de sérieuses réserves.
Celle-ci a été largement modifiée au Sénat et à plusieurs reprises, de nouveaux amendements ont été proposés, autant de modifications qui soulignent le caractère peu cohérent des dispositifs proposés, leur instabilité et finalement leur inutilité.
Je tiens pourtant à saluer le travail du rapporteur, Gilles Lurton, pour la façon dont il a mené ses auditions. Je reconnais aussi ses efforts pour améliorer le texte. Mais ces améliorations portent essentiellement sur la forme ou visent à simplifier les mesures proposées, sans changer rien au fond de la proposition. C’est pourquoi les membres socialistes, communistes et écologistes de la commission des affaires sociales ont rejeté cette proposition de loi la semaine dernière. Je vous proposerai, à mon tour aujourd’hui, d’en supprimer chaque article.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à l’initiative du groupe UMP, notre Assemblée examine aujourd’hui une proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant lui a été confié par décision du juge.
Adopté à la quasi-unanimité au Sénat, notamment, si j’ai bien compris, madame la ministre, par vous-même puisque vous siégiez alors au Sénat, ce texte vise, notamment, à revoir notre dispositif d’aide sociale à l’enfance à la lumière d’une évidence qui est que les allocations doivent bénéficier aux enfants, donc revenir à ceux qui en ont la charge effective.
Lorsqu’un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l’aide sociale à l’enfance, est chargée de répondre à l’ensemble de ses besoins. Les départements, en charge de la protection de l’enfance, développent des actions grâce aux services de l’ASE. La protection de l’enfance constitue l’une des principales compétences des conseillers généraux et représente l’un des principaux postes de dépenses dans nombre de départements. Les départements prennent en quelque sorte le relais des familles quand ces dernières rencontrent des difficultés, très souvent à la suite d’une décision de justice. Les services de l’ASE assurent par conséquent l’ensemble des responsabilités et des frais liés à l’exercice de la parentalité sans nécessairement bénéficier des allocations familiales, qui peuvent continuer d’être versées aux familles. Certes, en l’état actuel du droit, et en application de l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations doivent être versées à la personne qui assume « la charge effective et permanente de l’enfant ». Dans le cas d’un enfant confié aux services de l’ASE, la loi du 6 janvier 1986 prévoit le versement de la part des allocations familiales dues au titre de cet enfant à ce service.
À l’époque, le législateur avait très logiquement voulu porter au bénéfice de la collectivité une allocation correspondant pour partie à la charge qu’elle supporte.
Toutefois, le juge a la possibilité, sur auto-saisine ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsqu’il considère qu’elle participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant pour faciliter son retour dans le foyer familial.
Dans les faits, force est de constater que l’exception est devenue la règle car le juge décide presque systématiquement du versement des allocations à la famille alors que celle-ci n’a plus la charge de l’enfant. Ainsi, la loi est clairement dévoyée.

Je rappelle, par ailleurs, que les placements sont le plus souvent motivés par des faits graves comme la maltraitance ou la négligence, avec ce qu’ils impliquent de conséquences traumatisantes pour l’enfant.
Au nom même du principe d’équité, il est inacceptable, et même tout à fait scandaleux, que les parents n’ayant plus la charge de leurs enfants continuent de bénéficier des allocations familiales ou de l’allocation de rentrée scolaire au même titre que les familles qui élèvent leurs enfants. Des dérives criantes en découlent. Par exemple, certains parents trouvant leur niveau plus confortable, ne souhaitent plus récupérer leurs enfants. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

Oui, mais il faut aussi oser verser des allocations à des gens qui n’assument plus la charge de leurs enfants ! Chacun ose ce qu’il veut, mais en matière de responsabilité, vous n’avez pas de leçons à me donner !
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Pour vous, personne n’est irresponsable. Pour vous, quelqu’un a qui on a retiré son enfant doit nécessairement continuer à toucher les allocations familiales ! C’est votre choix, ce n’est pas le nôtre !

Et le constat va encore plus loin car force est de constater que certaines lacunes dans notre dispositif d’aide sociale perdurent. En effet, alors que le département assume la totalité des dépenses liées à la rentrée scolaire d’un enfant confié à l’ASE, l’allocation de rentrée scolaire est exclue de ce dispositif. Aucun texte ne prévoit que l’absence de charge effective puisse entraîner qu’elle ne soit pas versée. Là encore, le scandale – que vous approuvez – est criant !

Je rappelle que le lien entre l’attribution de prestations familiales et l’exercice de l’autorité parentale est un principe ancien et constant de notre droit. Or, notre système est tel aujourd’hui que ce principe est mis à mal.
Dans cet esprit, permettez-moi de rappeler que c’est votre majorité qui a abrogé, par pure idéologie, la loi du 28 septembre 2010, votée à l’initiative de notre collègue Éric Ciotti, qui prévoyait la suspension systématique des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire répété et injustifié. Son objectif était de faire de la responsabilité des parents un élément clé de la lutte contre l’absentéisme. Malheureusement, votre majorité est revenue sur ce dispositif. Je le regrette profondément.
Revenons-en au texte examiné aujourd’hui. Notre collègue sénateur, Christophe Béchu, propose à travers la présente proposition de loi de rétablir une certaine justice entre les familles, de moraliser notre dispositif d’aide sociale et donc de veiller à une meilleure utilisation des deniers publics.
Dans son article 1er, la présente proposition de loi vise à favoriser le versement des allocations familiales au service de l’ASE qui prend la charge de l’enfant, en supprimant la saisine d’office du juge. Initialement, il prévoyait de laisser le juge décider, après saisine du président du conseil général, soit du versement de la totalité de la part des allocations familiales, soit d’une répartition entre la famille et l’ASE. Lors de l’examen en première lecture au Sénat, la possibilité pour le juge de décider du versement de la totalité des allocations familiales a été supprimée. De ce fait, le juge sera dans l’obligation de répartir l’allocation entre l’ASE et la famille. Ainsi, au cas par cas, certaines familles pourront toujours toucher une partie des allocations.
Enfin, à travers l’article 2, l’allocation de rentrée scolaire sera désormais versée à l’ASE au titre des enfants qui lui sont confiés.
En définitive, cette proposition de loi relève avant tout du bon sens. Sans réduire les moyens consacrés à l’éducation des enfants confiés à la puissance publique, elle vise à rendre notre système plus juste vis-à-vis des familles qui élèvent leurs enfants. Bien évidemment, je soutiendrai cette proposition de loi.
Puisque j’en suis à ma troisième intervention de la journée, j’aimerais, chers collègues de la majorité, résumer nos débats : à neuf heures, vous avez refusé tout contrôle de la cybercriminalité mise en oeuvre par les djihadistes.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

C’est bien ce que vous avez voté – si toutefois vous étiez là ! À onze heures, vous avez refusé de maintenir l’Office en charge des rapatriés.

Et à présent, vous faites en sorte que les familles qui n’ont plus en charge leurs enfants…

…continuent à percevoir les allocations familiales. Cette journée est un bon condensé de votre idéologie !
Mêmes mouvements.

Un peu de calme, mes chers collègues !
La parole est à Mme Gisèle Biémouret.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, chers collègues, dans ce débat, comme nous venons d’en avoir la démonstration, nous avons clairement deux approches difficilement conciliables.
La première, défendue par ce texte, veut s’appuyer – pour reprendre certains des arguments qui ont été entendus – sur une logique de bon sens mais qui aboutit, une fois de plus, à la stigmatisation des plus précaires.

La seconde, que je défends, consiste à dire que le transfert des allocations familiales aux collectivités représente un risque – trop grand – de fragilisation des familles déjà largement en difficulté.
De plus, les juges ont déjà la faculté de faire transférer ces allocations aux collectivités : en cas de placement, 43 % des allocations familiales sont déjà versées à l’aide sociale à l’enfance. Laissons-leur la faculté de continuer ce travail d’appréciation et d’expertise de chaque situation, en faisant confiance à leur discernement.
Il se trouve que je siège au Conseil national de lutte contre les exclusions, en qualité de représentante de notre assemblée. Les débats qui ont eu lieu en son sein ont démontré la totale incompréhension suscitée par ce texte auprès des travailleurs sociaux et des associations. Je souhaite d’ailleurs remercier les associations pour leur implication quotidienne auprès des plus démunis. Tous nous disent que ce texte est totalement contraire à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, dont l’objet était de favoriser le retour de l’enfant dans sa famille lorsque la situation le permet. Or, le maintien des allocations familiales en est un outil majeur. Pour reprendre les propos de Pierre-Yves Madignier, président d’ATD Quart Monde, les associations en ont été « sidérées ».
N’oublions pas que la grande majorité des enfants placés viennent de familles en grande précarité économique, souvent monoparentales ; le fait de leur retirer cette aide peut grandement compromettre le paiement du loyer, le transport pour les visites et la possibilité de nourrir les enfants le week-end.
Bien que je sois vice-présidente du conseil général du Gers, je pense qu’au-delà du non-sens social qu’il représente, le fait de transférer automatiquement ces allocations aux conseils généraux serait également un non-sens économique à long terme puisqu’un enfant en rupture longue avec sa famille coûte en moyenne, selon le type de placement, familial ou collectif, de 34 000 à 64 000 euros par an.

Madame Dalloz, je pense que nous savons utiliser les impôts des contribuables gersois !
Je regrette votre choix de privilégier une logique comptable et immédiate, sans tenir compte de la complexité de la situation. Il est des domaines, en particulier celui dont nous traitons aujourd’hui, où l’application brutale des principes et la logique gestionnaire dont vous vous revendiquez peut occasionner davantage de dégâts qu’elle n’offre de solutions adaptées.
Mes chers collègues, je vous conseille de lire l’excellent rapport publié l’année dernière par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale – organisme de l’État sans parti pris politique –, qui démontre les effets de la stigmatisation systématique des plus précaires. Je voudrais vous convaincre que nous n’aurons rien à gagner collectivement en favorisant le populisme ambiant.

Dans ce débat, je ne peux m’empêcher de penser à ce proverbe chinois : « quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde le doigt. » Au lieu de systématiser la sanction, il serait plutôt nécessaire, comme l’ont rappelé certains parlementaires au Sénat ou dans notre assemblée, de nous interroger sur les raisons de l’augmentation des placements d’enfants, et d’entamer une large réflexion sur la protection sociale de l’enfance.
Susciter cette réflexion est, pour moi, le seul mérite de cette proposition de loi, à laquelle je suis néanmoins totalement opposée.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’état, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, cette proposition de loi « relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge », a pour objet de permettre aux conseils généraux de percevoir le montant des allocations familiales et de rentrée scolaire, au motif qu’ils assurent la prise en charge effective d’un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Les auteurs de la proposition de loi estiment que ces allocations doivent bénéficier en priorité à la collectivité, en contrepartie de la charge qu’elle supporte, sans tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’objectif affiché est – j’emploie ce terme avec des guillemets – de « moraliser » le dispositif en ciblant le fait que – je cite – « les placements sont le plus souvent motivés par des faits de maltraitance, de carence et de négligence ».
Dans le même état d’esprit, la proposition de loi pose le principe selon lequel l’allocation de rentrée scolaire, versée aux familles sous condition de ressources, devrait être versée à l’aide sociale à l’enfance pour compenser la totalité des dépenses des départements liées à la scolarisation et, ainsi, éviter – je cite à nouveau – « l’utilisation injuste de ce dispositif par les familles. »
Pour dépasser cette vision réductrice de la protection de l’enfance, telle qu’elle est exprimée par cette proposition de loi, il me semble bon de rappeler les dispositifs en vigueur.
Cette proposition de loi est à contre-courant de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Élaborée au terme d’une très large concertation, cette loi poursuit trois objectifs : renforcer la prévention, améliorer le dispositif d’alerte et de signalement et diversifier les modes d’intervention auprès des enfants et de leur famille. Plaçant au coeur du dispositif l’intérêt de l’enfant, elle a aussi pour ambition de renouveler les relations avec les familles.
Lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire, le magistrat évalue dès la première audience la situation de l’enfant dans le contexte familial. Il dispose, le plus souvent, d’un rapport d’évaluation détaillé de l’aide sociale à l’enfance pour étayer son analyse.
Le versement des allocations familiales à la famille est maintenu lorsque que cette dernière participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou en vue de faciliter son retour dans le foyer familial. Dans le cas inverse, les allocations familiales sont versées à l’aide sociale à l’enfance. Le magistrat décide d’office lors de l’audience ou, lorsque le placement est en cours, sur saisine du président du conseil général.
En ce qui concerne l’allocation de rentrée scolaire, son versement à la famille est interrompu lorsque l’enfant est placé, si les services de la protection de l’enfance indiquent à la caisse compétente qu’aucun lien matériel ou affectif ne subsiste avec la famille.
Aujourd’hui, les juges des enfants maintiennent les prestations aux familles dans un cas sur deux.
Comme vous le savez, les prestations familiales sont indispensables pour permettre aux familles les plus modestes, les plus démunies, de prendre en charge l’enfant, même si le temps d’accueil et la prise en charge familiale semblent minimes dans le cas où une ordonnance de placement provisoire est prononcée.
Les magistrats, comme les services de l’aide sociale à l’enfance, connaissent cette problématique et en tiennent compte dans le travail engagé auprès des familles.
La loi du 5 mars 2007 a fait évoluer un certain nombre de prestations en direction des enfants et de leur famille. Elle a notamment introduit l’accompagnement en économie sociale et familiale et la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, en lieu et place de la mesure de tutelle aux prestations sociales à l’enfance.
La première de ces deux mesures constitue le préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la seconde. Toutefois, elles poursuivent toutes deux une même finalité : répondre aux besoins de l’enfant tout en menant une action éducative auprès de la famille, dans l’intérêt de l’enfant.
Le juge peut décider de mettre en place une mesure de tutelle aux prestations familiales, lorsque ces prestations ne sont pas utilisées pour les besoins liés à l’entretien du ou des enfants. Concrètement, les prestations ne sont plus versées directement aux familles, mais à une tierce personne – le « délégué aux prestations familiales » –, qui décide avec les parents de leur utilisation en fonction des besoins de l’enfant. Cette mesure est d’une durée de deux ans maximum ; elle est renouvelable.
Toutefois, des outils restent à préciser dans le cadre de l’accompagnement budgétaire, en particulier la possibilité d’utiliser le versement partiel des allocations familiales aux parents ou à l’un d’eux pour favoriser la prise en charge financière des retours très courts au domicile. La prochaine loi de financement de la Sécurité sociale pourrait être une porte d’entrée pour améliorer les dispositifs actuels.
La proposition de loi en discussion, défendue au Sénat, notamment, par le président du conseil général de Maine-et-Loire, Christophe Béchu, ne s’inscrit pas dans la réalité des dispositifs existants mais participe à la stigmatisation des familles dont les enfants sont placés.
À juste titre, ATD Quart Monde a dénoncé une « confiscation » des prestations familiales qui pourrait – je cite – « mettre en péril le retour des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ». Cette même association ajoute que « confisquer les allocations, c’est fragiliser la famille, compromettre parfois le paiement du loyer, le transport pour leur rendre visite, la possibilité de nourrir leurs enfants quand ils les reçoivent le week-end, le maintien du lien par l’achat du cartable à la rentrée, et caetera. »
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, une évaluation de politique publique est en cours sur les questions de gouvernance de la protection de l’enfance et sur la qualité et l’efficience de la réponse coordonnée apportée aux besoins des enfants et de leur famille. Elle permettra, sans aucun doute, de nourrir une nouvelle réflexion pour continuer à améliorer les dispositifs législatifs actuels.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, faut-il ou ne faut-il pas verser les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire aux parents d’un enfant qui a été confié au service d’aide à l’enfance par décision d’un juge ? C’est une question complexe qui traduit des situations de vie difficiles, parfois même conflictuelles. C’est une question à laquelle chacun, dans cet hémicycle, cherche à répondre, en essayant de parvenir à la solution la plus adaptée aux enjeux pour les enfants et leur famille. Si M. Mariani était resté à l’issue de son intervention, je l’aurais appelé, au moins sur des questions comme celle-ci, à sortir des postures caricaturales, qui ne servent pas le débat public.

Je me limiterai, compte tenu de ce que mes collègues ont déjà dit à cette tribune, de deux approches pour justifier le fait que je voterai contre cette proposition de loi.
Une approche sur le fond, d’abord. Il est reconnu par les professionnels du secteur de l’aide à l’enfance que les allocations familiales sont des outils de négociation avec les familles, des moyens de retisser le lien de l’enfant avec ces dernières et de les responsabiliser, conformément à l’objectif qui prévaut généralement lorsqu’un enfant est retiré à sa famille, à savoir qu’il puisse un jour y retourner.
De la même manière, comme cela a été dit, l’allocation de rentrée scolaire peut être l’occasion pour la famille, bien qu’elle n’ait plus la garde de l’enfant, de participer aux achats nécessaires à l’enfant, maintenant ainsi un lien précieux avec lui.
Mais on pourrait rétorquer, à juste titre, que ce n’est pas pour autant qu’il convient de verser ces allocations de manière systématique à la famille biologique, notamment si le retour est inenvisageable à moyen terme, ou même à long terme.
J’en viens à ma seconde approche du sujet. En l’état actuel du droit, il appartient au juge de décider, guidé par sa connaissance du dossier – raisons du placement, conditions de vie de la famille naturelle, entre autres –, si les allocations doivent continuer à être versées à la famille ou, au contraire, lui être retirées. Dans près d’un cas sur deux, d’ailleurs, le juge décide de réattribuer les allocations directement au service d’aide à l’enfance.
Sauf à considérer que les parlementaires seraient plus à même de décider, a priori, du retrait systématique des allocations pour toutes les familles de France placées dans ces situations difficiles, la solution qui prévaut aujourd’hui, consistant à laisser les services sociaux et les magistrats se déterminer au cas par cas, me semble la plus adaptée.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Je souhaite répondre à quelques-unes des objections et des approbations qui ont été formulées.
Tout d’abord, je veux dire à Mme Dalloz, M. Habib et M. Mariani qu’ils ont démontré, au-delà de tout ce que nous avons pu entendre, qu’il existe quand même – c’est également, j’imagine, ce qu’ont ressenti nos collègues sénateurs – un problème réel dans le pays, à l’égard duquel nous ne devons pas nous voiler la face.
À Mme Buffet, qui, me semble-t-il, n’est plus parmi nous, je voudrais dire qu’il ne s’agit pas, par ce texte, de stigmatiser qui que ce soit – je l’ai répété à plusieurs reprises – ni de douter de la qualification des magistrats : je connais trop, à titre personnel, ces métiers, pour cela.
Je voudrais vous préciser également que j’ai bien entendu les observations de mes collègues en commission au sujet du taux retenu pour la part des allocations versée à la famille. Cette répartition – 35 % à la famille, 65 % à l’ASE – était une proposition que M. Yves Daudigny avait introduite par amendement au Sénat. Je souhaitais proposer par voie d’amendement, mais je crains que nous n’ayons pas l’occasion d’en discuter, le renvoi de la fixation des taux de répartition à un décret gouvernemental. J’étais en effet pour ma part tout à fait ouvert à une répartition différente de celle qu’a proposée le Sénat.
S’agissant de la décision relative au maintien du versement de l’allocation de rentrée scolaire, il est bien entendu totalement exclu d’en écarter le juge. Le Sénat avait d’ailleurs maintenu cette intervention dans la proposition initiale de Christophe Béchu et ne l’a supprimé qu’au cours de l’examen en commission. Nous proposons ici de la réintroduire.
Je voudrais remercier Mme Clergeau d’avoir reconnu qu’un travail important avait été effectué. C’est vrai que nous avons mené beaucoup d’auditions, lesquelles ont été extrêmement intéressantes et ont largement influencé ma réflexion sur cette proposition de loi.
Je note que si la plupart des personnes auditionnées – pas toutes, car l’Association des départements de France avait une position différente – se sont exprimées un peu à l’encontre de cette proposition de loi, toutes ont reconnu au terme de la discussion qu’il y avait effectivement un problème majeur et qu’un renforcement de l’accompagnement des familles auxquelles on retirait les enfants pour les placer soit en famille d’accueil soit en établissement était plus que nécessaire. Un autre constat partagé était que le juge se préoccupait rarement du devenir des allocations familiales quand il prenait la décision de placement, mais qu’il ne prenait pas toujours en compte cette donnée parce qu’il était souvent contraint d’agir dans l’urgence.
Monsieur le rapporteur, je voudrais tout d’abord saluer l’esprit dans lequel vous avez travaillé sur cette proposition de loi. Comme le montrent encore vos propos à l’instant, vous vous êtes efforcé d’élaborer, au-delà même de ce texte, une vision des questions relatives à l’aide sociale à l’enfance et à la prise en charge de l’enfance en difficulté. Certes, une partie des sujets qui ont été évoqués ne trouvent pas de réponse ou pas de réponse adéquate dans cette proposition de loi, mais ils devront nous conduire à nous rassembler à nouveau pour en discuter de manière prospective et utile afin de répondre aux difficultés soulevées par la question de l’enfance en danger.
À Mme Dalloz, M. Mariani et M. Habib, je voudrais dire qu’il est difficile de produire ensemble des raisonnements constructifs à partir de chiffres erronés et de principes flous.
Je commencerai par les chiffres erronés. Vous avez donné à plusieurs reprises une image des enfants confiés à l’ASE qui ne correspond pas à la réalité. Dans l’immense majorité des cas, les enfants placés ne sont pas des enfants maltraités ou battus par des parents indignes. Seuls 20 % des enfants confiés à l’ASE sont des enfants maltraités ; les 80 % restants sont des enfants de familles éclatées, disloquées, ou dans lesquelles il y a des malades, notamment des malades mentaux, de la précarité et de la pauvreté. Ne parlons donc pas des enfants de l’ASE, de leurs parents et de leurs familles comme de personnes indignes. Ce sont juste les plus pauvres d’entre nous, nous l’espèce humaine, nous les parents, qui voient leurs enfants confiés à l’ASE.
J’ai entendu à plusieurs reprises un autre chiffre erroné évoqué par Mme Dalloz concernant l’attribution par le juge des allocations familiales au département ou la famille. Aujourd’hui, 45 % des allocations familiales sont déjà versées aux services de l’ASE et 55 % aux familles. Voilà ce que les juges font.
Je parlais de principes flous parce que, bien que nous passions beaucoup de temps en ce moment dans l’hémicycle sur des questions relatives à la famille, je ne parviens pas à identifier la cohérence du groupe UMP sur ces sujets. Lors de la discussion de la proposition de loi sur l’autorité parentale, vous faisiez de la famille biologique l’alpha et l’oméga de tous vos raisonnements. Aujourd’hui, vous avez un raisonnement totalement inverse : la fameuse famille biologique dont vous défendez tant l’existence, l’intérêt et la survie quand il s’agit du code civil, devient le cadet de vos soucis quand il s’agit du code de la Sécurité sociale.
J’ai du mal à saisir la cohérence de vos positions. On ne peut pas aimer la famille biologique dans le code civil et la rejeter quand il s’agit du code de la Sécurité sociale !
Par ailleurs, toujours au cours du même débat, vous nous avez accusés de vouloir rigidifier, de ne pas vouloir laisser faire le juge, de vouloir trop encadrer. Mais c’est précisément ce que vous défendez aujourd’hui avec cette proposition de loi : rigidifier, encadrer le juge et l’empêcher de faire ce qu’il fait aujourd’hui, à savoir apprécier au cas par cas les situations.
Je vois en revanche une certaine logique qui consiste à retirer progressivement au juge pour enfant ses compétences, ce que vous avez déjà fait en matière pénale. Voilà qui me permet de déterminer où est la cohérence et de distinguer ce qui relève des postures…
Pour ma part, et j’ai bien entendu vos arguments, j’ai pris l’attache des experts et des différents acteurs aujourd’hui impliqués dans la défense des enfants, en particulier de la Défenseure des droits de l’enfant, de l’ensemble des associations caritatives comme ATD Quart Monde et des magistrats chargés de l’enfance : tous sont unanimes, tous pensent que votre proposition de loi n’apportera rien de plus aux services d’aide sociale à l’enfance et qu’il ne s’agit pas de moraliser les dispositifs. Vous avez parlé de moraliser, ou du moins ce terme figure-t-il dans l’exposé des motifs du texte initial.

Je n’ai pas dit « moraliser », j’ai dit que c’était moral ! Ce n’est pas la même chose !
C’est dans l’exposé des motifs ! Vous avez évoqué la fraude. On ne peut quand même pas aborder cette question en considérant que les familles dont les enfants sont placés par l’aide sociale à l’enfance se déchargent sur ces services de l’entretien, de la charge et de la nourriture de leurs enfants ! On ne peut pas regarder ces familles comme un fraudeur au fisc !
Il y a de la part de ces familles une défaillance qui est avant tout de nature sociale.
À ce propos, je voudrais citer quelques mots de Séverine, que vous connaissez peut-être, première femme journaliste, qui, à la fin du dix-neuvième siècle, aux côtés de grands auteurs comme Jules Vallès et d’autres combattait l’hygiénisme social qu’on pratiquait à l’encontre des plus pauvres, tant on disait « classes laborieuses, classes dangereuses ». Elle avait une formule dont il ne faut pas nécessairement s’inspirer à la lettre mais dont il est bon de rappeler l’esprit de temps à autre : toujours du côté des pauvres, quelles que soient leurs fautes.
Enfin, madame Dalloz, voilà quelques instants, à propos des enfants confiés à l’ASE, vous avez parlé des « enfants du département ». Croyez-moi, et c’est une spécialiste qui vous le dit, les enfants n’appartiennent ni au département ni à l’État.
Pour conclure, madame Clergeau, madame Buffet, madame Gourjade, monsieur Véran, madame Biémouret, je voulais vous remercier de votre approche à la fois pragmatique, bienveillante et utile, car la réflexion qui a été menée n’est pas simple. Il s’agit non pas d’une affaire de quelques centaines de millions, comme on pourrait le craindre après un moment de discussion, mais d’une affaire plus globale. La question est de savoir ce que nous pouvons faire de plus pour mieux accueillir les enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, pour mieux les aider et pour leur permettre de construire des liens affectifs, durables, de bénéficier d’une éducation et de trouver leur place entre leur famille d’origine, les familles d’accueil et l’aide sociale à l’enfance. Mais nous aurons à nous pencher ensemble sur ces questions très prochainement.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

La parole est à Mme la Présidente de la commission des affaires sociales.

Je tiens tout d’abord à saluer le travail effectué par M. Lurton, même si nous ne partageons pas la philosophie de son texte, ainsi que sa présence quasi-permanente en commission et, je veux le souligner, dans un esprit apaisé, ce qui n’est pas toujours le cas.
J’ai beaucoup entendu dire : « Puisque le Sénat a voté ce texte à la quasi-unanimité, pourquoi l’Assemblée nationale ne le ferait-elle pas ? » J’aimerais rappeler qu’il s’agit de deux chambres distinctes, et que la force de notre système de représentation est d’être bicaméral. Que les sénateurs socialistes votent quelque chose ne nous obligent pas, nous, les députés socialistes, à voter la même chose. Je tenais à le rappeler, car si les deux chambres faisaient strictement la même chose, il n’y aurait plus qu’à en éliminer une. Or, je ne pense pas que nous en soyons là : on élimine déjà beaucoup, on ne va pas non plus tout éliminer !
Il me paraissait important de le rappeler, car j’ai lu cet argument dans la presse et je l’ai entendu en commission. C’est la force de notre démocratie que nous ne soyons pas tous des suivistes au sein de nos groupes entre le Sénat et l’Assemblée nationale.
Une nouvelle fois, je vous remercie de votre travail, monsieur Lurton.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

J’appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte dont l’Assemblée a été saisie initialement, puisque la commission n’a pas adopté de texte.

Je suis saisie d’un amendement no 3 , tendant à la suppression de l’article 1er.
La parole est à Mme Marie-Françoise Clergeau, pour le soutenir.

Comme cela a été dit lors de la discussion générale, le dispositif de l’article 1er est inutile puisque l’article L 521-2 du code de la Sécurité sociale prévoit déjà que le juge peut décider le maintien des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
Je rappelle que 95 % des enfants placés ont vocation à revenir dans leur famille. Ces familles doivent donc faire face à des frais lors des droits de visite pendant le placement, puis pour préparer le retour de l’enfant dans la famille. Et cet article 1er ne favoriserait ni le maintien du lien avec l’enfant ni la préparation de son retour.

La commission a émis un avis favorable à cet amendement, mais je souhaite préciser qu’à titre personnel j’y suis bien sûr tout à fait opposé, et ce, pour au moins deux raisons.
Tout d’abord, la suppression de l’article témoigne du rejet quasiment viscéral par la majorité de la tentative opérée par les auteurs de la proposition de loi de mieux faire respecter l’esprit et la lettre de l’article L. 521-2 du code de la Sécurité sociale, alors que c’est pourtant là un objectif louable.
Ensuite, l’adoption de cet amendement ne me permettrait pas de défendre ceux que j’ai moi-même déposés à l’article 1er et que j’ai longuement évoqués dans ma présentation et en réponse aux intervenants. Ces amendements visent pourtant à instaurer un dispositif équilibré permettant au juge de décider au cas par cas y compris en recourant à une répartition des allocations entre la famille et l’aide sociale à l’enfance sur la base d’un taux fixe, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. D’ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit dans la discussion générale, madame Clergeau, ce dispositif ne vise pas uniquement à faire des économies ; mon souci est justement de permettre un retour le plus rapide possible de l’enfant au sein de son foyer, ce qui constitue à mes yeux une véritable économie pour les départements, une économie tout à fait souhaitable.
Favorable.

Quand j’entends un parlementaire de la majorité dire que mes propos et ceux de M. Mariani ne servent pas le débat public… De grâce, monsieur le député Olivier Véran, souffrez que la minorité s’exprime, car elle a aussi le droit de le faire dans le cadre du débat public !

Quant au populisme, je suis convaincue qu’en laissant les choses en l’état vous allez contribuer à l’encourager.
Voici la réponse à une question écrite posée sur ce sujet, en 2013, à la ministre des affaires sociales et de la santé : « Fin décembre 2011, sur les 50 941 familles dont l’un des enfants au moins était placé (soit 78 511 enfants), la plupart étaient précaires ou dans une situation de pauvreté (familles monoparentales, bénéficiaires du revenu de solidarité active [… ] ou de l’allocation de rentrée scolaire). »
J’aimerais bien, en ce qui me concerne, que l’on en revienne à la finalité des allocations familiales. Quand elles ont été conçues, avaient-elles pour but d’améliorer le quotidien d’une famille, ou bien de procurer un revenu supplémentaire à une famille qui en a besoin ?
Évidemment, vous n’aurez pas de mal à trouver des familles qui ont besoin des allocations familiales, mais, selon moi – et c’est là que nos conceptions divergent –, ce n’est pas parce qu’une famille en a besoin qu’il faut impérativement les lui donner ; il faut lui faire comprendre qu’elle a aussi des responsabilités. Quand un parent n’assume plus la parentalité, comment pourrait-on maintenir pour lui le bénéfice des allocations familiales ?
De votre côté, vous dites au contraire – c’est exactement ce que vous venez de faire, madame la secrétaire d’État – que ces familles en ont besoin, parce qu’elles sont dans la précarité et qu’il faut leur laisser ce revenu. Pensez-vous sincèrement que ce soit juste ou équitable vis-à-vis des personnes – je pense aux gens de mon département, le Jura, mais aussi à ceux du Gers, par exemple – qui, bien qu’elles soient elles aussi en situation précaire, paient la taxe d’habitation ou la taxe sur le foncier bâti, ce qui veut dire que vous leur prélevez de l’argent pour financer l’ASE ?

Votre vision est dogmatique et dépassée. Le fait d’adopter cet amendement et de supprimer l’article 1er en est une manifestation criante.

À l’article 2, je suis saisie de plusieurs amendements.
La parole est à Mme Marie-Françoise Clergeau, pour soutenir l’amendement no 4 , qui vise à supprimer l’article 2.

Cet article vise à faire faire des économies aux départements, sans prendre en compte la réalité des situations familiales. Or le département ne supporte pas toutes les charges : comme nous l’avons dit à propos de l’article 1er, 95 % des enfants placés ont vocation à revenir dans leur famille. Dans la majorité des cas, les parents continuent donc à engager des frais, y compris scolaires, pour leurs enfants. Même si je ne nie pas qu’il nous faille peut-être réfléchir différemment sur l’allocation de rentrée scolaire, car ce n’est pas la même que les allocations familiales, je demande que nous supprimions l’article 2 de cette proposition de loi.

En tant que rapporteur de la commission, je suis censé vous donner son avis. En l’occurrence, elle a émis un avis favorable sur cet amendement. Cela dit, une fois encore, j’y suis défavorable à titre personnel, pour les mêmes raisons que celles développées à propos de l’amendement visant à supprimer l’article 1er.
S’agissant de l’allocation de rentrée scolaire, le vide juridique est avéré. Or la suppression pure et simple de l’article 2 revient, non seulement à nier ce problème, mais aussi à refuser d’y apporter une solution, qui pourrait consister, comme pour les allocations familiales, en une intervention du juge, de manière à décider qui est le bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire.
Je rappelle, à cet égard, que l’allocation de rentrée scolaire est individuelle, à la différence des allocations familiales. Elle a un objet précis, qui est de permettre d’équiper un enfant pour la rentrée scolaire, au mois de septembre. Elle n’a pas vocation à maintenir à flot le budget familial. C’est pourquoi, plus encore que pour les allocations familiales, il convient de s’assurer que cette allocation bénéficie bien à l’enfant. Le juge me paraît tout à fait à même de prendre cette décision, sur la base d’un rapport de l’aide sociale à l’enfance, en fonction du comportement de la famille et de sa volonté de continuer à s’impliquer affectivement et matériellement dans la vie quotidienne de l’enfant placé. J’aurais donc voulu proposer, à travers l’amendement no 7 , de rendre possible cette intervention du juge s’agissant de l’allocation de rentrée scolaire. Malheureusement, nous ne pourrons pas l’examiner.
Favorable.

Je me suis munie de quelques chiffres, car il est important, au moment où nous débattons de cette question, que ceux de nos concitoyens qui se reporteront à nos débats aient une vision claire des choses.
Dans le département du Jura, que je connais bien, une famille d’accueil, au moment de la rentrée scolaire, perçoit de la part du département, à titre de compensation, 25 euros pour un enfant en maternelle, 50 euros pour un enfant à l’école élémentaire ou en institut médico-éducatif, 100 euros pour un collégien, 150 euros pour un lycéen et 170 euros pour un élève inscrit en lycée technique. Or, l’allocation de rentrée scolaire versée par l’État représente 362,63 euros pour les enfants âgés de six à dix ans et 382,64 euros pour ceux de onze à quatorze ans. Voilà la réalité. Cela veut dire qu’une famille d’accueil qui équipe un enfant perçoit au maximum un tiers de la somme versée aux parents, alors même que ces derniers n’équipent plus leurs enfants pour la rentrée. Si c’est là votre conception de la justice, ce n’est absolument pas la mienne.
Vous pouvez aussi me dire – car nous avons déjà eu un débat sur cette question en commission – que l’État ne peut pas verser l’allocation de rentrée scolaire au département. Soit. Mais ce sera quand même une dépense en moins pour le budget de l’État. À l’heure où nous recherchons des économies à tous crins dans nos dépenses, cela pourrait être une piste intéressante pour économiser de l’argent public.
Je ne comprends pas que vous vous obstiniez à considérer que, pour ces familles, il s’agit d’un revenu dont elles ont besoin, alors même qu’elles ne prennent plus en charge leurs enfants.

Nous avons achevé l’examen des articles de la proposition de loi.
L’Assemblée ayant rejeté tous les articles du texte, il n’y aura pas lieu de procéder au vote solennel décidé par la Conférence des présidents.

Prochaine séance, lundi 16 juin, à seize heures :
Suite de la discussion de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant.
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures cinq.
Le Directeur du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Nicolas Véron