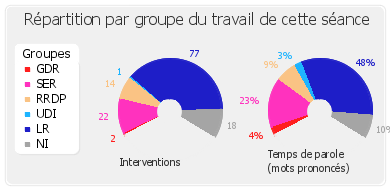Séance en hémicycle du 5 octobre 2015 à 16h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à seize heures.

Mes chers collègues, nous avons tous été bouleversés par les conséquences des intempéries meurtrières qui ont frappé les Alpes-Maritimes. L’Assemblée nationale rendra hommage aux victimes de cette catastrophe demain, avant les questions au Gouvernement.


La parole est à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les députés, il y a six mois, votre assemblée adoptait cette proposition de loi, qui présente une grande ambition : celle de faire évoluer le cadre législatif de la fin de vie dans le sens de la dignité et de la liberté des malades, parce que notre rapport à la fin de vie a évolué ; parce que les Français sont inégaux dans la connaissance et donc dans l’exercice de leurs droits ; parce que les progrès de la science et de la médecine nous permettent de vivre plus longtemps, à tel point que la frontière entre la vie et la mort s’estompe parfois.
Je ne reviendrai pas dans le détail sur les différentes étapes qui ont conduit à l’élaboration de ce texte, mais je tiens à en rappeler le sens. À travers la mission confiée au professeur Sicard, les débats régionaux et la conférence citoyenne organisée par le Comité consultatif national d’éthique, la société a pu s’exprimer le plus directement possible. Patients, professionnels de santé, représentants des grandes familles de pensée ou religieuses : tous ont été entendus, chacun a pu faire valoir son point de vue. Le Président de la République a souhaité qu’un consensus le plus large possible soit trouvé pour proposer une étape législative nouvelle. C’est le sens de la mission qui vous a été confiée, M. Alain Claeys et M. Jean Leonetti, et je tiens à saluer à nouveau votre travail.
Le texte que vous avez élaboré comprend des avancées importantes, sur lesquelles je veux revenir. D’abord, le texte renforce l’accès aux soins palliatifs, aujourd’hui insuffisant. Les soins palliatifs constituent l’un des grands progrès de la médecine à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, en ce qu’ils permettent d’apaiser les souffrances des personnes en fin de vie. Les unités se sont développées, le nombre de lits a été multiplié par vingt en dix ans. Pour autant, si les deux tiers des Français qui meurent de maladie ont aujourd’hui besoin de soins palliatifs, une grande partie d’entre eux n’y a pas accès, ou trop tardivement. Cette injustice, tant sociale que territoriale, est inacceptable.
C’est pour moi une priorité : garantir l’accès à cet accompagnement, que ce soit à l’hôpital, en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou à domicile. Le Président de la République a annoncé un nouveau plan triennal de développement des soins palliatifs. J’ai réuni le 24 juin dernier les membres de son comité de pilotage. Ce plan national triennal pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie comprendra quatre priorités et s’adressera tant aux professionnels de santé qu’aux patients eux-mêmes : d’abord, mieux informer les patients et leur permettre d’être au coeur des décisions qui les concernent ; ensuite, accroître les compétences des différents acteurs, en confortant la formation, en soutenant la recherche et en diffusant mieux les connaissances sur les soins palliatifs ; troisième orientation, développer les prises en charge de proximité, notamment au domicile ou dans les établissements sociaux ou médico-sociaux ; enfin, réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs. Je présenterai très prochainement aux acteurs des soins palliatifs le détail de ce plan dans le cadre d’un déplacement auprès d’une structure particulièrement impliquée dans la prise en charge des soins palliatifs à domicile. Le texte que nous examinons propose de reconnaître à toute personne malade un droit universel à accéder aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire. Les agences régionales de santé auront la charge de veiller à sa bonne application.
La deuxième grande avancée de ce texte est la possibilité donnée à nos concitoyens de faire valoir leurs droits. Les Français ne sont pas suffisamment informés de leurs droits. Près de la moitié de nos concitoyens ignore que le patient peut demander l’arrêt des traitements qui le maintiennent en vie. Seuls 2,5 % d’entre eux ont rédigé des directives anticipées, alors même que l’existence de telles directives pourrait, dans bien des cas, répondre à l’incertitude.
La proposition de loi propose ainsi de rendre les directives anticipées contraignantes et de supprimer leur durée de validité. C’est une avancée majeure, parce que ces directives ne constituent aujourd’hui que l’un des éléments de la décision du médecin. Désormais, c’est la volonté du patient qui sera déterminante. Rester maître de sa vie jusqu’au moment où on la quitte, voilà l’enjeu de dignité auquel ce texte s’attache. Pour permettre à nos concitoyens d’exercer leur droit, le texte prévoit de renforcer l’information sur les directives anticipées. Les amendements que vous avez adoptés lors de la première lecture y ont concouru. Ils prévoient l’élaboration d’un formulaire-type de directive anticipée sous l’égide de la haute autorité de santé et la création d’un registre national automatisé. L’objectif est de permettre à chaque Français de rédiger une directive anticipée de la manière la plus simple qui soit et de donner aux médecins une visibilité immédiate sur ces directives et d’abord sur l’existence ou non de celles-ci.
Enfin, la troisième avancée de ce texte est de franchir une étape supplémentaire en faveur de l’autonomie des personnes. L’encadrement de l’arrêt des traitements tel qu’il a été prévu par la loi de 2005 a constitué un progrès indéniable pour la dignité des malades. Personne ne conteste cet état de fait. Mais depuis 2005, la société a évolué et avec elle, nos attentes et notre rapport à la fin de vie. Beaucoup de patients, beaucoup de familles, ont le sentiment de ne pas être suffisamment entendus, parce qu’en l’état actuel du droit, c’est au seul professionnel de santé que revient la décision d’interrompre ou de ne pas initier les traitements. Et dans le même temps, des médecins m’ont aussi dit être désemparés lorsqu’ils ont à présumer et donc à assumer, seuls, la décision d’interrompre ou non les traitements.
Les Français attendent aujourd’hui que nous franchissions une étape nouvelle dans le renforcement des droits des personnes en fin de vie. C’est ce que propose ce texte, qui précise les modalités d’interruption des traitements. Il clarifie la notion « d’obstination déraisonnable » et propose d’instaurer un droit à bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. À l’heure actuelle, ce traitement relève de la seule appréciation médicale. Son application dépend donc largement du territoire, de l’établissement ou même du service. Il s’agira désormais d’un droit concret, reconnu à tous et partout.
Ce texte présente donc de grandes avancées. Son examen en première lecture a montré qu’il constituait un point d’équilibre. J’ai déjà eu l’occasion de le dire ici : sur un sujet comme celui de la fin de vie, il n’y a pas de vérité absolue. Nul ne détient la vérité, nul ne peut prétendre imposer sa vérité aux autres, mais chacun doit pouvoir exprimer sa conviction profonde. Certains parmi vous considèrent ce texte insuffisant et souhaiteraient aller plus loin. D’autres, au contraire, ne soutiennent pas ce texte, dans la mesure où ils souhaiteraient en rester au cadre juridique de la fin de vie tel qu’il existe aujourd’hui : cette position s’est exprimée de manière engagée, en particulier au Sénat.
Le Président de la République a fixé un cap clair : franchir une étape de liberté pour les malades, dans un moment où notre société a besoin de rassemblement. Ce texte rassemble très largement dans cet hémicycle, une immense majorité des députés l’a ainsi voté en mars dernier. Son examen par le Sénat a aussi montré qu’il constituait un point d’équilibre : plusieurs avancées ayant été supprimées en séance, il a été finalement rejeté à une écrasante majorité, aucun groupe ne soutenant plus son adoption. En commission, il y a quelques jours, vous avez fait le choix d’en rester à ce point d’équilibre. C’est donc le texte que vous avez adopté il y a six mois qui revient devant vous aujourd’hui. Ce texte, personne ne nie qu’il constitue une véritable avancée en faisant du patient le maître de son destin. Mais cet équilibre reste fragile : nous avons vu combien l’adoption d’une disposition, dans un sens comme dans l’autre, porte le risque de déstabiliser son ensemble.
Mesdames et messieurs les députés, les Français attendent de nous de la responsabilité et que nous redonnions « de la vie à la mort », si tant est que cela soit possible, en permettant à chacun, jusqu’au dernier instant, d’être respecté dans sa personne.
À nous de nous montrer, collectivement, à la hauteur de cette attente. Ce texte permettra de franchir une étape considérable. L’opposabilité des directives anticipées, couplée à la reconnaissance de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, renverse – et c’est bien là l’essentiel – la logique de décision : c’est le patient, et non plus le médecin, qui devient le maître de son destin.
Je l’ai déjà dit ici-même, le débat, comme tout débat de cette ampleur, reste ouvert. Vous aurez aujourd’hui, en tant que parlementaires, comme auront à le faire vos successeurs, à juger de l’application de cette loi. Et si plus tard une étape supplémentaire vous apparaît nécessaire, vous aurez alors à en décider.
Mais aujourd’hui, au nom du Gouvernement, je vous demande, par cohérence, par souci d’efficacité et par respect du travail conduit et des équilibres de notre société, de ne pas bouleverser l’architecture de ce texte tel qu’il a été adopté.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

La parole est à M. Alain Claeys, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, madame la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie revient devant nous en deuxième lecture.
Déposée en janvier dernier par Jean Leonetti et moi-même sur le bureau de notre assemblée, discutée en commission des affaires sociales en février et dans notre hémicycle en mars, elle a été adoptée en première lecture le 17 mars, par 442 voix contre 33.
Mes chers collègues, le texte que le Sénat a rejeté en juin dernier, par 196 voix contre 87, n’est pas celui que vous aviez adopté en mars. La sédation profonde et continue jusqu’au décès ainsi que les directives anticipées – qui ne s’imposeraient plus aux médecins – ont été abandonnées, et la parole attribuée à la personne de confiance limitée. Ainsi, tout ce qui faisait l’avancée de notre texte a été remis en cause en séance publique au Sénat.
Je sais le travail de nos collègues rapporteurs au Sénat, Michel Amiel et Gérard Dériot, et du président Alain Milon. Comme beaucoup au sein de la Haute assemblée, ils souhaitaient enrichir notre texte.
Malheureusement, ils ont dû assister, à longueur d’amendements, à la déconstruction pièce par pièce du texte initial et même – pourquoi ne pas le dire – à une remise en cause de la loi de 2005. À ce stade, le rejet par le Sénat ne pouvait être, de mon point de vue, que salutaire.
Et pourtant, mes chers collègues, le pays a besoin, et rapidement, de cette loi : chaque jour qui passe voit le mal-mourir perdurer dans notre pays. Les inégalités entre structures ainsi qu’entre territoires demeurent criantes.
Ce texte, nous le devons donc à nos concitoyens. Il s’inscrit dans le prolongement des grandes lois traitant de la fin de vie : la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Il est aujourd’hui l’expression du progrès nécessaire. Mais il y a un préalable : l’optimisation des politiques de soins palliatifs, tant dans leur généralisation que dans la formation des intervenants.
Vous le savez, des inégalités existent entre services. Une étude de l’Institut national d’études démographiques, l’INED, montrait qu’en 2012 déjà 52 % des personnes atteintes d’un cancer bénéficiaient de soins palliatifs contre moins d’un quart pour les patients touchés par une maladie respiratoire ou cardio-vasculaire.
Ces inégalités s’observent également entre régions, avec des écarts de un à quinze entre les territoires. Et que dire des différences entre les hôpitaux d’une part et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, d’autre part, sans évoquer même la mort à domicile ?
Je sais combien nous avons déjà fait dans ce domaine : au cours des quinze dernières années, le nombre de lits de soins palliatifs a plus que doublé. Si je vois le chemin parcouru, je mesure la distance qu’il nous reste collectivement encore à parcourir pour permettre à nos concitoyens de bénéficier d’un droit premier : l’égalité devant la mort.
Madame la ministre, vous avez présenté les grandes lignes de votre plan triennal de développement des soins palliatifs. Je ne peux que saluer, comme l’ensemble de mes collègues ici présents, cet indispensable effort dans un domaine qui en a tant besoin.
De la même façon, et là encore, comme le Président de la République s’y est engagé en décembre dernier, vous allez mettre en place un enseignement spécifique obligatoire et commun à tous les étudiants concernés. Consacré à l’accompagnement des malades, il sera intégré à l’ensemble des formations sanitaires, qu’il s’agisse des diplômes d’État ou des études de médecine.
Développement du nombre de lits, diversification des lieux d’intervention, formation des professionnels de santé, mais aussi des aidants : voilà les défis que nous avons à relever pour que la proposition de loi que nous avons largement adoptée en première lecture prenne toute sa place dans l’accompagnement vers la fin de vie de nos concitoyens.
Notre texte n’oppose ni les soins curatifs aux soins palliatifs, ni ces derniers à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Le texte de l’Assemblée offre de nouveaux droits et n’en retire aucun.
Compte tenu du vote du Sénat, c’est le texte adopté – à une très large majorité – en mars, qui revient, intact, devant nous. Il répond, je le crois, à la double demande des Français : être entendu, c’est-à-dire disposer de son existence jusqu’à son ultime moment, et, par ailleurs, bénéficier d’une fin de vie apaisée.
Le droit à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associé à une analgésie ainsi qu’à l’arrêt des traitements de maintien en vie, correspond à cette demande.
Un patient atteint d’une affection grave et incurable qui provoque chez lui une souffrance réfractaire aux traitements, mais qui demeure conscient, pourrait ainsi, lorsque son pronostic vital sera engagé à court terme et qu’il jugera inutile de prolonger sa vie finissante, demander à bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’à son décès. Elle sera, naturellement, accompagnée d’une analgésie et de l’arrêt de tout traitement de maintien en vie.
De même, un malade atteint d’une affection grave et incurable qui souhaiterait arrêter les traitements, engageant ainsi son pronostic vital, pourra bénéficier de ce même traitement à visée sédative et antalgique. Celui-ci provoquera une altération maintenue de sa conscience et ce jusqu’à son décès.
Enfin – et ce sont les cas les plus connus de nos concitoyens – les malades en état végétatif pourront également bénéficier de ce traitement à visée sédative. Il faudra, pour cela, que leur volonté en ce sens soit recueillie. Elle pourra l’être au travers de la personne de confiance qu’ils auront antérieurement désignée ou des directives anticipées qui s’imposeront désormais au médecin.

Renforcées dans leur finalité, ces directives anticipées satisferont, je l’espère, la volonté des Français de disposer de leur vie, même une fois leur conscience altérée.
Je conclus, monsieur le président : cette loi apportera d’importants progrès pour des millions de patients. Car ce qui nous réunit ici, c’est la bienveillance envers nos concitoyens et notre volonté d’améliorer le sort de tous.
Car si aucune vie n’est inutile, il arrive en revanche que sa prolongation le devienne. Offrir la possibilité, à la demande du patient, et à sa seule demande, de ne pas prolonger inutilement sa vie, c’est cela et rien d’autre que prévoit ce texte.
Quiconque a côtoyé la mort de ses proches sait que vient à tout mourant ce moment si particulier où chaque seconde supplémentaire ne répond plus à un bénéfice de vie. Partir apaisé, ne pas prolonger inutilement son existence mais décider sereinement de s’endormir calmement : voilà ce que permettra ce texte.
Cette loi est un texte d’humanité. Mes chers collègues, il appartiendra demain au Sénat de l’enrichir ou de le rejeter.

Il nous appartient aujourd’hui de préserver la somme des progrès que vous avez largement approuvés en première lecture et de permettre ainsi à l’ensemble de nos concitoyens de connaître, partout sur notre territoire, dans les conditions qu’ils auront eux-mêmes au préalable définies, une fin de vie apaisée.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

La parole est à M. Jean Leonetti, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, je vous remercie tout d’abord d’avoir rappelé le drame que vivent mon département et ma ville suite aux intempéries majeures qui les ont plongés dans le deuil et le désarroi.
Madame la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous abordons la deuxième lecture de cette proposition de loi.
Le débat, pourrait-on dire, a eu lieu et le texte dont nous débattons est identique à celui qui est sorti de nos débats et que nous avons adopté massivement.
Le débat a eu lieu ici et, je dois le dire, il a été respectueux et ouvert, en tout cas loin des caricatures – s’appuyant, d’un côté comme de l’autre, sur des positions tranchées – que l’on a pu en faire à l’extérieur.
Ce texte n’est pas dû à la seule initiative de deux parlementaires : il s’inspire de deux rapports majeurs, celui du professeur Sicard, et celui du Comité consultatif national d’éthique, qui a également rendu public un avis, d’une lettre de mission du Premier ministre et, enfin, de la volonté du Président de la République qu’un large consensus s’établisse sur ces problèmes. Ils doivent en effet nous rassembler au-delà de notre diversité et de nos convictions.
Ce texte établit deux droits nouveaux : d’abord celui, en phase terminale, à la sédation profonde. Il permet à chacun d’entre nous et à chaque citoyen de ce pays de disposer désormais du droit, lorsque les traitements sont inopérants contre sa souffrance et que sa fin est proche, de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir.
Je rappelle à ceux qui défendent – comme moi et comme la plupart d’entre nous – les soins palliatifs, que les conditions de mise en place de cette sédation en phase terminale correspondent aux recommandations de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Le deuxième droit a trait aux directives anticipées, qui, sans être opposables à tout moment, – si elles l’étaient, que ferions-nous devant une tentative de suicide survenant à l’hôpital et dont l’auteur ne pourrait pas être réanimé ? – sont désormais contraignantes.
Elles permettent ainsi de répondre à ce besoin de mieux entendre la parole du malade au moment où les décisions doivent être précises.
Bien entendu, Alain Claeys et moi-même – et vous avez, madame la ministre, en grande partie répondu à notre demande – avons dit que cette loi nécessitait deux préalables : la formation des soignants et le développement des soins palliatifs.
Faut-il refaire une loi pour réaffirmer, une fois de plus, la nécessité des soins palliatifs alors que la loi du 9 juin 1999 l’a déjà fait ? Ne faudrait-il pas que les lois soient plus efficaces plutôt que de les faire se succéder ?
La réponse est équilibrée, et elle répond à l’attente de nos concitoyens dont le mal-mourir perdure. Ils disent en effet : nous continuons à souffrir en fin de vie, et notre parole n’est pas entendue.
Puisque j’entends souvent que l’immense majorité des Français serait favorable à l’euthanasie, permettez-moi de rappeler le sondage réalisé par l’Institut français d’opinion publique, l’Ifop, à la suite des propositions qui ont été formulées : 96 % des Français se sont déclarés favorables, en cas de souffrance réfractaire et lorsque la mort est proche, à une sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Ce texte se situe dans la continuité de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie qui, dans un contexte passionnel, a été validé par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme. Permettez-moi de vous rappeler les faits selon lesquels cette loi établit que l’hydratation et la nutrition sont des traitements.
Je rappelle également que ce sont cette loi et celle du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui prévoient que l’obstination déraisonnable peut être jugée par le malade lui-même.
Je rappelle enfin que la même loi de 2005 prévoit que la poursuite du seul maintien artificiel de la vie par un traitement peut être considérée comme une obstination déraisonnable.
On ne peut pas affirmer qu’il ne faut pas toucher à cette loi et qu’elle est parfaite, et dans le même temps, comme le Sénat l’a fait au fur et à mesure de l’adoption de divers amendements, remettre en cause ses fondements. Ces amendements ont en effet non seulement vidé le nouveau texte de sa substance mais également détruit la loi de 2005.
Je voudrais donc inciter chacun et chacune d’entre nous, par cohérence vis-à-vis du texte qui nous revient et qui a été, comme je l’ai dit, voté à une large majorité, et par respect pour la proposition du Sénat, à ne pas envisager d’introduire dans ce texte de déséquilibres.
Bien sûr, en poussant le curseur d’un côté ou de l’autre, on peut très bien obtenir un texte allant à l’inverse des objectifs qu’il s’était lui-même fixés.
Le texte dont nous débattons est un texte d’équilibre entre l’Assemblée nationale et le Sénat, mais également entre la solidarité que l’on doit manifester envers les plus fragiles, et l’autonomie que l’on doit respecter y compris et surtout à leur égard.
Robert Badinter disait que la politique pouvait être considérée comme un affrontement dans une arène de gladiateurs. Ce peut être aussi la recherche consensuelle du bien commun, qui dépasse tout clivage, pour faire en sorte qu’il corresponde à l’attente de nos concitoyens.

La proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui en seconde lecture concerne la fin de vie, dont nous avons déjà plusieurs fois débattu ici.
Face à un tel sujet, le Président de la République a engagé une démarche visant à trouver un consensus, en confiant à deux députés de sensibilités différentes, nos collègues Alain Claeys et Jean Leonetti, la rédaction d’un rapport et de la proposition de loi que nous étudions aujourd’hui.
Ce nouveau texte ne marque pas de rupture fondamentale. Il est dans la continuité de la première loi sur les soins palliatifs de 1999, de celle sur les droits des malades de 2002 et de celle sur la fin de vie de 2005, mais il marque un indiscutable progrès dans la liberté de choix de chacun de nos concitoyens.
Il s’agit en effet, essentiellement, d’inscrire dans la loi le droit à une sédation profonde et continue en cas de douleur réfractaire à tout traitement et de renforcer auprès du corps médical le droit des patients en rendant leurs directives anticipées opposables aux médecins et en renforçant la place de la personne de confiance par eux désignée.
En première lecture, et, avant cela, lors de la présentation du rapport, j’avais, en mon nom propre et au nom de la majorité des députés du groupe GDR, mais pas de la totalité, approuvé à la fois la démarche consensuelle, qui s’appuie sur les nombreux travaux réalisés en amont, notamment par le comité consultatif national d’éthique, et le contenu de ce texte.
Je m’étais également inquiétée de l’état des soins palliatifs dans notre pays car la politique suivie par ce gouvernement comme par ses prédécesseurs concernant la santé en général et les hôpitaux publics en particulier contredit les déclarations sur leur nécessaire développement. Comment peut-on en effet annoncer vouloir supprimer 22 000 postes de travail dans les hôpitaux d’ici à 2017 et prétendre développer les soins palliatifs ?
J’avais enfin déploré la quasi-inexistence de soins palliatifs dignes de ce nom en ville, hors de l’hôpital, et dans les EPHAD.
Le texte adopté par la commission et présenté aujourd’hui est le même que celui que nous avons adopté à une large majorité en mars dernier. En dépit de la complexité et du sérieux du sujet traité, le Sénat a malheureusement été le lieu d’une médiocre bataille politicienne le conduisant à n’adopter aucun texte.
En effet, après avoir, par voie d’amendements, remis en cause le caractère continu de la sédation profonde et le fait que l’hydratation et la nutrition soient considérées comme un traitement et tenté de diminuer la portée des directives anticipées, la majorité des sénateurs ont finalement repoussé le texte qu’ils avaient pourtant amendé, mais profondément dénaturé, privant ainsi le Sénat d’expression sur un sujet aussi capital.
On peut dire que les sénateurs responsables de cette situation ont agi non pas au nom de l’intérêt supérieur du patient en veillant au respect des différentes approches et sensibilités de nos concitoyens, mais au nom de considérations idéologiques et partisanes. Comme l’a très justement résumé la sénatrice Françoise Gatel, le Sénat a manqué à son devoir de fraternité et d’humanité.
Ces sénateurs ont notamment dénoncé ce qu’ils appellent le « flou » qui entoure d’après eux la notion de sédation profonde et continue, y voyant la porte ouverte à une certaine forme d’euthanasie. Ce qui ici est qualifié de flou est la marge laissée à l’appréciation du patient en fin de vie, de sa famille qui l’entoure et des soignants qui l’accompagnent.
Notre travail de législateur consiste précisément à encadrer les pratiques humaines au nom de principes que nous jugeons supérieurs. Les pratiques humaines sont la façon de terminer sa vie. Les principes sont à la fois le respect de la liberté individuelle et le respect de la vie.
Autant dire que nous ne parviendrons pas à légiférer sur ces questions en embrassant la totalité des situations envisageables. Tout au plus pouvons-nous espérer trouver un point d’équilibre acceptable par tous, équilibre évidemment fragile et appelé à évoluer au rythme des évolutions de la société et des connaissances.
Je considère qu’à cette étape, l’objectif est atteint dans la mesure où ce texte permet à la fois d’accompagner le patient en douceur jusqu’à la fin, sans acharnement thérapeutique, et de refuser tout acte médical qui viserait à administrer délibérément la mort.
Il permet de répondre à l’immense majorité des cas. Nous devons cependant admettre que la loi, par définition générale, ne peut pas répondre à la totalité des situations envisageables, pour lesquelles il faut accepter de s’en remettre à la liberté des personnes en fin de vie, à l’amour de leurs proches, au professionnalisme et à l’éthique de l’équipe médicale, voire, dans quelques cas et en toute dernière instance, à l’intelligence de la justice.
Si le contenu du texte nous convient, autre chose est son application dans la vraie vie car, dix ans après la loi de 2005, on meurt toujours mal en France.

Il n’y a toujours pas de formation spécifique aux soins palliatifs dans le cursus d’enseignement universitaire. La Cour des comptes, dans son dernier rapport public annuel pour l’année 2015, intitulé de façon très explicite « Soins palliatifs : une prise en charge toujours très incomplète », s’en fait l’écho, indiquant que la culture médicale reste « marquée par la survalorisation des prises en charge techniques, au détriment des dimensions d’accompagnement et de prise en charge globale ». Et la Cour d’ajouter que « la mise en place d’une filière universitaire de médecine palliative est considérée par de nombreux acteurs comme essentielle pour une véritable promotion de la démarche et pour le développement d’activités de recherche ». Cette recommandation est très importante. Madame la ministre, maintenez-vous votre opposition à la mise en place de cette filière comme c’est mentionné dans votre réponse à ce rapport ?
Par ailleurs, le maillage territorial en unités de soins palliatifs est très hétérogène d’une région à l’autre. Ainsi, il y a très peu d’unités de soins palliatifs, sinon aucune, dans les Pays-de-Loire ou les régions d’outre-mer. Quelles mesures comptez-vous mettre en oeuvre pour assurer la présence de tels services sur l’ensemble du territoire et permettre ainsi une égalité de traitement de tous les citoyens ?
À côté de ces unités hospitalières, les réseaux de soins palliatifs, quand ils existent, font en ville un travail remarquable et injustement méconnu, cette ignorance permettant de ne pas les financer à la hauteur de ce qu’ils apportent dans la vie de nos concitoyens. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les incitations mises en place par les ARS pour favoriser le développement de ces réseaux de ville ?
Enfin, il nous paraît indispensable que les EPHAD soient tenus de conclure des conventions avec les unités mobiles de soins palliatifs afin que leurs résidents meurent dans des conditions dignes, avec un accompagnement spécifique. Que pensez-vous d’une telle obligation ?
Lors de l’examen de ce texte en première lecture à l’Assemblée, vous avez annoncé un plan triennal de développement des soins palliatifs qui, s’il devait être effectivement mis en oeuvre, permettrait de répondre à certaines des préoccupations que je viens d’évoquer. Je salue bien sûr cette annonce mais je m’inquiète. Quels moyens financiers et humains seront affectés aux soins palliatifs, sachant que vous annoncez dans le même temps un plan d’économie sur la santé de 10 milliards d’euros, dont 3 pour les hôpitaux publics ?
Pour conclure, nous voterons ce texte, dont nous partageons le contenu, mais, vous l’avez compris, nous restons extrêmement préoccupés et, je l’avoue, dubitatifs sur les conditions de son application.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

La mort, cette aventure horrible et sale, disait Albert Camus. Pourtant, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est non pas tant pour cette horreur et cette saleté que nous la redoutons d’abord, mais pour cette aventure souvent douloureuse, souvent solitaire qui nous y mène.
Douleurs, solitude, la mort est en la matière très inégalitaire, et c’est envers les grands âgés, pourtant ô combien en première ligne, qu’elle l’est le plus durement suivant qu’ils sont au domicile, en établissement, voire en service d’urgence.
Ce sont aujourd’hui de nouveaux droits que nous allons, je l’espère, confirmer avec cette proposition de loi : droit à n’être pas seul et à ne pas souffrir avec le développement et, bientôt, la généralisation des pratiques de soins palliatifs – non, il n’est pas acceptable que seulement 25 % de ceux qui pourraient en bénéficier y accèdent aujourd’hui ; droit à voir sa volonté respectée, et la sienne seule, par la possibilité d’écrire mais aussi de réviser à tout moment des directives anticipées qui s’imposeront au médecin ; droit à la sédation continue jusqu’à la fin, qui n’est pas la mort, ni l’intention de la donner.
Souvenons-nous de la prière de Moïse : « Seigneur, vous m’avez fait vieillir puissant » ou pas « et solitaire, laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre ».
Oui, ce sommeil de la terre n’est pas le sommeil éternel qu’est la mort. Il est bien, la sédation terminale également, l’apaisant sommeil de la terre.
Vous le savez, certains auraient aimé que nous allions plus loin, d’autres jugent que nous allons trop loin. Sur ce sujet si profondément humain et intime, il était nécessaire de rechercher le plus large consensus. Nous l’avons fait à l’issue de la première lecture dans cette assemblée et, pour ma part, j’invite chacun de nous à confirmer ce vote.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous examinons en deuxième lecture la proposition de loi de MM. Claeys et Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Le texte avait été approuvé en première lecture par l’Assemblée nationale, le 17 mars dernier, par 436 voix pour, 34 contre et 83 abstentions.
En commission des affaires sociales du Sénat, un certain nombre d’amendements, que nos deux rapporteurs ont eux-mêmes qualifiés d’utiles en commission cette semaine, ont été discutés et adoptés. Mais, en séance, le texte initial a été profondément modifié, au point même de revenir sur la loi de 2005, avant d’être logiquement rejeté par 196 voix contre 87, le 23 juin.
Nos collègues Leonetti et Claeys ont donc choisi de présenter en deuxième lecture à l’Assemblée nationale la version du texte adoptée en première lecture. Il y aura une deuxième lecture au Sénat, puis une commission mixte paritaire.
Dix ans après la promulgation de la loi de Jean Leonetti, auquel vous me permettez de rendre un hommage appuyé, chacun s’accorde, me semble-t-il, à reconnaître que la loi éponyme répond à l’immense majorité des situations de fin de vie. Il y a aussi consensus, je pense, pour affirmer deux réalités : la loi étant mal connue, elle n’est pas appliquée systématiquement ; les soins palliatifs auxquels les patients devraient pouvoir prétendre sont loin d’être accessibles à tous et les disparités géographiques sont très fortes.
Cette question de la fin de vie a fait l’objet d’une large concertation et de propositions : avis du comité consultatif national d’éthique, rapport Sicard, consultations en région, mais aussi rapport de la Cour des comptes de février 2015, dont je vous invite à relire les six recommandations.
Je veux, à cet instant, de nouveau saluer la contribution des deux rapporteurs de la loi, Jean Leonetti, député Les Républicains, et Alain Claeys, député socialiste. Ils ont bien entendu intégré dans leur réflexion le contenu et les conclusions de tous ces débats publics, mais ils ont aussi beaucoup travaillé et auditionné, avec à l’esprit la volonté de rendre la loi de 2005 totalement opérationnelle.
Dans sa majorité, le groupe Les Républicains partage pleinement l’esprit de leur proposition de loi : le refus de l’acharnement thérapeutique et de l’obstination déraisonnable, la non-souffrance de la personne, mais aussi l’interdiction de tuer, qui doit rester absolue – autrement dit, soulager mais pas tuer. Nous estimons en effet que le droit à la vie est le premier des droits de l’homme et que personne ne peut disposer de la vie d’autrui. C’est la raison pour laquelle nous restons opposés à toute légalisation de l’euthanasie.

Nous mettons aussi en garde contre la tentative d’aide active à mourir qui risque de recouvrir les mêmes réalités. Nous nous opposerons à tous les amendements qui iront dans ce sens.
Nous estimons, au contraire, que notre corpus juridique doit créer les conditions favorables à un accompagnement tout au bout de la vie. Certains de nos semblables se trouvent dans une situation d’extrême fragilité et rien dans notre regard ne doit trahir l’idée qu’ils ne seraient plus dignes de vivre. Nous disposons de nombreux témoignages d’équipes qui travaillent dans des unités de soins palliatifs. Si les demandes de recours à l’euthanasie existent, dans l’immense majorité des cas, elles ne sont pas réitérées, dès lors que les personnes sont soutenues et accompagnées, et que leur souffrance est soulagée.
Notre rôle de législateur est de parvenir à concilier le droit des patients à s’exprimer et le devoir des médecins à soulager. Si la loi est mal appliquée par le monde médical, c’est par manque d’information ; il faut donc renforcer la formation des jeunes médecins à l’accompagnement du patient, tout au long du parcours de santé. Cela est annoncé et nous veillerons à sa mise en oeuvre réelle. Nous estimons aussi que tout établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, toute structure d’hospitalisation à domicile devraient être tenus de mettre en place un plan de formation spécifique de son personnel à l’accompagnement de la fin de vie.
Si la loi est mal appliquée dans notre pays, c’est surtout parce que le recours aux soins palliatifs n’est pas systématique. La France ne compte pas suffisamment d’unités spécialisées : seulement un tiers des personnes qui décèdent à l’hôpital et qui auraient pu recevoir des soins palliatifs en ont effectivement bénéficié. La Cour des comptes constate néanmoins des progrès réels, surtout entre 2008 et 2012.
En 2013, les dépenses d’assurance-maladie relatives aux prises en charge palliatives dans les établissements de santé sont de l’ordre de 1,6 milliard d’euros, dont près des trois quarts sont concentrés sur le court séjour, près de 127 millions d’euros consacrés aux équipes mobiles et près de 300 millions d’euros à l’hospitalisation à domicile. Nous sommes encore loin du compte avec le report incessant du nouveau plan de développement des soins palliatifs. Il est donc plus que temps de dégager les moyens concrets nécessaires pour en garantir l’accès à tous. À défaut, l’engagement du Président de la République restera lettre morte. Nous ne pouvons faire l’économie d’un plan pluriannuel, à l’instar du plan cancer.
Vous venez d’évoquer, madame la ministre, un plan triennal visant à promouvoir la culture palliative et vous nous annoncez une visite ministérielle. Mais nous espérons surtout la traduction de ce plan dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 que nous allons examiner dans les prochains jours.

Je vous vois sourire, madame la ministre. J’ai donc bon espoir.
Ce dimanche 11 octobre sera la journée mondiale des soins palliatifs. Ce pourrait être l’occasion d’adresser un message d’espoir aux équipes qui font un travail remarquable et aux bénévoles des associations qui s’engagent avec humanité dans l’accompagnement psychologique. L’attente est grande s’agissant du développement des soins palliatifs, tout comme l’est la crainte de toute tentative de légalisation de l’euthanasie qui serait forcément un prétexte pour relâcher les efforts.
Avec ce texte, nos collègues Alain Claeys et Jean Leonetti nous proposent une voie permettant d’améliorer la loi de 2005 sans en dévoyer l’esprit, notamment grâce à deux mesures emblématiques : une meilleure prise en compte des directives anticipées par l’équipe médicale, contraignantes sans pour autant être opposables, et un droit absolu à la prise en compte de la souffrance, au moyen de la sédation profonde et continue jusqu’à la mort, lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Ce n’est pas une pratique systématique, mais bien une pratique ultime. Au cours de nos débats, chacun s’exprimera en conscience sur cette question de la sédation et, nous l’espérons, dans le respect des convictions de chacun.
Dans sa majorité, en première lecture, le groupe Les Républicains a estimé qu’un point d’équilibre a été trouvé avec ce texte et il n’a pas souhaité que cet équilibre fragile soit rompu. Notre société a été particulièrement malmenée par des réformes sociétales qui l’ont profondément divisée. Dans le contexte actuel, nos concitoyens attendent de nous, sur des sujets aussi complexes et sensibles, des propositions qui ne heurtent pas les consciences et qui rassemblent.
Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pudeur et humilité doivent nous saisir, alors que nous examinons une nouvelle fois ce texte. Pudeur d’abord, car la mort relève avant tout de l’intime. Elle est l’affaire des seuls individus, qu’ils la fuient ou qu’ils s’y préparent tout au long de leur vie. Humilité ensuite, car, ainsi que l’exprimait le philosophe Emmanuel Levinas, la mort est le « sans-réponse ». La mort n’existe que pour ceux qui restent et nous ne pouvons parler que de la mort des autres. Dès lors, comment trouver les mots justes pour l’évoquer ?
En 2005, la loi Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie, adoptée à l’unanimité, était parvenue à trouver un subtil équilibre : mieux respecter l’expression et la volonté des malades et prendre en compte les souffrances de ceux qui sont en fin de vie. Cette loi a amélioré le respect et la compréhension de la volonté du malade, en prenant en compte non seulement les douleurs, mais aussi la souffrance des malades en fin de vie, selon la belle distinction qu’autorise notre langue entre la douleur physique et la souffrance morale, plus englobante. Elle a fait progresser les soins palliatifs, fût-ce insuffisamment, et a condamné clairement l’acharnement thérapeutique.
Dix ans après cette loi, il nous fallait pourtant légiférer. Malgré les évolutions qu’a apportées la loi Leonetti, des difficultés subsistent. La douleur des patients n’est pas toujours prise en compte, et l’obstination déraisonnable demeure malheureusement une réalité dans notre pays. L’accès aux soins palliatifs est loin d’être toujours effectif et la formation des médecins demeure insuffisante.
Alors que nous devons légiférer à nouveau, quelques principes doivent nous guider : ni souffrance, ni abandon, ni acharnement. Aborder la question de la fin de vie impose de prendre en compte la dignité de la personne humaine. Il est de notre devoir de faire en sorte de soulager la douleur et la souffrance. Dans ces cas précis, le renforcement des soins palliatifs constitue une priorité. Toute personne qui vit ses derniers instants a le droit d’être accompagnée jusqu’au dernier moment.
Cependant, dans des hôpitaux au personnel surchargé de travail, le risque d’un traitement mécanique et impersonnel demeure. Les proches eux-mêmes ont bien du mal à trouver les mots justes qui pourraient servir à accompagner et à aider les mourants. Avec ce texte et ces mots, c’est à la solitude des mourants que nous voulons répondre. Ces hommes et ces femmes appelés à partir ont besoin d’une attention toute particulière à l’heure ultime de leur vie. Accompagner, veiller, atténuer les peurs et les souffrances, offrir une fin de vie digne et apaisée : tel est notre devoir.
Sur ce sujet intime, il ne serait pas possible de répondre aux attentes de chacun d’entre nous. Il y aura, à côté de ceux qui s’estiment satisfaits par le texte en l’état, ceux qui voudraient aller plus loin et ceux qui trouvent que le texte n’est pas une réponse aux imperfections de la loi Leonetti, mais qu’il opère un profond changement de paradigme. Il s’avère difficile voire impossible de trouver une réponse unique sur un sujet aussi complexe.
Mes chers collègues, la tâche qu’il nous faut désormais accomplir n’est plus seulement d’ordre législatif, mais il convient de mener une véritable réflexion sur la formation du personnel médical. En février 2015, le rapport de la Cour des comptes, cité par Mme Le Callennec, pointait les lacunes dans la répartition des soins palliatifs sur le territoire. En dépit des progrès observés dans le développement de l’offre en établissements de santé, de fortes inégalités territoriales demeurent dans l’accès aux soins. En outre, on ne peut que déplorer la faiblesse extrême de la formation des étudiants en médecine sur ce sujet et la quasi-absence de l’évaluation et de la formation continue des médecins durant leur exercice professionnel.
Une fois les principes définis, nous devons nous attacher à leur mise en oeuvre qui suppose des moyens humains. Les soins palliatifs ne sont pas des exercices mécaniques et la part d’humanité y est essentielle.
Avant de conclure, je souhaite rappeler l’opposition de notre groupe à la légalisation de l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté qui revient à accorder à la société, fût-elle représentée par le médecin, un droit sur l’existence de chacun qui outrepasse largement le respect, pourtant souhaité par tous, de la personne.
Nous l’avons souligné en première lecture, cette proposition de loi laisse place à une part d’indicible et d’incertitude, commandée par le respect de la vie. Une large majorité des députés du groupe UDI est favorable à l’équilibre de la proposition de loi. Certains souhaiteraient laisser plus de place à la volonté intime et le choix de la fin de vie à chacun. D’autres sont hostiles à la formulation de ce texte et craignent que ces nouvelles dispositions ne brisent le lien familial et social qui nous unit au plus profond de notre conscience. Ils estiment que, quelles que soient les circonstances, la vie doit être privilégiée.
S’il existe des positions différentes, elles méritent toutes respect mutuel et humilité. C’est pourquoi notre groupe a laissé à chacun de ses membres une totale liberté de vote depuis le début de l’examen du texte. Il en sera bien évidemment de même aujourd’hui. Chacune et chacun des membres de notre groupe se prononcera en son âme et conscience sur cette proposition de loi.

Madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, chers collègues, après son rejet par le Sénat, nous reprenons l’examen de cette proposition de loi, telle qu’elle a été adoptée par notre Assemblée en première lecture. C’est avec regret que je constate que notre système de navette parlementaire n’a pour le moment pas fait évoluer ce texte qui me semble encore inadapté aux véritables attentes des Français. Si nous sommes les représentants du peuple, c’est pour voter des lois qui répondent à leurs attentes. Or, ce texte incomplet n’apporte pas de réponse aux situations que chacun a en tête.
Je pense tout d’abord à Vincent Lambert, encore otage de décisions de justice en raison d’une famille déchirée et d’une loi inadaptée qui ne permettent pas de déterminer clairement quel serait le choix de Vincent. En effet, la loi actuelle prévoit, dans le cas d’une personne inconsciente qui n’a pas rempli de directives anticipées, de faire appel à la famille ou aux proches, sans définir le vaste périmètre que cela suppose. Qui définit ce qu’est un proche, quand la personne est inconsciente pour le dire ? Quelle place dans ce genre de décision peut-on donner à un membre de la famille qui serait en rupture avec le patient ?
L’ambiguïté de la législation actuelle – qui n’est toujours pas résolue dans cette proposition de loi – ajoute de la douleur à la douleur. C’est pourquoi je défendrai un amendement qui propose la mise en place d’une procédure de médiation afin qu’un médiateur puisse apprécier les témoignages de la famille et des proches avec un regard neutre pour trouver une issue la plus proche possible de celle qu’aurait souhaité le patient. Je pense aussi à Jean Mercier, poursuivi pour non-assistance à personne en danger envers sa femme Josanne. Quelle réponse apporte cette proposition de loi à une telle situation ? Aucune. Faudrait-il que nous ignorions ces situations de détresse qui poussent certains Français à réclamer à choisir en toute lucidité le moment et la manière dont ils souhaitent mourir ?
Reconnaissons-le : de trop nombreuses demandes de patients de mettre fin à leurs jours sont la conséquence du manque de places en soins palliatifs, de notre échec à leur apporter un accompagnement adapté pour que leurs derniers jours soient apaisés et dignes. Mais nous ne pouvons pas non plus nier que certaines demandes persistent malgré les soins, que certaines souffrances, physiques ou psychiques, ne peuvent être soulagées. Pourquoi devrions-nous refuser d’entendre ces Françaises et ces Français ? Pourquoi devrions-nous le leur refuser s’ils souhaitent partir entourés de leurs proches, à leur domicile ? Parfois, et nous devons l’accepter, le choix s’impose entre souffrir et mourir. Vous avez affirmé le contraire en commission Monsieur Leonetti, mais c’est pourtant la réalité :…

…la médecine, malgré tous ses progrès, ne permet pas de soulager toutes les souffrances. Quand le choix s’impose, lorsqu’une personne sait qu’elle va mourir, il n’y a bien entendu pas de bonne solution ; il s’agit seulement d’accepter la moins mauvaise : celle que la personne aura choisie. Vous me direz que la sédation profonde et terminale est une réponse aux souffrances inapaisables. C’est vrai en partie, je le reconnais, et je rappelle que cette pratique est déjà autorisée par notre législation, et ce texte a le mérite de généraliser cette possibilité qui n’est pratiquée aujourd’hui qu’à l’appréciation du médecin. Mais qu’en est-il du choix de la personne concernée ? Est-ce à notre assemblée de choisir pour elle les conditions de sa propre mort ? Je ne le crois pas. Acceptons que nos choix de fin de vie puissent être différents de ceux des autres. Certains ne veulent pas d’une sédation profonde et terminale qui impose au patient de partir sans conscience de son départ, qui impose à ses proches l’attente insupportable du moment inéluctable de sa mort.
Ce n’est peut-être pas votre choix, monsieur Leonetti, mais vous ne pouvez ignorer qu’il est celui de citoyens que nous représentons ici et qui ont espoir que nous le leur reconnaissions aujourd’hui. J’ai reçu une pétition d’initiative citoyenne qui a recueilli plus de 100 000 signatures ! 100 000 concitoyens qui demandent que ce texte aille plus loin et leur permette de choisir l’assistance médicale au suicide. Nous ne pouvons ignorer ces Françaises et ces Français, nous ne pouvons affirmer que nous, députés de la nation, savons mieux qu’eux-mêmes comment devrait se terminer leur propre vie. N’ignorons pas non plus les nombreux Français qui partent mourir à l’étranger car leur propre pays refuse d’accéder à leur demande. Il est de notre responsabilité d’apporter des réponses à ces personnes, à ces situations douloureuses. Les malades en fin de vie témoignent souvent d’une certaine dépossession d’eux-mêmes, livrés à des procédures médicales et juridiques qu’ils ne maîtrisent plus. Ces personnes, qui savent qu’elles vont mourir, ne leur devons-nous pas la liberté de se réapproprier leur propre vie pour les moments qu’il leur reste à vivre ? Je ne me résous pas à l’idée que notre pays n’accorde pas encore aux Françaises et aux Français cette ultime liberté, une liberté individuelle que l’on ne peut balayer d’un revers de main.
Nous avons donc l’occasion à présent d’améliorer ce texte tout en tirant les leçons des discussions que nous avons déjà eues sur ce sujet, que ce soit lors de l’examen de ma proposition de loi en janvier, à l’occasion du débat sans vote que nous avons également tenu dans l’hémicycle, et bien sûr lors de la première lecture du texte que nous examinons à nouveau aujourd’hui. Si je souhaite tirer les leçons de nos débats précédents, comme je l’ai fait la semaine dernière en commission, je ne vous proposerai cependant pas d’amendement visant à légaliser l’euthanasie : non pas que ce n’est plus ma conviction, mais parce que j’entends privilégier un débat apaisé et proposer à notre Assemblée d’étudier sérieusement un amendement qui pourrait nous rassembler.
Ainsi, je défendrai ici une proposition visant seulement à légaliser l’assistance médicale au suicide, dans le plus clair respect des préconisations du Conseil consultatif national d’éthique, le CCNE. L’assistance médicale au suicide est une demande clairement exprimée par une partie des membres de la conférence des citoyens sur la fin de vie organisée par le CCNE en décembre 2013. Il n’est alors pas question de permettre à un professionnel de santé de pratiquer le geste létal, pas plus de mettre en doute la décision du patient qui pratique alors lui-même le geste ou de lui opposer les soins palliatifs puisque j’y ai introduit, sur recommandation toujours du CCNE, de ne permettre cet acte si et seulement si « un réel accès à toutes les solutions alternatives d’accompagnement et de soulagement de la douleur physique et psychique » peut être proposé au patient. Je crois même que ce point précis confrontera notre modèle de santé et plus largement notre société entière au réel besoin de places en soins palliatifs qui fait gravement défaut en France. Les professionnels de santé ou les proches ne pourraient plus alors ignorer les appels au secours de ces malades qui souffrent dans nos hôpitaux et qui réclament à mourir. Ces demandes devront être étudiées, entendues, comprises, discutées avec le personnel soignant et les proches afin de mettre en oeuvre tout ce qui est possible pour proposer une alternative à ces malades.
Mes chers collègues, j’espère sincèrement que nous pourrons avoir un débat serein, un débat qui ne répète pas seulement celui de la première lecture avec les mêmes effets, et que nous trouverons enfin un terrain d’entente. C’est tout le sens de ma démarche aujourd’hui.
Je tiens à rappeler qu’en première lecture, un amendement de notre collègue Jean-Louis Touraine, soutenu par un grand nombre de députés SRC ainsi que par les groupes RRDP et écologiste, et visant à légaliser l’assistance médicalisée active à mourir, avait été repoussé à quelques voix près avec le secours de celles de l’opposition. Cet amendement, largement soutenu sur les bancs de la majorité, me laisse espérer que ma proposition plus consensuelle, celle de l’assistance médicale au suicide avec des garanties fermes quant à l’accès aux soins palliatifs, va apaiser certaines craintes et ainsi trouver au sein de notre assemblée une majorité pour la voter.
Je terminerai mon propos en rappelant que ma proposition de loi avait été renvoyée en commission au motif qu’elle abordait prématurément un sujet qui serait débattu à l’occasion de la proposition de loi Claeys-Leonetti. Or, plusieurs de mes collègues, de la majorité comme de l’opposition, y compris les rapporteurs, me rétorquent aujourd’hui que mes amendements déséquilibreraient le cadre de cette proposition de loi. Mais j’aimerais, par souci de cohérence, que ce débat ne soit pas verrouillé pour ce motif incompréhensible et que nous ayons un véritable débat de fond pour aborder en toute responsabilité la possibilité d’offrir à chacun le choix de sa propre fin de vie.
Applaudissements sur divers bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous voilà à nouveau réunis en séance afin d’examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi relative à la fin de vie, rejetée en première lecture au Sénat.
Vous le savez : les députés radicaux de gauche, et plus largement les membres du groupe RRDP, mènent depuis longtemps le combat pour le droit de mourir dans la dignité. Ce combat est inscrit dans leur histoire, dans leur ADN, un combat souvent mené contre l’intolérance, laquelle s’est encore exprimée de façon scandaleuse à l’occasion de la dégradation du siège du parti radical de gauche, la semaine passée, par des opposants à la fin de vie dans la dignité.
Nous sommes profondément attachés à la défense des libertés individuelles et nous considérons que le droit de vivre sa mort et de finir sa vie dans la dignité relève d’un choix individuel qu’il convient de respecter. Nous avons à cet effet défendu avec détermination les amendements allant en ce sens lors de la première lecture, tant en commission qu’en séance, ainsi encore qu’en commission la semaine passée.
Les radicaux de gauche ont toujours été des précurseurs en la matière. Le sénateur radical Henri Caillavet s’était déjà engagé sur ce terrain avec une proposition de loi en 1978, et ce sont, une fois de plus, les radicaux de gauche qui, à l’initiative de Roger-Gérard Schwartzenberg, président du groupe radical, citoyen, verts, avaient déposé en 1999 une proposition de loi visant à « garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs ». Ce texte devenu, sous le même intitulé, la loi du 9 juin 1999.
En 2005, la loi Leonetti consacre, en proscrivant l’acharnement thérapeutique, le droit du patient de refuser ou d’arrêter un traitement même si cela met sa vie en danger, et l’obligation pour le médecin de respecter sa volonté. C’est donc une loi qui accepte le laisser-mourir, mais qui continue d’interdire l’aide à mourir.
Mes chers collègues nous venons devant vous aujourd’hui avec une seule exigence : que l’engagement no 21 du candidat François Hollande…

…soit respecté, c’est-à-dire que « toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». Certes, depuis une quinzaine d’années, le développement des soins palliatifs, hélas encore trop limité, a permis d’accomplir de réels progrès. Il importe de leur consacrer plus de moyens pour qu’un nombre bien plus important de patients puisse y accéder. C’est d’autant plus nécessaire qu’il existe de fortes inégalités territoriales, certains départements étant nettement sous-dotés en réseaux de soins palliatifs, voire n’en possédant aucun.
Mais pour la très grande majorité des députés de notre groupe, c’est bien la volonté de la personne qui doit prévaloir. La capacité à apprécier ce qui est digne et ce qui est indigne doit lui être reconnue. C’est pourquoi notre groupe avait déposé une proposition de loi en ce sens dès le mois de septembre 2012. Il n’y avait qu’un seul nouveau droit à créer, celui de pouvoir choisir sa mort par la reconnaissance d’une aide active à mourir. Nous étions nombreux en première lecture de la présente proposition de loi – quelque 150 parlementaires, radicaux de gauche, écologistes, socialistes – à avoir proposé par voie d’amendement d’introduire le droit à bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir, relayant ainsi le souhait exprimé par l’immense majorité de nos concitoyens. Hélas, notre amendement n’a pas été adopté, à quelques voix près.
Mais nous ne baissons pas les bras. Pas aujourd’hui ! Pas maintenant ! C’est la raison pour laquelle nous avons déposé de nouveau cet amendement pour la deuxième lecture – nous avons d’ailleurs été les seuls en commission à le faire. Notre amendement vise à introduire le droit à bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir. Je veux le rappeler ici : nous demandons que toute personne majeure et capable ait la possibilité de bénéficier d’une aide active à mourir dans la dignité. Nous ne voulons en aucun cas imposer cette aide à mourir à tous, mais, fervents défenseurs des libertés individuelles, nous voulons laisser la liberté de choisir, liberté refusée en l’état actuel du texte.
Ne vous méprenez pas, mes chers collègues : nous n’opposons pas soins palliatifs, sédation profonde et continue et aide active à mourir ! Ces dispositifs doivent s’entendre comme des possibilités thérapeutiques permettant de respecter les différents choix exprimés par les personnes en fin de vie. Car il relève ici de la dignité mais également de la capacité de l’humain d’endurer, ou non, la souffrance, une souffrance qui n’est pas que physique mais aussi psychologique. Comme l’avait rappelé ma collègue Jeanine Dubié lors des explications de vote à l’issue de la première lecture, « on peut ne pas supporter un corps déformé et décharné, on peut ne pas supporter d’être tributaire de l’autre pour les actes essentiels, on peut ne pas supporter le sentiment d’indignité qu’engendre parfois la maladie, on peut ne pas avoir envie de continuer à vivre ». On a trop caricaturé, dans ce débat, l’aide active à mourir, en utilisant de manière dévoyée le terme d’euthanasie alors qu’il signifie pourtant en grec « belle mort ». La Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Québec, pour ne citer que ces exemples, sont-ils des pays où l’être humain n’est pas respecté ? Nous ne le pensons pas.
Il est temps de permettre à chacun de vivre sa fin de vie comme il l’entend. Si les progrès de la médecine et des traitements ont contribué à allonger l’espérance de vie, cela s’est parfois fait au détriment de la qualité de vie et de la dignité. Or, qui est plus à même d’apprécier sa dignité que l’individu lui-même ? Pourquoi la liberté, valeur fondamentale qui oriente la vie de chacun, est-elle si difficile à admettre lorsqu’il s’agit de la fin de vie ? Ainsi, on respecterait l’autonomie de l’individu, entendue comme ce qui permet aux êtres humains de mener et d’accomplir un projet de vie selon leurs convictions et dans les limites imposées par le respect des droits et libertés des autres.
Pour le groupe RRDP, cette proposition de loi, qui ne semble pas être à la hauteur de l’enjeu, s’apparente à un rendez-vous manqué. Son texte reste ambigu alors que, sur ce sujet, nos concitoyens ont besoin de clarté et de transparence. Il fournit des propositions a minima, sans régler la question de l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté.
Le terme « sédation profonde et continue », notamment, ne va pas assez loin. Laisser la personne s’endormir et mourir, selon les dispositions de ce texte, peut prendre du temps – entre deux et huit jours, d’après le Pr Sicard, ce qui ne correspond pas à la volonté actuelle et répétée de nombreux Français de pouvoir choisir le moment et le lieu de leur mort en cas de mort inéluctable et de souffrances trop grandes. Il n’est pas mentionné, par ailleurs, que la sédation en phase terminale s’accompagne de l’arrêt des traitements et des soins, telles que l’alimentation et l’hydratation artificielle, qui procure souvent des effets très pénibles – faim, soif, phlébites, escarres, infections.

Monsieur Leonetti, vous ne cessez de rappeler que, lorsqu’il y a anesthésie générale, le patient ne ressent pas la faim.
Je peux vous l’accorder.

Toutefois, vous omettez de dire que l’anesthésie générale telle que nous la connaissons ne dure que quelques heures et ne s’étend pas sur plusieurs jours, comme ce sera éventuellement le cas pour la sédation d’une personne en fin de vie. Dans ces circonstances ultimes, ressentons-nous la faim ? Ressentons-nous la soif ? Vous affirmez que ce n’est pas le cas. Nous affirmons que nous ne le savons pas.
Si faim et soif devaient être ressenties,…

…nous nous opposons à la sédation profonde proposée, qui ne permet pas au patient de partir conscient et interagissant avec ses proches qui l’entourent, dans la dignité. Nous le disons avec fermeté : la fin de vie ne peut pas être une mort de faim.
Madame la ministre, les Français attendent aujourd’hui la reconnaissance d’un droit à l’aide active à mourir. La liberté fondamentale de rester maître de sa destinée, de choisir pour soi, de ne pas aller au-delà de telles souffrances physiques, de ne pas supporter une déchéance inéluctable : voilà ce que veulent nos compatriotes.
Lors de la précédente législature, onze ministres de l’actuel gouvernement, ainsi que notre rapporteur, Alain Claeys, avaient signé une proposition de loi du député Manuel Valls. Aujourd’hui, alors que vous en avez le pouvoir, vous refusez, hélas, de mettre ce texte en application.
Mes chers collègues, nous voulons ici et maintenant une loi qui plonge ses racines dans le meilleur de notre république, une loi qui donne la liberté, une loi qui permette l’égalité, une loi qui incarne la fraternité. S’il n’est pas amendé de manière significative, nous ne pourrons pas voter ce texte, qui s’acharne dans une obstination déraisonnable, celle du statu quo.
On continue de mal mourir dans notre pays. Mais le laisser mourir ne peut pas rester le viatique hypocrite pour accéder à notre dernier départ. Il est vrai qu’il faut du courage pour affronter des tabous multiséculaires, des conceptions d’un autre âge, qui nient la réalité du temps présent. Oui, il faut du courage pour franchir le Rubicon des conservatismes, comme il a fallu du courage, ici même, à Simone Veil, il y a quarante ans, pour permettre le droit à l’avortement au milieu des huées fanatiques.

Sur un sujet de société comme la fin de vie, on nous dit qu’il n’est possible d’avancer que dans le consensus. Croyez-vous qu’en 1974 Simone Veil ait avancé dans le consensus ? Si elle avait attendu le consensus pour avancer, combien de temps aurait encore été nécessaire ?
« C’est vrai ! » sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

L’argument est d’autant moins recevable aujourd’hui que, selon toutes les études d’opinion, une immense majorité de Français souhaite faire entrer l’aide active à mourir dans la loi.
Est-il tolérable que les Français, du moins ceux qui en ont les moyens et qui peuvent se déplacer, soient obligés de partir à l’étranger pour bénéficier d’une aide active à mourir, comme il y a quarante ans, les femmes qui voulaient avorter devaient se rendre hors de nos frontières ? Allons-nous continuer longtemps à faire l’autruche devant toutes ces euthanasies, pratiquées dans le secret, comme il y a quarante ans, les femmes devaient avoir recours clandestinement, au péril de leur propre vie, à celles qu’on appelait les faiseuses d’anges ? Non ! Cela n’est plus possible !
Je rapproche volontairement ces deux combats car ils ont finalement le même sens.

Le droit de disposer de sa mort est le prolongement du droit de disposer de son corps. Notre mort, comme notre corps, nous appartient. Et, mes chers collègues, comme la vie nous est donnée, nous ne nous résoudrons jamais, jamais, à ce que la mort nous soit volée !
Applaudissements sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, et sur certains bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen et sur les bancs du groupe écologiste.

La parole est à M. Michel Liebgott, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ni la loi, ni les injonctions religieuses ne peuvent dicter les derniers instants d’une vie humaine. C’est pour cette raison que nous nous retrouvons aujourd’hui, afin d’améliorer les moments qui précèdent cette disparition.
Notre assemblée a rempli sa fonction voici quelques semaines, en adoptant ce texte en première lecture. Après 1999, 2002 et 2005, comme cela a été rappelé, il a donc fallu dix ans avant de poursuivre le débat sur ces questions.
Je ne reviendrai pas sur les propos prononcés aujourd’hui s’agissant des soins palliatifs : ils évoquent bien à quel point la loi de 2005 est insuffisamment mise en oeuvre, puisque seuls 20 à 25 % des Français qui devraient en bénéficier y ont accès.
Je voudrais seulement positiver, en rappelant tout d’abord que le Gouvernement élabore un plan triennal de développement des soins palliatifs. L’engagement d’améliorer l’accès aux soins palliatifs dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est une première réponse. Comme l’est l’engagement, à la suite d’un amendement que nous avons adopté, de faire pratiquer ces soins palliatifs à domicile et de former les personnels soignants. Décréter les soins palliatifs ne suffit pas, il faut également les préparer.
Enfin, un rendez-vous annuel sera organisé, pour que notre assemblée puisse, chaque année, vérifier et contrôler la mise en oeuvre de ces mesures. Dr Mino, directeur du Centre national de ressources Soin Palliatif, rappelle que les soins palliatifs dans les institutions ne sont pas le seul recours : il s’agit aussi d’une démarche, qui peut être mise en oeuvre à domicile.

Avant de conclure, je mettrai l’accent sur tout ce qu’apportera cette proposition de loi : elle clarifiera l’obstination déraisonnable, caractérisée par l’inutilité des traitements, leur disproportion et leur seule finalité de maintien artificiel de la vie ; elle renforcera la portée des directives anticipées, plus contraignantes pour le corps médical, plus encadrées dans leur rédaction et mieux diffusées parmi nos concitoyens ; enfin, elle clarifiera le statut du témoignage de la personne de confiance. Ces éléments sont essentiels.
Nous prescrivons également le respect de la liberté individuelle ultime de la personne, non seulement en institution de soins, mais aussi à son domicile. Nous créons ainsi un droit à la sédation profonde et continue à la demande du patient, accompagnant l’arrêt de traitement.
Enfin, nous inscrivons dans le marbre le droit du malade à un refus de traitement, en rappelant le médecin à ses obligations de suivi du patient, par l’application des soins palliatifs.
Nous aimerions tous mourir dans les meilleures conditions et choisir les conditions de notre mort. Noëlle Châtelet rappelait récemment dans Le Républicain lorrain les conditions dans lesquelles sa mère était décédée. Celle-ci a choisi elle-même le moment où se donner la mort, avec les médicaments qu’elle avait gardés et préparés depuis longtemps. Si on lui avait garanti que quelqu’un l’accompagnerait, elle aurait vécu deux ou trois ans de plus. Ces propos me font douter du suicide assisté – et nous sommes certainement nombreux dans ce cas. Pourra-t-on assurer l’universalité de cette pratique, faire en sorte que tout le monde soit à égalité, alors qu’aujourd’hui, nous n’assurons déjà pas à chacun d’entre nous la possibilité de mourir sans souffrance ? Je ne le pense pas. En tout cas, cela n’est pas garanti.
La mise en oeuvre de ce qui serait incontestablement un droit individuel nouveau pose des difficultés considérables. Or notre rôle consiste à légiférer pour l’ensemble de nos concitoyens, non pour des cas particuliers.
Ce texte, qui a attendu dix ans, émane de la volonté du Président de la République. Il a été accepté en première lecture par cette assemblée. Parce qu’il fera date, il fera honneur aux députés qui l’approuveront. Je me félicite du consensus qui semble se dégager. Comme l’a exprimé Mme Massonneau, ce consensus n’empêchera pas que nous continuions à débattre, en toute liberté, ce qui est le propre de notre assemblée.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, nous sommes ici parce que le Président de la République a souhaité respecter un des engagements qu’il avait pris pendant la campagne électorale de 2012. Cela est suffisamment rare pour être souligné ! Sans ironiser davantage, il apparaît que cette promesse allait de pair avec un déséquilibre dans la loi de 2005, qui nous vaut d’être réunis pour la deuxième fois dans cet hémicycle. Il nous conduit, malgré les efforts de MM. les rapporteurs, à une forme de consensus par dépit, attesté par l’ensemble des voix qui se sont exprimées jusqu’à présent sur le sujet.
Mme Jacqueline Fraysse me permettra de reprendre à mon compte la présentation qu’elle a faite du débat. Elle a indiqué qu’il s’agissait d’encadrer une pratique médicale supervisée par deux principes : la liberté individuelle et le respect de la vie. Je suis parfaitement d’accord avec cette manière de présenter la question. Tout le problème est de savoir à quel niveau respectif on situe la liberté individuelle et le respect de la vie.
Si l’on privilégie le respect de la vie sur la liberté individuelle, il ne faut pas toucher à la loi de 2005 ; dans le cas contraire, comme l’indiquait à l’instant M. Falorni, il faut aller plus loin – ou plus bas, selon le point de vue que l’on adopte –, jusqu’au bout de la logique selon laquelle on pourrait autoriser le suicide assisté ou l’euthanasie car c’est pour moi la même chose.
Au fond, quelle est l’intention de ce texte, une fois que l’on a décrit un cadre politique extrêmement complexe ? Une législation ou une avancée vers l’euthanasie que, visiblement, le Parlement ne veut pas, si j’en juge par le débat à l’Assemblée nationale et au Sénat en première lecture.
Je n’avais pas voté contre cette proposition de loi en première lecture parce que je considérais que les intentions de MM. les rapporteurs étaient faussées ou cachées. Au contraire, ils ont essayé de trouver la manière la plus équilibrée possible de répondre à l’invitation du Président de la République et à la mission qu’il leur avait confiée.
J’ai entendu qu’il fallait soulager la douleur et délivrer les patients d’un traitement que, pour une raison ou une autre, ils ne supportent plus. J’ai entendu que la pratique de la sédation servirait à empêcher la souffrance des patients, en cas de douleurs réfractaires. Mais tout cela figure déjà dans la loi.
Que modifie cette proposition par rapport à la loi de 2005 ? Trois éléments se trouvent modifiés, qui avaient justifié ma position lors du vote en première lecture.
La première modification concerne le caractère irréversible de la sédation. La sédation, bien que n’étant pas en elle-même une pratique à caractère euthanasique, porte la possibilité grave d’une dérive de cette nature. À ce titre, même si la loi peut distinguer la sédation d’une pratique euthanasique, il sera extrêmement difficile d’opérer cette distinction en pratique. En raison de cette dérive possible, le Parlement ne peut pas prendre le risque d’adopter une telle disposition dans la loi.
La deuxième modification a trait aux directives anticipées. La loi de 2005 prévoyait que le médecin les prend en compte ; la proposition de 2015 l’obligera à les suivre. Cette évolution montre, mes chers collègues, le désir de faire primer la volonté des patients sur la compétence et l’art des médecins. Je n’aime pas cette défiance à l’égard du corps médical. Quelle que soit l’appréciation qu’un patient peut porter sur sa propre situation, les médecins restent et doivent rester les plus qualifiés pour connaître celle-ci.
La troisième modification a trait à la nutrition et l’hydratation artificielle. S’il s’agit de soins, elles ne peuvent être arrêtées ; s’il s’agit de traitements, elles peuvent l’être. Ces dispositions, comme vous l’avez rappelé, monsieur Leonetti, figuraient déjà dans la loi de 2005 – je vous avais d’ailleurs interpellé en soulignant ce point problématique de la loi. En effet, lorsque le corps médical ne peut plus prodiguer à un patient la satisfaction de ses besoins vitaux, c’est-à-dire l’hydratation et la nutrition, où se trouve le principe du respect de la vie et de la satisfaction des besoins fondamentaux ?
Dans la mesure où ces différents points ne seront pas modifiés par le débat parlementaire, si j’en crois du moins la volonté du Gouvernement et de MM. les rapporteurs, il est probable que mon vote sera le même qu’à l’issue de la première lecture.
Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

Madame la ministre, chers collègues, quel est donc le prétexte ou l’urgence qui nous oblige aujourd’hui à statuer une fois encore sur la fin de vie alors que la loi Leonetti, en 2005, avait selon l’avis de presque tous emprunté la voie de la sagesse en écartant à la fois l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie pour mettre en place une grande politique de développement des soins palliatifs au service des malades sur le point de mourir ?
Ce qui semblait être sage en 2005 ne le serait donc plus en 2015, et pour cause : la gauche – avec la complicité de la droite, toujours si servile à l’égard de quelques groupuscules d’idéologues – veut briser l’un des derniers principes fondamentaux de la société, celui du vrai vivre ensemble : l’interdiction de donner la mort à autrui.
Car derrière ce texte se cache évidemment un objectif inavouable : maquiller l’euthanasie sous le nom de sédation « profonde et continue ».

La sédation est un soin de confort encadré aujourd’hui très précisément par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs. Elle répond déjà ainsi aux situations d’hémorragie massive, de détresse respiratoire majeure, de situations d’angoisse extrême. Celles-ci ne concernent en réalité que 2 % des malades en fin de vie que l’on parvient à soulager par ces traitements, le plus souvent de manière intermittente ou transitoire.
Dans la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui, il n’en est plus de même. On parle « d’altération profonde et continue jusqu’au décès, associée à l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation afin de ne pas prolonger inutilement la vie ». Il s’agit en fait de faciliter l’accès à une forme d’euthanasie passive.
Au-delà de l’impossibilité de définir juridiquement l’ « utilité » ou de la « dignité » d’une vie, le fait que le texte englobe les souffrances physiques et psychiques ouvre la voie à de graves dérives.
Avons-nous envisagé l’intolérable pression qui s’exercera demain sur beaucoup d’autres personnes vulnérables qui, face à leur perte d’autonomie, auront le sentiment d’être une gêne pour leur entourage ? Ne seront-elles pas poussées à demander la mort devant le reflet que leur renvoie une société les considérant comme « inutiles » ou « indignes » ?
De nombreux personnels soignants témoignent pourtant que, le plus souvent, la demande de mort exprime moins l’envie réelle de mourir qu’un appel au secours, le besoin d’entendre que la vie mérite encore d’être vécue et que les demandes répétées de mourir sont rares lorsque la personne est accompagnée et soutenue.
Dans votre texte, l’assimilation de l’hydratation et de l’alimentation à un traitement et non à un soin conduit à entraîner la mort par la privation d’eau et de nourriture du sédaté.

Il ne s’agit plus de soulager la souffrance mais bien de provoquer ou d’accélérer la mort.
Si cette loi est votée aujourd’hui – et j’en prends date avec vous –, on s’attaquera demain, comme c’est le cas dans d’autres pays, à l’euthanasie des enfants atteints d’une maladie incurable, puis, ce sera le tour des handicapés dont la vie n’est pas immédiatement menacée mais dont la dignité et l’utilité sont remises en cause par la société au même titre que celles d’un mourant.
Protestations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’affaire Vincent Lambert – qui a d’ailleurs été citée – ce grand handicapé qui, je tiens à le préciser, n’est pas en fin de vie et que l’on cherche pourtant à faire mourir coûte que coûte.
Non content de vous dérober en dissimulant aux Français la réalité des implications de ce texte, vous faites peser sur les épaules et la conscience des médecins l’obligation de donner la mort aux patients par le biais de directives anticipées contraignantes et non plus consultatives.
Il est scandaleux qu’un médecin ne puisse bénéficier d’une clause de conscience, lui qui a prêté un serment d’Hippocrate contraire à toute logique euthanasique !
La directive anticipée qui peut servir à orienter le choix du médecin, bien sûr, ne doit pas rompre le lien de confiance et le dialogue entre les équipes médicales, le malade ou son entourage – sans compter que ces directives orientent le patient vers un choix clairement défini : la sédation.
Le document modèle de rédaction émis par le Conseil d’État n’est pensé que pour le refus des traitements accompagné d’un placement sous sédation profonde jusqu’au décès. Le patient ne peut pas demander une sédation intermittente, l’arrêt du seul traitement thérapeutique ou le recours aux soins palliatifs.
De plus, cette directive devrait être obligatoirement rédigée en présence d’un médecin – ce qui n’est pas le cas dans votre texte – pour que le patient bénéficie de conseils, d’informations et d’expertises sur les conséquences que pourraient avoir ses choix.
Lors de cette phase ultime de la vie, il faut éviter le plus possible la rupture de contact entre le patient et ses proches. Or, la sédation profonde et irréversible brise les derniers échanges de l’existence d’un individu, si nécessaires tant pour le patient que pour ses proches.
À l’inverse, la sédation transitoire, sans raccourcir la vie, permet au malade de conserver sa liberté de choix et de garder le contact avec les siens tout en étant apaisé.
Les soins palliatifs, marginalisés dans votre proposition, sont pourtant la meilleure solution afin de préserver cette dignité qui nous est chère sur ces bancs.
Les services palliatifs sont encore trop peu développés en France, tout le monde s’accorde à ce propos : 80 % des médecins ne sont pas formés aux techniques de soulagement de la souffrance et les unités de soins palliatifs se concentrent dans seulement cinq régions métropolitaines. Le texte, néanmoins, ne propose rien pour pallier ces carences.
Votre proposition de loi n’a pas choisi cette voie mais celle de la généralisation de la sédation profonde qui, conséquemment, entraîne l’accélération de la mort. C’est la voie de la facilité et des économies qui triomphe de la solidarité la plus naturelle et la plus juste !
Ni Gilbert Collard ni moi-même ne serons complices de ce naufrage médical, institutionnel et éthique.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans la France du début du XXIe siècle, les malades ont encore une fin de vie douloureuse sur les plans physique et psychique : nous sommes très loin d’une mort apaisée, heureuse et choisie.
Nous examinons aujourd’hui en seconde lecture une proposition de loi qui inscrit dans notre corpus législatif quelques avancées qu’offre déjà, pour la plupart d’entre elles, le domaine réglementaire. Ainsi en est-il des directives anticipées ou du droit à bénéficier d’une sédation terminale.
Avec un amendement cosigné par 123 députés et un certain nombre de députés sympathisants, je propose d’enrichir cette loi. Ce n’est certes pas un bouleversement, pas même un changement notable de l’esprit de la loi mais, simplement, l’inscription d’un progrès tenant compte de l’évolution de la société tout au long du XXe siècle.
Selon l’INSEE, 3 000 à 4 000 Français bénéficient chaque année d’une forme ou d’une autre d’aide active à mourir dans les hôpitaux de notre pays – autant de cas qui pourraient alimenter ad nauseam la chronique journalistique et même, malheureusement, judiciaire alors que ces actions procèdent souvent de l’humanisme et de la compassion.
Toutefois, mes chers collègues, ces actes pratiqués en catimini ne souffrent-ils pas dans certains cas du risque d’un excès et, dans d’autres, d’une insuffisance, faute d’un quelconque contrôle ?

Je ne propose pas l’euthanasie stricto sensu, geste essentiellement décidé par l’équipe médicale, non plus qu’un suicide assisté, geste relevant quant à lui de la seule décision du patient, parfois sujet à une dépression passagère.
Je suggère qu’une aide active à mourir limite, mieux qu’une autre option, tout risque de dérive, tout dérapage, et favorise tous les encadrements possibles dès lors qu’elle est décidée conjointement par le malade lui-même – effectivement remis au centre des décisions – et par un collège médical capable d’assister la personne concernée ainsi que sa famille.
Chacun, bien évidemment, est libre de recourir ou non à cette aide selon ses convictions et sa philosophie. Nul ne force qui que ce soit à choisir cette solution : il s’agit uniquement de permettre à ceux qui le désirent d’en faire la demande.
Bien sûr, la première mission d’un médecin est de soigner et de guérir mais cela ne doit pas se faire au détriment de l’accompagnement de la personne, de l’apaisement de ses douleurs et du respect de ses décisions, mission également inhérente à la fonction de médecin.
Madame la professeur Agnès Buzyn, présidente de l’institut national du cancer, indiquait avant-hier que, selon son expérience, des douleurs extrêmes restent rebelles à tous les traitements. À titre personnel, elle exprimait une opinion très favorable à l’aide active à mourir pour les malades qui l’implorent.
Nous le savons : 3 400 personnes environ font chaque année l’objet d’une euthanasie, d’un suicide assisté ou d’une assistance active à mourir dans nos hôpitaux quand d’autres franchissent les frontières pour y recourir.
Nous connaissons quelques noms, quelques histoires. Les Lambert, Mercier, Imbert et beaucoup d’autres incarnent notre incapacité à répondre à certaines situations de fins de vie et au vide juridique qui les entoure.
L’euthanasie est pratiquée en France, c’est un fait que nul ne conteste. Mais comment être sûr que certaines euthanasies correspondent réellement aux choix individuels, libres et éclairés des malades sur lesquelles elles sont pratiquées ?
Rien ne nous le garantit car notre République continue de fermer les yeux sur cette réalité, tout comme cela a été le cas avec l’avortement ou, plus récemment, l’homoparentalité.
Certes, la proposition de loi de MM. Claeys et Leonetti consacre des avancées sur le plan législatif. Elle entend mettre le patient et non plus l’ensemble des soignants au centre des diverses mesures législatives préconisées, ce qui constitue un progrès.
Cependant, d’un point de vue légal, je ne peux que le constater : la sédation profonde et continue, mesure phare de ce texte, est déjà autorisée. Cette possibilité, en effet, est offerte aux patients depuis le décret de François Fillon du 29 juillet 2010 préconisant la mise en oeuvre de traitements à visée sédative en cas d’arrêt des traitements curatifs.
De la même manière, si l’on peut se féliciter du fait que les directives anticipées soient désormais contraignantes, comme je l’ai souligné précédemment, reste que certains termes de cette proposition de loi mettent à mal la future application de cette mesure.
Comment peut-on être assuré que les directives anticipées du patient seront respectées si l’on donne tout pouvoir à l’équipe médicale de juger de leur caractère « manifestement inapproprié » ?

Soit elles sont en dehors du champ de la loi et de facto ne peuvent s’appliquer, soit elles sont en conformité avec la loi et le médecin, comme les proches, doivent respecter le choix de l’intéressé.
Je voterai donc en faveur d’un amendement de ma collègue Marie Le Vern visant à supprimer cette ambiguïté.
Pour reprendre les mots de notre collègue Leonetti, le débat sur la fin de vie repose sur « une éthique de l’autonomie ayant pour référence la liberté et la défense de l’individu contre le groupe ». C’est le sens exact de l’amendement que nous portons et des valeurs de liberté, d’humanisme, de respect de la dignité et du libre choix éclairé de l’individu jusqu’à son dernier souffle.
L’examen du texte au Sénat a montré que des intégrismes pouvaient l’emporter sur le devoir de fraternité et d’humanité. Or, le premier des combats doit être la lutte contre toutes les formes d’extrémisme, qu’elles soient religieuses, politiques ou idéologiques afin que le respect de l’autonomie et des libertés de l’individu continue de progresser.
Pendant tous nos débats dans cet hémicycle, le respect de la volonté du malade et de sa dignité a toujours été la principale préoccupation des députés, quelles que soient leurs divergences.
Je rêve que tous les députés enrichissent quelque peu cette loi en votant un amendement de liberté, les uns parce qu’ils souhaitent éventuellement recourir à une aide terminale, les autres parce que, n’y étant pas favorables pour eux-mêmes, ils respectent les libres choix de leurs voisins, adeptes d’une autre philosophie.
Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen, et sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et du groupe écologiste.

J’appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées n’ont pu parvenir à un texte identique.

Après d’autres, je voulais dire que ce texte mérite la hauteur de débat dont nous avons fait preuve ici. Il fait appel à la conscience, au plus intime de chacun et doit rester à l’abri de tout ce qui peut se passer à l’extérieur.
De ce point de vue, je préfère citer Pythagore plutôt que Moïse…

…Pythagore qui disait, c’est important : « Souviens-toi bien que tous les hommes sont destinés à la mort. »
Pourquoi dis-je cela ?
Nous avons évoqué bien des textes concernant des problèmes de société qui ont suscité ici un certain nombre de mouvements, or, celui-ci est sans doute le seul, le seul traitant d’un sujet qui non pas tant concerne mais s’applique à chacune et à chacun des citoyens dans notre pays : la mort. Comme disait Pythagore, tous les hommes sont destinés à la mort.
Face à un tel questionnement, nous avons le droit de nous poser la question des portes que l’on ferme, et pas seulement de celles que l’on ouvre.
Aujourd’hui, messieurs les rapporteurs, nous ouvrons une nouvelle porte : celle de la sédation profonde et continue qui permettra de faire cesser les souffrances quand elles deviennent insupportables, y compris au-delà des soins palliatifs.
Nous en fermons une autre, qui permettrait pourtant de traduire la volonté et la liberté de chacune et chacun des citoyens dans notre pays qui ferait qu’il serait possible de dire : « Je veux que ça s’arrête ! Je veux que ça s’arrête ».
La dignité – je renvoie à la vingt-et-unième proposition pour une fin de vie digne du candidat Hollande, monsieur Falorni – c’est aussi la traversée du miroir, c’est aussi l’image que chacun veut laisser au moment du départ à ceux qui restent, à ceux que l’on aime. Ce n’est pas seulement l’image d’un homme ou d’une femme malades à qui l’on permet de s’endormir tout doucement.
De ce point de vue-là, l’amendement que propose Jean-Louis Touraine, dans sa grande sagesse, pourrait sérieusement enrichir le texte et nous permettrait non d’imposer un droit nouveau mais d’ouvrir une liberté nouvelle pour ceux qui choisiraient de s’en saisir.
Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen et sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Mes chers collègues, en première lecture, malgré des divergences très marquées, nous avons su nous écouter et respecter les différents points de vue sur un sujet éminemment délicat. Ce sujet est en effet très sensible pour nous, car il fait écho à nos histoires personnelles, mais aussi à celles de ceux qui nous écoutent ou nous liront, et qui peuvent se sentir incompris ou mal compris. Tous, nous avons à l’esprit un ami ou un parent qui a eu une fin de vie douloureuse ou qui souffre de graves handicaps. Tous aussi, nous connaissons de belles histoires, avec des retrouvailles inattendues, des pardons demandés et recueillis. J’espère donc que, comme en première lecture, le respect prévaudra au cours de nos débats – même si, bien évidemment, nous ne serons pas forcément d’accord entre nous.
On nous demande l’égalité face à la fin de vie ou à la maladie incurable ; malheureusement, cela est utopique : on meurt à des âges différents, dans des conditions différentes, plus ou moins entourés et préparés. La seule égalité, c’est que nous mourons tous.
L’enjeu de cette proposition de loi est, une fois de plus – et je veux saluer le travail de Jean Leonetti et Alain Claeys –, d’accepter le laisser-mourir sans permettre le faire-mourir. Toutefois, je regrette qu’au lieu de promouvoir la loi de 2005 pour qu’elle soit mieux appliquée, l’on ait décidé d’en repousser les limites.
Chaque vie vaut la peine d’être vécue. Chaque personne doit être respectée, quel que soit son état de santé ou de dépendance. Toute souffrance doit être soulagée.
J’ai une pensée pour une jeune femme courageuse, Anne-Dauphine Julliand, dont la petite fille était condamnée à court terme, et qui rappelle dans un livre poignant, Deux petits pas sur le sable mouillé, une citation du médecin et académicien Jean Bernard : « Quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, ajoutons de la vie aux jours ». Cette phrase illustre bien ce que sont les services de soins palliatifs. Celui qui meurt a besoin d’affection, de douceur, de compréhension, de soulagement. Il existe bien évidemment des cas particuliers, qui ne peuvent être pris en charge dans le cadre de la loi Leonetti de 2005, mais la loi est faite pour dire la norme générale et s’appliquer à tous, non à des exceptions.
Un mot enfin pour les soignants qui se dévouent pour accompagner les personnes en fin de vie. Leur présence aux côtés des familles est précieuse. Le texte qui sortira de cet hémicycle ne devra pas aller contre leur conscience et leur liberté.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises lors de la première lecture de ce texte : c’est avec beaucoup d’humilité, et aussi beaucoup d’incertitude, que j’aborde la question de la fin de vie. En effet, vous l’avez dit vous-même, madame la ministre : nul ne détient la vérité dans ce domaine ; j’ai néanmoins une certitude : nous ne pouvons demander à un médecin d’utiliser ses compétences pour abréger la vie.
La loi de 2005 me semblait une bonne réponse aux questions qui nous sont posées par la fin de vie, puisqu’elle prévoyait, sur tout le territoire, le développement des soins palliatifs. Or, en dépit des progrès réalisés depuis vingt ans, l’accès aux soins palliatifs reste très insuffisant. Ils sont pourtant la réponse à nombre de questions que nous nous posons aujourd’hui, et je ne vois pas ce que l’adoption d’une nouvelle loi pourra changer si l’on ne met pas en oeuvre les moyens nécessaires. Or, malgré l’engagement pris par le Président de la République et les annonces faites par vous-même, madame la ministre, je reste très dubitatif quant aux moyens prévus – mais le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, que nous examinerons dès cette semaine, répondra sans doute à cette question.
La priorité reste donc de développer les soins palliatifs, afin que tous les patients, quels que soit leur pathologie, leur âge et leur lieu de vie, puissent bénéficier précocement de soins palliatifs qualifiés. Cet objectif suppose un engagement fort et continu des responsables politiques, et une volonté réformiste au sein d’un univers où la lassitude, les habitudes et les enjeux financiers sont prégnants. C’est ce que j’essaierai de démontrer à travers les amendements que j’ai déposés sur l’article 1er.

Il s’agit d’un débat difficile, sur un sujet qui n’est pas uniquement personnel ; c’est une position de législateur que nous devons adopter. Il y a, bien sûr, le questionnement individuel sur la mort, mais aussi la vision de notre société sur la vie.
En première lecture, nous nous étions interrogés sur la raison d’être de cette nouvelle proposition de loi ; nous continuerons à le faire en seconde lecture. Le Premier ministre a en effet indiqué, il y a quelques mois, qu’il s’agissait d’une étape nouvelle – alors, comprenez la crainte de certains d’entre nous qu’il n’y ait là un glissement vers l’euthanasie ! Des questions continuent d’être posées, et si je sais que certains des auteurs de la proposition de loi ont entendu nos interrogations, il faudra que cela se traduise dans le texte.
Beaucoup d’entre nous ont ainsi été choqués par la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 3, qui emploie l’expression « prolonger inutilement [la] vie ». Il y a aussi des sujets que ce texte aborde et tranche, alors qu’il ne nous paraît pas aisé de le faire : ainsi, la qualification de l’hydratation et de l’alimentation – s’agit-il, oui ou non, d’un traitement ? Nous espérons par conséquent que le texte subira un certain nombre d’évolutions ; on nous dit que cela pourrait se produire à l’occasion de la commission mixte paritaire, mais il serait dommage que ces évolutions ne soient pas énoncées durant la discussion en séance plénière. « Prolonger inutilement [la] vie » est une expression tout à fait inacceptable ; si elle était susceptible d’être retirée du texte, il serait important de le savoir.
Cela a déjà été souligné par de précédents orateurs : les soins palliatifs ne sont pas assez développés dans notre pays. Une telle insuffisance justifie-t-elle le présent texte ? Je ne le crois pas. Chacun aura observé qu’il n’existe pas dans notre assemblée de consensus sur cette proposition de loi. Les questions que nous évoquons ont pu faire l’objet, à d’autres moments, d’un plus large accord. Ce texte nous suggère un pas que nombre d’entre nous ne souhaitons pas faire.

Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, quelques mots avant d’aborder l’examen des articles et des amendements, pour indiquer dans quelle optique nous avons, vingt-cinq collègues et moi-même, déposé nos amendements. Non pour refaire le débat de la première lecture : il a déjà eu lieu. On a abouti à un texte qui n’a pas été stabilisé ; pour preuve, nous avons été trente-quatre à voter contre le texte et quatre-vingt-trois de nos collègues se sont abstenus. On est bien loin du consensus et de l’unanimité qui existaient sur la loi Leonetti de 2005 !
Cela étant, il serait bon que nous tâchions d’améliorer et d’enrichir le texte. Le Sénat a essayé de le faire en commission des affaires sociales, avec l’adoption de douze amendements – que nous allons, pour une large part, déposer à nouveau. Et puis, il y a des inquiétudes persistantes, notamment s’agissant de l’association de l’opposabilité des directives anticipées – pour reprendre le terme employé par Mme la ministre, qui soulève des interrogations quant à la force qu’auront ces directives – et d’un droit à la sédation profonde et continue : Mme la ministre l’a dit très clairement, on changera d’équilibre par rapport au texte de 2005. On est très clairement en train de basculer vers des dérives euthanasiques.
Les amendements que nous allons présenter viseront donc à la fois à améliorer le texte et à montrer qu’il contient en germe une dérive dangereuse pour notre société.

Cet article 1er comprend deux points principaux. D’abord, un éloge des soins palliatifs, que je ferai à mon tour, et cela d’autant plus volontiers que, je le rappelle non sans immodestie, je suis l’auteur de la loi du 9 juin 1999 garantissant le droit d’accès aux soins palliatifs – qui résulte en effet d’une proposition de loi.
L’autre disposition sur laquelle je voudrais intervenir est la garantie d’un « droit à une fin de vie digne et apaisée ». Je ne partage pas du tout cette opinion. En effet, le décès par cette pratique médicale interviendra au bout, soit de deux à huit jours, si l’on en croit le professeur Sicard, soit, si l’on suit d’autres avis, d’une à deux semaines. Il s’agit donc d’un décès lent et prolongé. De surcroît, il est prévu une interruption de l’hydratation et de l’alimentation artificielles, que le texte considère comme des traitements quand d’autres les envisagent comme des soins qu’il conviendrait de poursuivre ; d’où le risque d’un décès dans des circonstances longues et douloureuses – ce qui ne correspond pas, je pense, aux objectifs des auteurs du texte.
J’ajoute que, s’agissant d’une anesthésie générale – ce qu’a reconnu M. Leonetti en commission, car il convient d’appeler les choses par leur nom : il ne s’agit nullement d’une « sédation » –, le patient sera victime d’une perte de conscience, ce qui l’empêchera d’avoir un ultime contact avec ses proches et sa famille, alors qu’en général un patient souhaite décéder entouré des siens.
Ce qui est proposé ne correspond donc pas à ce que nous souhaiterions, qui serait beaucoup plus humain, à savoir une assistance médicalisée au décès. Choisir sa mort est en effet la dernière des libertés.
Applaudissements sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et sur plusieurs bancs du groupe écologiste et du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Un mot pour rassurer notre collègue Bernard Roman : j’ai cité, non pas Moïse lui-même – qui, au demeurant, ne nous a laissé que très peu de citations ! –, mais le poème de Vigny, et cela parce que l’expression « s’endormir du sommeil de la terre » me paraissait en adéquation avec ce qu’est la sédation terminale, qui n’est ni la mort, ni l’intention de la donner – ce qui s’appelle « le sommeil éternel ».
Je veux dire aussi à Roger-Gérard Schwartzenberg que l’hydratation est considérée comme un médicament, notamment dans cette loi, quand elle n’est pas naturelle, c’est-à-dire quand on utilise une perfusion ou toute autre forme de tubulure – comme on dit. En revanche, pour lutter contre un éventuel inconfort, il n’est nullement interdit d’humidifier la bouche ou de faire avaler quelques gouttes d’eau – comme quand on dort. L’inconfort que vous dénoncez n’est donc probablement pas la réalité. J’entérine toutefois le fait que nous n’en savons pas tout.

À ce stade, je voudrais rappeler qu’en première lecture, j’avais voté pour cette proposition de loi, bien que je trouve qu’elle n’aille pas assez loin, parce que je considère que c’est une avancée – à mon avis, il faut toujours soutenir les avancées et ce qui est susceptible de débloquer une situation bloquée depuis dix ans. Cependant, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, la donne a changé, dans la mesure où le Sénat n’a pas voulu appuyer le compromis trouvé à l’Assemblée nationale, ni même l’amender a minima, et qu’il a rompu, en quelque sorte, la volonté de consensus qui prévalait. De surcroît, je ne pense pas qu’il soit possible d’avancer sur ces questions par consensus : l’histoire montre que les réformes dites « de société » ont toutes été adoptées dans un climat plutôt conflictuel ; ce n’est que par la suite, par leur application, qu’elles deviennent consensuelles – ou non. Et quand elles le deviennent, elles ne sont plus remises en cause.
Je voterai donc les amendements qui permettraient d’aboutir à un nouvel équilibre, propre à l’Assemblée nationale, une majorité d’entre nous étant, j’en suis convaincu, prêts à aller plus loin que le compromis initial proposé par nos collègues Claeys et Leonetti.
Et à l’attention de M. Mariton, qui soulignait qu’il fallait privilégier, non pas les opinions personnelles, mais la position du législateur, eh bien, je précise que je dis cela en tant que législateur ; peu importe ma position personnelle – je ne suis d’ailleurs militant d’aucune des causes en présence. Mais je crois que notre rôle de législateur est de permettre à chaque personne, à chaque Française et chaque Français, de faire valoir sa position personnelle. Voilà pourquoi je souhaite que les amendements sur le suicide médicalement assisté soient adoptés.

Nous en venons aux amendements à l’article.
Je suis saisi d’un amendement, no 268 , tendant à supprimer l’article 1er.
La parole est à M. Jacques Bompard, pour le soutenir.

Ayant eu l’occasion de fréquenter le monde hospitalier au cours des derniers mois, j’ai pu constater que la médecine française est dans un triste état : elle souffre d’un déficit de chirurgiens, de médecins et même d’infirmières. Dans les campagnes comme dans les villes, on ne parvient plus à remplacer les praticiens qui partent ; et ce n’est certes pas la suppression des éthiques médicales millénaires qui arrangera les choses.
Vous l’avez compris, je suis un adversaire acharné du présent texte, sans être toutefois de ceux qui plaident pour le maintien des dispositions actuelles : il aurait fallu, justement, supprimer celles qui remettent en cause le respect de la vie jusqu’à son terme naturel.
Avec l’article 1er, et c’est là toute sa prétention, vous entendez assumer jusqu’au bout le maintien des patients dans une situation de « dignité », haute et belle notion qu’il est intéressant de vous voir invoquer. En latin, la dignitas est l’estime, le mérite, la considération, le prestige. La vie en tant que telle recouvre donc bel et bien cette notion, et ce sans aucune béquille étatique. La vie s’intègre à un ordre naturel – même si je sais que cette expression vous choque –, lequel décide de son commencement et de sa fin ; d’où l’opposition essentielle à l’acharnement indu, mais aussi le devoir de rappeler qu’aucun homme n’a le droit de briser cet ordre : c’est ce qui fonde le refus du suicide dans toutes les sociétés.
Imposer à des étudiants et à des praticiens de se faire acteurs de la rupture de cet ordre revient à altérer en profondeur cette notion fondamentale, et cela contribuera à empirer encore la situation de la médecine dans notre pays.
L’amendement no 268 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.


Nous ne nous opposons pas frontalement au texte – aussi n’avons-nous pas déposé d’amendement de suppression –, mais souhaitons l’enrichir. En revanche, nous défendrons un amendement de suppression de l’article 3.
L’amendement no 274 , qui reprend une disposition votée par la commission des affaires sociales du Sénat, vise à ajouter, à l’alinéa 4, après le mot : « soins », les adjectifs : « curatifs et palliatifs ». Pourquoi ne pas profiter de la navette pour enrichir le texte ? Nous parlons de sujets délicats, pour lesquels chaque mot compte : chacune des lectures doit permettre de réfléchir à leur sens et d’améliorer la rédaction. Il me semblerait dommage de refuser les amendements pour figer les choses jusqu’à la commission mixte paritaire : ce serait nier la contribution de notre assemblée sur un texte qui, faut-il le rappeler, n’a pas fait consensus en première lecture, loin de là. Continuons donc à chercher un juste équilibre.

Au-delà de leur contenu, ces amendements posent la question de savoir s’il faut reprendre à notre compte les propositions du Sénat, dont certaines furent d’ailleurs acceptées par le Gouvernement.
Convient-il d’autre part de préciser que les soins doivent être « curatifs et palliatifs » ? Pour ma part j’estime que tout acte médical est une association de ces deux formes de soins. C’est même la condition pour que les choses évoluent positivement.
Nous aurons à examiner d’autres amendements de ce type. Je préférerais que nous en débattions en CMP afin de laisser au Sénat la possibilité, non de détruire le texte mais d’y contribuer positivement.
Vos amendements n’ont au demeurant pas une portée majeure, et je n’y vois pas de raison d’y être défavorable ; cependant il me paraît plus simple de nous en tenir aux fondements du texte que nous avons voté, certes sans unanimité mais à une majorité que, dans d’autres circonstances, on qualifierait d’écrasante, avec plus de 430 voix pour et une trentaine de voix contre. La décision de l’Assemblée ne souffre donc pas de la moindre ambiguïté.
Je ne méconnais pas les difficultés que pose le texte de 2005, qui fut adopté à l’unanimité : il a suscité inquiétudes d’un côté et déceptions de l’autre. Le texte dont nous débattons est de la même veine, et il a reçu l’assentiment de nos collègues. La cohérence me semble donc commander que nous le maintenions tel qu’il est.
Vous avez fait vôtres, monsieur Breton, monsieur Lurton, des amendements du Sénat qui, assurément, visent à enrichir la proposition de loi et non à la rejeter. À ce stade le texte préconise, à l’article 3, de « ne pas prolonger inutilement [l]a vie [du patient] » dans certains cas précis, s’inspirant ainsi du code de déontologie des médecins qui les engage à ne pas prolonger inutilement l’agonie ; mais, puisque l’adverbe vous a fait réagir, monsieur Mariton, on peut tout à fait trouver une autre formulation, par exemple celle qui consisterait à dire que le médecin ne doit pas prolonger la vie par une « obstination déraisonnable ». Cette dernière expression est peut-être mieux circonscrite : Alain Claeys et moi y sommes favorables et je suis sûr que le Gouvernement ne s’y opposerait pas.
Toutefois, pour mener à bien ce travail, le mieux me semble être de préserver les fondamentaux du texte voté à une très large majorité il y a six mois, avant de l’améliorer en commission mixte paritaire.
Comme vous l’avez compris, mon avis défavorable tient donc à des raisons, non de fond, mais de calendrier.
Au Sénat, le Gouvernement a émis un avis défavorable à la disposition dont nous parlons, comme il l’avait fait pour un amendement du même type au projet de loi de modernisation de notre système de santé.
Le fait de mentionner ainsi, de façon séparée, des traitements « curatifs et palliatifs » pourrait conduire à écarter des traitements préventifs qui peuvent être prodigués à des personnes en fin de vie.
Le Gouvernement a accepté d’autres amendements, mais ceux dont nous discutons introduiraient une ambiguïté qui risque d’être préjudiciable aux fins mêmes qu’ils poursuivent.

La majorité écrasante n’écrasera pas, je l’espère, l’expression de points de vue différents. Aux trente-quatre voix contre le texte, monsieur le rapporteur, il faut ajouter quatre-vingt-trois abstentions, sans compter les collègues n’ayant pas pris part au vote : on est donc loin de l’unanimité.

Le vote du Sénat, en effet, modifie l’équilibre recherché par l’Assemblée : s’il avait été différent, sans doute serions-nous en train d’examiner le texte de la Chambre haute.

Pourquoi donc s’interdire de réfléchir à des propositions que vous appeliez de vos voeux ? C’est à quoi tendent nos amendements : plutôt que d’attendre une CMP qui réunira en catimini quelques députés et sénateurs, n’ayons pas peur d’un débat ouvert, public, où chacun peut s’exprimer et prendre position.

En commission des affaires sociales, mercredi dernier, Mme Delaunay, du groupe SRC, regrettait que l’on n’ait pas les mêmes droits selon l’endroit où l’on meurt. De fait, et nous l’avons tous dit, les soins palliatifs sont loin d’être accessibles à tous puisque seuls 20 % des personnes concernées peuvent y accéder. Les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles et les lits identifiés pour ces soins sont insuffisants et les inégalités territoriales criantes.
La Cour des comptes et le rapport Sicard ont fortement pointé ces fortes inégalités territoriales et rappelé la nécessité d’un plan spécifique. Nous le savons tous, les exigences de la loi Leonetti de 2005 en matière de développement des soins palliatifs n’ont pas été respectées, et nos concitoyens, en fonction de l’endroit où ils finissent leurs jours – chez eux ou à l’hôpital, à Paris et dans les grandes villes ou dans les petites communes –, ne disposent pas d’un égal accès aux soins palliatifs, soins d’apaisement à un moment crucial de la vie. Assurer un égal accès à ces soins me paraît être un préalable à toute discussion sur un texte relatif à la fin de vie : de mon point de vue, c’est en effet la seule façon d’offrir à chacun une fin de vie apaisée. Tel est l’objet du présent amendement.
Défavorable également.

L’amendement vise l’ensemble des soins, et pas seulement les palliatifs. Par cette raison même il est déjà satisfait par l’article L. 1110-1 code de la santé publique, lequel garantit à chaque Français un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
Tout en confirmant les propos de M. Leonetti, je vous précise que l’article 38 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit la mise en place de projets régionaux de santé, dans lesquels seront inclus, aux termes d’un amendement qui fut adopté, les soins palliatifs. C’est là, me semble-t-il, une réponse aux préoccupations de M. Breton.
L’amendement no 340 n’est pas adopté.


Cet amendement, de nature à enrichir le texte, en reprend un autre adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.
Défavorable également.
L’amendement no 45 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Selon le philosophe Paul Ricoeur, si cher à notre ministre de l’économie, la « dignité » renvoie à l’idée que « quelque chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain » ; elle est donc liée à la personne elle-même, non à un état de vie.
Je pense que M. Leonetti en sera d’accord, toute personne mérite un respect inconditionnel, quel que soit son âge, son sexe, sa santé physique ou mentale, sa religion ou sa condition sociale. Limiter la dignité à la situation de fin de vie est par conséquent une erreur : les actes de soin et de soulagement doivent être administrés à tout moment de la vie, dans le respect de l’intégrité et de la dignité des personnes. D’aucuns diront que la précision va de soi, mais elle va mieux en le disant.

À la suite de celui de notre collègue M. Cinieri, le présent amendement vise à ce que nous nous interrogions sur la formule aujourd’hui retenue à l’alinéa 10 de l’article 1er : « Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. »
Que signifie le terme « apaisée » ? C’est sur ce point que la commission des affaires sociales avait beaucoup d’interrogations : est-ce une obligation de moyens, une obligation de résultat ? Dans ce dernier cas, il y a lieu de s’interroger. C’est la raison pour laquelle les sénateurs proposaient que la fin de vie soit « accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». Tel est le sens de cet amendement.

Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements en discussion commune ?
Défavorable.
L’amendement no 65 n’est pas adopté.


Je regrette que nous n’ayons pas d’explication précise sur l’utilisation du terme de dignité, car cette notion n’est pas précisément identifiée en droit français. C’est une notion large, ce qui rend ses critères difficilement définissables par le législateur. La dignité peut recouvrir diverses situations dans lesquelles il peut être difficile de rendre un tel droit opposable. Par conséquent, en cas de litige avec un médecin, sur quels critères une famille demandera-t-elle la reconnaissance de l’indignité de la personne malade ? Il n’est pas du pouvoir du juge de déterminer et de définir la dignité d’une personne.
Par ailleurs, dans l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, la dignité se rapporte non pas à la fin de vie mais à la personne. Ainsi, l’extension de la notion de dignité est une arme sémantique visant en réalité à ce que les partisans de la sédation profonde et continue, que la présente proposition de loi tend à autoriser, accaparent le débat sur la fin de vie afin de disqualifier ceux qui s’opposent à cette pratique.
J’aimerais donc obtenir quelques éclaircissements sur ce terme qui, bien que juridiquement flou, occupe tout de même une place centrale dans le texte.

Le terme de dignité suscite en effet beaucoup d’interrogations. Il figure à l’alinéa 10, selon lequel « toute personne a droit à une fin de vie digne ». On sait cependant qu’un clin d’oeil est adressé à un lobby pro-euthanasie, l’ADMD, l’Association pour le droit de mourir dans la dignité. On se rappelle des mots du Premier ministre qui concluait ici même son discours sur ce sujet en parlant du droit de mourir dans la dignité ; un clin d’oeil, là aussi, très appuyé. Tout à l’heure, Mme la ministre a indiqué dans son propos liminaire que rester maître de sa vie au moment où on la quitte était l’enjeu de dignité de ce texte ; quel clin d’oeil, à nouveau, au lobby de l’ADMD !
Ce terme suscite des interrogations : qu’entend-on par « dignité » ? Une définition juridique ne peut épuiser ce concept, qui renvoie à une philosophie. Il faudrait donc que nous nous accordions sur une philosophie de la dignité, alors qu’il existe des conceptions très divergentes. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer le mot « digne » à l’alinéa 10 de l’article 1er.

Dire que le mot « dignité » n’est pas défini en droit, c’est oublier ceci : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Il suffit donc de se rapporter à l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme pour savoir ce qu’est la dignité.
M. Bompard a évoqué tout à l’heure la conception de la dignité selon Sénèque, la dignitas, qui s’oppose au pretium, le pretium étant ce qui s’achète, la dignitas ce qui ne s’achète pas. Un de mes collègues se plaît à dire que le « dignitomètre » n’existe pas, que la dignité n’est pas mesurable, parce que tout homme, quelles que soient sa situation, sa fragilité ou la situation dans laquelle il aborde la fin de sa vie est digne parce qu’il est homme. Par conséquent, il n’existe pas d’altération de la dignité.
En revanche, il existe des conditions indignes. Celui qui souffre et qu’on ne soulage pas, celui qui parle et qu’on n’écoute pas vit dans des conditions indignes, d’autant plus indignes qu’il est dans la plus grande fragilité.
Bien sûr, je n’ignore pas que le mot dignité peut aussi être entendu comme l’estime de soi. À mes yeux, cette dernière acception n’est pas d’ordre constitutionnel ou législatif ; c’est une appréciation portée sur une situation subie comme indigne, une certaine façon de parler. Rappelons effectivement que la dignité est consubstantielle de l’humanité et que les conditions de la fin de la vie peuvent être indignes. Le terme est bien utilisé dans ce sens : on a droit à des conditions dignes et à l’apaisement de ses souffrances.
Je le répète, si ce sens doit être modifié, cela nécessite de mener une réflexion. Sur le fond, cependant, telle est l’interprétation que M. Claeys et moi-même avons des termes utilisés dans le texte.
Même avis. Je rappelle que des décisions du Conseil constitutionnel et des arrêts du Conseil d’État consacrent le principe de dignité.

Cet amendement vise à ce que soit reconnu sur tout le territoire le droit à des soins palliatifs.
Il est important que nous ayons ce débat, car si dans les discours tout le monde s’accorde sur la nécessité de développer les soins palliatifs – cela a été dit en première et en deuxième lectures, des plans ont été annoncés –, la réponse qui a été donnée à notre collègue Mme Le Callennec sur la nature des propositions concrètes contenues dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale est un peu courte. Au-delà des bonnes intentions, nous souhaitons donc avoir plus d’éléments sur le plan annoncé et sur les moyens budgétaires qui lui seront consacrés. Les besoins, qui sont importants, sont en effet loin d’être couverts sur l’ensemble du territoire.

Madame la ministre, nous voulons avoir la garantie que votre loi n’aboutit pas à un désengagement de l’État en matière de soins palliatifs. Nous proposons donc de réaffirmer dans l’article 1er que tout patient en fin de vie a droit à de tels soins.

Chaque femme, chaque homme a un avis sur la façon dont il souhaite mourir. Les approches de la mort sont très diverses selon les opinions et les croyances de chacun. Il existe cependant un point qui fait consensus : la volonté de ne pas souffrir à l’approche de la mort. Or, parmi les patients qui ont besoin de soins palliatifs, un sur deux seulement en bénéficie.
Le nombre de lits de soins palliatifs à créer est estimé à 20 000. Nous devons doubler les équipes mobiles qui oeuvrent avec les équipes d’hospitalisation à domicile et dans les maisons médicalisées, favoriser dans tous les services hospitaliers une culture palliative, laquelle passe par une formation initiale et continue de tous les personnels, et organiser des soins palliatifs à domicile qui demeurent aujourd’hui quasiment inexistants. Enfin, et je l’ai dit en présentant un précédent amendement, le développement des soins palliatifs nécessite de prévoir leur répartition sur l’ensemble du territoire.

La parole est à Mme Marion Maréchal-Le Pen, pour soutenir l’amendement no 8 .

J’exprime par cet amendement le même souci que les collègues qui sont intervenus avant moi. Développer et améliorer les soins palliatifs permettrait d’aborder la question du confort, de l’accompagnement et des conditions de la mort et, surtout, d’apaiser la peur à l’origine de l’adhésion à l’euthanasie.
Le champ de la lutte contre la douleur a connu de remarquables avancées techniques en permettant à l’homme d’atténuer plus que jamais ses douleurs physiques. Pourtant, 80 % de nos concitoyens qui pourraient bénéficier de soins palliatifs en sont exclus. Dans son rapport annuel paru le 11 février 2015, la Cour des comptes relève une prise en charge « très incomplète » des soins palliatifs avec de fortes disparités régionales voire infrarégionales : 62 % des unités de soins palliatifs se concentrent dans cinq régions représentant près de la moitié de la population, avec des effectifs insuffisants ; certaines régions telles que la Guyane sont très peu voire totalement dépourvues de lits en soins palliatifs. Le très petit nombre de lits que chaque service consacre à de tels soins ne permet pas le développement d’une vraie démarche palliative.
Il apparaît essentiel de répondre au légitime souhait des Français de choisir le lieu de leur fin de vie en ouvrant les soins palliatifs aux structures non hospitalières. De même, les équipes mobiles de soins palliatifs doivent déplacer la prise en charge de l’hôpital vers les lieux où les Français souhaitent finir leur vie.

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements en discussion commune ?

Je rappelle que lors du débat en première lecture à l’Assemblée nationale nous avons inscrit, à l’article 4 bis de la proposition de loi, que les agences régionales de santé devaient présenter un rapport annuel sur la politique poursuivie par la région en matière de soins palliatifs et pour le développement de ces derniers. Parce que nous considérons que ce sujet est important, nous avons ainsi fait en sorte que le Parlement puisse évaluer les progrès du développement des soins palliatifs. L’avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Permettez-moi d’ajouter qu’une loi de 1999 donne à tous l’accès aux soins palliatifs. J’ai parlé tout à l’heure de « loi efficace », si vous me permettez une telle expression : ne faisons pas des lois qui rappellent des dispositions ayant déjà été votées. Ce n’est pas ainsi que nous avancerons, mais plutôt en mettant les moyens pour que les lois qui ont été votées, en particulier si elles l’ont été de manière consensuelle, s’appliquent pleinement.
Je ferai une seconde remarque. Les soins palliatifs me paraissent faire l’unanimité. Peut-être serait-il nécessaire de relire les recommandations que la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs exprime au sujet de la sédation profonde et continue appliquée, jusqu’au décès, lorsque la mort est imminente et que le traitement contre la souffrance reste inopérant. Cela nous rappellerait à quel point le texte que nous présentons aujourd’hui est directement inspiré par la philosophie des soins palliatifs, et qu’il est donc difficile de s’y opposer frontalement lorsque l’on affirme défendre ces derniers.
Même avis, défavorable.

Madame la ministre, vous évoquiez à l’instant le projet de loi de modernisation de notre système de santé, dont l’article 38, relatif aux projets régionaux de santé, prévoit que soit obligatoirement traitée la question des soins palliatifs. Je reviens sur les propos tenus tout à l’heure par notre collègue Xavier Breton : nous aimerions qu’une telle disposition se traduise dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016. Comment sera-t-elle appliquée ? Une enveloppe dédiée sera-t-elle attribuée aux agences régionales de santé ? Quels en seront les critères de répartition ? Ces questions se poseront de façon concrète.
Même en supposant que l’article 38, auquel nous sommes favorables, soit adopté en l’état et que les fonds nécessaires à son application soient prévus dans le PLFSS, le nouveau découpage territorial ne simplifiera pas l’organisation des ARS dans les régions qui ont vu leur périmètre modifié. Je souhaite donc savoir si vous avez d’ores et déjà imaginé comment cette disposition serait mise en oeuvre.

Je suis d’accord avec M. Leonetti sur ce point : la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs comporte déjà cette disposition selon laquelle chacun a le droit à une mort digne, et toute personne en phase évolutive ou terminale d’une maladie potentiellement mortelle le droit d’avoir accès à des soins palliatifs. Il n’est donc pas utile de réécrire ce qui figure déjà dans le droit positif depuis 1999,…

…même si nous nous accordons tous sur l’utilité et la nécessité de développer les soins palliatifs.


Il vise à compléter l’alinéa 10 de l’article 1er. Aujourd’hui, le principe de proportionnalité qui préside aux justes décisions thérapeutiques est insuffisamment clarifié dans la législation actuelle. Il me semble nécessaire de donner des critères de discernement quant aux soins et aux traitements qui doivent être poursuivis lorsque l’on renonce à des traitements disproportionnés.
En principe, cette proposition de loi n’a pas pour but de légiférer sur l’euthanasie. Or il est important de rappeler que des euthanasies peuvent être provoquées aussi bien par action que par omission, par exemple en arrêtant un soin élémentaire comme l’alimentation ou l’hydratation – ce que permet le texte – ou un traitement proportionné dû au malade.

Nous évoquerons ce sujet de manière plus détaillée dans le cadre de l’article 2, mais nous pensons qu’il doit être abordé dès l’article 1er. Cette proposition de loi n’ayant pas pour but de légiférer sur l’euthanasie, il est important de rappeler que des euthanasies peuvent être provoquées par l’arrêt d’un soin élémentaire ou d’un traitement proportionné normalement dû au malade.

Madame Maréchal-Le Pen, on ne peut pas être pour la loi de 2005 et contre les dispositifs qu’elle a mis en place. D’ailleurs, cette loi a été examinée par le Conseil d’État et a même été validée par la Cour européenne des droits de l’homme. Soyons prudents lorsque l’on avance certaines affirmations : si on dit que la loi de 2005 est une très bonne loi, comme je l’ai entendu dans votre bouche,…

…alors son application par le Conseil d’État et sa validation par la Cour européenne des droits de l’homme doivent être respectées.
Permettez-moi également de vous rafraîchir la mémoire. En avril 2013, j’ai déposé une proposition de loi, cosignée par un certain nombre de collègues de l’opposition, qui reprenait strictement tant le principe de la sédation profonde et continue jusqu’au décès que celui des directives anticipées à caractère contraignant. À ce moment-là, M. Collard et vous-même aviez trouvé que c’était une bonne initiative.

N’essayez pas de changer d’avis : c’est à cette tribune que cela a été dit !

Je vois que vous le niez, mais je vous transmettrai le texte de l’intervention de M. Collard, à moins que vous ne vous en dissociiez.
Défavorable. Comme l’a dit M. Cinieri, c’est à l’article 2 que nous préciserons ces dispositions. L’expression « obstination déraisonnable » écarte toute ambiguïté quant à l’idée que nous pourrions permettre de donner la mort de façon volontaire.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement no 15 .

Il n’y a pas de définition claire de la fin de vie. Dans certaines situations, sa reconnaissance est évidente. En revanche, il existe de nombreuses maladies ou stades d’une maladie dont l’histoire naturelle est faite de poussées et où l’issue n’est pas toujours très claire. Dès lors, on ne peut affirmer que le malade était en fin de vie que rétrospectivement, après son décès. Avant cela, toute affirmation est chargée d’incertitude. Légiférer sur la fin de vie, c’est donc légiférer sur une donnée non définie.
Il est du devoir du médecin d’approcher la fin de vie le plus finement possible, par le biais d’une consultation approfondie du dossier et du patient, de l’établissement de scores cliniques, d’une rencontre avec la famille et d’une présentation du dossier à ses confrères. Il faut tenter d’approcher au mieux et dans chaque cas particulier ce qu’est la fin de vie, en coopération avec les structures existantes : le comité d’éthique d’établissement, la réunion de concertation pluridisciplinaire, le comité de lutte contre la douleur, les équipes mobiles de soins palliatifs. Tel est l’objet de cet amendement.
L’amendement no 15 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à Mme Marion Maréchal-Le Pen, pour soutenir l’amendement no 40 .

Il relève toujours du même esprit. Pour répondre à M. Leonetti, je n’avais pas encore le plaisir d’être députée en 2005 – j’étais bien trop jeune pour cela !

Mais à l’époque, si cela avait été le cas, je me serais permis de relever le risque de confusion que comportait cette loi, que je trouvais alors équilibrée mais qui n’indiquait pas clairement si l’alimentation et l’hydratation devaient être assimilées à des traitements ou à des soins. Lorsque je me suis exprimée sur ce texte en première lecture, j’ai d’ailleurs relevé cette difficulté, cette incohérence. Par cohérence, je la relève à nouveau aujourd’hui.
L’amendement no 40 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Nous abordons les amendements relatifs à l’alinéa 11, qui concerne la formation des professionnels de santé. Les étudiants en médecine, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et les aides à domicile doivent avoir droit à une formation aux soins palliatifs – c’était l’objet de l’amendement de notre collègue François de Mazières, adopté en première lecture dans cet hémicycle.
La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité préciser cette disposition. D’une part, il convient d’indiquer explicitement qu’elle concerne « la formation initiale et continue ». C’est important : le développement de la formation initiale sur les soins palliatifs dans les parcours d’études est une chose, mais il faut également penser à la formation continue ! D’autre part, il est proposé d’ajouter à la liste de professionnels concernés les psychologues cliniciens, qui font partie des équipes de soins palliatifs. Dans ma ville de Bourg-en-Bresse, j’ai rencontré un psychologue membre d’un service de soins palliatifs qui s’étonnait de ne pas avoir droit, lui aussi, à une formation sur ce sujet.
Il s’agit donc d’un amendement visant à enrichir le texte adopté en première lecture à l’initiative de notre collègue de Mazières.

La parole est à Mme Marion Maréchal-Le Pen, pour soutenir l’amendement no 7 .

Il convient de prévoir que « les cursus médicaux et paramédicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement ». Il est incroyable que 80 % des médecins ne soient pas formés aux techniques de soulagement de la souffrance ! De ce fait, une grande partie d’entre eux connaissent mal la loi Leonetti actuellement en vigueur. Dans ces conditions, avant de légiférer et d’aller encore plus loin, peut-être serait-il judicieux de faire en sorte que les médecins connaissent déjà les techniques actuellement possibles pour soulager la souffrance des patients.
Il est absolument indispensable que les professionnels de santé soient formés à l’accompagnement des personnes en fin de vie et aux soins palliatifs. Cependant, les contenus des programmes de formation, qu’elle soit initiale ou continue, ne relèvent pas du domaine législatif. Les maquettes de l’enseignement sont déterminées de manière réglementaire, à l’issue d’une concertation dans le cadre d’une commission réunissant des représentants des ministères chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. C’est cette commission, qui est d’ailleurs actuellement au travail, qui détermine les modules de la formation, en lien avec les professionnels de chacun des secteurs. En aucun cas le contenu de ces modules n’a de valeur législative – ce serait une première !
C’est comme si la loi disposait qu’on ne peut pas être médecin sans avoir été formé aux massages cardiaques – je ne sais pas si ce que je dis là a un sens, je parle sous le contrôle des médecins présents dans l’hémicycle. Il va de soi que les médecins connaissent les gestes de premier secours en cas de crise cardiaque, même s’ils ne sont pas cardiologues. Cela ne figure dans aucune loi.
Ainsi, les dispositions proposées par ces amendements ne sont pas de nature législative : c’est pourquoi j’y suis défavorable.

Merci pour votre réponse, madame la ministre. Vous dites que cette commission travaille. Va-t-elle dans le sens de cet amendement ?
Elle travaille !

Je ferai la même réflexion que tout à l’heure. L’article 7 de la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs dispose : « Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent […] les connaissances acquises […] en vue de permettre la réalisation de ces objectifs. » À moins que cette disposition ait été abrogée – ce que je ne pense pas –, l’obligation pour les CHU d’assurer une formation initiale et continue en soins palliatifs figure donc bien dans le droit positif, plus précisément dans la loi, et non dans un simple règlement. Chacun sait que, dans un texte juridique, l’indicatif a valeur d’impératif. Si nous ajoutions quelque chose, ce ne serait qu’une répétition.
L’amendement no 7 n’est pas adopté.

Les pharmaciens accompagnent les patients en fin de vie aux côtés des autres professionnels de santé : ils devraient également bénéficier d’une formation. Ce serait cohérent avec le souhait du législateur d’améliorer la fin de vie des patients, notamment à leur domicile. En effet, les pharmaciens d’officine sont amenés à délivrer des médicaments dans le cadre d’une prise en charge à domicile relevant de soins palliatifs. À l’hôpital, les pharmaciens participent aux comités de lutte contre la douleur dans les unités de soins palliatifs et s’occupent de l’approvisionnement en produits morphiniques. C’est la raison pour laquelle je propose que les pharmaciens soient ajoutés à la liste des professionnels de santé ayant droit à une formation.
L’amendement no 319 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.


Il s’agit de compléter l’article 1er par un alinéa ainsi rédigé : « Tout établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes doit conclure une convention avec une unité mobile de soins palliatifs afin d’organiser les modalités de son intervention dans l’établissement. » Ainsi, cet amendement vise à renforcer l’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs, notamment dans les EHPAD.
Il faut constater l’insuffisance des soins palliatifs dans les établissements médico-sociaux, particulièrement dans les EHPAD. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2015 intitulé Les soins palliatifs, une prise en charge toujours très incomplète, l’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs au sein des EHPAD reste insuffisante alors même qu’elles y auraient toute leur place.
La convention tripartite liant les départements, les agences régionales de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD – prévoit d’ores et déjà des référents en termes de soins palliatifs. Même s’il faut aller plus loin – ce sera l’objectif du travail qui sera poursuivi –, il est d’ores et déjà prévu qu’un point de contact soit identifié dans ces conventions. Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, le Gouvernement y sera défavorable.

Il y a quelque chose d’un peu irréaliste dans ce débat. On est en train d’essayer de remettre les soins palliatifs à la place où ils doivent être, c’est-à-dire avant la séquence de fin de vie, comme cela a été rappelé. Pour autant, toutes les questions que nous posons pour nous assurer que tout est bien déployé pour la mise en oeuvre des soins palliatifs sont contournées. Un collègue vient de demander si les choses étaient suffisantes dans les établissements pour personnes âgées. On sait bien qu’elles sont insuffisantes, mais on lui a répondu qu’une convention était prévue. À un autre collègue, il a été répondu que le déploiement des soins palliatifs était prévu dans les textes, alors qu’on sait très bien que les moyens financiers manquent. C’est extrêmement gênant !
Tout le monde reconnaît que les soins palliatifs sont importants, au coeur même du débat. On nous dit que leur développement est prévu dans les textes, qu’il y a des conventions, mais on sait très bien que, dans les faits, les services ne disposent pas des moyens, des personnels ni des dispositifs opérationnels qu’on serait en droit d’attendre. À chaque question sur les soins palliatifs, on nous apporte des réponses normatives, on nous dit que c’est dans les textes. On ne nous apporte aucune garantie, aucune assurance, aucun élément qui nous permette d’être sereins quant au fait que les soins palliatifs seront dispensés équitablement sur l’ensemble du territoire français.
Les intentions, les textes, les normes, les conventions ne suffisent pas. On ne peut aborder sereinement ces questions si l’on n’a pas des garanties sur ce que l’État, via les ARS, propose réellement en matière de fin de vie. On sait très bien que les soins palliatifs, aujourd’hui, ne sont pas à la hauteur des attentes des Français.

J’ai écouté avec attention nos débats et compris qu’un certain nombre d’amendements discutés en commission des affaires sociales du Sénat seraient repris et débattus en commission mixte paritaire. Cela signifie que seront probablement rejetés à l’Assemblée nationale les amendements qui a priori vont dans le bon sens. Pourriez-vous nous dire si ceux que nous défendons ont des chances d’être discutés et votés en commission mixte paritaire ?

Madame la ministre, vous annoncez un plan triennal pour développer la culture palliative. Ces amendements, qui portent sur la formation et les conventions avec les établissements sont au coeur du sujet, et l’on comprend mal qu’ils fassent l’objet d’un avis défavorable. Qu’ils ne soient pas votés ici, mais débattus en deuxième lecture au Sénat puis adoptés en commission mixte paritaire, est difficile à digérer.
Que contiendra le plan triennal de développement des soins palliatif si n’y figure pas ce que les amendements de nos collègues proposent ?


Les rapports ne permettent pas toujours d’avancer de manière considérable, mais il serait utile que le Gouvernement informe le Parlement des progrès en matière de formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement.
Madame la ministre, mes collègues, Mme Le Callennec en particulier, vont ont interrogée sur le développement des soins palliatifs, dont nous nous accordons tous ici à penser qu’il est nécessaire. Le Gouvernement a-t-il pris des engagements quantifiés, en termes de nombre de lits ou de proximité des services ?
Vous avez évoqué tout à l’heure les schémas régionaux, et sans doute le Gouvernement y renvoie-t-il en se satisfaisant d’une approche générale. Mais les schémas régionaux sont une chose, l’objectif national en est une autre. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ?

Madame la ministre, il faudrait que nous soyons certains que l’accès aux soins palliatifs sera développé dans les prochaines années à la hauteur des besoins. Nous souhaitons donc que la formation aux soins palliatifs des étudiants et du personnel médical soit évaluée dans un rapport remis au Parlement.

Jean Leonetti et moi-même sommes revenus à plusieurs reprises sur ce sujet important, la priorité donnée aux soins palliatifs, et Mme la ministre s’est exprimée sur cette question en début de séance. Malgré une hausse des soins palliatifs ces quinze dernières années, quels qu’aient été les gouvernements, le chemin qu’il nous reste à parcourir est encore très long.
Au-delà des déclarations, nous avons souhaité, en première lecture, créer un article spécifique, l’article 14 : « Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi, ainsi que la politique de développement des soins palliatifs. »
Je ne pense pas que, dans le cadre de cette loi, le législateur puisse aller au-delà. Avis défavorable.
Même avis. J’ai indiqué que le Gouvernement travaillait à un plan. Une part des objectifs qu’il contiendra seront chiffrés.

Il s’agit de compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport détaillant les modalités de la mise en place d’une filière universitaire de médecine palliative. »
La loi de 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – HPST – a instauré une formation continue obligatoire pour les médecins : le développement professionnel continu – DPC. En matière de formation continue aux soins palliatifs, deux parcours universitaires sont proposés : les diplômes universitaire et inter-universitaire de soins palliatifs. Le premier, d’une durée d’un an, est également ouvert aux étudiants et aux professions paramédicales ; le second prolonge le cursus d’une année supplémentaire de formation clinique et critique.
Pourtant, dans son rapport public annuel de 2015, la Cour des comptes souligne que « ces efforts ne se traduisent pas pour l’instant par une véritable évolution de la culture médicale qui reste marquée par la survalorisation des prises en charge techniques, au détriment des dimensions d’accompagnement et de prise en charge globale. De ce point de vue, la mise en place d’une filière universitaire de médecine palliative est considérée par de nombreux acteurs comme essentielle pour une véritable promotion de la démarche et pour le développement d’activités de recherche. »
Un amendement proposant la mise en place d’une véritable filière universitaire où serait enseignée la culture palliative aurait à passer sous les fourches caudines de l’article 40. Nous proposons donc que le Gouvernement présente un rapport sur la mise en place d’une telle filière, qui répondrait davantage à des objectifs d’accompagnement palliatif qu’à des objectifs de tarification. Nous attendons particulièrement la réponse de Mme la ministre sur ce point.
L’amendement no 226 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.
L’article 1er est adopté.

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 2.
La parole est à M. Bernard Roman.

Un certain nombre de repères essentiels du texte figurent dans cet article. Ceux qui, dans cet hémicycle, sont favorables à ce que l’on aille plus loin que la sédation profonde et continue, en donnant, comme l’a évoqué tout à l’heure Jean-Louis Touraine, la liberté à ceux qui le souhaitent de faire appel à l’aide active à mourir dans la dignité, ne voient aucune contradiction à souhaiter que les soins palliatifs continuent de se développer.
Vous interpellez la ministre, mais personne ne peut nier que beaucoup a été fait depuis 2012 dans ce domaine. Il ne faut pas opposer le développement des soins palliatifs et l’ouverture d’un droit, l’accès à une liberté nouvelle.
Limité par le temps, je souhaite encore évoquer ce qui est la réalité de nos hôpitaux en matière d’euthanasie médicale. L’Institut national d’études démographiques a publié un rapport sur l’année 2013 dans les hôpitaux français, mentionnant que 4 500 personnes environ y étaient décédées des suites d’une administration médicamenteuse dont l’objet était de mettre fin à la vie.
On peut faire comme si cela n’existait pas et affirmer que l’on va interdire l’euthanasie en France ; mais on n’interdira pas l’euthanasie aux Français, que ce soit dans les hôpitaux, parce que des médecins la pratiquent, ou à l’étranger, parce qu’ils peuvent s’y rendre. Il est de notre responsabilité de garder les yeux grands ouverts sur cet espace de liberté, investi par un certain nombre de nos concitoyens, et que nous souhaiterions fermer.

Le professeur Régis Aubry, président de l’Observatoire national de la fin de vie, a dressé un état des lieux détaillé de la fin de vie dans les établissements pour personnes adultes handicapées. Le préambule de son rapport contient des mots très justes : « Si l’on n’y prête pas attention, il y a un risque réel de négliger cette population du fait même de sa vulnérabilité et de sa difficulté à exprimer tout haut ce qu’elle pense le plus souvent tout bas. »
J’ai avec moi la liste des soixante-sept associations de personnes en situation de handicap, regroupées au sein du Comité d’entente : Autisme France, l’Association des paralysés de France, Vaincre la mucoviscidose, l’Association française contre les myopathies – et j’ai une pensée particulière pour l’Association myopathie à tout coeur, qui se mobilise dans mon département pour aider tous les malades –, l’Association pour le spina-bifida, la FNATH, l’Unapei, la Fédération française des groupements de parkinsoniens… Je ne les citerai pas toutes, mais elles le méritent pourtant, car le soutien qu’elles apportent aux malades ou aux personnes souffrant d’un handicap ainsi qu’à leur famille est indispensable.
Ces associations nous ont écrit il y a quelques jours pour nous faire part de leurs craintes, madame la ministre. Elles estiment que ce texte peut être dangereux pour les personnes en situation de handicap complexe de grande dépendance.
Ainsi, pour nombre de personnes dans ce cas, l’alimentation et l’hydratation artificielle sont courantes et constituent un soin qui améliore leur qualité de vie tout au long de leur existence. Ce mode d’alimentation est un soin de prévention et de compensation des troubles de la déglutition inhérents à la déficience motrice des personnes en situation de handicap complexe.
C’est pourquoi je défendrai dans quelques minutes des amendements afin que l’alinéa 3 de cet article soit supprimé.

L’article 2 détermine les conditions d’arrêt des traitements lorsque les actes pratiqués constituent une obstination déraisonnable et apparaissent inutiles ou disproportionnés. Il prévoit une procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale avant l’arrêt des traitements.
Je pense que les modalités de mise en oeuvre de la procédure collégiale pourraient être améliorées, en prenant davantage en compte l’analyse faite par les professionnels paramédicaux. Ce sont en effet les seules personnes qui, bien qu’au contact régulier des patients, ne peuvent déclencher cette procédure. Leur présence dans les soins, la relation que cette présence facilite leur permettent pourtant de se questionner, parfois avant l’équipe médicale, sur la mise en oeuvre d’une démarche de soins qui pourrait relever d’une obstination déraisonnable.
L’article 2 prévoit aussi que, dans le cas d’une suspension des soins, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant des soins palliatifs. Je crains pourtant que, malgré les déclarations du Président de la République, qui prévoyait en décembre qu’un enseignement spécifique serait proposé aux professions médicales dès la rentrée 2015 dans le cadre d’un plan triennal pour le développement des soins palliatifs, et malgré les engagements que vous venez de prendre, madame la ministre, cet objectif ne puisse être atteint faute de moyens, et que cette quatrième loi sur la fin de vie ne soit inapplicable.

L’article 2 vise à définir l’obstination déraisonnable et pose la question de la nutrition et de l’hydratation artificielles. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces sujets sensibles en défendant nos amendements.

En l’état actuel du texte, l’obstination déraisonnable est caractérisée dès lors que les actes mis en oeuvre s’avèrent inutiles ou disproportionnés. Toutefois, pour en juger ainsi, il faut avoir défini au préalable les objectifs que devaient remplir les traitements. C’est uniquement au regard du but à atteindre que les traitements pourront être jugés inutiles ou disproportionnés. Les deux critères alternatifs que nous propose le texte sont incomplets et méritent d’être précisés.
Outre cette clarification nécessaire, je souhaite vous alerter sur les conséquences qu’entraînerait l’adoption de l’alinéa 3. Il y est inscrit que la nutrition et l’hydratation artificielle constituent un traitement.
Vous imposez ainsi la logique du tout ou rien. Si le patient décide d’arrêter tout traitement, il sera également mis fin à l’hydratation et à la nutrition. Or, un patient peut très bien vouloir arrêter un traitement médicamenteux qui le fait souffrir tout en conservant l’alimentation et l’hydratation.
De même, l’arrêt de l’un ne doit pas systématiquement engendrer l’arrêt de l’autre. Un patient peut très bien supporter l’hydratation tout en ne tolérant plus l’alimentation. L’hydratation et la nutrition sont avant tout des soins dus aux personnes et ne peuvent donc pas être considérées uniquement comme des traitements.
Pour toutes ces raisons, je vous propose de modifier cet article afin d’offrir à chacun de nos concitoyens les conditions d’une mort sereine et apaisée.

Je voudrais défendre cet article 2 qui comprend trois alinéas, tous nécessaires à sa cohérence. Cet article s’inscrit dans le droit fil de la loi de 2005 et il reprend essentiellement l’article 37 du code de déontologie, qui dispose qu’un médecin doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
Je pressens bien que le débat portera sur la qualification ou non de traitement de l’hydratation et de l’alimentation. Je voudrais m’appuyer, pour vous convaincre, non pas sur ce que je pense, mais sur l’avis rendu en 2007 par deux sociétés savantes, la Société française de gériatrie et gérontologie et la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs. Selon elles, la très grande majorité des patients en fin de vie n’éprouveraient pas la sensation de soif car la déshydratation entraîne la sécrétion d’opioïdes cérébraux à l’action antalgique. Certains auteurs pensent même que la déshydratation peut améliorer le confort en diminuant les vomissements, les encombrements, les bronchites, les ascites, les oedèmes, réduisant ainsi la douleur. Ils considèrent également que l’hydratation parentérale n’améliore pas la sensation de soif des patients en fin de vie, au contraire. Par ailleurs, l’alimentation parentérale par sonde de gastrostomie, puisque c’est ainsi que cela finit le plus souvent, exposerait à de multiples complications, en particulier la pneumopathie d’inhalation. Enfin, l’alimentation et l’hydratation n’influeraient guère sur la vie de patients arrivés en phase terminale.
Nous pouvons conclure de ces différentes données que l’alimentation et l’hydratation sont bien des traitements. L’on ne saurait donc les dissocier de l’écriture de l’article, lequel ne peut pas être modifié.

Cet article 2 montre bien les limites de l’exercice auquel se sont livrés les auteurs de la proposition de loi malgré leur expertise incontestable. Bien que chaque mot ait été pesé, sa rédaction reste en effet contestable.
Qu’est-ce qu’une obstination déraisonnable ? Quels sont les actes inutiles ou disproportionnés ? Comment mesurer la dignité du mourant ? Comment soupeser la qualité de la vie ? Tous ces termes montrent la part de subjectivité et la difficulté d’analyse que représentent les situations de fin de vie. Je le répète, il n’est nul besoin de légiférer à nouveau. La loi de 2005 est un texte équilibré qui permet déjà au médecin de soulager les souffrances, au risque d’abréger la vie du patient. Cela se pratique déjà au cas par cas. Quel besoin d’aller plus loin ? Nous légiférons déjà beaucoup trop dans notre pays.
Il est inscrit au dernier alinéa de cet article que la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. Est-ce à la loi de définir ce qu’est un traitement ? Je ne le pense pas. Ce texte permettant d’arrêter les traitements, cet alinéa autorise de facto l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles. Cet ajout est de trop. Nous appartient-il de donner des injonctions au médecin ? Laissons le soin au médecin d’adapter les traitements et de prendre les mesures qui conviennent. Le serment d’Hippocrate leur impose déjà d’éviter la souffrance. Au lieu de donner un nouveau droit à la sédation, créé dans ce texte, donnons aux médecins les moyens de faire ce qui convient. Améliorons la formation au soulagement de la douleur et développons les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire.

Nous en venons aux amendements.
La parole est à M. Jacques Bompard, pour soutenir l’amendement no 362 .

Je partage l’intervention qui vient d’être faite : cet article témoigne d’une lourde subjectivité dont les contours ne peuvent être aisément cernés mais dont les conséquences pourraient être dramatiques. En effet, à partir de quoi considérer la pérennité de la vie comme inutile ou disproportionnée ? Dans une société touchée par l’ultra-consommation, où l’homme est le fruit d’une véritable marchandisation, cet article pourrait permettre une mort systématique, calculée d’un point de vue financier. Ce côté n’est pas oublié. Ce danger pourrait provoquer un basculement et faire de l’homme une véritable proie des intérêts financiers.
J’ajouterai que ce texte a été le fruit de longues heures de consultations et de travail. J’ai moi-même rencontré beaucoup des acteurs du traitement des derniers instants de la vie. J’ai entendu le remarquable témoignage de Viviane Lambert, notre voisine de la Drôme, et qu’une simple raison technicienne a voulu faire taire pour lui dicter que son fils voulait mourir.
Voilà ce qu’elle a dit. « Vincent n’a rien mangé depuis vingt jours »…

« Il est à peine hydraté. Il est là, devant moi, dans un lit d’hôpital à Reims, amaigri, affaibli et il va mourir. Dans un jour, dans cinq jours, je ne sais pas, mais il va mourir parce que quelqu’un l’a décidé. Un médecin lui a supprimé toute nourriture, presque toute hydratation, pour le mettre sur un chemin de fin de vie. »
Je crois qu’il n’est pas besoin de plus d’argumentation pour démontrer qu’il faut s’opposer avec la plus grande force à cet article.

Je voudrais vous répondre dans le cadre d’un débat apaisé. Vous évoquez un cas terrible, celui de Vincent Lambert. Dois-je vous rappeler que le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’Homme ont statué sur ce cas,…

…non pas au regard du texte dont nous discutons ce soir, mais de la loi Leonetti de 2005 ?
Au travers de cet amendement, vous demandez tout simplement de supprimer le refus d’acharnement thérapeutique. Nous ne pouvons pas être d’accord avec vous. Je souhaiterais, sur des sujets aussi graves que celui-ci, que chacun d’entre nous ait l’honnêteté intellectuelle de resituer les faits au regard de la législation en vigueur.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Avis défavorable.

Il est facile de traiter les autres de malhonnêtes. Je pense très clairement qu’il n’appartient pas au législateur de s’emparer de ces dossiers. Ils doivent rester du domaine de la famille, des médecins, mais surtout pas du législateur qui risque d’ouvrir la boîte de Pandore, tout comme vous l’avez fait en installant Internet dans les écoles primaires.
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

En agissant ainsi, en ouvrant l’accès à tout, vous pourrissez des situations d’une manière dramatique.
Mêmes mouvements.
L’amendement no 362 n’est pas adopté.

Cet amendement tend à rééquilibrer le texte en indiquant expressément que les soins et traitements proportionnés sont maintenus. Nous aurons en effet l’occasion de débattre de la notion d’obstination déraisonnable, qui impose à présent d’arrêter les traitements là où une simple faculté s’exerçait jusqu’à présent. Il nous paraît important, dès lors, de restaurer l’équilibre, surtout pour les personnes vulnérables.
L’amendement no 50 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Dans la rédaction actuelle de l’article 2, le refus de l’obstination déraisonnable implique l’arrêt des actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins.
Or, si le refus de l’obstination déraisonnable implique nécessairement l’absence de nouveaux actes de prévention, d’investigation et de traitements, il n’en est pas de même des actes de soins.
La rédaction est d’ailleurs contradictoire, en violation du principe constitutionnel de clarté de la loi, avec celle de la dernière phrase du deuxième alinéa, qui mentionne « les soins palliatifs visés à l’article L. 1110-10 ».
De surcroît, il n’y a aucune justification à l’arrêt des soins, même en cas de refus de l’obstination déraisonnable, en raison du fait que les soins apportés à une personne humaine se fondent exclusivement sur sa dignité. En conséquence, il faut modifier le début de l’article 2 et viser précisément « les actes de prévention, d’investigation ou de traitements mentionnés à l’article L. 1110-5. »
L’amendement no 51 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.


La rédaction actuelle de cet alinéa manque de précision. Soumettre l’arrêt des traitements à des critères d’utilité et de proportion n’a de sens qu’au regard d’un objectif recherché et préalablement défini qu’il convient donc d’inclure ici.

Cet amendement, qui reprend les travaux de nos collègues de la commission des affaires sociales du Sénat où il a été adopté, tend à modifier la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 2. Selon le texte issu de la première lecture à l’Assemblée, l’obstination déraisonnable implique que les actes mentionnés ne doivent être ni mis en oeuvre ni poursuivis. Nos collègues sénateurs ont préféré une autre rédaction : « Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ».
Il serait important que, dès cette deuxième lecture au niveau de notre Assemblée, nous sachions s’il y a une injonction, obligation d’arrêter les traitements en cas d’obstination déraisonnable ou s’il s’agit simplement d’une faculté offerte, à charge ensuite à la collégialité de prendre la décision.
Même avis.

Je regrette que nous ne puissions même pas avoir ce débat : obligation ou faculté ? C’est tout de même un sujet important et il faudrait savoir où nous en sommes avant que le texte ne reparte au Sénat. Ce n’est pas la même chose d’imposer la fin des traitements en cas d’obstination déraisonnable que d’en offrir la faculté. Dans le premier cas, les professionnels de santé, en particulier les médecins, sont complètement déresponsabilisés. Dans le deuxième, nous en resterions à l’état du droit, avec l’engagement d’une procédure collégiale. Pourquoi passer à l’obligation ?

Personne ne veut éluder ce débat important qu’éclaire un avis du Conseil d’État rendu dans l’affaire Lambert, au regard de la loi de 2005 qui, à l’époque, en tant que proposition de loi, n’avait pas été soumise aux contrôles réservés aux projets de loi. Deux éléments doivent être pris en compte. Tout d’abord, il faut proscrire l’obstination déraisonnable, ce qui ne signifie pas que l’on puisse se passer de l’avis du médecin. Ce sont justement les médecins, en formation collégiale, qui apprécient le caractère déraisonnable ou non de l’obstination. Dès lors que les médecins jugent l’obstination déraisonnable, il faut être logique et mettre fin aux traitements.
Pour autant, le Conseil d’État introduit une restriction : la volonté de la personne. Même en cas d’obstination déraisonnable, les traitements ne peuvent pas être interrompus si la personne concernée s’y oppose.
Sous réserve, donc, de l’appréciation et de l’expression de la volonté de la personne – condition, à mes yeux, du respect de son autonomie et de sa dignité –, la collégialité médicale doit proscrire l’obstination déraisonnable. L’équilibre est ainsi trouvé. La seule obligation du médecin est d’être cohérent avec sa propre appréciation. Il ne saurait poursuivre des actes dont il considérerait qu’ils sont inutiles, disproportionnés ou déraisonnables.
L’ambiguïté qui pouvait exister est compensée par le fait que la définition de l’obstination déraisonnable relève d’une définition collégiale au cas par cas et par la prise en compte de l’avis de la personne concernée, exprimé de manière directe ou de manière indirecte par le biais des directives anticipées et de la personne de confiance.


Cet amendement tend à compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « par rapport au bénéfice escompté ». Soumettre l’arrêt des traitements à des critères d’utilité et de proportion n’a de sens que relativement à un objectif recherché et préalablement défini, qu’il convient donc d’inclure ici. Par ailleurs, la rédaction actuelle de cet alinéa ouvre la voie à de potentiels abus, que le présent amendement entend corriger.

Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle, visant à compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « par rapport au bénéfice escompté ».

Défavorable. Je rappelle que les termes de l’alinéa sont presque identiques à ceux de la loi de 2005. Il paraît difficile de démonter cette loi au nom de l’avancée souhaitée dans la loi de 2015 !
Même avis.

La parole est à Mme Marion Maréchal-Le Pen, pour soutenir l’amendement no 42 .
L’amendement no 42 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.

Il s’agit de maintenir l’équilibre ménagé par la loi Leonetti en 2005 en conservant l’expression « obstination déraisonnable ».
L’amendement no 98 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.

Cet amendement tend à ajouter, après le membre de phrase : « Dans ce cadre, lorsque les traitements n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie », les mots : « d’une personne atteinte en phase terminale d’une affection grave et incurable ». Comme le proposait le Comité consultatif national d’éthique afin d’éviter la censure de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient de distinguer ce cas et celui où la personne n’est pas dans cette situation.

Je me permets de rappeler à mes collègues et amis que la loi de 2005 est relative « aux droits des malades et à la fin de vie » et non « aux malades en fin de vie ». À la question simple que nous devons nous poser – tout traitement doit-il être poursuivi indéfiniment pour maintenir les personnes en vie ? –, la réponse est non, quelles que soient les références philosophiques ou religieuses que l’on peut avoir. Le maintien artificiel en vie d’une personne alors que celle-ci n’a plus conscience qu’elle existe et plus de relation à l’autre pose le problème de l’acharnement thérapeutique, qualifié dans la loi d’« obstination déraisonnable ».
Si l’on dispose que l’on ne peut interrompre un traitement de survie que pour les personnes en fin de vie, on se trouve confronté à une contradiction puisque, précisément, si ces personnes sont en survie, elles ne sont pas en fin de vie !
Pour autant, je vous renvoie aux textes et aux études consacrés au sujet. Si vous vivez en milieu urbain, vous avez quatre-vingts chances sur cent de mourir à l’hôpital, et, dans cet hôpital, vous avez une chance sur deux de mourir d’une limitation ou d’un arrêt des traitements, qui apparaîtront, à un moment donné, inutiles et disproportionnés, ou n’ayant d’autre but que le maintien artificiel d’une vie purement physiologique. Devons-nous maintenir des corps en vie sans qu’il existe la moindre possibilité d’un retour à une pensée, si minime soit-elle ? Je ne parle pas ici de personnes handicapées, mais d’une absence totale de pensée et de relation à l’autre. Comment imaginer que l’on n’ait pas le droit d’arrêter ce type de traitement ?
Nous devons donc faire attention. Ce n’est pas parce que la loi de 2005 a été votée à l’unanimité qu’elle est parfaite. On ne peut la « sanctifier » d’un côté, en affirmant qu’il fallait en rester là, et, de l’autre, continuer de se poser les questions que nous nous posions à l’époque et qui ont donné à cette réflexion approfondie et à ces réponses.
Faut-il en revenir à avant la loi de 2005 et considérer que l’obstination déraisonnable n’existe pas et que l’on n’a pas le droit d’arrêter le traitement d’une personne maintenue artificiellement en vie ? Je vous invite à réfléchir aux dangers qu’une telle démarche pourrait présenter sur le plan du respect de la personne et de sa dignité.

Pour nombre de personnes en situation de handicap complexe de grande dépendance, l’alimentation artificielle est courante et constitue un soin qui améliore la qualité de vie. Ce mode d’alimentation constitue en effet un soin de prévention et de compensation des troubles de la déglutition inhérents à la déficience motrice des personnes en situation de handicap complexe.
La proposition de loi énonce, dans un paragraphe distinct, que « l’alimentation et l’hydratation artificielle constituent un traitement », énonciation qui, rapportée aux conditions posées dans le paragraphe précédent, autorise le médecin, sous certaines conditions, à arrêter les soins. Cette rédaction recèle bien des dangers, spécialement pour les personnes qui sont dans la situation exposée ci-dessus. Une lecture trop rapide de la loi pourrait ainsi conduire certains médecins à négliger les autres conditions pour qu’un arrêt des soins soit envisagé et à faire une application erronée de la loi.
Cet amendement vise donc à inclure le membre de phrase en question dans le corps du paragraphe précédent, afin de ne pas le dissocier d’un examen complet des conditions à réunir pour qu’un arrêt des soins soit envisagé.
L’amendement no 252 , repoussé par la commission et par le Gouvernement, n’est pas adopté.


Il est proposé par cet amendement, à la deuxième phrase de l’alinéa 2, de substituer aux mots : « la prise en compte de la volonté », les mots : « l’accord ».
En effet, les termes de « prise en compte de la volonté du patient » renvoient à une notion imprécise et potentiellement risquée. Celle-ci risque de bloquer le patient, souvent mal éclairé, dans le cadre rigide de ses directives anticipées et, ainsi, de l’empêcher de se prononcer sur son souhait profond au moment inédit de sa fin de vie. La notion d’« accord » permet, elle, d’actualiser l’approbation du patient lors de cette situation, et de se fonder sur les éléments tangibles de l’expertise médicale.


Cet amendement permet de prolonger le débat, engagé tout à l’heure avec le rapporteur Jean Leonetti, sur les notions d’obligation et de faculté. J’entends bien son explication, mais le risque est que des proches du malade considèrent qu’il y a obstination déraisonnable et que la loi, dans ce cas, oblige l’arrêt des traitements.
Si on laisse, dans le texte, la suspension des traitements comme une faculté, une possibilité ouverte à l’équipe médicale, on réduit beaucoup le risque de voir des affaires se poursuivre sur le plan judiciaire – les proches arguant qu’ils considèrent qu’il y a obstination déraisonnable et que, de ce fait, il existe une obligation légale. En maintenant la faculté de suspension, on élimine une source de contentieux, sachant que, sur de tels sujets, le risque de juridisme existe et que des versions contradictoires à l’intérieur d’une même famille peuvent donner lieu à des procès interminables.
Bref, la faculté laissée aux médecins permettrait d’éviter ces recours et préserverait la liberté d’appréciation de l’équipe médicale pour savoir si l’obstination déraisonnable se traduit ou non par l’obligation d’arrêter les traitements.

Cet amendement ne fait que rétablir les termes de l’article 1er de la loi Leonetti de 2005, dont je rappelle les termes : « Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. » Je me permets d’insister sur l’emploi du verbe « pouvoir », et je persiste à penser que c’était une bonne loi. Du reste, l’équilibre qu’elle ménageait est sans doute la raison pour laquelle elle a été votée à l’unanimité. Ce n’est pas le cas de ce texte, sur lequel quatre-vingt-trois d’entre nous se sont abstenus et trente-quatre ont voté contre en première lecture.
Aussi répéterai-je ce que j’ai déjà affirmé : ce n’est pas parce qu’une loi n’est pas appliquée qu’il faut en adopter une autre ! Je préférerais largement que l’on fasse appliquer les lois que nous avons déjà votées et je regrette que l’on ait supprimé, dans ce nouveau texte, le verbe « pouvoir » » inscrit dans la loi de 2005, ôtant ainsi au personnel médical qui entoure le patient en fin de vie toute faculté d’adaptation du traitement.

Rappelons que ni dans loi de 2005 ni dans celle de 2015 ne prévoient que la définition de l’obstination déraisonnable ne puisse jamais être donnée par la famille ou par les proches. Cette définition est donnée par le patient lorsqu’il est en conscience, lorsqu’il dit qu’il considère être en situation d’obstination déraisonnable et lorsqu’il refuse un traitement, même si cela met sa vie en jeu. Si, en revanche, le patient est totalement inconscient, sous réserve de la prise en compte de ses directives anticipées, de l’avis de la personne de confiance ou de son témoignage, on va alors recueillir le témoignage des proches.
La collégialité reste donc, dans ces circonstances exceptionnelles, maître de déterminer si le traitement est raisonnable ou déraisonnable. Vous comprenez bien que cela doit demeurer ainsi. On décide en effet au cas par cas et il se trouve des situations où le traitement est raisonnable à un moment donné et devient déraisonnable à un autre moment pour des raisons de pronostic.
C’est d’ailleurs le Conseil d’État qui a précisé ces notions, en indiquant que les traitements devaient être suspendus ou ne devaient pas être entrepris sous réserve de l’appréciation de la personne. Sur le plan philosophique, le nouvel équilibre est le même que l’équilibre initial : on peut arrêter un traitement lorsqu’il apparaît déraisonnable, et c’est la collégialité médicale, et non pas un médecin isolé, qui décide de ce caractère raisonnable ou déraisonnable après avoir recueilli les témoignages et pris en considération les directives anticipées ou, le cas échéant, le témoignage de la personne de confiance. En aucun cas une famille ne peut considérer elle-même qu’il y a obstination déraisonnable et intenter un procès.
Le tribunal de Châlons-en-Champagne, le Conseil d’État qui a confirmé sa décision en appel et la Cour européenne des droits de l’homme le disent : même lorsque la personne n’est pas en fin de vie, la loi de 2005 s’applique et l’on peut interrompre les traitements lorsqu’ils apparaissent inutiles et disproportionnés, ou n’ayant pour but que le maintien artificiel de la vie. Dans ces conditions, l’avis de la famille ou de proches, et demain leur témoignage, sera recueilli, mais c’est la collégialité qui décide.
L’affaire Vincent Lambert, qui déchire une famille, est bien sûr extrêmement douloureuse, mais je me permets de rappeler que le cas se rencontre 20 000 fois par an dans notre pays. En dix ans, donc, la problématique se sera posée une fois sur 200 000. Et cette problématique est réglée par le juge, qui dit comment appliquer la loi. On le voit, ce n’est pas la famille qui décide ou qui a un droit de veto : c’est bien la collégialité médicale qui, dans des circonstances précises, définit si le traitement est inutile, disproportionné ou n’a d’autre but que le maintien artificiel de la vie.

Je partage l’interprétation de Jean Leonetti. De surcroît, on ne peut pas en permanence adresser des messages contradictoires aux médecins. Je vous rappelle qu’ils sont tenus de respecter la loi et le code de déontologie ; or le code ne dit pas que le médecin « peut s’abstenir » mais qu’il « doit s’abstenir » de toute obstination déraisonnable.
Nous allons donc clairement dans le sens des textes en vigueur. On ne peut pas tantôt appeler les médecins à charge et tantôt à décharge. Recherchons un équilibre et permettons aux praticiens, dans un cadre collégial, de prendre les décisions qui s’imposent lorsqu’ils se trouvent face à des traitements déraisonnables.

Ce n’est pas la famille qui décidera et donnera à sa décision des effets de droits s’il y a obstination déraisonnable, nous sommes d’accord sur ce point. Mais tel que le texte est rédigé, si, d’un point de vue purement subjectif, elle considère qu’il y a obstination déraisonnable, il y a, pour les professionnels de santé, obligation d’arrêter les traitements et les actes. La famille est alors invitée à porter l’affaire au contentieux. Mais si l’arrêt des soins, en cas d’obstination déraisonnable, n’est qu’une simple possibilité, elle se voit ôter un fondement de droit pour aller en justice. Dans un cas, le constat d’une telle obstination doit entraîner obligatoirement l’arrêt des traitements. Dans l’autre, il ne s’agit pas d’une obligation juridique mais d’une faculté, qui n’ouvre pas de droits contentieux.

La dernière phrase de l’article 2 introduit une disposition radicale selon laquelle « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement ».
Cette interprétation est très contestable. La loi Leonetti de 2005 ne l’a jamais affirmée explicitement et beaucoup considèrent qu’il s’agit de soins, en particulier quand le patient n’est pas en fin de vie.
Le Comité consultatif national d’éthique l’a clairement affirmé dans un avis du 5 mai 2014 : « Le seul fait de devoir irréversiblement, et sans espoir d’amélioration, dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre, ne caractérise pas à soi seul – je souligne ces mots – un maintien artificiel de la vie et une obstination déraisonnable ».
L’affirmation proposée dans le texte aura donc de graves conséquences : des personnes qui ne sont pas en fin de vie pourront décider d’arrêter d’être nourries etou hydratées, ce qui, compte tenu du droit à la sédation terminale, reviendrait à introduire sans le dire clairement une possibilité de suicide assisté.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour soutenir l’amendement no 57 .

Cet amendement vise à supprimer l’affirmation selon laquelle l’hydratation et la nutrition artificielles constituent un traitement alors que, selon les cas, elles peuvent être un traitement ou un soin, notamment quand le patient n’est pas en fin de vie. Il est donc préférable de faire confiance à l’expertise du médecin plutôt que de réduire la nutrition et l’hydratation artificielles à une seule dimension, celle du traitement.

La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg, pour soutenir l’amendement no 93 .

La distinction entre traitement et soin est un sujet délicat qui, jusqu’à présent, n’était pas tranché par le droit, que ce soit dans une disposition réglementaire ou législative. Seul un arrêt plutôt ambigu du Conseil d’État semble considérer l’hydratation comme un traitement.
En tout état de cause, et quel que soit le respect que l’on peut avoir pour le Conseil d’État, rien n’interdit au législateur, qui représente la souveraineté nationale et est en conséquence placé au-dessus de ce dernier dans la hiérarchie des producteurs de normes juridiques, de prendre une autre orientation, à charge pour les juridictions de s’aligner sur sa décision.
Ce qui me préoccupe par ailleurs dans cet article, c’est sa référence à la prise en compte de la volonté du patient, « conformément à l’article L. 1111-12 » selon lequel prévaut la volonté de la personne de confiance. Cela signifie-t-il que l’information concernant la volonté du patient ne passera que par la personne de confiance ? Il s’agit peut-être d’une imperfection rédactionnelle, dans un texte au demeurant satisfaisant, tout au moins dans la forme car à mon sens, il ne l’est pas sur le fond.
Par ailleurs, je rappelle que le code de déontologie a valeur de décret et pas du tout de loi. Par conséquent, législateurs, je vous invite à légiférer.

C’est un sujet dont nous avons déjà longuement débattu, en commission et en première lecture. Mon amendement vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article car la majorité des soignants considèrent que la nutrition et l’hydratation sont des soins, en particulier quand le patient n’est pas en fin de vie.

Inscrire dans loi que l’hydratation et l’alimentation artificielles constituent un traitement n’implique pas forcément que le patient en fin de vie doit être abandonné et que l’on cessera d’humecter ses lèvres s’il a besoin d’être hydraté. Cela, je l’ai parfaitement compris. Je vous rejoins totalement sur ce point, monsieur Leonetti : affirmer le contraire est une véritable posture.
Mais si, en phase terminale, leur arrêt est parfois nécessaire et souhaitable pour éviter toute obstination déraisonnable et irrespectueuse, il me paraît injuste de définir l’alimentation et l’hydratation artificielles exclusivement comme des traitements. Ce sont aussi des soins que l’on doit aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable.
Comme l’ont indiqué le Comité consultatif national d’éthique ainsi que le Conseil d’État dans son arrêt du 24 janvier 2014, le seul fait de devoir irréversiblement et sans espoir d’amélioration dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre ne caractérise par à soi seul – je souligne ces termes – un maintien artificiel de la vie et une obstination déraisonnable.
En outre, préconiser l’arrêt systématique des traitements en fin de vie ne me semble pas légitime. Car certains traitements, s’ils ne sont pas démesurés, peuvent s’avérer utiles, et leur arrêt peut être sous-tendu par une intention d’abréger la vie.
Enfin, l’arrêt de la nutrition ne signifie pas systématiquement l’arrêt de l’hydratation, qui peut être bien supportée même si l’alimentation ne l’est plus.

La parole est à M. Jacques Bompard, pour soutenir l’amendement no 398 .

Quand l’État veut définir ce qu’est la mort, ce qu’est la vie, à son commencement et à sa fin, on en vient systématiquement à des horreurs. Cet alinéa n’est rien d’autre qu’une intolérable horreur.
Écoutez bien ce que dit l’article 2 : « La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement ». Boire et manger, ces droits fondamentaux, ces droits que vous avez gravé dans le marbre des droits de l’homme, vous souhaitez les retirer à une personne qui souffre, certes, mais qui n’est pas encore morte ?

Comment voulez-vous qu’une société ne soit pas fracassée quand une contradiction aussi énorme est inscrite dans la loi, même si elle a été très largement acceptée ?
Faut-il que l’idéologie ait définitivement supplanté le plus simple bon sens pour que vous fassiez d’un besoin naturel de l’homme une notion discutable ?
Vous apparaît-il naturel qu’en France on fasse mourir des patients en les assoiffant et en les affamant ?
Le bon sens contre l’idéologie morbide : voilà vers quoi le législateur doit tendre !
Je rappelle que la règle numéro un de la médecine est primum non nocere – d’abord ne pas nuire. Vous détruisez ce principe, ce qui n’est pas sans conséquences pour la société tout entière.

Alain Claeys et moi-même ne saurions fuir le débat. Est-ce que manger, respirer, dormir sont des choses naturelles ? Oui. Est-ce que boire est naturel ? Oui. Mais mettre quelqu’un sous respirateur artificiel, est-ce naturel ? Non. Nous passons d’une situation naturelle à une aide artificielle.
Peut-on arrêter un respirateur lorsqu’on juge que le traitement est devenu inutile, qu’il est disproportionné ou qu’il n’a pas de sens ? Oui. Doit-on alors considérer que la respiration n’est pas un besoin naturel tandis que le fait de s’alimenter, lui, serait naturel ? Existe-t-il, pour le commun des mortels, une grosse différence entre le fait de placer un tube dans la trachée d’une personne pour permettre à ses poumons de ventiler et le fait de poser, par voie chirurgicale, un tuyau dans un estomac en considérant que c’est un soin ? Humecter les lèvres, donner à boire, donner à manger à celui qui peut encore boire et manger sont des soins. Apporter de l’oxygène à quelqu’un qui a une difficulté respiratoire est un soin. Mais introduire des tubes et utiliser des machines pour faire fonctionner le corps d’une personne sont des traitements. On ne peut pas prétendre le contraire.
La deuxième question que vous posez, et de manière brutale, suggère que tout le monde sera concerné par l’arrêt des traitements. Non. Les traitements seront arrêtés uniquement lorsqu’on considérera qu’il y a obstination déraisonnable. Vous voyez donc bien qu’il ne s’agit pas d’une rupture de civilisation.
La pratique médicale repose sur deux principes : Primum non nocere, certes mais également perseverare diabolicum. Leur combinaison implique d’arrêter les traitements s’ils n’ont plus d’autre but que le maintien artificiel d’une vie et s’ils contreviennent au respect de la personne humaine – soit parce le patient souhaite cet arrêt, soit parce que ces traitements – par exemple en cas de lésions cérébrales majeures totalement irréversibles – ne permet pas de lui assurer une vie digne d’être poursuivie. Cette personne n’en est pas moins digne. Elle a droit au respect de sa dignité. Et précisément parce qu’elle a ce droit, on ne peut maintenir inutilement et artificiellement son corps en vie.
Ces idées ne sont pas celles du Conseil d’État mais celles contenues dans la loi de 2005, qui ont été discutées ici. Nous avions alors choisi de remplacer les mots : « un traitement » par « tout traitement ». Et pendant une demi-journée, nous avions débattu dans cet hémicycle pour savoir ce qu’est un traitement. Placer une perfusion, faire une piqûre sont des traitements. Arrêter les traitements ne veut pas dire arrêter les soins.
Par ailleurs, je vous en conjure, chers collègues : quel que soit le côté de l’hémicycle où vous siégez, cessez de dire que les personnes dont nous parlons meurent de faim, de soif, d’escarres et de phlébite !
Monsieur Schwartzenberg, votre avis peut être totalement différent du mien mais nous avons, ensemble, eu des débats respectueux et constructifs : nous ne sommes pas d’accord sur un certain nombre de choses mais nous sommes d’accord sur d’autres. Nous avons l’un pour l’autre un respect mutuel, alors cessez de dire que lorsqu’on endort profondément quelqu’un, il ressent quelque chose !
Chacun d’entre nous a vécu une anesthésie générale.

Chacun sait que celle-ci peut être prolongée. Qu’elle améliore la durée de vie, probablement pas, mais en tout cas elle supprime les sensations de faim ou de soif. Dit-on, lorsqu’on débranche un respirateur, que le malade va mourir étouffé ? Non.
Exclamations sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Pourquoi fait-on une sédation profonde ? Pour qu’il n’y ait pas le moindre risque que l’arrêt d’un traitement de survie n’entraîne une quelconque souffrance pour la personne et pour son entourage.
Telle est la philosophie du texte, que nous devrions partager. Je respecte l’opinion de chacun sur le suicide assisté et l’euthanasie, mais ce n’est pas l’objet de ce texte. C’est un texte d’équilibre qui tente de rassembler. Alors entendons-nous sur les mots et ce qu’ils recouvrent, et évitons de dire des choses fausses.
Je vous en conjure : regardons les choses objectivement. Ce n’est pas la peine d’invectiver la société en l’accusant de maintenir artificiellement des corps en vie – alors que les patients possèdent des lésions cérébrales irréversibles et majeures, qui les empêchent même de savoir qu’ils existent.
Personnellement – et j’espère partager ce point de vue avec des collègues de droite comme de gauche –, je considère que maintenir des personnes en vie dans ces conditions est contraire à leur volonté et à l’idée que l’on peut se faire de leur dignité, car une personne est aussi une pensée.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Le débat qui nous oppose n’est pas juridique. Il ne s’agit pas de savoir si le législateur est au-dessus du Conseil d’État, question qui a été tranchée depuis longtemps.
Celui-ci a interprété la loi du 22 avril 2005 : il a levé une ambiguïté, puisque certains prétendaient que l’arrêt des traitements au sens de la loi de 2005 ne pouvait inclure l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation. En somme, il a jugé, ce qui est son rôle. De son côté, si l’Assemblée nationale souhaite apporter une autre définition, elle en a la possibilité.
Le débat qui nous occupe est donc médical. L’alinéa 3 est soutenu par les médecins qui pratiquent des soins palliatifs. L’ensemble des médecins s’accorde sur le fait que l’interruption de l’alimentation et de l’hydratation relèvent du traitement et non du soin.
Ce que disent les professionnels de santé – en particulier les médecins –, c’est qu’il faut être attentif à ne pas dissocier alimentation et hydratation si l’on veut éviter l’inconfort, voire la souffrance du patient. Mais tous les professionnels impliqués et engagés conviennent que l’arrêt de l’alimentation ne provoque ni inconfort ni souffrance.
Pour l’hydratation, c’est la sensation de sécheresse dans la bouche qui est source d’inconfort. C’est pourquoi, en fin de vie, les médecins pratiquent non des traitements mais des soins de confort pour humecter la bouche des patients, et non hydrater leur corps.
Sur le plan juridique, le Parlement possède la suprématie. Il se prononce en toute légitimité. Mais, que les parlementaires ne souhaitent pas arrêter les traitements parce qu’ils ne veulent pas interrompre la vie ou qu’ils entendent au contraire aller plus loin, ils doivent veiller à ne pas interférer avec l’appréciation générale des professionnels de santé qui sont engagés dans cette démarche.
D’autre part, ils ne doivent pas se tromper sur le sens de l’alinéa, lequel inscrit dans le marbre de la loi, supérieure à la jurisprudence, ce qui relevait auparavant de celle-ci et créait interrogation et contentieux.
Monsieur Schwartzenberg, n’ouvrez pas un débat qui pourrait affaiblir votre position. Le fait que l’alimentation et l’hydratation ne seraient pas des traitements ne plaide pas en faveur du suicide assisté ou de l’euthanasie.
La suppression de l’alinéa ne viendrait pas à l’appui de la thèse que vous défendez, et que j’écoute avec beaucoup d’attention et d’intérêt.
Je le répète : ne faisons pas dire à l’alinéa plus qu’il ne dit. Nous sommes face à une affirmation médicale, qui concerne la prise en charge des patients en fin de vie.

Il n’est pas vrai que tous les médecins s’accordent sur l’absence d’inconvénients ou de souffrance lié à l’arrêt de l’hydratation ou de l’alimentation artificielle. Vous invoquez des textes issus de sociétés savantes, mais M. Decool en a cité d’autres, qui vont dans le sens inverse.
Rappelons-nous la position de certaines personnes qui ont fait de la politique et n’étaient pas totalement dépourvus de connaissances médicales : Bernard Kouchner ou Léon Schwartzenberg considéraient, comme les signataires de la loi de 2009, que l’interruption de l’hydratation et de l’alimentation présentent de graves inconvénients. Ils se fondaient notamment sur cet argument pour réclamer une autre rédaction.
Certains d’entre nous ne pensent plus aujourd’hui comme ils le faisaient à cette époque. Si le droit de changer d’avis est sacré, celui de donner des leçons à ceux qui restent constants me paraît assez inutile.
Je terminerai à m’adressant à M. Leonetti, qui, à chaque débat, me répète la même chose. Puisque nous n’avons pas d’expérience fréquente d’une anesthésie – arrêtons de parler de sédation – qui durerait dix jours à deux semaines, assurer de manière péremptoire que cette situation ne cause pas d’inconvénient me paraît aventureux. Si, comme l’observe Mme Delaunay avec sagesse, il est utile d’humidifier les lèvres du patient, c’est le signe que celui-ci ne ressent pas de bienfait démesuré après l’arrêt des soins qui lui était prodigués.

Je reviens sur l’argumentation que Mme la ministre vient d’opposer à M. Schwartzenberg, et selon laquelle, dès lors qu’on est favorable au suicide assisté, on considère nécessairement que l’hydratation et la nutrition artificielles constituent des traitements.
Une telle logique nous renforce dans la conviction qu’il faut se garder de certaines dérives. Peut-être la ministre devrait-elle revenir ce point.

Si l’alinéa 3 ne peut être supprimé, je vous en propose du moins une nouvelle rédaction. À mon sens, il ne revient pas à la loi de décider si les actes médicaux constituent ou non un traitement, mais, si tel est le cas, il faut le faire de manière exhaustive.
Lorsque les actes médicaux portent sur des fonctions vitales, il convient de distinguer les actes qui peuvent être assimilés à des traitements, et ceux qui sont assimilés à des soins élémentaires a priori normalement dus à la personne, sauf dans quelques situations particulières mentionnées.
L’amendement no 102 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour soutenir l’amendement no 18 .

Je resterai fidèle aux positions que j’ai déjà défendues.
L’arrêt de la nutrition et de l’hydratation ne doit être préconisé que si leur apport est délétère pour le patient ou mal supporté. En outre, l’arrêt de l’un ne doit pas systématiquement engendrer celui de l’autre, car une hydratation peut être bien supportée, alors que l’alimentation ne l’est plus.
Il importe donc de ne pas considérer l’alimentation et l’hydratation exclusivement comme des traitements. Elles sont aussi des soins dus aux personnes qui ne sont pas en fin de vie, mais qui peuvent être atteints par une affection grave et incurable.
Comme l’a déclaré le CCNE, repris par le Conseil d’État dans son arrêt du 24 juin 2015 : « Le seul fait de devoir irréversiblement, et sans espoir d’amélioration, dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre, ne caractérise pas à soi seul un maintien artificiel de la vie et une obstination déraisonnable ».
L’amendement no 18 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

Je propose d’ajouter le mot « parentérale » à l’alinéa 3.
Le corps médical admet dans sa quasi-totalité que la nutrition parentérale, nécessaire quand la nutrition entérale ou par gastrotomie est impossible, peut être assimilée à un traitement, car les substances nutritives utilisées dans ce cas précis sont beaucoup plus élaborées et les risques d’infection plus grands.
L’amendement no 103 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.

M. Leonetti fait un parallèle intéressant entre la respiration artificielle, d’une part, et la nutrition et l’hydratation artificielles, d’autre part. Mais un patient en fin de vie en état de grande souffrance, et atteint d’une maladie incurable, peut parvenir à s’alimenter et à s’hydrater naturellement.
L’alimentation et l’hydratation artificielles ne sont alors nécessaires que du fait de la mise sous sédation. Dans ce cas, le praticien accélère la mort, l’entraîne de facto ou la provoque. C’est pourquoi j’ai parlé tout à l’heure d’euthanasie passive.
Vous trahissez l’esprit de votre loi, qui était de laisser aux gens le libre choix de ne pas souffrir. En l’espèce, on n’est plus dans le cas d’une personne qui déciderait d’arrêter de souffrir en attendant une mort naturelle. Le choix est différent : soit la personne continue de souffrir ; soit on provoque artificiellement sa mort en arrêtant une alimentation et une hydratation qui lui étaient permises naturellement avant sa mise sous sédation.

Nous en venons aux amendements identiques.
La parole est à M. Xavier Breton, pour soutenir l’amendement no 55 .

L’amendement vise à substituer au mot « constituent » les mots « peuvent constituer ». Je rejoins M. Schwartzenberg : la modestie doit inciter le législateur – si celui-ci n’est pas mu par d’autres motivations – à ne pas être trop péremptoire sur un sujet qui fait manifestement débat.

Je rappelle qu’il existe plusieurs techniques de nutrition et d’hydratation. Il convient donc de les évaluer au cas par cas.
L’amendement no 28 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.


La même prudence, qui recommande ne pas affirmer trop vite que la nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements, incite à compléter l’alinéa par la précision suivante : « dans les conditions définies par des recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute Autorité de santé ».
L’article 2 est adopté.

Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente :
suite de la deuxième lecture de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly