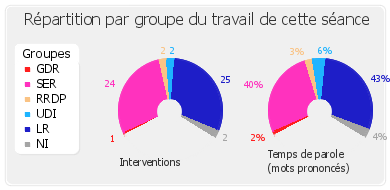Séance en hémicycle du 31 janvier 2017 à 9h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

La parole est à M. Jean-Patrick Gille, pour exposer sa question, no 1636, relative à l’hébergement d’urgence en Indre-et-Loire.

Ma question, monsieur le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, porte en effet sur l’hébergement d’urgence.
Tout d’abord, je tiens à saluer les efforts réalisés par le Gouvernement, depuis 2012, pour permettre à chacun, dans ce pays, de disposer d’un toit pour se construire ou se reconstruire. Durant le quinquennat, le budget de l’hébergement n’a cessé d’augmenter – il est passé de 1,2 milliard à 1,7 milliard cette année – et près de 40 000 places pérennes supplémentaires ont été créées pour répondre à ce besoin fondamental.
Pourtant, sous l’effet conjugué de la crise économique et de la hausse du nombre de demandeurs d’asile, le secteur de l’hébergement d’urgence semble toujours au bord de l’asphyxie, avec une demande en constante augmentation et une sortie des dispositifs qui demeure insuffisante.
À Tours, dans ma circonscription, nous avons fait face, en plein hiver, pendant les fêtes, à la liquidation judiciaire du foyer Albert-Thomas et, cette semaine, à celle d’une association d’accueil, La Barque. Tout cela intervient alors que le département est déjà confronté à une sous-budgétisation des crédits du budget opérationnel de programme « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », le BOP 177 ; cela complique le travail fourni par les services déconcentrés de l’État, que je salue, pour remédier à cette situation imprévue et assurer la nécessaire préservation de ces trente-six places d’hébergement d’urgence.
Dans l’attente des 578 000 euros de crédits de l’État qui leur manquent, les associations locales sont amenées à couvrir elles-mêmes, à partir de leur propre trésorerie, les besoins de financement pour poursuivre l’hébergement des populations les plus vulnérables. Cette situation les place précisément dans l’impossibilité de répondre à l’appel à projets lancé par le préfet – dont je veux souligner l’engagement – pour permettre la reprise du foyer d’hébergement Albert-Thomas.
Pouvez-vous nous décrire, monsieur le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, les orientations prises par le Gouvernement pour sécuriser le financement des dispositifs d’urgence et de soutien aux demandeurs d’asile, afin de permettre aux services déconcentrés d’apporter des réponses rapides aux situations d’urgence comme celle que nous vivons à Tours, mais aussi pour engager des projets à plus long terme ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Monsieur Gille, comme vous le rappelez très justement dans votre question, la politique en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes défavorisées est une priorité du Gouvernement depuis 2012. Celle-ci s’est traduite par la mise en oeuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, plan quinquennal adopté lors de la réunion du Comité interministériel de lutte contre l’exclusion du 21 janvier 2013. Les orientations de ce plan ont été confirmées par une feuille de route 2015-2017, présentée par le Premier ministre le 3 mars 2015, qui prévoit notamment, en matière d’hébergement d’urgence, un plan de réduction du nombre de nuitées hôtelières.
Comme vous le soulignez, les efforts entrepris dans ce champ de l’action publique restent cependant soumis à une forte demande, liée à la précarité et au contexte migratoire.
Cette demande a conduit le Gouvernement à déployer des moyens budgétaires très importants pour augmenter le parc d’hébergement d’urgence. Les crédits consacrés à l’hébergement des personnes sans domicile sont en effet passés de 1,2 milliard d’euros en 2012 à 1,7 milliard cette année. En 2017, les crédits inscrits en loi de finances initiale sont en augmentation de 15 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2016. Le parc d’hébergement pérenne, toutes catégories confondues, est passé d’environ 80 000 places en 2012 à plus de 120 000 places aujourd’hui. Dans la région Centre-Val de Loire, les crédits consacrés au dispositif d’hébergement via le budget opérationnel de programme 177 sont passés d’environ 29 millions d’euros en 2012 à plus de 36 millions en 2016. Les capacités d’hébergement pérenne dans ce département, toutes catégories confondues, sont passées de 367 places en 2012 à 637 places en juin 2016.
Ces efforts considérables sont ajustés au plus près des évolutions des besoins d’hébergement. D’autre part, pour tenir compte des difficultés de trésorerie des associations dans le département d’Indre-et-Loire, la ministre du logement et de l’habitat durable a demandé que les crédits soient délégués le plus rapidement possible en 2017. Ils l’ont été pour une part à la mi-janvier, à hauteur de 25 %, et le reste de l’enveloppe le sera courant février.
Au-delà de cette indispensable gestion de l’urgence, nous devons, comme vous le soulignez, prolonger les actions structurantes dans ce domaine. Ces actions doivent permettre de favoriser l’accès des personnes sans domicile à l’autonomie et, en particulier, à un logement autonome, car l’hébergement ne peut être un horizon de vie. Cela passe notamment par le développement des outils dits de « logement adapté » et par l’intervention du Service intégré d’accueil et d’orientation, qui doit pouvoir les mobiliser.
Soyez assuré de la totale mobilisation du Gouvernement pour assurer un accueil digne aux personnes sans domicile dans notre pays. Soyez également assuré de l’attention particulière portée par la ministre du logement à la situation de votre département et des opérateurs associatifs qui concourent à la mise en oeuvre de cette politique.

La parole est à M. Jean-Pierre Barbier, pour exposer sa question, no 1618, relative aux garanties d’emprunt des bailleurs sociaux.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, je veux appeler votre attention sur la problématique de la garantie des emprunts destinés à financer la production de logements sociaux.
Comme la plupart des collectivités, le département de l’Isère garantit les emprunts des bailleurs sociaux de son territoire, selon des critères définis par son assemblée. Faute d’une réelle gestion de ces garanties jusqu’en 2014, son encours de dette garantie est le troisième plus important de France, avec 1,285 milliard fin 2014, ce qui est deux fois supérieur à la moyenne des départements similaires. Aussi, pour diminuer ses engagements financiers hors bilan et ramener cet encours à un niveau plus raisonnable à moyen terme, le département de l’Isère, que je préside, a modifié ses règles d’attribution des garanties d’emprunt. Pour mémoire, le budget total du département de l’Isère est de 1,5 milliard d’euros.
Cependant, pour obtenir des prêts de la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux sont contraints de disposer d’une garantie. Ils se tournent donc vers d’autres collectivités territoriales ou vers la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS. Or cet établissement public administratif refuse de garantir à 100 % les emprunts des bailleurs sociaux adossés à une collectivité. Par ailleurs, lorsqu’il consent à octroyer une garantie partielle, celle-ci est facturée, selon les types de logement, à hauteur de 2 % du montant garanti, ce qui est tout à fait prohibitif dans un secteur où le défaut de remboursement par les bailleurs est extrêmement rare.
Cette situation est de nature à mettre en péril la production de logement social dans notre pays ou à enfermer les collectivités dans une spirale de dégradation continue de leur situation financière, puisqu’elles n’auraient d’autre choix que d’accepter l’octroi de garanties d’emprunt. Vous l’avez bien compris, monsieur le secrétaire d’État, l’enjeu est de continuer à construire du logement social sans dégrader la situation financière des collectivités.
Aussi, je vous serais reconnaissant d’intervenir auprès de la Caisse de garantie du logement locatif social pour qu’elle assouplisse ses règles d’attribution de garanties d’emprunt ou, à défaut, qu’elle pratique des tarifs plus en adéquation avec le risque encouru. L’idéal serait cependant de cesser d’imposer de telles garanties d’emprunt aux bailleurs sociaux et à la Caisse des dépôts, compte tenu du fait que le risque est très limité – pratiquement aucune défaillance n’a été enregistrée pendant les trente dernières années.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Vous soulignez, monsieur Barbier, la politique volontariste du département de l’Isère en matière de garantie d’emprunt des prêts de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction et la rénovation du logement social. Un tel volontarisme des acteurs locaux est indispensable à la continuité du dispositif de financement de ces investissements.
La Caisse de garantie du logement locatif social intervient en complément ou en remplacement des collectivités locales, lorsque celles-ci font défaut. La ministre du logement et de l’habitat durable considère que, sauf cas exceptionnel, les collectivités sur le territoire desquelles sont construits ou rénovés des logements sociaux, les collectivités de rattachement des offices public d’habitat, ainsi que les collectivités membres des conseils d’administration des organismes bailleurs ont une responsabilité particulière, qui doit les amener, comme c’est généralement le cas, à se coordonner afin que les prêts de la CDC soient garantis dans les meilleures conditions.
La garantie de la CGLLS n’intervient donc qu’à titre subsidiaire, pour moins de 2,5 % des émissions annuelles de prêts de la CDC en la matière, ce qui est le signe de la constance de l’engagement des collectivités. Il faut aussi rappeler que la garantie apportée par les collectivités aux emprunts des organismes constructeurs du logement social est gratuite et n’est pas soumise aux obligations prudentielles de solvabilité bancaire. Or ce n’est pas le cas de la CGLLS, laquelle, en qualité de société de financement, est soumise à la réglementation bancaire et au respect des ratios prudentiels, ce qui nécessite des fonds propres conséquents.
Le taux de 2 % pratiqué est donc très faible, notamment au regard de la durée des prêts, généralement de quarante ans ; il permet de majorer le taux d’emprunt de manière très limitée – de 0,05 % seulement. Par ailleurs, je vous rappelle que la garantie de la CGLLS est gratuite pour les logements très sociaux, afin d’inciter à l’effort de construction de ce type de logements. Le Gouvernement ne peut donc pas partager votre analyse sur le caractère prohibitif du prix des garanties que pratique la CGLLS. Au contraire, ce prix est juste suffisant pour inciter les collectivités à maintenir leurs efforts.
Comme la CGLLS l’indique dans son dernier rapport d’activité, les conseils départementaux préfèrent limiter l’apport de leur garantie aux organismes constructeurs de logements sociaux pour les opérations en zone rurale et exigent souvent une participation des communes concernées. Lorsque celles-ci refusent d’offrir leur garantie, il s’avère que la CGLLS est alors fréquemment sollicitée pour accorder la totalité de la garantie nécessaire. Cette situation me paraît inappropriée au regard de la gouvernance partenariale que la ministre du logement souhaite encourager sur les territoires.

J’ai bien entendu votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, mais il faut tenir compte des difficultés financières croissantes des collectivités. Il faut reconnaître que les organismes bancaires, à cause de cet encours de garantie, commencent à refuser certains emprunts aux collectivités.

La parole est à Mme Huguette Bello, pour exposer sa question, no 1617, relative à la gouvernance de l’Agence française pour la biodiversité.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, ma question porte sur l’Agence française pour la biodiversité, dont nous saluons tous la création au début de cette année.
Unique par sa richesse et remarquable pour sa diversité, le patrimoine biologique naturel des collectivités françaises d’outre-mer représente 80 % de la biodiversité de la France. Cette richesse et cette diversité sont présentes dans chaque territoire d’outre-mer, notamment dans ceux de l’océan Indien : à La Réunion, les pitons, cirques et remparts sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ; à Mayotte, les lagons sont mondialement réputés ; mais aussi aux îles Éparses, qualifiées de « sanctuaires océaniques de la nature primitive » ; sans oublier, bien sûr, les Terres australes et antarctiques françaises, les TAAF, où se trouve la plus grande réserve naturelle nationale de France, caractérisée par un endémisme très prononcé.
Ces territoires sont classés parmi les hotspots de la biodiversité mondiale. Or force est de constater que ces écosystèmes uniques ne se retrouvent pas dans l’organisation de la nouvelle structure au service de la nature. En effet, ni La Réunion ni Mayotte n’accueillent l’une des multiples implantations de cette nouvelle agence. Alors que la Nouvelle-Calédonie, les Antilles et la Polynésie française seront dotées, à juste titre, de trois des six antennes maritimes, l’océan Indien n’en accueillera aucune. De même, le conseil scientifique, si l’on en croit l’arrêté du 4 janvier 2017, ne comprend aucun scientifique de cette région. Par ailleurs, aucun des quatre pôles de recherche, développement et innovation n’est basé outre-mer. L’océan Indien n’est représenté qu’au sein du conseil d’administration, par deux personnalités, dont la nomination a d’ailleurs été unanimement saluée.
Cette sous-représentation interroge, et inquiète aussi, surtout lorsqu’on considère le rôle primordial que ce nouvel opérateur est appelé à jouer pour la connaissance, la préservation et la valorisation de la biodiversité française. D’où la question que nous sommes nombreux à nous poser : une délibération prochaine permettra-t-elle de donner aux territoires de l’océan Indien la place qui semblait pourtant aller de soi au sein de cet opérateur ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Madame Bello, votre question porte sur la place des représentants des outre-mer, notamment de l’océan Indien, dans la gouvernance de l’Agence française pour la biodiversité. Segolène Royal et Barbara Pompili l’ont souvent dit devant cette assemblée lors des débats sur la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a créé cette agence : les représentants des outre-mer, dans leur diversité, auront toute leur place dans sa gouvernance car 80 % de la biodiversité française est ultramarine.
L’arrêté de composition du conseil d’administration de l’agence, que Ségolène Royal a signé le 4 janvier dernier, comprend six représentants ultramarins, élus ou scientifiques, auxquels s’ajoute la représentante du ministère des outre-mer, ce qui va au-delà des exigences de la loi. L’océan Indien est représenté, au sein de ce conseil, par l’intermédiaire de Mme Sonia Ribes-Beaudemoulin, conservatrice du muséum d’histoire naturelle de La Réunion, et de Mme Bichara Bouhari Payet, présidente du conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte.
Quant à la présence dans l’océan Indien de l’Agence française pour la biodiversité, Ségolène Royal tient à vous rappeler que celle-ci dispose d’une implantation territoriale à Saint-Denis de La Réunion et de plusieurs implantations à Mayotte, dont l’antenne de façade maritime pour l’océan Indien. Un comité d’orientation sur la biodiversité ultramarine, placé auprès du conseil d’administration de l’agence, sera prochainement installé. Par ailleurs, le délégué à l’outre-mer de l’Agence française pour la biodiversité se déplacera, dans les semaines à venir, sur les territoires de l’océan Indien pour une première prise de contact avec les futurs partenaires de l’agence.
Lorsque Ségolène Royal a installé solennellement le conseil d’administration de l’agence, le 19 janvier, les premières initiatives que celle-ci pourrait prendre dès 2017 ont été évoquées. Elle a demandé que des actions de reconquête de la biodiversité soient très vite engagées dans les outre-mer, notamment dans le parc naturel marin de Mayotte. Ségolène Royal souhaite vivement que les ultramarins trouvent dans cette nouvelle agence un outil à leur service pour protéger et restaurer leurs milieux terrestres et marins remarquables, qui constituent une des plus belles richesses de notre pays.

La parole est à M. Arnaud Richard, pour exposer sa question, no 1648, relative aux carrières souterraines dans le massif de l’Hautil.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, ma question concerne le régime juridique applicable aux carrières souterraines de notre pays, notamment à celles situées dans les Yvelines, dans le massif de l’Hautil, en particulier à Conflans-Sainte-Honorine, à Triel-sur-Seine ou à Chanteloup-les-Vignes.
Ce régime résulte de textes très anciens : la loi du 1er avril 1810 a prévu l’ouverture des carrières sans permission, soumettant toutefois – heureusement – ces carrières souterraines à la surveillance de l’administration, dans les mêmes conditions que les mines. Ce n’est qu’après 1890 que des arrêtés préfectoraux, pris en application d’un décret type, ont introduit l’obligation d’établir des plans et celle de déclarer l’abandon desdites carrières – je retrace l’histoire parce que c’est important.
En conséquence, la plupart de ces carrières ne sont pas régies par le code minier actuel – nous l’avons encore constaté la semaine dernière, dans le débat sur l’adaptation du code minier au droit de l’environnement, lors duquel j’ai fait un certain nombre de propositions – et relèvent du régime de droit commun, notamment de la police municipale du maire et surtout de la responsabilité du propriétaire du sol.
Plusieurs milliers de personnes sont concernées par les plans de prévention des risques naturels de mouvement de terrain, ou PPRNMT, mis en place sur ce territoire. Ces propriétaires se trouvent aujourd’hui confrontés à la réalisation de leurs travaux, obligatoires ou non, très coûteux – jusqu’à 400 000 euros pour des travaux de confortement partiel de leur patrimoine – et souvent irréalisables car partagés entre plusieurs parcelles concomitantes, en danger imminent ou non suivant les cas. Ces situations découragent les acheteurs potentiels en cas de mise en vente.
Pourtant, un certain nombre de propriétaires, grâce à l’engagement, il faut le dire, des associations, des élus locaux et des représentants locaux de l’État, se mettent en règle avec les démarches énoncées dans le règlement du PPRNMT : ils font réaliser le diagnostic géotechnique, établir les devis de travaux et assurer la surveillance annuelle ou bisannuelle.
Je souhaite proposer trois pistes, monsieur le secrétaire d’État, pour favoriser la mise en sécurité de ces milliers de personnes concernées par le PPRNMT dans les Yvelines : tout d’abord, un crédit d’impôt, similaire à celui en vigueur pour les plans de prévention des risques technologiques, qui permet à nombre de propriétaires de réaliser des travaux ; ensuite, la mise en place d’un taux de TVA bonifié pour ces travaux de mise en sécurité des habitations ; enfin, un allégement de la fiscalité foncière, tel qu’il existe déjà pour les plans de prévention des risques miniers, avec une révision à la baisse ou un réajustement du calcul. Cette troisième disposition prendrait en compte la perte significative de la valeur du patrimoine due à la mise en place du PPRNMT, qui peut atteindre 30 à 50 %, et la raréfaction des acheteurs potentiels, plusieurs ventes ayant été annulées pour ce motif. Ces mesures pourraient s’appliquer aux personnes concernées dans les zonages PPRNMT en règle avec la législation.
Je souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement pourrait envisager pour concrétiser ces trois propositions, qui constitueraient une forte incitation à la surveillance, au contrôle de la vulnérabilité des propriétés sous-minées abandonnées et à la mise en sécurité des personnes et des biens. Vous l’aurez compris, monsieur le secrétaire d’État, j’en appelle, sur ce sujet, à la solidarité nationale.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Monsieur Richard, la prévention du risque lié aux effondrements d’anciennes carrières est un enjeu important dans la région Île-de-France et impacte de nombreuses communes. Le massif de l’Hautil est particulièrement concerné, en raison de l’exploitation passée des ressources de son sous-sol gypseux. Le phénomène d’effondrement de cavités souterraines est inéluctable, d’autant plus que les roches gypseuses sont très sensibles à l’eau.
Les carrières souterraines abandonnées peuvent, selon la date à laquelle leur exploitation a cessé, relever du code minier ou du code de l’environnement. Quoi qu’il en soit, elles sont régies par les dispositions de l’article 552 du code civil, qui dispose que le propriétaire du sol est également propriétaire du sous-sol. L’article 553 confirme cette notion de propriété : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir ». La responsabilité du propriétaire peut donc être engagée au titre de l’article 1384 du code civil.
Dans le cas des biens couverts par un plan de prévention des risques miniers, il existe, comme vous l’avez dit, un certain nombre de mesures financières permettant d’accompagner les propriétaires concernés, dont l’allégement de la fiscalité foncière, prévu à l’article 1383 G du code général des impôts. Cette dernière mesure s’applique également aux périmètres couverts par les plans de prévention des risques technologiques.
Pour les risques naturels, il existe d’autres types de mesures permettant d’accompagner les particuliers dans la réalisation de travaux de protection ou de prévention. Ainsi, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, ou FPRNM, dit « Fonds Barnier », est l’outil principal de la prévention des risques naturels.
Dans ce cas précis, il peut être sollicité via trois mesures différentes.
La première mesure concerne les biens couverts par un contrat d’assurance et exposés à un risque d’affaissement de terrain dû à la présence de cavités souterraines, y compris les carrières abandonnées. Elle permet de financer les opérations de reconnaissance lorsque le danger est avéré pour les constructions et les vies humaines, ainsi que les travaux de traitement ou de comblement si la menace grave pour les vies humaines est justifiée et si le coût du traitement est inférieur au coût de l’expropriation. Sous réserve du respect des conditions précisées par l’arrêté du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre de ce fonds, le taux de financement maximum des opérations précitées est de 30 %.
La deuxième mesure permet l’acquisition amiable des biens exposés à un risque naturel majeur et finance 100 % de la valeur vénale du bien, à condition qu’elle soit inférieure au montant des travaux de mise en sécurité.
La troisième mesure permet d’accorder une subvention, d’un montant maximal de 40 % en faveur des biens à usage d’habitation ou de 20 % en faveur des biens à usage professionnel des entreprises de moins de vingt salariés, pour les études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés dans les plans de prévention des risques naturels de mouvement de terrain.
Enfin, certaines opérations de prévention des risques peuvent également bénéficier d’une aide d’un fonds européen, de type FEDER ou FEADER – Fonds européen de développement régional ou Fonds européen agricole pour le développement rural –, en fonction de la nature de l’opération et du choix opéré par l’autorité en charge de la gestion de ces fonds.

La parole est à M. Gilles Lurton, pour exposer sa question, no 1628, relative au tri des déchets organiques.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, le V de l’article 70 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les services publics de gestion des déchets développent le tri à la source des déchets organiques. Un certain nombre de collectivités ont cependant investi des sommes importantes, ces dernières années, pour trier et valoriser mécaniquement les biodéchets et produire du compost, tout en respectant les normes, voire en appliquant des seuils beaucoup plus rigoureux eu égard à la qualité environnementale du compost produit.
Ainsi, à Saint-Malo, nous bénéficions d’une usine de traitement qui valorise à ce jour 50 % des déchets entrants – mieux que l’objectif initial du Grenelle de l’environnement –, dans le but de permettre un retour à la terre des matières fermentescibles. Un tri à la source des déchets a également été organisé grâce à la mise à disposition de deux bacs au domicile des habitants, au développement des points d’apport volontaire dans les quartiers et à la modernisation des déchetteries. Ce concept vertueux donne toute satisfaction aux habitants mais également aux agriculteurs, qui achètent le compost labellisé pour amender leurs terres.
Les nouvelles dispositions en matière de gestion des biodéchets mettent les collectivités comme Saint-Malo dans une situation particulièrement compliquée et risquent de les forcer à revoir tout leur process de tri, alors que des investissements particulièrement lourds viennent d’être réalisés – plus de 18 millions d’euros pour l’usine de Saint-Malo. De plus, cette modification des modalités de collecte entraînera une dégradation du bilan carbone, avec la circulation de camions de collecte supplémentaires en ville. De telles opérations généreront de nouveaux coûts financiers et une incompréhension de la part la population. Or la loi relative à la transition énergétique ne prévoit aucune dérogation.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite savoir quelles solutions pourraient être proposées à ces collectivités afin d’éviter au contribuable une nouvelle facture particulièrement élevée et d’autant plus inexplicable que le système mis en place fonctionne parfaitement et en cohérence avec la protection environnementale.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Monsieur Lurton, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte donne, pour le tri à la source des biodéchets, une orientation très claire, qui a fait l’objet d’un fort consensus dans les débats parlementaires.
La loi prévoit en effet la généralisation du tri à la source des biodéchets partout en France d’ici à 2025, pour les particuliers comme pour les entreprises. Le tri des biodéchets contribuera à diminuer la mise en décharge et permettra d’augmenter leur valorisation par le compostage ou la méthanisation. Ce tri à la source généralisé peut se faire selon diverses solutions techniques, au choix de chaque collectivité : collecte séparée des biodéchets mais aussi compostage de proximité, possible à plusieurs échelles, l’objectif étant que le tri à la source soit opérationnel et pleinement mis en oeuvre d’ici à 2025. Quelle que soit la solution retenue, le fait de trier ces déchets à la source permet d’assurer une très bonne qualité des composts et donc un retour au sol de qualité.
À l’inverse, l’expérience montre les limites des installations de tri mécano-biologique. Celles-ci consistent à extraire la fraction fermentescible des ordures ménagères collectées en mélange, mais le procédé ne permet généralement pas la production d’un compost de qualité. En effet, ces installations connaissent régulièrement des problèmes de fonctionnement et les composts contiennent des indésirables, comme de nombreux morceaux de plastique. Depuis de nombreuses années, l’ADEME – l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – et les services de l’État ont émis des réserves vis-à-vis d’un tel procédé. En conséquence, la loi privilégie explicitement la mise en place du tri à la source et indique que la création d’installations de tri mécano-biologique doit être évitée.
Pour une situation comme celle que vous évoquez, avec la rénovation importante d’un outil industriel réalisée en 2011, pourrait être envisagée la mise en place d’un pré-traitement pour réduire les quantités de déchets éliminées en extrayant davantage de matériaux orientés vers le recyclage ou la fabrication de combustibles solides de récupération. L’ADEME pourra vous apporter son expertise dans cette réflexion.

Je vous remercie pour cette réponse, monsieur le secrétaire d’État. Toutefois, l’expérience que nous avons menée dans la circonscription dans laquelle je suis élu, à Saint-Malo agglomération, a démontré que la qualité du compost produit était absolument exceptionnelle et répondait à toutes les normes en vigueur. De plus, en dehors d’un système de compostage à proximité du domicile des habitants, je crains que le fait de devoir mettre en place une troisième collecte pour les biodéchets ne dégrade fortement le bilan carbone de la collecte des déchets.

La parole est à M. Éric Elkouby, pour exposer sa question, no 1644, relative au statut des parcs naturels urbains.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, en qualifiant le projet de parc naturel urbain de Strasbourg de « territorial, thématique et transversal », le député Armand Jung, mon prédécesseur à l’Assemblée nationale, initiateur, en 2007, de ce dossier innovant, ne s’y était pas trompé.
Après de multiples échanges et réunions avec les acteurs locaux, les partenaires, les professionnels, les collectivités locales et les habitants, et après avoir visité d’autres parcs naturels urbains à travers le pays, dont celui de Rueil-Malmaison, précurseur en la matière, le PNU de Strasbourg, Ill-Bruche, a officiellement vu le jour en 2010.
Son périmètre englobait au départ les quartiers ouest de Strasbourg, allant de Koenigshoffen à l’Elsau, en passant par la Montagne verte et la gare. Un processus d’extension aux quartiers de l’Orangerie, du Conseil-des-Quinze et de la Robertsau est en cours. C’est l’un des plus grands parcs urbains de France, marqué par de nombreux cours d’eau et un riche patrimoine historique. Le PNU s’est rapidement imposé comme une zone d’excellence environnementale et un lien indispensable entre ces différents quartiers, qui ont ainsi réussi à se réapproprier des zones de nature urbaine et de multiples richesses jusqu’à présent enfouies.
Le 22 juin 2016, dans le cadre du débat en séance sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, je suis intervenu afin d’évoquer la question du cadre juridique des parcs naturels urbains, dont celui de Strasbourg, bien évidemment.
Il s’avère que le fonctionnement de ces parcs urbains ne relève pour le moment que de simples décisions municipales. Le parc naturel urbain de Strasbourg est par exemple régi par une charte municipale, évaluable et renouvelable, d’ailleurs cette année, mais qui, à mes yeux, n’est pas suffisamment structurante. Je regrette qu’aucune disposition législative ne permette aujourd’hui de valoriser et de protéger les espaces naturels au sein des zones urbanisées, car cela contribue malheureusement à accélérer leur mitage.
Il me semble donc essentiel que ces parcs naturels urbains, dont celui de Strasbourg, puissent bénéficier à l’avenir d’un véritable statut juridique, à l’instar des parcs naturels régionaux. Ils seraient ainsi davantage protégés, encadrés et réglementés.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Monsieur Elkouby, vous avez appelé l’attention de Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, sur la nécessité de protéger les espaces naturels au sein des zones urbanisées. Sachez que c’est également une préoccupation du Gouvernement, à laquelle il a répondu par la mise en place d’outils de planification adaptés.
Ces espaces naturels peuvent ainsi être identifiés et protégés dans divers documents et à plusieurs échelles.
À l’échelle régionale, ils peuvent être identifiés comme participant à la biodiversité, aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue dans le schéma régional de cohérence écologique ou dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Les orientations en matière de protection des espaces naturels en zone urbaine et de préservation de la biodiversité peuvent ensuite être déclinées plus précisément dans le schéma de cohérence territoriale.
Enfin, l’utilisation des plans locaux d’urbanisme permettra d’appliquer localement et réglementairement les principes définis à l’échelle régionale et précisés dans le SCOT. À cet égard, les collectivités compétentes en matière d’urbanisme disposent de plusieurs possibilités pour protéger un espace vert de l’urbanisation.
Elles peuvent classer en espace boisé classé, au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, des parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Elles peuvent aussi définir des orientations d’aménagement opposables en termes de compatibilité aux projets, pour protéger les continuités écologiques ou bien fixer les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Ainsi, tous les projets non conformes à la destination de l’emplacement réservé devront être refusés.
Elles peuvent encore localiser et délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état, ou délimiter les terrains concernés par des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue des espaces verts à créer ou à modifier.
Il existe donc, monsieur le député, un large éventail de dispositions juridiques mobilisables par les collectivités dans leurs plans locaux d’urbanisme pour protéger de façon pérenne les parcs urbains. La ministre estime par conséquent qu’il n’est pas nécessaire d’en créer de nouvelles.

Monsieur le secrétaire d’État, je tiens à vous remercier pour votre réponse et me réjouis de l’intérêt du Gouvernement pour les parcs naturels urbains. Je souhaite toutefois souligner que le parc naturel urbain répond à une démarche de projet territorial structurant qui dépasse le simple classement d’un espace vert ou biologique.
Je renouvelle à l’attention de Mme Royal et de Mme Pompili mon invitation à venir visiter le parc naturel urbain de Strasbourg, qui est un exemple en la matière et répond, j’en suis certain, aux exigences que vous venez de rappeler.
La séance, suspendue quelques instants, est immédiatement reprise.

La parole est à M. Paul Molac, pour exposer sa question, no 1639, relative aux orientations de la politique agricole commune après 2020.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, j’ai appelé l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur la réforme de la politique agricole commune après 2020.
La PAC actuelle, issue de l’accord de Luxembourg de 2003, a consacré la fin des quotas laitiers pour 2015, l’affaiblissement des outils de régulation du marché et le découplage des aides, avec la bénédiction des autorités françaises de l’époque. Cette vision est à l’origine de la grave crise laitière et bovine que nous traversons aujourd’hui. Elle fut une étape supplémentaire dans le processus de libéralisation de l’agriculture européenne et de fragilisation des territoires ruraux. Les producteurs sont désormais soumis à une extrême volatilité des prix. La production laitière vit une situation très difficile, avec des prix en dessous du prix de revient, qui ne permettent même pas aux agriculteurs de se dégager un salaire. De nouveaux outils de gestion des risques doivent être mis en place et les filets de sécurité existants renforcés.
La crise actuelle incite donc à repenser les mécanismes de crise et les outils de régulation du marché. Or la tournure très libérale prise lors de la réunion informelle du conseil Agriculture sur l’avenir de la PAC après 2020, qui s’est tenu à Amsterdam en mai dernier, ne semble pas devoir être remise en cause, bien au contraire. Ainsi, pris sous l’égide de la présidence néerlandaise de l’Union européenne, le document de travail qui a servi de base aux discussions prône une PAC beaucoup plus libérale. On peut y lire : « Il faut donner la liberté aux agriculteurs de devenir des entrepreneurs, pour innover et être compétitifs sur les marchés européens et internationaux. » S’agit-il d’amplifier l’orientation donnée à la PAC depuis 2003 ?
C’est pourtant bien en se livrant à l’arbitrage des marchés mondiaux, sans moyen de réguler les volumes, que l’Union européenne se retrouve désarmée et ses agriculteurs dans une grave difficulté. Il semble dès lors plus que nécessaire de se doter rapidement d’instruments de régulation afin de protéger nos agriculteurs et de leur permettre de vendre leur production à un juste prix.
L’agriculture n’est pas un secteur économique comme un autre. Elle est consubstantielle à notre histoire, à notre aménagement du territoire et à notre alimentation ; de ce fait, elle doit être une exception dans les discussions de l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce. Je souhaite donc connaître les orientations que défend le gouvernement français pour la PAC après 2020 et notamment savoir s’il prône un renforcement des outils de régulation du marché.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Monsieur Molac, vous avez appelé l’attention du Gouvernement sur les perspectives de réforme de la politique agricole commune après 2020. Vous demandez en particulier un renforcement des outils de régulation du marché.
Les outils d’intervention sur les marchés et le filet de sécurité européen existent et peuvent accompagner les agriculteurs pour surmonter les crises. La France a défendu ces outils et leur renforcement lors de la réforme de 2013. Il est donc toujours possible d’intervenir, comme a fini par le faire l’Union européenne dans la crise laitière récente ; cela demande toutefois une détermination politique sans faille, ce dont n’a pas manqué le ministre de l’agriculture français à cette occasion, qu’il s’agisse du constat de surproduction ou des solutions d’action proposées.
Face à des crises comme celle que nous traversons, d’une ampleur et d’une durée exceptionnelles, des réponses d’ampleur et coordonnées à l’échelle européenne sont nécessaires, consistant dans le déploiement des outils de régulation des marchés que nous avons contribué à maintenir et à renforcer en 2013.
La France considère cependant que la réactivité de l’Union européenne doit encore être renforcée et les outils de gestion des risques améliorés et diversifiés. Par ailleurs, cette réponse à une situation conjoncturelle doit nécessairement s’accompagner de solutions à long terme, permettant de renforcer la capacité de résilience et la compétitivité d’un secteur agricole confronté à un contexte de volatilité accrue des marchés.
La proposition du ministre pour la future PAC post-2020, présentée lors de la réunion informelle du Conseil agriculture de mai 2016 à Amsterdam, tient compte de ce contexte, tout en proposant des outils pour une meilleure compétitivité et une meilleure résilience des exploitations agricoles.
La PAC doit d’abord permettre de renforcer la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires, en développant notamment l’approche filière. Elle doit ensuite encourager l’innovation car, dans un monde globalisé avec une économie de marché ouverte, la compétitivité d’un secteur est intrinsèquement liée à sa capacité à innover, tant sur le plan technologique que sur les plans social ou organisationnel. La PAC doit enfin mieux accompagner les exploitations dans la gestion des risques et des aléas sanitaires, climatiques ou économiques majeurs, qui se multiplient. La crise actuelle que traversent plusieurs filières souligne bien ce besoin d’outils adaptés, qui devient même une condition nécessaire à l’atteinte des objectifs de compétitivité et de durabilité.
Il est donc proposé, pour la future PAC, de renforcer et de développer une panoplie d’instruments de gestion des risques et des aléas, en vue de favoriser le renforcement de la capacité de résilience propre, tant au niveau des exploitations, à travers la diversification des revenus et des modes de production pour une moindre dépendance aux intrants extérieurs et donc au marché et aux aléas, qu’au niveau des filières, à travers le développement de la contractualisation et le renforcement du maillon production.
Cette proposition recoupe le travail effectué par le Conseil, sous l’impulsion de la présidence slovaque, pour renforcer le positionnement des producteurs dans le fonctionnement de la chaîne de production et de commercialisation alimentaire.
En cas d’aléas, plusieurs dispositifs complémentaires pourraient intervenir : des mesures exceptionnelles de régulation des marchés, permettant d’intervenir rapidement et de limiter les conséquences et l’ampleur de la crise ; des outils de gestion des risques climatiques et sanitaires – assurances récoltes et fonds de mutualisation sanitaire – pour l’indemnisation des pertes ; un outil efficace de prise en charge des aléas économiques, de type assurance chiffre d’affaires ou outil de stabilisation des revenus, conditionné à la souscription d’une assurance et à la contribution au fonds de mutualisation ; enfin, un outil efficace de soutien à la trésorerie des exploitants, qui prendrait la forme d’une épargne de précaution obligatoire, permettant d’introduire un caractère contracyclique à la PAC.

La parole est à M. Gilles Lurton, pour exposer la question no 1630 de M. Marc-Philippe Daubresse, relative à la désignation du président de la société de projet du canal Seine-Nord.

M. Marc-Philippe Daubresse, empêché ce matin, appelle effectivement l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer sur la présidence de la société de projet du canal Seine-Nord.
Alors qu’un consensus se dessinait à peine, avec un engagement de l’ensemble des acteurs, pour faire de ce grand projet une réalité et un axe de développement majeur de la région Hauts-de-France, le Gouvernement, en choisissant de nommer un membre de la majorité parlementaire et en adoptant ainsi une posture politicienne, met à mal des semaines de travail, avec le plus grand mépris.

Cette nomination n’a même pas respecté les formes les plus élémentaires des relations entre l’État et la région Hauts-de-France, principale collectivité locale financeur du projet, ni aucune autre collectivité, qu’il s’agisse de l’Île-de-France ou des quatre autres départements concernés, alors que chacun finance à parité le projet.
De plus, cette nomination s’apparente à un détournement caractérisé de l’esprit de l’article L.O. 145 du code électoral, lequel prohibe le cumul d’un mandat parlementaire avec la présidence d’un établissement public de l’État et stipule qu’un député ne saurait toucher de rémunération au titre d’un siège dans un tel conseil de surveillance.
C’est pourquoi Marc-Philippe Daubresse et nombre d’élus de la région des Hauts-de-France souhaiteraient connaître l’avis du Gouvernement sur cette nomination.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Monsieur Lurton, je tiens à rappeler l’entière mobilisation du Gouvernement sur le projet de canal Seine-Nord Europe depuis que le Premier ministre a relancé le dossier, à Arras, le 26 septembre 2014.
Ce projet est en effet d’une importance vitale pour notre économie et la transition énergétique. Déjà, avec la déclaration de Tallinn du 17 octobre 2013, cosignée par la Commission européenne et les ministres chargés des voies navigables de la Belgique, des Pays-Bas et de la France, l’importance du développement de cette liaison fluviale a été réaffirmée. Celle-ci doit permettre de rattraper un retard certain du niveau de service du réseau d’infrastructure fluvial et ainsi concourir au développement des hinterlands des ports français de la façade nord, du Havre à Dunkerque en passant par les ports intérieurs.
J’ai porté le dossier devant la Commission européenne, où nous avons obtenu un financement de 40 %. L’attribution du taux maximal de subvention pour les travaux traduit bien l’identification de ce projet comme une priorité pour l’Europe au sein du réseau transeuropéen de transport. Je rappelle qu’en 2012 ce dossier était totalement dans l’impasse et en situation d’échec. Grâce au travail accompli par Rémi Pauvros, les bases sur lesquelles relancer le projet ont été déterminées. Le Gouvernement s’est associé dès l’origine à cette démarche.
Depuis lors, plusieurs décisions essentielles ont été prises sous l’impulsion de ce gouvernement. L’ordonnance de création de la société de projet a été signée le 21 avril 2016. Avec les collectivités et l’appui de la mission de financement, j’ai conduit un travail important qui a permis de trouver un accord, le 28 novembre dernier, sur le protocole de financement du projet, grâce notamment à un effort supplémentaire de la région Hauts-de-France. Cet accord acte le principe d’un partage à 50 % entre l’État et les collectivités du coût du projet, estimé à 4,5 milliards d’euros hors taxes, aux conditions économiques de 2016, déduction faite des crédits européens et des possibles recettes dédiées. Il pose également les bases de la gouvernance de la société de projet, qui sera composée de membres issus de l’État et des collectivités locales.
Cela va permettre la création de la société et la mise en place de ses instances de gouvernance, une fois publié le décret relatif à la société, en cours d’instruction devant le Conseil d’État.
Il nous revient désormais d’identifier les futurs membres du conseil de surveillance, de manière à assurer au plus tôt le bon fonctionnement de la société. Le conseil de surveillance est composé de vingt-quatre membres, dont douze représentants de l’État. Il compte aussi un député, un sénateur, trois représentants du conseil régional des Hauts-de-France, un pour chacune des collectivités partenaires, le directeur général de Voies navigables de France et une personnalité qualifiée.
C’est au vu de l’implication particulière et du travail accompli par Rémi Pauvros – je viens de rappeler son rôle – que les représentants de l’État soutiendront sa candidature à la présidence de la société. Je tiens toutefois à vous rassurer, le Gouvernement souhaite naturellement que la nomination du président et l’exécution de son mandat se fassent selon les règles légales : d’une part, il revient bien au conseil de surveillance d’élire un président en son sein ; d’autre part, après le renouvellement de l’Assemblée nationale, la fonction de président de la société ne sera évidemment pas compatible avec le mandat de député, et, dans la période transitoire, aucun cumul de rémunération ne sera possible. Voilà qui répond précisément à votre interpellation, monsieur le député.
Compte tenu des différentes étapes franchies récemment, de la démarche volontariste initiée par le Gouvernement et de l’implication des collectivités pour faire aboutir ce projet majeur, je suis convaincu que l’esprit de coopération qui a animé l’ensemble des partenaires jusqu’ici permettra de concrétiser dès cette année ce grand chantier nécessaire à la France et plus particulièrement aux territoires.

La parole est à M. Jean-Pierre Vigier, pour exposer sa question, no 1627, relative à la téléphonie mobile en zones rurales.

Ma question s’adressait à Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique et de l’innovation.
Nous sommes en 2017 et nos territoires ruraux souffrent toujours d’une couverture en téléphonie mobile largement insuffisante. La Haute-Loire est malheureusement un exemple emblématique en la matière. Encore récemment, des citoyens altiligériens faisaient état de l’absence de couverture téléphonique mobile dans leurs habitations. La liste des communes altiligériennes mal couvertes est très longue.
Les communes d’Aubazat, Champagnac-le-Vieux, Charraix, Chavaniac-Lafayette, Esplantas-Vazeilles, Jax, Saint-Vénérand et Thoras ont soumis un dossier afin de bénéficier du programme zones blanches centres-bourgs. Où en est le traitement de leur demande ?
Onze communes de la Haute-Loire ont répondu à l’appel à projets 800 sites pour l’attractivité du territoire, dans le cadre du programme de développement de sites mobiles prioritaires ; sont notamment concernés le musée de la Résistance du Mont-Mouchet, Champagnac-le-Vieux, le lac du Bouchet, Saint-Haon – le lac du Bouchet –, Alleyras, la haute vallée de la Loire et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quel est l’état d’avancement de leur dossier ?
Se pose enfin l’indispensable question du financement de ces programmes. Certes, les pylônes bénéficient d’une prise en charge de l’État. Mais qu’en est-il du raccordement électrique, toujours à la charge des collectivités locales, dont les finances sont de plus en plus réduites ? Qu’en est-il des territoires non couverts par les programmes ?
Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, bénéficier d’une couverture mobile est aujourd’hui primordial. Nos territoires ruraux ne peuvent plus souffrir des insuffisances actuelles ; leur développement est en jeu.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Je vous prie tout d’abord, madame la présidente, d’excuser Axelle Lemaire, qui ne pouvait pas être présente ce matin.
Monsieur Vigier, concernant la téléphonie mobile en zones rurales, vous m’interpellez tout d’abord à propos des difficultés que rencontrent les habitants de Saint-Georges-Lagricol pour accéder au réseau de téléphonie mobile dans leurs habitations. Cette problématique, très fréquente, peut être aisément résolue grâce au dispositif « femtocell », décrit sur le site internet du plan France très haut débit, rubrique mobile.
La couverture mobile à l’intérieur des bâtiments, ou indoor, dépend de plusieurs facteurs, notamment des matériaux de construction. À titre d’exemple, certains matériaux d’isolation des bâtiments limitent la circulation des ondes radioélectriques, ce qui réduit la réception indoor. Il existe deux types principaux de solutions individuelles pour améliorer la couverture dans un logement. Pour la téléphonie mobile, c’est-à-dire la voix, il est possible d’installer des femtocellules, micro-stations se connectant au réseau internet fixe, en général à la box ; les fournisseurs d’accès à internet proposent cette solution, le plus souvent à un prix inférieur à 20 euros à l’achat pour les particuliers, et son utilisation n’entraîne aucun coût supplémentaire sur l’abonnement à internet. Pour l’accès à internet, la connexion du téléphone mobile au wifi permet en principe d’apporter une solution satisfaisante.
Concernant les zones blanches en centre-bourg, que vous avez mentionnées, nous ne disposons pas exactement de la même liste que vous. À ce jour, selon les éléments de l’Agence du numérique, quatre communes ont été identifiées par les opérateurs mobiles, à la suite de mesures réalisées sur le terrain, comme étant non couvertes par les opérateurs de téléphonie mobile : Grèzes, Jax, Montclard et Roche-en-Régnier. Ont en revanche été mesurées comme couvertes par au moins un des quatre opérateurs de téléphonie mobile les communes d’Aubazat, Charraix, Chavaniac-Lafayette, Cubelles, et Saint-Vénérand. À notre connaissance, Champagnac-le-Vieux, Esplantas-Vazeilles et Thoras n’ont jamais été signalées dans le cadre du recensement 2016 des communes dont le centre-bourg est situé en zone blanche.
Concernant l’appel à projets 800 sites pour l’attractivité du territoire, l’instruction des dossiers est toujours en cours. Un comité d’engagement doit se tenir fin février pour analyser ces dossiers et les réponses des opérateurs mobiles à la consultation lancée par l’État en septembre 2016.
Concernant les zones grises, les maires, les présidents d’EPCI – établissements publics de coopération intercommunale – et le président du conseil départemental de la Haute-Loire ont reçu un mot de passe pour déposer, sur la plateforme France mobile mise en place à la demande d’Axelle Lemaire par l’Agence du numérique, les problèmes de couverture en téléphonie mobile qu’ils rencontrent. Les premiers dossiers seront priorisés d’ici fin février et transmis aux opérateurs dès le mois de mars. À ce jour, cinq dossiers ont d’ores et déjà été signalés sur cette plateforme par des communes de la Haute-Loire : Le Monastier-sur-Gazeille, en particulier pour Crouziols, Bonneval pour toute la commune, Le Bouchet-Saint-Nicolas pour le bourg et le lotissement, Boisset pour le bourg et Bellevue-la-Montagne.

La parole est à M. Julien Aubert, pour exposer sa question, no 1622, relative à la réglementation des enseignes de la grande distribution.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, je voudrais appeler votre attention sur le problème des exploitations illicites par les enseignes de la grande distribution, un sujet que, je suis sûr, vous connaissez amplement.
Si l’article L. 752-23 du code de commerce prévoit bien la possibilité pour le préfet d’ordonner des sanctions administratives en cas d’exploitation illicite d’une surface de vente, les fondements juridiques des sanctions par les autorités ont été grandement affaiblis. En effet, la loi Pinel du 18 juin 2014 a prévu que les modalités d’application dudit article seraient déterminées par décret en Conseil d’État. Un décret d’application a bien été pris en 2015 mais il ne traite pas des sanctions, privant toujours celles-ci de tout cadre, donc d’existence. En outre, une ordonnance de mars 2016 a abrogé les dispositions de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989, sur lesquelles reposait l’habilitation des agents à constater les infractions et à les transmettre au préfet, rendant ainsi la prise de sanctions encore plus délicate.
De nombreuses grandes surfaces se sont par conséquent ouvertes ou agrandies dans l’illégalité la plus complète. Cette situation anormale demeure impunie alors qu’elle représente une distorsion de concurrence et, de surcroît, un manque à gagner considérable pour le budget de l’État. Dans un tel contexte, les pouvoirs publics ne peuvent plus sanctionner les infractions, laissant libre cours à la folie des grandeurs illicite de la grande distribution et accélérant la mort des commerces de proximité.
En conséquence, je souhaiterais savoir si vous comptez remédier à cette situation en prenant un décret précisant les modalités des sanctions prévues à l’article L. 752-23 du code de commerce, afin de mettre un terme à l’impunité et de rendre la concurrence plus juste vis-à-vis des petits commerces.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Monsieur Aubert, il n’existe pas de remontées statistiques recensant les mesures prises en cas de violation des décisions et avis en matière d’exploitation commerciale, mais tout laisse à penser qu’elles ont été plutôt rares, tout comme les cas de violation.
Depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le régime de l’urbanisme commercial est fondé non plus sur un principe de régulation économique mais sur le respect d’objectifs relatifs à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs, comme en dispose l’article L. 752-6 du code de commerce.
Depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi ACTPE », et la création du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, pour les projets nécessitant un permis de construire et une autorisation d’exploitation commerciale, la procédure devant les commissions d’aménagement commercial est intégrée dans celle du permis de construire : l’avis défavorable de la commission départementale ou de la commission nationale empêche la délivrance du permis de construire ; un avis favorable laisse à l’autorité compétente en matière de permis de construire la possibilité d’accorder ou de refuser ce permis, au vu du seul droit de l’urbanisme.
Au-delà de la simplification et de l’accélération des procédures, la fusion entre permis de construire et autorisation d’exploitation commerciale assure davantage de cohérence, donc de contrôle entre le volet commercial et le volet urbanisme des projets. Par ailleurs, tant la surveillance croisée et nourrie des concurrents, dont les recours assurent à la commission nationale d’aménagement commerciale – la CNAC – une activité soutenue, que la nécessité de repasser devant la commission, notamment en cas d’extension ou de modification substantielle du projet initial, ce qui suppose de répondre du respect des avis et décisions précédents, semblent dissuader les pétitionnaires de frauder ; cela vaut notamment pour les enseignes nationales, particulièrement soucieuses de leur réputation.
En tant que de besoin, une circulaire, en préparation, incitera les préfets à la plus grande vigilance, en particulier sur les contrôles de légalité des permis de construire et autorisations d’exploitation commerciale.

Je vous remercie pour votre réponse, madame la secrétaire d’État.
Je rappelle que, le préfet, même en l’absence de décret d’application, peut prendre des mesures afin de régulariser administrativement la situation, et que le non-respect de ces mesures est un délit. Il serait donc tout à fait possible de sanctionner les grandes surfaces qui ne respectent pas la loi.
Le sujet n’est pas anodin : vous avez laissé entendre que le nombre de cas n’était pas massif, mais, en réalité, il est beaucoup plus important que ce qu’on pense. On ne peut pas, d’un côté, déplorer la disparition du petit commerce dans un certain nombre de communes et, de l’autre, laisser faire ainsi les grandes surfaces, qui ont manifestement atteint un niveau de déploiement suffisant. À titre personnel, je pense qu’il faudrait désormais geler les extensions, de manière à conserver l’équilibre actuel et à ne pas basculer dans un monde à l’américaine, où il y aurait une grande surface à l’entrée de chaque bourg, de chaque commune, et plus du tout de petits commerces.

La parole est à M. Martial Saddier, pour exposer sa question, no 1620, relative aux contributions sociales des travailleurs frontaliers.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur l’application de la CSG et de la CRDS – la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale – aux revenus du patrimoine des travailleurs frontaliers relevant du système de Sécurité sociale de leur pays d’origine. Je voudrais associer à ma question mes collègues Virginie Duby-Muller, Stéphanie Pernod Beaudon et Lionel Tardy, députés de l’Ain et de la Haute-Savoie.
Depuis l’arrêt de Ruyter, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2015, et l’arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 2015, la France n’a plus le droit de prélever la CSG et la CRDS sur les revenus du patrimoine des frontaliers relevant du système de Sécurité sociale de leur pays d’emploi. Le motif retenu est que le produit de ces prélèvements était destiné à financer les prestations bénéficiant aux seules personnes assurées au régime français de Sécurité sociale, ce qui est désormais contraire au droit européen.
Or l’administration fiscale estime que le prélèvement de solidarité de 2 % n’est pas affecté à la Sécurité sociale mais à l’aide sociale. Ce pourcentage, échappant ainsi à la jurisprudence européenne, est donc réclamé aux frontaliers. De plus, l’administration soutient que les frontaliers qui ont opté pour une assurance en France – assurance privée ou régime de la couverture maladie universelle pour les frontaliers – ne peuvent prétendre à la totalité du dégrèvement, dans la mesure où ils ne présentent pas une affiliation unique en Suisse pour couvrir l’ensemble des branches de la Sécurité sociale ; de ce fait, elle ne restitue pas la partie des prélèvements sociaux affectée au financement de l’assurance maladie et de la dépendance en France. Enfin, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a, dans son article 24, prévu d’affecter entièrement la part de la CSG et de la CRDS prélevée sur les revenus du patrimoine des travailleurs frontaliers vers le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, et vers la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA.
Ces différentes interprétations sont en totale contradiction avec la jurisprudence et le droit européen, et pourraient entraîner de nouveaux contentieux ; le Groupement transfrontalier européen, le GTE, a d’ailleurs saisi le Gouvernement à plusieurs reprises sur ce sujet.
Afin d’éviter un nouveau contentieux, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures vous envisagez de prendre pour mettre la législation française en conformité avec la jurisprudence et la réglementation européenne ?
Pouvez-vous également nous indiquer ce qu’il en est du remboursement des prélèvements sociaux – CSG et CRDS – indûment payés par les frontaliers ou anciens frontaliers ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Monsieur Saddier, vous m’interrogez à propos de l’assujettissement des travailleurs frontaliers aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital au taux de 15,5 % à la suite de la jurisprudence De Ruyter de février 2015. Dans sa réponse à une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il n’était pas possible de faire payer ses impôts à une personne affiliée à un autre régime de Sécurité sociale de l’Union européenne, de l’espace économique européen ou de la Suisse, parce qu’ils étaient destinés à financer la Sécurité sociale en France.
Par conséquent, sitôt rendue la décision du Conseil d’État, en juillet 2015, le Gouvernement a mis en place l’ensemble des dispositions nécessaires pour rembourser les prélèvements réalisés à tort sur les personnes justifiant d’une affiliation auprès d’un autre État.
Toutefois, comme vous le signalez, une partie de ces prélèvements n’a pas été remboursée, notamment une fraction de 2 points qui n’est pas affectée à la Sécurité sociale mais à des prestations de solidarité, accessibles sur simple critère de résidence, y compris à des personnes qui ne sont pas affiliées à la Sécurité sociale française. Cette décision est logique et conforme à l’interprétation à retenir. Le Conseil d’État a d’ailleurs validé cette interprétation, en juillet dernier, en reconnaissant que c’était à bon droit que cette partie des sommes prélevées n’était pas remboursée. Il n’est donc pas exact de prétendre que cette décision serait en contradiction avec le droit européen ; en tout cas, la plus haute juridiction française a un avis opposé.
S’agissant des frontaliers suisses affiliés à l’assurance maladie en France, sur lesquels porte, je crois, la seconde partie de votre question, il faut également adopter une règle différente : en effet, il ne serait pas justifié de rembourser à ces personnes, qui résident en France et y sont affiliées à l’assurance maladie, les sommes destinées à financer ce risque ; ce serait totalement inéquitable à l’égard de nos concitoyens. Il est là aussi nécessaire de tenir compte d’une situation particulière pour rembourser uniquement les prélèvements sociaux qui doivent l’être.
Le Gouvernement a donc tiré toutes les conséquences de ces décisions de justice pour les travailleurs frontaliers. Je rappelle que plus de 150 millions d’euros ont été remboursés à plus de 50 000 personnes depuis un an.

La parole est à Mme Marie-Hélène Fabre, pour exposer sa question, no 1635, relative aux numéros de téléphone surtaxés.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, la pratique des numéros de téléphone surtaxés se généralise depuis plusieurs années en France. Cette évolution semble particulièrement regrettable, a fortiori quand elle concerne de plus en plus de services publics et d’organismes sociaux de première nécessité pour nos concitoyens.
On constate que des organismes chargés d’une mission de service public ont choisi des plateformes téléphoniques avec des numéros surtaxés – je pense à la SNCF et à Air France. De trop nombreux organismes sociaux, relevant de l’assurance maladie, des allocations familiales ou de l’assurance vieillesse, ont aussi recours aux plateformes téléphoniques, avec des numéros spéciaux, un temps d’attente exagérément longs et des tarifs exorbitants.
Si certaines surtaxes téléphoniques ont occasionnellement baissé ces dernières années, la facturation de l’appel est généralement en augmentation depuis le changement de réglementation intervenu au 1er octobre 2015, en particulier quand le temps d’appel est long. Face à de telles pratiques, devons-nous rester sans réagir ? Ces abus manifestes sont d’autant plus choquants qu’ils pénalisent davantage les personnes de condition modeste, ceux pour qui le service public est le plus vital. De plus, ces numéros surtaxés sont très souvent le seul moyen connu par les usagers pour accéder aux services publics. Quelle est l’opportunité de ces systèmes ? Je tiens à rappeler qu’en qualité de contribuable, l’usager du service public a déjà abondé les finances publiques, ce qui revient à une double peine.
Les numéros d’appels à tarification normale devraient pouvoir être accessibles à tous, de manière générale, depuis les téléphones fixes ou mobiles, plus particulièrement pour l’ensemble des services sociaux et services publics. Je souhaiterais connaître, madame la secrétaire d’État, les initiatives que vous envisagez de prendre pour répondre aux problèmes que j’ai soulevés, concernant cet enjeu de l’accessibilité, souvent négligé.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Madame Fabre, un décret du 16 juin 2011 prévoit l’usage d’un numéro gratuit pour certains services sociaux : le service d’urgence pour les sans-abri, le 115, et le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, le 119. Cette gratuité totale, commune à d’autres numéros d’urgence, est justifiée par la nature des appels et la gravité des situations en cause.
Par ailleurs le code de la consommation prévoit que le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution du contrat ou le traitement d’une réclamation ne peut être surtaxé. Cette règle s’applique à toutes les entreprises, privées ou publiques. Dans les autres cas, il n’est pas illégitime que le recours par l’usager à un service téléphonique donne lieu au paiement correspondant à un numéro à tarification majorée.
Le principe d’une redevance pour service rendu prévaut pour de nombreux services publics. Les plateformes téléphoniques des organismes publics fournissent bien un service additionnel d’aide, d’orientation ou d’information, de très nombreuses informations étant accessibles par d’autres moyens, notamment en ligne. Le paiement par l’usager contribue au financement des moyens requis par la gestion des appels en masse. Il permet de réguler des appels en évitant que des usagers ne monopolisent les lignes, dans un contexte où les moyens de l’administration ne sont pas illimités.
Mais il va de soi que le tarif doit rester modéré et que l’utilisateur doit en être informé préalablement. Tel est le cas, l’information étant désormais beaucoup plus claire, grâce à la réforme de la tarification des numéros surtaxés.
Enfin, il est vrai que la concentration des appels à certains moments peut induire un temps d’attente ; je partage votre avis, madame la députée, sur la réalité de ce problème. Néanmoins, la gratuité du temps d’attente n’est pas techniquement praticable, car la technologie ne permet pas de distinguer le temps d’attente du restant de la communication. Cette contrainte est identifiée de longue date.
Les prestataires doivent donc mettre en place des solutions adaptées pour gérer efficacement des files d’appel, comme fournir une estimation du temps d’attente et, le cas échéant, inciter l’usager à rappeler ultérieurement. Si des difficultés apparaissent plus particulièrement pour certains organismes – vous les avez évoqués –, qu’elles concernent le niveau de tarification ou la gestion des files d’attente, il convient d’en alerter le ministre de tutelle, afin qu’elles fassent l’objet d’un examen attentif et que, le cas échéant, une action spécifique soit engagée.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, pour ces précisions. Pour autant, je resterai particulièrement vigilante, notamment s’agissant de l’accès aux organismes d’allocations familiales et d’assurance maladie, qui concernent les personnes les plus modestes.

La parole est à Mme Martine Martinel, pour exposer sa question, no 1640, relative au crédit d’impôt pour les associations.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, le secteur associatif est, vous le savez, un maillon fort de la vie collective de notre pays. Les associations participent à la solidarité, au dynamisme culturel et sportif de la France ; elles sont une force vive de la démocratie, la colonne vertébrale du lien social que l’on dit en crise partout mais que l’on voit encore si solide dans nos villes et villages. Élue d’une circonscription toulousaine, je constate chaque jour, quelle que soit la sociologie des quartiers, leur rôle essentiel.
Et le monde associatif est aussi un acteur économique majeur : avec 85 milliards d’euros de budget annuel, il représente 3,2 % du PIB de notre pays et emploie 1,8 million de salariés. Un salarié sur dix, dans notre pays, est employé par une des 165 000 associations, lesquelles représentent 80 % des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Partenaires essentiels de la construction et de la mise en oeuvre des politiques publiques, les associations doivent être encouragées, y compris par des mesures fiscales. La loi de finances pour 2017 a créé un crédit d’impôt qui leur est spécifiquement destiné : il s’agit de les faire bénéficier d’avantages similaires au crédit d’impôt compétitivité emploi, ou CICE. Les associations réclamaient ce geste fiscal pour compenser leur déficit de compétitivité par rapport aux entreprises commerciales, qui bénéficient du CICE depuis le 1er janvier 2013. Je me félicite donc que nous ayons collectivement décidé d’accéder à cette demande légitime ; c’est une reconnaissance bien méritée.
Pourriez-vous nous indiquer, madame la secrétaire d’État, votre estimation des gains attendus pour les associations et des retombées prévisibles en termes de maintien et de création d’emplois ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Madame Martinel, les associations, qui composent l’une des familles de l’économie sociale et solidaire, sont très fortement pourvoyeuses d’emplois, avec plus de 1,7 million de salariés, et ont encore confirmé, en 2015, leur dynamique de recrutement, avec une création nette de plus de 70 000 emplois.
Comme le révèle le rapport des députés Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico relatif à l’impact de la mise en oeuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, on observe aujourd’hui une tendance accrue du secteur marchand à intervenir sur des champs également investis par les associations. C’est notamment le cas pour des activités comme la garde d’enfant, les services à la personne ou l’accueil en EHPAD – établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – dans les zones jugées rentables.
Pourtant, les acteurs associatifs non lucratifs ont un modèle économique plus exigeant, dans la mesure où leurs missions les font intervenir dans les zones fragiles ou éloignées, délaissées par les acteurs marchands. Or les acteurs marchands, comme l’ensemble des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, bénéficient du CICE, qui leur fournit ainsi un avantage par rapport aux acteurs non lucratifs, estimé à 1 milliard d’euros en 2014. Mais ces derniers sont exclus de son bénéfice dans la mesure où, faute de poursuivre un but lucratif et donc de dégager des bénéfices, ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés, sur lequel s’impute le CICE. Pourtant, les acteurs non lucratifs, vous l’avez évoqué, supportent une charge fiscale non négligeable : ils acquittent notamment la taxe sur les salaires, laquelle est assise sur toutes les sommes versées aux salariés, en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il était donc indispensable de mieux prendre en compte les spécificités du secteur non lucratif, afin de lui permettre de maintenir son offre spécifique et d’affirmer que nous soutenons ce choix de modèle exigeant, parce qu’il poursuit un but d’utilité sociale.
C’est la raison pour laquelle a tout d’abord été mise en place une augmentation de l’abattement de la taxe sur les salaires. Cette mesure compensatrice – une augmentation de 6 000 à 20 000 euros de l’abattement – est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Valorisée à un peu plus de 314 millions d’euros, soit environ 1,5 % du coût du CICE, elle permet à de très nombreuses associations – 70 % d’entre elles – mais également à des mutuelles, à des fondations et à des centres de lutte contre le cancer de ne plus payer la taxe sur les salaires.
Cette mesure, appelée « abattement Hamon », a été complétée par le crédit d’impôt que vous évoquez, dit « CICE associatif », adopté dans la loi de finances pour 2017, dont le coût est évalué à 600 millions d’euros par an, à compter de 2018, pour le budget de la Sécurité sociale.
À ce stade, il est difficile de projeter avec rigueur l’impact de cette mesure, qui pourra créer des emplois et tout au moins consolider les emplois existants. Néanmoins, je peux préciser les éléments suivants : on compte aujourd’hui 144 000 associations de moins de dix salariés, soit 330 000 salariés, qui bénéficiaient déjà de l’abattement jusqu’à 20 000 euros. Les quelque 40 500 associations de plus de dix salariés, qui occupent 1,58 million de salariés, vont bénéficier de l’allégement de 4 % du CITS, le crédit d’impôt de taxe sur les salaires. Pour les centres de lutte contre le cancer, les fondations et les mutuelles, cette mesure permettra tout au moins de consolider leur effectif de 250 000 salariés.

Je remercie Mme la secrétaire d’État pour sa réponse très précise, qui va dans le sens de la reconnaissance et de la consolidation des associations.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour exposer sa question, no 1621, relative aux rapports entre les entreprises et l’inspection du travail.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, certains médias ont récemment mis en relief l’overdose réglementaire à laquelle les chefs d’entreprise sont aujourd’hui confrontés. Au-delà des discours lénifiants servis depuis le début du quinquennat, force est de constater que rien n’a été fait afin de rendre le droit du travail plus simple pour les employeurs, plus particulièrement pour les TPE, les très petites entreprises, qui constituent plus de 80 % des entreprises de notre pays.
Ainsi, malgré la création d’un secrétariat d’État chargé de la simplification administrative, le Gouvernement n’est toujours pas parvenu à gommer, dans le code du travail, la différence entre jours ouvrables, ouvrés, francs et calendaires. De même, si le principe selon lequel « qui ne dit mot consent » prévaut, il est entouré d’une kyrielle d’exceptions qui nous font nous demander ce qu’il vaut encore.
Dans ce contexte, le Gouvernement aurait dû inciter l’administration à développer le dialogue avec les entreprises, autrement appelé principe du contradictoire. Cela n’a pas été le cas. Au contraire, depuis le 1er juillet 2016, les pouvoirs des inspecteurs du travail ont été considérablement renforcés, sans que des garanties ne soient envisagées pour les entreprises.
Le problème a, semble-t-il, été partiellement perçu, puisque l’article 117 de la loi travail prévoit la création d’un code de déontologie du service public de l’inspection du travail. Au-delà de l’affichage, il convient d’être plus précis sur le contenu de ce code. Pourriez-vous donc m’indiquer les principales dispositions et garanties qu’il contiendra ? Plus largement, quelles mesures votre gouvernement a-t-il prises pour renforcer le dialogue entre les entreprises et l’administration ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Monsieur Decool, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, actuellement retenue auprès du Premier ministre. Vous l’interrogez en effet sur le code de déontologie prévu par l’article 117 de la loi relative au travail.
Vous le savez, l’inspection du travail remplit une mission difficile et essentielle dans notre pays : s’assurer du respect du droit du travail. C’est parce que le Gouvernement a pleinement conscience de son rôle crucial qu’il a considérablement renforcé ses pouvoirs et ses moyens d’intervention, grâce notamment à l’ordonnance du 7 avril 2016, ratifiée par la loi du 8 août 2016. C’est pour la même raison que son organisation a été profondément revue.
Ces moyens accrus rendent plus que jamais nécessaire, parallèlement, l’élaboration d’un code de déontologie tel qu’il en existe au demeurant pour un très grand nombre de corps, comme les pharmaciens, le service public pénitentiaire, les médecins et bien d’autres.
Ce code a pour but de rappeler les grands principes qui protègent l’inspection du travail. C’est important, notamment dans un contexte où des incidents récents nous rappellent que l’action des agents de ce corps est régulièrement remise en cause par certains usagers. À ce propos, je tiens à souligner que ma collègue ministre du travail apporte son soutien, chaque fois que cela se produit, aux agents qui se trouvent ainsi, de manière inacceptable, mis en cause dans l’exercice de leurs missions.
Le code réaffirme notamment le principe d’indépendance de l’inspection, consacré, nous le savons, au plus haut niveau, par les normes de l’Organisation internationale du travail.
Il clarifie aussi, pour les différents interlocuteurs de l’inspection, les missions de service public que celle-ci remplit, ainsi que le cadre et les règles de son intervention. Cette transparence va de pair avec une transparence accrue des agents de l’inspection. Le texte prévoit ainsi, conformément à la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et à son décret d’application du 28 décembre 2016, que les agents du système d’inspection du travail seront soumis à l’obligation de fournir une déclaration d’intérêts. Les débordements constatés s’expliquent souvent, de manière plus générale, par une plus grande exigence et des attentes plus fortes vis-à-vis de l’État et de son administration.
Cette réaffirmation du principe d’indépendance et cette transparence sont essentielles pour renforcer l’autorité du service public et de chacun de ses agents, et pour offrir aux usagers du service public les garanties qu’ils sont en droit d’attendre de la part de l’État.
La démarche qui sous-tend l’élaboration de ce code repose sur le principe que tout corps de l’État investi de responsabilités importantes se dote de règles rappelant ses droits et ses devoirs, et lui permettant de renforcer la confiance des usagers. C’est également le signe que l’administration se régule elle-même et explique le cadre et les valeurs dans lesquels s’inscrit son action au quotidien.
L’élaboration de ce texte a donné lieu à la consultation du Conseil national de l’inspection du travail, du Conseil national de l’Ordre des médecins et du comité technique ministériel. Ces concertations ont permis de faire évoluer le projet de guide, parfois de manière très substantielle, tout en maintenant et en renforçant les principes qui le portent : confiance et crédibilité, autorité et protection.
Enfin, la loi ayant prévu que ce guide reposera sur la norme réglementaire la plus forte, ce texte fera l’objet d’un examen par le Conseil d’État.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie pour cette réponse. J’avais déjà interrogé Mme la ministre du travail, le 18 février 2016, sur les simplifications à apporter au code du travail pour faciliter la vie des entreprises de notre pays ; il m’avait alors été répondu que ces simplifications seraient opérées dans le cadre de la loi travail. Malheureusement, je constate que, loin de simplifier le droit existant, la loi l’a un peu plus alourdi.

La parole est à Mme Françoise Descamps-Crosnier, pour exposer sa question, no 1634, relative à la carte prioritaire des lycées.

Je souhaite interroger Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, représentée ce matin par M. le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur la situation des lycées dans les zones prioritaires, comme le lycée Camille-Claudel de Mantes-la-Ville ou le lycée Jean-Rostand de Mantes-la-Jolie.
Des actions ont été menées par le mouvement Touche pas ma ZEP, depuis la rentrée scolaire, afin d’appeler l’attention, d’une part, sur la dégradation des conditions d’enseignement et, d’autre part, sur le déclassement du zonage prioritaire des lycées, qui suscite des inquiétudes pour les établissements concernés.
Mme la ministre a présenté fin novembre, vous le savez, une série de mesures visant à garantir le maintien des moyens alloués et vont dans le bon sens : déclenchement de la clause de sauvegarde, maintien des indemnités jusqu’en 2019, dotation exceptionnelle de 450 emplois nouveaux à la rentrée 2017 pour les lycées généraux et professionnels les plus défavorisés, et garantie du maintien de tous les moyens supplémentaires dont bénéficient les lycées de l’éducation prioritaire.
Toutefois, l’ensemble de ces mesures s’inscrivent dans une optique de court et moyen terme. Or les problèmes rencontrés localement sont structurels : les sureffectifs par classe ou le manque de dédoublement par matière fragilisent la qualité de l’enseignement, alors qu’une partie des lycéens concernés sont en grande difficulté. La récurrence dans les retards de paiement des salaires des contractuels pose également un problème de principe quant aux conditions de vie de ces agents.
L’attribution de quarante postes supplémentaires pour l’académie de Versailles est un élément positif. Cependant, cette académie, comme celle de Créteil, qui bénéficiera de cinquante postes supplémentaires dans les lycées prioritaires, comptabilise bien plus de lycées en zone prioritaire que certaines académies qui obtiennent pourtant, à la rentrée scolaire 2017, des renforts de postes supplémentaires au moins aussi importants.
Quelles sont donc les mesures que vous entendez prendre face à ces enjeux essentiels ? Pouvez-vous par ailleurs préciser, pour notre bonne compréhension, les modalités de la répartition des affectations des 450 postes supplémentaires à la rentrée 2017 ? Plus généralement, quelles perspectives envisagez-vous en matière de refonte de la carte prioritaire des lycées ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Madame Descamps-Crosnier, vous avez interrogé Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, à propos des conséquences particulières sur les lycées de la refondation de l’éducation prioritaire, qui va de l’école obligatoire à la fin du collège.
L’extension de cette réforme aux lycées doit passer, comme cela a été le cas pour les collèges, par l’actualisation de la liste des établissements qui rencontrent objectivement le plus de difficultés sociales et scolaires, afin de mieux les accompagner, par un effort financier soutenu et par l’établissement d’un référentiel pédagogique, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
En attendant la réforme à venir, des mesures de sauvegarde – vous les avez mentionnées – ont été prises pour les lycées concernés par une politique prioritaire ; elles resteront en vigueur jusqu’en 2019.
Pour ce qui est des établissements que vous évoquez, le lycée Jean-Rostand, situé en zone urbaine sensible et en zone prévention violence, bénéficie de façon prioritaire de la nouvelle allocation progressive des moyens, tout comme le lycée Camille-Claudel. Depuis trois ans, un soutien spécifique et un travail de réseau entre les deux lycées de Mantes ont permis de voir les effectifs du lycée Jean-Rostand remonter, alors qu’ils étaient en forte baisse. Je vous informe ainsi qu’une nouvelle division de seconde sera ouverte à la rentrée 2017, en plus de celle qui a vu le jour cette année ; cet établissement disposera donc pour 2017-2018 d’une dotation complémentaire de 3,5 équivalents temps plein.
La situation de ces deux lycées est suivie au quotidien par le rectorat et la situation que vous me décrivez est réglée depuis novembre, avec l’aide des professeurs en poste, qui ont en partie pris en charge les enseignements des professeurs manquants.

Au-delà du cas de certains établissements, comme le lycée Jean-Rostand, je voulais aussi souligner, avec ma question, l’inquiétude des enseignants : en l’absence d’une loi telle qu’il en existe pour les écoles et les collèges, dans l’attente d’une réforme, la situation reste transitoire ; si la clause de sauvegarde existe, elle est précaire. Nous connaissons la détermination de la ministre à lutter contre les inégalités mais ce combat doit comporter très concrètement un accompagnement fort et prioritaire dans des lycées où l’on sait que les conditions de vie des élèves, sur les plans économique, social et familial, ne sont pas propices à une scolarité facile, d’où notre volonté de voir ce type d’établissements dotés de moyens pérennes et structurels. Je vous remercie, au demeurant, de votre réponse, madame la secrétaire d’État.

La parole est à M. Alain Leboeuf, pour exposer sa question, no 1625, relative au recrutement des professeurs d’université dans les départements d’outre-mer.

Ma question s’adressait à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; néanmoins, puisqu’elle concerne l’université de Saint-Denis de la Réunion, vous serez tout à fait en mesure d’y répondre, monsieur le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le problème qui me préoccupe porte sur la préférence régionale pour les emplois publics dans les départements d’outre-mer.
La nomination d’une maître de conférences en histoire de l’esclavage à l’université de Saint-Denis de la Réunion est en effet le sujet d’un feuilleton rocambolesque qui fait les gros titres de la presse et des réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Je rappellerai brièvement les faits.
En 2015, un emploi de maître de conférences en histoire de l’esclavage, de l’engagisme et de l’économie des colonies dans les îles du sud-ouest de l’océan Indien aux XVIIIe et XIXe siècles est mis au concours par l’université de La Réunion. Ce poste est en parfaite adéquation avec les compétences d’une universitaire qui a précisément rédigé sa thèse sur ce sujet. Celle-ci postule, mais, surprise ! le concours est annulé. Deuxième épisode : en 2016, un concours est rouvert et la candidature de cette même enseignante est, cette fois, retenue.
Débute alors une véritable campagne de lobbying menée par des universitaires réunionnais et des associations identitaires contre ce recrutement, en raison, disent-ils, de l’origine métropolitaine, et plus spécifiquement nantaise, de l’enseignante. Selon les détracteurs de cette nomination, l’histoire de l’esclavage ne pourrait être enseignée par un professeur originaire de la ville qui fut le premier port français pour la traite négrière. Saisi par des associations, le tribunal administratif décide, en juillet 2016, de suspendre la nomination de l’universitaire nantaise.
Monsieur le secrétaire d’État, mes questions sont donc simples : quelles sont les règles des concours de recrutement des professeurs d’université ? s’appliquent-elles de la même façon en métropole et dans les DOM ? Ce sont des questions très précises, auxquelles je vous demande de répondre avec précision.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Monsieur Leboeuf, si je répondais à votre seconde question avec précision, ma réponse tiendrait en un mot : « oui ». Mais vous en seriez frustré. Permettez-moi donc d’aller au-delà de la réaffirmation de ce qui devrait être un principe évident.
Les enseignants-chercheurs sont, je vous le rappelle, des fonctionnaires titulaires nommés sur un emploi dans un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche. Sous réserve des dispositions particulières concernant les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ils sont recrutés, comme vous l’avez indiqué, par concours ouverts et organisés par les établissements. Ils doivent au préalable avoir été inscrits sur une liste de qualification établie par le Conseil national des universités, le CNU, et remplir plusieurs conditions.
Conformément aux dispositions des articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l’éducation, les candidatures, pour chaque recrutement d’enseignant-chercheur, sont examinées, sur l’ensemble du territoire national, par les organes compétents là où le concours a été organisé, à savoir le comité de sélection, le conseil académique et le conseil d’administration. En vertu du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, ces organes sont composés de leurs seuls représentants, et il n’existe pas de dispositions particulières pour l’outre-mer.
Vous m’interpellez à propos d’un concours de recrutement de maître de conférences en histoire avec un profil d’emploi orienté sur l’histoire de l’esclavage, de l’engagisme et de l’économie aux XVIIIe et XIXe siècles. Une candidate au concours ouvert par l’université de La Réunion a été classée en première position par délibération du comité de sélection, classement confirmé par les autres instances de l’établissement.
Cependant, le tribunal administratif de La Réunion a effectivement suspendu, le 4 juillet 2016, l’exécution de la délibération du conseil d’administration, car le moyen tiré de la composition du comité de sélection était de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la procédure de recrutement. C’est donc une contestation de la procédure pour vice de forme qui explique que cette procédure ait été suspendue, dans l’attente de la décision au fond.
Je le dis très clairement : si le tribunal confirme la légalité de la procédure, la nomination par les services du ministère aura lieu. Dans le cas contraire, cette procédure devra être reprise dans son ensemble.

Permettez-moi de continuer de m’inquiéter de l’importance croissante, voire démesurée, prise par ces associations identitaires dans les départements d’outre-mer. Au fond, les lois de la République s’appliquent-elles vraiment de la même manière en outre-mer et en métropole ? Je m’interroge vraiment…

La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour exposer sa question, no 1641, relative à la pratique de la moto en milieu urbain.

Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, certains de nos quartiers sont le théâtre de rodéos à répétition de quads, motos ou scooter. Les riverains et les commerçants sont exaspérés de subir, chaque jour, la circulation abusive de ces engins. Avec la vitesse, le bruit, parfois l’odeur, ils ne peuvent plus se promener tranquillement, laisser les enfants jouer dehors, profiter des espaces verts ni même ouvrir leurs fenêtres.
Bien que très connu des élus locaux et des forces de l’ordre, ce phénomène ne peut malheureusement pas à être jugulé. Certes, 20 000 contraventions sanctionnent chaque année ceux des conducteurs qui utilisent mal leur deux-roues motorisé ou leur quad. Nuisance sonore, non-port du casque, non-respect d’un stop ou d’un feu, dépassement par la droite, circulation à contresens, vitesse excessive, circulation sur piste cyclable, sur zone piétonne, conduite dangereuse, défaut d’immatriculation : la liste des infractions qui relèvent de la contravention est longue.
Pourtant, en l’état actuel du droit, les forces de l’ordre ne peuvent guère faire grand-chose pour les empêcher. Seule l’interception des individus sur le fait permettrait l’immobilisation immédiate du véhicule et l’identification du conducteur mais elle est concrètement presque impossible. On sait en effet qu’appréhender les conducteurs en infraction est une mission extrêmement délicate pour nos agents de sécurité, parce que toute course-poursuite présente un risque élevé d’accident pour le conducteur et les policiers ou gendarmes eux-mêmes, mais aussi pour les habitants. Même en cas d’identification préalable des individus en cause, grâce au non-port du casque ou à des moyens de vidéosurveillance, il reste impossible de procéder à leur interpellation a posteriori, à domicile par exemple, car, pris isolément, chaque fait ne relève que de la simple contravention.
Face à l’exaspération des habitants, au sentiment d’impunité des chauffards et au constat d’impuissance des acteurs publics, plusieurs élus de ma circonscription ont, après consultation de leurs interlocuteurs de police et de justice, réfléchi à une piste, que je vous soumets ce matin et qu’ils sont prêts à étudier avec vous ou vos services. Ma question, monsieur le ministre, est donc la suivante : vous paraît-il envisageable que ces contraventions liées au rodéo soient requalifiées en délit, dès lors que différentes infractions se cumulent ou bien qu’il y a récidive ou intention réelle de nuire ? Cette requalification en délit permettrait enfin aux forces de l’ordre d’interpeller chez eux les chauffards concernés, sans prendre de risque pour eux-mêmes ou autrui, de les livrer à la justice et de saisir leur véhicule.
Madame Linkenheld, je ne peux que confirmer la réalité du phénomène des rodéos urbains, qui occasionnent incontestablement des nuisances pour les riverains et peuvent caractériser des infractions au code de la route. Vous l’avez rappelé, un certain nombre de ses comportements sont déjà susceptibles de faire l’objet de sanctions : le non-port du casque, la conduite à une vitesse excessive, le défaut de maîtrise, l’utilisation d’un système d’échappement non conforme ou encore la conduite d’un véhicule non homologué ou débridé.
Sur la base de cet arsenal, compte tenu de l’augmentation de l’usage intempestif de véhicules comme les quads ou les moto-cross sur la voie publique, les parquets poursuivent ces actes délictueux. Ils le font dans le but de permettre la saisie des véhicules incriminés, en vue de leur confiscation ultérieure par le tribunal. Concernant les mineurs, ils ordonnent des mesures de composition pénale comportant l’obligation, pour l’auteur des faits, de se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Par ailleurs, dans les cas pertinents, sont également poursuivis, lorsqu’ils sont caractérisés, les délits suivants : la conduite sans permis, la conduite en état d’ivresse, la conduite sous l’emprise de stupéfiants, le refus d’obtempérer, le délit de fuite ou encore la mise en danger de la vie d’autrui. Les comportements de ce type font l’objet de réponses pénales fermes, qui s’appuient sur de nombreuses incriminations adaptées ; elles permettent d’apporter une réponse efficace, notamment grâce recours à la confiscation des véhicules en cause.
Objectivement, au vu de l’arsenal juridique existant, nous n’avons donc pas de raisons de modifier le droit. Puisque vous faites état de discussions avec des partenaires, notamment des services judiciaires, je vais demander au procureur de la République de votre ressort de me faire un point plus précis sur cette situation. En effet, s’il existe une demande de modification de la qualification des délits, il n’y a pas de raisons pour que nous ne l’étudions pas.

Vous l’avez dit, quand l’infraction est caractérisée, elle peut effectivement être sanctionnée. Toute la difficulté réside dans la possibilité d’interpeller l’auteur de l’infraction. Bien souvent, les forces de police renoncent malheureusement à poursuivre l’auteur de l’infraction pour ne pas mettre en danger l’environnement immédiat. Tel est le vrai sujet : comment contourner l’impossibilité d’agir en flagrant délit, puisque les faits incriminés ne constituent pas un délit mais une contravention ? C’est sur ce sujet qu’ont réfléchi les élus et les acteurs locaux. Je salue donc votre proposition de travailler ensemble.

La parole est à M. Arnaud Richard, pour exposer la question no 1647 de M. Michel Zumkeller, relative aux offices notariaux.

Je remplace effectivement Michel Zumkeller, qui est malheureusement retenu et que je vous prie, monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir excuser.
Lors de l’élaboration de la loi concernant les professions réglementées, défendue par un ministre dont je ne citerai pas le nom dans l’hémicycle, vous avez pu remarquer, en tant que président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, que la création de nouveaux offices de notaires était emblématique de la politique de l’époque.
Toutefois, alors qu’il s’agissait de permettre à des jeunes diplômés d’acquérir des offices, l’application de la loi est beaucoup plus compliquée que prévu, notamment pour le Gouvernement : 30 000 candidatures ont été déposées pour les 1 002 places proposées. Ainsi, des offices de notaires, censés assurer partout la sécurité juridique des contrats, sont soumis au hasard d’une forme de tirage au sort, sans prendre en compte la qualité de primo-installant.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016, le Gouvernement a instauré une nouvelle contribution, sous forme de taxe, pour l’accès au droit et à la justice. Or le Conseil constitutionnel, en fin d’année 2016, a censuré les dispositions de l’article 1609 octotricies du code général des impôts, au motif qu’elles n’étaient pas conformes au principe d’égalité.
Mon collègue Michel Zumkeller demande donc au Gouvernement de recevoir les représentants de la profession pour évoquer l’ensemble de ces difficultés. Il souhaite également vous rappeler, monsieur le garde des sceaux, que cette profession assure un véritable service aux citoyens et qu’elle mérite bien mieux que la situation dans laquelle elle se trouve.
Monsieur Richard, merci beaucoup pour cette question ; je regrette de ne pas pouvoir en discuter directement avec Michel Zumkeller. Il y a deux sujets distincts.
Premièrement, s’agissant de la contribution prévue par la loi Macron, l’intention du législateur – permettez-moi de parler en son nom – était précisément de créer un fonds destiné à faciliter l’installation des nouveaux professionnels concernés par la loi. Cependant, le Conseil constitutionnel ayant effectivement censuré cette disposition, elle est aujourd’hui inapplicable. Il appartiendra au législateur – mais cela ne sera pas fait dans les semaines qui viennent – de rediscuter des modalités d’abondement de ce fonds, puisque le Gouvernement croit à sa pertinence.
Le deuxième point est beaucoup plus compliqué. Les représentants de la profession sont systématiquement associés à nos travaux, singulièrement le Conseil supérieur du notariat, avec lequel nous traitons évidemment ces questions. Un diplômé notaire peut-il s’installer plus facilement qu’une société préexistante ? Cela a toujours été la position de la chancellerie, aussi bien aujourd’hui que lorsque Christiane Taubira était garde des sceaux. Mais ce n’est pas ce que vous avez voté, monsieur le député, puisque la loi Macron n’établit aucune distinction entre les diplômés notaires et ceux qui sont déjà associés.
Je voulais dire que le législateur a voté la loi ; je vous exonère de cette responsabilité personnelle, que vous n’avez aucune raison d’assumer si vous n’avez pas voté en sa faveur.
Quand bien même nous voudrions vous donner satisfaction, nous ne le pourrions pas, puisque la loi ne le prévoit pas. Dans les décrets d’application, la chancellerie a essayé de rétracter cette faculté d’adaptation, puisque l’intention du législateur était de faciliter l’installation des nouveaux notaires, notamment celle des diplômés notaires. Cependant, même lors des réunions interministérielles qui se sont tenues sur les dispositions réglementaires, ce n’est pas ce point de vue qui a été adopté.
Je me borne donc dorénavant à faire en sorte que les nouveaux notaires soient bien traités. Ils le seront, dans le respect de la complexité du sujet, puisque, comme vous l’avez dit très justement, 30 000 dossiers ont été déposés par 7 500 personnes. Nous devons procéder à 247 tirages au sort. Nous le ferons tous les mercredis, sans craindre les contentieux, puisque nous avons maintenant aplani toutes les difficultés. J’espère que tous les problèmes seront réglés au mois de septembre, terme fixé par le législateur.

La parole est à M. Jean-Luc Bleunven, pour exposer sa question, no 1633, relative au manque de places dans les instituts médico-éducatifs.

Madame la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, je souhaite vous interroger sur le manque de place dans les instituts médico-éducatifs, plus couramment appelés IME, pour les enfants et adolescents en situation de handicap. Ces instituts, comme vous le savez, prennent en charge les enfants ou adolescents présentant une déficience à prédominance intellectuelle. L’éducation est non seulement un droit fondamental pour chaque enfant mais également un outil essentiel de la construction individuelle et sociale des individus. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l’école et ainsi bénéficier des mêmes opportunités de se construire un avenir. En Bretagne, il existe quarante-cinq IME, dont treize dans le Finistère.
Un problème se pose : du fait de l’amendement dit « Creton », les adultes en situation de handicap ne trouvant pas de place dans les ESAT – les établissements et services d’aide par le travail – ont la possibilité de conserver leur place en IME, normalement réservés aux enfants et adolescents, ce qui aboutit à une raréfaction des places disponibles pour ces derniers. La réponse apportée aux parents est que leur enfant est placé sur liste d’attente. Cette situation peut être extrêmement longue, puisqu’il n’est pas rare qu’un enfant reste sur cette liste pendant plusieurs années successives.
Je voudrais également vous faire part de la réalité du terrain. Dans nos circonscriptions, nous nous trouvons bien souvent face à des drames humains : des familles, déjà démunies face aux difficultés auxquelles elles doivent faire face du fait du handicap dont souffre leur enfant, doivent bien souvent entamer un parcours du combattant pour arriver à le scolariser.

À titre d’exemple, l’un d’eux, résidant dans ma circonscription, avait progressé grâce à une classe spécialisée en école élémentaire, mais a dû la quitter car il est devenu trop âgé. Il est essentiel que son éducation se poursuive mais, faute de place en IME, aucune solution n’a été trouvée pour cet enfant, malgré les instructions de son médecin traitant. L’un de ses parents a donc dû quitter son travail pour se consacrer à lui à plein-temps, avec tous les sacrifices que cela suppose et bien qu’il ne possède pas les qualifications nécessaires.
Je connais et je salue les avancées de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Les nouvelles mesures qui en sont issues me semblent intéressantes mais des lenteurs dans leur application sont à déplorer. Le programme pluriannuel 2008-2016 de création de places en établissements et services pour personnes handicapées comprend, parmi ses principaux objectifs, la réduction des listes d’attente. Pour le moment, cette mesure vise principalement les ESAT, ce qui permettrait de désengorger les IME. Mais, si le problème vous est connu, madame la secrétaire d’État, l’effectivité des solutions amorcées n’est pas encore ressentie sur nos territoires.
Je vous demande donc quelles seraient les solutions à mettre en oeuvre pour que chaque enfant, même en situation de handicap, voit son droit à l’éducation devenir effectif.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Monsieur Bleunven, vous avez raison, l’éducation est un droit fondamental poux chaque enfant, et chaque situation doit pouvoir trouver une réponse personnalisée. La politique du handicap que nous avons menée depuis 2012 va tout à fait dans ce sens, puisque nous souhaitons, comme vous, que tous les enfants en situation de handicap puissent recevoir une éducation correspondant à leurs besoins.
Je me dois de vous dire que, depuis 2012, la proportion d’enfants accueillis à l’école « ordinaire » a augmenté de 30 %, précisément en raison des efforts que nous avons déployés. De fait, tous les enfants en situation de handicap n’ont pas vocation à intégrer un IME. Certains peuvent aller à l’école dans une classe ordinaire mais dans le cadre d’un accompagnement adapté – nous avons d’ailleurs professionnalisé les accompagnants d’élèves en situation de handicap et mettons progressivement fin aux contrats précaires pour les remplacer par des contrats pérennes. D’autres peuvent être accueillis dans des classes spécialisées – plus de cent unités d’enseignement en maternelle ont été créées pour les enfants autistes – comme les unités localisées pour l’inclusion scolaire, les ULIS. D’autres encore peuvent être accompagnés dans le cadre des services d’éducation spéciale et de soins à domicile, les SESSAD – ce pourquoi nous créons des places. D’autres, enfin, devront effectivement bénéficier de places en IME.
Cela implique de créer des places, ce que nous continuons à faire – dans votre région, en Bretagne, un peu plus de cent places d’IME ont été créées depuis 2012. Par ailleurs, le déblocage de 180 millions a été annoncé par le Président de la République à la suite de la Conférence nationale du handicap qui s’est tenue au mois de mai 2016. Ces fonds sont dédiés au développement de l’offre médico-sociale : la moitié est destinée à la création de nouvelle places car, vous avez raison, les besoins demeurent dans ce domaine, et l’autre moitié vise à transformer l’offre, c’est-à-dire à trouver de nouvelles solutions. Je pense en effet qu’il est encore possible d’aller plus loin en matière d’accueil des enfants en situation de handicap à l’école ordinaire. Tel est le mouvement que nous avons enclenché en externalisant aussi des classes en IME vers les écoles.
Vous avez également rappelé avec raison la situation des adultes : certains sont toujours accueillis en IME, en vertu de que l’on appelle l’« amendement Creton ». Il faut donc continuer à créer des places pour adultes, ce que nous faisons à travers les programmes dédiés. À cet égard, les départements sont eux aussi concernés : si, dans un certain nombre d’établissements comme les foyers d’accueil médicalisés, les places pour adultes sont financées conjointement par les départements et l’assurance maladie, les places en foyer d’hébergement et en foyer de vie – ou foyers occupationnels – le sont quant à elles exclusivement par les départements.
J’ajoute qu’une démarche importante a été initiée, intitulée « une réponse accompagnée pour tous », qui consiste à trouver une solution personnalisée pour chaque personne concernée. Depuis le début du mois, 90 départements se sont engagés en ce sens. Cette démarche complètement nouvelle, qui consiste à fournir une réponse à toutes celles et ceux, enfants ou adultes, dont les besoins ne sont pas jusqu’ici satisfaits, sera obligatoire à partir du 1er janvier 2018. Il s’agit d’un véritable changement dans la politique du handicap.

Comme nous avons dépassé le temps imparti, monsieur Bleunven, je ne vous donne pas la parole à nouveau.
Je vous rappelle que nous disposons de six minutes au total pour la question et la réponse.

La parole est à M. Michel Ménard, pour exposer sa question, no 1638, relative au financement des EHPAD.

Ma question s’adresse à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes âgées et de l’autonomie mais je suppose que la secrétaire d’État présente saura y répondre. Elle porte sur la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et plus particulièrement sur les effets de la mise en place de la convergence des financements de tous les EHPAD, qu’ils relèvent du secteur public, associatif ou mutualiste, ou du secteur privé à but non lucratif.
Des élus départementaux, à l’image du président du conseil départemental de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, s’inquiètent en effet des conséquences sociales mais aussi politiques de cette mesure contenue dans le décret no 2016-1814 du 21 décembre 2016 pris dans le cadre de l’application de l’article 58 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Le conseil départemental de Loire-Atlantique tient à assurer à la population âgée une bonne qualité de prise en charge par les EHPAD et se soucie en permanence de l’accessibilité de ces établissements au plus grand nombre. Il veille aussi à ce que les personnes qui travaillent dans les EHPAD bénéficient d’une bonne protection. Ces personnels exercent des métiers essentiels, difficiles, parfois précaires ; la difficulté de leurs conditions de travail s’accroît avec l’augmentation continue de la dépendance des personnes âgées accueillies. Je tiens aussi à souligner l’inégalité qui frappe les salariés selon le type d’établissement dans lequel ils travaillent : la convention collective est moins protectrice dans les établissements à but lucratif.
Si la mesure en question devait avoir pour conséquence l’augmentation des fonds publics alloués aux EHPAD à but lucratif au détriment des financements des EHPAD publics et à but non lucratif, le risque serait grand de voir se dégrader la qualité de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD et l’accessibilité de ces établissements à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Ce risque suscite l’inquiétude, en Loire-Atlantique comme ailleurs.
Dans le contexte budgétaire que connaissent les collectivités locales, les départements seront-ils contraints de rééquilibrer leurs dotations en faveur d’établissements gérés par des entreprises qui sont souvent des multinationales, à but lucratif, et ayant des objectifs en termes de rémunération des actionnaires ? Pouvez-vous m’indiquer les mesures envisagées qui permettront de corriger ces effets ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Monsieur Ménard, je connais votre implication sur ces questions sociales. Je vous réponds à la place de Pascale Boistard, qui n’a pu être présente ce matin, et je tiens à vous rassurer : la réforme de la tarification introduite par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement poursuit précisément des objectifs d’équité, de simplification et d’amélioration de la qualité.
Le décret du 21 décembre 2016 a été évidemment élaboré en concertation avec toutes les fédérations représentatives du secteur des personnes âgées et, bien sûr, l’Assemblée des départements de France.
Le nouveau modèle de tarification proposé objective et simplifie l’allocation de ressources par la mise en place de forfaits sur les soins et la dépendance en fonction de l’état de dépendance des résidents et de leurs besoins en soins.
La loi et ses textes d’application prévoient une convergence linéaire des établissements vers les forfaits soins et dépendance issus de l’équation tarifaire sur une période transitoire de sept ans, de 2017 à 2023. Au terme de cette période, tous les établissements bénéficieront d’un forfait soins équitable – ce qui ne signifie pas qu’il sera identique pour tout le monde : il sera élaboré en fonction des besoins effectifs en soins des personnes hébergées.
Cette convergence améliorera la dotation de 85 % des établissements et permettra effectivement de renforcer l’encadrement en personnel soignant pour améliorer la qualité de la prise en charge.
Dès 2017, la mise en oeuvre de la réforme de la tarification des EHPAD mobilisera 100 millions d’euros de crédits d’assurance maladie supplémentaires. Je pense donc que vous pouvez rassurer les responsables d’établissements : de toute façon, de l’argent supplémentaire sera débloqué – en fonction, je le répète, des besoins effectifs en soins des personnes hébergées.
L’objectif est bien de ramener les établissements vers un niveau de ressources optimal, apprécié grâce aux référentiels existants – AGGIR, pour la perte d’autonomie, et PATHOS pour les soins. Ce mécanisme est conçu comme un outil d’équité dans le financement des établissements.
Ce principe de convergence de la tarification des EHPAD induit un effet de redistribution des ressources entre les EHPAD sur-dotés et ceux qui étaient sous-dotés – indépendamment de ce que vous avez souligné s’agissant des différents statuts.
La tarification des EHPAD est aujourd’hui fondée sur des outils d’évaluation des besoins des résidents validés scientifiquement. C’est cela qui importe afin d’objectiver les besoins de financement des établissements. Elle permet, en outre, de favoriser la liberté de gestion des organismes gestionnaires d’EHPAD et de développer des objectifs de qualité grâce à la rénovation de la contractualisation entre les autorités de tarification et les organismes gestionnaires dans le champ des personnes âgées.

Je remercie tout d’abord Mme la secrétaire d’État de sa réponse.
À tout le moins, l’incompréhension est patente pour un certain nombre d’acteurs. Peut-être des explications sont-elles donc nécessaires quant au sens de ce décret. Je tiens à souligner combien il est important que les établissements publics, associatifs et mutualistes puissent assurer leurs missions dans de bonnes conditions et à moindre coût car nous savons que les revenus des résidents en EHPAD sont souvent modestes.

La parole est à Mme Valérie Rabault, pour exposer sa question, no 1642, relative aux statistiques sur la prime d’activité.

Ma question porte sur la prime d’activité. Je prendrai l’exemple très concret d’un couple dans ma circonscription : monsieur perçoit 1 600 euros par mois, madame, 686 euros. Ce ménage percevait 500 euros de prime pour l’emploi – PPE – sur l’année. Je suis allée faire pour eux la simulation sur le site de la CAF – du reste très clair et très bien fait ; on arrive parfaitement à s’y retrouver.
Si ce couple était locataire, il percevrait 164 euros par mois au titre de la prime d’activité ; étant propriétaire, il ne perçoit rien du tout. Non seulement donc il perd les 500 euros de PPE dont il bénéficiait auparavant, mais il n’a pas droit à la prime d’activité qu’il aurait touchée s’il avait été locataire. Or le couple en question est certes propriétaire, mais il rembourse un crédit tous les mois ; ses charges sont donc relativement importantes.
Première question : comment est-il possible de prendre en compte le fait qu’un certain nombre de ménages sont certes propriétaires mais ont acheté à crédit, et doivent donc rembourser chaque mois une mensualité à leur banquier ?
Deuxième question, qui est liée à la première : pourriez-vous nous indiquer le nombre de ménages qui percevaient la PPE et qui ne bénéficient pas de la prime d’activité ? Serait-il possible de connaître leur répartition par département ?
Dernière question, enfin : lors de la simulation sur le site de la CAF, qu’appelle-t-on « revenus » pour un professionnel indépendant ? Des confusions peuvent en effet exister entre le chiffre d’affaires, la marge nette et le résultat net. Quelle est donc la définition précise que vous retenez ? Dans ma circonscription, j’ai rencontré des commerçants qui ont été confrontés à un certain nombre de difficultés en la matière.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Madame la députée, pour le calcul de la prime d’activité comme du revenu de solidarité active, lorsque le bénéficiaire occupe un logement dont il est propriétaire ou un logement à titre gratuit, cet avantage en nature est valorisé de manière forfaitaire. Il s’agit du « forfait logement » qui est alors déduit du calcul du montant de RSA ou de la prime d’activité. Cependant, ce dernier n’est pas appliqué aux propriétaires n’ayant pas encore remboursé la totalité de leur emprunt. Cela concerne donc le couple dont vous avez parlé.
Le simulateur de la CAF sera amélioré…
…car s’il est très bien – comme vous l’avez dit –, il peut être encore perfectionné afin d’être plus lisible et, en l’occurrence, de faire apparaître cette exonération du « forfait logement » pour les propriétaires qui n’ont pas remboursé leur emprunt. La ministre des affaires sociales, Marisol Touraine, a donc demandé que cette rubrique soit corrigée rapidement.
Je reprends donc l’exemple que vous avez cité d’un couple avec enfant dont l’allocataire perçoit 1 600 euros et sa conjointe 686 euros, qui ne dispose d’aucune autre ressource et qui rembourse encore un prêt : il a droit à 160 euros par mois de prime d’activité. Vous pourrez le lui expliquer.
Depuis le 1er janvier 2016, vous le savez, la prime d’activité a connu une montée en charge très rapide. Plus de 4 millions de foyers l’ont touchée au moins une fois mais les différences sont importantes entre les départements. En septembre 2016, ils étaient plus de 121 000 dans le Nord contre 2 800 en Lozère et 9 753 dans le Tarn-et-Garonne. Cela est lié bien sûr à la population de chaque territoire mais des analyses plus fines doivent être menées. Un rapport d’évaluation de la prime d’activité sera remis au Parlement en juin 2017. Ce bilan à dix-huit mois évaluera notamment ses effets en termes de maintien dans l’activité et de lutte contre la pauvreté.
La prime pour l’emploi était critiquée pour son manque de ciblage. En 2012, 2,9 milliards étaient versés à 6 millions de bénéficiaires, pour un montant mensuel moyen de 38 euros, ce qui était très peu. La prime d’activité a donc permis de concentrer le dispositif sur certains bénéficiaires, ce qui a pu se traduire par des pertes pour les ménages moins en difficulté qui bénéficiaient de la prime pour l’emploi. Selon les estimations de l’étude d’impact, quelques centaines de milliers de ménages ont été concernés. Vous connaîtrez le chiffre exact dans le rapport qui sera remis au Parlement.
S’agissant de votre question sur les revenus, je précise qu’il ne s’agit pas du chiffre d’affaires. Il n’en reste pas moins que de nombreuses petites questions se posent en la matière. Par exemple, quid de ceux qui perçoivent des revenus une fois tous les trois mois – c’est le cas, par exemple, pour les droits d’auteur ? Certains mois, les revenus déclarés sont nuls, d’autres, ils triplent. Il importe de signaler toutes ces situations au ministère des affaires sociales qui, ainsi, parachèvera les ajustements auxquels il est en train de procéder.

Je vous remercie infiniment, madame la secrétaire d’État. Le simulateur de la CAF est très bien fait mais je constate avec plaisir la réactivité des équipes et le fait que l’outil évolue en fonction des questions qui peuvent se poser.
Je vous remercie pour vos propos concernant les propriétaires qui doivent encore rembourser des mensualités et qui ne sont donc pas complètement propriétaires. Les personnes que j’ai évoquées trouveront donc une solution.

La parole est à M. Christian Franqueville, pour exposer sa question, no 1646, relative aux services médicaux dans l’Ouest vosgien.

Je souhaite solliciter Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la révision du périmètre géographique des zones déficitaires en offre de soins, dont je sais qu’elle est actuellement en discussion au niveau national.
L’Ouest vosgien a connu une année 2016 très difficile et inquiétante pour la population. Quatre praticiens ont en effet arrêté leur activité ou ont changé de secteur, dont trois dans le secteur de Liffol-le-Grand. Au total, ce sont une dizaine de médecins qui sont partis depuis 2015. De plus, dans les deux années à venir, de nouvelles cessations d’activité sont attendues. Force est donc de constater que notre territoire est, pour reprendre un terme médical, véritablement « carencé ».
Cette insuffisance de praticiens, au regard d’un bassin de vie de 35 000 habitants qui s’étale sur trois départements, met le secteur de Neufchâteau, Châtenois et Liffol-le-Grand dans l’urgence d’une reconnaissance, par l’État, d’un statut de zone rurale très déficitaire. Il n’est en effet pas tolérable, pour mes concitoyens de ce bassin de vie, de constater que des villes, voire des régions entières, sont saturées de services médicaux, quand le leur en est cruellement dépourvu ; au surplus, ce manque de praticiens est l’une des raisons soulevées par les services de l’État pour surseoir à statuer sur l’opportunité de créer une maison médicale dans ce même secteur géographique.
Or, comme vous le savez, attirer et faire venir un praticien est aujourd’hui devenu, pour les communes rurales, un vrai parcours du combattant, malgré toute les bonnes volontés et le dynamisme des élus. On ne peut donc accepter une telle réticence des services de l’État, alors même que le projet de maison médicale vise à enrayer le déclin et la désertification médicale en zone rurale et à faciliter la venue de praticiens.
Je sais, madame la secrétaire d’État, que nous partageons la même vision de la politique d’aménagement du territoire en matière de santé, celle d’une politique qui assure une répartition équitable des services publics et garantisse l’accès aux soins à l’ensemble de nos concitoyens où qu’ils habitent, en milieu rural comme en ville.
C’est pourquoi je vous demande de considérer la situation particulière de l’Ouest vosgien, en incluant notre territoire dans le zonage médical déficitaire. Ce signal fort de l’État rassurera nos concitoyens, qui me font part de leur inquiétude et de leur sentiment d’isolement. Pourriez-vous également m’indiquer le calendrier associé à la révision de ces zones médicales déficitaires, notamment sa date d’entrée en application ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, tient à saluer, monsieur le député, votre engagement au quotidien sur les questions relatives à la santé de vos concitoyens et à la qualité de l’offre de soins dans votre département des Vosges, qu’il s’agisse de la situation des différents hôpitaux ou du nombre de médecins en activité.
Je veux d’abord rappeler les effets du pacte territoire-santé, lancé en 2012 dans votre département des Vosges : même si la densité médicale y est effectivement moins élevée que la moyenne française, un véritable maillage territorial de maisons de santé s’y est créé. À l’échelle de votre département, ce sont ainsi dix-sept structures pluri-professionnelles qui accueillent au quotidien la population. Deux nouvelles maisons de santé devraient voir le jour en 2017.
Nous pouvons nous réjouir de ce que, grâce au contrat de patricien territorial de médecine générale, mis en place par Marisol Touraine, six médecins se soient installés en zone sous-dense. Vous avez raison de rappeler l’importance de cibler et d’orienter les aides à l’installation vers les bassins de vie les plus en difficulté, afin que ceux-ci deviennent des zones prioritaires. C’est tout l’objet de ce que l’on l’appelle le zonage, lequel consiste à identifier les zones sous-dotées ou sous-denses en termes d’offre de soins.
Dans le courant du mois de février débutera, dans chaque région, une grande concertation avec les acteurs de terrain concernés pour réviser la carte des zones sous-dotées. Une fois le travail de concertation achevé, un arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé permettra aux nouveaux territoires identifiés comme prioritaires de bénéficier immédiatement des aides à l’installation.
S’agissant enfin de la situation très spécifique de Liffol-le-Grand et du projet de maison de santé, je puis vous assurer que le dossier sera accompagné avec une attention toute particulière, notamment pour soutenir l’indispensable investissement du corps médical. Je vous garantis en particulier, monsieur le député, un accompagnement actif de la délégation départementale des Vosges de l’agence régionale de santé au côté des professionnels de santé de terrain, des personnels hospitaliers, des patients bien sûr et de l’ensemble des élus du territoire.

Merci de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Nous savons que l’ARS effectue un travail de fond avec les élus locaux, la sous-préfecture et les parlementaires. Ce travail de fond trouvera, au vu de votre réponse, un écho favorable dans l’analyse et les choix qui seront faits pour le zonage, lequel, à mon sens, doit prendre en compte l’Ouest vosgien, particulièrement déficitaire.

La parole est à Mme Véronique Louwagie, pour exposer sa question, no 1623, relative au service de chirurgie ambulatoire de L’Aigle.

Ma question, qui s’adresse à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, concerne l’avenir du service de chirurgie ambulatoire du centre hospitalier de L’Aigle, dans l’Orne.
Comme je l’ai indiqué aux services ministériels, et rappelé par ma lettre datée du 26 septembre 2016, la nécessité de maintenir une activité de chirurgie de proximité est en effet fondamentale, eu égard aux besoins du territoire et de ses habitants. Les autorisations d’activité de chirurgie ambulatoire délivrées, pour le territoire de santé de l’Orne, au titre du projet régional de santé de Basse-Normandie et de sa déclinaison par le schéma régional d’organisation des soins pour la période 2013-2017, ont toutes été attribuées. Néanmoins, l’ARS a engagé une procédure de révision de ce projet régional et de sa déclinaison par le schéma régional, et il est fondamental qu’une avancée positive intervienne dans les premiers mois de 2017.
L’hôpital de L’Aigle a intégré le groupement hospitalier de territoire – GHT – Val de Seine et plateaux de l’Eure, aux côtés notamment des centres hospitaliers de proximité d’Évreux et de Verneuil, ce qui confortera indéniablement son rôle d’établissement de proximité. Les équipes, les élus et la population sont motivés par le désir de réussir. La création du projet d’établissement, dans lequel tous les acteurs et agents vont investir – avec, pour leitmotiv, l’idée que le patient est au milieu de ces relations – doit aussi constituer un élément déterminant.
Si les réorganisations internes et l’arrêt de la chirurgie ambulatoire ont pesé sur l’état des finances de l’établissement, il paraît donc aujourd’hui indispensable que l’autorisation de pratiquer la chirurgie ambulatoire lui soit effectivement délivrée très rapidement. Envisagez-vous de soutenir cette position, et d’aider à la remise en place de la chirurgie ambulatoire dans le centre hospitalier de L’Aigle dès les premiers mois de 2017 ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Le centre hospitalier de L’Aigle, madame la députée, déploie un ensemble d’activités de médecine, d’obstétrique, de soins de suite et de services à destination des personnes âgées. Il est également autorisé à pratiquer la chirurgie, mais uniquement pour des séjours en hospitalisation complète.
Les difficultés rencontrées par l’établissement ont conduit Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, à installer une administration provisoire à la fin de 2015, en étroite concertation avec vous. Le rapport de fin de mission établi par l’administrateur provisoire émet un certain nombre de propositions. Celles-ci ont vocation à permettre à l’établissement de jouer son rôle d’établissement de santé de proximité, capable de répondre aux besoins de santé de la population, en proximité et, bien sûr, dans le respect des standards de sécurité et de qualité opposables à tous les établissements.
Parmi ces propositions figure l’opportunité d’autoriser la création d’une unité de chirurgie ambulatoire au sein du centre hospitalier de L’Aigle. Les services de l’agence régionale de santé se sont engagés à étudier, avec l’établissement, ce projet dont l’intérêt est indiscutable et la finalité pleinement partagée par tous. Les conditions de mise en oeuvre seront étudiées dans les prochaines semaines entre l’établissement et l’ARS, de façon qu’ils définissent ensemble les étapes préparatoires à franchir rapidement.
Ce projet figurera dans la lettre de mission rédigée par la directrice générale de l’ARS au nouveau directeur installé depuis peu. Plus généralement, cet établissement en grande difficulté doit être en mesure de porter une véritable ambition autour d’un projet d’établissement réaliste et de s’inscrire dans des coopérations étroites avec d’autres, afin que l’ensemble de la population du bassin de vie concerné bénéficie d’une offre de services de qualité.
Nous serons attentifs, madame la députée, à la trajectoire de redressement financier que doit prendre le centre hospitalier, et continuerons à accompagner celui-ci dans des projets indispensables au maintien de l’attractivité de l’établissement comme dans les activités destinées aux personnes âgées.

Merci de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Je remercie également Mme la ministre des affaires sociales et de la santé d’avoir mis en place cette administration provisoire, qui a changé la donne en portant un oeil extérieur sur l’établissement.
Je me réjouis aussi du calendrier, puisque vous avez parlé de quelques semaines. Je resterai bien entendu attentive à ce qui sera fait, et irai dans votre sens en rappelant que tous les acteurs du centre hospitalier de L’Aigle sont très intéressés par le projet d’établissement qui, j’en suis d’accord avec vous, doit se concrétiser.
Vous avez également évoqué la coopération avec les centres hospitaliers du territoire. Des partenariats et des coopérations étroites doivent en effet être noués. Il convient toutefois de rester vigilant, à mon sens, sur leur réciprocité car, dans le cadre d’un vrai partenariat, chacun doit s’y retrouver.
La chirurgie ambulatoire est une activité importante pour un centre hospitalier tel que celui de L’Aigle, qui se trouve à cinquante-sept minutes du centre hospitalier le plus proche. À l’heure où Mme la ministre de la santé fait la promotion de la chirurgie ambulatoire, ce à quoi je souscris, il me paraît donc essentiel d’oeuvrer en ce sens pour le centre hospitalier de L’Aigle et, surtout, pour les habitants du territoire concerné.

La parole est à M. Édouard Courtial, pour exposer sa question, no 1626, relative à l’hôpital de Clermont.

Madame la secrétaire d’État, 12 février 2015, 26 mars 2015, 8 décembre 2015, 26 avril 2016, 31 janvier 2017 : ces dates ont toutes en commun de voir la même pièce se rejouer, moi défendant l’offre de soins dans l’Oise et vous m’expliquant, au mépris des réalités, que tout va bien dans le meilleur des mondes.
Je prendrai deux exemples que vous et moi connaissons bien désormais, à commencer par celui de l’hôpital de Clermont. Si l’ARS a finalement entendu raison en renouvelant l’autorisation du plateau de chirurgie, des incertitudes demeurent quant aux urgences. Votre collègue Laurence Rossignol, alors en campagne pour les régionales, en octobre 2015, avait annoncé le déblocage de 7 millions d’euros pour leur reconstruction ; quinze mois plus tard, la chose est effective dans la presse mais pas à Clermont, où les personnels dévoués ne voient concrètement rien venir, à l’exception d’une aide exceptionnelle de 2,5 millions d’euros provisionnée à la fin de l’année dernière.
Quant à la maternité, vous l’avez condamnée faute d’un nombre de naissances suffisant – suivant en cela une logique purement comptable –, comme l’a confirmé la direction auprès des sages-femmes il y a quelques jours. En laissant les rumeurs de fermeture prendre de l’ampleur, vous avez accéléré le processus ; et, à quelques mois des élections, vous vous gardez bien de rendre cette annonce publique. Mais personne n’est dupe de la manoeuvre, grossière, qui abîme la fonction qui est la vôtre. Cette façon de faire indigne illustre bien le manque de transparence qui caractérise votre politique et le respect que vous portez aux soignants comme aux patients.
Quant à l’hôpital Paul Doumer, où je me suis rendu en novembre dernier, si un transfert de la gestion de l’AP-HP – Assistance publique-Hôpitaux de Paris – vers l’ARS des Hauts-de-France est envisagé depuis un certain temps, la disparition programmée des quarante places en EHPAD – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes –, occupées dans une très large majorité par des Oisiens, n’est pas sans appeler de votre part des réponses précises quant à leur réaffectation dans d’autres établissements.
Le département de l’Oise, que j’ai l’honneur de présider, a pris ses responsabilités en apportant son concours à la transformation de trente places en EHPAD en places au sein du centre hospitalier de Clermont ; mais ces places ne suffiront pas, à elles seules, à répondre à la demande croissante.
Vous l’aurez compris, au crépuscule de votre gouvernement, l’offre de soins dans le centre de l’Oise reste très largement préoccupante. Ma question est donc simple : pouvez-vous nous donner des perspectives précises et concrètes concernant ces deux établissements ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
La réponse du Gouvernement, monsieur le député, ne sera pas différente de celles qui vous ont été précédemment apportées, ce en quoi je crains de vous décevoir.
S’agissant du centre hospitalier de Clermont de l’Oise, le constat est clair, il n’a pas changé et il est d’ailleurs unanimement partagé par les acteurs depuis le début. Vous le savez vous-même, cet établissement connaît, depuis plusieurs années, des difficultés liées à l’évolution de son activité et à sa situation financière, et le plan de redressement en cours est indispensable pour assurer son avenir.
La pérennité du centre hospitalier de Clermont passe par des coopérations médicales territoriales étroites avec le centre hospitalier de Beauvais, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, défini en juillet dernier : ainsi, l’un des axes du projet médical partagé consiste actuellement à développer la chirurgie ambulatoire à Clermont de l’Oise. C’est aussi dans ce cadre que les activités de gynécologie obstétrique et de chirurgie doivent s’envisager, afin d’instaurer un cadre de qualité et de sécurité des soins indispensable pour les habitants de ce territoire.
Désireuse d’accompagner l’établissement dans une dynamique positive, malgré une situation financière très délicate, la ministre des affaires sociales et de la santé avait annoncé une aide de 7 millions d’euros pour rénover le service des urgences et le plateau technique de l’hôpital de Clermont. L’établissement réfléchit actuellement à différents scénarios, qui, à terme, permettront d’offrir aux patients et au personnel de meilleures conditions d’accueil et de travail. C’est dans ce cadre concret que le Gouvernement tiendra ses engagements pour Clermont de l’Oise.
Permettez-moi, monsieur le député, de vous rappeler que le Gouvernement tient également ses engagements pour le second hôpital de Clermont : le projet d’investissement élaboré par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont, pour un montant de 81,5 millions d’euros, est aussi l’une de nos priorités. Le dossier de réhabilitation a définitivement été validé en fin d’année dernière, avec une aide nationale significative de 20,6 millions d’euros. Ce soutien important permettra d’offrir des conditions d’accueil favorables aux patients du département de l’Oise, non seulement en rénovant toute la structure hospitalière, mais également en redéfinissant le projet médical de l’établissement, afin d’adapter l’offre de soins à la réalité des besoins des patients, tout en améliorant les conditions de travail des personnels.
En outre, monsieur le député, je vous invite à vous pencher sur le programme de votre candidat à l’élection présidentielle, lequel a dit, mot pour mot, qu’il fallait fermer certains hôpitaux locaux.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, pour votre réponse. Vous n’aviez en effet pas menti en annonçant que la réponse que vous apporteriez serait du même ordre que celles données lors de mes multiples interpellations dans cette enceinte sur ce même sujet, s’agissant notamment de l’avenir de la maternité de Clermont. Vous ne répondez cependant pas à la question : comptez-vous fermer cet établissement ? Pour le savoir, j’aimerais vous donner rendez-vous une sixième fois, dans quelques mois, mais ce serait là, je n’en doute pas, un pari audacieux sur l’avenir.

La parole est à M. Arnaud Viala, pour exposer sa question, no 1629, relative au statut des orthophonistes.

Je souhaite à mon tour – puisque de très nombreux députés l’ont fait en vain – interroger le Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les orthophonistes.
Comme vous le savez, les orthophonistes possèdent des compétences spécifiques, en tant que professionnels de santé, dans le champ des pathologies de la communication. Or cette profession manque aujourd’hui cruellement de reconnaissance. Au terme d’un très long combat ayant débouché sur l’harmonisation des études dans les centres de formation en France, les orthophonistes sont dorénavant diplômés après cinq années d’études. Pourtant, leur grille salariale n’a toujours pas été révisée, alors que la réforme a été annoncée voici plus de trois ans. Les salaires des orthophonistes ne sont en aucun cas représentatifs des niveaux d’études et de compétence requis pour exercer cette profession. Ceux-ci se voient ainsi fréquemment contraints d’exercer en libéral alors que, trop peu nombreux, ils ne parviennent pas à assumer les charges qui leur incombent.
La profession d’orthophoniste souffre donc d’un manque de personnel : les postes dans les hôpitaux sont pour la plupart vacants, alors que la demande ne cesse de croître, non seulement pour les jeunes patients, mais aussi pour les nombreuses victimes d’accidents de tout genre, et pour nos aînés. Cette pénurie est extrêmement préjudiciable à la formation des jeunes praticiens car ceux-ci ne trouvent plus de cabinet d’orthophonie où effectuer un stage, pourtant nécessaire pour parfaire leur cursus et obtenir leur diplôme.
Qu’en est-il du décret concernant les règles professionnelles des orthophonistes ? Quid du décret d’application de la prescription, par les orthophonistes, de dispositifs médicaux ? Pourquoi les orthophonistes seraient-ils exclus du champ de la prescription des substituts nicotiniques ? Qu’est-ce qui justifie que la maîtrise de la langue française n’apparaisse plus comme une compétence reconnue aux orthophonistes dans l’ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé ? De nombreuses questions restent en suspens à l’heure actuelle.
De plus, madame la secrétaire d’État, je vous demande une nouvelle fois quand doit intervenir la révision de la grille salariale, afin de rendre de nouveau cette profession attractive.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Monsieur le député, garantir la prise en charge des patients qui justifient d’une rééducation orthophonique est une nécessité. C’est pourquoi le Gouvernement a lancé, dès 2016, un plan d’action pour renforcer l’attractivité de l’exercice hospitalier pour l’ensemble de la filière rééducation. Ce plan concerne non seulement les orthophonistes mais aussi les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes et les pédicures-podologues.
En effet, nous le savons, de nombreux établissements rencontrent des difficultés pour recruter des personnels de rééducation, pourtant essentiels à la qualité de la prise en charge des patients hospitalisés. C’est pourquoi Marisol Touraine a décidé d’octroyer une prime de 9 000 euros aux orthophonistes qui décideraient de s’engager pour trois ans sur des postes que les projets de soins partagés définissent comme prioritaires au sein des groupements hospitaliers de territoire.
Nous savons aussi que, parmi les orthophonistes, de nombreux professionnels souhaitent diversifier leur exercice, tant en termes de pathologies traitées que de modes de rémunération – salariés ou rémunérés à l’acte. La ministre a donc décidé d’autoriser l’exercice à temps non complet au sein de la fonction publique hospitalière, afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’avoir une activité mixte, libérale et salariée.
S’agissant de la rémunération des fonctionnaires, je vous rappelle que, pour la première fois depuis 2010, le Gouvernement a décidé d’augmenter la valeur du point d’indice de 1,2 %. Le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations, engagé en septembre 2015, permettra une évolution indiciaire de tous les corps de la fonction publique, échelonnée de 2016 à 2022.
Des mesures de reclassement indiciaire spécifiques pour la filière rééducation ont été décidées : la nouvelle grille indiciaire des orthophonistes, notamment, aboutira à une augmentation salariale moyenne de 17 %, échelonnée de 2017 à 2019. Cette revalorisation spécifique, complémentaire des mesures générales prises pour la fonction publique, apportera aux orthophonistes un gain allant de 2 675 à 4 500 euros bruts par an, selon l’ancienneté.
Tels sont, monsieur le député, les revalorisations salariales et le calendrier définis par le Gouvernement.

Madame la secrétaire d’État, votre réponse ne correspond pas exactement aux termes et à l’objet précis de ma question. Pour ce qui concerne la revalorisation salariale, vous savez qu’aujourd’hui le salaire d’un orthophoniste fonctionnaire est à peine supérieur au SMIC. L’urgence est donc criante.
De plus, point très préjudiciable du point de vue de ces professionnels, les orthophonistes demandent depuis juin 2016, par la voie de leur fédération nationale, à rencontrer Mme la ministre des affaires sociales et de la santé. Or celle-ci n’a daigné ni les recevoir ni répondre à leur demande d’audience. Il serait de bon aloi – je me permets de vous le dire, madame la secrétaire d’État – que Mme la ministre accepte de recevoir les représentants de cette fédération, afin d’entamer un échange constructif avec les orthophonistes.

La parole est à Mme Dominique Orliac, pour exposer sa question, no 1632, relative à la maison d’accueil spécialisée « Le Chemin d’Éole ».

Les patients atteints de la chorée de Huntington, maladie neurodégénérative, bénéficient avec la maison d’accueil spécialisée « Le Chemin d’Éole », située sur la commune de Castelnau-Montratier, d’un lieu spécifique d’accompagnement dans le département du Lot.
Cette MAS, gérée par l’Institut Camille Miret et élaborée en étroite collaboration avec l’association Huntington France, fut la première unité française dédiée à la prise en charge des patients atteints de cette maladie. Depuis son ouverture en août 2010, la demande de prise en charge est croissante et, faute de places suffisantes, cette unité se trouve dans l’impossibilité de pouvoir répondre à la plupart des demandes d’accueil, entraînant ainsi les patients et leurs proches dans une situation de grande détresse.
En 2016, sur quatorze personnes examinées, huit ont été jugées admissibles et aucune d’entre elles n’a pu être admise du fait d’un manque cruel de place. De même, en 2015, sur quatorze personnes jugées admissibles, trois seulement avaient été admises. Face à cette problématique sanitaire, l’Institut Camille Miret a élaboré un projet d’extension de la MAS visant à créer dix places supplémentaires au sein de l’unité. Ce projet, soutenu par l’agence régionale de santé, permettrait de répondre au mieux aux besoins de la population. Cependant, comme tout projet, cette extension a un coût, que l’Institut Camille Miret ne peut supporter seul, d’autant qu’il serait indispensable de prévoir, au niveau national, un tarif majoré pour les MAS accueillant les patients atteints de cette maladie, dont la prise en charge est lourde et nécessite un suivi vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
La ministre des affaires sociales et de la santé entend-elle apporter son soutien à ce projet, qui revêt un caractère de nécessité pour les malades, et réfléchir à un tarif majoré pour la prise en charge de patients atteints d’une pathologie lourde nécessitant un suivi continu ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Madame la députée, vous avez raison de rappeler que la chorée de Huntington fait partie des maladies rares, qui conduit à la reconnaissance d’une situation de handicap rare. Le deuxième plan maladies rares a permis de mettre en place une organisation nationale très structurée, constituée par les centres de référence maladies rares et par les vingt-trois filières de santé maladies rares.
Dès que la pathologie entraîne un handicap rare, ces filières collaborent avec les dispositifs déployés dans le cadre du second schéma national pour les handicaps rares 2014-2018, notamment avec les douze équipes relais handicaps rares, afin de mieux évaluer les besoins des patients et construire des réponses adaptées à ces situations.
Dans le cadre de ce schéma, de nouvelles places en maisons d’accueil spécialisées ont été créées ou sont en cours de création. La demande d’extension de la maison d’accueil spécialisée « Le Chemin d’Éole », gérée par l’Institut Camille Miret s’inscrit dans ce cadre. Néanmoins, au terme de son arbitrage, l’interrégion a préféré aux deux projets d’extension présentés par l’Institut dans le cadre d’appels à projets deux autres propositions – l’une dans le Limousin, l’autre en Aquitaine.
La MAS « Le Chemin d’Éole » souhaite aujourd’hui modifier son projet d’extension dans le cadre des négociations du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, qui sont en cours. L’Agence régionale de santé de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée examinera attentivement ces demandes.
Par ailleurs, madame la députée, vous avez raison de souligner que les tarifs des établissements peuvent être très variables, et qu’ils ne sont pas nécessairement corrélés avec l’importance du besoin en soins des patients, ni avec la surveillance nécessaire. C’est la raison pour laquelle, depuis janvier 2015, le projet de réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap, SERAFIN PH, vise à mettre en place une tarification des structures intervenant auprès de personnes en situation de handicap, selon des modalités renouvelées.
Cette démarche, qui doit aboutir en 2018, devrait permettre une meilleure adéquation entre la tarification des structures et les besoins réels de prise en charge et d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Je souhaite, comme vous, madame la députée, que la tarification des maisons d’accueil spécialisées soit davantage en adéquation avec les prestations réellement délivrées aux patients, notamment à ceux atteints de handicaps très lourds, tel celui résultant de la chorée de Huntington. Aussi, madame la députée, j’estime votre remarque sur ce sujet totalement justifiée.

J’espère que votre réponse, madame la secrétaire d’État, sera suivie d’effets un peu plus positifs que celle que aviez apportée à une autre question, que je vous avais posée il y a quelque temps, relative à l’hôpital de Gourdon. Pour mémoire, celui-ci avait été, de manière très curieuse, privé des financements versés aux hôpitaux isolés. Vous aviez répondu que cet établissement pourrait bénéficier d’une dotation en tant qu’hôpital de proximité. Or cela est impossible, puisque l’hôpital de Gourdon dispose d’un service de chirurgie ambulatoire, ce qui l’exclut de cette catégorie d’établissement.
Il serait décevant qu’il en aille de même de la réponse que vous venez de me donner. Du reste, Mme la ministre des affaires sociales et de la santé n’a donné suite à aucun des courriers concernant l’hôpital de Gourdon que j’ai pu lui adresser.

La parole est à Mme Michèle Bonneton, pour exposer sa question, no 1649, relative aux hôpitaux et à l’offre de soins en milieu rural.

Dans de nombreux secteurs ruraux, la question de l’accès aux soins et de la présence médicale est plus que jamais problématique. Nos concitoyens qui vivent en zone rurale ou de montagne subissent chaque jour les conséquences d’une fracture sanitaire qui semble se creuser toujours plus : plusieurs jours d’attente sont nécessaires pour obtenir un rendez-vous chez le généraliste, même en cas d’urgence ; le délai d’attente s’élève même à plusieurs mois pour obtenir une consultation chez certains spécialistes.
Les médecins généralistes n’acceptant parfois plus de nouveaux patients, certains Français sont dans l’impossibilité d’obtenir un médecin référent. Il en découle que les services d’urgence des hôpitaux de proximité sont souvent saturés. Le sentiment d’inégalité dans l’accès aux soins se renforce. Malgré la mise en place de mesures incitatives, la situation a plutôt tendance à se dégrader.
En Isère, dans ma circonscription, la commune de Pont-en-Royans a récemment perdu son dernier médecin et ne lui trouve pas de remplaçant, malgré de nombreux efforts. Les élus locaux engagent des actions volontaristes, telles que les maisons de santé. S’il convient évidemment d’accompagner leur création, elles ne suffiront pas à résoudre le problème. Ainsi, dans la maison de santé en construction à Saint-Marcellin, aucun nouveau médecin n’est prévu, faute de candidats. De plus, son rayon d’action, qui ne serait que de 15 kilomètres, serait loin de couvrir les besoins. Il apparaît donc que les mesures actuelles ne suffiront pas à résoudre durablement le problème de l’accès aux soins.
Quelles nouvelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour garantir l’accès à des soins de qualité à tout citoyen, quel que soit son lieu habitation ?
De plus, les hôpitaux locaux sont actuellement soumis à des contraintes financières et organisationnelles, notamment du fait de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, qui pourraient remettre en cause leur vocation et compromettre le maintien de capacités suffisamment larges d’hospitalisation de proximité et de qualité – je pense, par exemple, à l’hôpital de Voiron. Comment conforter ces établissements et garantir la présence d’une offre de soins de qualité au plus près de la population, sur l’ensemble du territoire ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Madame la députée, vous interrogez la ministre des affaires sociales et de la santé quant aux mesures mises en place pour favoriser l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Les deux minutes qui me sont imparties pour vous répondre ne me permettront pas d’être exhaustive, mais je veux vous citer quelques exemples très concrets de notre action.
D’abord, l’instauration de rémunération d’équipe permet aux maisons de santé pluriprofessionnelles de se développer. L’Isère en compte désormais dix-huit et deux nouvelles devraient voir le jour très prochainement. Notre territoire dispose désormais de plus de 800 maisons de santé pluriprofessionnelles et leur nombre a plus que triplé depuis 2012.
Puis viennent les vingt-huit médecins correspondants du SAMU de votre département, qui permettent aux patients d’accéder à des soins d’urgence en moins de trente minutes, comme s’y était engagé le Président de la République en 2012.
Je pourrais également vous citer les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale que les jeunes médecins signent et qui leur garantissent des revenus minimums en échange de leur installation dans une zone prioritaire : trente-six contrats ont été signés dans l’Isère.
Vous évoquez la situation particulière des zones de montagne. Là aussi nous avons agi, puisqu’il existe désormais un statut de praticien isolé à activité saisonnière, qui cible les médecins de montagne exerçant dans les stations de sports d’hiver. Il leur permet de faire face à des fluctuations d’activité et de bénéficier pendant six ans d’une rémunération complémentaire.
Tous ces efforts seront rapidement renforcés par deux mesures récentes : l’assouplissement du statut d’adjoint du médecin, afin de permettre à un jeune remplaçant d’exercer en même temps que le médecin remplacé, et le contrat de praticien territorial médical de remplacement, qui garantira un pool de médecins remplaçants à destination des zones sous-denses.
Pour résoudre les problématiques d’accès aux soins, il n’y a pas une mesure miracle. Nous sommes convaincus que nous devons prendre des mesures pragmatiques et diverses, allant de la formation aux conditions d’installation.
Quant aux hôpitaux locaux, Marisol Touraine, dès son arrivée aux responsabilités, a souhaité prendre des mesures spécifiques de tarification complémentaire pour les hôpitaux locaux qui manquent d’activité. Ces mesures, votées par le Parlement, ont permis de maintenir de dizaines d’hôpitaux locaux sur l’ensemble du territoire.
Je me permets, pour finir, de vous alerter, madame la députée, sur les intentions d’un des candidats à la présidentielle, qui propose de fermer purement et simplement un certain nombre d’hôpitaux locaux dont le maintien ne lui semble pas indispensable. Or je peux vous assurer que, là où un hôpital a été fermé, les médecins s’installent encore moins volontiers, ce qui aggrave la désertification médicale. C’est pourquoi nous avons soutenu les hôpitaux locaux tout au long du quinquennat.

Merci pour votre réponse, madame la secrétaire d’État. C’est vrai, des mesures ont été prises, mais je suis sur le terrain et je voulais appeler votre attention sur leur insuffisance. Ainsi, le critère retenu de trente minutes pour accéder à des soins d’urgence est purement théorique puisqu’il ne tient compte ni du relief, ni des aléas climatiques, ni des embouteillages.
Par ailleurs, je connais bien des élus qui essaient de trouver des médecins, pas seulement à Pont-en-Royans, mais aussi à Saint-Antoine, pour ne citer que ces deux villes. Si l’ARS dispose d’outils pour faciliter leur installation, elle ne propose pas de candidats. Il n’est pas possible de travailler en concertation avec le Conseil de l’ordre, lequel propose d’ailleurs peu de solutions. Les médecins étrangers qui pourraient s’installer sont souvent confrontés à des difficultés administratives.
Quant aux hôpitaux de proximité, celui de Voiron, que j’évoquais précédemment, est soumis à une contrainte financière telle que les conditions de travail pourraient se dégrader et décourager des médecins spécialisés de s’installer. Certains services pourraient en souffrir, voire fermer, comme ceux chargés de la stérilisation ou encore les laboratoires d’analyses médicales.
Nous sommes bien conscients des efforts consentis mais ils n’ont pas suffi à améliorer la situation sur le terrain.

La parole est à Mme Valérie Corre, pour exposer sa question, no 1645, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Ma question, qui s’adresse à Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes, concerne les suites des sévères inondations qui ont touché le Loiret au mois de juin dernier et ont nécessité que soit déclaré l’état de catastrophe naturelle pour plus de 80 % des communes du département.
De nombreuses communes de ma circonscription, situées sur le canal du Loiret qui a débordé, ont été atteintes. Je citerai Chécy et Fay-aux-Loges, particulièrement touchées.
Les conséquences de ces intempéries ont été immédiates : déplacements déconseillés, routes coupées, écoles fermées et, surtout, maisons sinistrées, ce qui a imposé de reloger de nombreux habitants. Aujourd’hui encore, beaucoup de familles n’ont toujours pas regagné leur domicile.
À la suite de ces événements douloureux, j’ai rencontré de nombreux sinistrés qui, en plus de devoir gérer leur quotidien bouleversé, ont rencontré – et rencontrent encore pour certains – de multiples difficultés avec leurs assurances.
Aussi, je me fais leur porte-parole en interrogeant le Gouvernement sur les évolutions nécessaires de la loi relative aux catastrophes naturelles, sur le code des assurances et sur les experts des assurances.
Comme je vous le disais, de nombreuses personnes ont dû être relogées, ce qui entraîne de nombreux frais. Or la garantie légale en cas de catastrophe naturelle n’inclut pas obligatoirement la prise en charge de ces frais. Le Gouvernement accepterait-il de faire évoluer la loi qui régit les catastrophes naturelles afin de rendre obligatoire la prise en charge des frais de relogement ?
Le code des assurances impose à l’assuré de déclarer tout sinistre au plus tard dans les dix jours suivant l’arrêté ministériel de catastrophe naturelle, ce qui est très court. Peut-on envisager de prolonger ce délai de dix à trente jours comme le propose le livre blanc de la Fédération française de l’assurance ?
J’en viens aux experts des assurances. Tiers indispensable dans le traitement des sinistres, cette profession n’est régie par aucun texte, condition de diplôme ou de formation. De plus, aucun délai n’étant défini pour le retour de l’expertise, les dossiers traînent parfois en longueur. Il me semble donc nécessaire de mieux encadrer l’exercice de cette profession. Quelles sont les intentions du Gouvernement ?
Ma dernière question concerne la franchise légale qui reste à la charge de tous les assurés – quelle que soit leur situation financière –, y compris les entreprises. Elle s’élève à près de 400 euros pour les biens à usage d’habitation et à usage non professionnel. Quant aux biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % des dommages matériels directs, avec un minimum de 1 140 euros. Ne peut-on pas, là encore, envisager une évolution ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Madame la députée, attachée à l’accompagnement dans la durée de toutes les victimes, Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes s’est rendue dès le 2 juin, et à plusieurs reprises depuis, dans les départements touchés par les inondations du printemps 2016. Elle a également réuni en plusieurs occasions les assureurs.
Le 4 novembre 2016, la secrétaire d’État et le président de la Fédération française de l’assurance ont signé une convention relative à la coordination entre les services de l’État et la FFA pour l’indemnisation des sinistrés d’événements climatiques majeurs. Une telle convention est une première en France. Son objectif est notamment de garantir la remontée d’informations du terrain afin d’identifier rapidement les difficultés rencontrées par les sinistrés et faciliter leur règlement.
Cette convention précise également que, en cas d’événement climatique majeur, la FFA désigne, dans chaque département, des représentants qui participent aux cellules de crise mises en place par les préfectures. La FFA s’est également engagée à obtenir des assureurs, dans les plus brefs délais, une réponse aux difficultés rencontrées par les sinistrés et à mettre en place une cellule dédiée qui permette d’échanger autour des problématiques rencontrées afin de dégager des solutions.
S’agissant des experts, la convention prévoit que les fédérations d’experts en assurance devront veiller à renforcer leur formation afin d’adapter leurs relations particulières avec les sinistrés aux circonstances particulières que sont les événements climatiques majeurs.
S’agissant des frais de relogement, ils ne sont effectivement pas couverts par la garantie obligatoire pour les cas de catastrophe naturelle. Néanmoins, le Fonds d’aide au relogement d’urgence finance le relogement des personnes fortement sinistrées pendant une durée maximum de six mois.
Concernant les délais de déclaration, les assureurs se sont engagés, lors de la réunion qui s’est tenue le 6 juin 2016, à accepter des déclarations de sinistres jusqu’au 30 juin.
Au sujet de la franchise légale qui reste à la charge de tous les assurés, une réflexion est en cours.
D’une manière plus générale, un travail est engagé autour du régime de catastrophe naturelle. La secrétaire d’État a consulté en ce sens les assureurs, les réassureurs, les experts des assurances et les assurés. Ce travail devra être poursuivi et approfondi avec les ministères concernés. Compte tenu de votre engagement en faveur des victimes, madame la députée, vous ne manquerez pas d’y être associée.

Merci pour votre réponse, monsieur le secrétaire d’État. Je connais l’implication de Mme la secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes et je salue l’avancée que représente la signature d’une convention avec la Fédération française de l’assurance.
Je souhaitais appeler votre attention sur la nécessité de faire évoluer la loi relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Nous nous retrouvons dans des situations difficiles à chaque catastrophe naturelle, soumis au bon vouloir des assureurs. Si la loi avait évolué, nous pourrions gérer l’urgence de manière plus sereine.
Au-delà de la volonté des assureurs de renforcer la formation des experts, nous insistons sur l’importance de la formation professionnelle, d’une qualification reconnue par tous. Beaucoup de soucis rencontrés par nos concitoyens viennent d’un manque de qualification et d’expérience des experts appelés au moment des catastrophes.

La parole est à M. Jean-Claude Bouchet, pour exposer sa question, no 1619, relative au dispositif d’alerte enlèvement.

Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a signé, le 28 février 2006, une convention visant à mettre en place un système d’alerte de la population en cas d’enlèvement d’un enfant mineur. Ce dispositif permet de diffuser très rapidement auprès de la population, sur l’ensemble du territoire national, des informations précises relatives à l’enlèvement afin de provoquer des témoignages susceptibles de favoriser la prompte libération de la victime. Les premières heures suivant la disparition sont en effet décisives.
Le message d’alerte qui indique un numéro de téléphone permettant aux témoins potentiels d’aviser immédiatement les autorités de toutes les informations utiles à la localisation de la victime ou du suspect est diffusé pendant trois heures par différents vecteurs : chaînes de télévision, stations de radio, agences de presse, panneaux à messages variables sur les autoroutes, dans les lieux publics, messages sonores dans les gares et les stations de métro, sites internet.
Or, malgré ce large dispositif, certains Français peuvent tout de même ne pas recevoir l’information de l’alerte enlèvement, sinon plusieurs heures après le déclenchement de la procédure. Dès lors, afin de toucher presque tous les Français, j’ai rédigé une proposition de loi en ce sens, qui n’a pas encore été étudiée par le Parlement. Il est proposé d’étendre le dispositif à une transmission par SMS. En effet, près de 92 % des Français possèdent un téléphone mobile. Ainsi, lorsqu’une alerte est déclenchée, il serait très efficace d’envoyer un message SMS, voire une photographie de l’enfant enlevé, aux abonnés en téléphonie mobile. Il pourrait également être envisagé de transmettre cette information sur les lignes téléphoniques fixes des abonnés. Ainsi, les chances de retrouver rapidement le mineur enlevé seraient largement augmentées. La vie des enfants mérite que l’on fasse le maximum pour les protéger.
Quels moyens seront mis en oeuvre afin d’étendre le dispositif alerte enlèvement et ainsi accroître les chances de succès rapide en cas de déclenchement du dispositif ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Monsieur le député, votre question a été réattribuée à M. le garde des sceaux. C’est donc en son nom que je vous réponds.
Le plan alerte enlèvement est un dispositif important, de diffusion rapide et très large de l’information au public, qui se veut particulièrement réactif et auquel il est recouru de manière exceptionnelle, en cas d’enlèvement d’enfants. C’est surtout, vous avez raison de le souligner, un dispositif efficace qui a permis de sauver la vie de plusieurs enfants.
Le plan alerte enlèvement a en effet été déclenché à dix-neuf reprises depuis sa création le 28 février 2006. Il a permis de retrouver vivants les vingt-quatre mineurs concernés par son déclenchement.
S’agissant de votre proposition, il n’est pas souhaitable que la photographie du mineur enlevé soit directement diffusée auprès de l’ensemble des abonnés téléphoniques. Il est en effet nécessaire de contrôler la diffusion de l’image du mineur victime et l’usage qui peut en être fait. Il y a lieu de préserver, en toutes circonstances, l’intérêt de l’enfant et s’assurer de ne pas porter une atteinte disproportionnée à son droit à l’image.
Ainsi, l’ensemble de nos partenaires procède au retrait immédiat de la photographie de l’enfant dès la cessation de l’alerte ou, à tout le moins, à son floutage. La vérification du respect de cette procédure serait évidemment rendue impossible par l’envoi à titre privé à des millions de destinataires particuliers. En revanche, un partenariat avec les opérateurs de téléphonie pourrait être étudié, afin de prévenir par SMS du déclenchement d’une alerte enlèvement.
Le Gouvernement partage votre préoccupation : il convient d’éviter que ce dispositif ne devienne désuet au regard des moyens modernes de communication et de veiller à ce que la diffusion de l’alerte soit la plus visible possible. Ainsi, le ministère de la justice travaille actuellement au développement de nouveaux partenariats, afin notamment que l’alerte soit diffusée encore plus largement qu’aujourd’hui sur les réseaux sociaux et internet.
S’agissant des téléphones mobiles, plus précisément des smartphones, les applications de nos partenaires actuels permettent déjà aux usagers de recevoir une notification d’alerte enlèvement.

Je savais que le taux de réussite de l’alerte enlèvement était de 100 %, ce qui est très important.
J’ai bien entendu également que la diffusion de la photographie du mineur enlevé pouvait perturber la procédure, compte tenu de la discrétion qui s’impose dans ce type d’affaire, d’autant qu’il est impossible d’effacer cette photographie par la suite.
Comme vous, monsieur le secrétaire d’État, je pense qu’il faut continuer à améliorer ce dispositif afin que tout le monde puisse recevoir les alertes, non seulement par SMS, mais aussi par le biais des lignes téléphoniques puisque certaines populations ne disposent pas de téléphone mobile. L’élargissement des modes de diffusion permettra de maintenir le taux de 100 % de réussite, au bénéfice des enfants enlevés.

La parole est à M. Sébastien Huyghe, pour exposer sa question, no 1624, relative au commissariat de Wattignies.

Depuis de nombreuses années, on évoque un projet de nouveau commissariat pour la commune de Wattignies, dans le Nord. Les fonctionnaires de police affectés à ce commissariat ont en charge neuf communes et 80 000 habitants de la proche banlieue sud de Lille. Outre la menace terroriste qui les mobilise en permanence, ils sont confrontés à une situation sécuritaire difficile, qui ne cesse de se dégrader.
Les locaux de ce commissariat sont indignes de nos fonctionnaires de police et de nos concitoyens qui s’y rendent. Je vous invite à m’accompagner dans ces locaux pour constater à quel point ils sont inadaptés à l’usage qui en est fait. Le commissariat est installé dans d’anciens appartements vétustes, au pied d’un immeuble d’habitation. Les salles de bains sont même toujours en place.
En 2011, après sept années de mobilisation des élus locaux sur ce dossier, le ministère de l’intérieur a donné son accord au financement des travaux, alors estimés à 3,7 millions d’euros. Le chantier devait être entamé fin 2012.
Le changement de majorité a provoqué un premier report de ce projet indispensable. Il nous avait cependant été assuré que ce report ne constituait en rien une remise en cause du projet en lui-même. Depuis, tout au long du mandat de François Hollande, le ministère n’a cessé de repousser d’année en année le lancement de la construction de ce nouveau commissariat, en le présentant malgré tout comme nécessaire. Au mois de juin 2016, le ministre de l’intérieur indiquait encore que cet équipement pourrait être inscrit dans le programme police nationale 2017-2019. Il apparaît cependant que tel n’a pas été le cas.
Quelle que soit leur étiquette politique, l’ensemble des élus concernés réclament à cor et à cri ce nouveau commissariat, qui fait depuis de trop nombreuses années l’objet d’une promesse de l’État. Les fonctionnaires de police eux-mêmes désespèrent de pouvoir un jour disposer d’un lieu de travail digne.
Monsieur le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, je vous remercie de m’indiquer si le Gouvernement entend affecter prochainement des crédits à la réalisation de ce commissariat. Je vous remercie également de m’indiquer les raisons qui ont conduit à la non-inscription de cet équipement dans le programme pour 2017.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Monsieur le député, les conditions de travail des policiers et, au-delà, de tous les personnels de la police nationale constituent un sujet absolument essentiel. Il y va de la reconnaissance et du respect que l’État leur doit.
Depuis le début du quinquennat, les crédits nécessaires ont été consacrés à rénover et moderniser les matériels – je pense particulièrement au parc automobile – et à développer une véritable politique d’investissement permettant la rénovation du parc immobilier. En outre, 9 000 policiers et gendarmes auront été recrutés durant ces cinq dernières années.
Mais le malaise qui s’est exprimé au sein de la police a montré qu’il fallait aller encore plus loin. Un vaste plan pour la sécurité publique de 250 millions d’euros comportant des mesures concrètes pour le quotidien des policiers a donc été décidé en octobre dernier. Une enveloppe spécifique de 16 millions d’euros, déléguée dès le 4 novembre aux services territoriaux de police, a permis de remédier aux situations immobilières les plus urgentes.
Les besoins restent considérables et de trop nombreux commissariats de police sont inadaptés ou vétustes. Or les commissariats sont l’incarnation de l’État et de la sécurité de proximité : c’est donc le respect que l’État doit aux territoires, à nos concitoyens et aux policiers eux-mêmes qui est en jeu. Comme le savent les élus locaux, les commissariats constituent aussi un levier pour le dynamisme des territoires.
Les locaux du commissariat subdivisionnaire de Wattignies, dans le Nord, sont en effet clairement inadaptés aux besoins du service. Des travaux réalisés en 2015 et 2016 visent cependant à améliorer quelque peu les conditions de travail des policiers. De nouveaux travaux, financés sur les crédits du plan pour la sécurité publique que j’évoquais à l’instant, sont en cours ou ont été programmés pour le premier trimestre.
Comme vous l’avez rappelé, monsieur le député, la construction d’un bâtiment neuf est envisagée de longue date. Dès 2005, un projet de relogement a commencé à être étudié en lien avec les élus locaux, notamment le maire. Aujourd’hui, je tiens à vous dire que cette opération d’investissement, estimée à près de 4 millions d’euros, a été relancée, notamment dans sa dimension foncière. Le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur dans la zone de défense Nord – SGAMI Nord – souhaite acquérir le foncier en 2017 et a sollicité à cet effet une autorisation d’engagement de 300 000 euros. L’inscription éventuelle de ce projet dans le prochain programme triennal immobilier est maintenant à l’étude. Vous le savez, il s’agirait de construire un bâtiment neuf, propriété de l’État, sur un terrain appartenant à la SA du Hainaut.
Soyez assuré, monsieur le député, que l’évolution de ce projet sera étudiée avec une attention particulière. Je sais qu’il s’agit d’un sujet important pour les policiers, mais aussi pour la population et ses élus.

Monsieur le secrétaire d’État, je regrette que ce projet de reconstruction, déjà prévu en 2011, ait été retiré de la liste des commissariats devant être construits. Sur ce projet, reporté d’année en année, les élus locaux et moi-même avons été menés en bateau.
J’observe que le vaste terrain prévu pour cette opération – une friche industrielle – a aujourd’hui été en grande partie utilisé pour la construction de logements. Aujourd’hui, il ne reste plus de place que pour la construction du commissariat.
J’ai encore évoqué ce projet hier soir avec le maire de Wattignies, Alain Pluss, qui m’a dit qu’il attendait désespérément que l’État inscrive enfin ce commissariat dans son programme de construction. L’État est désormais propriétaire du terrain : plus rien ne s’oppose donc au démarrage des travaux. Je compte sur le Gouvernement pour agir rapidement.

La parole est à M. Xavier Breton, pour exposer sa question, no 1631, relative aux procédures du droit d’asile.

À travers vous, monsieur le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, je souhaite interroger le ministère de l’intérieur sur la vague migratoire de très grande importance que connaissent la France et l’Europe.
Bien sûr, notre pays a historiquement une tradition d’asile, qui permet aux personnes persécutées du fait de leur appartenance politique, religieuse ou ethnique d’être accueillies et de trouver sécurité et solidarité dans un pays de liberté. Or, au cours des dernières années, les demandes d’asile dans notre pays ont explosé. Chacun sait très bien qu’une grande majorité de ces demandeurs ne sont pas de vrais réfugiés politiques.
Aujourd’hui, en France, de très nombreux demandeurs d’asile sont toujours dans l’attente d’une éventuelle reconnaissance du statut de réfugié ; ils vivent dans la rue des situations humainement dégradantes et inacceptables, comme on peut le voir actuellement dans la ville de Bourg-en-Bresse.
Malgré la loi du 29 juillet 2015, l’État est incapable d’accélérer les procédures et de faire appliquer les décisions de justice de déboutement du droit d’asile et donc de reconduite à la frontière, ce qui entraîne de fait un accroissement constant du nombre de personnes en situation irrégulière. Toute la procédure de demande d’asile est ainsi complètement embolisée. Les centres d’accueil de demandeurs d’asile – CADA – et les hébergements d’urgence sont majoritairement occupés par des déboutés du droit d’asile non reconduits à la frontière à l’issue des décisions définitives de rejet de leur demande, par absence totale de volonté politique. Moins de 10 % des déboutés quittent effectivement notre territoire une fois qu’ils ont épuisé les voies de recours.
Au moment où notre pays compte plusieurs millions de personnes en situation de chômage et de précarité, nous ne pouvons plus ouvrir nos portes aux réfugiés « économiques », qui ne peuvent trouver une activité sur notre territoire. De même, nous ne pouvons plus longtemps accepter sur le territoire national autant d’immigrés en situation irrégulière.
Bien sûr, la gestion de ces situations est complexe et nous devons saluer le travail effectué par les services préfectoraux et les associations locales, avec lesquelles nous sommes régulièrement en contact. Mais l’absence de clarté et de détermination crée fatalement un appel d’air pour les migrations, notamment vers des départements frontaliers comme l’Ain, dont les structures sont déjà surchargées.
Nous ne pouvons plus longtemps continuer à leurrer ces populations étrangères en leur faisant croire que notre pays peut continuer à les accueillir en leur offrant de nouveaux droits alors que la France est confrontée aux difficultés majeures que nous connaissons et que nombre de nos compatriotes qui ont travaillé toute leur vie durant n’ont même pas l’essentiel pour vivre dans de bonnes conditions.
Aussi, monsieur le secrétaire d’État, quelles dispositions le Gouvernement compte-t-il enfin prendre pour mettre un terme aux détournements des procédures du droit d’asile et pour appliquer enfin les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA – et de la justice tendant à l’éloignement du territoire national de tous les migrants déboutés lorsqu’ils ont épuisé les voies de recours ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Monsieur le député, pendant ces cinq dernières années, dans un contexte migratoire mouvementé, le Gouvernement a su perpétuer la force de la tradition républicaine d’accueil des demandeurs d’asile. Il l’a fait dans le cadre d’une réforme redonnant de la vigueur à nos procédures d’asile tout en renforçant les droits et les garanties des demandeurs. Contrairement à votre analyse, les premiers résultats sont tout à fait encourageants, même si les effets attendus de la réduction des délais de traitement se sont trouvés atténués par l’augmentation du nombre de demandes d’asile.
Nous avons aussi fait des efforts en matière d’hébergement des demandeurs d’asile en doublant le nombre de places offertes en CADA, soit une création de 20 000 places sur la durée du quinquennat alors que seules 2 000 places avaient été créées par la majorité précédente. Par ailleurs, depuis octobre 2015, la création de places en centres d’accueil et d’orientation a permis à 17 000 personnes de trouver un moment de répit dans leur parcours migratoire. C’est dans ces centres qu’elles ont pu bénéficier d’un accompagnement social, sanitaire et administratif et, pour un grand nombre d’entre elles, entreprendre de déposer une demande d’asile en France.
Afin d’assurer un juste équilibre, cette politique va de pair avec notre engagement à lutter contre le détournement des procédures d’asile et l’immigration irrégulière. Dès lors qu’un étranger est sous le coup d’une mesure d’éloignement et que sa situation administrative a fait l’objet d’un examen global, nous mettons tout en oeuvre pour que l’éloignement soit effectif. Par la loi du 7 mars 2016, nous avons renforcé le dispositif d’assignation à résidence pour accroître l’efficacité de cette politique.
L’efficacité de notre action se traduit par l’évolution des éloignements forcés. Dans ce cadre, l’éloignement de ressortissants de pays tiers est la mesure la plus emblématique car c’est la plus complexe à mettre en oeuvre. Certes, le nombre de ces éloignements est passé de 6 311 en 2015 à 6 166 en 2016, soit une baisse de 2,3 % – 145 mesures –, mais cette évolution doit être mise en perspective avec les effets du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen. Celui-ci s’est traduit par une très forte augmentation des non-admissions d’étrangers en situation irrégulière prononcées par les services de police aux frontières – le nombre de ces décisions est passé de 15 849 en 2015 à 63 732 en 2016, soit une hausse de 47 833 mesures ou 302 %. Ces personnes non admises n’ont pu entrer sur le territoire national ; ainsi, il n’a pas été nécessaire de prendre à leur encontre des mesures d’éloignement et encore moins de les faire exécuter.
Enfin, depuis 2009, le nombre total de mesures d’éloignement forcé est passé de 12 547 à 12 961, soit une augmentation de 3 %. De même, le nombre de retours forcés de ressortissants de pays tiers est à la hausse, passant de 4 015 à 6 539 mesures, soit une augmentation de 62 %.
Aussi, afin de favoriser la dynamique de retour des demandeurs d’asile déboutés, des dispositifs spécifiques de préparation au retour volontaire sont mis en place.
Enfin, les dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de rejeter des demandes d’asile formulées tardivement dans les lieux de rétention ou pouvant être considérées comme dilatoires, afin de ne pas entraver l’exécution des mesures d’éloignement.

La parole est à M. Henri Jibrayel, pour exposer sa question, no 1637, relative à la rémunération des infirmiers anesthésistes.

Madame la ministre de la fonction publique, je souhaite vous interpeller sur la situation statutaire et indiciaire des infirmiers anesthésistes diplômés d’État, les IADE.
En 2012, leur formation a été intégrée dans le protocole LMD au niveau master 2. Le niveau sommital des grilles master 2 de la fonction publique atteint l’indice 783 quand celle des IADE plafonne à l’indice 642.
À la demande du ministère de la santé, afin de justifier le niveau d’autonomie correspondant au master 2, le champ d’exercice des IADE a été clarifié, en collaboration avec le corps médical, aboutissant à une réécriture du décret no 2004-802 du 29 juillet 2004. Le nouveau texte sera très prochainement soumis à l’avis du Conseil d’État. Cette clarification permet d’inscrire la réalité de l’autonomie médicalement supervisée des IADE dans le code de la santé publique. Aucune autre profession paramédicale n’a actuellement ce degré d’autonomie et de responsabilité dans la prise en charge des patients.
Le 12 janvier, le ministère de la fonction publique leur a proposé une nouvelle bonification indiciaire de dix points et une augmentation de leur prime IADE de 30 euros, soit une revalorisation de 70 euros. Toutefois, l’écart avec les grilles master 2 est encore de plus de 600 euros, et nous le regrettons. Ainsi, je vous demande, madame la ministre, de préciser ce que souhaite faire le Gouvernement pour mettre fin à cette iniquité et répondre aux revendications d’une profession essentielle à notre système de santé.
Monsieur le député, soyez assuré que mon ministère, celui de la santé et le Gouvernement dans son ensemble portent une attention toute particulière à la situation des IADE de la fonction publique hospitalière, tant pour ce qui est de leurs conditions de travail que de leur cadre statutaire.
À la suite de l’important travail d’actualisation du décret d’acte des infirmiers anesthésistes, réalisé par le ministère des affaires sociales et de la santé en lien avec les professionnels concernés, une concertation a été engagée dès la mi-septembre 2016 entre la direction générale de l’offre de soins et les organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue d’apporter des réponses, notamment statutaires, aux revendications des IADE.
Nous veillons toutefois – c’est en particulier mon rôle – à ce que les perspectives d’avancée, en matière de rémunération des IADE, s’inscrivent bien dans une cohérence d’ensemble entre les trois versants de la fonction publique, et tiennent compte de deux données.
D’abord, le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations – dit PPCR –, propose de nouvelles grilles de rémunération à tous les fonctionnaires, dont les IADE. La mise en application du protocole sera échelonnée entre 2016 et 2020, et les négociations continuent sur ces questions. Ensuite, le transfert des primes en points d’indice permet d’améliorer les retraites des agents.
En outre, il faut assurer un équilibre interne dans la fonction publique hospitalière : la grille des rémunérations des IADE n’est pas sans proximité avec celles des autres infirmiers ou des cadres de la fonction publique hospitalière.
Bien que nos marges de manoeuvre soient étroites, il existe des perspectives d’amélioration. Vous les avez citées : la revalorisation prévue dans le cadre du protocole PPCR, l’augmentation des primes spéciales et une nouvelle bonification indiciaire. Je n’ai pas exactement les mêmes chiffres que vous, mais la négociation n’est pas terminée – j’aurais préféré qu’elle le soit ! – et les avancées proposées par le Gouvernement n’ont pas encore été approuvées par les organisations syndicales. Le travail continue, et je souhaite que les discussions, que j’espère concluantes, permettent de le mener à bien. Si nous arrivons rapidement à un accord, le texte pourra passer devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 16 mars 2017, et être publié au plus vite. Je m’engage à clore ce dossier avant notre départ.

Madame la ministre, je vous remercie. J’ose espérer que le 17 mars vous nous annoncerez la disparition de cette iniquité, qui permettra aux infirmiers anesthésistes de retrouver un statut normal, correspondant au niveau master 2, soit bac + 5.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions au Gouvernement ;
Fixation de l’ordre du jour ;
Suite de la discussion de la proposition de loi relative à la promotion des langues régionales ;
Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique.
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures trente-cinq.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly