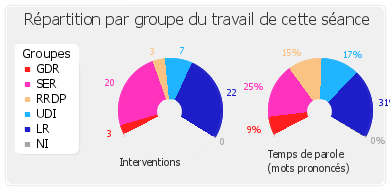Séance en hémicycle du 22 janvier 2015 à 9h30
Sommaire
- Convention de l'organisation internationale du travail relative aux agences d'emploi privées (voir le dossier)
- Accord france-azerbaïdjan relatif à la création et aux conditions d'activités des centres culturels (voir le dossier)
- Faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat (voir le dossier)
- Ordre du jour de la prochaine séance (voir le dossier)
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.


La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du développement et de la francophonie.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur suppléant de la commission des affaires étrangères, mesdames et messieurs les députés, le projet de loi de ratification qui vous est soumis aujourd’hui s’inscrit dans une tradition déjà longue, celle de l’engagement de la France dans les activités de l’Organisation internationale du travail.
La France est, avec l’Espagne, le pays qui a ratifié le plus grand nombre de conventions de l’OIT. Au-delà de ce chiffre, c’est notre attachement au respect et à la défense des règles internationales du travail que nous souhaitons réaffirmer aujourd’hui.
La convention no 181 de l’OIT s’inscrit dans ce contexte. Elle prend acte du fait que, depuis deux décennies, de nombreux pays font participer des agences d’emploi privées à l’intermédiation des demandeurs d’emploi et pose un cadre pour réguler à la fois les conditions d’intervention de ces agences et les droits des salariés qu’elles emploient.
C’est donc un texte protecteur, qui s’inscrit pleinement dans la lignée de principes qui, pour la France, sont fondateurs dans le champ du service public de l’emploi.
Dans la pratique, l’ensemble des garanties prévues par cette convention existe déjà dans notre droit interne : principe de gratuité du service pour les demandeurs d’emploi, respect du droit des travailleurs employés par ces agences et de ceux ayant recours à leurs services. Ce principe est posé dès l’article 2 de la convention : « La présente convention a, au nombre de ses objectifs, celui de permettre aux agences d’emploi privées d’opérer et celui de protéger, dans le cadre de ses dispositions, les travailleurs ayant recours à leurs services ».
La convention rappelle également les droits fondamentaux des travailleurs dont doivent bénéficier, comme tous les autres, les salariés des agences d’emploi privées, parmi lesquels figurent notamment le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective – article 4 de la convention –, les garanties en matière de salaires et de conditions de travail, ou encore l’accès à la formation – article 11 –, le principe de gratuité du service public de l’emploi – article 7 –, la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’accès à l’emploi – article 5 –, la protection des données personnelles des personnes ayant recours aux agences d’emploi privées – article 6.
Ce socle de droits et de pratiques, c’est aussi le nôtre. La France est attachée au rôle de la puissance publique comme acteur et régulateur du service public de placement des demandeurs d’emploi, et aux grands principes, tel celui de gratuité, qui structurent ce service public.
Et ce n’est pas un hasard si la France est souvent vue comme un pays jouant un rôle d’impulsion, au sein du Bureau international du travail, dans la protection des droits des travailleurs.
La convention de l’OIT ne prend pas position pour ou contre le recours aux agences d’emploi privées : elle prend acte de leur existence dans un nombre croissant de pays et pose un cadre protecteur pour l’exercice de leur activité. À ce titre, l’OIT joue pleinement son rôle de régulation des formes et des pratiques d’emploi, pour répondre au mieux à la réalité des pays qui sont ses parties prenantes.
Pour la France, ratifier cette convention ne modifiera en rien le droit interne, l’intervention des opérateurs privés de placement dans le champ de l’intermédiation étant déjà autorisée et encadrée par des règles nationales et communautaires, et la protection des travailleurs étant déjà garantie à un niveau élevé.
En revanche, ratifier cette convention permettra à la fois de mettre en cohérence nos pratiques et nos engagements internationaux et de réaffirmer notre attachement aux principes de protection que prévoit l’OIT.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur suppléant, mesdames et messieurs les députés, avant-hier se tenait la dernière édition des entretiens entre la France et le BIT, qui concrétisent une nouvelle fois la communauté de valeurs et d’action que nous partageons, que ce soit dans le champ normatif ou dans celui de la recherche.
L’Organisation internationale du travail est originale tant par son histoire que par sa composition : elle est la seule où se retrouvent dans une formation tripartite les représentants des États, des employeurs et des travailleurs. Cette originalité lui donne aussi un regard particulier sur la question des relations de travail et d’emploi. Le cadre que pose la convention no 181 est une nouvelle illustration concrète des principes que nous devons continuer à porter dans toutes les instances et notamment, dans les domaines de l’emploi.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir adopter le projet de loi portant ratification de cette convention.
Applaudissements sur les bancs des groupes RRDP et SRC.

La parole est à M. Thierry Mariani, suppléant M. Édouard Courtial, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État chargée du développement et de la francophonie, mes chers collègues, nous sommes saisis aujourd’hui de la convention no 181 relative aux agences d’emploi privées, et de la recommandation no 188 relative aux agences d’emploi privées, qui ont été adoptées à Genève, lors de la 85e session de la Conférence internationale du travail, après deux lectures successives. Cette convention est l’aboutissement d’un long processus débuté en novembre 2000, et auquel la France a apporté un soutien actif, car elle « offre un équilibre entre le besoin de flexibilité des entreprises et les besoins des travailleurs : environnement de travail sûr et conditions de travail décentes ».
Mon collègue Édouard Courtial, rapporteur de ce texte, vous prie d’excuser son absence. Retenu, il m’a demandé de le suppléer.
De quoi parle-t-on ici ? D’un phénomène à la fois récent et en expansion, à savoir le recours aux opérateurs privés dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Depuis une quinzaine d’années, l’accompagnement actif des demandeurs d’emploi, et non leur simple suivi par l’opérateur public, se situe, en Europe, au coeur des politiques actives du marché du travail.
La littérature économique sur le sujet a mis en évidence les effets bénéfiques de l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi, notamment une réduction significative de la durée de chômage, une meilleure qualité de l’emploi trouvé, et des épisodes moins fréquents de chômage.
Or, depuis quelques années, cet accompagnement est de plus en plus assuré par des opérateurs privés, en complément de l’action des opérateurs publics – de Pôle emploi, bien sûr, pour la France. Un tel suivi permet de définir des méthodes d’accompagnement innovantes ; de couvrir des zones géographiques dans lesquelles le service public de l’emploi est peu présent ; de proposer des prestations spécifiques ou à destination de publics spécifiques pour lesquels le service public ne dispose pas des compétences nécessaires, par exemple l’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise ; de garantir une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre ; de mieux faire entrer les demandeurs d’emploi, notamment défavorisés, sur le marché du travail ; de faciliter l’accès la formation.
Cependant, le recours à des opérateurs privés pour remplir la traditionnelle mission de service public doit être encadré afin de prévenir les éventuels abus et garantir la protection des travailleurs concernés.
À ce titre, l’objectif de la convention soumise aujourd’hui à notre approbation est double. Il s’agit, d’une part, de combler le vide juridique qui entourait l’action des agences privées pour l’emploi, et de mettre fin à ce qu’il faut bien qualifier de position quasi schizophrène sur le sujet : en effet, alors que, depuis les années 1990, le recours aux opérateurs privés dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi, qui produit souvent des résultats encourageants, s’est accru, la convention no 96 de l’OIT, référence en la matière, en interdit l’usage, ce qui est une véritable aberration juridique.
D’autre part, il s’agit – telle a été la position de la France lors de la négociation de cette convention – d’instaurer un cadre réglementaire pour assurer la protection effective des travailleurs contre des pratiques abusives en matière de rémunération, de santé et de sécurité, de la part d’agences intérimaires ou d’entreprises utilisatrices peu scrupuleuses.
Sans entrer dans le détail, car le temps nous manque, la convention autorise la création d’agences d’emploi privées mais exige la détermination d’un cadre juridique et des conditions d’exercice de leurs activités. Elle garantit aux travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective ainsi que la protection contre toute forme de discrimination.
En outre, elle pose le principe d’interdiction de mise à la charge des travailleurs des frais des services fournis, dont il faudra contrôler étroitement l’application afin d’éviter toute dérive. Elle stipule, enfin, que les pays membres doivent veiller à la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ce cadre, et c’est évidemment capital, les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail comme de l’utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à cette politique.
Quels seront les effets juridiques de la ratification de cette convention en droit national ? Vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État, aucun, ce qui est plutôt bon signe, car cela indique que la législation française est déjà conforme à la convention no 181 de l’OIT. Certes, la question du recours au secteur privé pour des prestations d’accompagnement a émergé plus tardivement en France que dans d’autres pays européens, tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne.
En prônant une plus grande personnalisation des services rendus aux demandeurs d’emploi, la Commission européenne l’a fortement encouragée, dès 1998, notamment pour développer l’innovation dans les méthodes d’accompagnement des demandeurs d’emploi, pour réduire les coûts et pour stimuler les services publics de l’emploi.
La France n’avait pas ratifié la convention no 181 en raison du monopole du placement détenu par l’Agence nationale pour l’emploi, devenue Pôle emploi. Mais la loi du 18 janvier 2005 y a mis fin. Ainsi, dès la fin du monopole de placement détenu par l’ANPE en 2005, l’UNEDIC a expérimenté le recours à des opérateurs privés pour accélérer le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi présentant, notamment, un risque de chômage de longue durée.
Dans un contexte de forte montée du chômage, le recours aux opérateurs de placement constitue principalement pour Pôle emploi un moyen d’adapter ses capacités à la conjoncture et de cibler des personnes nécessitant un suivi approfondi et personnalisé – cadres, créateurs d’entreprise, jeunes diplômés. Les opérateurs privés de placement jouent un rôle complémentaire par rapport au service public de l’emploi. Pôle emploi peut ainsi y recourir en mobilisant les compétences spécialisées dont il ne dispose pas forcément en interne, en particulier en matière d’évaluation des compétences et de formation, ou pour augmenter ses capacités d’action et confronter ses méthodes et résultats à ceux d’autres opérateurs.
Rappelons enfin qu’en France, les agences d’emploi privées n’interviennent sur le marché du placement que dans le cadre des appels d’offres de l’opérateur de l’État, et cela pour deux raisons : d’une part, les services de Pôle emploi étant gratuits pour les entreprises, celles-ci n’ont économiquement aucun intérêt à avoir recours directement à des agences privées dont les services sont payants ; d’autre part, le marché du placement n’est pas encore très développé.
Au final, la ratification de la convention no 181 n’entraînera pas de modification législative ou réglementaire du droit français et n’en changera pas fondamentalement la pratique. Elle permettra en revanche à la France de se mettre en conformité avec le droit international, puisque l’article 23 dispose que la ratification de ladite convention vaut dénonciation de la convention no 96 précédemment évoquée.
Pour terminer, j’émettrai seulement deux réserves.
Au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la convention, la délégation française avait émis trois souhaits : que la convention couvre le champ du travail temporaire ; que toute latitude soit laissée pour réglementer les activités comprises dans le champ de la convention ; que certaines dispositions figurant dans la recommandation de l’OIT relative aux agences d’emploi privées, telle l’interdiction de la mise à disposition de travailleurs pour remplacer les salariés d’une entreprise en grève, soient intégrées dans le texte de la convention. Or, si les deux premières demandes ont été satisfaites, la troisième ne l’a pas été. Les dispositions souhaitées figurent certes dans la recommandation no 188 qui accompagne la convention, mais leur portée juridique est évidemment moindre.
Par ailleurs, la France, qui est le deuxième État de l’OIT à avoir ratifié le plus grand nombre de conventions et qui a milité en faveur de celle-ci au sein de l’organisation, a attendu bien trop longtemps avant de solliciter des assemblées parlementaires l’autorisation de procéder à sa ratification – la convention étant en vigueur depuis mai 2000 ; cela est d’autant plus regrettable que le principe de la fin du monopole du placement public a été acté en 2005. Mais vous me répondrez avec raison, madame la secrétaire d’État, que de nombreux gouvernements issus de majorités différentes se sont succédé depuis cette date.
Notons cependant que nous ne sommes pas les seuls à ratifier la convention avec retard, puisque sur les vingt-sept pays qui l’ont fait à ce jour, on compte seulement douze États membres de l’Union européenne ; ni l’Allemagne ni la Grande-Bretagne ne l’ont encore fait.
Ces réserves émises, la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a approuvé la ratification de la convention no 181 de l’OIT.
Sourires.

Je vous rassure, cher collègue : sur ce texte, le groupe de l’UMP a la même position que le rapporteur !
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, la convention no 181 de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emplois privées résulte d’une réflexion amorcée dès 1994 au plan international, qui prenait acte du caractère obsolète de la convention no 96 de 1949 interdisant le recours aux agences d’emploi privées. En effet, les principes de cette dernière ne correspondaient plus à la réalité du marché du travail moderne, qui exigeait de nouvelles formes d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Le marché du travail fait face à des taux de chômage tellement élevés que l’accompagnement des demandeurs d’emploi par les seuls opérateurs publics est difficile. Il peut s’avérer nécessaire de recourir à des opérateurs privés, sans que ces derniers se substituent pour autant aux opérateurs publics.
Le marché du travail ayant évolué, nous devons faire évoluer le droit. En 2005, la loi de programmation pour la cohésion sociale a ouvert le marché du placement à des organismes privés, mettant fin au monopole de l’Agence nationale pour l’emploi, l’ANPE. En permettant à des opérateurs privés de se placer sur le marché du placement, le Gouvernement français a souhaité donner une impulsion nouvelle aux conditions de recherche d’emploi pour favoriser l’insertion professionnelle et le retour des demandeurs d’emploi à la vie active. L’objectif du législateur était notamment d’accroître les capacités d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’emploi, ainsi que la collecte et la diffusion d’offres d’emplois vacants, tout en veillant à ce que le service public de placement conserve un rôle essentiel.
La loi autorise donc les opérateurs privés à procéder à des activités de placement, tout en encadrant leurs conditions d’exercice. Ces conditions correspondent à celles prévues par la convention no 181 : respect du principe de gratuité pour les demandeurs d’emploi, respect du principe de non-discrimination, protection des travailleurs concernant le traitement des données qui leur sont personnelles mais utiles à l’activité de placement.
Depuis plusieurs années, la grande majorité des pays de l’Union européenne ont libéralisé leur marché du placement ; douze d’entre eux ont d’ailleurs ratifié la convention no 181.
Les effets bénéfiques de l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi ont été rappelés.
La ratification de la convention no 181 permettra de renforcer notre législation nationale, en comblant le vide juridique qui entoure l’action des agences privées.
Le présent texte prend acte de l’importance de la flexibilité dans le fonctionnement des marchés du travail et reconnaît le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer en ajustant mieux l’offre et la demande de main-d’oeuvre. La convention prévoit aussi la mise en place d’un cadre juridique et définit pour les opérateurs privés des conditions d’exercice garantissant une protection aux travailleurs qui feraient usage de leurs services.
Toutefois, le rapporteur Édouard Courtial a formulé certaines réserves sur le texte et les conditions de sa ratification.
Au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la convention, la délégation française avait émis trois souhaits, que je ne rappellerai pas à nouveau ; si le texte adopté répond en grande partie aux préoccupations françaises, l’intégration dans la convention de certaines dispositions de la recommandation n’a pas été obtenue. Certes, ces dispositions figurent dans la recommandation qui accompagne la convention, mais les deux textes n’ont pas la même portée juridique.
Ces remarques faites, le groupe de l’UMP approuve la ratification de cette convention.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis une quinzaine d’années l’accompagnement des demandeurs d’emploi est en Europe au coeur des politiques actives du marché du travail.
Comparativement à certains de nos voisins européens, comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, la France a eu recours assez tardivement au secteur privé pour les prestations d’accompagnement. Toutefois, ce secteur s’est peu à peu imposé comme un complément indispensable à l’action des opérateurs publics.
C’est en 2005, avec la fin du monopole de placement détenu par l’ANPE, que la France a expérimenté le recours à des opérateurs privés pour accélérer le retour à l’emploi des demandeurs présentant un risque de chômage de longue durée. Cette expérimentation a été prolongée jusqu’à la création de Pôle emploi en 2008.
Aujourd’hui, dans un contexte de forte montée du chômage, le recours, dans notre pays comme ailleurs, aux agences d’emploi privées s’avère être une réponse logique aux mutations du marché du travail. Si Pôle emploi continue de détenir des prérogatives régaliennes et si le service public de l’emploi ne doit en aucun cas être remis en cause, il convient de conforter les agences d’emploi privées dans leur rôle de complément du service public.
En effet, le recours à des opérateurs privés peut avoir des conséquences bénéfiques et non négligeables sur l’emploi dans la mesure où il permet d’assurer un accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi par rapport au simple suivi mis en oeuvre par le conseiller du service public. Cela permet notamment de couvrir des zones géographiques où le service public est peu présent, et là où le service public ne dispose pas des compétences nécessaires, notamment par manque de moyens, les agences d’emploi privées peuvent proposer aux demandeurs d’emploi des prestations spécifiques ou à destination de publics spécifiques, telles que l’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprises, ou encore en matière d’évaluation des compétences et de formation.
Le recours aux agences d’emploi privées est aussi un moyen d’entrer sur le marché du travail et d’accroître l’employabilité des travailleurs, par l’aide à la formation et l’acquisition d’une expérience professionnelle. En créant une dynamique favorable à la création d’emplois, les agences d’emploi privées jouent ainsi un rôle non négligeable en faveur de l’emploi.
Le recours croissant à ces agences doit cependant être encadré. Cet encadrement doit avoir pour objectifs la prévention d’éventuels abus en matière de rémunération, de santé ou de sécurité, ainsi que la garantie de la protection des travailleurs concernés. Tel est l’objet de la convention que nous examinons aujourd’hui.
Sur la forme, reconnaissons-le, notre assemblée est invitée assez tardivement à examiner sa ratification. Voilà près de dix-huit ans que la convention a été adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail et vingt-sept États l’ont déjà ratifiée. Si la France n’était pas, jusqu’en 2005, en mesure de le faire en raison du monopole de placement détenu par l’Agence nationale pour l’emploi, elle aurait pu procéder plus tôt à cette ratification, et cela d’autant plus qu’elle est le deuxième État de l’OIT à avoir ratifié le plus grand nombre de conventions et qu’elle a milité au sein de celle-ci en faveur d’un cadre juridique protecteur pour les travailleurs.
Sur le fond, les dispositions incluses dans la convention sont une réponse adaptée au recours croissant aux agences d’emploi privées. Il s’agit de permettre à ces dernières d’opérer tout en protégeant les travailleurs qui font appel à leurs services : protection contre toute forme de discrimination, protection des travailleurs migrants, garantie du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, notamment.
Ces dispositions correspondent à la position de la France, qui a participé activement aux travaux préparatoires. Deux des souhaits qu’elle avait formulés ont été respectés : couvrir le champ du travail temporaire et conserver toute latitude pour réglementer les activités comprises dans le champ de la convention. On peut cependant déplorer le fait que l’une des recommandations formulées par la délégation française n’a pas été suivie ; des dispositions telles que l’interdiction de la mise à disposition des travailleurs pour remplacer les salariés d’une entreprise en grève n’ont pas été intégrées dans le texte même de la convention : elles ne figurent que dans la recommandation qui accompagne la convention. Leur portée juridique en sera donc moindre, comme l’a souligné le rapporteur.
Nous ne pouvons cependant qu’approuver cette convention, qui correspond à notre législation existante. En 2010, la transposition de la directive « Services » avait permis de mettre en conformité la législation française sur l’activité de placement avec le droit européen. Notre droit ouvre l’exercice de l’activité de placement à tout organisme public ou privé, sous réserve que ses statuts le lui permettent.
Par ailleurs, conformément à la convention, les services de placement reposent sur les principes inscrits dans la loi : celui de la gratuité pour le demandeur d’emploi, d’une part, celui de la non-discrimination des services et offres d’emploi, d’autre part.
En outre, notre législation est en conformité avec la directive de 2008 visant à garantir un niveau minimum de protection effective aux travailleurs intérimaires.
L’adoption de la convention n’entraînera pas de modification législative ou réglementaire du droit français et n’en changera pas fondamentalement la pratique. Elle permettra en revanche à la France de se mettre en conformité avec le droit international, les dispositions de cette convention valant dénonciation de la convention no 96 de 1994, qui interdisait le recours aux agences d’emploi privées.
Si cette convention n’aura pas d’effets juridiques en droit français, elle devrait avoir pour conséquence d’encadrer le recours à ces pratiques dans des pays où la législation sociale est moins développée. Cet aspect est néanmoins à nuancer dans la mesure où la convention fait plusieurs fois référence aux législations et pratiques nationales. Ainsi, l’article 11 de la convention prévoit que « tout membre doit prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation et la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées » et l’article 12 indique que les pays membres doivent préciser les responsabilités respectives des agences et des entreprises en ce qui concerne les droits des travailleurs. On peut y voir les limites de la convention quant à la prévention des abus et à la garantie de la protection des travailleurs.
En dépit de ces quelques réserves, le groupe UDI votera en faveur d’un projet qui permet d’encadrer le recours aux agences d’emploi privées qui proposent des formes d’accompagnement des demandeurs d’emploi en adéquation avec les réalités du marché du travail moderne.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, avec les taux élevés de chômage que nous connaissons en Europe depuis des décennies, l’accompagnement des demandeurs d’emploi est au coeur des politiques actives du marché du travail. En effet, sans un accompagnement renforcé, il ne peut y avoir de réduction significative de la durée de chômage, de meilleure qualité de l’emploi trouvé et des épisodes moins fréquents de non-emploi.
Depuis quelques années, cet accompagnement est de plus en plus assuré, en complément de l’action des opérateurs publics – Pôle emploi, pour la France –, par des opérateurs privés : les agences d’emploi privées. En plus de proposer des services de rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi, elles peuvent également mettre des salariés à la disposition d’une entreprise avec laquelle elles concluent un contrat de travail temporaire ou d’intérim.
Différentes considérations peuvent motiver le recours à ces agences. Cela peut être la couverture de zones géographiques dans lesquelles le service public de l’emploi est peu présent, comme cela peut être aussi la mise en oeuvre de prestations spécifiques à destination de publics ciblés pour lesquels le service public ne dispose pas, ou pas suffisamment, des compétences nécessaires compte tenu, notamment, de la faiblesse relative des besoins – par exemple, l’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise.
En 1994, l’Organisation internationale du travail prenait acte du fait que les principes qui sous-tendaient la convention no 96, qu’elle avait adoptée en 1946, ne correspondaient plus à la réalité des marchés du travail modernes. En effet, cette convention interdisait le recours aux agences d’emploi privées alors que de nouvelles formes d’accompagnement des demandeurs d’emploi sur le marché du travail se révélaient indispensables.
L’OIT lançait donc, en 1994, une conférence sur le rôle des agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Trois ans plus tard, au mois de juin 1997, l’Organisation adoptait, à Genève, la convention no 181. Quel est son contenu ?
Cette convention autorise la création d’agences d’emploi privées mais elle exige la détermination d’un cadre juridique et des conditions d’exercice de leurs activités qui garantissent une protection adéquate aux travailleurs faisant usage de leurs services. Elle énonce ainsi un principe de non-discrimination des travailleurs dans l’accès aux services des agences d’emploi privées, tout en prévoyant la possibilité pour ces agences de se spécialiser ou d’offrir des services spécifiques aux plus défavorisés d’entre eux. À ce titre, elle garantit une protection adéquate pour les travailleurs migrants.
Chaque État doit faire en sorte que ces personnes recrutées ou placées sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et prendre des mesures pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements prévoyant des sanctions, y compris l’interdiction des agences d’emploi privées qui se livrent à des abus ou à des pratiques frauduleuses. La convention précise notamment que tout pays membre doit prendre des mesures pour s’assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées. Par ailleurs, elle garantit aux travailleurs recrutés par celles-ci leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
La convention énonce également un principe d’interdiction de mise à la charge des travailleurs des frais des services fournis, en prévoyant des dérogations nationales pour des catégories de services spécifiquement identifiés et dès lors que ces dérogations sont motivées par l’intérêt des travailleurs concernés.
Enfin, la convention oblige à définir des conditions de nature à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ce cadre, les autorités publiques conservent la compétence de décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail comme de l’utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à cette politique. Elle définit également une obligation statistique qui incombe aux agences privées : celles-ci doivent fournir de façon régulière aux autorités publiques compétentes des informations sur leurs structures et leurs activités, informations qui seront mises à intervalles réguliers à la disposition du public.
De ce dispositif conventionnel découle toute une série d’avancées significatives.
Tout d’abord, en instaurant un cadre clair pour la réglementation, la convention no 181 constitue un gage de fiabilité et elle assure la protection effective des travailleurs contre des pratiques abusives en matière de rémunération, de santé ou de sécurité de la part d’agences intérimaires ou d’entreprises utilisatrices peu scrupuleuses. Ensuite, la libéralisation de l’activité de placement doit avoir des effets positifs sur l’emploi, en créant une dynamique favorable à la création d’emplois, en favorisant une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de main-d’oeuvre et en permettant de développer des compétences nouvelles et innovantes. Notons que cette libéralisation permet aux agences d’emplois privées de jouer un rôle complémentaire par rapport au service public de l’emploi. Pôle emploi peut ainsi y avoir recours pour mobiliser les compétences spécialisées dont il ne dispose pas en interne – en particulier en matière d’évaluation des compétences et de formation – ou pour augmenter ses capacités d’action et confronter ses méthodes et résultats à ceux d’autres opérateurs.
Par ailleurs, l’adoption de la convention de l’OIT n’entraîne pas de conséquences juridiques en droit français puisque l’activité privée de placement est conforme aux dispositions de ladite convention.
Enfin, toujours conformément à celle-ci, les services de placement reposent sur les principes inscrits dans la loi, à savoir : le principe de la gratuité pour le demandeur d’emploi, selon lequel aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement ; le principe de la non-discrimination des services et offres d’emploi proposés. C’est d’autant plus vrai que Pôle emploi, il faut le rappeler, continue de détenir les prérogatives régaliennes telles que l’inscription et la gestion de la liste de demandeurs d’emploi, le contrôle de la recherche d’emploi, l’accompagnement et le placement des demandeurs d’emploi.
En effet, aujourd’hui les agences d’emploi privées n’interviennent sur le marché du placement que dans le cadre des appels d’offres de l’opérateur de l’État, et cela pour deux raisons. D’une part, les services de Pôle emploi étant gratuits pour les entreprises, celles-ci n’ont pas un intérêt économique à avoir recours directement aux agences d’emploi privées, dont les services sont payants. D’autre part, le marché du placement n’est pas encore très développé, en raison de l’ouverture relativement récente aux agences d’emploi privées.
La convention no 181, entrée en vigueur le 10 mai 2000, a été ratifiée par vingt-sept pays, parmi lesquels figurent douze États membres de l’Union européenne. La France manque jusqu’à présent à l’appel. À l’époque, elle n’était pas en mesure de ratifier la convention en raison du monopole du placement détenu par l’Agence nationale pour l’emploi, devenu Pôle emploi, mais la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a ouvert le marché du placement à des organismes de placement privés et ainsi mis fin à un monopole qui n’était plus respecté dans les faits. Il ne subsiste donc aujourd’hui plus aucun obstacle de nature législative à la ratification de la convention.
Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera donc le projet de loi autorisant cette ratification, d’une part, parce que la convention no 181 promeut la libéralisation des activités des agences d’emploi privées et prend acte de l’importance de la flexibilité dans le fonctionnement des marchés du travail et, d’autre part, parce qu’elle offre un équilibre entre le besoin de flexibilité des entreprises et les besoins des travailleurs dans un environnement de travail sûr et dans des conditions de travail décentes.

Ce projet de loi vise à ratifier, pour la faire entrer dans notre droit national, la convention no 181 de l’Organisation internationale du travail. Cette convention permet aux agences d’emploi privées d’intervenir dans le placement des demandeurs d’emploi, de façon concurrente avec le service public de l’emploi. Il s’agit, comme le précise l’étude d’impact, de promouvoir la libéralisation des activités des agences d’emploi privées.
Cette ouverture au privé est, certes, encadrée par la convention. Ainsi, à titre d’exemple, les États continuent à régir les statuts de ces agences, et les droits fondamentaux des travailleurs sont garantis. Par contre, la gratuité des services pour les demandeurs d’emploi peut désormais être remise en cause puisque des dérogations sont possibles dans certains cas pour « certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés ». Nous souhaiterions, madame la secrétaire d’État, que vous nous précisiez de quels services il s’agit. Nous avons bien noté qu’il était obligatoire de consulter les organisations syndicales pour autoriser ces dérogations, mais cela n’atténue pas notre inquiétude.
En cas d’adoption de ce texte, cette convention s’imposera à la France, ce qui obligera notre législation à y être toujours conforme. Cette ratification n’est donc pas une simple formalité ; c’est la confirmation de l’inscription au coeur de notre droit de l’entrée des entreprises privées de placement des demandeurs d’emploi.
Le Gouvernement a tenté de faire ratifier ce texte par l’Assemblée nationale le jeudi 18 décembre dernier, juste avant les congés de fin d’année et sans avoir respecté les textes qui prévoient la consultation des organisations syndicales. Celles-ci ont fini par obtenir le report du débat et la tenue d’une réunion le 13 janvier dernier. Pour notre part, au regard des enjeux, nous nous sommes opposés à ce que ce projet de loi soit examiné dans le cadre de la procédure d’examen simplifiée et nous avons souhaité avoir un vrai débat. C’est dans ce contexte qu’il arrive en discussion aujourd’hui.
Nous ne partageons pas votre empressement à ratifier cette convention alors que d’autres, plus importantes pour les salariés, restent en souffrance, et d’autant plus que, du point de vue du droit français, la loi du 18 janvier 2005 a déjà ouvert le marché de la recherche d’emploi aux entreprises privées, et ce dans un cadre tout aussi protecteur que la convention de l’OIT, voire plus.
À l’époque, les députés du parti socialiste avaient alerté sur les dangers d’une telle libéralisation. Votre volonté de faire entrer rapidement cette convention dans notre droit signifie-t-elle que vous souhaitez encourager l’intervention directe des agences privées sur le marché de l’emploi, dans la perspective de leur donner davantage de place et d’empêcher la réversibilité de cette situation ? Ou encore signifie-t-elle que vous souhaitez introduire la possibilité de faire payer aux demandeurs d’emploi certains services fournis par ces agences ?
Votre volonté de conforter les entreprises privées dans ce secteur est d’autant plus incompréhensible que nous disposons du recul nécessaire et de données suffisantes pour faire le bilan de l’entrée des opérateurs privés sur le marché du placement des demandeurs d’emploi, et le moins qu’on puisse dire est que ce bilan n’est pas brillant. En effet, les différentes études démontrent que les entreprises privées ne sont pas plus performantes que le service public de l’emploi, au contraire. Il semble d’ailleurs que ce constat ne soit pas une spécificité française mais se retrouve dans d’autres pays.
C’est ce que révèle le collectif des « Autres chiffres du chômage », ou ACDC, dans son étude datée du 9 février 2012 sur les opérateurs privés de placement. Une des explications avancées dans ces travaux tient au mode de fonctionnement des opérateurs privés, qui interviennent le plus souvent en tant que sous-traitants du service public de l’emploi et recourent à des salariés précaires, en contrat de courte durée, pour accomplir la mission qui leur a été déléguée. Ces salariés précaires sont chargés de trouver du travail à des demandeurs d’emploi, sans avoir ni les moyens ni la possibilité de maîtriser pleinement leur sujet. En effet, comment développer un réseau d’acteurs à mobiliser, une connaissance du bassin d’emploi, du type d’emplois localement disponibles, lorsque l’on a un contrat de travail de quelques mois ?
D’ailleurs, le rapport parlementaire sur la performance comparée des politiques sociales en Europe souligne que « le succès de l’accompagnement tient principalement à la pratique du conseiller, c’est-à-dire sa bonne connaissance du bassin d’emploi […], sa capacité à mobiliser des aides utiles pour le demandeur d’emploi […], sa connaissance des prestations d’aides au retour à l’emploi et de leurs effets, […], sa relation avec le demandeur d’emploi ». Les connaissances des conseillers de Pôle emploi, leur savoir-faire sont donc une des clés d’un service public de l’emploi performant. Or toutes ces qualités s’acquièrent et se développent grâce au temps passé à exercer ce métier et à l’expérience, ce dont ne semblent pas disposer les salariés des entreprises privées de placement, du fait de leurs conditions d’emploi. Toutefois, les effets positifs du savoir-faire des personnels de Pôle emploi sont contrariés par le manque de moyens, situation largement exploitée par les opérateurs privés, qui, à la recherche de marchés publics, ont tout intérêt à décrier le service public, qualifié d’inefficace, de trop cher et d’inadapté, même si ces agences privées peinent à convaincre en raison de leurs résultats pour le moins nuancés.
De plus, de récentes affaires ont mis en lumière le manque de sérieux de ces opérateurs privés. Ainsi, au mois de février dernier, Pôle emploi a été contrainte de verser 3,5 millions d’euros d’avance sur marché à son prestataire pour lui éviter la liquidation et pour ne pas abandonner le suivi de milliers de personnes privées d’emplois, et ce alors même que, selon la presse, ce prestataire, C3 Consultants, a été sanctionné par l’État en raison de soupçons de fraude sur plusieurs marchés, en Seine-Saint-Denis notamment.
La presse révèle également que d’autres entreprises ont dû fermer après avoir été sanctionnées par Pôle emploi pour ne pas avoir respecté le cahier des charges. La pertinence du recours aux agences privées est donc loin d’être démontrée.
C’est pourquoi nous regrettons que par une délibération de février 2014, le conseil d’administration de Pôle emploi ait adopté le principe d’un changement d’orientation stratégique majeur pour 2015. Comme l’écrivait Christophe Castaner dans son rapport d’information sur le recours par Pôle emploi aux opérateurs de placement pour l’accompagnement et le placement des demandeurs d’emploi, « les demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché du travail, qui constituaient les publics souvent confiés aux opérateurs privés, ne se verront plus proposer d’accompagnement externalisé, mais un accompagnement renforcé dans le cadre de Pôle emploi ; en sens inverse, une nouvelle prestation serait créée dans le but de sous-traiter au secteur privé l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus autonomes. » En clair, les opérateurs privés accompagneront les personnes les plus proches de l’emploi, ce qui est le plus facile, et Pôle emploi s’occupera des cas les plus complexes, donc les moins rentables.
Nous estimons que le marché de l’emploi n’est pas un marché comme les autres, et qu’un gouvernement de gauche devrait avoir à coeur de remettre en cause le choix politique fait par la droite dans la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale – texte que l’opposition socialiste avait d’ailleurs combattu – et devrait par conséquent refuser de ratifier cette convention, qui conforte l’entrée des prestataires privés sur le marché de l’emploi en l’inscrivant dans notre socle de droit. D’ordinaire, c’est le patronat qui est vent debout contre ces conventions, à l’image de Pierre Gattaz qui appelle régulièrement la France à sortir de la convention no 158 de l’OIT. Cette fois-ci, le patronat est satisfait…

Permettez, cher collègue, que je donne mon avis.
Cette fois-ci, disais-je, le patronat est satisfait, et c’est l’intérêt des salariés qui est cause.
Cette situation est d’autant plus regrettable que de nombreuses conventions, en attente depuis plusieurs années, mériteraient d’être ratifiées rapidement parce qu’elles apporteraient un réel progrès pour les salariés. Je pense notamment à la convention no 143, qui oblige les pays l’ayant ratifiée à appliquer aux migrants légalement présents dans les limites de son territoire un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants. Cette convention traîne au fond des tiroirs depuis plus de trente ans ! Je pense également à la convention no 189, qui octroie une protection spécifique aux travailleuses et travailleurs domestiques. Il est fort dommage que vous ayez choisi de ratifier la convention no 181 qui, elle, pouvait attendre sans dommage !
Pour toutes ces raisons, madame la secrétaire d’État, chers collègues, nous voterons contre ce texte qui conforte les entreprises privées de placement de demandeurs d’emploi, alors qu’il faudrait au contraire renforcer le service public de l’emploi.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui nous propose de ratifier la convention no 181 de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées. Cette convention, adoptée par la Conférence internationale du travail le 19 juin 1997 à Genève, est entrée en vigueur le 10 mai 2000. À ce jour, elle a été ratifiée par vingt-sept pays, dont douze États membres de l’Union européenne. À l’époque, la France n’avait pas ratifié cette convention en raison du monopole du placement détenu par l’Agence nationale pour l’emploi, devenue depuis Pôle emploi.
La France n’a pas non plus, au cours de ces dernières années, dénoncé la convention no 96 de l’OIT, ratifiée en 1952, qui interdit le recours aux opérateurs privés dans le placement des demandeurs d’emploi, alors même que ceux-ci sont utilisés depuis le début des années 1990. La loi de 2005 pour la cohésion sociale ayant mis fin au monopole de Pôle emploi, la France devait se conformer à la réglementation de l’OIT en la matière. C’est l’objectif premier du texte qui nous est présenté aujourd’hui : ratifier la convention no 181, et dénoncer la convention no 96.
Les agences d’emploi privées définies par cette convention fournissent trois catégories de services : agences de placement ; entreprises de travail temporaires ; services d’aides à la recherche d’emploi. Le recours à des opérateurs privés dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi est un processus en développement depuis les années 1990. Ces agences, missionnées par les opérateurs publics, sont un moyen d’adaptation dans un contexte de chômage important, et ont beaucoup été utilisées au moment de la crise, entre 2008 et 2011. On constate toutefois depuis 2011 que Pôle emploi a moins recours à des opérateurs privés pour l’accompagnement et le placement des demandeurs d’emploi. Cela s’explique notamment par le coût de cette sous-traitance.
Le recours aux opérateurs privés de placement est par ailleurs évalué : c’est l’un des rôles du comité d’évaluation de Pôle emploi, présidé par un représentant des organisations syndicales. Le bilan des performances est clairement mitigé ; la Cour des comptes l’a notamment relevé dans un rapport. Mais c’est davantage le manque de pilotage public que les opérateurs privés de placement eux-mêmes qui est identifié comme source de dysfonctionnement. Il faut donc désormais que Pôle emploi intègre mieux le recours aux opérateurs privés dans sa stratégie.
Le recours à des agences d’emploi privées doit être encadré afin de prévenir les éventuels abus : c’est l’objectif de la convention dont nous débattons aujourd’hui. Ses différents articles définissent un cadre juridique, un socle de droits. La convention exige tout d’abord que les organismes privés concernés respectent les dispositions protégeant les travailleurs qui ont recours à leurs services. Les articles 4 et 5 garantissent, par exemple, la liberté syndicale et le droit à la négociation collective des travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées ; ils les protègent également contre toute forme de discrimination.
Nous en sommes très satisfaits, mais s’il un est domaine où l’on constate un grand écart entre la théorie et la pratique, c’est bien celui des demandeurs d’emploi et des salariés précaires ! Renvoyer à la négociation collective des organismes qui ont en fait tout pouvoir et des personnes en situation précaire est souvent peu réaliste. On sait aussi qu’en réalité, dans ce genre de situation, les organisations syndicales sont souvent absentes. Il est donc nécessaire que la puissance publique continue d’encadrer ce secteur.
Il est très important aussi que le principe de gratuité du service public de l’emploi soit rappelé et garanti par l’article 7 de la convention.
Nous avons rappelé en commission notre attachement au fait que l’accompagnement des demandeurs d’emploi soit toujours une mission régalienne. À ce sujet, l’article 13 rappelle que les autorités publiques conservent la compétence de décider en dernier ressort de « la formulation d’une politique du marché du travail » comme de « l’utilisation et du contrôle de l’utilisation des fonds publics destinés à la mise en oeuvre de cette politique. »
Enfin, si cette convention reconnaît le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail, elle favorise également la coopération entre services d’emploi publics et privés. C’est grâce à des partenariats entre différents acteurs, par des innovations, que nous trouverons des solutions nouvelles au problème du chômage, et pas essentiellement par la sous-traitance des politiques de l’emploi.
En France, la ratification de cette convention aura une portée seulement théorique. Elle n’aura en effet aucun impact sur la législation sociale française, car les dispositions qu’elle propose sont inférieures à notre droit. C’est d’ailleurs un aspect que nous retrouvons assez souvent lors de nos débats sur la ratification de telle ou telle convention internationale. Cette convention a malgré tout une portée globale non négligeable. En ratifiant ce texte, la France encourage la ratification de la convention par des pays à la législation sociale moins développée. Cette convention de l’OIT participe à la fabrication d’un filet social universel : cela nous semble un élément important du débat.
L’adoption de cette convention doit permettre à la France, qui est le deuxième État à avoir ratifié le plus grand nombre de conventions, de réaffirmer son attachement aux missions et aux règles de l’OIT. Ainsi, dans la perspective de la négociation du partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement, nous ne pourrons accepter que des conventions que nous avons ratifiées soient remises en cause, comme certaines organisations patronales le souhaitent.
Les agences d’emploi privées sont un élément d’accompagnement des demandeurs d’emploi, mais nous devons concentrer nos moyens sur l’amélioration du service offert par le service public de l’emploi. Nous devons améliorer l’articulation et la coopération avec les collectivités territoriales chargées du développement économique et de la formation. Nous devons également encourager d’autres réponses innovantes au chômage de masse. À cet égard, je pense notamment aux entreprises de l’insertion par l’activité économique, dont le rôle doit être renforcé aux côtés du service public de l’emploi.
Les députés socialistes voteront donc pour ce projet de loi de ratification, qui met en cohérence le droit interne et les engagements internationaux de la France.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur par intérim (Sourires), mes chers collègues, nous sommes invités aujourd’hui à examiner deux conventions internationales, qui ont soulevé bien des interrogations en commission. Ces interrogations prolongent d’autres questions posées par ceux qui ont eu le plaisir d’assister et de participer aux débats de mardi après-midi, qui portaient sur une convention internationale relative à la fiscalité. Je ne reviendrai pas sur le bien-fondé des préoccupations exprimées par mes collègues des différents groupes parlementaires.
Le groupe socialiste s’est prononcé favorablement sur les trois textes examinés : la convention fiscale négociée avec la principauté d’Andorre, la convention no 181 de l’Organisation internationale du travail, et l’accord sur les centres culturels négocié avec l’Azerbaïdjan dont nous allons débattre dans quelques instants. Cette approbation s’inscrit pleinement dans le cycle des préoccupations soulevées sur ces bancs.
Nous sommes favorables à ces textes parce qu’ils engagent la France, et que sous une forme ou sous une autre, ils accompagnent la bonne marche de notre influence extérieure. Qui, en effet, pourrait s’opposer à la lutte contre la fraude fiscale, à l’accès à notre culture et à nos valeurs, et à la consolidation d’une organisation internationale plus que nécessaire en ces temps de globalisation économique et sociale ?
Il n’en reste pas moins que le caractère particulier du droit international, fabriqué avec des partenaires étrangers, et donc soumis à des règles spécifiques, laisse au Parlement un espace d’intervention des plus limités. Les élus que nous sommes ont bien entendu un point de vue. Nous l’avons – vous l’avez – exprimé au cours des différents débats de ratification. Mais nous n’avons pas, sur ces questions internationales, la capacité d’amender le texte, ce qui est possible lorsque nous votons la loi. Nous pouvons approuver, rejeter, mais aussi – ne l’oublions pas – refuser d’examiner un texte international. Cette dernière option empêche, rappelons-le, l’inscription d’un instrument international à l’ordre du jour de notre assemblée.
La commission des affaires étrangères a pu, en certaines circonstances, utiliser cette faculté. Est-il possible d’aller au-delà ? La séparation des pouvoirs réserve à l’exécutif l’initiative et la négociation des traités ; soit. Mais sans doute pourrait-on imaginer la mise en place d’une communication régulière entre le Quai d’Orsay, le Sénat et l’Assemblée nationale, sur les textes en cours d’élaboration. Je propose à notre commission des affaires étrangères de réfléchir à ce sujet, en concertation avec vous, madame la secrétaire d’État.
Dans l’attente, nous pourrions explorer quelques pistes pour donner un peu plus de flexibilité à nos débats de ratification. Les conditions d’examen des textes mériteraient par exemple d’être améliorées : la commission est trop souvent saisie en urgence, et paradoxalement, les textes qui nous sont envoyés dans des conditions peu satisfaisantes sont inscrits à l’ordre du jour soit en début de semaine, le lundi, soit en fin de semaine, comme aujourd’hui. Cela explique que nous soyons si nombreux dans l’hémicycle ce matin !
Sourires.

Cette façon de procéder aggrave le malaise des parlementaires. Réviser ce mode de fonctionnement ne suppose pas de rupture conventionnelle, ni même de changer le règlement de l’Assemblée nationale. Il s’agit simplement d’avoir un peu de bon sens, et de faire preuve de bonne volonté réciproque ! Je vous demande votre avis, madame la secrétaire d’État, sur ce point.
J’ai évoqué, mardi dernier, une autre possibilité : le Gouvernement, singulièrement le ministère des affaires étrangères, peut assortir de clauses interprétatives la ratification d’un traité. Notre collègue Charles de Courson a signalé une possibilité voisine.
Par définition, une déclaration interprétative est unilatérale. En vue d’éviter tout malentendu, le Parlement peut donc proposer au ministre des affaires étrangères d’assortir la ratification d’un accord international d’une telle déclaration – nous l’avons d’ailleurs fait mardi dernier, sans succès, au sujet de la convention fiscale France-Andorre.
Compte tenu du contexte parlementaire de ces derniers jours, je souhaitais, madame la secrétaire d’État, soumettre à la réflexion collective – à mes collègues de la commission des affaires étrangères, à l’Assemblée nationale dans son ensemble, et au Gouvernement – ces remarques et ces propositions, que je vous remercie d’avoir écoutées.

La discussion générale est close.
La parole est à M. le rapporteur.
La parole est à M. Thierry Mariani, suppléant M. Édouard Courtial, rapporteur.

Je serai très bref, car je suis un rapporteur suppléant, un rapporteur intérimaire, ou, dans ce débat sur le droit du travail, un rapporteur précaire,…

… ce qui prouve d’ailleurs que la précarité est toujours en train de se développer, quelle que soit la majorité.
Sourires.

Plus sérieusement, j’insisterai simplement sur deux éléments, puisque la quasi-totalité des orateurs sont favorables à l’adoption de ce texte. Je fais remarquer très aimablement à Mme Fraysse, qui a parlé de précipitation, que la convention a été signée en 1997. Les gouvernements successifs – pour une fois, j’englobe la gauche et la droite dans cette précipitation collective – n’ont pas mis moins de dix-huit ans à se précipiter ! Je ne pense donc pas qu’on puisse parler de précipitation.
Ensuite, comme cela a été souligné par tous les orateurs et par Mme la secrétaire d’État, ce texte n’a quasiment aucun impact sur notre législation actuelle. Nous pouvions donc le mettre à l’ordre du jour de l’Assemblée très rapidement après l’épisode que nous avons connu en décembre.
Enfin, je m’associe aux remarques de Mme Guittet sur la méthode d’examen des projets de loi de ratification. S’agissant par exemple de la fameuse convention entre la République française et la Principauté d’Andorre, cela nous aurait permis d’éviter certains problèmes.
Je prends bien en compte l’ensemble de vos remarques et vos quelques réserves. Il s’agit du résultat d’une négociation internationale, donc d’un compromis entre des pays qui sont dans des situations totalement différentes. Je l’ai dit tout à l’heure, cette convention n’est pas moins protectrice que notre droit national. Il s’agit d’une mise en cohérence de notre droit, qui favorise la protection des salariés des agences comme des demandeurs d’emploi. Je rappelle combien le Gouvernement tient à ces éléments.
Madame la députée Jacqueline Fraysse, je le répète, cette convention ne libéralise pas le service public de l’emploi. Elle prend acte de la diversité des acteurs et intervenants dans ce domaine et donne un cadre protecteur à cette action. Vous l’avez rappelé, les partenaires sociaux ont été consultés en 2011, mais il avait été jugé souhaitable de les consulter à nouveau, ce qui a été fait en janvier 2015, à leur satisfaction, car ils ont eu une nouvelle occasion de s’exprimer.
Le recours à des opérateurs privés de placement permet à Pôle emploi de se concentrer sur ses missions essentielles – j’insiste sur ce point : l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragiles, qui en ont le plus besoin. De plus, même si Pôle emploi fait appel à un opérateur privé de placement, il continue d’intervenir : c’est lui qui procède au premier entretien, puis à l’entretien de bilan à la fin de la prestation.
Pôle emploi et les opérateurs chargés du service public de l’emploi partagent un cahier des charges.
Je rappelle également le principe de gratuité, auquel le Gouvernement tient,…
… comme les gouvernements précédents. Ce principe important conduit notre action, et personne ne le remet en cause aujourd’hui.
En outre, l’action des opérateurs privés de placement est bien sûr évaluée, comme l’ont dit plusieurs orateurs. M. Marsac a notamment rappelé qu’il s’agissait de l’un des éléments examinés par le comité d’évaluation de Pôle emploi. Certains rapports de la Cour des comptes, notamment celui de mai 2014, contribuent également à cette évaluation. Pour tenir compte de ces premiers bilans, Pôle emploi a rééquilibré et recentré sa doctrine en février 2014 et ces évolutions seront mises en application à compter de juillet 2015. L’évaluation est indispensable, tout comme la révision de tous les dispositifs pour les adapter à l’évolution des situations. Je vous remercie et espère votre soutien et l’adoption de ce texte.

J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, l’article unique du projet de loi.
L’article unique est adopté, ainsi que l’ensemble du projet de loi.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan relatif à la création et aux conditions d’activités des centres culturels (nos 784, 2396).

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du développement et de la francophonie.
Monsieur le Président, monsieur le rapporteur de la commission des affaires étrangères, Thierry Mariani, mesdames et messieurs les députés, …

C’est le vrai rapporteur cette fois-ci, non le rapporteur intérimaire !
Titularisé pour le deuxième essai, en effet ! C’est d’ailleurs pour cela que je l’ai cité nommément, cette fois-ci !
Sourires.
Vous avez souhaité débattre ce matin du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan relatif à la création et aux conditions d’activités des centres culturels.
Cet accord est important pour les relations franco-azerbaïdjanaises pour plusieurs raisons. Il vise d’abord à doter les centres culturels des deux pays d’un véritable statut, tout en définissant leurs missions et leurs obligations vis-à-vis du droit local. Côté français, l’Institut français est actif à Bakou depuis 2004. Créé avec le soutien du Parlement sous le nom de Centre culturel français George-Sand, ce centre joue un rôle majeur dans la diffusion de la langue française, dans la formation des élites mais aussi dans le débat d’idées.
Cet institut a pu exister et fonctionner avant la signature de cet accord, en 2009, mais il nous faut maintenant consolider son statut en droit international. Vecteur d’influence important, participant au rayonnement de la France, de sa culture et de ses valeurs, il contribue à la mise en oeuvre de notre politique culturelle – avec une programmation « dans et hors les murs » – et de coopération, non seulement à Bakou mais aussi dans l’ensemble du pays.
L’apprentissage de la langue française y tient une place essentielle : plus de 500 étudiants y sont inscrits chaque année. Cet institut est aussi un centre d’examen et d’information sur les études en France. En tant que secrétaire d’État chargée de la francophonie, permettez-moi de souligner cet aspect essentiel, notamment au regard des événements récents. La France défend des valeurs universelles, en particulier la solidarité internationale, valeurs qu’il nous faut, à plus d’un titre, rappeler. Faire connaître notre langue, attirer les étudiants étrangers, n’est-ce pas le meilleur moyen de transmettre ces valeurs de tolérance, de solidarité, de fraternité ? Qui seront nos meilleurs ambassadeurs demain, si ce n’est les étudiants que nous aurons formés ? C’est une question que nous devons nous poser régulièrement.
L’Institut français est aujourd’hui reconnu comme une référence qui compte dans le paysage azerbaïdjanais. L’accord que je soumets à votre approbation permettra de lui donner une dimension supplémentaire. En effet, en l’absence d’un accord fixant son statut, il reste largement dépendant de la bonne volonté des autorités locales pour poursuivre ses missions. En revanche, l’Azerbaïdjan ne dispose pas pour l’instant d’un centre culturel à Paris, même si son ambassade possède un service culturel très actif. Cet accord pourrait rendre envisageable que Bakou ouvre un centre culturel en France, ce que justifierait le dynamisme de nos échanges culturels. Il est donc important que cet accord puisse être ratifié sans plus tarder et entrer pleinement en vigueur.
Deuxièmement, la France a conclu des accords similaires avec un grand nombre d’États, afin de définir les conditions de fonctionnement des instituts français à l’étranger. L’accord avec l’Azerbaïdjan s’inscrit dans ce cadre. Parce que la France croit aux vertus du dialogue et des échanges culturels, parce qu’elle affirme les valeurs de la diversité et de la solidarité, elle a initié il y a plus d’un siècle la création d’un vaste réseau d’établissements culturels à travers le monde. Ce réseau est le plus ancien et le plus important dispositif de ce type. Il s’inscrit dans le cadre de la diplomatie française d’influence. Les importants moyens qui lui sont consacrés témoignent de la volonté de la France de promouvoir la diversité culturelle. L’apprentissage de la langue française y tient une place essentielle, mais aussi la participation au débat d’idées, le dialogue entre les cultures, la coopération culturelle, ainsi que la documentation sur la France et les études en France. Des priorités spécifiques ont été définies pour chaque grande région du monde.
Troisièmement, cet accord intervient dans le contexte d’un important développement de nos relations bilatérales. La visite officielle du Président de la République à Bakou en mai 2014, comme première étape d’une tournée dans le Caucase du sud, a illustré la dynamique de nos relations. Cette visite a notamment permis un renforcement de nos relations économiques, grâce à la signature de plusieurs contrats dans le domaine des transports, ainsi qu’une relance de la coopération universitaire pour encourager les étudiants azerbaïdjanais à venir se former plus nombreux en France. Les grands contrats signés ou en cours de négociation permettront de rééquilibrer un commerce bilatéral structurellement déficitaire au détriment de la France, avec, en 2013, 266 millions d’euros d’exportations contre 1 688 millions d’euros d’importations, du fait de nos achats d’hydrocarbures à ce pays important producteur de pétrole et de gaz.
La France est par ailleurs co-médiatrice, avec les États-Unis et la Russie, sur le conflit du Haut-Karabagh, qui oppose l’Azerbaïdjan à l’Arménie. À ce titre, le Président de la République a accueilli, le 27 octobre dernier à Paris, un sommet arméno-azerbaïdjanais, pour faire avancer la recherche d’un règlement pacifique à ce conflit. À l’issue du sommet de Paris, les Présidents arménien et azerbaïdjanais ont décidé de procéder à des échanges de données sur les disparus du conflit, sous l’égide du Comité international de la Croix-Rouge – le CICR. Il s’agit là de la première mesure de confiance que les deux pays aient accepté de mettre en oeuvre. C’est un geste important de leur part, alors que, comme le prouvent les soixante tués recensés en 2014, ce conflit continue de faire des victimes, plus de vingt ans après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Les Présidents arménien et azerbaïdjanais sont convenus en outre de poursuivre leur dialogue, notamment lors d’une nouvelle rencontre en septembre 2015, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York. La France entend, quant à elle, continuer son travail de médiation, en honnête courtier bénéficiant de l’amitié et de la confiance des deux parties.
Quatrièmement, cet accord nous permet, à plus long terme, de promouvoir nos valeurs. Je suis consciente des critiques émises contre l’Azerbaïdjan en matière de droits de l’homme, et j’imagine que ces critiques, davantage que l’accord en tant que tel, expliquent la tenue de ce débat ce matin. Je tiens à cet égard à assurer la représentation nationale que le Gouvernement suit de très près la situation des libertés individuelles dans ce pays. La France a ainsi marqué publiquement sa préoccupation à la suite des arrestations de la défenseure des droits de l’homme Leyla Yunus à la fin du mois de juillet dernier, puis de la journaliste Khadija Ismayilova, début décembre. Nous soutenons les démarches européennes en cours sur le cas de Mme Yunus et les questions de droits de l’homme sont régulièrement évoquées lors de contacts bilatéraux avec les autorités azerbaïdjanaises. Par ailleurs, la France s’est à plusieurs reprises exprimée publiquement sur les arrestations et les condamnations de défenseurs des droits de l’homme ou de membres de l’opposition, parmi lesquels Ilgar Mammadov. La France ne ménage pas ses efforts dans ce domaine.
À vos interrogations légitimes, que vous ne manquerez pas d’exprimer tout à l’heure, je vous réponds sans ambiguïté : maintenir le dialogue avec Bakou, y compris sur les droits de l’homme et la liberté de la presse, est indispensable.
Et ce dialogue sera facilité par la qualité de nos relations bilatérales, notamment dans le domaine culturel. Il est important de soutenir tout ce qui peut accompagner l’évolution de la démocratie dans ce pays : l’Institut français est justement un espace de liberté, qu’il faut aujourd’hui conforter.
La ratification de cet accord, plus de cinq ans après sa signature, correspond donc pleinement aux intérêts de la France. L’Institut français doit bénéficier d’un véritable statut juridique pour pouvoir pleinement jouer son rôle de diffuseur d’idées et de valeurs, et c’est cela qu’il s’agit de promouvoir aujourd’hui, a fortiori après les tragiques événements que nous venons de traverser. Je ne doute pas, mesdames et messieurs les députés, que vous serez également convaincus de l’intérêt de voter cette convention.
Applaudissements sur les bancs des groupes RRDP et SRC.

La parole est à M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’accord qui nous est soumis a été conclu avec l’Azerbaïdjan. Il concerne, vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État, les conditions de fonctionnement des centres culturels établis, de façon bilatérale, dans nos deux pays.
Il existe depuis 2004 un centre culturel français à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan. Ce centre a pris en 2011, dans le cadre de la réforme de notre réseau culturel, l’appellation d’Institut français d’Azerbaïdjan. Cet Institut français est certes assez modeste, avec un budget d’environ 350 000 euros et 25 employés, à temps plein ou partiel. Son activité principale consiste à dispenser des cours de français.
Cet institut joue un rôle significatif dans la promotion de la francophonie à Bakou, puisque y ont été dispensés à plusieurs centaines de personnes, en 2013, des cours de français. C’est en partie grâce à lui que le français demeure, encore aujourd’hui, la troisième langue étrangère enseignée en Azerbaïdjan, après le russe et l’anglais, mais devant l’allemand.
Cet institut gère également une médiathèque qui comporte plus de 7 500 titres et organise des examens, des manifestations culturelles ainsi que des actions d’information sur les études en France.
Avec le lycée français de Bakou – qui a été créé plus récemment, grâce à l’aide et au financement de l’Azerbaïdjan –, l’Institut français d’Azerbaïdjan est un élément essentiel de notre présence culturelle et éducative dans ce pays.
Cette présence est d’autant plus nécessaire qu’à Bakou, comme ailleurs, nous nous trouvons, en quelque sorte, en concurrence avec les autres grands pays. Y sont en effet également implantés l’Agence des États-Unis pour le développement international, l’USAID, le British Council, l’Institut Confucius, un centre culturel russe, ainsi que, en ce qui concerne la Turquie, l’institut Yunus Emre. Bref, l’Azerbaïdjan se situe véritablement au confluent de toute une série d’influences et de cultures.
Il est donc important d’être présent en Azerbaïdjan, car ce pays constitue un partenaire intéressant, tant au niveau économique que politique et culturel.
Il présente d’abord un intérêt économique, du fait de ses ressources en hydrocarbures et de sa position géographique. L’Azerbaïdjan n’est certes ni le Qatar, ni la Russie. Il ne détiendrait en effet qu’à peine 0,5 % des réserves mondiales d’hydrocarbures. Il a en outre peut-être dépassé son pic de production pour le pétrole, qu’il exploite depuis le XIXe siècle. Il n’en restait pas moins, en 2013, le vingt et unième producteur mondial de pétrole, ainsi que le huitième fournisseur de la France. Plus de 5 % de nos importations de brut proviennent toujours aujourd’hui d’Azerbaïdjan. S’agissant du gaz, ce pays conserve des perspectives significatives avec la mise en exploitation prochaine du gisement de Shah Deniz 2. GDF Suez s’est engagé à écouler une partie de la production qui en sera issue.
Dans l’hypothèse où le gazoduc transcaspien serait réalisé, l’Azerbaïdjan se situerait par ailleurs également sur la route de transit du gaz en provenance du Turkménistan.
Ces ressources pétrolières font de l’Azerbaïdjan un pays prospère, qui a connu, dans les années 2000, une croissance très rapide. Il a bien traversé la crise de 2008 et affiche, encore aujourd’hui, une croissance enviable. Elle devrait en effet approcher les 5 % en 2015.
Il s’agit donc d’un pays solvable qui attire les entreprises françaises, et pas seulement Total ou GDF Suez, qui sont là pour d’évidentes raisons. Je pense en particulier au groupe CNIM, qui a fourni l’usine d’incinération de Bakou, à Alstom, qui finalise actuellement le contrat de fourniture des voitures du métro de Bakou, ou encore à Danone, à Lactalis ainsi qu’à Air Liquide.
Il représente également un marché où les exportations françaises, tirées par les ventes d’Airbus, sont en forte augmentation, même si le commerce bilatéral reste à ce jour fortement déficitaire en notre défaveur.
L’Azerbaïdjan constitue également un partenaire politique qui compte, avec lequel nous avons d’ailleurs des relations de haut niveau très suivies. Uniquement au cours de l’année 2014, le Président Hollande s’est rendu à Bakou au mois de mai et le Président Aliyev à Paris au mois d’octobre. Ces relations de haut niveau ne sont pas seulement justifiées par les enjeux économiques.
Elles sont également liées, en effet, au rôle joué par la France dans les tentatives de règlement du principal problème international auquel l’Azerbaïdjan est confronté, celui du conflit avec l’Arménie, dans la région séparatiste du Haut-Karabagh.
Sans revenir longuement sur ce conflit, qui n’a rien à voir avec l’accord dont nous débattons aujourd’hui, je rappellerai que, depuis le cessez-le-feu de 1994, une grande partie du territoire de l’Azerbaïdjan – à peu près 20 % –, allant bien au-delà du Haut-Karabagh à proprement parler, est occupé par les forces arméniennes. Cette occupation a été condamnée par l’ONU comme par le Conseil de l’Europe, car elle est contraire au droit international. En effet, en 1993, le Conseil de sécurité a successivement adopté à ce sujet plusieurs résolutions très claires.
Aux termes de la résolution 884 par exemple, il était « exigé » un retrait unilatéral des forces arméniennes des divers territoires occupés en Azerbaïdjan, ces forces étant qualifiées de « forces d’occupation ».
En 2005, de même, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une résolution 1416, où elle « rappelle que l’occupation d’un territoire étranger par un État membre constitue une grave violation des obligations qui incombent à cet État en sa qualité de membre du Conseil de l’Europe, et réaffirme le droit des personnes déplacées de la zone du conflit de retourner dans leur foyer dans la sécurité et la dignité ». Ce conflit a en effet eu pour conséquence un nombre important de réfugiés.
La France copréside avec la Russie et les États-Unis ce que l’on appelle le groupe de Minsk, lequel n’a certes pas réussi à régler le conflit. Il a néanmoins évité, jusqu’à présent, une nouvelle escalade, malgré des incidents très fréquents sur la ligne de démarcation.
Dans ce dossier, les deux parties sont cependant reconnaissantes à la France de sa mission de bons offices. Cette mission a notamment été à l’origine de la rencontre organisée à Paris, au mois d’octobre dernier, entre les Présidents azerbaïdjanais et arménien.
L’intérêt des relations politiques avec l’Azerbaïdjan tient également à la position prudente et équilibrée de la diplomatie de ce pays. De plus en plus, on assiste en effet dans l’ancien espace soviétique à une sorte de bipolarisation entre les différents pays qui en font partie. Certains d’entre eux se trouvent en conflit avec la Russie et cherchent le soutien occidental : je pense à l’Ukraine, à la Géorgie, et à la Moldavie. D’autres ont accepté, avec quelques réticences par moments, d’entrer dans l’Union eurasiatique avec la Russie : je pense au Belarus, au Kazakhstan, et à l’Arménie.
Dans ce contexte, l’Azerbaïdjan a, nous le reconnaîtrons, une position originale et indépendante. Ce pays est effectivement parvenu à maintenir, jusqu’à présent, de bonnes relations aussi bien avec la Russie qu’avec l’Occident, en affirmant sa volonté d’indépendance. Il n’est candidat ni à une entrée dans l’OTAN, ni à une entrée dans l’Union européenne, ni à une entrée dans l’Union eurasiatique.
Dans ce tableau général, l’accord que nous étudions aujourd’hui a, vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, une portée assez limitée. Son impact sera en réalité très faible, j’allais dire presque nul. Au point que, lorsque j’ai contacté notre conseiller de coopération et d’action culturelle à Bakou, il était étonné car il pensait que l’accord dont nous discutons avait déjà été ratifié.
Je suis convaincu que cet accord ne posera aucun problème. C’est pourquoi je serai bref quant à son contenu.
Tout d’abord, il prend acte formellement de l’existence du centre culturel français à Bakou, lequel n’a pas eu besoin de cet accord, je l’ai dit, pour exister puisque les autorités azerbaïdjanaises n’ont fait jusqu’à présent aucun problème. Cependant, grâce à cet accord, cet institut verra son statut consolidé en droit international. L’accord autorise aussi, par réciprocité, l’ouverture éventuelle d’un centre culturel azerbaïdjanais à Paris. Il n’existe pour le moment qu’une section culturelle au sein de l’ambassade, qui a été inaugurée en 2012 par le Président Aliyev en personne.
L’accord comprend ensuite des dispositions relatives aux missions et aux activités des centres culturels. Ces mentions peuvent apparaître triviales, mais elles sont importantes. Elles visent en effet à garantir la liberté des centres culturels visés – en l’espèce, pour le moment, le seul Institut français d’Azerbaïdjan – en matière de programmation de leurs activités, dès lors que celles-ci sont visées par cet accord.
Enfin, cet accord garantit aussi la liberté des centres culturels en matière d’organisation d’activités hors de leurs locaux, ainsi que le libre accès du public à ces activités.
Il comprend, enfin, des dispositions classiques dans ce genre d’accords, telles que des exemptions fiscales pour l’importation de biens, notamment culturels, par lesdits centres, ainsi que des dispositions relatives aux personnels.
À cet égard, cet accord permet notamment au centre culturel de Bakou de se voir, conformément à la pratique dans notre réseau culturel, dirigé par un diplomate, en l’espèce le conseiller de coopération et d’action culturelle. Ce statut diplomatique du directeur concourt aussi à garantir le libre fonctionnement du centre. Ce dernier ne bénéficie pas, en tant que tel, de la même immunité.
Mais, je le redis, le conseiller de coopération et d’action culturelle en poste m’a confirmé que notre centre culturel ne rencontrait, depuis sa mise en place, strictement aucune difficulté avec les autorités locales.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à approuver cet accord, qui a été négocié à la demande de la France. Il consolide juridiquement l’existence d’un outil de notre politique d’influence dans un pays stable et francophile, qui est, pour des raisons économiques, mais aussi politiques, un partenaire important de la France.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis ce matin pourrait être l’occasion d’évoquer l’importance, selon le terme utilisé par le rapporteur, ainsi que les enjeux de la diffusion de la francophonie dans une région où, historiquement, la France a été peu présente mais où l’on constate aujourd’hui une demande croissante de culture française.
Que la France ait créé et financé depuis 2004, à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, un centre culturel où sont dispensés des cours de français, ne manque pas d’intérêt et ne pose, en soi, aucune difficulté. Il est donc tout naturel que cet Institut français d’Azerbaïdjan fasse, demain, l’objet d’une reconnaissance internationale.
L’accord qui nous est présenté ne suscite, pour ce qui nous concerne, aucune réserve ni remarques particulières, mais, chacun l’aura compris, le débat ne saurait se limiter à ce seul aspect culturel des relations franco-azerbaïdjanaises.
C’est d’ailleurs pourquoi, contrairement à l’habitude, l’examen du projet de loi autorisant l’approbation de cet accord de partenariat fait l’objet, ce matin, d’une discussion en séance publique et non de la procédure dite simplifiée qui limite les interventions aux travaux en commission.
Le rapporteur a élargi le débat, puisqu’il a cru bon de souligner certaines particularités de l’Azerbaïdjan, notamment sur le plan des droits de l’homme et de la démocratie. Il est parti de l’idée que l’Azerbaïdjan est, je cite ses propos en commission, « un partenaire politique important pour notre pays, lequel s’implique traditionnellement dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. C’est aussi un pays où les entreprises françaises s’implantent, du fait principalement de sa richesse en hydrocarbures. »
On le comprend, l’Azerbaïdjan est perçu comme un partenaire stratégique, et sa politique étrangère est, de l’avis de bien des experts, profondément déterminée par le conflit du Haut-Karabagh.
Ce ne sont malheureusement pas les informations en provenance de la République du Haut-Karabagh qui peuvent nous rassurer, avec encore, dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier, huit nouvelles tentatives d’incursion par les forces azéries. Nous en sommes ainsi à deux cent vingt violations du cessez-le-feu, accompagnées de tirs, avec plus de deux mille tirs de projectiles en quelques heures. Ces tirs ont provoqué la mort de plusieurs soldats.
Ces agressions se multiplient et les forces azéries ne se contentent plus de tirs isolés. Ainsi, cet été, elles ont abattu un hélicoptère.
À peine vingt ans après le cessez-le-feu, on ne peut que déplorer ce climat de guerre entretenu et ces violations répétées du cessez-le-feu de 1994. Jamais la paix n’a paru aussi fragile.
La France n’a jamais été indifférente à ce conflit. Elle l’a montré en maintes occasions. Cela a été notamment le cas, dernièrement, lorsque le Président de la République a reçu à Paris, le 27 octobre dernier, les Présidents d’Azerbaïdjan et d’Arménie.
La France a toujours oeuvré en faveur de la recherche d’une solution de paix durable, ne serait-ce qu’en participant activement aux travaux du groupe de Minsk, dont je sais qu’il assure un contact indispensable entre belligérants et qu’il empêche la reprise du conflit ouvert.
Nous sommes conscients qu’il n’y aura pas de paix durable tant que l’on ne parviendra pas à assurer la sécurité des peuples de cette région du monde. Pour cela, il convient d’agir pour le développement d’un espace de dialogues et d’échanges, ce qui suppose, au préalable, de mettre un terme à l’isolement international que l’on impose au peuple du Haut-Karabagh.
Je vous ai attentivement écouté, monsieur le rapporteur, cher collègue. Lorsque vous délaissez le champ culturel, comme ce fut le cas lors de votre présentation en commission, vous mettez en perspective d’autres considérations moins consensuelles. Vous comprendrez que, sur un sujet aussi sensible, on puisse apporter un éclairage complémentaire. Aussi, je me permets de dire sans détour que l’Azerbaïdjan, dans les faits, est manifestement loin d’être le pays démocratique que certains veulent décrire.
D’ailleurs, il n’y a qu’à regarder les classements de ce pays à partir de différents critères permettant d’évaluer la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, le classement établi par l’organisation Freedom House désigne l’Azerbaïdjan parmi les pays « non libres », le classement sur la liberté d’informer, publié chaque année par l’organisation Reporters sans frontières place l’Azerbaïdjan dans le cercle des États les moins libres, en cent soixantième position sur 180 pays. Le Président Aliyev figure quant à lui parmi les dix « prédateurs mondiaux de la presse ». À titre d’exemple, la Biélorussie, l’Irak, la Birmanie sont mieux classés que l’Azerbaïdjan.
Comment qualifier un État où l’on se transmet le pouvoir de père en fils, où un véritable clan, le clan Aliyev, détient depuis des décennies l’ensemble des leviers décisionnels, aussi bien au plan politique ou militaire qu’au plan économique ?
En 2009, le chef de l’État est parvenu à faire abolir par référendum populaire, ratifié par 90 % du corps électoral, la limitation du nombre de mandats présidentiels. Il est ainsi assuré de rester indéfiniment au pouvoir. Comment, dans ces conditions très particulières, analyser des résultats où le président sortant est systématiquement réélu à plus de 80 ou 90 % ?
Où sont les progrès démocratiques dans un pays où la presse est muselée, où toute contestation publique du régime est impossible sous peine de sanctions sévères ? J’en veux pour preuve les innombrables atteintes contre les droits de l’Homme, les partis politiques d’opposition, les ONG, etc., ce qui fait régulièrement l’objet de rapports ou de communications par des organisations de défense des droits fondamentaux, comme Human Rights Watch, qui dénonce l’existence de prisonniers d’opinion dans ce pays.
Tout récemment, le bureau de Radio Free EuropeRadio Liberty à Bakou a été frappé à son tour par la répression. Le 26 décembre dernier, le bureau à Bakou de radio Azadliq et le service azerbaïdjanais de RFERL ont été perquisitionnés et placés sous scellés.
Je ne peux passer sous silence le sort réservé à Mme Leyla Yunus, éminente défenseure des droits de l’Homme, et à son mari Arif, analyste politique réputé, ce qui est révélateur. Mme Yunus est décorée de la Légion d’honneur et lauréate du prix international Theodor Haecher, remis en Allemagne, pour le courage et la sincérité politique. Elle et son mari ont été arrêtés à Bakou au printemps 2014 et ont subi un véritable harcèlement pour avoir dénoncé notamment l’arrestation du journaliste Hilal Mammadov, dont vous avez parlé, madame la secrétaire d’État. D’autres militants des droits humains comme Rasul Jafarov ou Intigam Aliyev ont fait l’objet de mesures arbitraires d’arrestation. Quotidiennement, la liberté de la presse, la liberté d’expression, la liberté d’opinion sont violées par le régime.
Comment ne pas évoquer ici également la bien triste affaire Safarov, du nom du meurtrier d’un officier arménien, tué dans son sommeil à Budapest lors d’un stage de l’OTAN auquel il participait, tout simplement parce qu’il était arménien ? L’assassin fut condamné par la justice hongroise, mais extradé dans son pays avant le terme de sa peine, puis gracié et promu héros national.
À cela s’ajoute la décision prise par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe de ne plus tenir de réunion de commission en Azerbaïdjan pendant deux ans, à la suite de la décision des autorités azerbaïdjanaises d’annuler au dernier moment le visa d’un membre de cette assemblée, notre collègue et ami René Rouquet, président de la délégation française, l’empêchant ainsi d’assister aux réunions du bureau et de la commission permanente de l’APCE à Bakou les 22 et 23 mai derniers. Cette violation des règles du Conseil de l’Europe conduit à marginaliser un peu plus l’Azerbaïdjan en Europe.
Si nul d’entre nous n’ignore les enjeux économiques en présence, ni ce que peuvent sous-entendre certaines exigences pétrolières ou gazières dans le contexte mondial actuel, nous affirmons que cela ne doit en aucun cas conduire à passer sous silence toutes ces atteintes répétées aux droits humains, à la démocratie et aux valeurs universelles.
Face au choix qui nous est proposé, d’un côté les hydrocarbures et, de l’autre, les droits de l’homme, prenons garde à ne pas laisser s’installer l’idée selon laquelle seules compteraient les valeurs du marché. Ne fermons pas les yeux sur les manquements de certains dirigeants peu scrupuleux.
Il est du devoir de la France, berceau des droits de l’homme, de rappeler le caractère intangible et universel des grands principes. C’est en tenant ferme ce cap que notre diplomatie obtiendra des résultats et fera respecter notre vision du progrès et du développement humain.
Compte tenu de tous ces éléments, madame la secrétaire d’État, vous comprendrez que je ne puisse à titre personnel approuver ce projet de loi. Aussi, comme je l’ai fait en commission, je m’abstiendrai.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis la reconnaissance de l’indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991, la France entretient avec cet État du Caucase des relations bilatérales régulières. En témoignent les visites particulièrement nombreuses ces dix dernières années, au niveau présidentiel et au niveau ministériel, en raison notamment de l’implication française dans la recherche d’une solution au conflit du Haut-Karabagh.
La fréquence de ces échanges traduit l’intensité des relations entre les deux pays. Le grand nombre d’accords, treize, conclus entre la France et l’Azerbaïdjan en est l’illustration. Pour n’en citer que quelques-uns, il y a la ratification le 20 décembre 1993 d’un traité d’amitié, d’entente et de coopération, l’accord de janvier 2007 sur la coopération dans le domaine du tourisme, ou encore, dans le domaine de l’éducation, l’accord relatif à la création de l’École française de Bakou, signé en novembre 2011.
Cette relation étroite s’observe aussi par des échanges économiques importants. L’Azerbaïdjan affiche un très large excédent commercial avec l’ensemble des États de l’Union européenne, dont le nôtre, qui, après l’Italie, est son deuxième pays importateur et son cinquième fournisseur.
Les importations françaises en provenance d’Azerbaïdjan sont composées exclusivement de produits énergétiques. Des entreprises françaises y sont implantées, principalement présentes dans le secteur pétrolier, la banque, les télécommunications, l’électricité et le bâtiment. L’Azerbaïdjan est donc, de très loin, en valeur, le pays du Caucase avec lequel la France a développé les relations commerciales les plus fortes.
Les relations culturelles le sont tout autant. La présence française y repose sur le service de coopération et d’action culturelle de son ambassade à Bakou et sur l’Institut français d’Azerbaïdjan.
Ce dernier, créé en 2004, est aujourd’hui une référence en Azerbaïdjan dans tous les domaines de la coopération et de l’action culturelle. Il contribue en effet à la mise en oeuvre de la politique culturelle et de coopération de la France, tant à Bakou que dans l’ensemble du pays. L’apprentissage de la langue française y tient une place essentielle, avec plus de 500 étudiants annuels. Centre d’examen, l’établissement donne des informations sur les études en France et met à disposition du public une offre documentaire et multimédia diversifiée, riche de plus de 7 500 ouvrages. Il propose une programmation culturelle variée, participe aux débats d’idées, à la diffusion des savoirs, à la coopération universitaire et scientifique, en lien avec les universités et les centres de recherche.
Comme la plupart des centres culturels dans les pays de la zone, l’Institut français d’Azerbaïdjan n’a pas de statut officiel. Il n’est présenté que comme un service de l’ambassade de France, et ce même s’il a bénéficié d’un traitement favorable de la part des autorités locales.
La France et l’Azerbaïdjan ont donc souhaité doter l’établissement d’un statut juridique clair. C’est dans ce cadre que, le 9 décembre 2009, a été signé entre les deux parties un accord relatif à la création et aux conditions d’activités des centres culturels, qui vise, à travers ses 19 articles, à doter les centres culturels des deux pays d’un véritable statut tout en définissant leurs missions et leurs obligations vis-à-vis du droit local.
Il est tout d’abord stipulé une autorisation réciproque d’ouverture de centres culturels entre les deux pays. Il est en effet prévu formellement l’existence d’un centre culturel français à Bakou et, réciproquement, la création d’un centre culturel azerbaïdjanais à Paris. L’accord dispose que ces centres culturels sont placés sous l’autorité des ambassades de leur État d’envoi et ont la personnalité juridique de celui-ci, mais doivent avoir la capacité de passer dans l’État d’accueil les actes nécessaires à leur fonctionnement. Ce statut d’autonomie limitée correspond à l’organisation administrative actuelle de notre réseau culturel.
Cet accord définit ensuite les missions des centres avec, par exemple, la diffusion à un large public de connaissances sur l’histoire, les beaux-arts et la culture, le potentiel scientifique, culturel et économique de leurs États respectifs, et, également, leurs activités avec, entre autres, l’organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions.
En définissant ces missions et activités, l’accord vise à garantir la liberté des centres culturels. Cette liberté comprend également la possibilité d’organiser des activités hors de leurs locaux sur l’ensemble du territoire de l’État d’accueil et la garantie par l’État d’accueil du libre accès du public aux activités des centres.
L’accord prévoit par ailleurs des exemptions fiscales pour les centres culturels. S’il est stipulé le caractère non lucratif de l’activité des centres, il est toutefois précisé en effet que ceux-ci peuvent, afin de couvrir leurs frais de fonctionnement, et dans le respect de la réglementation nationale de l’État d’accueil, vendre des ouvrages, percevoir divers droits comme des droits d’inscription à leurs cours de langue et leurs autres activités.
Il permet également d’appliquer le principe selon lequel un établissement culturel n’exerce pas d’activité commerciale, et, à ce titre, n’est pas assujetti à la fiscalité locale. Ainsi, les centres bénéficient, dans le respect du principe de réciprocité et de la réglementation nationale de l’État d’accueil, de l’exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l’importation concernant par exemple les biens mobiliers, divers ouvrages et films destinés à être visionnés ou projetés dans les locaux des centres.
Enfin, cet accord aborde les questions relatives au statut du personnel des centres culturels. Il revient, à ce titre, à chaque pays de nommer le personnel de son centre, avec la possibilité d’en confier la direction à un diplomate. Cependant, ces nominations doivent faire l’objet d’une information à l’État d’accueil.
Cet accord, relatif à la création et aux conditions d’activités des centres culturels, permet à la France de consolider son vaste réseau d’établissements culturels à travers le monde, initié il y a plus d’un siècle, qui fait de lui le plus ancien, un réseau dense et diversifié, qui a su s’adapter à l’évolution du monde, avec, au cours des années, un profond renouvellement de ses implantations, de ses missions et de ses modes de fonctionnement, une présence culturelle à l’étranger qui s’inscrit aujourd’hui dans le cadre d’une diplomatie française d’influence et de solidarité.
Les importants moyens qui lui sont consacrés témoignent de la volonté concrète des autorités françaises de promouvoir la diversité culturelle, avec, notamment, la volonté de donner à l’apprentissage de la langue française une place essentielle, de promouvoir la participation au débat d’idées, le dialogue entre les cultures, la coopération culturelle.
Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutient donc ce projet de loi autorisant l’approbation de cet accord, et ce à plus d’un titre, d’abord parce que cet accord garantit à la France la poursuite de sa diplomatie culturelle et d’influence dans un cadre juridique cohérent, ensuite parce qu’il assure une complète réciprocité à l’Azerbaïdjan, qui pourra mettre en place, lorsqu’il le souhaitera, un centre culturel en France, enfin, parce qu’il consolide les relations avec un État dont la situation géopolitique et économique est importante pour la France et dont le développement doit être poursuivi pour assurer sa stabilité et son association à la sphère d’influence européenne.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, l’accord qu’il nous revient d’examiner aujourd’hui aux fins de ratification traite de la création et des conditions d’activité des instituts culturels français et azerbaïdjanais dans l’État partenaire. Député des Français de l’étranger, familier des instituts culturels de ma circonscription, je ne peux que soutenir un tel texte, qui consolide en droit le statut de l’Institut français d’Azerbaïdjan, dont je salue ici les personnels et les quelque 500 apprenants.
Je vous rejoins, monsieur le rapporteur, lorsque vous affirmez qu’il est important pour la France d’être présente en Azerbaïdjan. Je n’ignore pas la richesse de ce pays, notamment en hydrocarbures. Je n’ignore pas les marchés que la France peut et doit y conquérir. Je n’ignore pas davantage la position politique de l’Azerbaïdjan, aussi prudente qu’indépendante, au sein de l’ancien espace soviétique. Votre rapport décrit bien ces réalités-là, importantes dans le contexte international. Il fait en revanche silence sur les droits de l’homme, et je le regrette beaucoup. Je vous l’avais dit lors de l’examen en commission, à la fin de l’année passée, et je vous le redis ce matin en séance.
Un institut culturel n’est pas un endroit neutre, où l’on apprendrait une langue, un vocabulaire, une grammaire, une syntaxe en dehors de tout idéal, de tout cadre de pensée, de tout système de valeurs. Derrière la langue française, il y a une histoire, il y a des convictions, il y a un combat. Derrière la langue française, il y a la liberté,…

…cette liberté tellement malmenée en Azerbaïdjan ces dernières années. Ce n’est pas faire insulte à ce beau et grand pays, à sa culture et à son peuple que de l’affirmer. C’est en revanche encourir l’assurance d’indisposer un régime, dont la relation à la démocratie est à tout le moins distendue.
J’assume cette critique. L’Azerbaïdjan est membre du Conseil de l’Europe, la maison européenne du droit. Respecter fidèlement la Convention européenne des droits de l’homme et les arrêts de la Cour européenne de Strasbourg est une obligation. Or, quelles conclusions tirer quand la société civile azerbaïdjanaise, le dos au mur, se bat pour ne pas sombrer face aux arrestations arbitraires, aux détentions sans fin, à la violence, à l’intimidation, au harcèlement et aux disparitions forcées ?

Je pense ici à Leyla Yunus, militante des droits de l’homme, dirigeante de l’Institut pour la paix et la démocratie, finaliste du prix Sakharov décerné par le Parlement européen, qui est maintenue en détention depuis des mois sous des motifs fantaisistes et sans le moindre jugement, tout comme son mari Arif. Quels sont leurs seuls torts ? Avoir porté haut et fort la cause des droits de l’homme. Avoir asséné un certain nombre de vérités, qui, à l’évidence, dérangent. Avoir recherché le dialogue avec le voisin arménien, pour dépasser les fractures de l’histoire, les atavismes et les haines recuites, pour construire enfin la paix.

Je pense à l’avocat Intigam Aliyev, qui coordonnait les programmes de formation juridique du Conseil de l’Europe à Bakou et qui avait mené le combat devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Il est lui aussi en détention sans jugement depuis des mois.
Je pense à Anar Mammadli, lauréat en septembre 2014 du prix Vaclav Havel, décerné par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui purge cinq années et demie de prison pour infraction à la législation sur les organisations non-gouvernementales.
Je pense enfin à la jeune activiste Gulnara Akhundova, travaillant à Copenhague pour l’organisation non-gouvernementale International media support, dont le témoignage bouleversant devant la commission des affaires juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 30 octobre dernier à Madrid – j’y étais –, a valu à sa mère, le 3 novembre, à Bakou, un interrogatoire musclé et la mise à sac de son domicile en présence de sa fille âgée de 7 ans.

Dans un rapport récent, en date du mois d’octobre 2014, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Nils Muižnieks, déplorait la détérioration continue de l’État de droit et du respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme en Azerbaïdjan. Les difficultés sont de plusieurs ordres, touchant en particulier à la liberté d’expression, de réunion et d’association. La liberté d’expression est brimée lorsque se multiplient les procédures contre les journalistes critiques à l’égard du pouvoir. Cela s’étend de plus en plus également aux blogueurs et aux personnes actives sur les réseaux sociaux. Ces procédures – il faut le savoir – conduisent en prison.
La pénalisation de la diffamation, elle aussi, mène derrière les barreaux les voix dissonantes, malgré les recommandations répétées de la Commission de Venise appelant les autorités azerbaïdjanaises à la dépénalisation de la diffamation, qui est un grand, long et beau combat du Conseil de l’Europe. La liberté d’association est en péril lorsque diverses exigences administratives apparaissent subitement concernant l’enregistrement des organisations non-gouvernementales, leur financement, en particulier quand il provient d’une source étrangère, et leurs rapports d’activité, aboutissant de facto à un assujettissement en vertu du contrôle exercé par le ministère de la justice.
Enfin, la liberté de manifester est attaquée lorsque de nombreuses manifestations, pourtant pacifiques et bien organisées, sont interdites, et que les participants sont arrêtés et parfois même condamnés à de lourdes peines.
Mes chers collègues, on ne peut débattre d’un accord avec l’Azerbaïdjan sans avoir ce contexte-là à l’esprit.

Un pays dont tous les défenseurs des droits de l’homme sont en prison, à l’hôpital ou en exil est un pays qui ne se porte pas bien. Un pays dont la récente présidence du Comité des ministres du Conseil de l’Europe s’est traduite par une offensive sans précédent dans l’histoire de l’organisation contre la société civile et les droits de l’homme mérite la critique internationale, notamment celle de la diplomatie parlementaire. Si l’Azerbaïdjan demandait aujourd’hui à nouveau son adhésion au Conseil de l’Europe, un tel bilan se traduirait à l’évidence par un rejet.

Certes, je connais et j’accepte les exigences de la Realpolitik. Je ne passe pas cependant la liberté, le droit et les droits par pertes et profits.

C’est parce que j’ai la conviction que le travail d’un institut culturel français est un formidable investissement dans la liberté, dans l’esprit critique et dans l’avenir que je voterai la ratification de la convention qui nous est soumise. Ce ne sera toutefois pas sans avoir saisi l’occasion de ce débat dans notre hémicycle pour dire, comme député français et membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ma solidarité avec celles et ceux qui luttent pour un Azerbaïdjan juste et libre. Leur combat est celui des valeurs qui unissent nos démocraties. Il est celui de l’État de droit. Il est celui d’une communauté de destins, notre plus belle et notre plus grande richesse : l’Europe.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs des groupes UMP et UDI.

Monsieur le président, madame le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, l’Azerbaïdjan est un pays profondément attaché à son indépendance et cette particularité le relie très évidemment à la France. Il faut avoir beaucoup de courage et de volonté pour être indépendant quand on a pour voisin, au nord, la Russie et, au sud, l’Iran. C’est une première raison d’entretenir les meilleurs rapports possibles avec l’Azerbaïdjan.
La deuxième raison, que nous avons peu évoquée jusqu’à maintenant, c’est son extraordinaire laïcité. Par les temps qui courent, elle est essentielle. Ce pays compte 70 % de musulmans chiites, 20 % de musulmans sunnites et environ 10 % de chrétiens orthodoxes, de juifs, de catholiques et de protestants. Jamais il n’y a eu le moindre affrontement entre ces différentes religions au sein de l’Azerbaïdjan. Les juifs d’Azerbaïdjan, qui sont sur ce territoire depuis 2 500 ans, vous diront qu’il n’y a jamais eu le moindre acte ni même la moindre pensée antisémite à leur égard. Le pays est un symbole de laïcité qui mérite d’être cité dans ces temps terribles que nous traversons.
Il existe en France une demande de coopération, qui est également très forte en Azerbaïdjan. Elle se manifeste à travers toutes les actions, culturelles notamment, menées par l’ambassade d’Azerbaïdjan en France, laquelle développe aussi d’importantes coopérations décentralisées avec de nombreuses communes de France. C’est une manière de coopération propice au développement de la démocratie.
J’entendais tout à l’heure certains de nos collègues dire que la démocratie est insuffisante en Azerbaïdjan. Certes, il reste des progrès à accomplir, mais il ne faut pas exagérer non plus. Je rappelle que ce pays a donné le droit de vote aux femmes en 1918, soit un quart de siècle avant nous. Il est membre du Conseil de l’Europe depuis 2001. Il a présidé le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe en 2014. Il a déjà réalisé des progrès importants en matière démocratique. Ne soyons pas trop donneurs de leçons. Il nous a fallu pratiquement un siècle pour stabiliser notre démocratie en France, de 1789 à 1880 ; or, l’indépendance de l’Azerbaïdjan ne date que de 1991.
On leur reproche également le conflit du Haut-Karabagh. Mais, là encore, ne nous laissons pas trop abuser par certaines manipulations. Certes, ce conflit qui concerne l’Arménie et l’Azerbaïdjan est tragique et dure depuis trop longtemps, mais il ne faut pas oublier que le Haut-Karabagh représente 20 % du territoire azerbaïdjanais et qu’il est actuellement occupé – c’est l’ONU elle-même qui le dit – par l’Arménie. Cela s’est traduit par la fuite de 900 000 réfugiés hors de ce territoire vers d’autres zones de l’Azerbaïdjan. On ne le dit pas suffisamment.
Il faut trouver une solution et c’est en cela, comme vous l’avez dit à juste titre tout à l’heure, madame le secrétaire d’État, que la France a un rôle majeur à jouer. Notre pays copréside le groupe de Minsk avec les États-Unis et la Russie et nous avons à plusieurs reprises, et récemment encore, à l’occasion de la rencontre entre le Président de la République, le président arménien et le président azerbaïdjanais, suscité toutes les tentatives nécessaires pour faire avancer les choses. Je souhaite vivement que nous poursuivions en ce sens et que nous parvenions à une solution pacifique et juste pour le conflit du Haut-Karabagh. Il serait particulièrement heureux que la France en soit l’auteur.
Voilà, chers collègues, autant de raisons de voter à l’unanimité, je l’espère, ce projet de loi qui se fonde sur l’excellent rapport de notre collègue Thierry Mariani. Il va dans le bon sens et montre que la France et l’Azerbaïdjan sont des partenaires et des amis loyaux et fidèles.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l’Azerbaïdjan, que l’on nomme aussi « Terre de feu », est riche d’une histoire fascinante et d’un patrimoine culturel extraordinaire. Ce pays, issu de l’Union des républiques socialistes soviétiques a retrouvé son indépendance en 1991 – cela a déjà été évoqué, mais il convient de le rappeler. Cet État caucasien, plutôt que de diviser, comme je l’ai entendu, fait partie de ceux qui sont le trait d’union entre le monde occidental et l’Asie centrale.
L’accord qui nous est soumis aujourd’hui concerne les relations bilatérales entre la France et l’Azerbaïdjan quant aux conditions de fonctionnement des centres culturels. En qualité de président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan, j’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, de visiter notre centre culturel, et je dois dire que j’ai été impressionné par le travail effectué par ceux qui y travaillent. Il existe depuis 2004, et a pris l’appellation d’« Institut français d’Azerbaïdjan » depuis 2011, dans le cadre de notre réseau culturel. Cet établissement fonctionne bien. Il est modeste – son budget est de l’ordre de 350 000 euros –, mais il accueille régulièrement 300 personnes et joue un rôle important dans le développement de la francophonie en Azerbaïdjan, à l’instar du lycée français, qui a ouvert ses portes pour la rentrée scolaire de 2013 et que j’ai eu l’occasion de visiter. Thierry Mariani a rappelé que le français était la troisième langue étrangère enseignée – après le russe et l’anglais. Aujourd’hui, 80 000 personnes apprennent le français.
L’Institut français d’Azerbaïdjan administre une médiathèque qui comporte, outre des livres – notre rapporteur a cité le chiffre de 7 500 volumes, mais il me semble qu’elle en compte plutôt 9 000, en français bien sûr mais aussi en d’autres langues –, des journaux, des périodiques, des bandes dessinées, des CD, ou encore des DVD. Il utilise les outils technologiques modernes adaptés aux nouvelles méthodes d’enseignement en vigueur chez nous aujourd’hui. Il est le seul centre agréé pour la passation des examens de langue française. L’intérêt du présent accord est qu’il affirme les prérogatives de l’Institut : il énonce ses activités, définit ses règles de fonctionnement et en assure la liberté.
Nous entretenons des relations constantes avec l’Azerbaïdjan – j’en veux pour preuve les visites des présidents de chacun de nos deux pays en 2014. Thierry Mariani et moi-même sommes tous deux membres de l’OSCE. Je puis en témoigner, monsieur Le Borgn’ : les problèmes de l’Azerbaïdjan y sont constamment évoqués. S’agissant du Haut-Karabagh, il faut écouter les invectives de part et d’autre, et je puis vous dire qu’il est très difficile de se faire une idée. Je me félicite que notre pays copréside le groupe de Minsk, avec les États-Unis et la Russie, afin qu’un jour on voie enfin la paix revenir sur ce territoire.
En tant que président du groupe d’amitié, je ne peux que me réjouir d’un projet de loi qui scelle cet accord, et je vous invite, mes chers collègues, à émettre un vote favorable.

Tout d’abord, je constate, même si certains s’abstiendront pour des raisons que l’on peut comprendre, que tout le monde est d’accord sur le texte ; c’est là l’essentiel. Je rappelle qu’il s’agit de ratifier un accord qui permettra à la France d’avoir gratuitement un centre culturel.
Comme Pierre-Yves Le Borgn’, je suis député des Français de l’étranger, et à ce titre je visite les centres culturels un peu partout, qu’il s’agisse des instituts ou des alliances françaises, et je peux témoigner que cet accord est d’autant plus important que l’on assiste à une baisse de crédits par endroits dramatiques – ce n’est pas propre à ce gouvernement, je reconnais que cela avait déjà commencé sous l’ancien. L’Azerbaïdjan est plutôt bien doté, mais je tiens à évoquer un cas très grave, celui de l’Alliance française de Moldavie, troisième en Europe : baisse des subventions de 75 % en un an, soit de 78 000 euros à 20 000 euros sans préavis. C’est d’autant plus grave qu’il s’agit d’un pays extrêmement francophile – comme la Roumanie ; d’ailleurs, la Moldavie et la Roumanie sont très proches à tous points de vue –, dont le Premier ministre et tous les chefs de l’opposition et de la majorité parlent français.
Je profite donc de votre présence, madame la secrétaire d’État chargée de la francophonie, pour tirer le signal d’alarme : étudiez le dossier de la Moldavie. Un accord d’association avec l’Europe est sur le point d’être signé, tous les pays européens renforcent leurs positions dans ce pays, alors que nous, nous sommes en train de baisser pavillon. Certes, il est normal que l’on ferme notre consulat, puisqu’il n’y a plus besoin de visas, mais les postes ainsi récupérés devraient permettre de ne pas brimer l’Alliance française.
Quant au reste, nous ne sommes pas ici pour refaire le débat sur l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Je suis député des Français des deux pays : j’aime profondément l’Azerbaïdjan, dont j’ai présidé le groupe d’amitié, et profondément l’Arménie, où je suis allé plusieurs fois. Je pense que le rôle des parlementaires français est, comme nous l’avons fait vis-à-vis de l’Allemagne – je le dis en me tournant vers Arlette Grosskost, députée de l’Alsace –, d’essayer de rapprocher ces deux pays plutôt que de se faire le champion de l’un ou de l’autre parce qu’on sait très bien qu’au final, ils s’en sortiront beaucoup mieux le jour où il y aura la paix dans le Caucase et non des tensions éternelles.

La situation politique est ce qu’elle est : un pays occupe 20 % de l’autre. Des résolutions du Conseil de sécurité ont condamné clairement cette situation.
Monsieur Rochebloine, vous avez cité trois associations, mais il est tout de même étonnant qu’elles soient toutes américaines.

Je suis fasciné par les parlementaires français qui prennent comme référence des organisations américaines dont on sait la dépendance totale par rapport au gouvernement américain : Human Rights Watch, Radio Free Europe et Freedom House.

Je ne connaissais pas Freedom House et, grâce à vous, je me suis penché sur cet organisme. Première constatation : il place l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans la même catégorie.

Il est vrai qu’en ce qui concerne la liberté de la presse, ce n’est pas terrible, pour le dire gentiment. Je suis persuadé que vous avez vu son site : on voit très nettement que cette association est financée par le gouvernement américain. Je vous invite à regarder sa page de garde. On y apprend que le pays qui représente, selon cette association, le plus grave danger en ce moment, est… la Grèce ! Je sais qu’il y a des problèmes là-bas, mais qu’il représente le plus grave danger dans le monde à l’heure actuelle m’avait échappé. Je me méfie de tous ces classements, mais particulièrement de celui-là, qui met par exemple sur le même plan la Grèce et la Bulgarie.
Est-ce que l’Azerbaïdjan est une démocratie parfaite ? Bien sûr que non.

…pas plus que la Géorgie. Rappelons que ces pays n’ont qu’une vingtaine d’années d’indépendance. Il faut les accompagner. Jean-François Mancel a rappelé à juste titre que la tolérance religieuse est extraordinaire en Azerbaïdjan. Je vous invite à vous rendre devant l’ambassade d’Israël à Bakou : vous n’y verrez pas un policier – je n’ose pas dire combien on doit en mettre en France…

En conclusion, monsieur le président, il faut voter ce texte qui garantit la présence française. En tant que parlementaires français, nous sommes tous attachés à la paix. Notre rôle – Michel Voisin est président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan, François Rochebloine est membre du groupe d’amitié France-Arménie – est de favoriser le dialogue et de mettre de l’huile dans les rouages plutôt que de l’huile sur le feu.
Pour ramener de la sérénité dans cet hémicycle, je tiens à dire que je remercie beaucoup ceux qui se sont exprimés. Tous ont tenu des propos forts et réalistes.
Monsieur Rochebloine, monsieur Le Borgn’, le Gouvernement est totalement conscient des atteintes aux libertés individuelles en Azerbaïdjan, atteintes que vous avez l’un et l’autre énumérées avec beaucoup d’émotion. Le ministère des affaires étrangères a exprimé ses préoccupations à ce sujet à plusieurs reprises, ainsi que la Haute représentante de l’Union européenne au nom de l’ensemble des États membres.
Notre dialogue et notre coopération avec Bakou portent toujours sur l’ensemble des sujets, y compris, je le réaffirme ici, sur la défense des droits de l’homme car la France est porteuse, comme tous les orateurs l’ont rappelé, de valeurs universelles. Le ministère pense toutefois avoir davantage d’influence à Bakou en maintenant le dialogue, que vous-mêmes avez appelé de vos souhaits, pour résoudre un certain nombre de conflits et pour participer à des débats avec la société civile grâce à l’Institut français d’Azerbaïdjan que nous allons conforter juridiquement aujourd’hui.
C’est d’autant plus pertinent – M. Mancel l’a souligné lui aussi – que ce pays est situé dans un environnement géopolitique complexe, avec comme voisins la Russie au nord et l’Iran au sud, et a le souhait de développer ses relations avec l’Europe, notamment avec la France, ce dont nous devons nous féliciter. La France, amie à la fois de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, est fortement engagée dans la médiation portant sur le conflit du Haut-Karabagh. J’ai ainsi rappelé l’organisation, par le Président de la République, du sommet du 27 octobre dernier. Par conséquent, aussi bien publiquement que dans nos contacts proprement bilatéraux, nous appelons régulièrement les autorités des deux pays à s’abstenir de déclarations belliqueuses…
...et, au contraire, à préparer leur opinion publique à la paix. Il faut certes être deux pour la faire, mais aussi des pays comme la France pour le rappeler régulièrement.
Applaudissements sur tous les bancs.

J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, l’article unique du projet de loi.

La parole est à M. Yves Jégo, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Le groupe UDI est évidemment très attaché au rayonnement culturel de la France, et celui-ci est en jeu derrière le texte que l’on examine ce matin. Nous considérons que le rôle joué par notre pays dans le règlement des conflits dans le Caucase est particulièrement important et qu’il faut à cet égard conserver une forme de neutralité en ne prenant pas position de façon trop tranchée pour éviter que la diplomatie parlementaire n’entrave les efforts du Gouvernement.

La position très clairement exprimée par notre collègue Rochebloine est une position personnelle, comme il l’a lui-même reconnu. Elle n’engage donc pas le groupe UDI qui, dans sa majorité, ne la partage pas.
Sourires.
L’article unique est adopté, ainsi que l’ensemble du projet de loi.
La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante.


La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur de la commission des lois, mesdames et messieurs les députés, votre assemblée entame ce matin l’examen en deuxième lecture de la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Le Sénat avait lui-même voté ce texte le 22 janvier 2014, il y a un an, jour pour jour. Vous connaissez l’ambition et l’économie générale de ce texte ; je souhaite donc simplement en rappeler quelques principes.
Nos élus locaux accomplissent une tâche noble et difficile. Chaque jour, ils mettent leur énergie au service de l’intérêt général. Dans une société de plus en plus individualiste et dématérialisée, où le lien social se distend, ils restent les premiers garants de la continuité républicaine. Ils doivent de surcroît faire face à des contraintes de plus en plus lourdes. L’argent public est rare, les normes sont multiples et nos concitoyens de plus en plus exigeants.
Le choix de représenter ses concitoyens et de se mettre au service de l’intérêt général, vous le savez comme moi, n’est pas un choix facile, d’autant plus que tout le monde ne concourt pas à égalité dans la compétition démocratique.
À cela, il y a d’abord des raisons financières. Faut-il rappeler que 80 % des élus municipaux ne perçoivent aucune indemnité ? Leur engagement, de jour comme de nuit, la semaine comme le week-end, est donc le plus souvent bénévole. Cet engagement est lourd. Cela explique que les élus soient souvent des agents de la fonction publique, qui bénéficient d’un statut leur offrant la possibilité de retrouver leur emploi au terme de leur mandat. Quand ils ne sont pas fonctionnaires, ils sont retraités ou exercent une profession libérale.
Parce qu’ils incarnent l’autorité publique, les élus locaux doivent aussi être exemplaires en tous points, et ils le sont.
Le Président de la République a fait le choix clair d’une refondation profonde de notre vie politique. Grâce aux réformes relatives à la transparence de la vie publique, à la lutte contre l’évasion fiscale, à l’instauration de la parité dans les conseillers départementaux et à la fin du cumul des mandats, nous avons déjà beaucoup fait pour moderniser la vie politique de notre pays. C’est un texte important qu’il vous revient d’examiner aujourd’hui car les dispositions qu’il apporte permettront à de nouveaux citoyens de s’engager dans la vie publique sans pour autant devoir renoncer à leur carrière professionnelle.
Cette proposition de loi des sénateurs Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, issue des travaux des états généraux de la démocratie territoriale, organisés au Sénat en octobre 2012, offre en effet de nouvelles garanties aux élus qui exercent une activité professionnelle et améliore leur droit à la formation.
Ainsi que l’a souligné le président Jean-Jacques Urvoas lors de vos débats en commission, le rapport intitulé Renouer la confiance publique, remis le 6 janvier dernier par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, M. Jean-Louis Nadal, au Président de la République, fait amplement référence au rapport d’information déposé par les députés Philippe Doucet et Philippe Gosselin sur le statut de l’élu, ainsi qu’aux travaux sur la présente proposition de loi, en soulignant en particulier l’intérêt de la charte de l’élu local.
Je saisis cette occasion pour saluer la qualité d’un travail parlementaire exemplaire qui a su rassembler au-delà des clivages partisans, car vous êtes tous députés de tous les territoires de la République. Lorsqu’il s’agit de la vie démocratique locale, les clivages s’estompent pour permettre d’avancer.
La navette parlementaire dure depuis désormais près de deux ans et le Premier ministre s’était engagé lors du dernier congrès de l’Association des maires de France, en novembre dernier, à faire inscrire rapidement cette proposition de loi à l’ordre du jour de votre assemblée. C’est maintenant chose faite.
Les quelques divergences qu’exprime le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture ne portent en rien sur l’amélioration nécessaire des conditions d’exercice des mandats locaux. Elles traduisent seulement, sur certains points, des choix différents quant aux moyens d’atteindre cet objectif.
Les articles que vos deux assemblées ont votés dans les mêmes termes apportent une réponse aux principales préoccupations des élus locaux.
Ces demandes ou inquiétudes ont trait au régime indemnitaire, à l’accès aux prestations sociales soumises à condition de ressources, aux garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, au remboursement des frais exposés par les élus dans l’accomplissement de leurs fonctions, aux conditions de réinsertion professionnelle et à la formation.
Votre commission des lois a introduit des précisions et des coordinations nécessaires afin que l’application du texte n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les collectivités territoriales.
Sur l’initiative de son rapporteur, M. Philippe Doucet, dont je souhaite saluer la qualité du travail mené tout au long de la navette parlementaire, la commission a constaté l’absence de consensus et de nécessité juridique immédiate à faire évoluer la définition de la prise illégale d’intérêts. En conséquence, elle a supprimé l’article 1er A. Sur ce point particulier, je tiens à vous dire que le Gouvernement partage votre point de vue. En effet, modifier cette définition n’est sans doute pas la meilleure solution. En dix ans, la jurisprudence s’est stabilisée et un changement législatif pourrait susciter de nouveaux débats et bouleverser la jurisprudence, que les élus connaissent bien désormais. Ajoutons que, chaque année, moins de trente condamnations concernent des élus, lesquels sont au nombre de 618 384.
Par ailleurs, en adoptant deux amendements de votre rapporteur, la commission a rétabli, au sein de la charte de l’élu local, la disposition selon laquelle les élus s’abstiennent de s’octroyer des avantages personnels futurs, qu’ils siègent en vertu de la loi et agissent, à tout moment, conformément à celle-ci.
Elle a rétabli l’article 1er bis A qui vise à sanctionner financièrement l’absence sans motif valable des élus aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Votre commission des lois, tenant compte des avancées contenues dans ce texte, a voulu affirmer, en imposant cette règle plus stricte, le nécessaire équilibre entre les droits et les devoirs. Elle a rétabli le financement de l’allocation différentielle de fin de mandat par une cotisation obligatoire assise sur les indemnités de fonction des élus ainsi que le financement du droit individuel à la formation des élus locaux par une cotisation obligatoire de ces derniers, au taux d’au moins 1 % du montant de leurs indemnités.
Sur l’initiative de votre rapporteur, elle a fixé l’entrée en vigueur des dispositions financières applicables aux conseillers régionaux au prochain renouvellement des conseils régionaux, prévu en décembre 2015, et aux conseillers municipaux et conseillers départementaux à la date du 1er janvier 2016.
Le texte qui vous est soumis aujourd’hui intègre donc des dispositions pragmatiques répondant aux attentes de nos élus locaux.
La France a besoin d’élus responsables et compétents – ils le sont –, de toutes professions et de tous horizons – ils ne le sont pas assez –, animés par la seule passion du bien public – c’est le cas – et pourvus de la capacité matérielle d’exercer leurs fonctions. Cette proposition de loi les y aidera en leur donnant les moyens de remplir la plus belle des missions : celle de servir la République.
Applaudissements sur tous les bancs.

La parole est à M. Philippe Doucet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, deux ans quasiment jour pour jour après la première lecture de ce texte par le Sénat, nous allons conclure aujourd’hui la deuxième lecture de la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
Après avoir été adopté en première lecture à l’unanimité au Sénat, puis dans un très large consensus dans notre assemblée, ce texte a de nouveau été adopté à l’unanimité de la commission des lois la semaine dernière.
Nous avons réussi à dépasser bon nombre de réflexes et de postures pour apporter des réponses pratiques à des enjeux réels pour les élus de nos territoires.
Le premier défi que nous sommes en mesure de relever avec ce texte est celui du juste équilibre entre les droits et les devoirs dans l’exercice de leurs responsabilités par les élus locaux.
Le travail de la mission d’information conduite avec notre collègue Philippe Gosselin a démontré l’absolue nécessité de redéfinir ce point d’équilibre pour insuffler une nouvelle vigueur démocratique dans l’exercice des mandats locaux et d’encourager, en amont, les vocations de nos concitoyens qui veulent s’engager pour leur territoire. C’est le sens de la charte de l’élu local, ce nouveau rite républicain solennel, introduit par notre commission des lois en première lecture et dont le principe a été validé au Sénat. L’exigence en matière de présence des élus procède elle aussi de ce même mouvement d’exemplarité, qui doit redonner du sens à l’exercice d’un mandat local.
Le deuxième défi auquel cette proposition entend répondre consiste à donner aux élus locaux les moyens d’accomplir pleinement leurs mandats. Tout au long de nos travaux, les élus locaux, par leurs associations représentatives, nous ont alertés sur un certain nombre de manquements et de freins au plein exercice de leurs responsabilités. À celles et ceux qui s’investissent et qui servent leur collectivité, la loi doit accorder des compensations justes et de nature à permettre à chaque élu de concilier vie privée, vie professionnelle et engagement public. Rappelons que 80 % des élus ne perçoivent pas d’indemnités de fonction. De même, l’existence d’un droit à la formation des élus demeure vaine si les pouvoirs publics ne se préoccupent pas des modalités pratiques de sa mise en oeuvre, c’est-à-dire du financement et des conditions de l’offre de formation destinée aux élus.
Or, depuis le vote des premières lois de décentralisation en 1982, le rôle des élus locaux n’a cessé de se complexifier au fur et à mesure de l’attribution de nouvelles compétences aux différents niveaux de collectivités. La présente proposition de loi apporte des réponses concrètes et fournit un cadre clair pour l’établissement réel de la formation des élus.
Le temps qui nous a été imparti n’a pas été inutile : il nous a permis de soupeser les dispositions du présent texte tout en progressant dans la recherche d’un consensus entre les deux assemblées.
La proposition de loi fait en effet l’objet d’une assez large convergence de vues entre le Sénat et l’Assemblée nationale. J’en veux pour preuve 1e nombre important de dispositions déjà adoptées conformes. Or, ces dispositions revêtent un caractère essentiel si nous voulons apporter des améliorations concrètes à la condition d’élu local.
Il s’agit en premier lieu du régime indemnitaire des élus : par le vote conforme des assemblées, le montant de l’indemnité de fonction des maires et des présidents de délégation spéciale sera désormais fixé par principe au montant maximal qui résulte de l’application du taux prévu par la loi.
En deuxième lieu, le Sénat et l’Assemblée nationale ont convenu de la nécessité d’étendre le champ des dispositifs existants concernant les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle. Cette orientation commune se traduira demain par l’extension du nombre d’élus susceptibles de bénéficier du congé électif, du crédit d’heures, du droit à suspension du contrat de travail, du droit à la réintégration professionnelle ou encore de l’application du statut de salarié protégé.
Il convient enfin de signaler les dispositions relatives au remboursement des frais exposés dans l’accomplissement des fonctions électives, ainsi que celles qui concernent les conditions de réinsertion professionnelle des élus ou de leur formation. Avec l’accord du Sénat, nous disposons d’un texte qui permettra aux élus de bénéficier d’une allocation différentielle de fin de mandat rénovée : c’est une allocation plus protectrice grâce au doublement de sa durée de versement, mais aussi une allocation qui incite à la reprise d’une activité professionnelle dans un délai raisonnable, compte tenu de son caractère dégressif. Les élus pourront exercer le droit individuel à la formation que le texte leur reconnaît, et bénéficieront en outre d’un système de dépenses obligatoires pour la formation des élus, ou encore de l’organisation obligatoire d’une formation au cours de la première année de mandat.
Nous faisons ici un grand pas vers l’égal accès aux fonctions électives. Souvenons-nous qu’en 2012, notre pays ne comptait que 14,4 % de femmes parmi les maires et 7,2 % parmi les présidents de structures intercommunales, seulement cinq femmes présidentes de conseils généraux et une seule présidente de région ! Et que dire des phénomènes de surreprésentation de certaines catégories socio-professionnelles ? Les élus ne reflètent pas la diversité de la société française. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que, même s’il ne s’agit pas d’un « grand soir », nous entamons tout de même, avec cette proposition, une discrète révolution.
Il va de soi que le diable se niche souvent dans les détails, et le Sénat ne s’est pas fait faute de revenir ici ou là – parfois de manière substantielle – sur certaines dispositions auxquelles l’Assemblée nationale avait pourtant souscrit ou qu’elle avait étoffées. Ainsi, tout en approuvant notre projet de charte de l’élu local, le Sénat a choisi d’en resserrer la portée en limitant le nombre de principes qu’elle rappelle.
Cela étant, il me semble qu’il existe, sur le plan des principes, une réelle communauté de vues concernant les voies – sinon les moyens – d’une réelle amélioration des conditions d’exercice des fonctions électives locales. Bien souvent, nous le verrons, les modifications apportées par les sénateurs ne reflètent pas une divergence d’objectifs. Elles traduisent plutôt un choix différent concernant les moyens employés pour les atteindre. En tout état de cause, elles n’hypothèquent en rien la possibilité d’un accord. À cet égard, il convient de saluer le rôle joué par le rapporteur du texte au Sénat, M. Bernard Saugey, qui a su faire la preuve d’une certaine bienveillance dans l’analyse et la présentation des apports de l’Assemblée nationale.

Ce même esprit de conciliation a présidé à l’examen du texte par la commission des lois de l’Assemblée nationale, qui l’a en effet adopté à l’unanimité après y avoir apporté plusieurs modifications, afin de parvenir à un plein équilibre entre la revalorisation des droits des élus et la réévaluation de leur devoir d’exemplarité.
La commission a notamment constaté l’absence de consensus et de nécessité juridique immédiate à faire évoluer la définition de la prise illégale d’intérêts. Cependant, il nous a semblé important d’affirmer ou de réaffirmer des règles nécessaires à l’exercice des fonctions électives et correspondant aux exigences démocratiques de notre temps. En adoptant deux amendements de son rapporteur, elle a rétabli au sein de la charte de l’élu local le point rappelant que les élus siègent par et pour la loi de la République et le fait qu’ils s’abstiennent de s’octroyer des avantages personnels futurs. Cependant, par souci de conciliation, la commission n’a pas rétabli les points qui ont suscité l’incompréhension de nos collègues sénateurs.
Dans le même esprit, à la suite de propositions émanant de tous les bancs de notre assemblée, a été rétablie l’obligation pour les règlements intérieurs des conseils départementaux et des conseils régionaux de prévoir une modulation des indemnités des élus en fonction de leur assiduité aux réunions plénières et aux réunions des commissions auxquels ils appartiennent.
Sur l’initiative de notre collègue Yves Goasdoué, la commission des lois a également rétabli le financement de l’allocation différentielle de fin de mandat par une cotisation obligatoire assise sur les indemnités de fonction des élus. Elle a aussi rétabli le financement du droit individuel à la formation des élus locaux par une cotisation obligatoire de ces derniers, au taux d’au moins 1 % du montant de leurs indemnités.
Toujours sur proposition de M. Yves Goasdoué, elle a rappelé pour coordination l’article 5, qui vise à offrir aux élus de nouvelles possibilités de reconnaissance des acquis de l’expérience obtenue dans l’exercice de leur mandat, par l’obtention d’un diplôme ou d’un titre universitaire.
Enfin, sur ma proposition, la commission a fixé l’entrée en vigueur des dispositions financières applicables aux conseillers régionaux au prochain renouvellement des conseils régionaux, prévu en décembre 2015, et, concernant les conseillers municipaux et les conseillers départementaux, à la date du 1erjanvier prochain.
Chers collègues, cette nouvelle lecture nous permettra d’avancer de manière constructive dans la recherche d’un texte consensuel entre les deux assemblées, que j’appelle de mes voeux. De ce point de vue, même si nous avons parfois une appréciation personnelle de telle ou telle disposition – j’en prends à témoin Philippe Gosselin, avec qui nous avons eu des échanges nourris et animés pendant la mission d’information que nous avons conduite en commun –, il me semble cependant qu’un message important serait envoyé aux élus locaux et aux Français si ce texte pouvait faire l’objet d’un vote à l’unanimité de notre assemblée.
Applaudissements sur tous les bancs.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, chers collègues, un an après l’examen de cette proposition de loi par le Sénat, nous sommes enfin invités à nous prononcer sur ce texte en deuxième lecture. Nous devons cette proposition de loi aux sénateurs Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, qui se sont efforcés de condenser les mesures les plus consensuelles et de répondre aux principales attentes exprimées par les élus à travers des rapports ou des propositions de loi qui n’avaient pas pu aboutir.
Trente ans après les premières lois de décentralisation, l’édification d’un véritable statut de l’élu ne s’est, hélas ! pas encore produite. Elle représente toujours un défi de taille pour l’avenir de la représentation démocratique locale.
La situation actuelle est préoccupante, et nous avons été nombreux à la décrire au cours des différentes lectures : elle se caractérise par un manque d’attractivité des fonctions électives locales. Il s’agit même d’une véritable crise des vocations, notamment dans les communes rurales et, d’une manière générale, dans la plupart des communes de taille modeste. C’est une situation dans laquelle ne cesse de se creuser le fossé entre les citoyens et les élus, dont les compétences et l’autorité sont de plus en plus incomprises et contestées.
De surcroît, les élus rencontrent dans l’exercice de leur mandat un certain nombre d’obstacles qui peuvent en partie expliquer cette crise des vocations dans le paysage politique : difficultés à concilier mandat et activité professionnelle puis à se réinsérer professionnellement, incertitudes quant à leurs responsabilités juridiques et rémunérations qu’ils jugent parfois incohérentes au regard des responsabilités qui pèsent sur eux.
Le groupe UDI a plusieurs fois dénoncé une autre des caractéristiques de la vie politique : il s’agit de l’inégal accès aux mandats publics, qui se traduit notamment par une surreprésentation de la fonction publique qui, à terme, nuit au renouvellement et à la respiration pourtant essentielle de la vie politique.
Dans ce contexte, le travail des acteurs de proximité et des élus locaux doit être encouragé. Il ne s’agit nullement de remettre en cause cette conviction ancienne, ancrée dans la culture politique française, qui refuse d’assimiler le mandat électif à un métier. Il ne s’agit pas non plus de donner aux élus des avantages particuliers. Pour construire le statut de l’élu, il faut faciliter la tâche des élus, leur donner les moyens d’accomplir pleinement leur mandat, leur permettre de s’investir librement dans l’exercice des fonctions exécutives locales, de recevoir une juste compensation pour les contraintes propres à l’accomplissement d’un mandat et de bénéficier d’une formation permettant de mieux servir la collectivité.
Dès lors, chers collègues, s’il ne répond pas définitivement à la question – lancinante dans le débat public – du statut de l’élu local, ce texte a tout de même le mérite de prévoir des mesures concrètes et utiles à l’amélioration de l’exercice par les élus locaux de leur mandat.
L’une des principales dispositions de ce texte consiste à fixer l’indemnité allouée au maire au taux maximal. Cette disposition avait notamment fait l’objet de propositions de loi de mon collègue et ami François Sauvadet, ainsi que des sénateurs Jacqueline Gourault et François Zocchetto. Elle revient à accorder une juste contrepartie pour le temps passé au service de la collectivité et devrait permettre de simplifier la vie municipale.
Autre atout de ce texte : il propose de favoriser la conciliation entre activité professionnelle et exercice des fonctions électives, notamment par l’élargissement du bénéfice du congé électif aux candidats aux élections dans les communes de 1 000 habitants au moins, et par la reconnaissance du droit à un crédit d’heures pour certains conseillers municipaux.
Dans le même objectif de conciliation des activités professionnelles et des fonctions électives, la proposition de loi permet l’extension du droit à suspension du contrat de travail et à l’octroi du statut de salarié protégé. Cette qualité de salarié protégé a d’ailleurs été étendue par le Sénat aux bénéficiaires du droit à suspension du contrat de travail qui n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat.
Le texte offre également aux élus locaux des garanties de réinsertion à l’expiration de leur mandat et donne aux adjoints des communes de 10 000 habitants au moins le droit à la formation professionnelle et à un bilan de compétences. De même, le droit individuel à la formation des élus, introduit par le Sénat, constitue un apport important de ce texte.
Après deux lectures au Sénat, force est de constater que certaines dispositions n’ont pas recueilli un avis unanime de la part des deux chambres. La redéfinition de la prise illégale d’intérêts, introduite par le Sénat, a finalement été supprimée par notre Assemblée en commission. Quant à l’institution d’une charte de l’élu local, son contenu a été modifié à plusieurs reprises. En outre, notre assemblée a rétabli la réduction des indemnités des conseillers généraux et régionaux à raison de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de commissions, que le Sénat avait supprimée.
L’évolution du texte au fil des différentes lectures démontre que, si nous sommes d’accord sur l’esprit de ces mesures, certaines modalités sont encore à déterminer.
Pour autant, nous saluons des mesures concrètes, établies dans l’intérêt des élus locaux et pour une meilleure représentation de l’ensemble de nos concitoyens, et dans la perspective, nous l’espérons, de l’édification – enfin – d’un statut de l’élu. Comme l’a indiqué mon collègue et ami Michel Zumkeller en première lecture, cette proposition de loi ne doit pas nous dispenser à l’avenir d’une nécessaire rénovation en profondeur du statut de l’élu. Un vaste chantier doit être lancé afin que le statut de l’élu local soit à la hauteur des exigences toujours croissantes des citoyens mais aussi de l’État, lequel délègue sans cesse davantage de responsabilités aux collectivités – et aux élus locaux en particulier.
Ce chantier implique notamment que nous abordions le problème de la multiplicité des collectivités, du manque de lisibilité du système d’administration territoriale pour nos concitoyens, et de la difficulté d’identifier les compétences, le rôle et les responsabilités de chacun.
Même s’ils sont louables, tous nos efforts seront vains tant que nous n’aborderons pas les véritables questions : la pertinence du nombre de strates administratives, la rationalisation de la répartition des compétences de chacune des collectivités et les responsabilités des élus.
Pour autant, nous en convenons, ce n’est pas là l’intention des auteurs de ce texte, qui proposent non pas de concevoir un statut de l’élu local mais de faciliter l’exercice de son mandat. Ce texte y parvient puisqu’il améliore la situation des élus qui s’engagent chaque jour au service de nos collectivités.
Vous l’aurez compris, le groupe UDI votera en faveur de cette proposition de loi qui apporte sa pierre à l’édifice.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 22 janvier 2014, visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat.
Cette proposition de loi n’est pas nouvelle. Déposée au Sénat par Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur en novembre 2012, elle est l’oeuvre d’un consensus. Ce consensus s’illustre par l’adoption conforme, en première lecture, de six articles, auxquels s’ajoutent cinq articles votés conformes en seconde lecture par le Sénat. Restent soumis à notre examen, dans le cadre de la navette, neuf articles destinés à améliorer encore le statut de l’exercice de leur mandat par les élus locaux.
Ainsi, nous sommes satisfaits de la mise en place d’une charte de l’élu local qui prévoit que l’élu « exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité » ; qu’il « poursuit le seul intérêt général à l’exclusion de tout intérêt particulier » ; qu’il « veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » et « s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition » à d’autres fins que « l’exercice de son mandat ou de ses fonctions » ; qu’il « s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel » ; qu’il « participe avec assiduité aux réunions » et « reste responsable de ses actes » durant son mandat. Si ces dispositions vont de soi, il n’était pas inutile de les préciser.
Pour autant, nous déplorons la suspicion que jette sur les élus locaux le recours à une nouvelle législation dans ce domaine. La mise en place d’une charte des bonnes pratiques insinue que ces bonnes pratiques font défaut dans l’exercice de leur mandat par les élus locaux.
Nous validons la mise en place d’une égalité de traitement entre les membres des organes délibérants et les élus assumant des fonctions exécutives ou ayant reçu un mandat spécial en ce qui concerne les remboursements des frais de garde d’enfants et d’assistance à la personne occasionnés par l’exercice d’un mandat.
En effet, l’exercice effectif d’un mandat par un élu, y compris lorsque celui-ci ne dispose pas d’une fonction exécutive, demande un engagement complet de sa part et l’expose à endosser des frais subsidiaires liés à l’obligation d’être présent au sein des réunions et conseils.
La mise en place d’une dégressivité des indemnités perçues par les élus locaux, susceptible d’atteindre la moitié de l’indemnité pouvant être allouée et tenant compte de leur participation réelle aux séances plénières et aux réunions des commissions, nous semble être une bonne disposition, car cette participation est nécessaire à l’exercice effectif du mandat local.
Nous sommes également satisfaits de la mise en place, pour les élus locaux, d’un droit à suspension du contrat de travail pendant l’exercice des fonctions électives et d’un droit à la réintégration professionnelle quand elles arrivent à leur terme. Ces droits participent de la conservation de représentants pleinement investis dans leurs missions.
Dans le même temps, nous souscrivons au renforcement des mesures d’adaptation de l’emploi pour les élus.
Ainsi, la reconnaissance d’un congé de formation professionnelle et l’instauration d’un bilan de compétences constituent des avancées intéressantes pour l’ensemble des élus. Nous constatons avec satisfaction que le seuil de population des communes dont les adjoints se voient reconnaître cette possibilité a été abaissé de 20 000 à 10 000 habitants en première lecture car il est apparu inéquitable de faire bénéficier de ce dispositif les seuls élus des grandes villes.
La proposition prévoit également d’intégrer l’exercice d’une fonction élective locale ou d’un mandat électoral à la liste des activités susceptibles de permettre l’obtention d’un diplôme ou d’un titre délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur au titre de la valorisation des acquis de l’expérience. En coordination avec la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie locale, cette disposition permet de reconnaître les connaissances acquises par les élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Toutefois, nous sommes étonnés par certaines dispositions contenues dans le texte. Nous pensons, à l’instar des sénateurs, qu’il aurait été judicieux de redéfinir et de préciser la notion de prise illégale d’intérêts pour les élus locaux en introduisant l’élément moral et en précisant que celle-ci s’entend de la prise d’un « intérêt personnel distinct de l’intérêt général » afin de restreindre le champ d’application de ce délit. Mais la commission des lois a préféré supprimer cette précision et en rester à la définition générale de la prise illégale d’intérêts prévue par l’article 432-12 du code pénal.
Cette proposition de loi, en précisant dans la charte de l’élu local que l’élu reste « responsable de ses actes » durant son mandat « devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale », permet également de rouvrir le débat sur la responsabilité pénale des élus locaux. Ce débat nous semble nécessaire.
En revanche, non seulement le Gouvernement n’a pas souhaité donner suite à la proposition faite par le groupe RRDP, dans le cadre de nos débats sur le non-cumul des mandats, d’instaurer le non-cumul des indemnités, mais la proposition de loi qui nous est soumise propose d’étendre encore la possibilité de bénéficier des allocations de fin de mandat. Nous nous interrogeons sur la pertinence de ce dispositif.
Nous trouvons également excessif le dispositif prévu par l’article 5 bis visant à reconnaître aux élus un droit individuel à la formation qui pourrait concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat d’élu.
Nous nous sommes avec constance opposés à la professionnalisation des fonctions électives. Les mandats des élus doivent demeurer une mission reconnue et accordée par le corps électoral à titre provisoire, la limitation de durée gageant de la bonne application et de l’exercice effectif d’un mandat dont l’objet est la satisfaction de l’intérêt général, contingent d’un État.
Comme le demandait déjà notre collègue Alain Tourret – mais le débat est ancien –, « faut-il vivre pour la politique ou vivre de la politique ? » En effet, éviter la professionnalisation permet de reconnaître la spécificité des fonctions électorales exercées. Étant fermement attachés à cette distinction, nous notons avec satisfaction que cette proposition de loi reconnaît les droits et les garanties des élus locaux.
Pour autant, nous restons attentifs à ce qu’elle n’aille pas à l’encontre de ses objectifs en reconnaissant un droit au travail de l’élu et, plus globalement, qu’elle amène une reconnaissance de la profession d’élu local.
Accorder des droits pour plus de sécurité nous semble être l’un des atouts de cette proposition de loi, mais nous ne souhaitons pas aller plus loin que le texte qui a été voté par la commission des lois de notre assemblée dans le cadre des droits à la formation professionnelle des élus.
Ainsi que l’a souligné notre collègue Jacques Mézard lors des débats au Sénat, cette proposition de loi apporte quelques légères améliorations pour le statut des élus locaux. Alors, pourquoi ne pas la voter ? Aussi, et pour toutes ces raisons, vous l’aurez compris, le groupe RRDP votera le texte qui nous est soumis aujourd’hui.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les difficultés liées à l’exercice d’un mandat local sont clairement identifiées. Elles l’ont été en particulier par la mission d’information mise en place par notre commission des lois en mars 2013. Ces difficultés s’articulent autour de trois principaux objectifs.
Premièrement, il convient de pallier le manque de diversité parmi les élus. La sous-représentation féminine, l’inégale représentation des classes d’âge et le déséquilibre dans la représentation des catégories socioprofessionnelles, constatés par de nombreux travaux scientifiques, attestent l’inégalité d’accès aux fonctions électives. Des progrès indéniables ont été réalisés grâce à l’évolution des modes de scrutin communal et régional, mais il n’en reste pas moins que les femmes, les jeunes, les citoyens issus de l’immigration, les salariés du privé, les ouvriers et les employés demeurent encore insuffisamment représentés.
Deuxièmement, il faut donner à tous les élus les moyens de s’investir librement dans l’exercice de mandats locaux.
Troisièmement, on doit veiller à l’équilibre des droits et des devoirs des élus dans l’exercice de leurs responsabilités, et cela au moment où la défiance des citoyens envers leurs élus va croissant.
Face à la nécessité ainsi établie de rénover le dispositif normatif en vigueur, la mission d’information avait formulé des propositions susceptibles d’apporter un certain nombre de réponses concrètes. Dans cette perspective, la proposition de loi dont nous débattons ce matin propose une série d’améliorations que nous avons déjà saluées en première lecture, même si elles restent limitées.
Cette proposition de loi est effet un texte équilibré qui prend en considération les conditions d’exercice des mandats locaux dans leurs différentes dimensions : compensation de l’engagement dans l’exercice des mandats électifs par le biais d’un régime indemnitaire renforcé, conciliation favorisée entre activité professionnelle et vie publique, extension des garanties de réinsertion à expiration du mandat, développement des droits à la formation.
En deuxième lecture, la commission des lois a pour l’essentiel rétabli les dispositions votées par notre Assemblée en première lecture. Nous souscrivons ainsi au rétablissement de dispositions supprimées par le Sénat au sein de la charte de l’élu local comme le rappel pour les élus locaux qu’ils doivent se conformer à la loi ou l’interdiction de prendre des mesures leur accordant un avantage personnel futur après la cessation de leur mandat.
L’institution et la proclamation d’une charte de l’élu local, en ce qu’elle établit un cadre déontologique, est de nature à favoriser la transparence de la vie publique.
Nous soutenons également l’extension du crédit d’heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. Cette disposition répond à la nécessité, soulignée par la mission d’information, d’assurer l’effectivité des garanties reconnues aux élus par la loi dans l’exercice de leur mandat.
Dans le même esprit, nous sommes satisfaits de l’évolution du régime indemnitaire, qui prend mieux en compte les spécificités des petites communes. De même, nous nous félicitons de l’amélioration des conditions de perception par les élus municipaux, départementaux et régionaux, de l’allocation différentielle de fin de mandat. Dans ce cadre, qui renforce la logique assurantielle du dispositif, nous soutenons le rétablissement par la commission des lois du financement de l’allocation par une cotisation obligatoire assise sur les indemnités de fonction des élus, l’allocation n’étant plus à la charge des collectivités territoriales.
Nous approuvons aussi la consécration d’un droit individuel de formation ainsi que son financement par une cotisation obligatoire des élus, fixée à un taux d’au moins 1 % du montant de leurs indemnités, même si nous regrettons pour notre part que le plancher minimal fixé à 3 % par la proposition de loi initiale ait été ramené à 1 %.
Nous craignons que l’application d’un tel seuil n’aboutisse dans les petites communes à de très faibles montants n’assurant pas à chaque élu local la possibilité de suivre une formation de qualité. C’est pourquoi nous souhaitons que ce seuil constitue vraiment une base minimale et ne devienne pas en fait le taux de référence.
Si toutes ces mesures constituent indéniablement des avancées, seule l’instauration d’un véritable statut de l’élu améliorera réellement à nos yeux l’exercice de la démocratie. Cette réforme est à l’ordre du jour depuis plus de trente ans ; elle demeure indispensable. En dépit de cette réserve, les députés du Front de gauche voteront une nouvelle fois cette proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le travail visant à faciliter l’exercice de leur mandat par les élus locaux est lancé depuis plus d’un an. La question du statut de l’élu n’est pas nouvelle, c’est le moins que l’on puisse dire. En réalité, l’affaire est d’une plus grande complexité qu’il n’y paraît de prime abord en raison de ce que nous attendons de l’élu. Nous ne voulons pas qu’il fasse de son mandat un métier tout en attendant des élus qu’ils soient disponibles et formés à des disciplines de plus en plus variées et complexes, ce qui réduit le champ des possibles pour les jeunes, les femmes, les salariés du secteur privé, les membres de professions libérales et bien d’autres catégories socio-professionnelles. Ce constat a conduit le Président de la République à déclarer, lors des états généraux de la démocratie territoriale, le 5 octobre 2012, que la mise en place d’un réel statut de l’élu local constitue un impératif démocratique.
Que la représentation nationale réaffirme que les élus locaux sont au coeur de la démocratie n’est pas neutre, ce dont deux illustrations très récentes me viennent naturellement à l’esprit.
J’évoquerai d’abord la grande affaire de la préparation de la fusion et du redécoupage des régions. En Normandie, où je suis élu, d’innombrables réunions publiques ont eu lieu. Toutes ont fait salle comble, réunissant les élus régionaux, départementaux et locaux avec de très nombreux citoyens venus s’informer, parfois se rassurer, écouter et demander des explications auprès de leurs élus.
L’autre exemple, chacun l’a naturellement en tête. Après les événements tragiques que nous avons vécus les 7 et 9 janvier, partout en France les citoyens sont allés voir leurs élus, ceux qui voulaient comprendre et ceux qui craignaient d’être stigmatisés, et ont organisé avec eux des manifestations qui leur semblaient appropriées. C’est autour des élus de la République que le peuple s’est levé.
Il faut donc que tous ceux qui sont désireux de s’engager pour l’intérêt général puissent le faire. Les élus sont de plus en plus sommés d’intervenir dans des pans de l’action publique de plus en plus étendus. La transformation de la fonction d’élu local est considérable. Les lois de décentralisation de 1982, la spécialisation des différentes collectivités et l’émergence de nouveaux modes de gestion publique territoriale sont autant de réformes ayant déplacé une partie des pouvoirs décisionnaires vers les collectivités locales. Les élus locaux sont devenus les acteurs majeurs de l’aménagement et du développement du territoire. L’accroissement de technicité et de responsabilisation qui en résulte n’a pas été accompagné d’une mise à disposition de moyens correspondants, tant s’en faut. Dans les plus petites communes, les élus doivent faire face avec leurs compétences personnelles et quelques maigres services à une avalanche de normes et de demandes.

On dénombre aujourd’hui 524 280 conseillers municipaux, 4 052 conseillers généraux et 1 880 conseillers régionaux ; plus de 80 % de ces élus ne perçoivent aucune indemnité. L’engagement personnel des élus pour l’intérêt général est donc de plus en plus prenant, lourd et professionnellement risqué. L’élu local fait preuve d’un réel dévouement méritant la considération de la représentation nationale. Un tel investissement peut faire peur et rebuter, voire susciter une vraie crise des vocations. Faut-il rappeler que plusieurs communes de France n’ont pas participé au dernier renouvellement municipal faute de candidats ? Agir est donc une urgence, comme l’a réaffirmé M. le Premier ministre au dernier Congrès des maires de France.
Nous examinons la proposition de loi en deuxième lecture, je n’en développe donc pas les aspects techniques. Certains points méritent cependant d’être signalés.
Le texte fait l’objet d’un fort consensus. Le Sénat a accepté le principe de la charte de l’élu, ce qui n’allait pas de soi. Des modifications ont certes été votées en commission des lois, mais l’idée même d’une charte lue en début de mandat ne fait plus débat. Les sanctions pécuniaires applicables aux élus en cas d’absence ont été réintroduites, juste contrepartie des droits nouveaux qui leur sont reconnus.

Les droits nouveaux portent sur la validation des acquis de l’expérience et l’assurance d’un droit individuel à la formation financé par un prélèvement sur les indemnités qui facilitera la reconversion professionnelle de l’élu, ce qui est à mes yeux une bonne chose, contrairement à ce qui a été dit tout à l’heure. Les droits nouveaux faciliteront également la conciliation de l’exercice d’un mandat électif avec la vie professionnelle car les droits aux prestations sociales seront recalculés et le remboursement des frais de garde généralisé à toutes les collectivités. Enfin, afin de favoriser le retour à l’emploi, le droit à la suspension du contrat de travail sera élargi et l’allocation différentielle de fin de mandat portée à un an, en contrepartie de quoi elle devient dégressive et financée par une retenue sur les indemnités de l’élu.
Le texte n’est technique qu’en apparence et sera en fait très concret pour celles et ceux qui en bénéficieront. Il constitue une réelle avancée démocratique, c’est pourquoi le groupe SRC le votera sans aucune hésitation.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je constate que la parité n’est pas tout à fait de mise dans cette assemblée au moment où je prends la parole.
Je commencerai d’un mot : enfin ! Enfin, nous voici peut-être au terme d’un long parcours, car ce sujet est un véritable serpent de mer : on en parle depuis de longues années déjà, selon des procédures et des engagements parallèles du Sénat et de l’Assemblée. Pour une fois, les parallèles se rejoignent, ce qui est assez exceptionnel en géométrie, j’en conviens, mais ce que la géométrie interdit, la politique et le bon sens le permettent.

Une fois encore ce matin, nous sommes donc à l’unisson.
Notre discussion a pour origine la proposition de loi des sénateurs Gourault et Sueur, rédigée dans le prolongement des états généraux de la démocratie. De notre côté, la commission des lois a constitué, au mois de mars 2013, une mission d’information dont Philippe Doucet, que je salue, était président et rapporteur. Nous avons mené des travaux d’intérêt général, en nous accordant sur l’essentiel, comme en témoigne notre rapport, adopté au mois de juin 2013, dont vingt-neuf propositions ont émergé. Le Gouvernement avait alors souhaité accélérer le processus afin que le rapport constitue le point de départ de travaux parlementaires prolongeant la proposition de loi Sueur-Gourault. Les arcanes du travail parlementaire et aussi un peu d’attentisme du Gouvernement ont amené à suspendre les travaux. Il y a un an jour pour jour – bon anniversaire ! –, la belle qui dormait au bois, ou plutôt au jardin du Luxembourg, nous est revenue.
Nous l’examinons enfin aujourd’hui en deuxième lecture. Tant mieux, car l’attente des élus locaux est forte. Je regrette que le texte n’ait pu être voté et donc promulgué plus vite, car il aurait alors été appliqué dès le renouvellement des conseils municipaux au mois de mars 2014. Ne boudons pas notre plaisir, néanmoins ! Nous nous acheminons vraisemblablement vers un vote à l’unanimité et une application dès les prochaines échéances départementales du mois de mars, je l’espère, en tout cas pour les élections régionales prévues en décembre et pour tous les élus au 1er janvier 2016 ; réjouissons-nous en !
La présente proposition de loi vise à faciliter l’exercice de leur mandat par les élus locaux. Il ne s’agit pas d’un statut à proprement parler.

Les dispositions peuvent sembler relativement modestes, mais elles constituent en réalité de vraies avancées. Le constat de départ est simple : le mandat d’élu reste un engagement unique en son genre, qui ne saurait être assimilé à un métier – nous en sommes tous d’accord. Il ne s’agit pas non plus d’un travail salarié. Le patron, si je puis dire, c’est le citoyen dont le bulletin détermine l’éventuelle capacité et donc la qualité d’élu. Ce n’est pas un employeur quelconque !
L’engagement unique et le travail remarquable des acteurs de proximité soucieux du bien commun que sont les élus locaux doivent être encouragés et respectés. Les élus doivent avoir la possibilité de se former, auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, de ses délégations régionales ou encore des nombreuses associations départementales agréées de maires assurant la formation des élus locaux.
Ils doivent aussi avoir les moyens d’assurer leurs missions, recevoir une protection sociale ou juridique et se voir garantir une indemnisation décente sans être excessive. Il s’agit de trouver le juste milieu. Cela est particulièrement vrai des maires de nos petites communes rurales qui très souvent accomplissent un véritable sacerdoce. Ceux qui touchent réellement une indemnité sont trop peu nombreux et beaucoup en sont de leur poche, ce qui n’est pas normal. Bref, ils doivent avoir les moyens d’accomplir pleinement leur mandat dans le cadre d’un bon équilibre entre droits et devoirs, les deux étant évidemment liés, comme le rappelle d’ailleurs avec force la charte des élus locaux, que nous examinerons tout à l’heure, à laquelle je souscris. Sa lecture lors de l’installation des nouveaux conseils constitue un rite républicain ; elle introduit une forme de solennité dont l’intérêt est de rappeler les droits et les devoirs en vigueur, sans bien sûr en créer de nouveaux.
Le texte peut sembler modeste au regard des enjeux d’un statut de l’élu que nous appelions de nos voeux dans le rapport Doucet-Gosselin. Que l’on ne se méprenne pas d’ailleurs sur le terme de « statut ». Il ne fait pas référence au statut général des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires mais désigne une position plus ouverte, non pas une position d’exception plaçant les élus hors du droit commun et au-dessus de leurs concitoyens, mais simplement la reconnaissance d’un engagement unique au profit de nos concitoyens et de la société. Il est temps de rendre hommage à nos élus, qui depuis quelque temps sont soumis à rude épreuve. Ainsi, les changements de mode de scrutin ont parfois été compliqués dans les petites communes rurales comptant moins de 1 000 ou 3 500 habitants, qui marquait l’ancien seuil.
Citons également l’actuelle recherche un peu désespérée de candidats en vue du scrutin départemental. Les binômes sont difficiles à constituer et même si le monde entier nous envie, paraît-il, notre mode de scrutin, il est tout de même un peu compliqué à mettre en place ! Les dotations sont révisées à la baisse, les compétences seront revues et le développement des communes nouvelles et de l’intercommunalité pose d’importantes questions. Bref, nos élus locaux sont soumis à rude épreuve et l’heure est venue d’améliorer les conditions d’exercice de leur mandat. L’évolution des textes en ce sens est attendue, non pour faire des élus locaux des privilégiés au-dessus des lois, des règlements et de leurs concitoyens mais pour leur envoyer collectivement le signal que nous les avons compris.
Élus locaux, nous vous avons compris !
Vous attendez des évolutions, vous qui donnez du temps, vous qui vous engagez, qui travaillez, qui bâtissez, et qui, en fin de compte, faites la démocratie de proximité jour après jour.
Si le texte présenté reste modeste, il n’en comporte pas moins des avancées très notables. J’évoquais tout à l’heure la charte des droits et devoirs, ce rite républicain empreint d’une certaine solennité – je n’y reviendrai pas, mais il constitue en quelque sorte la synthèse de l’ensemble.
Si quelques éléments concernent l’entrée dans le mandat, avec le congé électif, c’est surtout dans l’exercice du mandat et à la sortie de celui-ci que le texte me semble apporter des modifications substantielles.
Le régime indemnitaire est ainsi précisé sur différents points. Il s’agit pour l’essentiel, et afin de mieux tenir compte des spécificités des plus petites communes, de reconnaître l’engagement des conseils municipaux. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les indemnités ne pourront plus être inférieures au taux maximal prévu par la loi. C’est bien, car nombre d’élus de petites communes n’osaient pas percevoir ces indemnités dont ils ont pourtant besoin pour assumer leur mandat.
La contrepartie de tout cela est une responsabilité accrue des élus : on ne peut avoir de droits sans avoir aussi des devoirs. Les règlements intérieurs des assemblées pourront ainsi prévoir de sanctionner financièrement les élus qui ne remplissent pas leurs obligations, qui sont absents. C’est une juste contrepartie ; nos concitoyens comprendront parfaitement que celui qui travaille soit reconnu et que celui qui ne travaille pas soit sanctionné ; cela me paraît juste et équitable.

Le texte comporte aussi des éléments sur la fraction représentative des frais d’emploi dans le calcul des ressources ouvrant droit à prestations sociales, qui est écartée. Là encore, c’est une mesure de justice et de bon sens.
Surtout, des garanties nouvelles permettant à l’élu d’être plus disponible et plus efficace sont ouvertes pendant le mandat. Citons le dispositif du crédit d’heures, qui était attendu et se voit repris, le droit à une suspension du contrat de travail pendant le mandat et à une réintégration professionnelle, un statut de salarié protégé, le droit à un congé de formation professionnelle et à un bilan de compétences, le tout associé à un droit individuel à la formation, sans oublier le remboursement des frais exposés pendant le mandat – frais de garde d’enfant, frais d’assistance à personne… Cela paraît de bon sens, et permettra peut-être à d’autres citoyens, à d’autres élus, de mieux assumer leurs engagements.
Enfin, des avancées sont à noter en ce qui concerne la sortie du mandat. On reproche souvent aux élus de « s’accrocher » ou de « s’arc-bouter » à leur mandat ; c’est peut-être parce que parvenus à un certain âge, ils s’interrogent sur la suite de leur vie professionnelle – et il est vrai que cette question a son importance.

Les conditions d’attribution de l’allocation de fin de mandat sont donc revues, et la validation des acquis de l’expérience professionnelle des élus locaux réaffirmée.
Ces éléments peuvent paraître insuffisants, mais j’espère que nous nous retrouverons pour affirmer notre attachement à nos élus locaux, ces « bras armés » de la République jusqu’au plus lointain des territoires hexagonaux et d’outre-mer, ceux-là mêmes qui font que dans nos territoires, il fait encore bon vivre.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le rôle de l’élu a changé, c’est le moins que l’on puisse dire. Les obligations et l’investissement des élus, premiers interlocuteurs de nos concitoyens, ont évolué avec notre société. Dès lors, les dispositions législatives les concernant doivent aussi évoluer.
Les enjeux, nous les connaissons : les élus sont l’eau qui alimente la vie démocratique, économique et sociétale de notre pays. Philippe Gosselin parlait de « bras armé » ; ils sont aussi le ciment de la République. L’élu est aujourd’hui un assistant social, un directeur des ressources humaines, un entrepreneur, un investisseur, un juriste. Il crée le lien entre les acteurs économiques et dynamise le territoire. Ses fonctions sont diverses et de plus en plus complexes, alors même qu’il est conduit à appliquer un grand nombre de normes.
Ces rôles, ces contraintes, peu d’entre nous sont formés dès l’origine ou entourés pour y faire face de manière satisfaisante et répondre aux attentes de nos concitoyens. Une formation, notamment pour les élus des petites communes, est donc une nécessité ; elle assurera un fonctionnement plus efficient de notre système.
Mais la formation n’est pas une fin en soi. D’autres éléments doivent aussi être pris en compte. La parité, même si elle s’améliore, demeure insuffisante, de même que l’origine socio-professionnelle des élus : ils doivent être plus représentatifs de ceux qu’ils représentent. Il faut donc revoir l’accès à des fonctions électives, leur conciliation avec la vie professionnelle et leurs conséquences une fois le mandat achevé. C’est pourquoi il faut ouvrir le champ des candidatures, mais aussi assurer une indemnisation décente et justement calculée du service que l’élu rend à la population, prendre en compte l’élément de la retraite, la valorisation des compétences acquises et le droit à la formation en fin de mandat, sans oublier le renouvellement des modalités de financement de l’allocation différentielle de fin de mandat.
Le rôle d’élu doit être accessible, mais aussi valorisé et sécurisé. L’élu doit connaître ses droits et ses devoirs : c’est l’objet de la charte des élus. Il doit être en mesure de concourir sereinement à l’intérêt général, en particulier dans les petites structures, où les élus sont polyvalents et n’ont pas toujours de nombreux services à leur disposition.
Il faut aussi mettre fin à la suspicion permanente dont ils font l’objet. Sans nécessairement tomber dans le voyeurisme, la transparence doit être améliorée, de sorte qu’elle devienne – avec la déontologie – notre marque. C’est aussi par ce biais que nous revaloriserons les mandats que l’on nous confie.
Je conclurai sur le rôle de l’élu et son avenir. Vous le savez, l’élu est souvent vu comme un privilégié. Par manque de clarté, les compensations de son rôle sont considérées comme des avantages. La réalité est tout autre : l’élu est confronté à de nombreuses difficultés. Aucun de nous ne s’en plaint, car la majorité des élus sont habités par un profond sentiment d’abnégation ; ils servent l’intérêt général avec la conviction qui les anime, qui est reconnue par nos concitoyens. Et j’ai une pensée particulière pour les élus des petites communes rurales, qui sont tant sollicités.

Voter ce texte, c’est être à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui et de demain ; c’est valoriser la démocratie à tous ses échelons ; c’est promouvoir la République et pérenniser la France et sa cohésion sociale. Voter ce texte, c’est tout simplement reconnaître le rôle essentiel de nos élus.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et du groupe UDI.

J’appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées n’ont pu parvenir à un texte identique.
L’article 1er B est adopté.
pour coordination

La parole est à M. Philippe Doucet, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 20 .
L’amendement no 20 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’article 1er, amendé, est adopté.
L’article 1er bis A est adopté.

La parole est à M. Philippe Doucet, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 1 .
L’amendement no 1 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’article 2 ter, amendé, est adopté.

L’article 3 bis B, amendé, est adopté.

La parole est à M. Philippe Doucet, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 4 .
L’amendement no 4 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’article 4, amendé, est adopté.
L’article 5 est adopté.
Article 5
L’article 5 bis est adopté.

Je suis saisi de deux amendements, nos 21 et 22 rectifié , de la commission des lois, qui peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.
La parole est à M. le rapporteur, pour les soutenir.
Les amendements nos 21 et 22 rectifié , acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.
L’article 7, amendé, est adopté.

La parole est à M. Philippe Doucet, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 11 rectifié .

Cet amendement prévoit l’application en Polynésie française des dispositions relatives au droit à réintégration des salariés.
L’amendement no 11 rectifié , accepté par le Gouvernement, est adopté.

La parole est à M. Philippe Doucet, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 12 .

Cet amendement vise à étendre l’application de la charte de l’élu local aux élus municipaux de la Nouvelle-Calédonie.
L’amendement no 12 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

Ces amendements visent à étendre des dispositions du texte aux communes et aux élus municipaux de la Nouvelle-Calédonie.

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour soutenir l’amendement no 24 .
Cet amendement de coordination vise à insérer dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie les modifications apportées à l’article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales par l’article 4, dans son I-2°, concernant l’allocation différentielle de fin de mandat des maires et des adjoints au maire dans les communes les plus importantes.
Il procède à l’actualisation des dispositions équivalentes au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L’amendement no 24 , accepté par la commission, est adopté.

La parole est à M. Philippe Doucet, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 18 .

Cet amendement vise à étendre aux communes de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la proposition de loi.
L’amendement no 18 , accepté par le Gouvernement, est adopté.

La parole est à M. Philippe Doucet, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 23 de la commission des lois.
L’amendement no 23 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L’article 8, amendé, est adopté.

La parole est à M. François Rochebloine, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, je me félicite des interventions que nous avons entendues. C’est un pas important que nous accomplissons ce matin, et je ne doute pas que cette proposition de loi va être adoptée à l’unanimité.
Permettez-moi cependant de regretter qu’un débat aussi important pour nombre d’élus ait été inscrit à l’ordre du jour ce matin, et que nous soyons si peu nombreux dans l’hémicycle. Il y a certes des explications à cet état de fait, et elles sont nombreuses. Cela n’empêche pas qu’il faille revoir les conditions de l’inscription de tels textes à l’ordre du jour. Songez que nous sommes neuf députés en séance !

Cela ne donne pas une belle image de la représentation nationale. Nous n’avons siégé que mardi et mercredi après-midi cette semaine. Rien n’était inscrit à l’ordre du jour hier soir, où nous aurions sans doute été bien plus nombreux, mais trois textes étaient inscrits ce matin ! Il y a donc quelque chose à revoir ; je ne doute pas que vous saurez en faire part à la présidence.
Cela étant, je me félicite une nouvelle fois de ce texte, que le groupe UDI votera.

Je transmettrai votre observation à la Conférence des présidents, monsieur Rochebloine. Permettez-moi cependant de vous rappeler que nous siégeons généralement le jeudi matin. Mais il est vrai que ce texte était assez consensuel ; cela peut expliquer cette faible mobilisation.
La parole est à M. Philippe Gosselin, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Une belle unanimité se profile au sein de notre assemblée sur le vote de ce texte ; je me réjouis que l’on puisse se retrouver derrière nos élus locaux. Cette unanimité permettra de défendre un certain nombre d’éléments auprès de nos collègues sénateurs.
Toutefois, je regrette moi aussi que l’on ne soit pas plus nombreux ce matin. Certes, ce texte peut paraître technique et secondaire, et le grand public n’est pas immédiatement concerné par les mesures que nous votons ce matin. Toutefois, si les élus de nos territoires, dans les départements, les régions, les outre-mer, peuvent mieux exercer leur mandat, ce sont bien, in fine, les territoires et surtout nos concitoyens, qui devraient en récolter le bénéfice.
J’espère aussi que ce sera l’occasion – pas immédiatement, mais sans doute à moyen terme – de vivifier le terreau des élus locaux et de les mettre en lumière, eux qui oeuvrent véritablement au quotidien pour faire vivre la République dans tous nos territoires.
La proposition de loi est adoptée.
Applaudissements sur tous les bancs.

Prochaine séance, lundi 26 janvier, à seize heures :
Discussion du projet de loi pour la croissance et l’activité.
La séance est levée.
La séance est levée à treize heures.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly