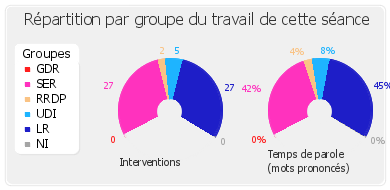Séance en hémicycle du 18 février 2016 à 9h30
Sommaire
- Questions orales sans débat (voir le dossier)
- Schéma de cohérence territoriale et établissements publics de coopération intercommunale (voir le dossier)
- Accès des plombiers chauffagistes au crédit d'impôt pour la transition énergétique (voir le dossier)
- Ordre du jour de la prochaine séance (voir le dossier)
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

La parole est à Mme Sylviane Alaux, pour exposer sa question, no 1313, relative au processus pour la paix au Pays Basque.

Madame la secrétaire d’État chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage, mes chers collègues, ma question porte sur le processus de paix engagé au Pays basque.
Le 11 juin dernier s’est tenue à l’Assemblée nationale une conférence humanitaire pour la paix au Pays basque. De nombreux intervenants du monde judiciaire et politique, notamment l’ancien Premier ministre irlandais, sont venus expliquer l’importance de l’accord du Vendredi Saint. Des anciens prisonniers mais également des victimes dialoguant ensemble ont expliqué la nécessité de conclure cette paix définitive.
Cette conférence a été aussi l’occasion de rappeler la nécessité de la prise en compte des demandes légitimes de rapprochement des prisonniers basques et de requalification de leurs peines, éléments essentiels dans la mise en oeuvre de ce processus.
Depuis plusieurs années, le Pays basque est impliqué dans la construction de cette paix durable. Les exemples étrangers ont montré que cette réconciliation et cette paix ne peuvent se réaliser sans une participation active de l’État. C’est pourquoi je souhaiterais que le Gouvernement nous précise sa position quant à son implication dans ce processus de paix.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Tout d’abord, madame la députée, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence du ministre de l’intérieur, retenu par ailleurs.
Vous m’interrogez sur l’implication du Gouvernement dans le processus de paix au Pays basque.
Depuis longtemps, la violence est fermement rejetée par une très large majorité des citoyens et des partis politiques du Pays basque espagnol comme du Pays basque français.
Plusieurs conférences se sont réunies à Bayonne, Pampelune et Bilbao et plusieurs manifestations ont été organisées jusqu’à cette conférence qui s’est tenue à Paris le 11 juin 2015 à laquelle vous avez fait référence. Un texte en quatre points a été adopté à son issue – dont vous étiez, madame la députée, une des signataires – qui appelle le Gouvernement à s’impliquer dans le processus de paix.
Vous le savez, la position de ce dernier est constante : la dissolution de l’organisation ETA et son désarmement effectif constituent deux conditions préalables et indispensables à la concrétisation d’un processus de paix.
Pour cela, il faut que l’organisation ETA assume sa propre dissolution et matérialise sa volonté de déposer les armes par une remise intégrale et unilatérale de son arsenal aux autorités françaises ou espagnoles, donnant ainsi un gage tangible de la sincérité de sa démarche qui, pour l’heure, consiste uniquement à opérer des séquences médiatiques ou des déclarations qui ne se traduisent jamais par des décisions claires, concrètes et assumées.
Permettez-moi de rappeler que durant la période où cette organisation a commis de nombreux attentats et assassinats, 829 personnes ont trouvé la mort. Cette violence a durablement marqué la société espagnole, notamment dans la Communauté autonome basque. Elle a aussi marqué la société française, qui fut également touchée.
Outre les tués, il y eut aussi de nombreux blessés – par milliers – pour lesquels j’ai une pensée, ainsi que pour les familles des victimes. Cette dérive terroriste a pendant longtemps fait obstacle à la construction d’une solution politique et démocratique à la demande de reconnaissance de l’identité du Pays basque dans le cadre de nos institutions.
Enfin, vous évoquez le rapprochement des détenus basques répartis sur l’ensemble des territoires nationaux français et espagnol. Ils ont été condamnés pour des actes terroristes et leur suivi, faut-il le rappeler, relève de la seule compétence de l’autorité judiciaire.
Pour conclure, madame la députée, deux actions concrètes – dissolution et remise intégrale de son arsenal – sont attendues et sont la seule manière pour ETA de donner du crédit à son affirmation de vouloir renoncer à l’action armée.

Puisque vous êtes la porte-parole de M. le ministre de l’intérieur, madame la secrétaire d’État, je vous prie de bien vouloir lui transmettre une question supplémentaire.
J’entends bien la nécessité de restituer les armes mais l’arsenal d’ETA n’est pas constitué d’un bloc : des armes sont partout sur le territoire et pour orchestrer le dépôt des armes, je crois qu’il est absolument indispensable – nul ne peut le nier – d’organiser une véritable rencontre autour d’une table afin de savoir comment engager ce processus et de décider du sort des prisonniers. Les droits de l’homme s’appliquent également à ces derniers. Ils n’en sont pas exclus !
Je le répète, la société basque demande que les États, les gouvernements de Paris et de Madrid se mobilisent et engagent la poursuite de ce processus de paix afin que ce territoire tourne définitivement le dos à la violence.

La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz, pour exposer sa question, no 1305, relative aux schémas de cohérence territoriale et aux établissements publics de coopération intercommunale.

Madame la secrétaire d’État chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage, l’article L. 122-5 IV du code de l’urbanisme prévoit que l’intercommunalité issue de la fusion de plusieurs EPCI adhère dans un délai de six mois à l’établissement porteur de SCOT dans lequel réside la majorité de sa population, le périmètre du SCOT étant étendu en conséquence. Le nouvel EPCI peut néanmoins refuser ce rattachement d’office et choisir un autre établissement porteur de SCOT.
Cette obligation de rattachement du territoire d’un EPCI à un autre SCOT combinée au principe, énoncé à l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme, de l’inscription de l’intégralité du territoire d’un EPCI dans un SCOT unique peut soulever un problème au regard d’un rapprochement d’EPCI sur une base volontaire.
Ce délai de six mois est jugé trop court et risque de compromettre l’aboutissement d’élaboration de SCOT déjà bien avancés. Est-il envisageable que les SCOT en cours aillent à leur terme dans les conditions pré-existantes avant d’éventuelles fusions et que le nouveau périmètre de l’intercommunalité ne soit pris en compte qu’à la première révision d’un des deux SCOT ?
En outre, quitter un établissement porteur de SCOT peut également remettre en cause un périmètre de programmation de crédits si l’établissement est un syndicat mixte ouvert chargé de l’exécution du contrat de pays.
Dans le département du Jura, le SCOT du Haut-Jura est porté par le Parc naturel régional du Haut-Jura et repose sur un syndicat mixte ouvert. Certaines communautés de communes du secteur, bien que non soumises à l’obligation légale de fusionner du fait de l’application de la dérogation liée aux territoires de montagne prévue par la loi NOTRe, seraient intéressées par une fusion avec une communauté de communes voisine dépendant d’un SCOT porté par un pôle d’équilibre territorial et rural – PETR –, le SCOT du Pays lédonien.
Compte tenu des équilibres démographiques en jeu, ces communautés de communes, en application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, seraient contraintes de quitter le SCOT du Haut-Jura – syndicat mixte ouvert – pour le SCoT du Pays lédonien, qui est un PETR, ce qui remettrait en cause l’exécution du contrat de pays du Haut-Jura et l’allocation de certaines subventions, notamment celles du programme LEADER.
Quelle solution juridique existe pour résoudre cette situation qui contrevient à la démarche de regroupement et d’extension de taille des intercommunalités ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Madame la députée, vous avez interrogé le Gouvernement sur l’avenir des schémas de cohérence territoriale au regard de l’évolution de la carte intercommunale en cours.
Vous évoquez en particulier la situation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de la fusion de plusieurs intercommunalités et appartenant à des SCOT différents.
Dans un tel cas, l’article L. 143-13 du code de l’urbanisme prévoit que l’EPCI à fiscalité propre issu de la fusion devient, au terme d’un délai de six mois à compter de sa création, membre de plein droit de l’établissement public gérant le SCOT sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population sauf si, dans ce même délai, son organe de délibération décide d’adhérer à un autre établissement public ou de n’adhérer à aucun.
Les communes sont alors automatiquement retirées de l’établissement porteur de SCOT dont l’EPCI issu de la fusion n’est pas devenu membre et le périmètre du SCOT concerné s’en trouve réduit.
Parallèlement, le périmètre du SCOT dont le nouvel EPCI à fiscalité propre est devenu membre est automatiquement étendu, étant précisé que l’établissement porteur du SCOT auquel cet EPCI décide d’adhérer ne peut pas s’y opposer.
Le Gouvernement souscrivant au double objectif de mise en cohérence et de rationalisation des périmètres des SCOT et des EPCI à fiscalité propre, il n’a pas l’intention de modifier les dispositions de l’article L. 143-13 du code de l’urbanisme. Elles ont donc vocation à s’appliquer dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas de coopération intercommunale en cours et prévus par la loi du 7 août 2015.

La situation est vraiment ubuesque. Dans le cadre de la loi NOTRe, l’État a souhaité définir des territoires pertinents pour les intercommunalités. La carte intercommunale a donc été revue pour l’ensemble du territoire en vue de possibles regroupements et fusions dans un but de cohérence et de rationalisation.
Sauf que cette démarche se heurte à des SCOt. Vous le dites très bien : il est aujourd’hui possible de sortir de leurs périmètres, mais s’agissant du SCOT du Haut-Jura porté par le Parc naturel régional du Haut-Jura, vous remettez en cause la programmation LEADER ! C’est quand même ubuesque !
J’aimerais que l’on retravaille sur l’article 51 de la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales – RCT – précisant que les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.
Il s’agit de laisser vivre la contractualisation actuellement appliquée dans les périmètres des SCOT. Même s’il y a une adhésion, qu’on ne change pas leurs périmètres, jusqu’à la fin de la contractualisation. Appliquer une telle règle ne me semble pas si difficile.
En même temps, des regroupements prévus et volontaires seront grandement pénalisés alors qu’il s’agissait précisément de favoriser une cohérence. En effet, il y a des arbitrages rendus dans le cadre de SCOT qui ne pourront pas être réalisés.
Je voudrais que vous entendiez vraiment cela parce que de nombreux territoires sont confrontés à cette réalité, qui soulève un vrai problème.

La parole est à Mme Elisabeth Pochon, pour exposer sa question, no 1318, relative aux effectifs de magistrats au tribunal de grande instance de Bobigny.

Madame la secrétaire d’État chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage, ma question s’adresse à M. le ministre de la justice et concerne le manque dramatique de magistrats au tribunal de grande instance de Bobigny.
Si, en premier lieu, je tiens à saluer la politique volontariste de recrutement engagée par Christiane Taubira depuis 2012 faisant suite à un affaiblissement délibérément assumé par l’ancienne majorité avec la révision générale des politiques publiques, je déplore en revanche la sous-dotation originelle du tribunal de grande instance de Bobigny en effectif de magistrats alors qu’il s’agit du deuxième TGI de France en volume d’affaires traitées.
Les effectifs théoriques de la juridiction sont faibles, avec seulement 124 magistrats au siège, 83 magistrats au parquet et 475 fonctionnaires, greffiers, secrétaires et adjoints.
Mais la réalité est encore plus inquiétante car, à ce jour, ce sont seulement 97 juges au siège, 44 magistrats et 438 fonctionnaires qui se dévouent chaque jour pour faire fonctionner le service public de la justice dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ils méritent qu’on leur rende hommage.
Le tribunal de grande instance de Bobigny cumule donc les difficultés en matière d’effectifs depuis trop longtemps. Les premières victimes de cette carence sont les justiciables, pour lesquels les délais de traitement s’allongent sans fin.
Il faut attendre près de quinze mois pour les dossiers de surendettement et les conciliations prud’homales, une année pour la mise en place d’une mesure éducative et pour un divorce et, alors qu’il faut deux mois pour voir un juge aux affaires familiales à Paris, les habitants de la Seine-Saint-Denis doivent pour leur part patienter plus d’un an. Sans parler des délais intolérables pour les délits : il faut près de cinq ans pour qu’une affaire de stupéfiants soit jugée.
On mesure donc les conséquences d’une telle pénurie d’effectifs. Elles sont multiples et touchent toute la population du territoire : consommateurs rencontrant des difficultés de remboursement, salariés en conflit avec leur entreprise, jeunes en difficultés, familles et enfants affrontant le divorce, mais aussi tous les habitants victimes du trafic de drogue et de ses méfaits.
La justice séquano-dyonisienne est asphyxiée, et la France s’installe lentement dans une contradiction avec les objectifs de célérité fixés par les conventions européennes. Cela a conduit le tribunal à supprimer 20 % des audiences pour permettre aux magistrats de siéger. Pour tenter de pallier cette situation qui confine au déni de justice, il conviendrait d’affecter une trentaine de magistrats supplémentaires sur cette juridiction.
Je souhaite donc connaître les efforts que le Gouvernement est prêt à réaliser pour rétablir la justice sur ce territoire, dont le dynamisme démographique, social et économique est un véritable atout pour l’avenir de ce pays.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Madame la députée, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser le garde des sceaux, qui ne peut être présent et qui m’a demandé de vous répondre à sa place.
Vous avez appelé son attention sur la situation des effectifs de magistrats du tribunal de grande instance de Bobigny et sur l’urgence d’y affecter rapidement des renforts. Ce tribunal se trouve, de fait, confronté à un sous-effectif manifeste, au regard du contentieux dont il a la charge et des missions qui sont les siennes. La circulaire de localisation des emplois fixe, pour l’année 2015, un effectif théorique de 124 pour les magistrats du siège et de 53 pour ceux du parquet. Or on compte 27 postes vacants. La situation extrême de Bobigny illustre les difficultés que rencontrent de nombreuses juridictions françaises.
Comme vous l’indiquez, il en résulte des retards inacceptables dans le traitement des procédures et les réponses apportées aux justiciables. Vous avez raison de dénoncer cette situation. Cette année, nous avons accueilli à l’École nationale de la magistrature la plus importante promotion depuis 1958, avec 366 auditeurs. Il faudra malheureusement du temps avant qu’ils puissent prendre leurs fonctions, puisque leur formation dure 31 mois.
Or Bobigny ne peut pas attendre. Pour faire face à l’urgence, le garde des sceaux a annoncé vendredi dernier à Chartres qu’il réorientait 14 millions d’euros pour créer immédiatement des postes de vacataires, afin de soulager les magistrats et les greffes et de leur permettre de se concentrer sur leurs missions. Ils ont besoin de cet effort et leur message a été entendu.
Le garde des sceaux poursuit la réflexion engagée par sa prédécesseure, Christiane Taubira, sur un contrat d’objectif, avec la direction des services judiciaires et le président du tribunal de grande instance. Mais ce n’est pas suffisant. Il s’est entretenu mardi matin avec le bâtonnier Campana et il recevra demain le président et la procureure du tribunal de grande instance de Bobigny, afin d’arrêter avec eux des mesures rapides et opérationnelles, tenant compte de l’urgence de la situation.
Le garde des sceaux aura besoin de l’appui de tous, y compris du vôtre, madame la députée, car nous partageons la conviction que si la justice ne peut pas bien remplir sa mission, c’est la démocratie qui sera abîmée.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Vous aurez compris que, pour nous, la justice en Seine-Saint-Denis, c’est aussi l’état d’urgence. Tous les parlementaires élus dans ce département sont attachés à l’image de celui-ci. Or tous les reportages qui montrent des couloirs encombrés et des justiciables déboussolés ne sont pas satisfaisants pour un département qui se bat, avec des personnels qui sont vraiment à la hauteur de leur mission. J’espère donc que nous aurons l’occasion, dans les prochains mois, d’être plus satisfaits.

La parole est à M. Charles de La Verpillière, pour exposer sa question, no 1300, relative à la généralisation du programme de déradicalisation en milieu carcéral.

Madame la secrétaire d’État chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage, nous sommes malheureusement obligés de faire un terrible constat : le système pénitentiaire, c’est-à-dire les prisons françaises, fabrique des terroristes ! Lors d’un colloque interministériel qui s’est tenu la veille des attentats de Paris et Saint-Denis, Christiane Taubira a donné un chiffre : « Nous savons […] que 15 % des personnes impliquées dans des activités terroristes ont eu un antécédent carcéral. » En réalité, presque tous les auteurs français des attentats les plus violents sont passés par la « case prison » et y ont amorcé leur dérive terroriste : Mohamed Merah, Chérif Kouachi, Amedy Coulibaly, et tant d’autres.
D’où ma première série de questions, madame la secrétaire d’État. Des mesures concrètes sont-elles prises pour endiguer ce phénomène de radicalisation carcérale : surveillance renforcée, contrôle des parloirs, multiplication des fouilles, interdiction ou interception des communications téléphoniques et électroniques, mise à l’isolement ? Les moyens affectés aux actions de renseignement en prison ont-ils été augmentés ? La coordination entre le renseignement pénitentiaire et les services de sécurité est-elle suffisante ? Est-il prévu d’agir dans tous les établissements, et pas seulement à Osny, Lille et Fresnes ? Les budgets sont-ils suffisants ? Y a-t-il, enfin, des dispositions législatives à prendre pour améliorer le dispositif ?
En second lieu, il faut aussi pouvoir contrer efficacement le discours islamiste radical. Pouvez-vous, madame la secrétaire d’État, faire le point sur la mission des aumôniers musulmans agréés par l’État ? Pouvez-vous également nous dire si une formation spécifique est dispensée aux personnels pénitentiaires qui se sentent démunis face à la radicalisation ?
J’ai bien conscience que la question de la radicalisation en prison appellerait de très longs développements, qui excèdent le temps d’une question orale sans débat. Mais la gravité de la situation et l’urgence d’agir sont telles qu’il m’a semblé indispensable d’interpeller le Gouvernement.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Monsieur le député, je vous prie à nouveau d’excuser le garde des sceaux, auquel votre question était adressée, et qui n’a pu être présent aujourd’hui. Je constate que la question que vous m’avez posée est un peu différente de celle pour laquelle il m’a donné des éléments de réponse, puisque vous avez apporté des compléments extrêmement importants.
Cela n’est pas très grave. Je vais répondre à votre question initiale et je demanderai au garde des sceaux de vous répondre par écrit sur les points supplémentaires que vous avez soulevés. Je tenais à préciser les choses d’emblée et à vous présenter mes excuses. Vous comprendrez que je ne souhaite pas répondre à la place du garde des sceaux, dont je ne suis pas plus que la porte-parole dans cet hémicycle. Vous pouvez en revanche compter sur moi, je le répète, pour lui demander de vous répondre par écrit.
Vous avez interrogé le garde des sceaux sur les programmes de déradicalisation, et plus spécifiquement sur le dispositif des unités dédiées mis en place depuis le 25 janvier.
La création de quatre unités dédiées constitue l’une des principales mesures de la partie pénitentiaire du plan de lutte contre le terrorisme annoncé par le Premier ministre le 21 janvier 2015. Cette création n’est à ce jour prévue qu’au sein de maisons d’arrêt ou de quartiers maison d’arrêt dans des centres pénitentiaires, eu égard à la faible proportion de personnes détenues condamnées pour des faits de terrorisme.
Parmi ces quatre unités dédiées, celle de la maison d’arrêt d’Osny est déjà opérationnelle. La maison d’arrêt de Fleury-Mérogis accueillera, dès le mois de mars, deux unités dédiées, l’une consacrée à l’évaluation, et l’autre à la prise en charge des détenus radicalisés. Enfin, d’ici la fin du premier semestre, le centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin mettra en place la quatrième unité. En plus de ce dispositif, depuis octobre 2014, la maison d’arrêt des hommes de Fresnes a déjà mis en place une unité de regroupement et il existe un centre national d’évaluation pour tout type de profil, notamment pour les personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation. Néanmoins, le souhait d’une spécialisation en matière d’évaluation des radicalisés, ainsi que la gestion des interdictions de communiquer, nombreuses dans les dossiers d’association de malfaiteurs, ont conduit à la création d’une seconde unité d’évaluation à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Il faut préciser qu’une affectation implique automatiquement un encellulement individuel et que le principe de séparation des personnes prévenues et des personnes condamnées s’applique. En outre, toute personne hébergée en unité dédiée est prise en charge dans le respect du régime ordinaire de détention, avec les droits et obligations afférents. Dans les faits, à la suite de l’évaluation, les personnes détenues seront orientées en fonction de leur profil et de leur degré d’adhésion au programme mis en place. Si elles ne peuvent s’y intégrer et qu’elles justifient des mesures de sécurité particulières, elles seront placées à l’isolement. Dans le premier cas, les personnes détenues seront affectées à la maison d’arrêt d’Osny ou à celle de Fleury-Mérogis et, pour les personnes les plus radicalisées, au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin.
Chaque unité dédiée pourra proposer des modes de prise en charge différents, liés au profil des personnes. En outre, le personnel y sera exclusivement consacré – ce qui est rendu possible par les renforcements permis par le plan de lutte contre le terrorisme – et éligible à des formations spécifiques.
La prise en charge des personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation ne saurait néanmoins être assurée exclusivement en unités dédiées. Celles-ci restent, à ce jour, un dispositif expérimental. C’est pourquoi la direction de l’administration pénitentiaire s’attache à formaliser un cadre commun d’organisation de gestion de ces détenus dans tous les établissements pénitentiaires.
Monsieur le président, j’ai encore quelques éléments de réponse précis à donner.

Mais il y a quand même des règles à respecter, madame la secrétaire d’État.
Seront privilégiées les mesures suivantes : prise en charge individuelle, placement au quartier d’isolement, affectation en maisons centrales, affectation en secteurs brouillés, propositions d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.

Madame la secrétaire d’État, il faudra préciser au rédacteur des notes que vous lisez que tout doit être fait en six minutes.
Je suis désolée et confuse de ne pouvoir faire une réponse complète à M. le député.

Je vous remercie de cette réponse, madame la secrétaire d’État. J’ai bien conscience que ma question embrassait un sujet très vaste et je vous serais effectivement très reconnaissant de demander à M. le garde des sceaux de me transmettre par écrit une réponse à cet ensemble de questions.

La parole est à M. Gérard Cherpion, pour exposer sa question, no 1307, relative aux pensions d’invalidité des non-salariés agricoles.

Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, l’agriculture traverse actuellement une crise particulièrement violente, qui entame fortement le niveau de vie des agriculteurs, eux qui, pourtant – et nous pouvons partager ce constat sur tous les bancs de cet hémicycle – travaillent durement pour répondre aux besoins alimentaires de notre pays. À cela s’ajoute, pour un certain nombre d’entre eux, la survenance de troubles physiques entraînant une invalidité partielle ou totale, et ce en raison de ce travail éprouvant.
Or les montants des pensions d’invalidité servies aux personnes relevant du régime des non-salariés agricoles sont particulièrement faibles. Depuis le 1er avril 2015, ces montants s’élèvent à 3 379,95 euros par an, soit 281,66 euros par mois pour une pension d’invalidité pour inaptitude partielle, et à 4 356,31 euros par an, soit 363,03 euros par mois pour une inaptitude totale.
Ces montants forfaitaires sont très inférieurs aux montants des pensions servies dans les autres régimes. Ainsi, afin de rétablir une équité, il faudrait envisager le rapprochement de ce régime du régime social des indépendants. En effet, les assurés de celui-ci peuvent bénéficier d’une pension d’un montant maximal de 11 412 euros annuels pour inaptitude partielle, c’est-à-dire 30 % du plafond de la Sécurité sociale, et 19 020 euros annuels pour inaptitude totale, c’est-à-dire 50 % du plafond de la Sécurité sociale.
En outre, la mise en place du dispositif d’indemnités journalières maladie pour les non-salariés agricoles crée un décalage important entre le niveau mensuel de ces indemnités journalières, proche de 850 euros par mois, et le montant de la pension d’invalidité qui est susceptible de s’y substituer.
Monsieur le ministre, cette situation est très désavantageuse pour les non-salariés agricoles, et ce d’autant plus que leur effort contributif est tout à fait comparable à celui des bénéficiaires du RSI. Quelle mesure entendez-vous prendre pour répondre à ces inégalités de traitement ?

La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Monsieur le député, vous avez évoqué la situation de l’agriculture et la crise que traverse l’élevage. Le Premier ministre a fait hier de nouvelles propositions, qui étaient d’ailleurs demandées par l’opposition, comme par une partie du monde agricole. Il a notamment annoncé une baisse des cotisations, considérées, vous l’avez souvent rappelé, comme des charges grevant la compétitivité. La contribution de l’agriculture à un certain nombre de systèmes de solidarité va baisser, ce qui est normal, puisque notre objectif est aussi de favoriser la compétitivité.
Sur la question de l’invalidité, monsieur le député, il est vrai que les prestations qui sont versées aux non-salariés agricoles sont inférieures à celles que touchent par exemple les indépendants, mais il y a aussi une différence de contribution : celle des artisans et des commerçants est supérieure à celle des agriculteurs.
La revalorisation des retraites agricoles que j’ai menée a été financée à la fois par des réserves de la Mutualité sociale agricole – MSA – et par des cotisations supplémentaires. Si le niveau des retraites, vous le savez, est assuré à 80 % par la solidarité nationale, et c’est normal, la part qui a été revalorisée est également financée par des cotisations supplémentaires parfaitement ajustées à l’augmentation du niveau des retraites.
S’agissant des pensions d’invalidité, on peut et on doit de la même manière ouvrir des discussions pour déterminer comment il est possible de financer leur augmentation, qui doit être un objectif. Deux voies existent : l’une repose sur la contribution, l’autre sur la mise en oeuvre de la solidarité. Je suis ouvert à ces discussions – je les ai menées pour les retraites agricoles. S’agissant de la retraite complémentaire obligatoire, la RCO, des dispositifs ont été mis en oeuvre. L’AMEXA – assurance maladie des exploitants agricoles – a été complètement rendue à la MSA. Maintenant que nous disposons d’outils et qu’un périmètre existe, il convient de travailler sur le sujet en consacrant à ce travail le temps nécessaire. Vous le comprenez, la prestation dépend de la cotisation et du périmètre du financement. Nous devons être capables de répondre aux besoins des agriculteurs qui peuvent être victimes de graves accidents du travail.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse qui est en partie favorable, puisque vous êtes ouvert à une discussion sur ce sujet. Je tiens toutefois à souligner que la différence de l’effort contributif entre le régime social des indépendants – RSI – et celui de la MSA n’est pas aussi importante que vous le laissez entendre. Je crois que la période est particulièrement difficile. Un effort est effectivement consenti en matière de charges. Nous devons porter notre attention sur ce problème qui est très important pour l’avenir de ces personnes.

La parole est à M. Alain Marleix, pour exposer sa question, no 1298, relative à la prolifération des rats taupiers.

Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, je souhaite appeler votre attention sur les inquiétudes des agriculteurs de plusieurs régions françaises, notamment du Massif central, devant la prolifération, voire la pullulation des rats taupiers. Les dégâts en phase de pullulation – 1 500 rats par hectare : c’est considérable ! – ont des effets économiques majeurs sur les exploitations agricoles concernées. Il est évident que seule la combinaison de tous les moyens de lutte existants, notamment préventifs, peut permettre aux agriculteurs de réussir à endiguer ce phénomène.
L’arrêté du 14 mai 2014, encadrant la lutte contre le campagnol, notamment l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, vise « la maîtrise des populations » de ces rongeurs, en limitant le recours à ce raticide. Des méthodes empiriques ont été mises à l’essai, un peu timidement, je dois le reconnaître. Malgré cela, la situation est loin de s’améliorer, hélas. La cible a été manquée, chacun en convient, si bien que la colère des agriculteurs grandit devant ce fléau qui semble impossible à éradiquer, s’étend et gagne petit à petit tous les départements du Massif central, de la Corrèze au Cantal jusqu’à la Lozère et l’Aveyron en passant par le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire.
Lors du bilan de santé de la PAC, l’Union européenne a engagé une réforme de la gestion des risques en agriculture, ouvrant à ses États membres la possibilité de mettre en place des fonds de mutualisation pour indemniser les pertes subies par les agriculteurs lors des crises sanitaires ou des accidents environnementaux. Ces fonds de mutualisation existent : ils sont financés à la fois par la profession agricole, l’État et l’Union européenne. Depuis cette date, un travail a été engagé sur le campagnol sous l’impulsion notamment de l’Institut national de la recherche agronomique – INRA –, de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est concernée par la situation, ainsi que par la Franche-Comté, qui est habituée à ces pullulations de rats taupiers. Ces dernières semaines, des recherches, menées à partir de l’université de Lyon, se sont enfin accélérées
Ce qui nous inquiète, c’est que le comité scientifique qui avait été nommé par l’administration dans le Massif central, ne s’est, me semble-t-il, toujours pas réuni, alors que nous sommes aujourd’hui plus de quatre mois après l’annonce de la création de ce comité chargé de faire des propositions. Il nous paraît grand temps de trouver le produit susceptible d’éradiquer définitivement ce fléau récurrent qui, joint à la sécheresse et à la fièvre catarrhale, contribue, vous le savez, à affaiblir l’élevage français et à décourager nos agriculteurs, notamment les jeunes, de s’installer. Le fait que le Cantal, mon département, qui est peut-être celui qui installe, chaque année, le plus grand nombre de jeunes agriculteurs – plus d’une centaine –, ait vu ce nombre réduit de moitié cette année est un signe de ce découragement.
Monsieur le ministre, pouvez-vous me donner des précisions sur l’évolution de ce dossier, qui pénalise de plus en plus les campagnes françaises, puisque, à ce jour, aucune solution durable n’a pu être mise en place pour éviter cette prolifération ? Il le faut avant que ne se déclare également une véritable crise sanitaire liée aux cadavres des dizaines de milliers de rats présents dans nos ruisseaux et dans nos rivières.
Deux questions urgentes se posent : quels sont les moyens de lutte crédibles en période de pullulation massive ? En 1990, le seuil de bromadiolone admis était de vingt et un kilogrammes à l’hectare ; dans les années 2000, il a été abaissé à quatorze kilogrammes et il est aujourd’hui de 7,5 kilogrammes. Ne peut-on pas, pour réguler cette pullulation, revenir pour quelque temps, par dérogation exceptionnelle, aux anciens seuils de tolérance ? Par ailleurs, comment l’État pourra-t-il aider dans quelques semaines ces agriculteurs de montagne qui n’auront ni herbe ni fourrage ?

La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Monsieur le député, vous avez évoqué les problèmes à l’ordre du jour, notamment les zones réglementées « fièvre catarrhale ovine » – FCO ; j’aurai à répondre également à une question sur l’influenza aviaire. Vous avez parlé de la crise de l’élevage et de la sécheresse et rappelé, à juste titre, les problèmes dus aux campagnols ou rats taupiers, qui occasionnent des dégâts, notamment dans les prairies permanentes.
Je souhaite vous apporter une réponse objective, capable de régler le problème. Vous avez évoqué les deux approches possibles. La première consiste à relever les niveaux de tolérance de bromadiolone, ce qui ne serait pas sans risque. En effet, si ce produit est de moins en moins utilisé, c’est qu’il comporte des risques pour l’environnement. Il convient aussi d’utiliser des produits de substitution. Des pistes intéressantes existent aujourd’hui, sur lesquelles nous pouvons désormais travailler : je pense notamment à l’introduction sous terre de glace carbonique pour asphyxier les rats.
La seconde stratégie vise, contre ces parasites et nuisibles, à appliquer des règles de prévention coordonnées et organisées. Une fois qu’on a laissé proliférer les nuisibles, on est contraint de trouver des mesures d’éradication qui ont souvent de lourdes conséquences environnementales. Le comité scientifique, dites-vous, ne s’est pas réuni. Aussitôt après vous avoir répondu, je ferai passer un message visant à demander la mise en place d’un comité de pilotage de gestion et de prévention de l’ensemble de ce sujet, qui prendra en considération les éléments techniques et scientifiques supplémentaires qui sont à notre disposition – j’ai évoqué la glace carbonique. Le FMSE, le fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, pourrait être également mobilisé puisque nous avons affaire à un problème sanitaire.
Plutôt que de nous retrouver dans une situation qui ne nous laisserait pas d’autre choix que l’éradication par des produits et la mutualisation des aides, nous devons prévoir des stratégies de prévention.

La parole est à Mme Martine Faure, pour exposer la question no 1319 de Mme Régine Povéda, relative à la formation dans les maisons familiales rurales.

Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, je me permets de vous poser la question de Mme Povéda, qui est retenue par des obsèques dans sa circonscription.
Elle souhaite appeler votre attention sur la question de l’enseignement prodigué dans les maisons familiales rurales, les MFR. La première MFR a été créée en 1937 à Lauzun, dans son département. Depuis, ce réseau s’est étendu et on compte aujourd’hui plus de 450 maisons familiales en France, où plus de 50 000 élèves suivent un enseignement agricole : ils sont donc sous statut scolaire dépendant du ministère de l’agriculture. Les maisons familiales rurales sont un modèle d’éducation alternatif qui se révèle très efficace à de nombreux égards : elles participent de la lutte contre les inégalités et promeuvent la mixité sociale. De nombreux jeunes issus des milieux ruraux, qui se trouvaient exclus de l’enseignement traditionnel par des difficultés d’accès ou en raison de décrochage scolaire, peuvent bénéficier grâce à ce système d’un enseignement qui les réintègre dans la vie scolaire et, plus largement, dans la vie sociale. De plus, le fonctionnement de ces maisons met l’accent sur la vie en collectivité et les responsabilités quelle engage, ce qui favorise, chez les jeunes qui suivent cet enseignement, le goût de l’engagement personnel et de la citoyenneté.
Chaque année, plus de 90 000 personnes, jeunes et adultes, sortent diplômés des MFR. Ces maisons assurent efficacement un haut niveau de réussite à la fois dans l’acquisition des diplômes et dans l’insertion socio-professionnelle des jeunes. Elles permettent l’intégration et la formation pour des populations rurales qui n’ont pas toujours le meilleur accès à l’enseignement. Face à un tel constat d’efficacité, la volonté d’encourager le développement du réseau des maisons familiales rurales est évidente. Pour poursuivre ce soutien, il faudrait renforcer la formation effectuée par les MFR en densifiant leur réseau dans le milieu rural, par exemple par des aides à la création de nouvelles maisons.
Monsieur le ministre, Mme Povéda souhaiterait connaître votre position sur les maisons familiales rurales et savoir quelles actions vous comptez mettre en place pour développer et soutenir ces formations très importantes pour la jeunesse du milieu rural.

La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Madame la députée, je tiens tout d’abord à rappeler que l’enseignement agricole comprend trois grandes entités : l’enseignement public, l’enseignement privé et les maisons familiales rurales, que je connais bien – je pense notamment à celles de la Sarthe. Je n’ignore ni le rôle ni la place qu’elles occupent dans la formation des jeunes en milieu rural.
Alors que l’enseignement public agricole est directement géré par l’État, l’enseignement privé agricole et les maisons familiales rurales font l’objet de contrats négociés et signés avec le ministère, en vue de garantir leur fonctionnement et les moyens nécessaires à chacune de ces institutions pour leur permettre d’assurer l’enseignement, le développement et l’apprentissage de tous les enfants du milieu rural.
Un accord commun a été signé entre le ministère et l’Union nationale des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation le 19 juillet 2013 : il fixe un plafond de subvention négocié et évalué à 205 millions d’euros. Je me suis rendu à Bernay-en-Champagne, dans la Sarthe juste après cette signature. C’est sur cette base que nous travaillons ensemble à assurer l’évolution des effectifs des maisons familiales ainsi que leur fonctionnement.
Vous pourrez dire à Mme Povéda que je suis attaché à cette répartition de l’enseignement agricole entre un enseignement public très important, avec ses lycées, un enseignement privé, qui couvre tous nos départements, et les maisons familiales, qui appartiennent à une histoire ancienne et assurent la promotion sociale. Je rappelle que j’avais fixé trois grands objectifs dans le débat sur la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : le projet agroécologique, le développement de la relation à l’international et la promotion sociale. Les maisons familiales rurales remplissent parfaitement ce rôle.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse, que je transmettrai à Mme Povéda.
Je tiens également à vous remercier à titre personnel de votre engagement en faveur de l’enseignement agricole dans toutes ses composantes.

La parole est à M. Claude de Ganay, pour exposer sa question, no 1306, relative aux contraintes réglementaires sur les exploitants agricoles.

Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, je souhaite débuter mon intervention par un hommage à la mémoire d’une salariée de la chambre d’agriculture de l’Aveyron, qui a perdu la vie hier lors d’une effroyable agression. Rien ne peut justifier un tel acte. J’adresse toutes mes condoléances aux proches de cette victime.
Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur toutes les causes de la terrible crise que traversent nos agriculteurs et nos éleveurs. J’ai à l’esprit toutes les mesures que vous avez annoncées depuis quelques semaines, que nous jugerons sur leurs résultats.
J’aimerais toutefois vous suggérer une décision concrète, qui pourrait être mise en oeuvre immédiatement par votre ministère. Les travailleurs de nos campagnes sont soumis à des contrôles administratifs fréquents, parfois intrusifs, qui peuvent être vécus comme des humiliations. Pour beaucoup, les contrôleurs incarnent une administration aveugle, rigide, qui ne se soucie pas d’eux. Je ne nie pas l’utilité de l’existence même des contrôles, ni la bonne volonté des contrôleurs, mais en période de crise, les excès de l’administration sont intolérables pour des travailleurs à bout.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, quelles mesures vous comptez prendre pour alléger les contraintes et réduire la fréquence abusive des contrôles administratifs des exploitations agricoles.

La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Tout d’abord, monsieur le député, je veux rappeler moi aussi ce qui s’est passé hier. J’assure la famille et tous les proches de cette jeune femme de notre soutien, et je leur adresse nos condoléances. C’est un drame extrêmement grave. Certains ont voulu faire des amalgames, mais j’ai tout de suite souligné que la visite de cette conseillère agricole ne consistait pas en un contrôle, mais en une visite de conseil ; par ailleurs, ce n’est pas le chef d’exploitation mais son frère qui a été l’auteur de ce drame. La justice nous dira ce qui s’est passé exactement, mais comme vous l’avez très bien dit, nous devons soutenir la famille et les proches de la victime, ainsi que l’ensemble des salariés de la chambre d’agriculture de l’Aveyron, auxquels j’ai adressé un message hier. J’imagine qu’ils sont, eux aussi, très touchés.
J’en viens à votre question sur la simplification. Il convient de procéder aux contrôles nécessaires pour justifier le versement des aides sans qu’ils deviennent répétitifs, du fait d’une organisation trop compartimentée de nos services, et qu’ils se succèdent dans les exploitations à tel point que les agriculteurs ne se sentent pas justement contrôlés pour justifier des aides qu’ils perçoivent, mais soupçonnés, comme je l’ai constaté. En effet, des contrôles de la Mutualité sociale agricole – MSA –, des contrôles liés à la politique agricole commune – PAC – et des contrôles de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques – ONEMA – peuvent se succéder dans la même exploitation, qui peut être contrôlée trois fois au cours de la même année.
Or, la première des choses que nous devons aux agriculteurs, c’est de coordonner les contrôles des services de l’État et d’éviter que ces derniers soient en permanence dans les exploitations en train de contrôler. C’est un vrai sujet ! C’est l’objectif du rapport Massat, et c’est ce que nous mettons en oeuvre afin d’atténuer ce sentiment de suspicion que vous avez évoqué. L’État ne doit procéder à des contrôles que pour justifier du versement des aides. Sur ce premier point, qui est très important, vous avez parfaitement raison.
Par ailleurs, certains contrôles vont au-delà de ce qu’exige la réglementation européenne. Dans ce cas, nous reviendrons au niveau requis par la réglementation européenne, comme l’a indiqué le Premier ministre hier. Notre objectif sera de limiter le nombre de contrôles.
Il faut également veiller à la manière dont les contrôles sont effectués. Il ne doit pas s’agir d’une inquisition : les contrôles ne visent qu’à vérifier le bien-fondé des aides versées ou le respect des normes sanitaires – nous avons évoqué tout à l’heure un certain nombre de sujets. C’est tout !
Depuis un an, notamment depuis la remise du rapport Massat, j’ai envoyé des lettres et des circulaires en ce sens. De plus, le préfet de la région Bretagne a conduit une expérimentation en vue d’alléger, de coordonner et de simplifier les contrôles. Tout cela est mis en oeuvre, et c’était absolument nécessaire. Quand quelque chose fonctionne, personne ne s’en rend compte, mais on s’aperçoit maintenant qu’on a laissé libre cours à des pratiques qui ont donné aux agriculteurs le sentiment que nous les suspections dans leur travail. Nous devons contrôler, dans le respect du travail des agriculteurs, avec un seul objectif : assurer le paiement des aides et garantir le respect de la réglementation. C’est tout.
Toutes ces mesures sont en train d’être mises en oeuvre, monsieur le député. Nous pourrons même faire un point, à l’Assemblée nationale, sur les suites données au rapport Massat. Cette réunion pourrait être organisée par la commission des affaires économiques et ouverte à tous les députés. Il s’agirait de faire un point précis sur ce qui a été mis en oeuvre, et peut-être aussi d’avoir des remontées du terrain, pour savoir ce qu’il faut encore corriger afin d’améliorer l’équilibre entre la nécessité des contrôles et le respect des agriculteurs.

Merci, monsieur le ministre : je vois que vous m’avez entendu. Je ne mets pas en cause la pertinence des contrôles, qui sont souvent totalement justifiés : ma question porte sur la forme. Il faut que l’intervention de l’administration prenne la forme d’un dialogue, et non d’un contrôle un peu intrusif.
Tout à fait.

Dans le cadre de la police des eaux, par exemple, de nombreux contrôles sont effectués. Les agents arrivent avec une arme à la ceinture. Il faudrait peut-être leur donner des consignes et leur dire qu’ils ne sont pas au Far West : ils sont là pour dialoguer avec les agriculteurs.

La parole est à Mme Martine Faure, pour exposer sa question, no 1312, relative aux conséquences de la grippe aviaire sur les petits producteurs.

Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, je souhaite revenir sur les conséquences et la gestion de la crise que provoque l’intervention contre l’influenza aviaire, et plus particulièrement sur le sort des petits producteurs de Gironde et du Lot-et-Garonne.
Toute la production de ces deux départements provient de petites exploitations qui, pour une grande partie, ne vivent que grâce à l’élevage des seuls canards. Ces petits éleveurs ne disposent d’aucune trésorerie pour supporter financièrement un arrêt d’activité de quatre mois. Pour passer le cap de cette crise et rebondir très vite, ils ont besoin d’aides spécifiques, adaptées à chaque exploitation.
Permettez-moi également de revenir sur l’arrêté du 8 février dernier rendant obligatoire la conduite en bande unique de toute unité de production. J’aimerais connaître précisément les nouvelles règles d’élevage et de biosécurité.
Pour la majorité des producteurs, c’est le modèle des multibandes qui est en vigueur aujourd’hui. Si le modèle des bandes uniques devenait la règle, sans possibilité de multiplier au sein d’une unité de production plusieurs bandes uniques, ceci entraînerait une grande fragilisation voire la disparition de nombreux aviculteurs.
En Gironde, un département qui compte trente-cinq producteurs, une coopérative, Palmagri, est alimentée par seize producteurs et emploie quatorze salariés. Cette coopérative ne pourra survivre sans ses producteurs. Aussi, face aux pertes à venir et aux investissements exigés pour répondre aux obligations sanitaires, quels sont les accompagnements et les aides financières dont pourront bénéficier les producteurs, les salariés et la coopérative ? Dans moins d’un mois, de nombreuses familles vont se retrouver sans ressource.
Les producteurs aimeraient également profiter du vide sanitaire pour réaliser des travaux et être opérationnels dès le 16 mai prochain.
Je terminerai ma question en évoquant des murmures qui se font entendre, à propos de la filière espagnole qui viendrait envahir le marché français avec des canards prêts à gaver dès la fin du vide sanitaire chez nous.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous rassurer sur tous ces points et confirmer que la qualité et le savoir-faire français seront toujours garantis et valorisés par nos décisions politiques ?

La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Madame la députée, vous êtes directement concernée par le sujet de l’influenza aviaire. J’ai déjà répondu à plusieurs questions qui relayaient des inquiétudes, s’agissant notamment des petites exploitations autarciques. Ce sujet a été abordé dans le cadre d’une discussion avec l’ensemble des représentants du secteur, à laquelle ont participé les coopératives les plus importantes, les coopératives de taille moyenne, les plus petites, ainsi que les petits producteurs. La Confédération paysanne, la Coordination rurale et le Mouvement de défense des exploitants familiaux – MODEF – étaient présents. Nous avons donc cherché à prendre en compte ces exploitations autarciques.
S’agissant du principe de la bande unique, il faut savoir que les vides sanitaires sont nécessaires pour éviter que, dans le cadre d’une exploitation continue, les animaux véhiculent un virus et finissent par le transmettre. C’est toujours la même question qui est posée : devons-nous mettre en oeuvre des mesures permettant d’éradiquer le problème, c’est-à-dire l’influenza aviaire, ou prendre des risques pouvant avoir des conséquences économiques importantes ?
Il faut bien comprendre que le principe de la bande unique ne doit pas être appréhendé par exploitation, mais par unité de production ou par surface. Si l’on élève en continu des canards ou des palmipèdes d’âges différents – je parle bien d’une exploitation continue –, alors on prend un risque. Si l’on est capable de compartimenter, d’avoir des bandes différentes permettant une rotation, c’est-à-dire un élevage continu mais dans des endroits différents, alors on respecte les règles. Mais si les animaux se trouvent tout le temps au même endroit, alors nous prenons tous des risques.
Après avoir aidé les entreprises directement concernées, les accouveurs et les éleveurs, à hauteur de 130 millions d’euros, nous allons bien sûr venir en aide à l’ensemble des acteurs de la filière.
S’agissant des canards prêts à gaver, j’ai pris une décision lors de la réunion que nous avions organisée, tous ensemble, pour préparer la mise en oeuvre de ce plan. On m’avait demandé le droit d’acheter des canards prêts à gaver provenant de zones indemnes : je l’ai refusé, et je me suis d’ailleurs assuré que tous ceux qui étaient autour de la table approuvaient ce refus. Nous risquions en effet de ne pas avoir de canards sains, d’étendre la contamination à des zones aujourd’hui indemnes mais qui ne le seront pas forcément demain, et de recourir à l’importation de canards en France. C’est pourquoi j’ai refusé la solution des canards prêts à gaver, préférant celle des canetons produits chez des accouveurs. Vous pourrez donc, madame la députée, réfuter de la manière la plus claire et la plus ferme qui soit la rumeur dont vous avez entendu parler, puisque c’est justement pour éviter le recours à des canards prêts à gaver que nous avons décidé que la remise en production se ferait avec des canetons.

Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse claire. Je veux tout de même insister sur la nécessité de prévoir un accompagnement personnel de chaque producteur. Je sais que les services de l’État sont vraiment à leurs côtés, mais il faut absolument qu’ils permettent à chacun d’entre eux, pendant ces quatre mois, de préparer son dossier, lequel doit être le moins complexe possible – vous savez que c’est souvent un vrai casse-tête pour les producteurs de remplir un dossier. Merci d’éviter ainsi tous les préjudices moraux, sociaux et économiques dont nos campagnes pourraient pâtir.

La parole est à Mme Sandrine Doucet, pour exposer sa question, no 1321, relative à la Validation de l’apprentissage informel.

Madame la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, nous allons débattre prochainement de votre projet de loi relatif au travail. À ce sujet, je souhaiterais appeler votre attention sur la place qui devrait être faite à la validation de l’apprentissage informel et non formel en France aujourd’hui.
En effet, suite à la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 2012, dans une perspective de développement des compétences, il devrait être possible, d’ici 2018, dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, de se former ou d’acquérir une qualification ou un diplôme à tout âge, en faisant reconnaître ses compétences et ses savoir-faire, même lorsqu’ils sont le fruit d’expériences non académiques ni formelles. Les salariés, les demandeurs d’emploi et, plus largement, tous les adultes devraient pouvoir, dans cette optique, faire reconnaître officiellement leur parcours et leurs compétences. La validation relève ainsi de l’objectif d’éducation et de formation tout au long de la vie, dans l’idée sous-jacente qu’il existe chez les individus un vaste vivier inexploité de connaissances et de compétences.
Cette validation participe également au programme « Jeunesse en mouvement », qui cherche à améliorer l’éducation et l’employabilité de la jeunesse, et notamment à réduire le taux de chômage des jeunes, si important en Europe, en adaptant l’éducation et la formation aux besoins des jeunes, en leur donnant les qualifications requises pour les emplois d’aujourd’hui et de demain et en encourageant la flexibilité des transitions entre éducation et travail. Mais en France, ces transitions ne sont possibles qu’une fois maîtrisé le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
En outre, la validation de l’apprentissage informel et non-formel ne concurrence ni ne remplace le diplôme, mais est une autre forme, complémentaire, de reconnaissance des compétences.
Pour autant, si la reconnaissance des acquis de l’apprentissage informel et non formel constitue assurément une ambition légitime en ce qu’elle cherche à prendre en compte la diversité des parcours de formation et notamment les parcours des personnes peu ou pas qualifiées pour leur donner une chance sur le marché de l’emploi, la validation des acquis de l’apprentissage est un chantier plus délicat, notamment en France.
En effet, bien que la France bénéficie d’un dispositif ancien et élaboré avec la mise en place de la validation des acquis de l’expérience depuis 2002, ce dispositif demeure cependant marginal. À côté des difficultés d’ordre technique, l’instauration de dispositifs de validation se heurte ainsi à un certain nombre d’obstacles, notamment culturels, liés au primat des dispositifs formels, à la difficulté d’évaluer des compétences transversales.
Dès lors, dans quelle mesure cette question de la validation de l’apprentissage informel et non-formel pourrait-elle être prise en compte au sein du futur projet de loi sur le travail ou sous une autre forme, afin d’avancer sur ce sujet ?

La parole est à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Madame la députée, vous le savez, le Gouvernement fait de la qualification professionnelle l’un des axes de sa politique.
C’est notamment l’enjeu du plan « 500 000 formations » supplémentaires pour les demandeurs d’emploi que le Président de la République a annoncé le 18 janvier dernier.
Vous le savez aussi, les trajectoires professionnelles ne sont plus aussi linéaires qu’auparavant. Et encore trop de jeunes et de moins jeunes, même si des progrès ont été faits, ne disposent pas d’un diplôme permettant l’accès à un emploi, ou une prochaine reconversion.
Pour ces raisons, et je partage votre propos, il est important de reconnaître toutes les formes d’expériences : celles acquises en situation professionnelle, mais aussi celles acquises dans d’autres cadres – vie dans une association, périodes de formation ou engagement citoyen.
La validation des acquis de l’expérience – VAE – poursuit cet objectif. Mais je sais les freins qui existent encore dans notre pays pour y accéder et qui expliquent le nombre insuffisant, très insuffisant, autour de 30 000, de certifications délivrées chaque année.
C’est bien pour lever ces freins qu’une évaluation de politique publique a été lancée en décembre 2015 dont mon ministère, avec l’éducation nationale, est maître d’ouvrage.
L’objectif de cette évaluation est double : réinterroger la politique en matière de validation des acquis de l’expérience, ses résultats, et son utilité au regard des attentes des bénéficiaires ; proposer des pistes d’amélioration.
C’est à partir de ces évaluations que je travaille. Et dans le cadre du projet de loi que je défendrai au Parlement dans les prochaines semaines, je souhaite d’ores et déjà proposer des dispositions qui permettront de simplifier l’accès à un plus grand nombre.
La formation est un enjeu majeur et un défi pour l’avenir. Le Conseil national du numérique m’a récemment remis un rapport demandant de simplifier l’accès à la VAE et d’utiliser davantage les outils numériques dans ce cadre. Nous avons pris l’engagement de renforcer les outils qui y sont dédiés et dans le cadre du plan « 500 000 formations » pour les demandeurs d’emploi, nous nous sommes engagés à ce qu’il y ait au moins 10 000 à 20 000 personnes qui puissent en bénéficier et soient accompagnées dans la VAE.

Je remercie Mme la ministre de sa réponse, qui montre qu’à partir d’une expérience éprouvée, celle de la VAE, on peut déployer d’autres modes d’accès à la validation des acquis et accompagner, dans une politique de pas à pas, tous ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi, de la formation. Cela est de bon augure pour l’acquisition de diplômes ou de compétences via le déploiement de la VAE vers le plus grand nombre.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour exposer sa question, no 1301, relative à la notion de jour ouvrable en droit du travail.

Madame la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à plusieurs reprises, le Président de la République a évoqué la nécessité d’un « choc de simplification », indispensable pour les chefs d’entreprise. Ce choc devait notamment passer par des clarifications concernant les contradictions et les dispositions floues présentes dans le code du travail, bel ouvrage de plus de trois milles pages…
Madame la ministre, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a, par exemple, autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’harmoniser la définition et l’utilisation des notions de « jour » dans la législation du travail pour retenir essentiellement la notion de « jour ouvrable ». Cela pouvait permettre à un dirigeant de TPE ou PME d’appréhender la différence entre un jour ouvrable, ouvré, franc et calendaire. Mais en dépit des déclarations volontaristes de François Hollande et des divers instruments mis à la disposition du Gouvernement, à l’heure actuelle, rien ne semble avoir été fait en ce sens. Pis, les mesures récemment prises contribuent à renforcer le flou des dispositions juridiques.
Pour exemple, le décret du 10 décembre 2015 relatif à la procédure de reclassement à l’étranger en cas de licenciement pour motif économique, en insérant un nouvel article D. 1233-2-1 au code du travail, introduit par là même trois notions différentes de « jours ». Bien loin d’apporter des clarifications, les textes semblent poser de nouveaux problèmes. Tout l’art de compliquer des choses simples !
Quel crédit faut-il donc accorder aux déclarations volontaristes visant à réformer le code du travail alors que la notion de « jour », notion essentielle, demeure imprécise ? Madame la ministre, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Où est donc la volonté, où est le chemin ?

La parole est à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Monsieur le député, je ne peux pas vous laisser dire que nous n’avons pas à coeur de préciser et de simplifier le code du travail. Vous le savez c’est tout l’enjeu du projet de loi que je présenterai le 9 mars en Conseil des ministres. Cette réforme sera, je vous le dis, ambitieuse. Il nous faut, j’en suis convaincue faciliter l’accès et renforcer la lisibilité de notre droit du travail, dans la lignée de ce que propose le rapport de Jean-Denis Combrexelle. Je me préoccupe en effet d’apporter de la simplification, notamment en direction des chefs d’entreprise de TPE et de PME, qui n’ont pas de directions des ressources humaines.
Pour répondre précisément à votre question, et je vous rejoins sur votre analyse, il est nécessaire d’harmoniser la définition et l’utilisation des notions de « jour » dans la législation du travail. La lisibilité et la clarté du droit sont essentielles pour les employeurs, mais aussi pour les salariés.
Ce travail d’harmonisation est extrêmement conséquent et il n’a pu être effectué dans les délais prévus par l’habilitation. Je suis convaincue que c’est un sujet qu’il faut traiter, dans un souci de lisibilité et de clarté du droit.
C’est pourquoi il faudra réfléchir, dans le cadre de la réforme que je porterai, à une éventuelle nouvelle habilitation. C’est également un sujet qui pourra être traité par la commission chargée de réécrire l’intégralité du code du travail.
Cette commission, je le rappelle, sera installée sur deux ans,…
…elle sera chargée de réécrire l’intégralité du code du travail. C’est un travail colossal. L’objectif de cette réforme est clair : rendre le droit du travail plus accessible renforcera la protection des employeurs et des salariés.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse. Je me félicite que vous me rejoigniez dans mon analyse. Il y a donc une volonté, mais le chemin est probablement encore long. En tout cas, je serai vigilant lors de notre débat sur la simplification, qui devra lever des ambiguïtés, véritables freins au développement économique.

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour exposer sa question, no 1324, relative à l’habilitation des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage.

Madame la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, je souhaite appeler votre attention sur l’habilitation des organismes à percevoir la taxe d’apprentissage.
Outre les agréments concernant les établissements délivrant des formations par apprentissage, une fraction de 23 % appelée « hors quota » finance quant à elle les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage.
À ce titre, de nombreux organismes sont habilités à percevoir la taxe dans la mesure où ils dispensent, ou oeuvrent pour la promotion des formations technologiques et professionnelles, conformément à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Or, la liste publiée par arrêté du 24 novembre 2015 autorisant ces derniers à percevoir des financements sur la part dite du « hors quota » laisse entrevoir une acception bien plus large que celle définie par la loi, puisque certains organismes ne dispensent aucune formation de quelque nature que ce soit, et n’interviennent sur le champ de l’apprentissage que de façon lointaine et pour tout dire incertaine.
À titre d’exemple, et sans juger de l’utilité publique de ces organismes, nous pourrions citer les associations « Les Entrepreneuriales » et « Les Entretiens de l’Excellence ».
À l’inverse, de nombreux organismes ont vu leurs demandes d’agrémentation rejetées alors qu’ils contribuent, eux, fortement à la promotion des formations technologiques et professionnelles, voire en dispensent directement.
C’est par exemple le cas du réseau national Mission Emploi qui oeuvre quotidiennement au développement de l’apprentissage par de multiples actions entre futurs apprentis, CFA et entreprises, notamment en proposant des formations et en accompagnant des élèves décrocheurs vers les filières d’apprentissage.
Avec près de 7 000 candidats et plus de 1 900 « sorties positives » – CDI, CDD, intérim, formations qualifiantes – depuis vingt mois, ce réseau, pourtant efficace et qui croît chaque jour – la communauté de communes de Montluçon vient de la rejoindre il y a quelques jours –, se voit refuser, par votre décision et par ce décret, le droit de percevoir la taxe d’apprentissage.
C’est pourquoi, madame la ministre, je vous demande si le Gouvernement entend remédier à ces incohérences et rétablir la logique de la taxe d’apprentissage, qui veut que soient financés les organismes qui favorisent réellement le développement de l’enseignement technologique et professionnel, et qui sont directement utiles à nos entreprises et nos demandeurs d’emploi. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les entreprises veulent les financer.

La parole est à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Monsieur le député, je ne peux vous laisser dire qu’il y aurait une acceptation large, voire complaisante des organismes retenus pour bénéficier de la taxe d’apprentissage. Les termes de la loi sont en l’espèce très clairs. Les organismes qui agissent au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers peuvent bénéficier de la taxe d’apprentissage.
Pour cela, un arrêté – co-signé avec la ministre de l’éducation nationale – est pris après une instruction rigoureuse conduite par nos services. Cette instruction se fait notamment sur la base des trois critères suivants.
Premièrement, l’organisme doit être public ou privé à but non lucratif. Deuxièmement, l’activité conduite doit permettre de promouvoir la voie professionnelle auprès des jeunes. Et, comme vous le dites, les structures qui dispensent des formations ne sont donc pas concernées. Troisièmement, l’activité doit être exercée de façon permanente sur le territoire national.
Aussi, toutes les structures 2015 répondaient à ces critères. A contrario, une structure comme l’association Réseau national des missions emploi, n’y répond pas encore, d’après mes services. Je ne dis pas ainsi que cette structure ne conduit pas des actions importantes en matière d’apprentissage et de valorisation de la voie professionnelle. J’entends ce que vous dites, je ne suis pas là pour juger et j’ai confiance en ce que vous dites, monsieur le député. Mais l’association, récemment constituée, localisée sur Drancy exclusivement, ne peut à ce jour justifier d’une activité réelle, exercée en propre, et sur l’ensemble du territoire. Pour l’année 2017 et dès lors qu’elle remplira ces critères, l’association pourra représenter un dossier.
J’invite cette association à contacter mes services. Pour l’heure, il me semble que les trois critères retenus ne s’appliquent pas à elle.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Permettez-moi de vous apporter quelques informations complémentaires. L’association dont il s’agit a un réseau national. Aujourd’hui, des villes comme Bourges, Maubeuge, Montluçon – qui en fait partie depuis quelques jours – en sont membres. Maubeuge, Bourges et d’autres en font partie depuis plusieurs mois et cette information figurait dans le dossier qui a été examiné par vos services.
Je souhaiterais que vous examiniez à nouveau les choses car les trois critères retenus sont remplis. Les actions sont pérennes et existent depuis deux ans. Le réseau s’étend bien – et de plus en plus – sur le territoire national. Pour vous donner une information récente, j’indique qu’une entreprise comme KPMG souhaite également participer au réseau.
Le système est en réalité simple, les communes en question ont connaissance par leurs services sociaux de nombreux demandeurs d’emploi. Les entreprises recherchent des demandeurs d’emploi, lesquels ont parfois besoin d’une courte formation, ou d’une formation un peu plus longue. C’est cette mise en relation, y compris la mise en formation des personnes en recherche d’emploi, qui donne des résultats efficaces, qui intéresse les entreprises, ce qui les inclinerait à participer via la taxe d’apprentissage au développement du partenariat.
Je souhaite vivement, madame la ministre, que vous vous penchiez à nouveau sur le fonctionnement de ce dispositif. J’ajoute qu’à aucun moment, ce réseau ne demande de subventions publiques.
Oui, j’ai bien compris.

Il ne coûte pas un centime d’argent public et permet de mettre en relation les demandeurs d’emploi et ceux qui sont en recherche de candidats, de gens formés. Il s’agit d’un système vertueux qui pourrait se développer sans argent public et qui est du reste en train de se développer sur l’ensemble du territoire national.

La parole est à Mme Sophie Dion, pour exposer sa question, no 1304, relative au plan pour l’emploi en Haute-Savoie.

Madame la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le chômage n’épargne malheureusement aucun territoire. La vallée de l’Arve, la vallée du Giffre et le pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, ne font pas exception. Dans le bassin de Cluses, le taux de chômage atteint 9,7 %, affichant une hausse de 2,5 points en 2015. Quant au bassin de Sallanches, la progression du chômage y est encore plus forte, avec une augmentation de 6,8 % l’an passé. Tous les secteurs économiques sont touchés.
Pour inverser la courbe du chômage, le Gouvernement propose un plan d’urgence pour l’emploi, avec une augmentation des formations pour les chômeurs, des mesures pour l’apprentissage et des aides à l’embauche pour les petites et moyennes entreprises – PME. Cependant, les chefs des entreprises qui composent le tissu économique de ces vallées haut-savoyardes ne sont pas convaincus par ces mesures, pour la simple raison qu’en réalité, ils n’en bénéficieront pas. Ils auraient préféré, comme beaucoup d’autres chefs d’entreprise, une exonération des cotisations sociales patronales pour tout nouveau recrutement.
En ce qui concerne la prime à l’embauche, valable uniquement jusqu’au 31 décembre 2016, une entreprise s’est trouvée dans l’impossibilité d’en bénéficier, car elle avait embauché un salarié le 1er janvier, alors que le dispositif n’était applicable qu’à partir du 18 janvier. C’est regrettable. Au surplus, et de manière générale, les entreprises de ces vallées n’en bénéficieront pas, car cette prime est limitée à certains postes.
Deuxième exemple : en matière de formation pour les chômeurs, quel sera l’impact du dispositif du plan emploi sur le financement des formations existantes ? J’en donnerai une illustration concrète : un groupement d’employeurs créé par l’ensemble des acteurs du décolletage propose déjà aux demandeurs d’emploi des formations longues – de 300 à 400 heures – et diplômantes, avec un emploi pérenne à la clé, aujourd’hui financées par les entreprises et les organismes paritaires collecteurs agréés – OPCA. Ces formations longues seront-elles toujours financées ou votre plan pour l’emploi ne financera-t-il que des formations courtes, dans le seul but de faire baisser les statistiques du chômage ?
Troisième exemple : alors que chacun sait que l’apprentissage est une voie d’excellence pour permettre aux jeunes d’accéder à un premier emploi et au marché de l’emploi, la filière du décolletage est très fortement mobilisée pour attirer les talents et transmettre les savoir-faire. Plus de 80 % des apprentis trouvent un emploi à l’issue de leur formation. Encore faut-il qu’ils restent, à l’issue de cette formation, dans l’entreprise qui les a formés et ne soient pas attirés par des salaires trop élevés, notamment dans les pays frontaliers.
Vous proposez d’augmenter le nombre des contrats de professionnalisation, le portant à 50 000, contre 8 000 actuellement, et d’apporter un soutien financier, sur le modèle des emplois aidés. Encore des contrats aidés ? À quand une vraie politique de valorisation de l’apprentissage ?
Voilà, madame la ministre, les questions auxquelles les entreprises qui portent la compétitivité attendent des réponses précises et concrètes.

La parole est à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Madame la députée, le territoire que vous évoquez, l’arrondissement de Bonneville, est exemplaire à bien des égards et la vallée de l’Arve est un fleuron industriel.
Selon vous, les entreprises auraient préféré des baisses de cotisation. Cependant, comme vous le savez, les effets cumulés de la baisse de cotisation sur les bas salaires, du pacte de responsabilité, du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE – et de l’aide Embauche PME reviennent à rembourser l’intégralité des cotisations patronales pour un recrutement au SMIC.
Vous dites que les entreprises ne sont pas favorables à l’aide Embauche PME. Or, celle-ci a, au contraire, reçu un écho favorable chez les chefs d’entreprise qui, en un peu plus de deux semaines, ont formulé un peu plus de 16 000 demandes.
Bien sûr, comme vous le dites vous-même, certaines villes présentent un taux de chômage plus important que d’autres, le nombre de demandeurs d’emploi, notamment de longue durée, est croissant, même s’il reste inférieur à la moyenne nationale, et la population présente également un niveau de qualification relativement faible par rapport à l’ensemble du département. Ce sont cependant toujours ces mêmes demandeurs d’emploi qui restent éloignés de l’emploi.
C’est la raison pour laquelle nous mobilisons tous les outils de l’emploi. Les contrats aidés, que vous citez, sont destinés aux personnes en situation de handicap, aux seniors ou aux jeunes habitant certains quartiers relevant de la politique de la ville, à qui, sans ces contrats, nous ne permettrons pas d’avoir accès à une première expérience professionnelle. Il en va de même pour la garantie jeune. J’ai du reste demandé à l’ensemble des missions locales de réorienter de nombreux jeunes en direction des centres de formation d’apprentis – CFA –, car il manque bien souvent un tel tuilage entre les dispositifs. La mission locale doit donc être aussi un outil nous permettant de développer l’apprentissage.
Les départs vers la Suisse, que vous évoquez, ne doivent pas nous empêcher de faire le pari du développement des compétences pour les jeunes les moins qualifiés et nous devons donc être capables, dans le cadre de la semaine de l’industrie, mais aussi de la campagne d’orientation scolaire qui se tiendra au printemps, d’informer systématiquement sur les taux d’insertion des différentes formes de formation. Il s’agira également d’une mesure qui figurera dans la loi que je présenterai d’ici quelques semaines.
Toutes ces raisons nous ont conduits à élaborer le plan 500 000 formations prioritaires. Prévoir, dans ce cadre de ce dernier, que 50 000 personnes soient en contrat de professionnalisation – il ne s’agit pas d’un contrat aidé –, c’est répondre à de vrais besoins des entreprises en formant ces personnes au sein de l’entreprise, entre formation et qualification. Il s’agit également de développer les préparations opérationnelles à l’emploi, en lien avec les entreprises. Je ne vois là aucune contradiction avec les demandes que vous venez de formuler.
Il s’agit, en effet, d’investir dans leur parcours et de nous efforcer de proposer des formations qualifiantes. Il s’agit aussi, bien sûr, de partir d’un diagnostic des besoins des entreprises. C’est ce que j’ai fait dans le cadre des demandes que j’ai adressées à l’ensemble des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – DIRECCTE. Tous ces besoins des entreprises, décrits par les directions régionales de Pôle emploi, sont remontés et nous travaillons sur la liste des métiers non pourvus, afin d’améliorer la notion de parcours entre la formation et l’insertion.

Madame la ministre, j’ai également cité la vallée de l’Arve, le pays du Mont-Blanc et la vallée du Giffre, soit un périmètre plus large que le territoire que vous venez d’évoquer.
Au-delà de cette remarque géographique, mes autres observations sont d’ordre technique et portent sur les mesures que vous avez prévues pour l’emploi. Selon vous, en effet, la prime pour l’emploi bénéficiera aux salariés payés au SMIC. Or, dans ces vallées où la technicité est forte et la main-d’oeuvre est réputée et de grande qualité, possédant un savoir-faire exceptionnel, les salariés ne pourront malheureusement pas bénéficier de cette prime.
Par ailleurs, les contrats que vous évoquez sont tout de même des contrats aidés. Je vous renvoie à cet égard au rapport de la Cour des comptes, qui a souligné le peu d’intérêt de ces contrats, simple sparadrap sur la plaie béante du chômage.

La parole est à M. Gilles Lurton, pour exposer sa question, no 1297, relative aux militaires ayant servi en Afrique du Nord entre juillet 1962 et juillet 1964.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, l’article 87 de la loi de finances pour 2015 a accordé, à partir du 1er octobre, la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures. Je souhaite vous interroger sur la situation des militaires français ou supplétifs qui ont servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le mois de juillet 1964 et j’associe à cette question mon collègue Gérard Cherpion.
Ces militaires ont défendu, hors du territoire français, les intérêts de la France et ont effectué des missions de sécurité dans un pays devenu indépendant. Ces opérations ont été menées d’un commun accord, après le cessez-le-feu, selon les dispositions déterminées par les accords d’Évian. Ils sont donc restés en territoire étranger dans un contexte dangereux pour eux. Durant cette période, 535 militaires français ont été tués ou ont disparu et une mention « mort pour la France » a été récemment attribuée à un militaire décédé le 5 juillet 1962.
Il apparaît dès lors évident qu’après l’indépendance de l’Algérie, ces forces françaises doivent être considérées comme étant en opérations extérieures – OPEX –, déployées sur un territoire étranger, conformément aux accords conclus entre les deux pays, pour assumer une mission de sécurité, avec un désengagement progressif.
Pourquoi donc l’article 87 de la loi de finances ne peut-il être appliqué à ces militaires français ou supplétifs présents en Algérie pendant quatre mois et plus à partir du 2 juillet 1962 et jusqu’en 1964 ? Le Gouvernement a-t-il l’intention de prendre des mesures visant à considérer ces militaires comme relevant des OPEX et, en conséquence, de leur appliquer les règles actuelles régissant l’attribution de la carte du combattant ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Monsieur le député, vous m’interrogez sur la possibilité de considérer comme relevant des OPEX les militaires ayant servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et juillet 1964.
Permettez-moi tout d’abord de rappeler que la fin de la guerre d’Algérie est communément fixée au 2 juillet 1962. Cette date est également retenue depuis 1974 comme limite chronologique pour l’attribution de la carte du combattant au titre des opérations dites de « maintien de l’ordre » en Afrique du Nord. Comme vous le savez, il a fallu attendre 1999 et le gouvernement de Lionel Jospin pour qualifier de « guerre » ce que l’on nommait jusqu’alors pudiquement les « événements d’Algérie ».
Depuis lors, de nombreux droits ont été engagés afin de reconnaître le sacrifice de nos soldats. Je pense notamment à la mise en oeuvre par mon prédécesseur, Kader Arif, de la carte dite « à cheval », qui permet de bénéficier de la carte du combattant dès lors que l’on a cumulé quatre mois de présence sur le théâtre d’opérations en Algérie, dont au moins un jour avant le 2 juillet 1962. Dix mille personnes furent concernées par cette mesure adoptée en loi de finance initiale pour 2014.
Pour revenir plus précisément sur votre interrogation, si les premières semaines de l’indépendance algérienne ont été marquées par une insécurité réelle sur le terrain, le facteur d’insécurité n’a jamais été retenu comme justifiant l’ouverture du droit à la carte du combattant.
Au-delà du coût très élevé d’une telle mesure, il n’est tout simplement pas envisageable, symboliquement, de considérer que la guerre d’Algérie se soit poursuivie au-delà de cette date charnière du 2 juillet 1962, ni qu’une opération extérieure lui ait succédé.
J’ajouterai pour mémoire que les personnes ayant séjourné en Algérie à partir du 2 juillet 1962 et jusqu’au 1erjuillet 1964 peuvent en revanche bénéficier du titre de reconnaissance de la nation, le TRN, sur le critère d’une présence de trois mois au moins.
Soyez en tout cas assuré, monsieur le député, que le Gouvernement est mobilisé pour garantir les droits et la reconnaissance des militaires d’hier, d’aujourd’hui et de demain. C’est le cas sur ce sujet, à propos duquel je sais que vous êtes interpellé, comme je le suis moi-même. Il n’est toutefois pas envisagé, pour l’heure, de modifier ce dispositif, car je ne vois pas comment cela pourrait être soutenable juridiquement.

Monsieur le secrétaire d’État, j’entends bien votre argumentation, notamment pour ce qui concerne la date du 2 juillet 1962, communément admise comme étant celle de la fin de la guerre d’Algérie.
Cependant, toutes les personnes restées en Algérie jusqu’au qu’au mois de juillet 1964 sont des soldats en opérations extérieures, qui ont été privés durant toute cette période d’une vie normale, privés parfois de leur famille et des libertés essentielles dont nous pouvons jouir tous les jours, et qui se sont trouvés sur des terrains d’opération d’une très grande insécurité, parfois même au péril de leur vie – j’ai en effet rappelé que 535 d’entre eux sont décédés.
Le Gouvernement s’honorerait donc en élargissant la possibilité d’attribuer la carte du combattant à ceux qui sont restés au moins quatre mois.

La parole est à Mme Geneviève Gosselin-Fleury, pour exposer sa question, no 1311, relative aux effectifs de la base de défense de Cherbourg.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, ma question concerne les effectifs de la base de défense de Cherbourg.
Cherbourg est le siège de la préfecture maritime et il lui revient d’assurer l’organisation de l’action de l’État en mer, ainsi que la sécurité des ports. Il s’agit en outre d’un port nucléaire, où aura lieu prochainement la mise à l’eau du premier sous-marin Barracuda. La base de défense assure également la sécurité de toute la zone littorale qui s’étend de la baie du Mont Saint-Michel à la frontière belge.
Compte tenu de ces missions importantes, il convient, en cette période marquée par de fortes menaces, de ne pas fragiliser les effectifs de la base de défense en charge de la sécurité, mais également de maintenir le personnel chargé du soutien, indispensable au bon fonctionnement de la base. Or, après une suppression de 80 postes civils et militaires en 2015, de nouvelles déflations ont été annoncées pour l’année 2016 : au minimum, 68 postes pourraient disparaître – 38 pour le personnel civil et 30 pour le personnel militaire. La suppression de ces postes restreindrait considérablement le périmètre d’action de la base de défense.
Je vous demande, donc, monsieur le secrétaire d’État, s’il est possible d’assurer la stabilité, voire un renforcement, des effectifs de la base de défense de Cherbourg, en raison du rôle important qu’elle joue pour la sécurité du littoral et de la Manche.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Madame la députée, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser mon collègue Jean-Yves Le Drian, retenu par ailleurs.
La base de défense de Cherbourg abrite la préfecture maritime pour la Manche et la mer du Nord, l’école des fourriers de Querqueville et le groupement de soutien relevant du service du commissariat des armées. Ce port, dont la vocation nucléaire sera bientôt réaffirmée avec la construction de nos prochains sous-marins d’attaque de type « Barracuda », est aussi un élément clé de notre dispositif pour l’action de l’État en mer dans une zone stratégique pour l’Europe.
Vous faites part au ministre de la défense de vos préoccupations relatives aux effectifs de cette base de défense. S’agissant des fonctions opérationnelles, l’année 2016 sera conforme à la décision ministérielle du 31 juillet 2015.
Pour la période 2017-2019, le Président de la République a annoncé au Congrès la fin des diminutions d’effectifs de la défense. Le ministère poursuivra donc sa transformation, avec plusieurs chantiers de rationalisation, mais il redéploiera dans le même temps plus de personnels vers les grandes priorités rappelées par le chef de l’État : les unités opérationnelles et leurs soutiens, le renseignement et la cyberdéfense, en intégrant la base de défense de Cherbourg dans l’ensemble de ces travaux.
Pour 2016, le ministre de la défense tient à rappeler la création à Cherbourg d’une école des mousses, après celle de Brest ouverte en 2009. Outre son encadrement, cette école formera annuellement quarante élèves qui auront vocation à exercer ensuite les compétences acquises au sein des unités navigantes de la marine nationale.
Concernant le groupement de soutien de la base de défense et eu égard à l’importance des opérations maritimes dans cette zone, les réorganisations du site de Cherbourg font l’objet d’une attention particulière de la part du ministère. À ce jour, il dispose des moyens humains en adéquation avec les objectifs qui lui sont assignés et pourra absorber les charges supplémentaires liées au renforcement éventuel des missions de ce site.
L’école des fourriers fait partie du paysage cotentinois depuis plus d’un siècle. Elle est depuis 2015 sous la responsabilité du service du commissariat des armées qui a relayé la marine nationale. Avec ses 186 permanents, elle continue de former les militaires des trois armées à l’ensemble des métiers d’une douzaine de familles professionnelles. C’est un pôle d’excellence reconnu, même en dehors du ministère de la défense.
Cette école tient une place très importante dans l’organisation et la démarche de transformation du service du commissariat des armées, puisqu’elle forme environ 4 000 stagiaires chaque année ; elle gardera cette place.
Enfin, l’activité de construction navale ne faiblira pas à Cherbourg compte tenu de la commande des « Barracuda » et du démantèlement futur des sous-marins de la génération précédente de la classe « Rubis ». La construction des « Barracuda » entraînera la présence continue d’au moins un équipage d’une centaine de personnes jusqu’en 2030.
Vous le voyez, madame la députée, les spécificités et l’importance des missions de la base de défense de Cherbourg sont bien connues du ministère et seront prises en compte dans les travaux à venir en matière d’effectifs.

La création de l’école des mousses est une bonne nouvelle. Toutefois, si l’existence d’écoles sur la base de défense de Cherbourg est une bonne chose, cela ne renforcera pas les effectifs qui doivent assurer la sécurité du littoral et ne répondra pas au besoin que nous avons d’un renfort de fusiliers-marins sur la base de Cherbourg pour assurer la sécurité du littoral et des ports.

La parole est à Mme Marianne Dubois, pour exposer sa question, no 1308, relative au financement des associations en milieu rural.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, ma question s’adresse à M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et porte sur les difficultés que rencontrent les associations dont le rôle auprès des habitants est essentiel, notamment en milieu rural.
Alors que l’engagement associatif a été déclaré « Grande cause nationale » en 2014, les problèmes et les obstacles continuent de s’accumuler et de peser sur le tissu associatif, affaiblissant significativement l’efficacité des actions sur le terrain.
Si la baisse du financement public semble inéluctable, d’autres difficultés se présentent à elles, comme les réglementations, qui émoussent les vocations. Ainsi, la législation interdit aux associations de réaliser plus de cinq buvettes dans l’année, dix pour les associations omnisports, étant précisé qu’elles sont libres de répartir les autorisations au sein des sections.
Or, ce nombre paraît quelque peu arbitraire : qu’en est-il, par exemple, si l’association regroupe onze sections ? Qu’en est-il pour une association qui regroupe plusieurs sections non exclusivement sportives ? C’est précisément le cas dans ma circonscription. Ces questions sont d’autant plus prégnantes en zone rurale que la mutualisation est de mise dans le milieu associatif ; nous constatons ainsi le regroupement de nombre d’associations.
Il n’est pas question de concurrence puisque nous déplorons la disparition de nos bars, cafés et restaurants, incapables de faire face aux réglementations en tout genre. Ainsi selon une enquête récente, fin 2014, la France ne comptait plus que 34 669 établissements. Alors qu’étaient recensés au début du siècle près de 500 000 bistrots, leur nombre a chuté à 200 000 dans les années 1960, selon les chiffres de l’INSEE.
Faut-il continuer dans cette voie législative et réglementaire, au risque de précipiter la désertification rurale et le bénévolat, qui se fait rare dans nos associations ? Nos maires, ruraux en particulier, ne sont-ils pas les mieux à même de juger de toutes ces questions ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Madame la députée, le 11 janvier dernier, lors de ses voeux à la jeunesse et aux forces de l’engagement, le Président de la République a, une nouvelle fois, réaffirmé le rôle essentiel des associations dans la cohésion de notre société. À ses côtés, le Gouvernement a comme ambition de favoriser le développement de la vie associative et de l’engagement citoyen, qui représente 1,3 million d’associations et, avec elles, des millions de Français.
Dans la continuité de la Grande cause nationale 2014 dédiée à l’engagement associatif, qui a permis la signature de la Charte des engagements réciproques rappelant l’importance du partenariat pluriannuel et de la coconstruction des politiques publiques avec les associations, le Premier ministre a annoncé un New deal avec le mouvement associatif lors du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté du 6 mars dernier.
Ce New deal repose sur quatre actions principales : un choc de simplification pour alléger le quotidien des associations ; de nouveaux crédits permettant au secteur associatif de mettre en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale dans les quartiers prioritaires ; la rénovation des relations entre les pouvoirs publics et les acteurs associatifs ; des mesures destinées à favoriser l’engagement bénévole, notamment celui des actifs.
Ce choc de simplification permet ainsi de résoudre les problèmes que vous avez dénoncés, notamment en milieu rural. Lancé avec l’ordonnance du 23 juillet 2015, il met en place un formulaire unique de demande de subvention, qui simplifiera la présentation des demandes auprès des financeurs publics, État ou collectivités territoriales.
La modernisation de l’appel public à la générosité, la suppression du registre spécial ou encore le rapprochement en un lieu unique des missions assurées par différents services déconcentrés de l’État sont tout aussi importants. De nouveaux téléservices facilitant les démarches en ligne, appliquant le principe « Dites-le nous une fois », seront également mis en production dès cette année.
En 2016, enfin, nous continuerons à oeuvrer pour faire de l’engagement une priorité de ce quinquennat, avec le projet de loi à l’égalité et à la citoyenneté que défendra devant vous le ministre Patrick Kanner.
Renforcer la cohésion sociale et la promotion des valeurs républicaines, c’est bien sûr notre priorité : elle passe et elle passera évidemment par le soutien au monde associatif.

J’ai bien entendu votre réponse et je me félicite de toutes ces simplifications que vous annoncez. Toutefois, je parle de moyens financiers : c’est vraiment là que le bât blesse pour toutes nos associations, spécialement en milieu rural.

La parole est à Mme Marianne Dubois, pour exposer la question no 1302 de M. Jean-Pierre Barbier, relative à la délégation des compétences entre les départements et les métropoles.

Monsieur le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, mon collègue député de l’Isère, Jean-Pierre Barbier, étant empêché exceptionnellement en Isère ce matin – il vous prie de bien vouloir l’excuser –, il m’a demandé de m’exprimer en son nom.
Je veux appeler votre attention sur l’interprétation du paragraphe IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l’article 90 de la loi NOTRe du 7 août 2015. Cet article est relatif aux modalités de transfert ou de délégation de compétences à conclure entre les départements et les métropoles.
Il dispose que « par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences. » Ces derniers sont ensuite listés et numérotés de 1 à 9.
Il est indiqué ensuite que « la convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation (…) »
À la différence de ce que prévoit le 2° du paragraphe II du même article L. 5217-2, pour certaines compétences que l’État peut déléguer à la métropole « sans dissociation possible », le paragraphe IV, en utilisant pour les compétences transférées ou déléguées par le département à la métropole l’expression « tout ou partie des groupes de compétences », semble ouvrir aux deux partenaires la possibilité de ne transférer ou de ne déléguer qu’une partie des compétences de chaque groupe. En d’autres termes, le groupe de compétences serait dissociable ou sécable, par exemple le PDI – programme départemental d’insertion – ou la voirie.
En ajoutant que la convention entre le département et la métropole doit préciser « les compétences ou groupes de compétences », cet article semble bien autoriser les deux partenaires à ne prévoir le transfert ou la délégation de compétences que sur une partie seulement du groupe de compétences.
Cette interprétation est la seule conforme aux travaux parlementaires ; c’est aussi la logique de la démarche conventionnelle. Le texte ouvrirait ainsi aux deux partenaires la possibilité de négocier le périmètre de chacun des groupes de compétences transférables, y compris la voirie et le PDI, selon un intérêt conjoint d’efficacité de l’action publique et de bon usage des fonds publics, au plus près des besoins de la population.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer que l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales permet bien une telle approche, offrant aux métropoles et aux départements la possibilité de s’entendre en bonne intelligence territoriale sur le conventionnement le plus fin, efficace et efficient possible.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire.
M. le député Barbier appelle l’attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, que je vous prie de bien vouloir excuser, sur les modalités d’application du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l’article 90 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Cet article instaure un mécanisme fortement incitatif de délégation ou de transfert de groupes de compétences, notamment dans le domaine social, entre le département et la métropole, par voie conventionnelle.
Je vous confirme qu’il est prévu que si, à la date du 1er janvier 2017, aucune délégation ou transfert de compétences n’est opéré sur au moins trois des huit premiers groupes énumérés à cet article, la totalité des compétences listées est transférée d’office à la métropole, à l’exception du groupe relatif à la construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges.
Le Gouvernement a eu l’occasion de rappeler tout l’intérêt de ce dispositif. Les territoires les plus urbanisés, par leur densité et par l’organisation spatiale de la ville, concentrent les enjeux de cohésion sociale au sens large, incluant le logement et les transports.
La coordination des politiques menées dans ce domaine par le bloc communal et le département est apparue comme une nécessité. La création de nouvelles métropoles résultant de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles s’est naturellement accompagnée d’une possibilité de transfert et de délégation d’un certain nombre de compétences départementales à la métropole.
L’objet de l’article 90 de la loi NOTRe est de poursuivre et de renforcer cette dynamique d’intégration et de simplification nécessaire à la construction d’un véritable projet d’aménagement et de développement économique mais aussi territorial, écologique, éducatif, culturel et social. Autrement dit, il appartient au département et à la métropole de définir ensemble, parmi les compétences figurant à cet article, celles qui pourront être exercées par la métropole sur son propre périmètre.
Seules les compétences listées dans le groupe 6 – personnes âgées et action sociale, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale – et dans le groupe 7 – tourisme en application du chapitre II du titre III du livre I du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport – du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent faire l’objet d’un transfert partiel.
Il est en effet expressément précisé que le transfert ou la délégation peut ne concerner qu’une partie de ces compétences. Elle ne s’applique pas aux autres compétences listées du premier au neuvième groupes.
Ce dispositif a vocation à assurer la montée en puissance des métropoles, tout en permettant aux acteurs locaux de s’entendre. Telle est la volonté du législateur, à laquelle le Gouvernement est attaché.

La parole est à Mme Martine Martinel, pour exposer sa question, no 1315, relative à la révision des bases cadastrales.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, le calcul de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères repose sur la valeur locative cadastrale qui a été établie en 1970 pour le bâti. Le constat d’une nécessaire réforme de la fiscalité directe locale est aujourd’hui unanimement partagé.
Un calcul de l’administration fiscale fondé sur de nombreux indices macroéconomiques permet d’appliquer chaque année un taux de révision mais l’évaluation se fait toujours à partir de ces références anciennes.
La situation géographique, les standards de confort ou les équipements des habitations pris en compte dans le calcul de cette valeur locative cadastrale ont depuis considérablement évolué. Cette valeur, fruit d’un travail d’enquête réalisé par l’État en 1970, correspond donc à un loyer qui n’a rien à voir avec les loyers du marché d’aujourd’hui. Cela engendre des situations d’inégalité.
À Toulouse, les habitants du quartier du Mirail, que vous connaissez bien, madame, sont directement concernés.
Classé en septembre 2012 zone de sécurité prioritaire par le ministère de l’intérieur, le Mirail – « miroir » en occitan – d’aujourd’hui est à mille lieues du rêve de Georges Candilis, l’architecte urbaniste grec, élève de Le Corbusier, qui en 1962 avait séduit avec son projet de ville-annexe – on ne disait pas encore ville nouvelle. L’idée générale était de faciliter le contact et les rencontres entre habitants, faisant de ce quartier un objet révolutionnaire que des urbanistes du monde entier venaient visiter. Equipement moderne des logements, multitude de commerces, présence des services publics, le projet de vie pour les habitants se voulait presque idéal.
Aujourd’hui, même si de nombreuses associations se battent au quotidien pour le vivre ensemble, ce quartier, très loin de son image d’antan, est marqué par un fort taux de chômage chez les jeunes, une extrême précarité et des trafics en tout genre.
Il apparaît donc indispensable de procéder à une réactualisation complète des bases d’imposition car le système actuel engendre un niveau de fiscalité qui ne correspond plus à la réalité immobilière et sociologique de ces quartiers.
S’agissant des locaux d’habitation, le Gouvernement s’était engagé, en juillet 2013, dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales, à consulter les associations d’élus de manière à permettre l’inscription dans la loi de finances de la fin de l’année des principes et des modalités pratiques de mise en oeuvre de la révision de leur valeur locative. Comme pour les locaux professionnels, une expérimentation devait ensuite être organisée et un rapport présenté au Parlement.
Pourriez-vous m’indiquer, madame la secrétaire d’État, à quel stade se trouve cette expérimentation et dans quels délais ces taux pourront être révisés ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Madame la députée, je vous prie d’excuser l’absence de Michel Sapin, qui m’a demandé de vous répondre.
L’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2013 a effectivement prévu la mise en oeuvre d’une simulation de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile. Cette simulation a été mise en oeuvre en 2015 dans cinq départements représentatifs de la diversité des territoires français : la Charente-Maritime, le Nord, l’Orne, Paris et le Val-de-Marne. Elle a essentiellement consisté à collecter des informations sur la consistance des locaux d’habitation loués et sur le loyer annuel de ces derniers.
Le même article 74 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur cette simulation, qui doit également retracer les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale – EPCI – ainsi que pour l’État.
Des travaux de simulation de grande ampleur ont par ailleurs été conduits au second semestre 2015 sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et ont permis d’éclairer l’examen parlementaire de la loi de finances rectificative pour 2015. La lourdeur de ces travaux n’a pas permis d’exploiter dans le même temps les données collectées dans le cadre de l’expérimentation sur les locaux d’habitation.
Une première partie du rapport a toutefois été remise aux commissions des finances du Parlement début février 2016 : elle s’attache à décrire la campagne déclarative qui s’est déroulée au premier semestre 2015.
La deuxième partie du rapport sera consacrée à l’analyse des informations collectées et aux conséquences d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation. Des travaux complexes de simulation sont actuellement menés par la direction générale des finances publiques, la DGFiP, et cette deuxième partie devrait être disponible au cours du second trimestre 2016. Le calendrier de généralisation dépendra des résultats de cette simulation.
En parallèle, les travaux se poursuivent en matière de révision des valeurs locatives des locaux professionnels, dont la mise en oeuvre est prévue pour 2017.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, pour la précision extrême de votre réponse.
Je regrette, à titre personnel, que la Haute-Garonne ne figure pas au nombre des départements qui ont été choisis pour cette expérimentation. Cela étant dit, votre réponse est encourageante et prometteuse. Les habitants attendent avec impatience cette révision tant est grande l’injustice que constitue la valeur locative retenue pour leurs logements en comparaison d’autres quartiers de la ville où la souffrance est moindre.

La parole est à M. Jacques Cresta, pour exposer sa question, no 1316, relative au développement des zones commerciales en milieu rural.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, dans mon département des Pyrénées-Orientales, qui connaît de fortes variations démographiques saisonnières, des centaines de milliers de mètres carrés de zones commerciales ont vu le jour ces dernières années, captant de plus en plus de consommateurs. Dans le même temps de nombreux commerces de centre-ville cessent leur activité par manque de clientèle.
En ma qualité de président du groupe d’étude sur les quartiers anciens dégradés, je souhaite attirer votre attention sur le lien fort qui existe entre la multiplication des zones commerciales en périphérie des petites villes et des villes moyennes et la fermeture des commerces de centre-ville, entraînant la paupérisation de coeurs de ville de moins en moins attractifs voire l’apparition de zones d’insécurité.
Ce phénomène engendre à terme des difficultés supplémentaires pour les collectivités dans l’entretien de leur patrimoine historique. Elles doivent faire face à la dégradation du parc de logements, ce qui engendre l’éloignement des classes moyennes et supérieures, qui préfèrent aller s’installer dans des quartiers mieux dotés en termes d’équipements et d’infrastructures.
Cette situation mérite un moratoire au plan national afin de mieux encadrer et informer les membres des commissions départementales et de la commission nationale d’aménagement commercial, les CDAC et la CNAC, chargées d’autoriser l’implantation de ces zones commerciales sur des territoires déjà surdotés.
Pour ces motifs, il pourrait être envisagé d’ouvrir plus largement les voies de recours devant la commission nationale d’aménagement commercial, notamment aux chambres consulaires ainsi qu’aux présidents des intercommunalités des départements ou des régions concernées.
Je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur ces propositions et les moyens qu’il peut mettre en oeuvre pour réguler la prolifération de ces zones commerciales. Elles impactent durablement les terres agricoles et l’emploi en raison de la disparition des commerces de proximité en centre-ville et ont des conséquences durables sur le patrimoine et le logement dans ces communes.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Monsieur Cresta, vous abordez un sujet qui me tient particulièrement à coeur. J’ai conscience comme vous des difficultés que rencontrent certaines petites villes et villes moyennes concernant leurs commerces de centre-ville.
Avant de rappeler ce que le Gouvernement fait à ce propos, je vais répondre plus précisément à vos interrogations concernant l’implantation de zones commerciales à l’entrée de nos communes.
À ce sujet, les choses sont très claires : nous ne mettrons pas en oeuvre un moratoire qui contreviendrait au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre.
Mais cela ne condamne pas à l’impuissance, bien au contraire : nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que les acteurs locaux puissent réguler eux-mêmes l’implantation harmonieuse d’espaces commerciaux.
Il est vrai que la directive Services de 2006 interdit aux présidents des chambres consulaires de siéger au sein des commissions départementales, les CDAC, car ils sont considérés comme des « opérateurs concurrents ».
Néanmoins, je dois rappeler que les présidents des intercommunalités peuvent y siéger et que, grâce à la loi « Artisanat, commerce et très petites entreprises » de 2014, nous avons ouvert son accès au président du conseil départemental, au président du conseil régional, à un représentant des maires au niveau départemental et à un représentant des intercommunalités au niveau départemental.
Ces acteurs ont la capacité de réguler de manière concertée l’implantation de zones commerciales à l’entrée des villes, d’autant plus que la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, lui-même défini par les intercommunalités.
Je rappelle par ailleurs que le droit de recours auprès de la commission nationale d’aménagement commercial est très large. Il concerne tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant.
Outre ces dispositifs de contrôle, nous avons également pris des mesures pour aider les acteurs locaux dans leurs actions de revitalisation des commerces de centre-ville. Nous avons introduit créé les contrats de revitalisation commerciale, qui permettent aux communes et intercommunalités d’exercer un droit de préemption renforcé pour réimplanter des commerces dans leurs centres-villes.
Nous avons également lancé un appel à manifestation d’intérêts « centres bourgs » en 2014, qui a permis de redynamiser 54 communes grâce à des crédits d’ingénierie spécifiques.
Enfin j’ai engagé, le 5 février dernier, avec le ministère du logement et de l’habitat durable, une mission conjointe pour revitaliser les commerces en centre-ville.
Vous le voyez, le Gouvernement est pleinement mobilisé, dans le respect du droit européen et de la liberté d’entreprendre, pour permettre aux acteurs locaux de prendre les choses en main et de faire revivre les centres-villes en difficulté.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, mais pourrions-nous disposer d’outils plus prégnants pour éviter que les centres-villes anciens, ou moins anciens, ne se dévitalisent avant de songer à les revitaliser ? Il est quand même paradoxal qu’une commune sollicite le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, le FISAC, pour revitaliser un centre-ville qu’elle a elle-même contribué à désertifier.

La parole est à M. Philippe Folliot, pour exposer sa question, no 1323, relative aux zones blanches dans le Tarn.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, je voudrais attirer l’attention du Gouvernement sur le sujet des zones blanches, qui doivent être urgemment équipées en téléphonie mobile et en internet.
En effet, de nombreux foyers ruraux peinent à obtenir une couverture numérique raisonnable. La part de la population située dans une zone dépourvue de réseau téléphonique et de connexion internet est estimée à 20 %, et plus de trois quarts des Français seraient encore privés de très haut débit. Or une bonne couverture numérique contribue à créer et à consolider le lien social, lien qui ne cesse de se déliter dans les régions les plus isolées de notre pays. En outre, les investissements dans ce domaine sont nécessaires pour favoriser le développement économique. À l’heure du « tout numérique », les entreprises ne peuvent pas se permettre de s’installer dans des territoires où le réseau est de mauvaise qualité, voire inexistant et les populations sont gênées dans leur vie quotidienne.
Face à ce problème, vous avez, avec le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, lancé le plan « France Très Haut Débit ». Dans un courrier en date du 26 novembre 2015, vous nous avez ainsi annoncé qu’à la suite d’une campagne de mesures réalisée dans 620 centres-bourgs, 171 ont été identifiés comme n’étant pas couverts. Mais au vu de la liste des bénéficiaires, je constate que, pour le département du Tarn, seule la commune d’Algans figure dans le plan d’amélioration de la couverture mobile du territoire mis en place par le Gouvernement.
Par conséquent, trop de villages ruraux se voient encore privés de connexions internet et du réseau de téléphonie mobile tout en assistant de bien loin au développement dans les métropoles de technologies toujours plus rapides et performantes. Dans le Tarn, c’est notamment dans les zones de montagne et dans l’est du département que la situation est inquiétante. Nombre de communes de ce territoire disposent de moins deux mégabits de débit, soit le Moyen Âge de l’internet ! Ces inégalités entre territoires ont trop duré et participent à la fuite de nos entreprises et de nos services hors de nos villages et de nos campagnes, favorisant ainsi la désertification rurale.
Je souhaite savoir ce que les pouvoirs publics comptent faire afin de résoudre ce problème majeur pour nos concitoyens.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Monsieur le député, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de Mme la secrétaire d’État chargée du numérique, qui m’a chargée de vous transmettre sa réponse.
La couverture numérique en réseaux à très haut débit fixes et mobiles est une priorité pour faire de l’égalité des territoires une réalité. Comme vous le savez, le Gouvernement s’est engagé à améliorer l’accès au très haut débit et aux services mobiles de communications électroniques.
Notre priorité, c’est de répondre à l’urgence en visant en premier lieu les communes qui n’ont aucun accès au mobile. Nous avons lancé deux campagnes de vérification de terrain pour établir une liste de communes à couvrir. Elles ont permis d’établir une liste de 268 communes qui pourront bénéficier, de la part de l’ensemble des opérateurs de réseaux mobiles, d’une couverture en internet mobile d’ici la fin 2016, ou six mois après la mise à disposition d’un pylône. D’ici la mi-2017, les quatre opérateurs auront l’obligation d’équiper en haut débit mobile 2 200 communes qui n’y ont pas accès. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – l’ARCEP – pourra sanctionner tout manquement. Enfin, une mesure complémentaire a été prévue pour identifier 800 sites d’intérêt particulier, qu’il soit économique, touristique ou lié à un service public, qui pourront être couverts au cours des quatre prochaines années.
S’agissant plus particulièrement du département du Tarn, 15 communes ont été signalées et vérifiées. Deux de ces communes, non couvertes, devront être équipées conjointement par les quatre opérateurs : Algans et Vieux. Par ailleurs, sur les 32 communes du Tarn qui n’ont pas accès à l’internet mobile, 14 restent à équiper et bénéficieront d’une couverture 3G d’ici la mi-2017.
La relance du programme de résorption des zones blanches mis en place par le Gouvernement vise ainsi à répondre à l’urgence. Si ce programme n’épuise pas la question de la couverture du territoire en services mobiles, il permet, à court terme, d’améliorer la situation dans près de 3 300 communes rurales.
S’agissant du très haut débit fixe, les échanges se poursuivent entre les services de l’État et le conseil départemental du Tarn, dans le cadre de l’instruction du dossier. L’élaboration de projets d’infrastructures aussi ambitieux est complexe et nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Nos services sont pleinement mobilisés à cette fin, mobilisation qui, je le sais, fait écho à celle du conseil départemental du Tarn.
Sur l’ensemble du territoire, 13,9 millions de locaux sont éligibles au très haut débit et tous le seront d’ici 2022. C’est l’engagement du Président de la République.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État. Cependant, il y a toujours un décalage entre de telles annonces et les réalités du terrain. Par exemple, dans la commune de Saint-Pierre-de-Trivisy dont je suis élu, un jeune médecin est venu s’installer, mais l’absence de haut débit a compliqué son installation en l’empêchant de communiquer avec les autres médecins – et je ne parle pas de la télémédecine, qui est hors de portée.
De même, on constate l’inadéquation entre la stratégie de l’État et la réalité, quand on demande aux agriculteurs de remplir par télédéclaration les formulaires de la PAC alors qu’ils n’ont pas accès au haut débit dans leurs exploitations. La différence de traitement est trop grande entre le monde rural et le monde urbain : il est urgent d’y remédier.

La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour exposer sa question, no 1293, relative à l’avenir des buralistes.

Madame la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, ce gouvernement est pleinement engagé dans la lutte contre le tabagisme, et je m’en félicite. La mesure emblématique de cette politique est bien sûr l’instauration du paquet neutre que nous avons soutenue lors du vote de la loi de modernisation de notre système de santé.
Selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les ventes de tabac en France ont baissé de 20 % ces cinq dernières années. On est ainsi passé de 55 milliards de cigarettes vendues en France en 2010, à environ 45 milliards en 2014.
Ces chiffres sont encourageants en matière de santé publique. Mais le corollaire de cette action est bien sûr la conséquence économique pour les buralistes. Ces derniers ont d’ailleurs fait entendre à plusieurs reprises leurs inquiétudes légitimes au regard des difficultés qu’ils rencontrent.
Je tiens à redire ici que lutter contre le tabagisme ne signifie pas lutter contre les buralistes.
Ces commerçants de proximité rencontrent de plus en plus de difficultés financières, malgré une densité d’activité qui les oblige bien souvent à ne pas compter leurs heures.
De plus, le commerce illicite, les achats transfrontaliers ne font que compliquer la situation pour ces commerces de proximité.
Pourtant, le bureau de tabac demeure bien souvent le dernier lieu de socialisation dans nos petites communes. Peu de réseaux commerçants peuvent aujourd’hui revendiquer une couverture aussi dense de notre territoire national. Ils sont une véritable chance à l’heure où même les services publics ont déjà déserté certains de ces territoires.
C’est donc de l’intérêt de ces professionnels, mais aussi de l’intérêt des Français qui se sentent de plus en plus isolés dans nos villages, qu’il est question.
Notre collègue Frédéric Barbier a mené un travail remarquable sur ce sujet à travers un rapport déposé en octobre dernier. Je souhaite savoir, madame la secrétaire d’État, quelles suites le Gouvernement entend donner à ce rapport. Quelles mesures l’État compte-t-il mettre en oeuvre pour permettre notamment une diversification de l’activité des buralistes et ainsi ouvrir un nouvel horizon à cette filière ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
Madame la députée, je vous prie d’excuser M. Christian Eckert, qui ne pouvait être présent ce matin et m’a chargée de vous répondre.
L’État est particulièrement attentif à la situation des buralistes. Les contrats d’avenir successifs signés depuis 2003 avec la Confédération nationale des buralistes de France ont pleinement joué leur rôle de soutien à l’activité des débitants de tabac.
Le contrat d’avenir en cours prévoit ainsi une augmentation annuelle de la rémunération nette liée à la vente de tabac sur la période 2012-2016. Cette rémunération est portée de 6,5 % à 6,9 % du chiffre d’affaires sur la durée du contrat, au travers d’une trajectoire de réévaluations régulières comprenant notamment une dernière étape en 2016, qui a été mise en oeuvre très récemment. Ce contrat comprend également diverses aides de l’État qui ont représenté, en 2014, un montant total de près de 50 millions d’euros pour l’ensemble du réseau, en particulier au bénéfice des débitants de tabac situés dans des départements en difficulté ou frontaliers.
Au titre de la diversification, on citera notamment la prime de service public de proximité – PSPP –, créée en 2012, une aide financière visant à inciter les buralistes à élargir la palette de leurs activités. Les détaillants qui proposent au moins quatre services ou produits, parmi lesquels les timbres fiscaux, la réception de colis ou la délivrance de titres de transport locaux, sont éligibles à une prime annuelle de 1 000 euros, montant porté à 1 500 euros dans les communes de moins de 1 500 habitants. En 2015, cette prime a été versée à 4 844 buralistes, pour un montant total de 6,7 millions d’euros.
En outre, une étude de faisabilité est en cours de réalisation sur la possibilité d’attribuer le label « Maison de service au public » aux débitants de tabac, et ainsi de renforcer la complémentarité entre les réseaux de la Poste et celui des buralistes, particulièrement en zone rurale.
Enfin, et c’est essentiel, les buralistes eux-mêmes ont su faire preuve de dynamisme et ont pris des initiatives énergiques pour diversifier leurs activités, en se positionnant sur de nouveaux produits tels que la cigarette électronique ou encore les services de paiement, métier nouveau pour lequel les détaillants peuvent apporter une offre alternative intéressante face aux prestataires habituels.
L’État entend bien sûr demeurer aux côtés des préposés de l’administration des douanes que sont les buralistes, réseau de proximité créateur de lien social et jouant dans les territoires un rôle d’animation essentiel, notamment en zone rurale. Le dialogue entre l’État et la Confédération nationale des buralistes de France a donc naturellement vocation à se poursuivre, pour appuyer la profession dans ses efforts de modernisation.

La parole est à M. Vincent Burroni, pour exposer sa question, no 1317, relative au centre de santé d’Airbus Helicopters à Marignane.

Madame la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, ma question porte sur le centre de santé d’Airbus Helicopters à Marignane qui est aujourd’hui en danger.
En effet, ce dispensaire, créé dans les années 1970 par le comité d’établissement et devenu un centre de santé particulièrement actif et performant, se voit aujourd’hui dans l’obligation de salarier les dix médecins spécialistes qui y exercent en libéral sous forme de vacations hebdomadaires.
Or cela n’est pas possible, ni d’un point de vue financier pour le comité d’établissement, ni pour les médecins libéraux vis-à-vis de la Caisse primaire d’assurance maladie.
De nombreuses démarches ont été réalisées auprès de l’Agence régionale de santé – l’ARS – et de la CPAM afin de régulariser la situation de ces praticiens libéraux et d’homologuer le numéro du centre sur leurs cartes de professionnels de santé, ce qui rendrait possible une télétransmission généralisée. Mais, à ce jour, seules les feuilles de papier sont tolérées par la CPAM.
Or le rapport de l’inspection générale des affaires sociales – l’IGAS – de juillet 2013 a révélé l’optimisation des centres de santé par le concours de praticiens libéraux à temps très partiel venant, de fait, corroborer la performance du parcours de soins au sein de ce centre de santé.
Laisser planer sur ce centre de santé la possibilité d’une cessation d’activité serait en totale contradiction avec l’action que nous menons en faveur de la prévention et du développement des parcours de soins.
Cette fermeture – que je n’ose imaginer – serait aussi en contradiction avec la lutte menée contre le chômage puisque dix personnes sont déjà salariées dans ce centre de santé : deux médecins généralistes, deux chirurgiens-dentistes, deux infirmières et quatre secrétaires médicales.
Cette structure de soins du comité d’établissement d’Airbus Helicopters, fleuron de l’aéronautique française et premier employeur de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, bénéficie à l’ensemble de ses salariés qui sont au nombre de 8 000, à leurs familles, à leurs ayants droits, aux retraités de l’entreprise et, s’ils le souhaitent, au personnel intérimaire et à celui des entreprises sous-traitantes. Cela représente plus de 10 000 actifs et plus de 15 000 consultations en 2014.
Je vous sollicite afin de vous demander d’intervenir auprès de l’ARS et de la CPAM sur cette situation bien particulière qui mérite, à mon sens, un traitement spécifique. Une solution doit être trouvée afin de pérenniser tous les services rendus par ce centre de santé exceptionnel.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Monsieur le député, je vous prie d’abord de bien vouloir excuser Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, qui m’a chargée de vous répondre.
Je veux vous donner des éléments précis. À l’heure actuelle, que se passe-t-il dans ce centre de santé d’Airbus Helicopters ? Des professionnels de santé libéraux y exercent, mais ce centre a la particularité d’être géré directement par le comité d’établissement.
Les responsables de l’entreprise ont demandé à la Caisse primaire d’assurance maladie que ces médecins spécialistes libéraux puissent facturer des actes en leur nom propre en télétransmission.
Or, un tel mode de fonctionnement est contraire à la législation actuelle sur les centres de santé, qui pose comme condition de base que les médecins soient des salariés du centre de santé. Ce principe a été d’ailleurs réaffirmé dans la loi modernisation de notre système de santé.
Une des solutions envisagées consisterait donc à ce que les médecins spécialistes consultants soient rémunérés par le centre sous forme de vacations – ainsi seraient-ils salariés –, ce que le comité d’entreprise n’est pas en mesure d’accepter, dans la mesure où il applique la convention collective des salariés de la métallurgie, convention qui ne prévoit pas aujourd’hui qu’un employé puisse être rémunéré en dessous d’un mi-temps.
Cette solution nécessiterait donc un assouplissement de la mise en oeuvre de la convention collective de la métallurgie, appliquée aux médecins dans ce contexte très particulier.
Par ailleurs, la reconnaissance de cette structure comme centre de santé pose un problème s’agissant d’autres critères réglementaires. En effet, le centre n’est pas ouvert à toutes les personnes qui souhaitent être reçues, mais uniquement aux salariés de l’entreprise et à leurs apparentés. C’est pourquoi l’Agence régionale de santé recommande que la structure change de portage juridique pour devenir une association ou un organisme mutualiste.
Mais là encore, ce n’est qu’à titre dérogatoire que le fonctionnement actuel pourrait être poursuivi, par analogie avec un centre de santé, sans régler le problème de facturation des actes des médecins libéraux, ni permettre à la structure d’adhérer à l’accord national des centres de santé.
Vous le voyez, monsieur le député, la situation que vous exposez ce matin est à la fois complexe et très particulière. Elle pose différents problèmes juridiques, mais soyez assuré que l’objectif de la ministre de la santé et de l’ARS est d’examiner avec les responsables de la structure comment maintenir cette offre de soins qui, comme vous l’avez dit, est très appréciée des salariés de l’entreprise Airbus Helicopters.

Madame la secrétaire d’État, je connaissais bien sûr les complications juridiques et techniques de ce dossier, sinon nous n’en serions pas à questionner au plus haut niveau, en interrogeant le Gouvernement.
Je pense que des portes viennent de s’ouvrir, ce qui n’était pas le cas dans les premières discussions entre les membres du comité d’établissement et l’ARS. Ce qui importe, c’est de trouver une solution pour ce centre de santé qui, j’en conviens, est atypique, mais qui est aussi performant et joue un rôle important dans ce territoire urbain comptant, avec Eurocopter, de nombreuses activités industrielles.
À une situation exceptionnelle, il faut trouver une solution exceptionnelle, qui reste bien sûr dans le cadre de la légalité.
J’espère qu’avec le soutien et l’appui de la ministre de la santé que vous venez d’exprimer, on se remettra autour de la table. Je suis prêt à continuer à mener les discussions avec les membres du comité d’établissement.

La parole est à M. Claude Sturni, pour exposer sa question, no 1299, relative au redécoupage des territoires de santé en Alsace.

Madame la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, ma question concerne l’organisation des groupements hospitaliers de territoire en Alsace et l’éventualité de la fusion des territoires de santé 1, en Alsace du Nord, et 2, autour de Strasbourg.
Le dimensionnement démographique actuel de ces territoires est en cohérence avec les effectifs de population des autres territoires de santé de notre nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. La population d’Alsace du Nord est satisfaite de l’offre de soins actuelle, qui repose sur un équilibre bien maîtrisé entre professionnels publics et privés. Les acteurs locaux ont consolidé, par le biais des SROS II et III, les activités de référence au sein du territoire pour aboutir à une offre médicalement équilibrée, cohérente et d’excellente qualité. Les hôpitaux en Alsace du Nord ont démontré la réalité de leur coopération, qui devrait naturellement se poursuivre au sein d’un GHT, dont je soutiens la création à cette échelle, à l’instar des deux territoires haut-rhinois autour de Colmar et de Mulhouse.
Les objectifs du législateur en termes de proximité, de pertinence dans les parcours de soins, de couverture démographique et de capacité à monter des coopérations efficaces, sont donc atteints en Alsace du Nord. On ne comprendrait pas quels autres objectifs conduiraient à une fusion éventuelle de ces territoires et à la création d’un GHT XXL.
Le Gouvernement a fait de l’efficacité et de la cohérence de l’offre de soins un enjeu majeur dans sa stratégie nationale de santé, et nous y souscrivons. Par conséquent, je propose de m’appuyer sur l’existence de ces deux territoires, autour de Haguenau et de Strasbourg, pour construire deux projets médicaux partagés et deux futurs GHT, favorisant la poursuite des projets structurants définis par le projet régional de santé en cours, qui est valable jusqu’à la fin de 2017.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Monsieur le député, vous m’interrogez au fond sur le périmètre des futurs groupements hospitaliers de territoire prévus par la loi de modernisation de notre système de santé, qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain dans votre région, l’Alsace.
Ces groupements ont comme objectif non pas seulement de constater les coopérations existantes, même si elles sont remarquables, mais également de donner aux hôpitaux une vision dynamique et prospective de l’offre de santé sur leur territoire. C’est le sens de la réforme portée par Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé.
Le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire doit renforcer l’organisation de prises en charge coordonnées des patients et valoriser les complémentarités entre établissements. La constitution des GHT sert donc à maintenir une égalité d’accès à des soins de qualité pour l’ensemble de la population. C’est dans cette perspective que doit être abordée la délimitation du ou des futurs groupements hospitaliers de territoire en Alsace.
D’ores et déjà, des actions de coopération lient de manière structurée les établissements des deux territoires de santé d’Alsace depuis de nombreuses années. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg collaborent déjà avec leurs partenaires hospitaliers de Saverne, de Wissembourg, d’Haguenau et au-delà, de Sarrebourg, par exemple.
Une question se pose légitimement. Ne faut-il pas renforcer ces coopérations, en facilitant les échanges entre les établissements, en garantissant la cohérence des filières de soins et en permettant au sein du groupement de soutenir les projets qui répondent aux besoins de la population ?
Il y a un autre enjeu extrêmement important, c’est la démographie médicale, et le GHT est là aussi pour apporter une réponse sur la formation, la meilleure répartition des compétences médicales en fonction des besoins du territoire, des postes d’assistants partagés ou encore la possibilité de constituer des équipes médicales territorialisées.
Telle est la démarche dans laquelle s’inscrit l’Agence régionale de santé pour définir prochainement le périmètre des futurs GHT, en concertation avec les représentants de la Fédération hospitalière de France, les communautés médicales, les présidents des conseils de surveillance concernés et, bien entendu, je vous rassure, les élus.

Je vous remercie pour cette réponse, madame la secrétaire d’État. Je suis d’accord avec vous sur le fait qu’il y a déjà des coopérations. Elles sont normales puisque le CHU est l’hôpital de l’ensemble des territoires alsaciens pour les activités de recours, que ce soit le 1, le 3 ou le 4 dans le Haut-Rhin.
Je note que la concertation va continuer. Cela ne peut en tout cas être imposé d’en haut. J’ai bien compris les objectifs de la loi, et j’y souscris, mais je ne voudrais pas qu’on en ajoute d’autres.

La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour exposer la question no 1294 de M. Gabriel Serville, relative à l’épidémie du virus Zika aux Antilles et en Guyane.

Madame la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, c’est une question que je pose au nom de mon collègue Gabriel Serville, député de Guyane, qui ne pouvait être présent aujourd’hui. Elle s’adresse à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.
La Guyane traverse actuellement, aux côtés de la Martinique, un épisode épidémique de Zika particulièrement virulent, qui mobilise l’ensemble des acteurs de santé publique dans un effort de coopération et de mutualisation des moyens humains et matériels sans précédent.
Or le centre hospitalier de Cayenne est parallèlement secoué par un large mouvement de contestation des cadres de santé, des médecins et instances représentatives du personnel à l’encontre de leur direction, qui fait craindre que l’hôpital ne soit pas capable d’assumer les responsabilités qui lui incombent dans la lutte contre l’épidémie de Zika.
Dès le 13 janvier, Gabriel Serville vous alertait à l’occasion de la séance de questions au gouvernement du climat social extrêmement dégradé observé au CHAR sur fond d’impasse budgétaire. Ensuite, par courrier du 3 février dernier, il vous faisait part de ses plus vives inquiétudes après le rejet à l’unanimité du plan de performance de l’hôpital, qui semblait dès lors rendre inévitable un changement de direction à la tête de l’établissement.
Aujourd’hui, force est de constater que le point de non-retour est atteint puisque les syndicats des médecins, la CFDT-CDTG et la CGT FO-CHAR viennent de voter une motion à l’encontre du directeur, alors même que le CHAR est appelé à se muer prochainement en hôpital universitaire.
Aussi, je vous demande de bien vouloir nous informer des mesures que vous envisagez afin que le centre hospitalier de Cayenne puisse retrouver un climat social apaisé et, ainsi, de nouveau assurer un service public de santé de qualité.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.
Madame la députée, l’épidémie de Zika qui a débuté à la fin de décembre est aujourd’hui installée en Martinique et en Guyane, avec plus de 5 000 cas évocateurs recensés. Quelques cas ont également été détectés en Guadeloupe et à Saint-Martin. Dans les départements français d’Amérique, trente-trois femmes enceintes ont été détectées positives et font l’objet d’un suivi renforcé.
Dès l’apparition du premier cas en France au mois de décembre, la ministre de la santé, Marisol Touraine, a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger et informer nos compatriotes qui vivent dans les zones touchées. Avec les agences régionales de santé et les professionnels de santé, elle a mis en place un suivi et renforcé la prise en charge des femmes enceintes.
Le centre hospitalier de Cayenne joue un rôle déterminant pour apporter aux Guyanaises une prise en charge adaptée. L’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS, a mené une mission d’évaluation de la capacité du système de santé à faire face à cette épidémie. Les moyens nécessaires au centre hospitalier de Cayenne ont été identifiés et des renforts ont été apportés. Deux respirateurs supplémentaires ont été livrés, dix-sept réservistes sont mobilisés en renfort : treize professionnels de santé basés au CHU de la Martinique pourront intervenir dans tous les départements français d’Amérique, deux techniciens de laboratoire sont en Guadeloupe et en Guyane et deux ingénieurs spécialistes en lutte anti-vectorielle sont basés en Guadeloupe.
Le centre hospitalier connaît par ailleurs de grandes difficultés financières. C’est la raison pour laquelle il fait l’objet d’un fort soutien financier de la part de l’État en 2015, avec près de 9 millions d’euros d’aides exceptionnelles. De plus, l’État accompagnera le projet de reconstruction du centre hospitalier de Cayenne.
Marisol Touraine sait que cet établissement est engagé dans un travail important pour définir un projet de retour à l’équilibre permettant, d’une part, de retrouver une capacité à investir et, d’autre part, de renforcer leurs activités médicales.
Marisol Touraine se rendra en Guyane à la fin de la semaine prochaine. Elle aura l’occasion de prendre la mesure des difficultés évoquées pour l’élaboration de ce plan et de rappeler la nécessité que les mesures proposées fassent l’objet d’un dialogue social nourri, tant avec la communauté médicale qu’avec l’ensemble des personnels hospitaliers et leurs représentants.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de cette réponse étayée, que je transmettrai évidemment à M. Serville.

La parole est à M. Jacques Krabal, pour exposer sa question, no 1309, relative au statut des pièces de réemploi automobile.

Madame la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, ma question concerne le marché de la pièce de réemploi, qui représente un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros par an, soit 2 % du marché de la pièce de rechange.
La pièce de réemploi trouve de plus en plus sa place dans la réparation et la maintenance automobile. C’est une alternative complémentaire à la pièce neuve. Elle permet de sauver un véhicule qui, sans elle, serait déclaré économiquement irréparable. Elle valorise également le savoir-faire des différents professionnels de l’automobile.
La pièce de réemploi peut avoir un fort impact sur le pouvoir d’achat des automobilistes, car elle permet de faire baisser la facture de réparation. Elle contribue à atteindre les taux de recyclage et de valorisation requis et se définit véritablement comme une pièce essentielle de l’économie circulaire, chère à François-Michel Lambert.
Vous connaissez l’article 77 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiant un article précédent du code de la consommation. Les professionnels s’interrogent donc sur le statut de déchet qu’aurait la pièce de réemploi. Ce statut est la cause de nombreux freins au développement de l’activité des centres agréés, notamment en matière d’exportation. C’est ce que me disent un syndicat, le CNPA, et les entreprises du territoire comme Caréco ou Multirex, impactées de ce fait dans leur développement économique, ce qui pénalise la création d’emplois.
Un avis publié au Journal officiel le 13 janvier dernier confirme que tout déchet traité dans une installation de traitement de déchets conserve un statut juridique de déchet après traitement. Par ailleurs, le ministère de l’écologie prévoit, dans un arrêté destiné à retirer ce statut aux pièces détachées, qui fait actuellement l’objet de consultations, de rendre la démarche volontaire et, de ce fait, optionnelle pour les centres VHU agréés.
Pouvez-vous donc nous dire quelle est la position du ministère sur la perspective de sortie des pièces de réemploi de ce statut de déchet ?
Monsieur le député, vous avez interrogé Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Réunissant actuellement la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, elle m’a chargée de vous répondre.
Les véhicules hors d’usage sont des véhicules dont les propriétaires souhaitent se défaire. Ce sont donc des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, qui prévoit que le traitement de ce type de déchet ne peut être réalisé que dans une installation titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 543-162.
Ces véhicules peuvent contenir des pièces en bon état, susceptibles d’être réutilisées comme pièces d’occasion, après avoir été démontées. Il s’agit d’une pratique ancienne, qui s’inscrit pleinement dans les objectifs de gestion des déchets fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Cette pratique n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 541-22 du code de l’environnement auquel fait référence le 6° de l’article L. 541-46 que vous mentionnez, puisque ces deux articles concernent le traitement du véhicule hors d’usage dans son ensemble et la préparation en vue de la réutilisation des pièces qui en sont issues.
La vente de ces pièces de véhicules hors d’usage ne fait pas partie du traitement en lui-même. Des objectifs de taux de réutilisation sont d’ailleurs fixés dans les cahiers des charges des agréments de ces installations.
Afin de faciliter l’utilisation de ces pièces, le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en liaison avec les différents professionnels concernés, élabore un arrêté ministériel fixant des critères permettant de les considérer comme des produits. La consultation par les services du ministère des organismes concernés est en cours. Elle s’appuie sur la démarche engagée par l’exploitant des centres de traitement de véhicules hors d’usage.
Enfin, la ministre de l’environnement soutient auprès de la Commission européenne, dans le cadre de la révision de la directive-cadre « Déchets », l’inscription de la reconnaissance du fait que les pièces de véhicules hors d’usage n’ont pas le statut de déchet dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, pour votre réponse. Rendre optionnelle la démarche de sortie du statut de déchet revient à distinguer deux catégories parmi les centres VHU agréés, seuls producteurs de la pièce de réemploi automobile : ceux qui auront le droit de vendre des pièces aux réparateurs ou aux consommateurs et ceux qui n’auront le droit de vendre leur stock de pièces qu’à des centres VHU agréés qui auront fait la démarche de sortie explicite du statut de déchet.
La France est le seul État membre à avoir fait le choix de la sortie explicite du statut de déchet pour les pièces d’automobiles issues des centres VHU agréés, ce que les entreprises du recyclage regrettent, puisque cela leur impose une démarche administrative supplémentaire qui impacte, de fait, leur compétitivité déjà fortement menacée par la chute des cours des métaux. Il est dommage que la France n’ait pas suivi les préconisations du comité d’adaptation technique dédié qui s’est déroulé le 30 novembre dernier à Bruxelles.
Au lendemain de la COP21, il devient plus que nécessaire de définir un véritable statut pour les pièces issues de l’économie circulaire, en leur apportant un cadre juridique clair et sécurisé, contrairement aux produits non contrôlés, vendus notamment par les particuliers sur internet. C’est l’engagement que vous venez de prendre. Jean de la Fontaine concluait sa fable « Le Renard et le Bouc » par ce vers : « En toute chose il faut considérer la fin. ». Cela est d’autant plus vrai quand il y va des 15 000 emplois répartis dans les 1 700 centres VHU qui sont actuellement pénalisés de fait.

La parole est à M. Pascal Popelin, pour exposer sa question, no 1310, relative à l’avenir du site du fort de Vaujours.

Madame la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, ma question porte sur le devenir du site du fort de Vaujours, situé pour partie sur le territoire des communes de Coubron et de Vaujours, dans la circonscription dont je suis l’élu, et pour partie dans le département de la Seine-et-Marne. Cet ancien terrain militaire a été exploité, durant la deuxième moitié du siècle dernier, par le Commissariat à l’énergie atomique, qui y a notamment réalisé un certain nombre d’expériences et d’opérations liées à la mise au point et au développement de l’arme de dissuasion nucléaire.
La société Placoplatre, désormais propriétaire de l’essentiel des emprises, prépare actuellement un dossier de demande d’autorisation, afin d’exploiter le précieux gypse que contient le sous-sol de ce site. Au préalable, il convient de démolir des bâtiments de l’ancien site du CEA, dont la plupart, à l’exception d’une partie du fort historique lui-même, ne présentent aucun intérêt architectural et se trouvent dans un état avancé de friche industrielle.
Si l’approvisionnement en gypse des usines Placoplatre est une nécessité économique, vitale pour la préservation de l’emploi sur le territoire, le projet d’exploitation et la démolition des bâtiments en cours suscitent légitimement des inquiétudes parmi les populations riveraines, en raison du passé des lieux et des suspicions de contamination radioactive du sol et de certaines constructions.
Certes, une enquête publique a eu lieu et un protocole de destruction des bâtiments a été établi à l’initiative de l’Autorité de sûreté nucléaire – ASN. Des contrôles de son respect sont bien régulièrement diligentés sous l’autorité des services de l’État. Une commission consultative de suivi rassemblant exploitants, associations, experts et élus, sous la présidence des préfets des deux départements, a bien été mise en place et se réunit régulièrement. Pourtant, les doutes dans la population demeurent, par manque d’information, par défiance sur la réalité de ces informations, voire par désinformation.
Je souhaiterais donc que vous puissiez faire connaître ici, très précisément, madame la ministre, la réalité du niveau éventuel de radioactivité du site du fort de Vaujours, selon les expertises officielles crédibles, la méthodologie et le calendrier de démolition des bâtiments, l’ensemble des mesures prises et les modalités de contrôle arrêtées pour garantir la sécurité de ces opérations, ainsi que les dispositions qui pourraient être envisagées par l’État afin d’améliorer l’information des populations concernées, de manière claire, précise, transparente et incontestable.
Monsieur Popelin, vous avez interrogé Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Réunissant actuellement la commission supérieure des sites, perspectives et paysage, elle m’a chargée de vous répondre.
Le Gouvernement confirme tout ce que vous avez très justement indiqué dans votre question sur les très nombreuses mesures de prévention et d’information prises par l’État dans cette affaire, avec la réalisation d’études, la mise en place de plusieurs sites d’information et d’une commission de suivi de site associant les élus et les riverains.
Vous demandez des informations sur le niveau de radioactivité réel du site. Elles sont disponibles et ont été largement diffusées, notamment dans le cadre de la commission de suivi de site que je viens de mentionner. Ségolène Royal a d’ailleurs demandé que tous les documents présentés dans cette commission soient diffusés à l’ensemble des participants. Par ailleurs, la ministre de l’environnement a demandé le 29 juin dernier qu’une réunion puisse se tenir entre les élus locaux et l’Autorité de sûreté nucléaire, afin que celle-ci présente les mesures de radioactivité réalisées jusqu’à présent et les conditions de réalisation de la tierce expertise demandée par les riverains.
La méthodologie de démolition des bâtiments et de gestion de leurs déchets a fait l’objet d’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui ont été présentés à la commission de suivi de site. La démarche proposée par l’ASN suit la même méthodologie de démantèlement que celle mise en oeuvre dans les installations nucléaires, alors même que ce site n’a jamais reçu que des quantités limitées d’uranium et qu’il n’a, dès lors, jamais été classé comme installation nucléaire.
Le chantier a débuté en 2015 par la démolition des bâtiments diagnostiqués comme ne présentant pas de risque particulier. Les bâtiments susceptibles de présenter des traces de contaminations résiduelles en uranium naturel ou appauvri seront démolis dans les mois à venir. Les préfets de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis suivront l’avis de la commission de suivi de site qui s’est tenue le 10 février pour la désignation d’un tiers expert. Je rappelle aussi que toutes les garanties d’indépendance sont données à cette tierce expertise dans la mesure où, même si l’exploitant la finance intégralement, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire qui est l’unique donneur d’ordre.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, pour la précision de cette réponse. Il était bon que les choses soient dites ici, officiellement, par le Gouvernement, de manière à clarifier ce dossier à destination des différents acteurs concernés.
La question des contrôles menés par le tiers expert est l’une de celles qui se posent et qui chagrinent un certain nombre d’élus. Pour ma part, je fais mienne votre analyse, dans la mesure où, par exemple, lorsqu’un maire soumet son plan local d’urbanisme à une enquête publique, si c’est bien la mairie qui finance l’étude et les experts, ils ne sont pas désignés par elle et conservent leur indépendance. Nous devons parvenir à poursuivre sur ce chemin au sujet d’un dossier qui est aussi important pour le développement économique du territoire, que sensible du point de vue de l’environnement et des questions de santé publique.

La parole est à M. Jean-Claude Buisine, pour exposer sa question, no 1314, relative à l’accès des plombiers chauffagistes au crédit d’impôt pour la transition énergétique.

Madame la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, ma question porte sur la nécessité d’adaptation d’une formation à la qualification RGE, « Reconnu garant de l’environnement », dédiée aux pompes à chaleur air-eau, laquelle est nécessaire pour bénéficier du mécanisme du crédit d’impôt pour la transition énergétique – CITE. Nous sommes tous d’accord pour soutenir l’innovation, notamment dans le domaine des économies d’énergie. Pourtant, nos PME et PMI se trouvent parfois devant des murs qui freinent leur volonté et leur investissement dans de nouveaux produits porteurs et assemblés en France.
La société Auer, implantée dans la Somme à Feuquières-en-Vimeu, est la seule usine française à fabriquer des chauffe-eau thermodynamiques, autrement dit des pompes à chaleur air-eau. Ces appareils permettent de réaliser jusqu’à 75 % d’économie d’énergie et ils sont jusqu’à mille fois moins polluants que la majorité des appareils du marché.
Si ce produit figure bien sur la liste des équipements pouvant bénéficier du CITE, défini à l’article 200 quater du code général des impôts, son installation doit être réalisée par une entreprise « RGE » depuis le 1er janvier 2015. Cette obligation de qualification exclut les plombiers chauffagistes du mécanisme du CITE. Sans cette incitation, on empêche une diffusion large de ces équipements énergétiques durables qui vont dans le sens des objectifs d’économie d’énergie de la France.
En outre, la qualification « QualiPAC » est obtenue au terme d’une formation dispensée principalement sur la géothermie, ce qui n’a aucune utilité pratique pour la pose d’un chauffe-eau thermodynamique, qui est aussi simple à poser qu’un chauffe-eau traditionnel. Il suffirait de spécialiser cette formation, en prévoyant un module dédié à l’aérothermie et un autre à la géothermie. La formation « QualiCET », dédiée aux chauffe-eau thermodynamiques, exige du professionnel une assurance décennale qu’une majorité de plombiers n’ont pas besoin de souscrire pour leurs travaux habituels et qui exclut presque totalement les équipements dédiés au marché de la rénovation.
Je souhaiterais donc vous demander, madame la ministre, si, au vu de l’objectif du CITE qui est d’inciter le plus grand nombre de particuliers à effectuer des travaux d’amélioration énergétique de leurs logements, vous comptez rendre plus accessible le dispositif du CITE aux plombiers chauffagistes et, si oui, de quelle façon.
Monsieur Buisine, vous avez interrogé Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Réunissant actuellement la commission supérieure des sites, perspectives et paysage, elle m’a chargée de vous répondre.
La qualité des installations est un enjeu essentiel pour réussir la rénovation énergétique des bâtiments et en faire un pilier de la transition énergétique pour la croissance verte. C’est pourquoi la qualification « RGE » des entreprises est obligatoire pour bénéficier du crédit d’impôt transition énergétique depuis le 1er janvier 2015.
Dans ce cadre, la qualification « QualiPAC » permet aux entreprises d’installer des pompes à chaleur air-eau et géothermiques qui assurent le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Elle repose sur une formation de cinq jours, comme vous le savez. L’essentiel de la formation théorique est commun à toutes les technologies de pompes à chaleur. Afin de répondre aux besoins des artisans qui ne posent que des pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ou des chauffe-eau thermodynamiques, l’organisme de qualification Qualit’EnR a mis en place, courant 2015, la qualification « QualiCET », qui repose sur une formation allégée de deux jours.
S’agissant de la garantie décennale, l’article L. 241-1 du code des assurances précise que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur la base de l’article 1792 du code civil doit être couverte par une assurance. Ce dernier dispose que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Dans ce cadre, les installateurs de chauffe-eau thermodynamiques ont tout intérêt à se couvrir des risques encourus, même si la notion d’ouvrage relève de l’appréciation du juge, notamment pour couvrir les risques de fuite importante ou en cas d’absence totale de production d’eau chaude sanitaire. L’exigence de garantie décennale pour obtenir la qualification intervient dans une logique de sécurisation des ménages qui investissent dans des travaux de rénovation avec le soutien de l’État.
Enfin, pour tenir compte de certaines spécificités, notamment des entreprises qui interviennent dans plusieurs domaines de travaux de rénovation énergétique, comme les plombiers chauffagistes, les règles de qualification ont été simplifiées par l’arrêté du 1erdécembre 2015, en concertation avec les organisations professionnelles et les organismes de qualification. Parmi les mesures de simplification, un audit unique a été mis en place en cas de multiqualifications pour les travaux éligibles au crédit d’impôt. Plus de 55 000 entreprises sont actuellement titulaires de la qualification RGE.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État. Je tiens aussi à préciser que l’usine Auer a besoin de votre soutien. Cette entreprise et ses quelque 400 salariés ont choisi de parier sur l’avenir et les énergies renouvelables, qui représentent aujourd’hui 50 % de leur activité. L’usine vient de créer quarante emplois et de réaliser des travaux d’agrandissement importants sur son site de Feuquières-en-Vimeux. C’est aussi la raison pour laquelle je souhaiterais vous inviter à la visiter dans les prochaines semaines.

La parole est à Mme Annick Lepetit, pour exposer sa question, no 1322, relative au déploiement des bornes de recharge électriques.

Madame la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, dans un monde post-COP 21, où la lutte contre les gaz à effet de serre est érigée au rang de priorité internationale, la mutation du parc automobile français vers les véhicules électriques est un outil plus que jamais nécessaire. Le 30 janvier 2015, les ministères de l’écologie et de l’économie ont reconnu une dimension nationale au projet du groupe Bolloré d’installer 16 000 bornes sur l’ensemble du territoire. Conformément à la loi du 4 août 2014, il se verra exonéré de la redevance d’occupation du domaine public pour chaque borne installée. Cet effort de la collectivité suppose des garanties.
Je souhaite donc savoir quels sont les dispositifs de contrôle et les consignes données aux préfets qui permettent à l’État de s’assurer que l’intérêt général est bien prioritaire dans le déploiement de ces bornes. Plusieurs questions sensibles sont en effet soulevées, comme le choix de l’emplacement des bornes, notamment dans les zones urbaines denses où la recharge à domicile n’est pas possible en l’absence de garage, ou encore la prévention d’ententes éventuelles entre opérateurs, particulièrement nécessaire sur ce marché naissant.
Un autre sujet me tient à coeur, à savoir l’encadrement des tarifs pratiqués. Et je suis certaine que ce sera un des principaux sujets dans les années à venir. Personne n’accepterait, par exemple, qu’une station-service vende de l’essence à un tarif plus élevé aux clients qui ne font pas partie de son réseau, et c’est pourtant le risque que nous encourrons si l’État ne met pas en place une régulation efficace.
Madame la députée, vous avez interrogé Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et qui, pour la raison que j’ai déjà indiquée, m’a chargée de vous répondre.
L’article 41 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte dispose que le développement des transports à faibles émissions de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques est une priorité pour réussir la transition énergétique. Cela implique une politique de déploiement d’infrastructures dédiées. Un ensemble de recommandations sont formulées dans le Livre Vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules décarbonés, mis à jour pour sa partie technique en décembre 2014. Elles sont opposables aux collectivités territoriales qui sollicitent le concours financier de l’État pour développer des réseaux territoriaux d’infrastructures de recharge ; elles le sont également aux opérateurs d’un projet reconnu de dimension nationale aux termes de la loi du 4 août 2014 et facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public, et aux termes de son décret d’application, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à la recharge.
Un projet de décret, élaboré par le préfet Francis Vuibert en charge du plan industriel, avec l’appui des services du ministère de l’environnement et de l’énergie et de ceux du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, vise à uniformiser dans un texte unique l’ensemble des dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et à intégrer les dispositions réglementaires issues de la directive 201494UE sur le déploiement des carburants alternatifs. Ce décret visera notamment à assurer l’universalité de la charge pour les véhicules électriques légers, les véhicules électriques d’ancienne génération et les véhicules hybrides rechargeables en prescrivant un socle technique minimum pour les points de recharge normale et les points de recharge rapide. Il intégrera des dispositions relatives à l’itinérance de la recharge : recensement des points de charge en leur attribuant un identifiant ; accès des conducteurs de véhicules électriques à une information fiable sur les infrastructures de recharge ouvertes au public – localisation géographique, caractéristique technique – ; mise en place d’une plate-forme d’opérabilité nationale neutre ; exigences relatives à interopérabilité. Le projet sera examiné par le Conseil national d’évaluation des normes lors de sa séance du 3 mars 2016.

Je remercie Mme la secrétaire d’État pour cette information. Ce projet de décret est une excellente nouvelle. Je serai bien évidemment vigilante quant à sa rédaction parce que je pense à ce qui s’est avec les opérateurs de téléphonie. Même si dernièrement deux fédérations se sont entendues sur l’installation des bornes de recharges électriques, il ne faut pas attendre que toutes l’aient fait. L’État a un rôle à jouer à cet égard, surtout au début de la mise en place d’un système qui va être de plus en plus puissant et dans lequel on voit déjà arriver un certain nombre d’opérateurs. Il est par conséquent urgent que l’État mette en place des garanties, avec bien sûr comme objectif l’intérêt général.

La parole est à M. Sauveur Gandolfi-Scheit, pour exposer sa question, no 1296, relative à la crise des déchets en Corse.

Madame la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, depuis plusieurs mois, l’Île de beauté se transforme en une véritable poubelle. Les décharges sont saturées, les poubelles pleines à craquer, les détritus sur les plages, au bord des routes et en pleine nature ; la Corse croule sous les déchets qu’elle ne parvient plus à traiter. Le retard de la collecte et leur stockage provisoire créent un trouble à l’ordre public et un risque sanitaire majeur pour nos concitoyens. Madame la secrétaire d’État, il y a urgence : urgence pour l’environnement, vous devez y être particulièrement sensible, et avant tout urgence pour l’hygiène et la santé publique.
Cette crise majeure est loin d’être réglée, comme le montre le rapport de la mission du conseil général de l’environnement et du développement durable qui a été remis à votre ministère en octobre 2015. En effet, les capacités de traitement de la Corse sont inférieures à sa production de déchets : elle produit actuellement 235 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par an pour une population d’environ 392 000 personnes – 54 % de ces déchets sont produits dans les bassins d’Ajaccio et de Bastia –, alors que la capacité d’enfouissement actuelle sur les trois sites en exploitation, ceux de Vico, Viggianello et Prunelli-di-Fiumorbo, a un potentiel annuel autorisé de 118 000 tonnes. L’enfouissement n’est plus la solution adaptée depuis de nombreuses années.
Au-delà de la réelle volonté politique menée sur le tri sélectif et le traitement mécanique, la Corse a besoin, sans attendre, d’une solution impérative et durable. Des solutions existent comme le traitement thermique ou l’incinération. Elles ont fait leur preuve dans beaucoup de régions de France. Dès lors, pourquoi ne pas mettre en place en Corse une économie circulaire en valorisant la partie de ses mâchefers récupérée qui serviraient de tout-venant, évitant ainsi de créer des carrières à ciel ouvert ?
Madame la secrétaire d’État, la Corse voudrait connaître les solutions urgentes et durables que le ministère de l’environnement souhaite aider à mettre en place, et surtout, vu l’urgence sanitaire, environnemental et économique, dans quels délais ?
Monsieur le député, vous avez interrogé Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et qui, pour la raison que j’ai déjà indiquée, m’a chargé de vous répondre.
Elle partage votre constat : la Corse rencontre actuellement des problèmes majeurs de gestion de ses déchets ménagers. La saturation des décharges de l’île risque ainsi d’aboutir, si des solutions courageuses ne sont pas prises dès maintenant, comme vous l’avez dit, à la prolifération de dépôts sauvages de déchets. Cette crise environnementale aurait par ailleurs des conséquences fortes d’un point de vue touristique et économique, et peut-être également pour la santé publique. Je rappelle que Mme Ségolène Royal a voulu que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte contienne un volet sur l’économie circulaire et a lancé différentes actions pour réduire la production de déchets et favoriser leur recyclage.
Quatre territoires en Corse sont engagés dans la démarche « zéro gaspillage zéro déchet », et la première réponse à la situation que vous avez décrite passe bien par le renforcement de telles actions. La ministre de l’environnement souhaite en particulier que les acteurs compétents proposent des actions concrètes et fortes à destination des particuliers, telles que la distribution de composteurs, pour avancer rapidement sur cette voie. Certaines collectivités en charge de la collecte et du tri ont déjà lancé des réformes importantes en vue de réduire de 50 % la quantité de déchets à stocker en décharge d’ici trois ans. Comme vous, elle pense qu’une solution est à trouver pour le traitement en Corse des déchets résiduels qui y sont produits. Ce sujet relève de la compétence des communes et de leurs groupements qui ont à choisir le mode de traitement le plus adapté au contexte territorial. Le rapport du CGEDD que vous mentionnez constitue une contribution utile. De plus, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a travaillé à proposer différents scénarios qui seront mis à disposition des élus des collectivités locales afin de gérer la période estivale qui s’annonce d’ores et déjà extrêmement tendue si rien n’est engagé dès maintenant. À cet effet, la ministre a demandé aux préfets de l’île de rendre publics ces scénarios afin de poursuivre le dialogue entamé avec l’ensemble des parties prenantes.
Soyez assuré de la mobilisation de Mme Ségolène Royal et de l’État. Elle vient d’ailleurs de rencontrer le préfet de Corse pour faire le point sur la situation afin de contribuer à faire émerger le plus rapidement possible une solution partagée.

Je vous remercie de cette réponse, madame la secrétaire d’État, mais vous savez que les problèmes d’enfouissement, que ce soit en aérobie ou en anaérobie, ne peuvent pas durer indéfiniment parce que les mercaptans se dégagent au bout de cinq ans et si on ne les récupère pas, cela aboutira à une pollution atmosphérique énorme. Il apparaît que cela ne relève pas de la compétence des communes ni même des intercommunalités. Il faut travailler, c’est vrai, sur le tri sélectif, pour arriver à un taux de 40 %. Pour le reste, il va falloir à mon avis débattre d’une solution de plus grande ampleur.

La parole est à M. Thierry Lazaro, pour exposer sa question, no 1303, relative à la ligne de très haute tension Avelin-Gavrelle.

Madame la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, je veux alerter votre ministère sur le projet de construction de la ligne très haute tension Avelin-Gavrelle entrepris par RTE – Réseau de transport d’électricité – qui défigurera à tout jamais la région de la Pévèle, poumon vert de la métropole lilloise et du bassin minier, qui accueille quantité de promeneurs, cyclistes et cavaliers dans la forêt de Phalempin, sur le site historique de la bataille de Mons-en-Pévèle, dans la réserve ornithologique des Cinq-Tailles à Thumeries et dans les nombreux clubs hippiques de la région dont le rôle économique et social n’est plus à démontrer. Ce projet impactera durablement également les riverains de cette future infrastructure industrielle.
Alors que le Gouvernement se donne comme objectif de réduire de 50 % la consommation d’énergie d’ici 2050 – celle de l’électricité de 25 % – et incite aux énergies alternatives, cette véritable autoroute électrique imaginée en 2003, l’une des plus puissantes et des plus hautes d’Europe, n’a plus lieu d’être alors que l’ensemble de la région est déjà parfaitement desservi et sécurisée par les lignes existantes. Néanmoins, RTE projette la construction de cette ligne de deux fois 400 kilovolts sur pas moins de vingt-huit kilomètres, avec vingt-quatre câbles, cinquante-sept pylônes de soixante-dix mètres de haut, dont vingt-neuf pylônes espacés de seulement trois cents mètres sur les neuf kilomètres de la Pévèle. Négligeant a priori les multiples risques sanitaires et environnementaux pourtant démontrés, RTE refuse l’enfouissement de dix kilomètres de cette ligne en zone ouverte rurale, enfouissement dont nous avons l’amère impression qu’il n’a pas été sérieusement étudié.
En ce qui concerne les risques sanitaires, le Centre international de recherche sur le cancer a classé en catégorie 2B possiblement cancérigène les champs magnétiques domestiques de très basse fréquence et en catégorie 3 les champs électriques et les champs magnétiques statiques. Or RTE n’en a pas fait état lors de la concertation. Au nombre de ces risques sanitaires figurent non limitativement : l’augmentation du risque de leucémie aiguë de l’enfant, de cancers cérébraux et du sein. À titre d’exemple, une équipe de l’INSERM a mis en évidence une augmentation du risque leucémique chez les enfants de moins de cinq ans, jusqu’à 2,6 fois s’ils résident à moins de cinquante mètres d’une ligne très haute tension et 1,6 fois s’ils résident à cent mètres. Il y a aussi les troubles de l’humeur dans le cadre du syndrome d’hypersensibilité électromagnétique ; les dysfonctionnements d’appareils médicaux, dont les pacemakers ; les atteintes du système immunitaire.
Au nombre des risques environnementaux ont été observées des modifications du comportement du bétail et de sa productivité, ainsi que des atteintes aux cultures maraîchères et fruitières. Or je vous rappelle que la Pévèle est riche en exploitations agricoles et en élevages de bovins ou de chevaux. Les oiseaux et abeilles en perdent également le nord… c’est tout dire.
Madame la secrétaire d’État, il n’est pas possible au ministère de l’environnement et de l’énergie d’ignorer les effets néfastes sur la santé et l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension. En conséquence et au nom du principe constitutionnel de précaution, je demande l’abandon de ce projet, au moins dans sa forme aérienne, et de me préciser la position du ministère quant à l’enfouissement des lignes THT en général et de la ligne Avelin-Gavrelle en particulier.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité.
Monsieur le député, vous avez interrogé Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Ne pouvant être présente pour la raison que j’ai indiquée, elle m’a chargé de vous répondre.
Vous attirez son attention sur la reconstruction de la ligne THT Avelin-Gavrelle actuelle. Cette ligne ne comporte aujourd’hui qu’un circuit alors qu’elle transporte des flux croissants d’électricité résultant de l’essor des énergies renouvelables et des échanges interrégionaux et européens. Au-delà de son rôle d’alimentation, elle participe donc à la transition énergétique par son rôle d’insertion et de mutualisation de ces renouvelables en Europe. De plus, seule ligne du réseau de transport d’électricité dans cette zone à ne comporter qu’un seul circuit, elle constitue donc un point de fragilité, surtout en hiver. Cette fragilité est d’autant plus inacceptable que la ligne permet d’alimenter un nombre important d’usagers. C’est pourquoi il est indispensable de la reconstruire à double circuit. Cette reconstruction sera suivie de la suppression de la ligne actuelle. Le paysage ne sera donc pas profondément modifié par l’ajout du double circuit.
Vous souhaitez que la ligne soit mise en souterrain au niveau de la Pévèle. Ségolène Royal a été très attentive à votre demande. Toutefois, à ce niveau de tension – 400 000 volts –, la mise en souterrain n’est malheureusement pas possible car un tel tronçon dans la Pévèle aurait la largeur d’une autoroute et un impact hydrogéologique majeur du fait de la modification des écoulements souterrains dans cette zone. Par ailleurs, la mise en souterrain occasionnerait un coût important, qui se répercuterait sur l’ensemble des consommateurs d’électricité. En outre, le souterrain n’offre pas la même qualité d’alimentation, indispensable sur le réseau de grand transport européen mais aussi pour les consommateurs d’électricité du Nord et du Pas-de-Calais. Ce n’est donc pas une solution électrique satisfaisante. Une étude spécifique commandée au Centre italien d’expertise technologique et électrique l’a confirmé. Elle a été présentée aux acteurs de la Pévèle le 14 octobre 2014.
Attaché à la préservation des paysages, je vous rappelle que le Gouvernement est très attentif à la question du transport d’électricité en souterrain.
La France est un des pays qui enfouit le plus d’ouvrages de transport d’électricité : en 2014, 90 % des nouvelles lignes à haute tension – à 63 000 volts et 90 000 volts – ont été construites en souterrain. En revanche, la mise en souterrain de lignes à 400 000 volts est une solution technique et financière qui ne peut être privilégiée. à A titre de compensation, RTE propose donc d’enfouir d’autres ouvrages de tension inférieure, telles que les lignes à 90 000 volts situées au nord de Gavrelle et une ligne à 225 000 volts en zone urbanisée, qui croise la ligne Avelin-Gavrelle.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la reconstruction de 30 kilomètres de lignes aériennes, RTE déposera près de 80 kilomètres d’ouvrages existant en haute tension. D’autres mises en souterrain pourraient être envisagées, en partenariat avec les propriétaires des réseaux de distribution.

Comme vous pouvez l’imaginer, madame la secrétaire d’État, je ne peux pas me satisfaire de votre réponse, pour deux raisons. Premièrement, RTE a toujours nié le fait qu’il existe un transit européen, ce que le député européen Dominique Riquet et moi-même, qui travaillons sur le sujet, ne cessons de répéter. Aussi, madame la secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir souligné cet argument, que RTE réfute. Il faudra que l’entreprise s’explique enfin sur l’impact de cette ligne. Vous qui connaissez bien la région, madame la secrétaire d’État, autorisez-moi à préciser qu’une ligne qui passe de 6 à 24 fils aura un profond impact sur le territoire de la Pévèle.
Deuxièmement, l’enfouissement de la ligne est présenté comme impossible par certains et comme faisable par d’autres. Ce point mérite réflexion. RTE doit du moins donner le sentiment aux acteurs d’avoir véritablement, sereinement et efficacement étudié la question, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

La parole est à Mme Marie-Jo Zimmermann, pour exposer sa question, no 1295, relative aux filières d’enseignement franco-allemandes.

Madame la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, j’appelle l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le fait qu’en 2015, le Gouvernement a annoncé la suppression des classes bilangues dans les collèges, ce qui mettait par contrecoup en cause les sections européennes et franco-allemandes Abibac.
Cette décision a porté atteinte à des filières d’excellence. Ainsi, les sections Abibac donnent aux élèves une ouverture extraordinaire sur l’Allemagne et les élèves qui en sont diplômés réussissent encore mieux que ceux des sections européennes. La suppression des classes bilangues pénalise tout particulièrement la langue allemande, ce qui a d’ailleurs amené le Gouvernement allemand à protester auprès de la France. En outre, cette décision a été très mal ressentie dans le département frontalier de la Moselle qui déploie, ainsi que les communes, des efforts importants en faveur du bilinguisme franco-allemand.
Pendant des mois, le ministère de l’éducation nationale n’a rien voulu entendre. Il vient heureusement d’annoncer que certaines classes bilangues seraient maintenues, ce qui prouve que la décision initiale de suppression n’était pas forcément pertinente. Le maintien des classes bilangues n’étant cependant que très partiel, serait-il possible de donner la priorité aux départements frontaliers, qui, beaucoup plus que les autres, ont besoin d’offrir à leurs lycéens et collégiens une bonne connaissance de la langue du pays voisin – Espagne, Italie ou Allemagne ? En ce qui concerne la langue allemande, qu’envisage de faire le Gouvernement pour garantir non seulement le maintien mais surtout le développement des filières franco-allemandes en Moselle, notamment les classes européennes et les sections Abibac ?
Dans le même ordre d’idée, le ministère refuse toute participation à des projets associant la Moselle, la Sarre et le Luxembourg, comme par exemple celui du Schengen-Lyzeum de Perl. Cet établissement, situé en Allemagne à quelques kilomètres des frontières luxembourgeoise et française, accueille des lycéens et collégiens provenant des trois pays. Cependant, le refus du ministère de l’éducation nationale de participer aux frais de fonctionnement de l’établissement au prorata du nombre d’élèves Français conduit à ce que ceux-ci n’y seront plus accueillis à l’avenir. Que compte faire le Gouvernement pour régler cette question ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité.
Madame la députée, l’amélioration des compétences en langue vivante étrangère des élèves français est l’une des priorités du ministère de l’éducation nationale. Comme vous le savez déjà, à compter de la rentrée 2016, l’apprentissage de la première langue vivante commencera dès le cours préparatoire et celui de la deuxième langue vivante, dès la classe de cinquième.
Le volume d’heures consacré à ces enseignements sera augmenté sensiblement, afin que chaque élève, et non plus seulement les élèves des classes bilangues et européennes, puisse bénéficier d’un apprentissage renforcé en langues. Il n’a jamais été question d’une suppression généralisée des dispositifs bilangues. Comme la ministre l’a annoncé lors de la présentation de la réforme du collège au printemps 2015, les dispositifs bilangues de continuité, pour les élèves ayant étudié une autre langue que l’anglais en primaire, sont tous maintenus. Les classes bilangues de contournement, qui créent des inégalités entre collégiens, sont au contraire supprimées, dans un contexte où, comme je viens de le rappeler, l’apprentissage des langues vivantes est par ailleurs rendu plus précoce, pour tous les élèves.
S’agissant du développement de l’enseignement de l’allemand en France, les engagements pris par la ministre sont non seulement tenus mais dépassés : plus de 3 800 écoles élémentaires, dont 438 en Moselle, proposeront un enseignement de l’allemand à la rentrée 2016, soit 1 000 écoles de plus qu’aujourd’hui. Près de 4 700 collèges proposeront l’allemand en LV2 à la rentrée 2016, soit près de 700 collèges de plus qu’aujourd’hui. En outre, 2 300 collèges, dont 89 en Moselle, proposeront un dispositif bilangues anglais allemand.
Enfin, s’agissant de l’établissement de Perl, je vous précise, madame la députée, que ses statuts accordent une priorité aux élèves allemands et luxembourgeois car l’État luxembourgeois et le land de Sarre ont cofinancé sa construction. Il n’y a donc, pour cet établissement, aucune marge d’intervention institutionnelle.
Vous le voyez, madame la députée, c’est en faveur de la maîtrise la plus large des langues vivantes par les jeunes de notre pays que l’action de ce Gouvernement est conduite, dans le souci constant du rétablissement d’un système éducatif juste, en faveur de la réussite de l’ensemble des élèves.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, pour cette réponse, qui ne varie pas depuis 2015. Je le regrette car les filières construites depuis des années, notamment les sections européennes et les classes Abibac, que M. Allègre, l’un des prédécesseurs de Mme Belkacem, avait accordées, donnaient des résultats extraordinaires en Moselle, un département dont la situation est bien particulière. Grâce à elles, nos lycéens bénéficiaient d’un plus lorsqu’ils partaient à l’étranger, notamment en Allemagne.
Je souhaite donc, non pas que l’on favorise les classes bilangues anglais allemand, mais que l’on revienne vers les sections bilangues, comme c’est le cas dans certaines régions, notamment en région parisienne. Pourquoi ces classes ne sont-elles pas recréées en Alsace et en Moselle, lieu idéal pour de telles filières ?

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Questions sur la politique du Gouvernement en matière d’infrastructures de transports ;
Questions sur l’économie collaborative ;
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi relatif au droit des étrangers.
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures quarante.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly