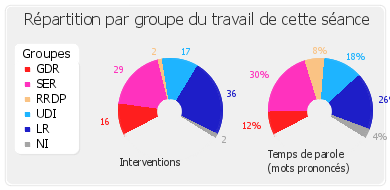Séance en hémicycle du 19 octobre 2016 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à quinze heures.

L’ordre du jour appelle les questions au Gouvernement sur des sujets européens.

Monsieur le Premier ministre, au lendemain du référendum sur le Brexit, François Hollande annonçait pour la énième fois que la France serait « à l’initiative pour que l’Europe se concentre sur l’essentiel », en particulier « l’harmonisation fiscale » et « le renforcement de la zone euro et de sa gouvernance ». Aujourd’hui, toujours rien. La vérité, c’est que François Hollande parle, bavarde beaucoup même, ces temps-ci, mais ne s’occupe pas des véritables enjeux.
Protestations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La vérité, c’est que l’influence de la France en Europe a fortement reculé depuis quatre ans. La tâche est immense, certes, mais urgente face aux nombreuses crises que traverse l’Europe.
Quand, avec l’Allemagne, doterez-vous la zone euro d’une gouvernance économique avec harmonisation fiscale, d’une politique industrielle et d’une politique énergétique communes ?
Quand, devant la crise migratoire, vous engagerez-vous vers une modification en profondeur du système de Schengen, aujourd’hui effondré, en le dotant, comme nous le proposons, d’une direction politique, en harmonisant au préalable les politiques d’asile et en renforçant considérablement FRONTEX pour protéger efficacement les frontières extérieures de l’Europe ?
Quand serez-vous enfin clair sur le fait que la Turquie n’a pas vocation à entrer dans l’Union européenne ?
Depuis la création de l’Europe, la France a toujours contribué à faire avancer le grand projet européen. Mais, depuis 2012, François Hollande n’offre aucune vision pour ce dernier et, dans les faits, c’est vers l’Allemagne que les regards de nos partenaires sont tournés. Le Brexit est un séisme ; il devrait vous appeler au sursaut. Quand le Président de la République mettra-t-il sur la table du Conseil européen des propositions concrètes pour répondre aux nombreuses crises que traverse l’Europe ?
Applaudissements sur quelques bancs du groupe Les Républicains.
Monsieur Lequiller, parce que vous connaissez bien ces sujets, pour les traiter régulièrement – j’ai déjà eu l’occasion de vous répondre –, mais aussi parce que vous êtes un Européen convaincu, je suis toujours étonné non pas du ton que vous employez mais du caractère caricatural de vos question concernant l’engagement et la politique du Président de la République ou du Gouvernement sur les questions européennes.
Nous pouvons nous mettre très vite d’accord sur le constat : oui, l’Europe est à la croisée des chemins et même menacée de se déliter, de disparaître de l’histoire. Brexit, menace terroriste, crise des réfugiés, tensions au sein même de l’Union européenne entre les anciens pays de l’Est et de l’Ouest, entre le Nord et le Sud : nous savons que ces crises existent et il convient en effet d’en appeler à un sursaut, mais pas en caricaturant.
Je vous répondrai de manière extrêmement précise.
La zone euro était en très grande tension en 2012 – je n’accuse d’ailleurs pas le précédent Président de la République d’en être responsable – et elle est aujourd’hui stabilisée. Si la Grèce en est restée membre, c’est grâce à l’initiative du Président de la République François Hollande, alors même que, comme vous le savez, des voix s’élevaient en Allemagne pour qu’elle en sorte.
Certains voudraient que les choses évoluent beaucoup plus vite. Mais la vision et la volonté de la France, quelles que soient les majorités, impliquent d’accroître les investissements d’avenir – je pense au plan Juncker –, de modifier la gouvernance de l’euro, de mettre en place une autre politique et de donner un autre rôle à la Banque centrale européenne, comme je l’ai dit, dans cet hémicycle, lors du discours de politique générale. Et si tout cela est au coeur des débats, si certaines de ces politiques sont mises en oeuvre, c’est parce que la voix de la France compte.
De même – nous aurons l’occasion d’y revenir –, si des solutions à la crise ukrainienne qui menace les frontières orientales de l’Europe peuvent être recherchées, malgré toutes les difficultés, c’est grâce à une initiative commune du Président de la République et de la chancelière Merkel, qui se retrouvent d’ailleurs ce soir avec les présidents russe et ukrainien à Berlin.
On ne règle pas non plus les problèmes liés aux réfugiés en caricaturant ou en posant une seule question, car la situation est particulièrement difficile, nous le savons. Il n’en reste pas moins que ce sont les positions de la France défendues par Bernard Cazeneuve sur le PNR – Passenger Name Record – ou sur les gardes-frontières qui sont aujourd’hui mises en oeuvre. Est-ce suffisant ? Non, il faut évidemment aller plus loin. Parce que l’Europe, à mon sens, est une question de frontières, les protections aux frontières extérieures sont nécessaires.
Vous m’interrogez sur la Turquie. Oui, je crois que des clarifications sont nécessaires à ce propos mais, enfin, ne soyez pas caricatural ! C’est sous la présidence de Nicolas Sarkozy que onze chapitres de négociation ont été ouverts. Je rappelle également que les positions parfois ambiguës vis-à-vis de la Turquie ne datent pas d’hier ; le Président Jacques Chirac les incarnait, je crois, avec un certain talent…
Sur tous ces risques majeurs, nous devons avancer. Et, Jean-Yves Le Drian aura l’occasion d’y revenir, si des initiatives existent en matière de défense, c’est précisément que l’Allemagne et la France, sous l’impulsion du ministre de la défense, avancent dans ce domaine.
Nous y reviendrons mais il faut un débat sérieux et précis parce que l’Europe est en danger. Bien des choses passeront par le couple franco-allemand. En tout cas, il faut sortir des caricatures : sur ces questions, j’en suis convaincu, si, les uns et les autres, nous oublions les primaires et les débats politiques primaires, nous pourrons avancer intelligemment ensemble.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain et du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Politique européenne de la France

La parole est à Mme Marietta Karamanli, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur le Premier ministre, l’Union européenne est confrontée aujourd’hui à plusieurs défis majeurs : préserver sa production face à une concurrence déloyale, qui ne respecte pas toujours les minima sociaux ou environnementaux ; protéger ses ressources face à des entreprises géantes qui font leurs affaires en Europe mais n’y paient pas – ou peu – d’impôts ; maîtriser les migrations ; donner plus de force à sa police et à sa défense pour assurer la protection de ses citoyens contre les agressions portées en son sein.
Il est clair que les réponses ne peuvent être que continentales, si nous voulons qu’elles soient vraiment efficaces. Sur tous ces sujets, monsieur le Premier ministre, l’Europe n’est pas le problème ; elle est la solution. Certes, il peut être tentant de s’en tenir à une orientation très libérale ou peu volontariste, mais le défi est bien de mener de grandes politiques publiques en matière industrielle et fiscale, mais aussi en faveur des droits sociaux, de la police et de la défense, des politiques favorables au plus grand nombre, afin de construire une Europe qui rassure, une Europe qui va de l’avant.
Sur tous ces thèmes, il est temps de prendre de nouvelles initiatives et de faire partager une vision politique qui ne soit pas seulement l’addition de mesures techniques, lesquelles n’ont de sens ni pour nos compatriotes ni pour les autres citoyens européens.
Monsieur le Premier ministre, ma question est simple : la France entend-elle profiter de ce moment de doute pour proposer plus d’espérance, plus de protection et plus de partage efficace entre les 27 États membres de l’Union européenne, qui entendent profiter de leur force commune pour protéger et avancer ensemble ?
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.
Madame la députée, dans le monde d’aujourd’hui, il importe en effet qu’il existe des régulations et des organisations. L’Europe doit pouvoir jouer ce rôle – c’était d’ailleurs son projet initial. Le joue-t-elle aujourd’hui ? Cela dépend des sujets, mais soyons parfois positifs – j’aurais pu le dire il y a un instant au président Lequiller.
Je prendrai deux exemples, en commençant par l’environnement et les suites de la COP21. Si celle-ci est sur le point d’être approuvée – nous aurons l’occasion de célébrer l’événement, dans quelques semaines, à Marrakech –, c’est grâce à l’Europe, au travail de la Commission européenne, et plus particulièrement à la France. Alors, réjouissons-nous du rôle joué par l’Union européenne dans le succès de la COP21, qui permettra de relever le défi considérable que représente la lutte contre le réchauffement climatique.
J’en viens, deuxièmement, au libre-échange, auquel nous sommes effectivement favorables, mais pas à n’importe quelle condition. C’est la France, par la voix du secrétaire d’État Matthias Fekl, qui a défendu une position intransigeante dans les négociations entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique. Nous sommes mêmes allés jusqu’à demander l’arrêt de ces négociations, car telle n’est pas notre conception du libre-échange et des accords commerciaux.
L’Europe, c’est aussi un espace de civilisation, et des frontières. Nous nous devons de défendre certains progrès qui définissent cet espace de civilisation et qui sont malheureusement remis en cause au sein même de l’Union européenne. Je songe à l’abolition de la peine de mort, mais aussi à l’interruption volontaire de grossesse, que nous considérons comme un droit essentiel. Nous avons déjà eu l’occasion, avec Laurence Rossignol, de nous féliciter du choix que les Polonais ont finalement fait sur cette question.
Un autre droit essentiel est le droit d’asile. La maîtrise des migrations est une question difficile, et vous connaissez ma position sur la politique de l’Allemagne s’agissant de l’accueil des réfugiés : nous respectons ce choix, mais ce n’est pas celui de la France. Le droit d’asile, lui, est en revanche un droit universel, que nous devons garantir – nous y reviendrons, dans un instant, lorsque nous aborderons la question de Calais.
L’Europe, enfin, c’est un projet pour le monde et pour la jeunesse. S’il y a une nouvelle frontière pour l’Europe, c’est, plus que jamais, la Méditerranée et l’Afrique. L’Afrique est le continent de l’avenir, car c’est là que se posent les grands enjeux de demain : enjeux démographiques, enjeux culturels, enjeux religieux, enjeux sécuritaires, enjeux économiques. Si la France et l’Europe doivent avoir un seul projet, c’est bien celui-ci.
Je suis convaincu que, forte de ces valeurs fondamentales, dans un monde qui a totalement changé, qui n’est plus celui de Yalta, la France, sa parole et son action sont essentiels pour que l’Europe, plus que jamais, soit notre avenir.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à M. Joël Giraud, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Monsieur le ministre de l’agriculture, ma question a trait à un sujet que l’on peut analyser comme une surinterprétation des textes européens, un mal français qui n’est ni de gauche ni de droite, mais qui contribue à faire détester l’Europe. Le dernier exemple en date concerne les normes phytosanitaires et leurs conséquences sur l’agriculture française. Je souhaite associer en particulier mes collègues Sylvia Pinel, Jeanine Dubié, Dominique Orliac et Jacques Krabal à cette question.
Nous sommes très attachés à une prise en compte des enjeux de sécurité alimentaire et de santé publique. Nous saluons les avancées considérables et régulières effectuées par le Parlement, le Gouvernement et les acteurs concernés pour encadrer et limiter l’utilisation des produits néfastes pour les paysans, les habitants et l’environnement. Mais nous ne voulons pas que des surréglementations dogmatiques puissent pénaliser inutilement nos paysans et mettre en péril la « ferme France ».
Or le premier projet d’arrêté qui a circulé sur les normes phytosanitaires semble relever de cette catégorie. En ajoutant – ce qui n’est le cas dans aucun pays d’Europe – les fossés, les bosquets et les forêts aux cours d’eau, dans la référence des largeurs de zones non traitées qui peuvent atteindre 50 mètres, il restreindrait la surface traitable – et donc, dans nombre de cas, cultivable – de manière considérable, voire même à peau de chagrin dans les zones de montagne, où de petites parcelles séparées par des rigoles sont la norme, surtout lorsqu’il s’agit d’arboriculture.
L’arrêté ne doit pas non plus abandonner l’échelle de Beaufort pour la mesure du vent, échelle basée sur le bon sens – lequel manque parfois tant –, au risque, sinon, d’imposer à nos paysans de traiter avec un anémomètre sur leur tracteur, et de l’arrêter chaque fois qu’une rafale dépasse 19 kilomètres par heure.
De telles dispositions réglementaires seraient d’autant plus déconcertantes qu’elles reviennent, en les contredisant, sur des dispositions législatives votées à plusieurs reprises par le Parlement, comme la loi d’avenir pour l’agriculture ou la loi pour la reconquête de la biodiversité.
Hier, le Comité de rénovation des normes en agriculture se réunissait pour rendre un avis sur ce projet d’arrêté. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous dire où en sont les réflexions du Gouvernement sur ce sujet ? Nous devons, et nous pouvons, dépasser une opposition stérile et idéologique entre les exigences environnementales et la nécessité de renforcer la compétitivité de l’agriculture française.
Applaudissements sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et sur plusieurs bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Monsieur le député, vous me posez une question dont vous semblez déjà connaître la réponse, puisque vous avez manifestement entre les mains un arrêté qui aurait déjà été signé et serait déjà entré en application. Quel est cet arrêté ? D’où vient-il ? A-t-il été signé par le ministre de l’agriculture ? Je ne le crois pas, et vous savez bien que ce n’est pas le cas.
Si nous voulons avoir un débat serein, reconnaissez que j’ai toujours milité contre la surtransposition des directives européennes en France. Je vous rappelle par exemple que, s’agissant des installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE –, nous sommes revenus, pour les élevages porcins et de volaille, sur des surtranspositions qui avaient eu lieu avant notre arrivée au pouvoir. Notre logique a toujours été la même. Les lignes directrices de l’Union européenne actuellement en vigueur concernant les nouvelles autorisations de mise sur le marché datent de janvier 2016. Êtes-vous d’accord avec moi pour dire que nous devons les respecter ?
Je rappelle que si nous sommes en train de discuter de cet arrêté, c’est parce qu’une association de producteurs de pommes et de poires a saisi le Conseil d’État et nous a contraints à renégocier tout cela.
Ce n’est pas de la responsabilité du Gouvernement.
J’ai toujours été très clair. Nous veillerons à la fois à développer les productions et à protéger les populations, tout en respectant le travail des agriculteurs. C’est sur cette base que nous prendrons un arrêté, lequel sera en conformité avec les lignes directrices définies à l’échelle européenne, même si nous devrons faire un travail de coordination pour tenir compte des nouvelles normes d’autorisation de mise sur le marché de janvier 2016. Notre souci, vous l’avez très bien dit, sera de respecter à la fois l’environnement, la santé de nos concitoyens et, surtout, le travail des agriculteurs.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à M. Marc Dolez, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous interroger sur les accords de libre-échange que l’Union européenne négocie avec les États-Unis, le Transatlantic Free Trade Area, TAFTA, et avec le Canada, le Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA.
Vous avez déclaré, le 28 juin, dans cet hémicycle, que le TAFTA n’était pas acceptable. Ma première question est donc simple : quelles initiatives la France a-t-elle prises ou va-t-elle prendre pour mettre un terme aux négociations ?
Le CETA n’est pas plus acceptable car la négociation avec le Canada est tout aussi opaque sur la forme et néolibérale sur le fond : déréglementation des normes sociales, écologiques et alimentaires, soumission des États aux marchés, sans compter de nombreuses zones d’ombre, qui font de ce texte de 1 600 pages un véritable chèque en blanc. Et pourtant, monsieur le Premier ministre, vous l’avez qualifié d’« équilibré » et de « gagnant-gagnant », alors que, par exemple, les multinationales américaines de l’agroalimentaire détenant une filiale au Canada pourront profiter de l’accord pour mieux pénétrer et inonder le marché européen.
J’en viens à ma seconde question. Après l’échec, hier, du conseil des ministres du commerce, la France entend-elle tirer les leçons de la négociation et renoncer en toute cohérence à soutenir le CETA ? S’engage-t-elle aussi à s’opposer à toute application du traité, avant même une hypothétique ratification par les parlements nationaux ?
Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger.
Monsieur le député, je vous remercie de votre question. Nous sommes clairement à la fin d’un cycle en matière commerciale. Après trente années de suppression des règles, de néolibéralisme, de promesses d’emploi et de croissance qui, il faut le dire, n’ont souvent pas été tenues, l’Union européenne a aujourd’hui l’ardente obligation de réinventer sa politique commerciale et de s’affirmer comme une puissance commerciale qui défend les Européens et ses intérêts propres.
C’est pourquoi, comme l’a rappelé M. le Premier ministre, nous demandons – et nous sommes à ce stade le seul pays européen à le faire – la fin pure et simple des négociations sur le TAFTA, qui vont clairement dans le mauvais sens et dont l’Europe n’a manifestement rien à attendre.
S’agissant des négociations avec le Canada, il faut d’abord rétablir un certain nombre de vérités. Ces discussions sont achevées depuis deux ans et la France s’est battue, même après la fin des négociations, pour obtenir un certain nombre d’avancées extrêmement importantes.
D’abord, concernant la ratification des parlements, comme je m’y étais engagé devant vous, Sigmar Gabriel et moi avons écrit à la Commission européenne avant l’été pour obtenir la reconnaissance du caractère mixte de l’accord, afin que vous, mesdames et messieurs les parlementaires, puissiez avoir le dernier mot.
Ensuite, nous nous sommes battus, hier encore, en conseil des ministres européens, à Luxembourg, sur la question de son application provisoire. Il est maintenant clairement acté au niveau européen qu’en cas d’opposition des parlements nationaux à cet accord, son application provisoire devra être remise en question, conformément aux procédures européennes. C’est la première fois que la démocratie est respectée à ce point.
Enfin, l’arbitrage privé a été remplacé par une cour de justice commerciale internationale publique, ce qui est inédit. Je suis fier que cette initiative, portée par la France, ait abouti au niveau européen.
Pourquoi les progressistes européens, y compris les soutiens de M. Tsipras, en Grèce, et le Bloc de gauche, au Portugal, soutiennent-ils cet accord ? Parce que celui-ci pose des règles et protège l’économie européenne.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à M. Gilles Savary, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, élu d’une circonscription agricole, à dominante viticole et forestière mais comportant également des exploitations d’élevage bovin, je réalise sur le terrain la pertinence de l’orientation que vous avez donnée à notre politique agricole vers l’agro-écologie et un rééquilibrage des aides de la PAC – la politique agricole commune – entre les cultures agro-industrielle et celles plus protectrices de l’environnement et des sols, face aux nouvelles exigences environnementales et surtout face aux nouvelles aspirations de sécurité alimentaire des consommateurs et des néoruraux.
Mais cette réorientation de la PAC, qui s’est traduite, sur le terrain, par la création laborieuse d’un référentiel européen systématique du parcellaire éligible par voie satellitaire, n’a pas encore été totalement perçue par les agriculteurs eux-mêmes. Ces derniers ont notamment eu à déplorer des retards de paiements, d’autant plus regrettables qu’ils ont traversé des crises de marché particulièrement anxiogènes pour leur avenir.
Je vous interroge pour savoir où en est précisément la procédure de versement des aides de la PAC et dans quels délais nos agriculteurs peuvent raisonnablement envisager d’en disposer. Enfin, je souhaiterais savoir si la réorientation progressive des aides en matière de convergence, de verdissement et de bonus pour les petites exploitations, que vous avez personnellement impulsée et défendue à Bruxelles, est d’ores et déjà palpable dans les versements en cours.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Monsieur le député, vous avez posé une question qui me permettra de donner une information à l’Assemblée nationale
« Ah ! » sur les bancs du groupe Les Républicains
la réforme de la PAC aura deux conséquences précises sur la répartition des aides.
Premièrement, les aides découplées convergeront, avec la fin des références historiques, et seront redistribuées, comme vous l’avez expliqué, avec la surprime accordée aux 52 premiers hectares. En 2013, 20 % des agriculteurs recevaient 54 % des aides ; en 2015, 20 % des agriculteurs bénéficiaient de 52 % des aides ; en 2019, au terme de la réforme de la PAC, 20 % des agriculteurs recevront 47 % des aides.
Lorsque je préparais mon BTS dans un lycée agricole, je me souviens que 20 % des agriculteurs recevaient 80 % des aides. Avec cette réforme, la répartition sera meilleure et plus en conformité avec les enjeux de la diversité du monde agricole.
Deuxièmement, le registre parcellaire graphique est un vrai sujet : nous avons été obligés de le mettre en place pour éviter de payer des amendes.
Monsieur Jacob, je ne veux même pas entrer dans les détails des erreurs commises par le passé, que j’ai dû assumer.
Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.
Nous allons maintenant rattraper l’ensemble des retards, grâce à une ATR – avance de trésorerie remboursable –, financée par le budget de l’État, représentant 90 % des aides de 2015 : 5,2 milliards d’euros ont déjà été versés en novembre, incluant l’ICHN, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels. Quant au solde de 2016, il sera versé au début de l’année 2017. Ainsi, début 2017, nous aurons rattrapé les retards et mis en oeuvre la totalité de la nouvelle politique agricole commune.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à Mme Marie-Jo Zimmermann, pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le Premier ministre, notre industrie automobile doit faire face à la concurrence des autres pays de l’Union européenne. Il faut donc la protéger en évitant de modifier trop brutalement la fiscalité comme on le constate avec le diesel. Le groupe PSA vient d’annoncer des mesures de restructuration qui concernent plus de 2 000 emplois : elles s’expliquent en partie par les mesures fiscales prises à l’encontre du diesel. Le diesel est pourtant l’un des points forts des constructeurs automobiles français. La plus grande usine de moteurs diesel au monde se trouve en France, à Trémery.
Or les investissements dans l’automobile sont très importants et ne s’amortissent que sur une période longue. C’est pourquoi la mission d’information sur l’offre automobile française demande que l’alignement fiscal soit étalé sur cinq ans, comme un minimum incompressible. Le ministre du budget avait d’ailleurs accepté ce principe.
Les anciens véhicules diesel, je le concède, étaient polluants, mais il est regrettable qu’on s’appuie sur eux et sur le problème de Volkswagen pour justifier l’explosion de la fiscalité, d’autant que les constructeurs français ont considérablement amélioré les nouveaux moteurs et qu’aujourd’hui un moteur diesel rejette deux fois moins de gaz à effet de serre qu’un moteur à essence.
Dans ces conditions, l’annonce par la ministre de l’environnement d’un alignement fiscal sur deux ans est une aberration économique. Notre industrie a besoin de temps pour adapter ses usines, faute de quoi on risque de casser une dynamique et de poser un problème à notre industrie automobile au sein du marché européen. Une fois de plus, nous sommes en présence d’incohérences gouvernementales.
Monsieur le Premier ministre, je vous demande de me répondre clairement : la convergence fiscale entre le diesel et l’essence sera-t-elle étalée sur cinq ans ou sur deux ans ? Dans ce dernier cas, le secteur automobile ne sera plus compétitif.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains.
Madame la députée, un mot tout d’abord pour souligner le redressement de la filière automobile, qui est un élément très important.
Ce n’est pas grâce à vous ! Dites merci à Sarkozy !
Et, à ceux qui parfois s’interrogent sur le rôle de l’État dans le domaine industriel, je crois important de rappeler que c’est grâce à l’engagement en faveur de PSA comme de Renault que ce redressement a eu lieu.
Sur le point plus spécifique que vous avez évoqué, madame la députée, je veux rappeler combien la convergence de la fiscalité entre le diesel et l’essence est importante.
Un amendement a été déposé par Mme Delphine Batho, que la commission des finances a repris. Il prévoit un alignement sur cinq ans, mesure que le Gouvernement soutient : à votre question très précise je réponds ainsi très précisément.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.
Cette décision à venir comprend non seulement un enjeu environnemental mais également un enjeu industriel, puisqu’elle permettra aux constructeurs de s’adapter à l’évolution de la motorisation diesel sans subir une dédieselisation trop importante qui pourrait venir perturber leur production.
Elle évitera également aux constructeurs français de reculer au profit des constructeurs étrangers qui, parce qu’ils produisent des modèles hybrides ou à bas coût, pourraient bénéficier de cette opération. Madame la députée, pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à l’amendement proposant un alignement sur cinq ans de cette fiscalité.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à Mme Sophie Errante, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, ma question concerne l’AECG – accord économique et commercial global – avec le Canada, en anglais CETA.
Nous vous connaissons pour votre engagement clair en faveur d’accords commerciaux gagnant-gagnant, qui a d’ailleurs débouché sur votre souhait d’un arrêt des négociations sur le TAFTA avec les États-Unis. Les arguments que vous avez employés dans vos réponses au cours de vos auditions devant la commission des affaires économiques nous ont convaincus que la France et l’Europe pouvaient valoriser un tel accord.
On oublie souvent que le Canada est un pays avec lequel nous commerçons et entretenons une histoire : 75 % des 10 000 entreprises qui exportent vers le Canada sont des PME. Seuls 64 % des exportations françaises entrent au Canada sans droits de douane aujourd’hui, alors que 97 % de celles-ci pourraient être concernées après l’accord. Plusieurs secteurs pourraient plus particulièrement en bénéficier : les vins et spiritueux, le textile et l’habillement, les cosmétiques et les produits agricoles transformés.
Soucieuse d’avoir une vision d’avenir au moment où la position de la Belgique pourrait remettre en cause la poursuite de ces négociations, je souhaite savoir comment on peut faire en sorte que notre commerce extérieur soit porteur d’opportunités plutôt que de craintes et comment on peut protéger nos savoir-faire, mais aussi les consommateurs.
Lorsque, dans nos territoires, les agriculteurs et les citoyens nous interrogent, leurs préoccupations concernent souvent l’information sur l’origine des produits, la traçabilité des modes de production et le respect de l’environnement. Si le commerce international est une chance pour notre pays et pour l’Europe, il doit être équilibré, transparent et réciproque.
Monsieur le secrétaire d’État, quelles positions avez-vous défendues pour que ces priorités soient respectées ?
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger.
Madame la députée, je vous remercie de vos propos. Vous l’avez rappelé, le commerce extérieur peut, lorsque les choses sont bien faites, représenter une réelle opportunité pour notre pays. S’il y a aujourd’hui autant d’inquiétudes, c’est parce que nous arrivons au terme d’une période où beaucoup de choses ont été faites dans le laisser-aller et dans la suppression des règles. On a besoin aujourd’hui, dans la mondialisation, d’un retour des règles, d’un retour de la puissance publique et d’un retour de la capacité pour les choix démocratiques de s’imposer.
C’est aussi cela qui se joue en Wallonie et nous comprenons parfaitement les inquiétudes qui s’y font jour : elles sont dues aux trente années de dérégulation que nous avons connues. Depuis ma nomination, j’ai porté un grand nombre de ces préoccupations au niveau international. S’agissant du TAFTA, nous avons encore demandé la fin des négociations au Conseil européen de Bratislava et nous continuerons de le faire.
Lorsque j’ai été nommé, les discussions sur le CETA étaient terminées. Malgré cela, la France, avec d’autres pays européens, a obtenu de grands progrès, notamment le remplacement de l’arbitrage par une cour de justice commerciale internationale. C’est la première fois qu’un État important a accepté une telle disposition. Cette avancée a été possible après la victoire du Premier ministre Trudeau aux élections, car une telle décision était inenvisageable pour le gouvernement conservateur en place auparavant.
Une déclaration est également en cours de négociation entre l’Union européenne et le Canada pour graver dans le marbre différents principes : le principe de précaution, l’accord de Paris – auquel la France a demandé qu’il soit fait référence, parce qu’il a été négocié avant le CETA et qu’il s’agit de montrer que ce dernier est évolutif et qu’il prend en compte les préoccupations environnementales –, le respect des services publics et l’idée que la coopération réglementaire ne peut en aucun cas s’imposer aux États.
Les lignes sont en train de bouger, en Europe et dans le monde, grâce à l’action menée par la France de concert avec ses partenaires européens. La question que pose le CETA est la suivante : voulons-nous être du côté du statu quo et garder l’arbitrage et le laisser-aller, ou bien essayer de conclure des accords d’un nouveau type, qui commence aujourd’hui à émerger ?
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur le Premier ministre, à l’instar du chef de l’État, qui préfère confier ses pensées profondes et ses choix stratégiques à des journalistes plutôt qu’à son propre gouvernement, vous semblez préférer les annonces médiatiques aux débats de cet hémicycle et donc à l’exercice de la démocratie.
Dans un courrier au sujet de la situation internationale et du démantèlement de la « jungle » de Calais, je vous demandais de bien vouloir m’éclairer sur plusieurs points : sur votre vision des raisons qui conduisent des milliers de malheureux à s’échouer au mieux sur nos côtes, au pire dans les eaux meurtrières de la Méditerranée ; sur la réponse qu’apporte ou n’apporte pas l’Europe à l’arrivée de ces populations sur son sol, aucun dispositif d’accueil digne de ce nom n’étant prévu ; sur les modalités du démantèlement du centre d’accueil de Calais ; sur votre décision unilatérale d’organiser – je cite M. le ministre de l’intérieur – « l’accueil de migrants dans les départements sur l’ensemble du territoire » puisqu’il s’agit d’une « exigence de solidarité nationale et de respect de la dignité humaine ».

Je le dis haut et fort, et je n’accepterai pas que vous donniez à penser qu’il en est autrement : en posant ces questions, nous ne sommes ni insensibles au drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux, ni racistes, ni désireux de voir cette misère concentrée ailleurs. Nous sommes simplement des élus de la nation qui exigent d’être informés de ces problèmes majeurs de notre pays, des élus et habitants de territoires inquiets à juste titre, des Français horrifiés par la montée inexorable de sentiments de rejet et de haine suscités par l’absence totale de concertation pour laquelle vous avez opté sur ce sujet.
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Je vous réitère donc mes questions. Quand organiserez-vous dans cet hémicycle un vrai débat sur la question des migrants ? Quand considérerez-vous enfin que, si effort national il doit y avoir, les territoires de France ne peuvent pas être les otages passifs de vos atermoiements ?
Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.
Monsieur le député, personne n’a dit que vous ou vos collègues étiez insensibles, et encore moins racistes. Le sujet n’est pas là.
Protestations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

S’il vous plaît, mes chers collègues ! Écoutez la réponse du Premier ministre !
Monsieur Viala, comme parlementaire et comme élu local, vous avez posé des questions tout à fait légitimes. De quoi s’agit-il ? Oui, un drame se joue à nos frontières, à quelques heures d’avion de notre pays. Des migrants viennent de la corne de l’Afrique ou du reste du continent et meurent en Méditerranée – même si beaucoup sont sauvés, il faut le dire, grâce à l’action des ONG, de l’Union européenne et de la France. Il y a aussi bien sûr, nous y reviendrons tout à l’heure, le drame des réfugiés lié à la guerre en Irak et surtout en Syrie, qui jette sur les routes des millions de déplacés.
Face à cela, comme je l’ai déjà dit en début de séance, l’Europe doit apporter une réponse bien plus forte. Nous savons que la résolution de cette crise passe d’abord par la diplomatie, mais aussi par l’action militaire, nous y reviendrons.
Il faut commencer par aider les pays qui accueillent les réfugiés.
Je pense à l’Italie et, bien sûr, à la Grèce. Il faut aussi mieux organiser les frontières extérieures de l’Union européenne.
Pour notre part, nous n’avons jamais dit que nous accueillerions tous les réfugiés, tous les migrants – l’Allemagne, par exemple, a fait un choix différent –, mais nous avons assuré que nous assumerions nos responsabilités dans le cadre du plan européen de relocalisation de 180 000 réfugiés : nous prendrons notre part en accueillant 30 000 personnes sur deux ans.
En outre, nous assumons nos propres responsabilités à Calais. Parlons-nous de 1,5 million, de 1 million, de 500 000 ou de 100 000 réfugiés ? Non, les réfugiés se trouvant à Calais sont au nombre de quelques milliers – 5 000 à 7 000 personnes –, dont la plupart, sans doute 80 % d’entre eux, obtiendront le droit d’asile dans notre pays.
Comment s’organiser ? Bernard Cazeneuve a eu l’occasion de le rappeler hier : par une relocalisation des réfugiés sur l’ensemble du territoire.
Eh bien ! Il est quand même assez extraordinaire que ceux qui nous parlent de l’autorité de l’État se fassent les chantres de la démocratie participative, un peu partout dans leurs départements, quand l’État assume ses responsabilités en matière d’accueil !
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain et sur plusieurs bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Je vous le dis calmement, monsieur Goasguen, même si je sais que vous avez joué un rôle de modération dans cette affaire : honnêtement, ce que nous avons vu dans le 16e arrondissement à propos de l’accueil des SDF n’a pas donné une très belle image de ce que peut être l’accueil de ceux qui ont besoin de notre solidarité.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Attendez d’avoir les résultats de l’enquête ! Vous n’allez pas être déçu !
Monsieur Goasguen, cela ne sert à rien de brandir ce doigt menaçant. Vous ne m’impressionnez pas.
Nous assumons donc nos responsabilités, en faisant en sorte que 6 000 à 8 000 personnes – des hommes, des femmes, des familles, des enfants – puissent être accueillis dans les meilleures conditions avant de savoir s’ils ont droit ou non à l’asile, ce qui sera probablement le cas de 80 % d’entre eux.
Il y a quelques jours, à Épernay, j’ai vu ce que nous pouvons faire : au sein d’une petite unité, des opérateurs, des associations, des professionnels et des bénévoles font tout pour que le droit d’asile soit octroyé dans les meilleures conditions et préparent l’intégration des bénéficiaires,…

Cela représente 100 000 personnes par an pour un coût de 3 milliards d’euros !
…qu’il s’agisse de leur intégration sociale, de l’apprentissage du français ou du respect de nos valeurs. Ceux qui n’ont pas droit à l’asile devront être reconduits à nos frontières.
Voilà ce que fait la France. J’étais interrogé tout à l’heure sur la place de la France en Europe et dans le monde : assumer nos responsabilités et nos valeurs avec maîtrise, responsabilité et sérieux, c’est cela, la France !
Ainsi, nous pourrions avancer ensemble. À Épernay, on m’a rappelé qu’un ancien maire de la ville, Bernard Stasi, donnait une belle image…
…de ce que pouvaient être la générosité et la droite françaises.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain. – Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.

La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur le ministre de l’économie et des finances, le premier grand appel pour une taxation des transactions financières date de 1997 : c’était il y aura bientôt vingt ans. Cet appel fondateur d’ATTAC reprenait l’idée déjà ancienne d’un économiste qui n’avait rien d’un négationniste économique : le prix Nobel James Tobin. Cet appel, qui a vingt ans, est toujours d’actualité et, depuis 2012, tous les ans, on nous annonce la taxe sur les transactions financières pour l’année suivante…
Il y a quelques jours, à Luxembourg, en marge de l’Eurogroupe, les ministres des États volontaires pour mettre en place, dans le cadre d’une coopération renforcée, une taxe européenne sur les transactions financières ont tenu une réunion importante et constructive. Dans une Europe qui nous habitue au pire, c’est une bonne nouvelle, même si le processus est extrêmement lent. La Commission européenne est missionnée afin de préparer un projet ; pour s’assurer que Goldman Sachs ne tienne pas le stylo, il vaudrait mieux que les États le rédigent eux-mêmes…

La base de cette taxe serait large, puisqu’elle inclurait les produits dérivés, mais ni son taux ni son affectation ne sont connus. J’aimerais que le Gouvernement nous éclaire sur les conclusions de cette réunion et la suite des événements.
La réunion de Luxembourg est aussi rassurante parce que, depuis le vote du Brexit, les discours sur la main tendue aux traders de la City prolifèrent, y compris à gauche. Les financiers sont peut-être les bienvenus mais leur accueil n’est ni une priorité ni un motif de cadeaux.
D’ailleurs, cette perspective européenne très tardive ne doit pas nous interdire de prendre des initiatives nationales. Plusieurs amendements parlementaires sont en débat dans la discussion budgétaire…

Vous êtes arrivé au terme de votre temps de parole, mon cher collègue.
La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances.
Monsieur Laurent, je partage votre conviction comme votre impatience.
Votre conviction, partagée très largement, bien entendu, par la majorité, est aussi celle qu’a exprimée très clairement le Président de la République : à une époque marquée par la mondialisation, nous avons besoin d’une taxe sur les transactions financières qui soit la plus large possible, qui sélectionne les bons mouvements, c’est-à-dire les mouvements purement spéculatifs, afin de les éviter ou de les renchérir, tout en rapportant les millions d’euros nécessaires, par exemple, à l’aide au développement, que nous devons toujours augmenter.
Je partage aussi votre impatience car je participe aux débats au niveau européen, bon niveau pour mettre en place une taxe sur les transactions financières. Vous l’avez dit, cela fait des mois et des mois, des années et des années, que nous travaillons sur ce sujet au niveau européen.
Mais, le 10 octobre dernier, à Luxembourg, un pas extrêmement important a en effet été franchi. Les dix pays qui travaillent ensemble, dans le cadre d’une coopération renforcée, pour créer cette taxe sur les transactions financières se sont explicitement mis d’accord sur les principes.
Le principe le plus important concerne l’assiette de la taxe : elle sera large. À un moment donné, il était envisagé de ne taxer que les actions, mais on le fait déjà, y compris en France.
On nous demandait aussi d’éviter de taxer tel ou tel produit. Eh bien non, l’assiette sera extrêmement large.
Nous devrons aussi travailler, bien sûr, sur le taux et l’affectation de cette taxe.
Le plus difficile était de se mettre d’accord sur les principes, notamment sur l’assiette de la taxe. Cet accord politique, conclu par les dix pays, est aujourd’hui acquis. J’ai craint, à un moment donné, qu’un ou deux États ne quittent la coopération renforcée et que nous perdions alors la capacité de créer cette taxe au niveau européen. Mais elle sera bien créée, nous y travaillons. La Commission européenne nous soumettra des propositions extrêmement précises, juridiquement opérationnelles, d’ici à la fin de cette année.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à Mme Bérengère Poletti, pour le groupe Les Républicains.

Monsieur le Premier ministre, l’agriculture française était leader en Europe. Nous avons désormais reculé à la troisième place pour les exportations européennes. La compétitivité de notre agriculture est très faible comparée à celle de nos voisins. Nos agriculteurs meurent en silence, parce qu’à l’inverse de ce qui se passe dans les autres pays d’Europe, les charges pèsent lourdement sur eux ; les contraintes sanitaires, environnementales et économiques qu’on leur impose sont plus lourdes. Près de la moitié de nos éleveurs est dans le rouge.
Dans ce contexte déjà très difficile, un projet d’arrêté interministériel envisagerait de durcir drastiquement les règles d’utilisation des produits phytosanitaires. Il serait question d’élargir le périmètre des zones non traitées. Celles-ci incluraient les abords des fossés, des forêts, des bosquets, des landes et les zones non cultivées adjacentes, au lieu de se limiter aux abords des cours d’eau.

C’est vrai, il faut diminuer l’usage des produits phytosanitaires ; mais ce qui se trame serait redoutable pour l’agriculture française, et d’une grande brutalité. En effet, 4 millions d’hectares seraient touchés, avec pour conséquence une perte de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. Rien que dans les Ardennes, cela ferait perdre 15 % à 20 % de terres cultivables, et ce sans aucun dédommagement.
Dans aucun pays d’Europe les gouvernements n’imposent cela à leurs agriculteurs.

Les mesures agro-environnementales et climatiques sont un outil intéressant, incitatif et pédagogique pour aboutir à la transition écologique, laquelle est effectivement nécessaire. Cependant, tous les agriculteurs n’y ont pas accès. Les aides au titre des MAE – les mesures agro-environnementales – de 2016 n’ont d’ailleurs pas été intégralement versées.
Monsieur le Premier ministre, ce sujet agricole, environnemental et sanitaire fait actuellement l’objet de réunions ministérielles. Quand permettrez-vous à nos agriculteurs de travailler dans les mêmes conditions que leurs collègues européens ?
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains et sur quelques bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Madame la députée, vous dressez un tableau très sombre. Je voudrais vous rappeler que la baisse la plus forte de la place de la France dans les exportations agricoles et agroalimentaires se situe entre 2008 et 2012.
Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.
Depuis un an, nous avons redressé la situation : les exportations ont augmenté et la balance commerciale s’est améliorée.
Mêmes mouvements.
Que les choses soient claires : lorsque nous sommes arrivés, les baisses de charges représentaient environ 750 millions d’euros pour les agriculteurs,…
…contre 1,8 milliard aujourd’hui.
Vous me parlez de baisses des charges, je vous donne des chiffres – les vôtres et les nôtres. Il faut être honnête.
Nouvelles exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.
Si j’en crois ce qui a été dit lors du débat de vos primaires, je veux prévenir les agriculteurs qu’avec les 100 ou 150 milliards d’euros de dépenses publiques en moins que vous prévoyez, ils risquent de ne plus bénéficier des déductions de cotisations si jamais – mais cela n’arrivera pas – vous gagniez la présidentielle.

Il faudrait indemniser les agriculteurs pour leur avoir donné un ministre pareil !
S’agissant de ce fameux arrêté, que puis-je vous dire,…
…sinon qu’il n’existe pas. Vous faites une description apocalyptique de ce qui se passerait s’il existait. Qui vous l’a procuré ? Il n’existe pas, et la preuve en est que je n’ai rien signé.
Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains et du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.
Je suis suffisamment bien informé pour savoir que l’on engage parfois le débat sur un texte en cours de discussion mais, en l’occurrence, cet arrêté n’existe pas.
« Ah ? » sur les bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.
L’objectif est clair : il faudra appliquer les lignes directrices européennes qui sont en vigueur depuis le mois de janvier 2016.
Vous siégez à la commission des affaires sociales, madame la députée, où vous vous occupez des problèmes de santé. Eh bien, on doit tenir compte de la santé de nos concitoyens. Mais il faut également tenir compte des règles environnementales. Enfin, il faut permettre aux agriculteurs de travailler dans de bonnes conditions. Pour ma part, j’ai toujours été sur cette ligne – cela n’a pas toujours été le cas pour d’autres.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à M. Jean-Luc Bleunven, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

Je souhaite interroger M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes sur l’aide apportée par l’Union européenne au développement des territoires.
Montagneuses, isolées, maritimes… l’Union européenne se compose de très nombreuses régions au profil et au niveau de développement bien distincts. Pour certains territoires, dans un contexte de crises multiples et face aux réalités de la mondialisation, le développement reste un défi malgré les efforts mis en oeuvre depuis des années. Nos concitoyens ont souvent l’image d’une Europe qui reste sourde aux demandes de nos régions les plus fragiles, d’une Commission européenne sans accroches locales. Depuis des dizaines d’années, l’Union européenne poursuit l’ambition de créer un ensemble plus dynamique et moins inégal, mais nous sommes encore loin de la réalité.
Ma question concerne donc plus précisément l’avenir de l’arc Atlantique. En Bretagne, les investissements européens sont très visibles. Cette région dispose d’une enveloppe du Fonds européen de développement régional de 307 millions d’euros au titre de la programmation 2014-2020. Au sein de ma circonscription, grâce à l’investissement territorial intégré, Brest métropole bénéficie d’une aide de 10 millions d’euros pour faire émerger et accompagner des projets sur le territoire. Le téléphérique urbain est l’une des initiatives innovantes rendues possibles grâce à l’aide de l’Union européenne. Les investissements de la région dans le port de Brest témoignent également d’une volonté de nous raccrocher à nos voisins par la mer. Il existe de ce point de vue de nombreuses opportunités de développement avec nos pays voisins maritimes.
L’Arc atlantique promeut une coopération plus ambitieuse, dans un contexte européen de plus en plus incertain. Les régions atlantiques partagent un littoral attractif qui offre une haute qualité de vie, mais surtout un haut potentiel pour les filières innovantes. En s’ancrant dans l’autoroute de la mer reliant les ports de Liverpool, Brest et Leixões ou encore en étudiant la possibilité de bénéficier de la production électrique de l’Irlande, la Bretagne a pris conscience de ses opportunités en termes d’aménagement du territoire et de développement énergétique. Cependant, le référendum britannique de juin dernier pourrait remettre en cause cette coopération.
Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous éclairer sur l’impact du Brexit sur les coopérations au sein de l’Arc atlantique ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Monsieur le député, vous évoquez le rôle des financements européens dans votre région, la Bretagne. J’ai moi-même pu constater au cours d’un déplacement à Brest l’an dernier, où vous étiez du reste présent, la contribution des fonds européens au projet d’aménagement du plateau des Capucins, du port de Brest, ou encore du nouveau téléphérique urbain – vous venez de le rappeler.
Comme vous le soulignez, la contribution des fonds européens à l’investissement dans nos territoires est malheureusement trop souvent méconnue. Ce sont pourtant 26 milliards d’euros qui seront mobilisés au cours de la période 2014-2020 au titre des fonds européens structurels et d’investissement, en partenariat avec les régions françaises.
Vous m’interrogez plus particulièrement sur l’avenir de l’Arc atlantique, dans le contexte du Brexit. Depuis plus de vingt-cinq ans, l’Arc atlantique est l’une des coopérations interrégionales européennes les plus dynamiques. Il mobilise des acteurs territoriaux qui vont de l’Écosse à l’Andalousie, en passant par la Bretagne et d’autres régions françaises.
La décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne ne doit pas affecter la vitalité de cette coopération. D’abord, parce qu’après le déclenchement de l’article 50, qui interviendra au plus tard en mars 2017, une période de négociation de deux ans va s’engager s’agissant des conditions de sortie du Royaume-Uni, mais aussi des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Ensuite, parce que la participation de régions de pays tiers – ce que deviendra le Royaume-Uni après sa sortie – est d’ores et déjà prévue dans la réglementation relative aux coopérations territoriales européennes. Ces coopérations pourront donc continuer si tel est le choix des deux parties et elles se poursuivront dans le cadre futur des rapports entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
L’élan et le travail remarquables engagés par les acteurs locaux doivent être poursuivis parce que c’est l’intérêt de nos territoires, de nos concitoyens et des projets auxquels la Bretagne participe.

La parole est à M. François Rochebloine, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Monsieur le Premier ministre, le piège turc est en train de se refermer sur l’Europe. Le président Erdogan, à qui l’Union européenne a confié la gestion de ses frontières et le contrôle des arrivées des migrants, demande aujourd’hui des comptes. « On est arrivé à la fin du jeu », déclare-t-il, sommant ainsi les Européens de se prononcer, une bonne fois pour toutes, sur l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.
Le Président de la République et vous-même n’avez plus le choix : vous devez maintenant sortir de l’ambiguïté dans laquelle vous vous êtes confortablement réfugiés depuis la crise migratoire. Vous devez aujourd’hui répondre de cet accord inacceptable passé avec la Turquie et de ses conséquences, ce que vous avez refusé de faire lorsque nous vous avons demandé d’en débattre ici, à l’Assemblée nationale.
Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, exempter les ressortissants turcs de visas ? Allez-vous, oui ou non, verser à la Turquie l’aide financière prévue par l’accord ? L’absence de réponse claire de votre part signifierait que la France, jusqu’ici hésitante et inaudible, aurait définitivement renoncé à porter l’idée d’une politique européenne commune de gestion des flux migratoires.
Mais surtout, monsieur le Premier ministre, allez-vous avoir enfin le courage de faire entendre la voix de la France en Europe en disant non, de manière ferme et définitive, à l’adhésion de la Turquie ? L’esprit de responsabilité exige de ne pas donner de faux espoirs à la Turquie. J’espère, monsieur le Premier ministre, que vous m’apporterez vous-même une réponse.
Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et sur quelques bancs du groupe Les Républicains.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Protestations sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains et du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Mes chers collègues, le Premier ministre ne peut pas répondre à toutes les questions !
Vous avez la parole, monsieur le secrétaire d’État.
Monsieur Rochebloine, je m’efforcerai tout de même de vous répondre. Le Premier ministre s’est du reste déjà exprimé tout à l’heure à propos des relations avec la Turquie.
Votre question porte plus particulièrement sur l’impact de l’accord conclu entre l’Union européenne et la Turquie, le 18 mars, à propos de la crise migratoire.
Je noterai d’abord que cet accord a permis de réduire significativement les flux de migrants en Méditerranée orientale, avec une diminution du nombre des naufrages, et donc des morts, dans cette partie de la Méditerranée.
Je vais vous répondre très précisément. Ces derniers mois, le nombre des arrivées en Grèce a légèrement augmenté, mais on en est toujours à une centaine d’arrivées par jour, ce qui est sans commune mesure avec les 2 000 à 3 000 arrivées quotidiennes constatées dans les îles grecques avant cet accord. La bonne mise en oeuvre de celui-ci reste donc essentielle pour éviter que ne se répète la situation de 2015, avec tous les drames humains qui l’ont accompagnée.
La Turquie et l’Union européenne doivent donc tenir leurs engagements dans le cadre de cet accord.
Vous m’avez par ailleurs interrogé sur la contribution financière. Oui, l’Union européenne continue à mobiliser des fonds pour venir en aide aux réfugiés syriens installés en Turquie. Nous devons également veiller à ce que de nouvelles routes d’immigration illégale ne soient pas ouvertes.
Pour ce qui concerne les visas,…
…soixante-douze critères ont été fixés, dont la modification d’une loi sur le terrorisme. Il appartient désormais aux autorités turques de progresser dans la mise en oeuvre de ces critères.
Parallèlement, la France demande, avec l’Allemagne, une révision du mécanisme de suspension du régime sans visas entre l’Union européenne et un pays tiers, en vue de le rendre plus efficace et plus rapidement activable.
Il n’y aura donc pas de libéralisation des visas si les critères ne sont pas remplis.
Pour ce qui est de l’adhésion, très peu de chapitres de négociation ont été ouverts et, de toute façon, cela ne préjuge en rien d’une adhésion future de la Turquie à l’Union européenne.

Madame la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l’augmentation ininterrompue des chiffres du chômage depuis le début de ce quinquennat s’est encore aggravée au mois d’août. Plus de 750 000 jeunes restent sans emploi ni formation, chiffre bien supérieur à la moyenne européenne.
Dans notre pays, le taux de chômage des 15-24 ans excède largement ceux de l’Allemagne, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, ces pays « ont fait le choix de l’association des études et du travail en encourageant le développement de l’apprentissage ». L’Allemagne et le Royaume-Uni ont mené, depuis 2009, une réforme de l’apprentissage de grande ampleur, en intégrant les principes fondamentaux de performance et d’autonomie. Les résultats sont là : dans ces pays, le chômage diminue.
Pour ce qui vous concerne, vous avez fait le choix, dès le début du quinquennat, de privilégier la montée en puissance des emplois d’avenir :10 milliards d’euros y ont été consacrés, au détriment de l’apprentissage, qui constitue pourtant une véritable insertion vers l’emploi.
Dans un rapport du mois d’octobre, la Cour des comptes dénonce un enchevêtrement de dispositifs qui concernent majoritairement le secteur non-marchand et génèrent des dépenses publiques sans créer d’activité. Les formations liées à ce type de contrats ne sont pas suivies car elles ne fournissent aucune qualification. C’est ce que nous n’avons cessé de dénoncer depuis le début du quinquennat.
Malgré les conclusions de ce rapport, vous persistez, alors que la Cour des comptes demande de redéployer les crédits vers des dispositifs d’accompagnements plus efficaces, comme l’apprentissage.
Madame la ministre, allez-vous suivre les conclusions de ce rapport et prendre exemple sur les autres pays européens ?
Applaudissements sur quelques bancs du groupe Les Républicains.

La parole est à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Monsieur Lurton, je ne commencerai pas par une bataille de chiffres. Notre pays se situe en effet dans la moyenne haute, en Europe, pour ce qui est du chômage des jeunes, mais mon appréciation diffère de la vôtre : le niveau est pratiquement stable par rapport à mai 2012.
Protestations sur les bancs du groupe Les Républicains.
Il est vrai toutefois que nous nous situons dans une moyenne haute.
La question est, en réalité, de savoir ce que nous avons mis en oeuvre. Il est clair que nous avons travaillé sur l’orientation scolaire, en vue notamment de lutter contre les sorties du système scolaire sans qualification. Le nombre de jeunes désignés comme « NEET » – Not in Education, Employment or Training – est ainsi passé de 150 000 à 110 000 par an. C’est là un point essentiel, sur lequel nous travaillons avec la ministre de l’éducation nationale.
Deuxième aspect : la formation. Il faut porter un regard critique sur notre pays dans ce domaine car l’accès à un niveau de qualification est évidemment porteur, par la suite, sur le marché de l’emploi. Ainsi, 25 % des formations proposées dans le cadre du plan « 500 000 formations supplémentaires », que nous mettons en oeuvre avec les présidents de région et que nous promouvons avec Clotilde Valter et les partenaires sociaux, sont destinées aux jeunes.
Une autre donnée n’a malheureusement pas été prise en compte dans le rapport de la Cour des comptes : comme le montre un rapport de la DARES – direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques – publié le 5 octobre dernier, trois jeunes sur quatre en emploi d’avenir ont bénéficié d’une formation, et la moitié d’entre eux ont bénéficié d’une formation certifiante, ce qui est, bien sûr, essentiel.
Il convient enfin de citer la garantie jeunes.
La loi travail contient deux mesures spécifiques : l’obligation de publier les taux d’insertion des voies de formation, élément important pour l’orientation ; la valorisation de l’apprentissage, qui s’est déjà traduite par une augmentation de 5 % des entrées dans cette filière. Nous continuons donc dans la voie tracée.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à M. Thierry Benoit, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous interroger, au nom du groupe UDI, sur le CETA, traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada qui sera signé la semaine prochaine à Bruxelles. Malheureusement, de nombreuses réserves demeurent sur ce texte, sur la méthode employée et, surtout, sur l’ordre des priorités.
Sur le fond, le porte-parole du Gouvernement répète que ce texte offre des garanties. Pourtant, ce traité risque de déstabiliser de nombreuses filières agricoles en multipliant par dix les importations de viande bovine en Europe. Nos normes sociales et environnementales pourraient aussi être bradées par le CETA, lequel serait, de l’aveu même de Nicolas Hulot, incompatible avec l’accord de Paris sur le climat.

Sur le calendrier, nous avons une nouvelle fois sacrifié l’essentiel à l’accessoire. Le Gouvernement français comme la Commission européenne se sont trompés de priorités. La priorité, c’était l’achèvement du marché unique ; c’était l’harmonisation des normes, non pas avec des pays tiers mais ici, en Europe, et surtout maintenant. La priorité, c’était la réforme de la PAC en dotant enfin l’Europe d’un mécanisme de sécurisation des marges et des revenus agricoles. La priorité, ce n’était pas de signer un nouveau traité international mais de consolider l’Union européenne pour affronter la compétition mondiale. Sur tous ces dossiers, la France reste encore bien inaudible et inefficace – je le regrette.
Enfin, concernant la méthode, l’opacité demeure. J’interroge donc le Gouvernement : estimez-vous que le CETA était la priorité ? Trouvez-vous légitime que cet accord entre en vigueur dès 2017, avant même sa ratification par les parlements nationaux ?
Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger.
Monsieur le député, nous entendons parfaitement les inquiétudes qui s’expriment dans nos campagnes. Je suis moi-même élu d’un département, le Lot-et-Garonne, qui compte plus de soixante-dix productions agricoles différentes, et nous savons les difficultés que rencontrent les agriculteurs.
Mais nous savons aussi que notre agriculture, dans bien des domaines, est exportatrice et a besoin d’une politique commerciale lui permettant de conquérir de nouveaux marchés. Nombre de filières nous demandent d’ailleurs d’obtenir l’ouverture de certains marchés, à condition bien sûr que les accords soient bien négociés. La « diplomatie des terroirs » que nous menons dans le cadre de la diplomatie économique est précisément destinée à ce que l’agriculture et l’agroalimentaire – il s’agit, n’en déplaise à certains, du deuxième excédent commercial français – continuent à exister dans le monde et à travailler.
Ainsi, lorsque les accords sont mauvais, nous les dénonçons, mais nous ne sommes pas favorables à la position selon laquelle la France dirait non à tout sans examiner le fond. Lorsque les accords sont mauvais, nous disons non, mais lorsqu’ils sont globalement positifs, nous disons oui.
Des progrès ont été obtenus. La France a demandé, et je m’y étais engagé devant vous, que les parlements nationaux aient le dernier mot : c’est aujourd’hui garanti. Même l’application provisoire de tout ce qui relève du niveau européen serait remise en cause si vous, mesdames et messieurs les députés, décidiez de dire non.
En ce qui concerne l’agriculture, l’accord reconnaît quarante-deux indications géographiques françaises ; en outre, le mécanisme de l’article 20.22 permet d’ajouter des indications géographiques si l’on constate des problèmes.
S’agissant des quotas globaux, il est vrai que le degré de quotas octroyés est élevé mais nous sommes attentifs, au sein de l’Union européenne, à ce que les quotas globaux, négociation par négociation, ne dépassent pas un certain seuil. Il faudra d’ailleurs les revoir du fait du Brexit, afin de prendre en compte la nouvelle situation dans laquelle se trouve l’Europe agricole après la sortie du Royaume-Uni.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur le ministre de la défense, un grand quotidien national titrait ce week-end : « Nous bombardons Daech en Irak et en Syrie, mais nous sommes incapables de contrôler nos banlieues ». Au-delà de la question de l’opportunité, est-il raisonnable, voire efficace, de se lancer dans des offensives comme à Mossoul, lorsque nous sommes incapables d’assurer la sécurité sur notre territoire ?
« Oh ! » sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Il faut bien sûr combattre Daech par tous les moyens, mais nous savons pertinemment que ce n’est pas la France qui libérera Mossoul.
Monsieur le ministre, les renforts venus de Mossoul ne risquent-ils pas de relancer, depuis la Syrie, la campagne d’Europe, au coeur de la stratégie transnationale de Daech ? Vous le savez bien : ce n’est pas vraiment en Irak que le terrorisme se développe : c’est à partir de la Syrie que le djihadisme prolifère. C’est en Syrie qu’il doit être terrassé avant qu’il ne soit trop tard.
Monsieur le ministre, nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre le prochain attentat ni de défiler en condamnant le terrorisme. Selon les experts, la bataille de Mossoul sera longue, l’issue en sera incertaine et le drame humain qui s’ensuivra risque de créer d’autres difficultés dont nous n’imaginons pas encore les conséquences.
Notre priorité, au-delà du symbole de notre présence aux côtés des vainqueurs potentiels de Mossoul, doit être de protéger notre territoire. Quand on fait la guerre, on doit en assumer les conséquences. Si les djihadistes ne se posent pas cette question, nous devons, nous, être garants de la sécurité de nos concitoyens. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer sur ce point ?
Applaudissements sur quelques bancs du groupe Les Républicains.
Monsieur le député, le Premier ministre irakien, M. Haïdar Al-Abadi, a décidé il y a deux jours le lancement de l’offensive contre la capitale de Daech, Mossoul. Car cette ville est bien la capitale de Daech et donc le lieu où ont été fomentés, décidés et organisés les attentats commis en France. Mossoul est la capitale de notre ennemi.
Nous appuyons donc les forces irakiennes et les forces peshmergas dans leur détermination à reconquérir Mossoul. C’est une question de sécurité pour notre territoire, raison pour laquelle nous sommes actifs et déterminés à les accompagner jusqu’à l’éradication de Daech dans ce territoire. Il est vrai que cela ne règle pas tout, mais il faut d’abord éliminer le centre pour pouvoir ensuite s’attaquer aux métastases.
Cette bataille sera longue, pour trois raisons : d’abord, parce que c’est la capitale de Daech et qu’ils se sont organisés en lignes de défense rigoureuses, en creusant des souterrains et en piégeant les entrées de la ville ; ensuite, parce que la population y est importante – 1,5 million d’habitants – ; enfin, parce que nous avons des règles d’engagement extrêmement précises pour éviter les dégâts collatéraux, et ces règles seront scrupuleusement respectées pendant toute la bataille.
Par ailleurs, nous avons mis les moyens nécessaires pour assurer les conditions humanitaires minimales : 750 000 places pour les réfugiés sont prévues aux alentours de Mossoul.
Monsieur le député, la bataille contre le terrorisme commence là-bas.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Nous avons terminé les questions au Gouvernement sur des sujets européens.
La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt.

L’ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement sur les opérations extérieures de la France, suivi d’un débat, en application de l’article 50-1 de la Constitution.
La parole est à M. le Premier ministre.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées, monsieur le ministre de la défense, monsieur le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les députés, dans un monde marqué par l’instabilité, les menaces, la France, parce qu’elle est une grande puissance, assume ses responsabilités, notamment militaires, en engageant ses forces armées.
Alors que je prends la parole devant vous, je veux d’abord exprimer en notre nom à tous la gratitude et le respect que nous devons à nos soldats.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.
Sur tous les théâtres d’opérations, au Levant, dans la bande sahélo-saharienne, en Centrafrique, des militaires français sont morts pour le France ces trois dernières années ; d’autres ont été blessés ; certains sont encore sur leur lit de douleur car quand la France répond présent militairement, ce sont nos soldats qui en assument les risques.
Avec le Président de la République, avec Jean-Yves Le Drian, nous mesurons la gravité de ce que nous demandons aux jeunes Français qui s’engagent. Quand la France se bat pour les valeurs démocratiques et universelles, ce sont eux qui sont en première ligne.
En Jordanie, au Niger, au Tchad, au Mali, au Sénégal, j’ai pu, en compagnie du ministre de la défense, leur dire, comme il le fait régulièrement, combien la Nation comptait sur eux, combien elle était fière d’eux et des différentes opérations extérieures qu’ils mènent.
À trois reprises au cours des trois dernières années, votre assemblée a approuvé le déploiement des forces françaises. En avril 2013, par votre vote, vous avez confirmé la décision du chef de l’État de déployer la force Serval au Mali. Après les attaques terroristes de janvier 2015, vous avez également autorisé nos armées à poursuivre leur intervention en Irak contre l’État islamique – une intervention décidée en septembre 2014 par le Président de la République, à la demande du gouvernement irakien, je veux le rappeler. Enfin, en novembre dernier, au lendemain des attentats de Saint-Denis et de Paris, vous avez approuvé l’extension de nos opérations aériennes à la Syrie.
Avec, mesdames et messieurs les députés, à chaque fois le même objectif, à chaque fois la même détermination : combattre les groupes djihadistes qui depuis leurs sanctuaires nous ont déclaré la guerre, une guerre rampante, lâche, sournoise, qui frappe de manière aveugle, là-bas et sur notre sol. La France – elle n’est bien sûr pas la seule – est visée parce qu’elle est la France ! Parce qu’elle incarne aux yeux de monde cette part d’universel !
L’ennemi que nous devons affronter, nous ne le découvrons pas. C’est un ennemi redoutable. Il frappe depuis plusieurs décennies dans le monde arabo-musulman et en Afrique. Il s’est organisé au Levant sous la forme d’un proto-État, capable de mobiliser des ressources financières, de lever une armée de terroristes, d’étendre son emprise barbare.
Il recrute y compris jusqu’au coeur de notre société. Il ne connaît pas de frontières, et encore moins dans le cyberespace, devenu un vaste terrain d’embrigadement, de recrutement et de préparation des attaques.
Nous avons changé d’époque. Notre monde n’a plus le même visage. Depuis le 11 septembre 2001, depuis ce jour terrible que personne n’avait vu venir, la terreur djihadiste s’est diffusée partout, depuis l’Europe jusqu’en Asie. Elle est aujourd’hui, sans aucun doute, le plus grand péril pour nos démocraties.
L’inaction n’est pas une option. Et donc, la France agit. Contre les groupes djihadistes, elle marque des points, elle agit efficacement, et d’abord au Mali.
Au Mali, coude à coude avec l’armée malienne, à la demande des autorités maliennes, à la demande du président intérimaire Traoré, avec le soutien de l’Union africaine et des Nations unies, nous avons empêché le basculement dans le chaos de ce pays avec lequel nous entretenons des liens si privilégiés. La décision audacieuse et courageuse du Président de la République a évité la création d’un bastion djihadiste.
Nous savons que le chemin de la stabilité du pays est encore long. La sécurisation du Nord est lente à intervenir. Le processus de réconciliation nationale tarde à se concrétiser même si des progrès sont intervenus récemment – et nous connaissons l’engagement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous savons cependant que les groupes terroristes continuent de déstabiliser la région du Sahel et portent leurs menaces au-delà. Tous ces groupes qui se financent grâce à des trafics divers et aux filières clandestines de migrants peuvent encore frapper violemment.
La France restera engagée tant que la menace djihadiste continuera de peser sur le destin de ce pays et de cette région car quel message enverrions-nous si nous envisagions un départ ou même une réduction de notre effort ? Nous n’avons pas le droit d’abandonner nos frères africains au moment où précisément ils ont le plus besoin de nous pour consolider des équilibres encore fragiles. Le Président de la République aura l’occasion à Bamako, en janvier prochain, lors du sommet Afrique-France, de redire notre solidarité à l’Afrique.
Mesdames et messieurs les députés, avec l’opération Barkhane – 4 000 hommes déployés au Sahel sur un territoire aussi vaste que le continent européen –, nous voulons empêcher les groupes terroristes de reconstituer un sanctuaire. Nous aidons les forces régionales, celles des pays du G5 Sahel, à remonter en puissance. Tous les jours, nos soldats patrouillent avec leurs camarades africains, au Mali et au Niger en particulier. Nous accompagnons également nos partenaires internationaux – je pense à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies, la MINUSMA, comme à celle de l’Union européenne, l’European Training Mission, l’EUTM Mali.
Au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, les crimes de Boko Haram font planer un risque de déstabilisation qui appelle notre très grande vigilance.
En République Centrafricaine, l’engagement de la France a permis de mettre un terme à des violences qui menaçaient de dégénérer en une guerre civile confessionnelle, avec son cortège d’atrocités. Trois ans après le lancement de l’opération Sangaris dont nous savons qu’elle fut difficile et éprouvante pour nos soldats, et à quelques jours de sa clôture officielle, nous passons le témoin aux Nations unies et à l’Union européenne. Mais nous resterons engagés à leurs côtés pour oeuvrer dans la durée à la stabilité de la RCA.
N’oublions pas l’action de notre marine nationale dans le Golfe de Guinée pour lutter contre la piraterie maritime, cet autre fléau contre lequel la France s’engage.
Je veux le dire avec force ici : sans l’action de la France, une partie du continent africain aurait complètement basculé,…
…comme plusieurs chefs d’État africains l’ont rappelé avec gratitude à Jean-Yves Le Drian, à Lomé, au Togo, en début de semaine.
Nous aurions assisté à des massacres de masse. Nous aurions aujourd’hui un califat au coeur de l’Afrique, de cette Afrique où nous avons tant de nos ressortissants, de cette Afrique où se joue une part du destin de l’Europe, de cette Afrique avec qui nous devons, nous Européens, nous Français, construire un partenariat ambitieux pour la sécurité, pour des migrations contrôlées, pour le développement.
Autre région où nous intervenons : l’Irak et la Syrie. Là-bas, même s’il ne faut pas être naïf, même s’il faut être lucide, Daech recule.
La France est un partenaire majeur de la coalition en Irak, le deuxième en termes de frappes, même si nous savons quelles sont les proportions. Depuis le début de nos opérations, plus de 900 frappes ont été opérées par nos chasseurs, pour l’essentiel en Irak. Nous agissons toujours en conservant notre autonomie d’appréciation sur le choix des cibles.
La bataille de Mossoul, qui vient de s’engager, est un enjeu symbolique bien sûr, mais aussi stratégique. Il faut tout faire pour épargner des souffrances aux populations civiles. Il faut donc organiser l’aide et la France y prendra toute sa part. Il faut aussi réfléchir aux conditions de l’administration de la ville et de sa région après sa libération. C’est l’objet de la réunion ministérielle que la France accueillera demain à Paris, à l’initiative de Jean-Marc Ayrault, et que le Président de la République ouvrira.
Cette bataille sera longue, difficile, certainement très meurtrière, car libérer une ville de deux millions d’habitants, aux mains des djihadistes depuis juin 2014, ne sera pas – passez-moi l’expression – une mince affaire. Les Irakiens sont prêts. Ils ont montré leur détermination et sont engagés depuis de longs mois dans une dynamique de reconquête : Sinjar, Ramadi, Baïji, Falloujah, Qayyarah, toutes ces villes qui étaient aux mains des djihadistes ont été depuis reconquises.
C’était le rôle de la France de répondre, en 2014, à l’appel des Irakiens et de prendre part à une coalition de plus de soixante pays, avec notamment nos alliés du Proche-Orient.
Nous pouvons compter sur le courage de nos militaires de l’opération Chammal. Tous les jours, ils sont engagés dans des opérations aériennes à haut risque, engagés tous les jours pour former et conseiller les forces irakiennes et les Peshmergas. Je veux saluer le courage de ces combattants, femmes et hommes, qui sont pour nous tous les visages du combat pour la liberté.
Au moment où débute la bataille de Mossoul, la France continue d’assumer ses responsabilités, en renforçant notre dispositif en appui des forces irakiennes.
Il y a d’abord le groupe aéronaval déployé en Méditerranée orientale. Il y a également une batterie d’artillerie et 150 hommes déployés au sud de Mossoul avec nos alliés américains. Jean-Yves Le Drian en avait d’ailleurs informé vos commissions le 26 juillet dernier et je veux, devant vous, une nouvelle fois, lui rendre hommage, rendre hommage à son action, à sa détermination, à sa compétence unanimement reconnue par nos armées et par ses pairs.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain, du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.
Mossoul est une première étape, très difficile. Et la tâche ne sera pas achevée. Il faudra ensuite, en Syrie, appuyer les forces insurgées – celles qui combattent à la fois le régime de Bachar el-Assad et Daech ; je pense en particulier aux Kurdes. Il faudra aussi, à condition qu’il y ait une volonté, tenter de reconquérir Raqqa, cette pseudo-capitale de l’État islamique, d’où partent aussi les ordres visant à frapper l’Europe et la France.
Le 25 octobre prochain, à Paris, se tiendra une réunion des treize pays militairement les plus impliqués, sous la présidence conjointe de Jean-Yves Le Drian et de son homologue américain, Ashton Carter.
Vous le voyez, le 25 octobre ou demain, la France est là : elle prend l’initiative et est présente pour essayer de déterminer le destin de cette région qui compte tant pour nous et pour l’Europe.
Combattre Daech, c’est aussi pour la France, nous y reviendrons, agir en Libye. L’État islamique a été évincé de son fief de Syrte. Mais nous savons le danger que représente la dissémination des djihadistes dans le reste du territoire libyen et dans les pays voisins, en particulier en Tunisie. C’est pourquoi, même si la France ne mène pas en Libye une opération extérieure, elle y conduit une action de soutien et d’observation.
La difficulté, c’est que tout reste à reconstruire dans ce pays, car disons-le, nous n’avons pas su anticiper les conséquences de la chute du régime de Khadafi lorsque nous sommes intervenus – sans doute à juste titre – en 2011. Nous devons donc redoubler d’efforts pour que le gouvernement d’entente nationale puisse véritablement rassembler toutes les forces politiques libyennes. Et nous savons l’importance de la Libye en Méditerranée, s’agissant en particulier de la question des flux migratoires.
Mesdames, messieurs les députés, nos soldats sont mobilisés à l’extérieur, mais je ne voudrais pas que le débat d’aujourd’hui passe sous silence les autres engagements de nos armées sur le territoire national, avec les 7 000 femmes et hommes de l’opération Sentinelle. Il y a un continuum géographique de la menace. Il y a donc un continuum géographique d’action pour nos forces militaires. Elles contribuent, avec les forces de sécurité intérieure, avec nos services de renseignement, avec notre justice, à protéger nos concitoyens. C’est notre priorité.
Ce sont des missions inhabituelles pour ces militaires, aujourd’hui appelés à patrouiller dans nos rues, à surveiller nos bâtiments publics, nos axes de transports, mais ce sont des missions essentielles que demandent nos concitoyens.
Le combat contre le djihadisme sera long. Il ne sera pas seulement militaire, mais jamais nous ne transigerons avec la sécurité de la Nation, en France comme sur les théâtres extérieurs. Jamais nous ne priverons nos forces intérieures – police et gendarmerie – des moyens humains et matériels nécessaires. Et l’effort engagé depuis 2012 devra se poursuivre. Jamais nous ne priverons nos armées des moyens indispensables pour assumer leurs missions sur notre sol et le coût de leurs engagements hors de nos frontières. En 2016, le surcoût des opérations extérieures dépassera le milliard d’euros pour le budget de la défense et il sera compensé conformément au mécanisme prévu, madame la présidente de la commission, par la loi de programmation militaire.
C’est aussi la raison pour laquelle le Gouvernement réalise autant d’efforts pour la défense. Et parce que les menaces vont persister, parce que le contexte géopolitique demeurera lourd d’incertitudes, nous devrons, je l’ai déjà dit, poursuivre l’accroissement du budget de la défense avec l’objectif de le porter à 2 % du produit intérieur brut.
Cet effort budgétaire doit être aussi celui des pays européens. Dès le lendemain des attentats de janvier 2015, la France a fait appel à la solidarité de ses partenaires, par l’invocation de la clause de solidarité prévue par le traité de l’Union européenne, l’article 42-7. La plupart d’entre eux ont répondu à notre appel et nous les avons remerciés de cet engagement à nos côtés.
Aujourd’hui, face aux menaces qui pèsent sur elle, l’Europe est au pied du mur. Elle doit mettre les enjeux de sécurité et de défense au coeur de ses priorités.
Parce qu’aucun membre de l’Union européenne ne peut s’estimer à l’abri, parce qu’aucun ne peut s’exonérer de la responsabilité que nous tous, collectivement, avons à l’échelle du monde, nous devons renforcer l’effort de défense européen.
Nous devons enfin donner sa consistance à une véritable Europe de la défense. Bien sûr, la souveraineté nationale doit être profondément respectée, mais je le dis tout net : face aux menaces au sud de la Méditerranée, la France ne peut être la seule à assumer ses responsabilités et à assumer, comme l’a dit Jean-Claude Juncker, « pour les autres » la défense de l’Europe. Afin de construire son autonomie stratégique, l’Europe doit être capable d’intervenir à l’extérieur de ses frontières, de projeter des forces européennes. Le Fonds européen dévolu à la défense et à la sécurité, demandé par la France et annoncé par la Commission, sera l’un des instruments pour que l’Europe se dote de toutes les capacités militaires et des ressources industrielles nécessaires.
L’Europe doit aussi être capable de renforcer son efficacité opérationnelle en apportant son appui au déploiement rapide des missions et opérations militaires de l’Union européenne. Nous assumons une responsabilité, nous avons notre autonomie, la France continuera bien sûr à conduire ses propres opérations, mais l’Europe doit s’engager et doit assumer ses responsabilités.
Mesdames et messieurs les députés, pour faire reculer Daech, nous avons fortement engagé nos moyens militaires ; je viens de les évoquer : plus de 4 000 hommes au Sahel, plus de 4 000 hommes au Levant, issus de toutes nos armées, de terre, de l’air, de la marine.
Cette guerre contre Daech, nous allons la gagner : il faut la gagner. Mais soyons lucides : ces victoires ne signifieront pas que nous en aurons terminé avec le terrorisme djihadiste.
Les racines du fondamentalisme demeureront. Les bouleversements stratégiques au Sahel, au Levant, sur le pourtour de la Méditerranée, en Orient, continueront de mettre à l’épreuve les États, de contester les frontières, de provoquer les ingérences extérieures, d’aiguiser les appétits de puissance, de pousser vers les routes d’Europe des cohortes de réfugiés, de mettre en danger les minorités religieuses d’Orient installées là depuis des siècles et aujourd’hui martyrisées : je pense aux chrétiens d’Orient et aux yézidis, qui méritent notre solidarité. Il faut que nous puissions les accueillir, quand ils le demandent, dans les meilleures conditions.
La Syrie, comme d’ailleurs le Yémen, est le précipité de toutes ces fractures qui déchirent l’Orient : la rivalité multiséculaire entre chiites et sunnites qui se réveille, si elle s’est jamais assoupie ; la résurgence de l’aspiration nationale kurde ; les luttes d’influence entre puissances régionales sunnites pour asseoir une domination sur le monde musulman sunnite. Et le jeu russe, bien entendu, qui tire profit de l’abstention ou du retrait américains pour retrouver sa puissance et son influence au Moyen-Orient, en renouant – quel qu’en soit le prix – avec une politique de brutalité et en soutenant à bout de bras le régime de Bachar el-Assad.
Au Levant, la France avec sa diplomatie s’engage pleinement car elle parle à tout le monde ; je dis bien « à tout le monde », car c’est peut-être elle qui connaît le mieux cette partie du monde et sa complexité.
Parler à tout le monde, c’est avoir une diplomatie active avec les grands pays sunnites de la région : Turquie, Arabie saoudite, Égypte, États du Golfe. Sans ce dialogue direct avec les pays sunnites, nous savons que les fractures peuvent s’aggraver en Orient.
Nous avons bâti avec plusieurs d’entre eux des partenariats stratégiques. Et nous devrons encore les approfondir car l’avenir du Moyen-Orient ne peut se construire sans une relation forte de la France avec ces pays. C’est cette relation forte qui nous permettra de lutter plus efficacement contre le financement direct ou indirect de la propagande salafiste…

Indirect !
…qui est le ferment de la radicalisation et du basculement dans le terrorisme.
Parler à tout le monde, c’est aussi, comme nous l’avons fait, renouer avec l’Iran car il est une grande puissance de la région ; la France veut avec l’Iran un dialogue politique franc et une relation bilatérale à nouveau dynamique.
Parler à tout le monde, c’est agir au Conseil de sécurité pour sauver Alep, pour arracher une trêve, pour garantir l’accès de l’aide humanitaire, comme le fait avec tant de détermination le ministre des affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault – et je veux aussi saluer devant vous son action.
Parler à tout le monde, c’est aussi parler à la Russie…
…comme le fera ce soir le Président de la République à Berlin, comme nous le faisons sur l’Ukraine depuis deux ans, dans le cadre du format de Normandie.
Je l’ai dit devant vous il y a quelques jours : la Russie est une grande nation ; nous avons avec elle une longue histoire, tant d’affinités, tant d’intérêts communs. La France sera toujours prête à travailler avec la Russie dès lors qu’il s’agira de faire avancer la paix, de lutter contre le terrorisme, d’oeuvrer ensemble à une véritable transition politique en Syrie. Parce que nous nous connaissons, parce que nous nous respectons, il faut avancer ensemble.
Parler à tout le monde, ce sera engager tout de suite le dialogue avec la nouvelle administration américaine dès sa prise de fonction. Les États-Unis n’ont pas suivi la France à la fin de l’été 2013, lorsque le président Barack Obama a finalement décidé de ne pas intervenir, alors que le Président de la République le lui proposait, pour tirer les conséquences de l’utilisation par le régime syrien des armes chimiques contre sa propre population.
Nous attendons de notre partenaire américain qu’il soit pleinement engagé et déterminé à peser de tout son poids pour relancer enfin une solution politique à la tragédie que vit la Syrie.
Mesdames, messieurs les députés, dans un monde incertain, face à la menace terroriste, la France assume ses responsabilités. Elle engage – et ce sont les décisions du Président de la République – fortement ses armées. Et elle continuera de le faire à chaque fois que sa sécurité, que ses intérêts seront en cause ; chaque fois que la sécurité du monde est en jeu.
Nous avons cru, peut-être, que la guerre était derrière nous. La fin des deux blocs avait laissé penser à un équilibre durable.
La vérité est tout autre. Des grandes nations expriment à nouveau leur volonté d’influence. La fin de l’histoire, annoncée il y a vingt ans, n’est pas advenue. Au contraire, la part tragique de l’histoire est de retour – d’une histoire qui s’accélère.
Et parce que nous sommes une grande nation, nous devons être là : agir, peser, faire entendre notre voix. Nos armées ont besoin de sentir que la Nation est rassemblée derrière elles.
Je ne doute pas que le débat qui va suivre en donnera la preuve.
Mesdames et messieurs les députés, soyons plus que jamais unis, rassemblés derrière nos forces. Car cette unité, ce rassemblement, c’est cette force indivisible qui fera que nous, la France, le pays de la liberté, le pays de l’universel, aux côtés de nos alliés, contre les ennemis de la liberté, nous vaincrons.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, madame et messieurs les secrétaires d’État, mesdames les présidentes des commissions des affaires étrangères et de la défense, en prenant la décision de déployer plusieurs centaines de soldats français au sol en Irak, avec notamment une batterie d’artillerie équipée de canons CAESAR qui doit servir à la prise de Mossoul, non seulement vous avez mis le doigt dans un engrenage dangereux, dans une guerre de religion entre sunnites et chiites et dans une guerre par procuration entre Turcs, Iraniens et Saoudiens que vous ne contrôlez pas, mais vous avez aussi violé la Constitution. La transformation de l’opération Chammal, intervention désormais terrestre autant qu’aérienne, aurait dû vous amener à appliquer l’article 35 de la Constitution : obligation d’information du Parlement et obligation, dans les quatre mois qui suivent, de demander l’autorisation du Parlement par un vote. Or si l’on peut considérer que l’information a effectivement été donnée en juillet dernier, le vote, lui, n’aura pas lieu, puisque vous avez choisi de recourir à l’article 50-1 de la Constitution, qui vous en exonère. Ce débat essentiel – à savoir : que fait la France en Irak ? quelle est notre politique pour l’après-Mossoul ? quels sont les risques d’engrenage ? – ne sera pas sanctionné par un vote de la représentation nationale.
Pourtant, un tel débat aurait pu être l’occasion de nous interroger sur les buts que vous poursuivez, y compris s’agissant de nos relations avec la Russie – dont vient de parler le Premier ministre. Le président russe, Vladimir Poutine, a été menacé par son homologue français, il y a quelques jours à peine, de poursuites devant la Cour pénale internationale pour les bombardements à Alep, où résident 300 000 civils.

Mais alors, que dire des bombardements de Mossoul, où résident près de 2 millions de personnes, bombardements auxquels nous participons dans les airs et désormais au sol ; et que dire des bombardements de Sanaa par nos amis saoudiens ?
Ce débat aurait pu aussi être l’occasion de nous interroger sur les moyens financiers mis à la disposition de nos armées. Jamais, en tout cas, l’armée française n’aura été autant employée par ceux qui ne l’auront jamais autant désarmée.
Exclamations et rires sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

L’occasion, encore, de nous interroger sur notre politique au Sahel et au Moyen-Orient, à laquelle plus personne ne comprend rien : nous nous contentons de suivre chaque zig et chaque zag de la politique américaine.

Mais pendant que nous faisons semblant d’en débattre ici, à raison de dix minutes par groupe, je note que le Président de la République, lui, soigne les journalistes, …

…au point de leur confier, des dizaines d’heures durant, les détails les plus secrets de nos actions diplomatiques et militaires. Tout cela se retrouve aujourd’hui sur la place publique !
Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

Comment peut-on imaginer, monsieur le Premier ministre, que le Président de la République, chef des armées, s’installe dans le rôle d’un commentateur, en temps réel, de ses décisions les plus secrètes en matière d’emploi de la force, décisions qu’il confie à des journalistes, comme il leur communique par le menu le contenu de ses conversations avec les présidents Obama et Poutine, son analyse détaillée de leur psychologie, ses propres « tourments intérieurs » ? Qu’il les fasse même assister, en direct, à un échange téléphonique avec le Premier ministre grec ? Comment imaginer que le Président leur confie le ciblage des bombardements français sur des objectifs en Syrie et que ces documents ultra-confidentiels soient fuités aux journalistes, puis publiés dans leur journal ? Comment imaginer que le Président leur détaille les conditions de libération des otages par nos forces spéciales, qu’il leur précise que la France paie des preneurs d’otage, directement ou indirectement ? Qu’il leur confie qu’il a lui-même ordonné l’assassinat de plusieurs terroristes identifiés, dans le cadre des fameuses opérations « homo » – je cite : « J’en ai décidé quatre au moins » ?

La liste des personnes ciblées est même passée aux journalistes. Mes chers collègues, les bras m’en tombent !
« La France est en guerre », a dit lui-même le Président de la République, le 16 novembre 2015, devant le Congrès, à Versailles. Nous sommes en état d’urgence, état que nous avons prorogé ici même, à quatre reprises. Nous avons eu 250 morts et 800 blessés. Près de 20 000 de nos soldats sont engagés, tant sur le sol national que sur plusieurs théâtres d’opération à l’étranger, qui, tous, peuvent avoir des conséquences graves pour la sécurité de la France. Dans de telles conditions, il est insupportable que le Président de la République, dans l’exercice de ses fonctions, viole ainsi ouvertement l’obligation de secret qui pèse sur les décisions les plus sensibles qu’il doit prendre en tant que chef des armées.
Comment ne pas voir, dans ces confidences, bien plus qu’un effondrement de la fonction présidentielle, un manquement caractérisé aux devoirs du Président de la République, chef des armées, « manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », selon les termes de l’article 68 de la Constitution ?

Autant de telles révélations seraient compréhensibles dans des mémoires rédigées dix ou vingt ans après les faits par un Président qui aurait quitté depuis longtemps le pouvoir, autant elles sont proprement intolérables, et même dangereuses, alors que la France est en guerre et que le Président est le chef des armées ! On sait que Mme Clinton est aujourd’hui critiquée, et même menacée de poursuites, pour avoir utilisé son adresse électronique alors qu’elle était à la tête du département d’État. Pour moi, je vous le dis avec beaucoup de gravité, monsieur le Premier ministre, la question de l’application de l’article 68 de la Constitution est désormais posée.
Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la défense, messieurs les secrétaires d’État, madame la présidente de la commission de la défense, mes chers collègues, depuis le début du quinquennat, les députés du groupe de l’Union des démocrates et indépendants ont soutenu sans réserve le Président de la République et le Gouvernement chaque fois que l’intérêt de la France était en jeu, dans un esprit de responsabilité et d’union nationale – je voudrais à ce propos saluer, monsieur le Premier ministre, la tonalité de votre discours, discours d’unité, de rassemblement et de responsabilité, dans un contexte qui, comme l’a rappelé notre collègue Pierre Lellouche, nous interpelle de plusieurs façons. Ce soutien, nous l’avons manifesté pour les interventions au Mali et en Centrafrique ; ce fut encore le cas pour le lancement de l’opération Chammal en Irak, ainsi que pour les frappes aériennes en Syrie.
Nous tenons à saluer le professionnalisme de nos hommes, leur courage et leur abnégation. Nous rendons hommage à ceux sont tombés au champ d’honneur, et nous soutenons nos hommes blessés, ainsi que leurs familles, dont le sacrifice est immense.
Cet engagement de nos troupes, c’est avant tout l’engagement de la France, sous mandat des Nations unies, pour la défense de la démocratie et de la liberté, et pour combattre le terrorisme et la barbarie qui menacent nos valeurs et la sécurité de nos concitoyens.
Nous devons cependant être conscients que, malgré l’atout que représente la troisième dimension, un conflit se règle toujours, in fine, au sol, comme en témoigne la bataille qui se livre actuellement pour reprendre Mossoul à Daech, et dans laquelle les forces irakiennes sont en première ligne, en partie formées, entraînées et accompagnées par des forces françaises, que nous saluons pour leur courage et leur efficacité.
Monsieur le Premier ministre, une question se pose : au regard de l’article 35 de la Constitution, cette présence, de par sa nature, ne justifierait-elle pas un débat, puis un vote spécifique, quatre mois après, au Parlement ?
En outre, dans la guerre globale que nous devons mener, il est essentiel que nous puissions nous adapter rapidement à l’évolution des menaces. Face aux dangers – par nature volatiles, de par leur fulgurance et leur radicalité –, il est indispensable d’anticiper davantage notre action grâce au renseignement, tant en opérations extérieures que sur notre sol. En effet, le continuum défense-sécurité est de plus en plus prégnant ; mes différents déplacements sur les théâtres d’opérations extérieures, notamment auprès de l’élite des troupes de marine qu’est le huitième régiment de parachutistes d’infanterie de marine, basé dans ma chère ville de Castres, m’ont permis de mieux cerner que c’est en Afghanistan, au Mali, au Niger, au Tchad, au Liban ou encore en République centrafricaine que se joue aussi, et surtout, notre sécurité. Plus il y aura de zones « grises », de non-droit, bases actives du terrorisme et de la criminalité internationale, plus le risque sera élevé en France. Nous devons donc combattre notre ennemi tant à l’étranger que sur notre propre sol.
L’opération Sentinelle est à ce titre un élément important de cette lutte, et nous l’avons naturellement soutenue dès son lancement. Il est à nos yeux logique que les forces armées puissent intervenir ponctuellement sur le territoire national, afin de protéger la population face à une menace terroriste qui n’a jamais été aussi élevée. Toutefois, nos militaires assurent dans ce cadre un rôle qui n’est pas la mission première de la défense ; ils se substituent de fait à des missions de police et de gendarmerie, voire à des sociétés privées. C’est pourquoi l’installation dans la durée de ce dispositif nous interpelle. Comme le souligne le rapport du Gouvernement sur l’emploi des forces sur le territoire national, extraordinaire dans son principe, cet emploi sur le territoire national doit demeurer extraordinaire dans le temps. En effet, nos armées sont au maximum de leurs possibilités : 34 000 soldats sont actuellement engagés, en France et dans vingt-cinq opérations extérieures. C’est un niveau jamais atteint depuis la fin de la guerre d’Algérie !
Dès 2013, le groupe de l’Union des démocrates et indépendants avait fait part de ses inquiétudes concernant le manque de moyens et les conséquences dramatiques des baisses d’effectifs prévues : 23 500 postes devaient être supprimés, auxquels devaient s’ajouter les 54 000 déjà supprimés dans la précédente loi de programmation militaire. Si cette trajectoire avait été maintenue, les effectifs de la défense auraient diminué d’un quart en dix ans, entre 2009 et 2019 ; on aurait réussi à faire rentrer toute l’armée de terre dans le stade de France : quel symbole !
En 2014, le ministère de la défense, à lui seul, a assumé près de 60 % des suppressions d’emplois d’État. Pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants, il était irresponsable de demander à la défense de réaliser tant d’efforts – plus que les autres ministères –, dans un contexte où la menace n’a jamais été aussi élevée. Nous avons donc salué la prise de conscience du Gouvernement, si tardive fut-elle, de la nécessité de mettre un terme aux suppressions de postes dans le domaine de la défense.
Toutefois, les récents recrutements ne seront pas en mesure de soulager rapidement les tensions dans nos armées, puisque les nouveaux militaires doivent être formés. Cette situation joue malheureusement sur les temps de repos, mais aussi sur la capacité de préparation opérationnelle de nos militaires, dont nous saluons une nouvelle fois le professionnalisme et le dévouement. C’est pourquoi nous soutenons la volonté du Gouvernement de renforcer la réserve, dans l’objectif de passer des 28 000 réservistes actuels à 40 000 d’ici à 2019 et, à terme, de déployer en permanence un millier de réservistes pour des missions de protection sur le territoire national, contre 400 à 450 aujourd’hui. Cette initiative est essentielle, mais nous devons aujourd’hui aller plus loin, afin de mettre sur pied une force nombreuse, répartie sur tout le territoire, très facilement mobilisable et disposant d’une formation élémentaire.
Il est d’abord indispensable d’adopter les mesures sociales et administratives préalables à l’emploi des réserves, dont bénéficient par exemple les réservistes américains, anglais ou encore canadiens, afin de mobiliser massivement des réservistes opérationnels, en leur assurant une couverture spécifique et des garanties particulières concernant leur emploi civil. Il s’agit d’une première étape nécessaire avant que notre pays se dote d’une véritable garde nationale, ayant pour pivot la réserve de la gendarmerie, et qui prenne le plus rapidement possible le relais des effectifs classiques engagés dans les opérations intérieures Vigipirate et Sentinelle, afin de réduire les fortes tensions pesant sur nos armées.
Si nous saluons l’augmentation, attendue de longue date, des moyens de la défense, nous appelons le Gouvernement à intensifier cet effort, afin que le budget de la défense atteigne rapidement les 2 % du PIB, contre 1,7 % aujourd’hui. Certes, cet objectif peut paraître très ambitieux ; il est cependant la condition sine qua non du maintien de notre capacité de défense, alors que la France est en Europe la seule puissance à disposer d’un outil d’une telle qualité, qu’il s’agisse de nos hommes ou de notre cadre institutionnel particulièrement favorable – ce qui n’est malheureusement pas le cas de l’Allemagne, par exemple.
À ce titre, je tiens à rappeler que lorsque la France s’engage en opération extérieure, elle ne le fait pas pour elle-même, mais pour la sécurité de l’ensemble de l’Europe. C’est pourquoi il nous semblerait juste qu’une solidarité financière effective soit enfin mise en place – ce que l’UDI préconise depuis 2013.
L’augmentation de notre budget de la défense est indispensable pour respecter le contrat opérationnel des armées fixé par le dernier Livre blanc – contrat inatteignable avec le budget actuel –, mais également pour donner à nos soldats les moyens de mener le combat contre le terrorisme, alors que notre matériel est parfois servi par des hommes plus jeunes qu’eux puisque 85 % des équipements en service dans l’armée de terre ont été conçus et acquis il y a trente-cinq ans. Pouvons-nous imaginer les troupes anglaises et américaines débarquant en Normandie, en 1944, avec du matériel du début de la Guerre de 14-18 ? En outre, moins de 40 % des hélicoptères de l’armée de terre sont en mesure de voler, et moins de 65 % des véhicules sont en état de rouler. Cette situation n’est plus tenable.
Mes chers collègues, alors que le monde dans lequel nous vivons est chaque jour plus instable et dangereux, nous devons non seulement donner des moyens supplémentaires à notre défense, mais également susciter une prise de conscience collective. Une approche globale passera aussi par le développement et l’éducation dans toutes les zones fragilisées par le terrorisme et par la menace islamiste radicale. De plus, la sortie de crise et l’après conflit doivent être au coeur de nos préoccupations, que ce soit par la mobilisation des moyens de l’action civilo-militaire ou par l’octroi de crédits à l’aide au développement via, entre autres, l’AFD, l’Agence française de développement.
L’engagement de dizaines de milliers de nos concitoyens civils au service de la France et de la sécurité constituera une réponse déterminante face au terrorisme, car c’est par la résilience de chacun et de tous que nous pourrons faire face à la barbarie et aux menaces qui pèsent sur notre pays. C’est pourquoi il nous paraît important de retrouver des éléments d’union : c’est à quoi nous appelons, non seulement sur les bancs de l’UDI, mais aussi, je pense, sur la majorité des bancs de notre assemblée.
Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, messieurs les secrétaire d’État, madame la présidente de la commission de la défense, mes chers collègues, la France connaît depuis 2013 un niveau d’engagement militaire inédit, en termes de durée et d’intensité, dans des opérations majeures menées simultanément sur plusieurs fronts extérieurs : je veux parler de l’opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne, de l’opération Sangaris en Centrafrique et de l’opération Chammal au Levant. Elle est en outre présente au Liban au sein de la force des Nations unies, et sa marine continue à mener des opérations dans le golfe de Guinée et dans l’océan indien. Elle participe par ailleurs aux opérations navales européennes au large de la Somalie ou en Méditerranée, fournit des éléments à certaines missions des Nations unies et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et assure des missions de défense aérienne au profit des pays baltes.
Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutient cet engagement car il repose sur une responsabilité particulière de notre pays au nom de ses valeurs, d’une part en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies, et d’autre part au nom de son histoire, du maintien de son influence et des impératifs de sa sécurité.
Ainsi, la France intervient pour des motifs humanitaires, afin de protéger des populations civiles menacées. C’est le cas de l’opération Sangaris en Centrafrique, engagée en décembre 2014 pour faire cesser exactions et affrontements entre groupes armés, violences qui auraient pu conduire à une situation de génocide. Ce motif humanitaire fut aussi un élément déclencheur de l’intervention en Irak, contre Daech, pour éviter les massacres de populations civiles.
Notre pays intervient par ailleurs pour apporter conseil et formation à des forces armées ou de sécurité de pays fragilisés. C’est le cas de la mission de la force Daman au Liban, ou dans le cadre de missions de l’Union européenne telles que l’EUTM Mali ou en République Centrafricaine.
La France agit aussi, à la demande des autorités d’un pays ou du Conseil de sécurité des Nations unies, pour mettre un terme à des conflits. Elle le fait alors dans le cadre de missions de stabilisation, afin d’installer la sécurité nécessaire à un processus de transition démocratique et au rétablissement des institutions, et pour engager le désarmement des groupes armés. C’est le sens de l’opération Sangaris en Centrafrique depuis 2013 et, pour partie, de l’opération Serval au Mali, également engagée en 2013 et suivie, depuis 2014, de l’opération Barkhane.
La France intervient enfin et surtout en opérations extérieures pour lutter contre les groupes armés terroristes qui menacent la stabilité de certains États et celle du monde. C’est le cas au Mali depuis 2013, intervention suivie, un an plus tard, d’une autre dans l’ensemble des cinq pays de la bande sahélo-saharienne, ainsi qu’en Irak depuis 2014 et en Syrie depuis 2015, afin de soutenir la lutte contre Daech aux côtés de la coalition internationale. Cette lutte s’est, à juste titre, renforcée depuis 2015 et les trois attentats menés sur notre territoire. La menace reste forte, la France étant l’un des pays les plus visés au monde par Daech, mais aussi par Al-Qaïda au Maghreb islamique – AQMI – et dans la péninsule arabique – AQPA.
Ces interventions sur des théâtres d’opérations extérieures ont permis des avancées significatives, en particulier dans la lutte contre les groupes armés terroristes. En effet, l’État islamique recule sur le terrain, en Irak et en Syrie. Depuis le début de l’opération Chammal en septembre 2014, l’armée française a effectué d’importantes sorties aériennes et mené 10 % des frappes au total, en appui des forces irakiennes. Plus d’un millier de combattants de l’EI ont été neutralisés et des centres de commandement et d’entraînement détruits, notamment autour de Raqqa ; Ramadi est tombée. Les forces spéciales ont formé 1 500 commandos irakiens et appuyé les peshmergas kurdes, à qui la France livre des armes. Le bilan est donc positif, à l’heure où la reprise de Mossoul et de Raqqa se dessine.
Au Sahel, la pression sur les groupes armés terroristes porte ses fruits, puisque le dispositif militaire réduit leurs sanctuaires, perturbe leurs trafics et neutralise leur arsenal. Plus de 200 djihadistes ont été neutralisés depuis le début de l’opération, essuyant des pertes logistiques importantes. La menace d’un « Sahelistan » est donc aujourd’hui écartée car l’ennemi, traqué en permanence, n’a plus de zone refuge.
Pourtant, les conditions sont souvent très difficiles, en premier lieu, pour les 7 000 militaires engagés sur les théâtres d’opérations. Ceux-ci, notamment au Sahel et au Levant, sont situés dans des zones climatiques et géographiques particulièrement rudes en raison de leurs caractéristiques, qu’il s’agisse des fortes chaleurs, des vents de sable ou de la dureté du terrain. Face à de telles conditions climatiques et géologiques, les forces doivent être particulièrement endurantes, entraînées et aguerries. Nous saluons leur courage, et pensons aussi à ceux qui ont perdu la vie sur ces théâtres d’opérations. En ce sens, le monument aux soldats morts en opérations extérieures, qui verra le jour l’an prochain à Paris, est une initiative salutaire, car il signifie, pour les combattants de ces OPEX, que la nation n’oublie pas ceux dont le sacrifice ultime a témoigné de la valeur de leur engagement militaire.
Les conditions naturelles éprouvent aussi les matériels déployés, qui sont conséquents. Rappelons que l’opération Barkhane nécessite une quinzaine d’hélicoptères, 400 véhicules blindés et logistiques, une dizaine d’avions tactiques et de chasse et cinq drones.
À ce titre nous soutenons les engagements budgétaires pris pour 2017 en faveur de nos soldats et de leurs équipements. En effet, dans un budget global de la défense en hausse pour cette nouvelle annuité de loi de programmation militaire réactualisée, des mesures d’amélioration de la condition du personnel ont été posées. Elles sont à la hauteur du niveau d’engagement en opérations extérieures comme intérieures. Ainsi, le plan d’amélioration de la condition du personnel permettra de compenser les fortes sujétions qui pèsent sur lui. Ce plan comporte un volet « rémunérations » et des mesures d’amélioration des conditions de travail et de soutien aux familles pendant l’absence, pour une enveloppe de 287 millions d’euros en 2017.
Le rééquipement des armées se poursuivra également. L’engagement de plus de 17 milliards d’euros de crédits permettra l’acquisition de nouveaux matériels : quinze hélicoptères de combat, trois Rafales, trois avions de transport et des navires de protection, pour ne citer que ces quelques exemples. Par ailleurs, les stocks de munitions – fortement entamés par l’opération Chammal en Irak – seront regonflés, puisque 80 millions d’euros supplémentaires ont été budgétés pour ce poste.
Cependant, si nous soutenons ces opérations extérieures et leur coût budgétaire très élevé, nous voulons rappeler avec force que les interventions menées en Centrafrique, dans le Sahel, en Syrie et en Irak sont aussi dans l’intérêt de l’Union européenne. Elles profitent à tout le continent. Par conséquent, la France serait en droit de demander de déduire de son déficit le coût de ses opérations militaires extérieures, au regard des critères du pacte de stabilité et de croissance, ou, le cas échéant, d’obtenir une participation financière de l’Union européenne aux opérations militaires qu’elle mène, puisque celles-ci sécurisent l’ensemble du continent.
Par ailleurs, rappelons-le encore, il est impératif de mettre en place une Europe de la défense ; à ce titre nous saluons, monsieur le ministre, la feuille de route signée le mois dernier avec votre homologue allemand pour relancer cette idée. Cela facilitera la mise en place d’opérations dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune, avec l’appui d’États membres volontaires. La France a un rôle moteur à jouer en ce domaine, d’autant que, dans le contexte du Brexit, elle sera demain la première puissance militaire de l’Union européenne. Nous espérons ainsi que l’année 2017, au cours de laquelle sera célébré le soixantième anniversaire du traité de Rome, marquera des avancées sur le terrain laborieux de la défense européenne.
Je terminerai en citant un propos du chef d’état-major des armées, le général de Villiers, qui disait que « gagner la guerre ne suffit pas à gagner la paix ». Les armées doivent en effet pouvoir compter sur les puissants effets de levier que sont l’action politique et l’action diplomatique. À ce titre, nous saluons l’initiative du ministre des affaires étrangères de réunir demain, à Paris, une vingtaine de pays afin de préparer l’avenir politique de Mossoul après la bataille militaire.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission de la défense, mes chers collègues, la France est en guerre sur de multiples théâtres d’opérations en Afrique et au Moyen-Orient ; des guerres certes particulières car de nature asymétrique, mais des guerres dans lesquelles la vie de nos soldats est en jeu ; des guerres susceptibles, aussi, d’avoir des conséquences et de provoquer des réactions sur notre propre territoire.
Dès lors, il serait particulièrement logique que la représentation nationale soit pleinement impliquée dans le déclenchement et le suivi de ces opérations militaires. Or il n’en est rien. Dans la Ve République, le domaine de la guerre demeure un angle mort démocratique.

Ainsi le Parlement, en vertu de la lettre de notre Constitution, a été mis à l’écart des décisions qui lançaient ces opérations tous azimuts. Si le Gouvernement nous a invités à nous prononcer sur l’opportunité de les poursuivre, ce geste tardif relève d’une logique plus formaliste et symbolique que foncièrement démocratique.
Nous avons, malgré tout, participé à ces débats et assumé notre part de responsabilité, sans arrière-pensées ni procès d’intention. Et c’est au nom du souci partagé de combattre sans merci le terrorisme que nous avons, sans résignation, alerté l’exécutif sur les conséquences de ces interventions.
Le changement de majorité, en 2012, offrait l’espoir d’un changement dans la conduite des affaires internationales. Il était temps, en effet, de rompre avec la politique menée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, politique dont nous payons encore aujourd’hui les dérives et les échecs. Le plus significatif étant sans conteste le fiasco de l’expédition militaire en Libye.

Le pays, qui a sombré dans le chaos, est toujours sans gouvernement national et en quête de sécurité et de stabilité politique, en proie à la division et aux tensions claniques et tribales.
Il y a près d’un mois, un rapport parlementaire britannique a pointé la responsabilité franco-britannique dans le chaos provoqué par une intervention qui, faut-il le rappeler, a été soutenue au Parlement français par la droite et les socialistes.
Après l’épisode libyen et l’alternance de 2012, la rupture avec l’atlantisme décomplexé de Nicolas Sarkozy n’a pas eu lieu et François Hollande a marché dans les pas de la politique étrangère amorcée par son prédécesseur.
Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.

Quatorze mois à peine après la fin de la guerre en Libye, le Gouvernement français envoyait notre armée au Mali pour combattre les mêmes armées islamistes, dont l’intervention de la coalition avait permis l’émergence en Libye. Aujourd’hui, malheureusement, l’accord d’Alger pour la paix et la réconciliation au Mali du 20 juin 2015 n’a pas encore permis le retour de la paix dans le pays. Pire, l’expansion du terrorisme au centre du pays et la naissance de nouveaux groupes armés semblent rendre le processus de paix inextricable.
L’Histoire nous enseigne des leçons, qu’il convient de garder à l’esprit. Les guerres peuvent avoir des conséquences imprévisibles et trop souvent porter en elles les germes de nouveaux conflits. Si elles sont menées sans penser le jour d’après, sans envisager la construction de la paix, elles sont vouées à l’échec. Est-il besoin de se remémorer le bilan des interventions qui se sont multipliées depuis le 11 septembre 2001 : Afghanistan, Irak, Libye, Mali… ? Dans chacun de ces cas, dans chacun de ces pays, au-delà de la particularité de chacune de ces situations, le constat est cinglant : affaissement du rôle de l’État, négation de l’État de droit, exacerbation des antagonismes communautaires, règne des milices, extension internationale du djihad armé et populations exsangues.
Pour être efficace dans la lutte contre le terrorisme et ne pas répéter les erreurs du passé qui amplifient le chaos, les décisions militaires doivent procéder d’objectifs politiques clairement pensés et déterminés, en vue de relever le défi de la lutte contre le djihadisme.
Nous sommes les premiers à penser que face aux avancées des forces islamistes radicales, le silence et l’inaction ne peuvent être de mise. Face aux crimes et au sentiment d’impunité des djihadistes, la responsabilité de la communauté internationale est de protéger les civils quels qu’ils soient. Mais pas n’importe comment, pas sous commandement américain ni sous la tutelle de l’OTAN.
Ainsi, l’offensive menée à Mossoul depuis lundi ne pourra-t-elle prendre tout son sens que si elle est conçue comme une étape décisive dans les réponses apportées aux défis que représentent Daech et la construction d’un Irak uni. Or, hélas, il semblerait qu’entre les forces nombreuses – aux intérêts divergents voire contraires – qui mènent cette offensive, il n’y ait pas de plan politique préalable et nécessaire pour relever ces défis intimement liés. Dans ce cas, et malgré une victoire militaire, le terreau du djihadisme continuera de fleurir.

La question du contrôle de la province de Ninive à l’issue de la bataille n’a toujours pas été tranchée. Qu’adviendra-t-il des différentes composantes de cette province qui est l’une des régions les plus multiculturelles d’Irak ? La France doit agir pour faire respecter la citoyenneté de chacune d’entre elles sans exception : musulmans chiites et sunnites, chrétiens, kurdes, yézidis, turkmènes, shabaks. C’est l’avenir de l’Irak comme État-Nation qui est en jeu, dans le respect de toutes ses composantes.
La France doit également mettre toute son énergie à préparer le devenir des civils qui fuiront les zones de combats. Ils pourraient être plus d’un million selon Amnesty international. Dans l’immédiat, elle doit être à l’initiative de l’organisation de l’aide apportée aux civils fuyant les zones de combat.
En Syrie, à Alep, une tragédie similaire se déroule. Elle ne doit pas être négligée. La France ne saurait abandonner les civils à leur propre sort et assister passivement à la destruction complète de la ville. Il n’est pas trop tard pour que la France assume sa responsabilité et son sens de l’audace sur la scène internationale, et qu’elle renoue avec la tradition et la culture française dans un esprit de solidarité, contre toute forme de domination. Pour cela elle doit abandonner la diplomatie de l’émotion et des intérêts commerciaux qui a pris le pas sur la diplomatie de la raison.

Nous ne pouvons, en effet, mener des guerres au seul prétexte que nous, « grande civilisation occidentale », serions dépositaires des vrais principes moraux – une lecture morale des relations internationales qui conduit le plus souvent à défendre une ligne belliciste sur tous les dossiers. Les leçons de morale démocratique assenées au monde entier alimentent, en effet, les pires aventures militaires, comme en Irak ou en Libye. Les va-t’en guerre ne sont jamais vertueux, encore une leçon de l’histoire !
Le ministre des affaires étrangères en 2012 justifiait une offensive militaire en Syrie parce qu’« il fallait punir Bachar » et « qu’il ne méritait pas d’être sur la terre ». Ces mots, enfantins, ont décrédibilisé notre diplomatie qui était prête à s’affranchir de l’aval des Nations unies ; prête à conduire, seule sur la scène internationale, une guerre improvisée et illégale. Une façon de renouer avec la « mission civilisatrice » de l’Occident qui nous plaçait du mauvais côté de l’Histoire.

Les guerres ne peuvent non plus être menées au nom de nos intérêts économiques. Preuve, s’il en était besoin, que la morale peut être à géométrie variable. Une géométrie qui varie en fonction des marchés en jeu. Les liens avec les pétromonarchies, qui sont le fourrier du terrorisme fanatique, doivent être reconsidérés sur d’autres critères que ceux de la vente d’armes. Jamais la vente de quelques Rafales, de palaces ou d’autres contrats hypothétiques mirobolants ne devraient réduire au silence une démocratie.
Ce sont de telles erreurs dans la conduite des affaires internationales qui peuvent nous mener au pire. Un pire aujourd’hui bien réel et qui a pris la forme d’une créature monstrueuse répondant au nom de Daech, de Front al-Nosra, d’Al-Qaïda ou de Boko Haram. De Paris à Nice, cette créature monstrueuse sévit aujourd’hui sur notre territoire et partout dans le monde.
Il appartient désormais à la France d’en finir avec ses hésitations et tergiversations, et de prendre toute sa part dans le combat long et crucial contre Daech. À défaut, elle risque de rester cantonnée à un rôle de figurant sur la scène internationale. Notre diplomatie doit être questionnée pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Elle pourra alors proposer des réponses audacieuses dans le double objectif de vaincre le terrorisme et de gagner la paix.
Ainsi, pour la résolution du conflit en Syrie, devrait-elle prendre au sérieux l’alerte de M. de Mistura, envoyé spécial des Nations unies : « L’histoire nous jugera si nous ratons un certain type d’opportunité pour arriver à un changement ».
Aucune option ne doit être écartée pour mettre fin au martyr du peuple syrien, y compris l’option non militaire.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, chers collègues, reconnue et admirée par ses alliées et partenaires, crainte par ses adversaires, l’armée française concourt, de par ses opérations intérieures et extérieures, au poids de la France sur la scène internationale. Elle permet ainsi à notre pays, membre fondateur de l’ONU et de l’OTAN, pays des droits de l’Homme, membre permanent du Conseil de sécurité, de prendre ses responsabilités en matière de sécurité nationale et collective et ainsi de continuer à faire entendre sa voix dans un monde multipolaire, aussi complexe qu’interconnecté.
Il est important à ce stade de saluer l’engagement de nos militaires, les risques pris et les sacrifices consentis et de rappeler que nombre d’entre eux y ont laissé la vie ou portent les suites des blessures physiques ou psychiques qu’ils ont subies.
Les OPEX s’inscrivent aujourd’hui dans un continuum OPEX-OPINT – opérations extérieures et intérieures –, lié à la menace djihadiste.
Si cette menace domine aujourd’hui nos préoccupations, elle n’est pas exclusive et nos armées ont à assurer de nombreuses missions. Nous nous devons, me semble-t-il, d’évoquer aussi dans ce débat, au nom de ce continuum, les opérations intérieures, pleinement dans les missions de nos armées.
Les armées contribuent quotidiennement à la protection de la population, ainsi qu’à la défense des intérêts de sécurité de la Nation contre les menaces et les risques susceptibles de la mettre en péril. J’évoquerai la posture permanente de sûreté aérienne, qui mobilise 1 000 personnes au quotidien, la posture permanente de sauvegarde maritime, pour laquelle 1 400 marins sont engagés et assurent la sûreté des approches maritimes de notre territoire par le renseignement, la surveillance et l’intervention dans les approches, le contre-terrorisme maritime, la lutte contre les engins explosifs, et bien évidemment, la posture de protection terrestre, où 10 000 soldats sont déployés depuis le 12 janvier 2015 au sein de l’opération Sentinelle et agissent aux côtés des forces de sécurité intérieure dans le cadre de réquisitions préfectorales sur les sept zones de défense de la métropole ainsi qu’outre-mer.
Venons-en aux opérations extérieures proprement dites. L’opération Barkhane, créée le 1er août 2014 par la fusion des opérations Serval et Épervier, s’inscrit dans une logique de régionalisation et de coopération avec cinq pays de la bande sahélo-saharienne – Mauritanie, Mali, Burkina-Faso, Niger et Tchad, dits « G5 Sahel » – et s’étend ainsi sur un vaste théâtre.
Avec près de 3 500 militaires engagés, il s’agit de la plus importante des opérations extérieures menées par les forces armées françaises, qui en exercent le commandement. Les militaires français sont aussi engagés au sein des opérations multinationales MINUSMA et EUTM.
L’opération Barkhane vise deux objectifs : appuyer les forces armées des pays partenaires dans leurs actions de lutte contre les groupes armés terroristes – c’est très important de le rappeler après ce que nous venons d’entendre –, et contribuer à empêcher la reconstitution de sanctuaires terroristes dans la région afin que cette lutte puisse être prise en compte par les forces locales et que les États concernés puissent retrouver tous leurs droits.
L’évolution de notre action repose sur trois piliers : la mobilité, la modernisation de moyens et l’efficacité des appuis.
Par ailleurs, même si Barkhane ne lutte pas directement contre Boko Haram, la France soutient ses partenaires dans le cadre de leur lutte contre la secte terroriste.
L’opération Chammal, lancée le 19 septembre 2014, est conduite par les armées françaises en coordination avec leurs alliés présents au Levant agissant au sein de la coalition. Elle est destinée à affaiblir Daech et à mettre l’organisation terroriste islamiste à la portée de forces de sécurité locales.
L’engagement français est initialement réalisé à la demande du gouvernement de l’Irak, puis dans le cadre des décisions du Conseil de sécurité des Nations unies, par la résolution 2170 du 15 août 2015. Nos opérations se sont progressivement étendues au territoire syrien depuis septembre 2015 pour pouvoir frapper l’organisation terroriste dans son sanctuaire – opérations qui se sont intensifiées depuis les attentats de novembre 2015. L’Assemblée nationale en a été saisie.
L’engagement français, qui mobilise en moyenne 1 400 militaires, revêt deux aspects : une véritable campagne aérienne pour renseigner sur l’ennemi et le frapper au plus près des lignes de front jusqu’au coeur des territoires qu’il contrôle, et la participation aux programmes de régénération des forces de sécurité irakiennes conduits par la coalition.
Ainsi, en 2015, les forces locales ont repris l’offensive et obligé l’ennemi à reculer : Daech a perdu environ 13 000 kilomètres carrés sur les 90 000 occupés initialement tandis que les frappes soutenues contre sa production pétrolière ont fragilisé son assise financière.
Depuis septembre 2016, un détachement de l’armée de terre d’environ 150 soldats, la « Task Force Wagram », met en oeuvre quatre pièces d’artillerie CAESAR depuis la base de Qayyarah, située au sud de Mossoul, afin d’empêcher Daech de positionner des pièces d’artillerie d’une part, et d’entraver la liberté de manoeuvre de l’ennemi en empêchant sa progression d’autre part.
La bataille pour Mossoul qui s’engage sera probablement de longue durée et difficile, mais elle est nécessaire et notre pays doit y participer dans le rôle et le cadre qu’il s’est fixés. Des questions restent néanmoins posées. Les besoins évolueront-ils ? Quel rôle serons-nous amenés à jouer après la bataille de Mossoul entre les différentes forces coalisées – armée irakienne, forces kurdes, tribus sunnites, milices chiites ? Comment tout cela va-t-il s’organiser ? C’est une question cruciale qui se posera ensuite mais dont il faut s’occuper dès aujourd’hui.
La France est aussi engagée en Méditerranée et au Liban.
Le développement des crises au Levant et en Libye s’est traduit par le déploiement de moyens, notamment de renseignement, en Méditerranée centrale et occidentale pour conserver des capacités de réaction rapide et d’appréciation autonome de la situation. En 2015, ces engagements ont représenté près de 100 jours de mission, tous moyens confondus.
Au Liban, la France fournit une force de réserve de 855 militaires au profit du commandant de la Force interimaire des Nations unies au Liban, déployée dans le cadre de la résolution 1701 du 11 août 2006, et renouvelée chaque année.
La France est aussi engagée en Centrafrique pour empêcher un désastre humanitaire grâce à l’opération Sangaris. En intervenant en République Centrafricaine en décembre 2013, cette dernière a mis fin à un cycle d’exactions et empêché un désastre humanitaire dans un contexte prégénocidaire. Aujourd’hui, les améliorations constatées sur le plan politique, économique et sécuritaire ainsi que l’autonomie acquise par la force onusienne, la MINUSCA, Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en Centrafrique, permettent de poursuivre la réduction progressive du dispositif de Sangaris. De 1 300 militaires déployés en 2015, la force est passée en juin 2016 à 350 militaires avant sa fermeture en fin d’année, conformément aux engagements du Président de la République.
Il y a également les mesures de réassurance à l’est de l’Europe. Depuis le début de la crise, la France déploie un large éventail de capacités dans la zone d’intérêt de l’Ukraine pour réassurer ses partenaires d’Europe centrale et de l’Est. Sont notamment effectuées des missions aériennes régulières pour renforcer la surveillance des espaces aériens de l’Europe de l’Est, aux côtés des autres aéronefs de l’Alliance.
La liste des interventions de l’armée française ne s’arrête pas là. On peut notamment citer sa participation à de multiples opérations de l’ONU, de l’OTAN ou encore de l’Union européenne, mais aussi sa lutte contre le piratage dans le golfe de Guinée, à travers l’opération Corymbe, contre l’orpaillage illégal en Guyane – opération Harpie –, ou contre d’autres sinistres pouvant survenir en métropole.
En conclusion, nos armées sont un instrument essentiel de la politique extérieure de notre pays et nous permettent d’être actifs dans les affaires du monde. L’objectif, chacun le sait bien, n’est pas strictement militaire, c’est le rétablissement d’un bon niveau de sécurité par la réduction du risque djihadiste, ainsi que la paix, et nous pouvons être fiers de l’action de nos armées.
Messieurs les ministres, le Gouvernement est pleinement engagé dans sa mission après des décisions stratégiques et soutient concrètement et de façon cohérente nos armées et nos militaires par un gros effort budgétaire, conforme aux décisions du Président de la République. Aussi le groupe socialiste, écologique et républicain vous apporte sans restriction son soutien, pour vous et pour nos militaires engagés dans cette difficile mais noble tâche.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la défense, mesdames les présidentes de la commission de la défense et de la commission des affaires étrangères, mes chers collègues, alors que s’engage à Mossoul une bataille décisive dans notre lutte contre l’État islamique, permettez-moi de rendre hommage à l’ensemble de nos forces armées.
Nous saluons l’engagement de ces femmes et de ces hommes qui prennent part à cette bataille mais aussi de celles et de ceux qui servent notre pays sur le territoire national ou sur tous les autres théâtres d’opération, avec une exigence et une abnégation dignes de nos traditions militaires, pour nous protéger de notre ennemi, l’islamisme.
Les Français les croisent quotidiennement dans le cadre de l’opération Sentinelle, mais combien de nos concitoyens savent-ils que nos soldats et marins qui sécurisent notre territoire reviennent de mission en Centrafrique, au Liban, au Mali, au Niger, en Irak ? Combien savent-ils que certains d’entre eux ont passé plus de 200 jours hors de leur foyer, au service de la France ?
Depuis 2013, nos forces armées n’ont jamais été autant sollicitées. Elles ont bien entendu une forte tradition de prépositionnement, elles sont intervenues au Liban, en Bosnie, en Afghanistan, mais force est de constater que, depuis l’élection de François Hollande, nos forces sont de plus en plus engagées sur des terrains dangereux pour nos hommes et usants pour nos matériels.
Cet engagement militaire, très au-delà du contrat opérationnel prévu par le Livre blanc et les budgets votés pour nos armées depuis 2013, n’est-il pas devenu un moyen de peser là où votre diplomatie n’est plus entendue du fait de vos hésitations et tergiversations ? Nous pouvons légitimement nous interroger. En effet, Mali, Centrafrique, Syrie, Irak, l’engagement de nos armées a toujours été décidé dans un contexte marqué par les erreurs d’analyse de l’actuel Président de la République.
Voici trois exemples marquants.
Mali : pendant que les islamistes imposaient leur ordre sanguinaire à Tombouctou, François Hollande annonçait la fin des interventions militaires françaises en Afrique. Tout le monde connaît la suite…
Centrafrique : personne n’a oublié les propos ici même de M. Le Drian expliquant les raisons du choix par le Gouvernement du nom de Sangaris – papillon dont l’espérance de vie est très courte – pour illustrer le fait que l’opération ne devait durer que quelques semaines, tout au plus trois mois, selon le ministre de la défense lui-même. Tout le monde connaît également la suite… Pour ne pas avoir stoppé dès le début de leurs exactions les milices Séléka, qui se livraient à des massacres dans le nord de ce pays, nos forces armées se sont retrouvées « scotchées » de longs mois durant sur ce théâtre d’opération.
Syrie : annoncer une intervention, l’annuler, dénoncer des lignes rouges franchies, armer des rebelles pour le moins suspects – pour ne pas dire plus –, pour quel résultat ?
Le groupe Les Républicains a pris ses responsabilités en soutenant ces interventions militaires. Il n’en a pas moins dénoncé les incohérences, voire les errements diplomatiques de votre politique.
Si le Président de la République a pu ainsi solliciter nos forces armées, c’est parce qu’elles étaient prêtes. Les décisions prises durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, dans un contexte de crise économique mondiale sans précédent depuis 1929,
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain

ont permis en effet de préparer et d’assurer le maintien en condition opérationnelle de nos hommes et de nos équipements.

Les efforts de réorganisation et l’acquisition de nouveaux matériels ont permis, de fait, à l’actuel Président de la République d’engager nos troupes au Mali dès 2013, …

…mais qu’en est-il aujourd’hui ? Entre loi de programmation militaire initiale, loi de programmation militaire réactualisée, réponses aux attentats, le Gouvernement s’est lancé dans une politique d’annonces à tout va. Les spécialistes en perdent leur latin même si, ils le savent tous, l’enfumage du ministre de la défense
Protestations sur de nombreux bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain

n’a qu’un seul but : dissimuler l’état d’attrition du matériel de nos armées et le suremploi de nos hommes.
Au cours des quatre années, vous avez non seulement épuisé nos hommes mais également entamé le capital en matériel de nos trois armes.
Selon l’article 4 de la loi de programmation militaire, monsieur le ministre, « Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l’objet d’un débat au Parlement. Le Gouvernement communique, préalablement à ce débat, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours ». Si l’on peut considérer que ce débat a lieu aujourd’hui, où est le bilan politique, opérationnel et financier ?
Les enjeux sont pourtant clairs : pour être efficaces, nos armées ont besoin d’hommes et de femmes formés et entraînés mais aussi de matériels rénovés. Or les effectifs ne le permettent plus…

…compte tenu du rythme des opérations, et le maintien en condition opérationnelle de nos matériels ne suit plus.
Les témoignages sur la vétusté de nos matériels sont légion, avérés et démontrés. Des ruptures capacitaires à un niveau inégalé sont connues et répertoriées.

Les budgets des années 2018 à 2022 devront donc redonner à nos armées les moyens de mener à bien leurs missions pour que notre pays soit capable d’intervenir.
Je tiens à rappeler également notre opposition à la participation du ministère de la défense à la réserve de précaution utilisée pour financer le surcoût des OPEX.
Faire la guerre pour protéger nos intérêts et nos concitoyens nécessite des engagements budgétaires réels et sérieux. C’est pourquoi notre groupe propose de bâtir une loi de programmation militaire qui permettra d’atteindre 1,85 % du PIB hors pensions en 2022 et 2 % du PIB, toujours hors pensions, au plus tard en 2025.
Il serait aussi très important, pour engager sereinement nos armées, de voter une loi de programmation militaire pour la période 2018-2022, qui ne sera plus à cheval sur deux quinquennats. Cela évitera la grande opération d’enfumage de l’actuel gouvernement qui reporte les engagements non financés sur le gouvernement suivant.
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, la guerre est aujourd’hui partout. Il s’agit par moment de guerres classiques et à d’autres moments de guerres tout à fait inattendues.
On se bat en Afrique, on se bat au Moyen-Orient, et les combats que l’on mène là-bas ont des répercussions sanglantes ici.
Au moment où je parle, je ne peux évidemment m’empêcher de penser à nos soldats qui meurent ou sont blessés.
La différence entre eux et nous, c’est que ce que nous écrivons par des minutes de silence, des paroles, des adjectifs consolants, eux l’écrivent dans la poussière avec leur sang.
Quelle que soit l’idée que nous ayons de notre fonction, nous sommes dans les mots, ils sont dans la chair. Cela dit toute la mesure de notre responsabilité à tous. Que nous ayons tort ou que nous ayons raison, c’est à eux que nous devons penser et il faut se dire que, quand on fait les beaux, parfois, eux font les vrais morts.
Ces guerres, on l’a dit, ont des conséquences à la fois directes et indirectes et, quand on pense à ces soldats qui meurent, qui sont blessés, on ne peut s’empêcher de penser aussi au chef des armées, et je ne doute pas que, dans le secret de vos consciences, vous ayez le même sentiment que moi. Comment se peut-il qu’un Président de la République aille se confier à des journalistes en livrant des secrets qui touchent à la défense nationale ? Quel que soit le côté où nous nous trouvions, nous sommes obligés de trouver cela inacceptable, pour ne pas dire plus, surtout si l’on pense à celui qui attend la balle qui va le tuer ou la mine qui va le faire exploser.
Tous, nous sommes d’accord pour mener une lutte sans merci contre le terrorisme, tous. On peut déplorer, cela a été dit et je me fais un devoir de le répéter, que le Parlement ait été mis à l’écart de ces questions de guerre, sur lesquelles, dans une démocratie, il devrait tout de même intervenir prioritairement, mais ce n’est peut-être pas le plus important.
Le plus important est que nous sommes dans l’ère des guerres à ondes de choc multiples, ondes que nous ne sommes peut-être pas encore capables d’analyser sur le sismographe de nos horreurs. Et peut-être n’avons-nous pas suffisamment appréhendé le fait que nous pouvions nous aussi être le jouet de ces forces qui, quelque part, par la manipulation, essaient de nous instrumentaliser et de nous faire agir comme nous ne le voudrions pas.
En Irak, en Libye, au Mali, en Syrie, sous les ordres de qui sommes-nous ? Peut-on jurer que le commandement américain ne nous fait pas faire un peu ce qu’il veut ? Peut-on affirmer que, lorsque l’on parle de la Russie ou de Bachar el-Assad, l’on n’est pas dans la diplomatie des mots destinée à se faire une belle conscience alors qu’elle risque d’être très moche quand le jugement de l’Histoire tombera, parce que nous aurons, à l’évidence, manqué de pragmatisme ?
Depuis quand choisit-on dans l’horreur ? Dresde a été bombardée. Depuis quand peut-on choisir dans l’horreur alors que, nous avons maintenant le moyen de le savoir, il y a une incertitude sur la présence, parmi ceux que l’on appelle les rebelles, de l’État islamique, avec des ramifications cancéreuses que l’on ne contrôle pas ?
Nous, nous faisons le choix de tourner le dos à la Russie parce que nous sommes bien, parce que nous avons des principes, mais, en même temps, nous décorons le prince d’Arabie saoudite.
Entre les bons et les méchants, prenons garde qu’un jour l’Histoire ne dise que, pour faire les bons, nous avons été du côté des vraies brutes masquées.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires étrangères.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission de la défense, mes chers collègues, au début de ce débat dont le Gouvernement a pris l’initiative,
Exclamations sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains

je veux saluer le courage, le dévouement et l’efficacité des quelque 10 000 militaires français engagés dans vingt-quatre opérations militaires extérieures.
En Centrafrique, la décision du Président de la République d’engager nos forces a permis d’éviter des massacres de masse, de rétablir un niveau de sécurité satisfaisant et de mettre sur les rails un processus de transition politique.
Au Mali, le pire a été évité grâce à une décision prompte et résolue du chef de l’État. Les terroristes n’ont pu s’emparer de Bamako et ont dû lâcher prise au nord, écartant le risque de constitution d’un État terroriste qui aurait menacé directement la France, l’Europe et toute l’Afrique. La France joue depuis longtemps un rôle essentiel au Liban. Ses opérations contribuent aussi à la lutte contre la piraterie dans l’océan Indien et le golfe de Guinée, et participent au contrôle des flux migratoires en Méditerranée conformément à nos principes d’humanité.
Saluons, chers collègues, la mémoire des trente militaires tués en opérations extérieures depuis 2012, morts pour notre protection, et pensons aux souffrances de leurs familles, et à celles des cent cinquante militaires blessés.
Dans l’utilisation de la force, la France a toujours veillé à épargner le plus possible les populations civiles. Le Parlement a toujours été informé rapidement et en continu. Les opérations ont toujours été accompagnées d’un processus politique efficace, car gagner la paix est aussi important que gagner la guerre. Enfin, en mettant en oeuvre le 7. de l’article 42 du traité sur l’Union européenne, le ministre de la défense a su mobiliser et entraîner nos alliés européens qui, chacun en fonction de ses traditions et de ses moyens, ont répondu à cet appel de manière positive et utile. Mais comme le demande le Premier ministre, l’Europe doit s’engager davantage ; le fonds européen pour la sécurité et la défense, proposé par le Président de la République, doit être créé au plus vite.
Notre débat s’inscrit également dans le contexte de la préparation de l’offensive qui doit libérer Mossoul. Depuis plusieurs mois, Daech recule en Irak et en Syrie. Nos forces frappent les ennemis de la France là où ils se trouvent, c’est-à-dire à Mossoul et à Raqqa. C’est en effet à partir de ces villes que les attentats de Paris et de Nice ont été organisés, et c’est sur ces territoires que les djihadistes sont entraînés et préparent leurs actions. Je souligne que le siège d’Alep ne répond en rien à nos intérêts stratégiques. Daech n’est plus à Alep depuis 2013 et les combattants d’al-Nosra y sont quelques centaines tout au plus, et ne sauraient légitimer les bombardements criminels qui frappent cruellement les 325 000 personnes, dont 100 000 enfants, qui vivent encore dans la ville…

…et qui meurent tous les jours ou sont blessés par les bombes à fragmentation ou au phosphore, et les bombes « bunker » qui percent les sous-sols, larguées par le régime et – hélas – par l’armée russe.
La bataille de Mossoul s’annonce difficile. Les forces de Daech y sont nombreuses et déterminées. Elles se préparent à un combat urbain qui risque d’être long et coûteux en vies humaines. Car c’est la prise de Mossoul qui a permis à Daech d’acquérir un trésor de guerre important et un prestige immense auprès des terroristes. Frapper Daech à Mossoul, c’est l’attaquer à la tête. Nous devons aussi veiller à ce que cette bataille ménage la possibilité d’un avenir de paix pour l’Irak, ce pays qui a déjà tant souffert et qui est aujourd’hui menacé dans son identité même par l’exacerbation des tensions confessionnelles. Pour cela, nous avons, dès le début de l’intervention, promu une solution politique qui permette de réconcilier les Irakiens. Les forces au sol qui ont engagé le combat sont irakiennes, c’est-à-dire sunnites, chiites ou kurdes ; il en va de la survie de la nation irakienne, et la guerre contre Daech ne sera gagnée que si elle permet d’en réconcilier les trois principales composantes. C’est à ces forces qu’il appartiendra de reconquérir la ville, avec en particulier le soutien des forces françaises engagées dans le cadre de l’opération Chammal : nos pilotes basés en Jordanie ou dans les Émirats – dont j’ai pu admirer la compétence lors des visites que nous y avons effectuées avec le ministre de la défense –, ou encore embarqués sur le Charles de Gaulle, et d’autres éléments déployés en Irak, au Koweït et au Qatar. Nous connaissons leur dévouement, leur professionnalisme et la maîtrise avec laquelle ils accomplissent leurs missions.
Nous devons aussi veiller à ce que cette bataille n’ait pas des conséquences désastreuses pour la population. Nos frappes aériennes ne sont délivrées que sur des cibles militaires clairement identifiées afin de limiter au maximum les pertes civiles. Je sais également que la coalition se prépare à ce que cette bataille provoque d’importants déplacements de population, et je remercie MM. les ministres de bien vouloir nous préciser quels dispositifs sont engagés à cet effet. Voilà toutes les raisons pour lesquelles il est important, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, que notre assemblée vous exprime son soutien.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à Mme la présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la défense, madame la présidente de la commission des affaires étrangères – chère Élisabeth –, mes chers collègues, pour la commission que je préside, le débat que nous avons aujourd’hui n’est pas nouveau. Monsieur le ministre, nous vous auditionnons régulièrement à ce sujet : en moyenne une à deux fois par trimestre, et ce n’est pas peu dire ! La dernière fois, vous êtes intervenu sur les opérations en cours le 26 juillet, et vous interviendrez à nouveau devant notre commission le 16 novembre. La qualité de nos échanges tient à la fois à votre disposition et à la responsabilité dont font preuve les parlementaires vis-à-vis du respect du off. En effet, le suivi des opérations est bien la vocation première de nos travaux et l’enjeu ultime de cette période d’examen budgétaire.
Je ne répondrai pas aux provocations de M. Lellouche, ni entrerai dans la polémique qu’il souhaite susciter.

Philippe Nauche l’a déjà fait, et je suppose que Jean-Yves Le Drian le fera également. L’effort de guerre a un coût, et je voudrais vous faire partager quelques observations à ce sujet. Première observation : notre effort de guerre est durable. L’accroissement de nos dépenses militaires marque, après leur stabilisation en 2013, la fin d’un long cycle d’ajustement budgétaire au détriment de notre outil de défense. Tous les gouvernements y ont contribué. Il faut se féliciter de cette situation peut-être historique, en espérant que l’infléchissement des dépenses de défense s’inscrive dans le temps long car les menaces, qu’elles soient d’origine étatique ou non conventionnelle, ne diminuent pas et évoluent sans cesse.
Deuxième observation : il n’y a pas d’effort de guerre crédible sans adaptation des contrats opérationnels assignés aux armées. Fort heureusement, l’exercice budgétaire pour l’année 2016 et celui proposé pour 2017 tiennent compte des besoins nés de l’intensification du rythme d’activité des forces. Je le dis ici à l’endroit des comptables de l’État : le dépassement des contrats opérationnels fixés aux armées engendre des dépenses incompressibles. Il me paraît donc inévitable, à l’avenir, de rallier la cible de dépenses militaires à 2 % du PIB, évoquée par le Premier ministre : c’est le seuil minimal si l’on souhaite adapter les contrats opérationnels actuels à l’évolution des menaces et des missions.

J’observe avec satisfaction que cette cible semble désormais partagée par le plus grand nombre.
Troisième observation – et c’est l’idée principale que je souhaite développer devant vous –, il n’y a pas d’effort de guerre durable sans le soutien de l’arrière. Je veux parler ici des familles et de l’entourage de nos soldats. En effet, la suractivité qui découle de la nouvelle posture opérationnelle sur le territoire national entraîne l’usure des hommes et des femmes – car il y a également des femmes déployées –, mais également de leurs familles, en raison des lourdes contraintes d’absence du foyer familial endurées par les soldats. Il s’agit là d’une question prioritaire, en raison des conséquences qu’elle emporte sur l’attractivité du métier des armes comme sur la fidélisation des nouvelles recrues. J’insiste sur ces deux aspects. Vous y répondez, monsieur le ministre, à travers le nouveau plan d’amélioration de la condition militaire ; c’est une juste compensation des efforts demandés à nos soldats. Permettez-moi cependant d’insister sur ce point : le soutien des familles est une des conditions du succès opérationnel. Il appelle, je crois, une réflexion nouvelle de notre part sur les moyens d’y pourvoir, y compris – mais nous en débattrons encore – en matière de fiscalité applicable aux rémunérations des militaires en mission intérieure. La commission de la défense présentera les conclusions de ses travaux sur la protection sociale des militaires en janvier 2017. Des collègues y travaillent, et bien que nous serons dans une période déjà très proche des élections, …

…j’espère que leur rapport recevra l’assentiment unanime des membres de la commission de la défense.
Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames les présidentes, mesdames et messieurs les députés, je voudrais revenir sur quelques points majeurs évoqués dans ce débat, sans en faire l’exégèse complète, car les théâtres d’opération sont amenés à évoluer.
Pour commencer, je voudrais m’arrêter sur le cadre légal de notre engagement au Levant. Pour l’intervention militaire en Syrie, le Gouvernement a expressément exclu l’envoi de troupes au sol lors de sa déclaration du 15 septembre 2015 sur l’engagement des forces aériennes. Cette exclusion a été réitérée au moment du vote d’autorisation, le 25 novembre 2015. En revanche, la prolongation de l’intervention des forces françaises en Irak, décidée par le Parlement le 13 janvier 2015, ne fait pas une telle distinction.
Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.
En outre, au moment du débat – je le redis, monsieur Lellouche, et pourrais le redire encore –, le Premier ministre a explicitement indiqué que le dispositif français dans ce pays continuerait d’évoluer. Depuis de nombreux mois, des éléments terrestres chargés de la formation, du soutien et du conseil à l’armée irakienne et aux Peshmergas y sont déployés.
Mêmes mouvements.
À cet égard, le déploiement récent d’une unité d’artillerie de quatre canons CAESAR dans la région de Mossoul représente un simple prolongement de la mission d’appui des forces françaises aux forces irakiennes. Il ne diffère pas, en substance, de l’action que mène notre aviation de combat dans la même zone à partir des bases de l’armée de l’air ou du porte-avions Charles de Gaulle.
Il s’agit toujours de soutenir, par nos appuis, l’action et la progression des forces irakiennes et des peshmergas engagés au sol contre Daech. Il n’y a donc aucune raison de recourir à un nouveau vote du Parlement en la matière.
Je voudrais aussi dire à ceux qui estiment qu’il n’y a pas eu de débat sur nos interventions extérieures que depuis vingt-quatre mois, je suis passé vingt fois devant les commissions du Parlement. Je regrette que ceux qui se sont exprimés ici, notamment MM. Chassaigne, Collard ou Meunier, ne soient pas assidus à ces réunions où je rends compte, à huis clos, de l’ensemble de nos opérations. Ils y sont invités. Si vous voulez m’auditionner tous les quinze jours, je viendrai tous les quinze jours ; pour l’instant, les parlementaires semblent très bien se satisfaire du rythme d’une fois par mois.
M. Meunier et partiellement M. Folliot ont évoqué les effectifs, les moyens et la légitimité de notre action. Les principes des actions de projection de nos forces ont été inscrits dans le Livre blanc de 2008 et dans la loi de programmation militaire qui a suivi. Ils ont été repris et approuvés par le Parlement dans le Livre blanc suivant et dans la loi de programmation en cours. Mais vous avez, monsieur Meunier, la mémoire courte. Si l’on regarde les effectifs engagés aujourd’hui dans différentes opérations, on constate que 10 000 militaires participent aux opérations extérieures ; si l’on y ajoute les 4 000 prépositionnés en Afrique et aux Émirats arabes unis, 14 000 hommes en tout se trouvent à l’étranger. À la fin du mois de décembre, lorsque le porte-avions aura fini sa mission et que l’opération Sangaris sera terminée, les effectifs en opérations extérieures descendront à 7 000.
Étant bien conscient de votre compétence sur ces questions, je me suis référé à l’état des opérations extérieures en 2011. À cette date, il y avait 10 860 militaires en OPEX, sur des opérations très variées : la Libye, l’Afghanistan, le Liban – opération toujours en cours –, la Côte d’Ivoire, la RCA, l’opération Atalante, encore le Kosovo…
Et voici le plus curieux : au moment même où 10 860 militaires étaient mobilisés pour des opérations qui étaient sans doute en grande partie justifiées à cette époque-là, le Gouvernement diminuait les effectifs de 40 000 postes !
Protestations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.
Et vous venez nous faire la leçon ! Vous nous reprochez de trop intervenir, alors qu’à l’époque vous interveniez beaucoup plus, et de ne pas avoir assez d’effectifs, alors que c’est vous-mêmes qui avez pris la décision de les réduire.

Vous les avez diminués encore plus avec la loi de programmation militaire de 2014 !
Nouvelles protestations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.
Permettez-moi de poursuivre, monsieur Meunier, je ne vous ai pas interrompu, moi ! Je comprends que ces chiffres vous énervent, mais je continuerai à vous énerver en rappelant la dure réalité des chiffres. Peut-être n’étiez-vous pas député à cette époque, mais vous ne pouvez nier la réalité des faits !

Je les connais, les chiffres ! Vous avez supprimé 34 000 postes dans l’armée !
Je voudrais aussi, monsieur Meunier, compléter vos informations au sujet de l’entretien programmé des matériels. Là aussi, comparons les chiffres. Vous dites que le vieillissement des matériels, leur usure, s’aggrave à cause de l’importance des forces et des moyens engagés. Mais c’était aussi le cas sous la précédente législature ! Vous aviez alors engagé 10 000 hommes en OPEX…

10 000 hommes, mais pour quelle intensité d’opérations ? Ce n’est pas sérieux !
Pour 10 000 hommes en OPEX, dans des théâtres d’opérations où les conditions atmosphériques n’étaient pas meilleures que celles que rencontrent nos soldats actuellement, l’entretien programmé des matériels s’élevait à 2,8 milliards d’euros en 2011. J’ai fait porter ce montant à 3,65 milliards d’euros. Voilà la vérité ! Il est vrai que les matériels subissent une attrition plus forte : nous avons donc décidé de renforcer leur entretien programmé. Ceux qui sont assidus à la commission de la défense savent que cet engagement est tenu.
M. Nauche a évoqué l’opération Sangaris, de même que M. Meunier – sur un ton différent de celui qu’il a employé à propos des chiffres des OPEX. Je suis très heureux de constater que nous pouvons mettre fin à l’opération Sangaris. Nous allons mettre fin à une opération !
Monsieur Lellouche, nous y mettons fin, car cette opération a été un succès. Non seulement nous avons évité des massacres de masse, mais nous avons permis un processus de réconciliation intercommunautaire ainsi que la reconstruction de l’État centrafricain, avec des élections présidentielles et législatives. Nous avons mis en place un outil de formation de la nouvelle armée centrafricaine, baptisé EUTM RCA. Enfin, nous avons permis le déploiement de la mission des Nations unies, pour garantir sur le moyen terme la sécurité de ce pays.
Cette opération est la preuve du pragmatisme et de l’efficacité des hommes et des femmes qui se sont succédé sur ce théâtre difficile. Je serai heureux de clore officiellement notre intervention sur ce terrain et de passer le relais aux Nations unies le 31 octobre prochain. Nous n’abandonnerons pas pour autant la République Centrafricaine, car nous continuerons à appuyer et à soutenir les forces internationales.
Je tenais à faire cette mise au point, car c’est un événement important. Notre mission terminée, et même si la stabilité n’est pas totalement revenue, il importe à présent que le relais soit pris aussi bien par les forces centrafricaines que par la mission des Nations unies.
Je dirai deux mots, également, du Levant, et de l’opération Barkhane.
Les objectifs de notre stratégie au Levant sont clairs, et tiennent en deux mots : vaincre Daech. Cette organisation est notre ennemie, qui nous attaque sur notre propre territoire. Il faut la vaincre, et pour la vaincre il faut la frapper au coeur. Pour cela, nous avons trois objectifs d’application au Levant : premièrement, infliger à Daech une défaite militaire ; deuxièmement, renforcer les capacités des forces de sécurité irakiennes et kurdes qui combattent Daech au sol, en les aidant à se structurer sur la longue durée ; troisièmement, soutenir un processus de réconciliation irakien, car seules la stabilité et la crédibilité politiques garanties par les institutions irakiennes seraient de nature à empêcher la résurgence de Daech sur le long terme.
Il nous faut donc aider le processus de réconciliation irakien en encourageant la construction d’institutions multiconfessionnelles, inclusives et représentatives. Je dis cela à l’attention de M. Chassaigne, qui a soulevé une vraie question à propos de gouvernorat de Ninive : comment Mossoul sera-t-elle dirigée après sa reconquête ? Il faudra que les différentes communautés présentes dans cet espace – vous les avez rappelées : musulmans chiites et sunnites, kurdes, yézidis et chrétiens – soient bien représentées. C’est aux Irakiens de prendre les initiatives nécessaires pour assurer la stabilité après la reprise de Mossoul. Pour avoir rencontré un certain nombre d’entre eux, je sais qu’ils se préoccupent dès à présent de la manière dont ils prendront le relais.
J’ai déjà évoqué Mossoul lors de la séance de questions d’actualité. La bataille pour la reconquête de cette ville sera longue, pour trois raisons. Premièrement, parce qu’elle est d’une taille importante : on estime que le nombre d’habitants est compris entre 1,5 et 2 millions. Certains d’entre eux ont déjà quitté la ville depuis plusieurs mois. Deuxièmement, parce que c’est la capitale de Daech ; à cause de cela, les membres de cette organisation ont structuré une ligne de défense, creusé des souterrains, miné les entrées de la ville : il faudra du temps pour déjouer ces obstacles. Troisièmement, la coalition se montre très rigoureuse quant aux critères d’intervention. Nous sommes rigoureux quant aux frappes aériennes, quant à l’autonomie qui nous est laissée dans la coalition. Celle-ci doit donner son autorisation pour chaque type de frappe, chaque type de cible, afin d’éviter les dégâts collatéraux.
Tout à l’heure, j’ai cru entendre un orateur comparer la manière dont les Russes interviennent à Alep et la manière dont la coalition intervient à Mossoul. Les conclusions que l’on peut tirer d’une telle comparaison s’imposent d’elles-mêmes : depuis deux ans, la coalition a frappé de nombreuses fois – la France elle-même a mené de nombreuses frappes – : à chaque fois, les conditions d’engagement, les règles d’engagement, ont été scrupuleusement respectées, afin d’éviter les dégâts collatéraux. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas à Alep ; ce n’est pas, du moins, ce que donnent à penser les images que l’on voit à la télévision.
En complément d’information sur l’opération à Mossoul, je signale que les dispositifs d’accompagnement humanitaires ont été mis en place préalablement à l’opération. 750 000 places sont prévues dans des lieux d’accueil pour les réfugiés. Nous souhaitons qu’elles n’aient pas à servir, mais il importe qu’elles y soient.
J’ajoute, enfin, qu’après Mossoul il faudra prendre Raqqa. Cette question me préoccupe, ainsi que M. le Premier ministre – qui en a parlé tout à l’heure – et M. le ministre des affaires étrangères. C’est dans ces deux villes, en effet, qu’ont été organisés tous les attentats qui nous ont frappés, ainsi que d’autres pays européens.
Concernant l’opération Barkhane, il faut bien remettre en perspective les deux temps de notre intervention. Tout d’abord, lorsque nous sommes intervenus au mois de janvier 2013, c’était pour empêcher qu’Al-Qaïda, en descendant sur Bamako, ne se constitue un vaste repaire territorial, qui eût représenté une menace insupportable pour la sécurité de notre pays. Nous avons alors anéanti les groupes terroristes qui descendaient sur Bamako. L’opération Serval a ainsi permis d’éviter qu’un État terroriste s’implante au Sahel.
Nous avons considéré, par la suite, qu’il fallait agir selon une nouvelle perspective afin d’éviter la déstabilisation de la région. Pour cela, nous avons constitué un dispositif dénommé Barkhane, reposant sur un partenariat avec cinq pays, pour l’ensemble du Sahel, et visant à éviter la résurgence de groupes terroristes. Pour éviter les actions asymétriques des groupes armés, en effet, il faut exercer une pression permanente.
Le but de cette opération, à terme, est de faire en sorte que les différents pays concernés puissent assurer eux-mêmes, sur la durée, leur propre sécurité : cela prendra du temps. Pour cela, nous assurons des missions de formation, notamment dans le cadre de la mission EUTM Mali. Il est vrai que la mise en oeuvre des accords d’Alger a pris plus de temps que prévu. La détermination politique du président Ibrahim Boubacar Keïta pour les mettre en oeuvre concrètement dans les semaines qui viennent, avant le sommet France-Afrique de Bamako, me paraît assurée. Les premières initiatives à cet égard ont été prises.
Je tiens également à dire un mot de la Russie, puisque plusieurs d’entre vous y ont fait référence. Je rappelle qu’à la demande du Président de la République, après les attentats du mois de novembre 2015, je me suis rendu à Moscou. À l’époque, la question que j’avais examinée avec le ministre russe de la défense était de savoir comment nous coordonner dans la lutte contre Daech. Or vous avez pu constater comme moi que depuis cette rencontre, les forces russes se sont concentrées sur de tout autres objectifs que les soldats de l’État islamique ! Le combat contre ces soldats en Syrie est plutôt le fait de l’Armée syrienne libre, à Dabiq, et des forces kurdes avec leurs alliés arabes, à Manbij, mais pas des forces russes, qui sont pourtant bien présentes sur le terrain, où elles accompagnent le pilonnage d’Alep par les forces de Bachar Al-Assad.
Nous sommes donc prêts à dialoguer avec la Russie. C’est le cas sur des questions majeures d’intérêt commun telles que la lutte contre la prolifération des armes nucléaires, la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix internationale. Concernant la Syrie, il faudrait que les objectifs de telles discussions soient clairs, ce qui ne nous semble pas être le cas aujourd’hui.
Monsieur le président, mesdames les présidentes, voilà les quelques éléments que je souhaitais vous donner pour conclure ce débat. Je constate, comme vous, que l’environnement stratégique de la France et de l’Europe s’est dégradé depuis quelques années ; instabilité au Sahel, chaos en Libye, explosion du Moyen-Orient, crise ukrainienne : autant de défis. Face à ces crises, le repli n’est pas une option ; il n’apporterait qu’un soulagement transitoire, car ceux qui frappent depuis Mossoul proclament clairement qu’ils souhaitent nous détruire. À mon sens, l’action, l’action résolue, est la seule réponse possible.
Pour cela, notre pays peut compter sur une défense forte et respectée : je le constate depuis quatre ans et demi. Je rends hommage à nos forces armées qui remplissent leur mission au service de la France, et que vous avez tous saluées.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

Nous avons achevé le débat sur les opérations extérieures de la France.
La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-huit heures quinze, sous la présidence de Mme Catherine Vautrin.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2017 (nos 4061, 4125, 4126 à 4132).
La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances qui souhaite répondre aux orateurs qui se sont exprimé dans la discussion générale.
Je sais que Christian Eckert, qui va nous rejoindre, souhaitera aussi le faire, mais je vais d’emblée apporter quelques éléments de réponse au débat qui a commencé hier et s’est achevé cette nuit. Tout d’abord, je tiens à vous dire, mesdames, messieurs les députés, et non simplement par la politesse que doit un ministre aux parlementaires, que j’ai trouvé ce débat non seulement intéressant mais aussi instructif et que chacune des interventions – même s’il nous arrive parfois de répéter quelque peu les mêmes arguments – l’a nourri.
Je me permettrai une appréciation globale avant de la compléter en apportant plusieurs informations à votre Assemblée : j’ai trouvé que nombre d’interventions, et j’en remercie les orateurs, soulignaient l’importance – je ne dirai pas la qualité car ce n’est pas le sujet –,…
…disons le caractère approprié, des propositions qui sont les nôtres dans ce projet de loi de finances, à commencer du point de vue budgétaire puisque ici personne n’a mis en cause nos grandes priorités que sont, par exemple, l’emploi et surtout, bien entendu, les questions de sécurité ? Quant à la priorité qui tient à coeur au Gouvernement et que nous considérons consubstantielle à cette majorité, mais qui peut parfaitement être partagée sur d’autres bancs, c’est-à-dire l’éducation, je n’ai pas non plus entendu profondément mise en cause, pas davantage que les crédits que nous avons dégagés en sa faveur.
S’agissant des dispositions nouvelles, ou plus précisément des baisses d’impôts nouvelles que nous proposons d’appliquer dès 2017, je n’ai pas entendu de critiques frontales, je pense à la baisse d’un milliard de l’impôt sur le revenu, n’ayant entendu personne dire qu’il fallait voter contre. Certes, j’ai noté des critiques sur la concentration de l’assiette de cet impôt, mais je rappelle que celle-ci n’est que le retour à la période précédente puisque 46 % des ménages concernés correspond au plus au chiffre de 2007-2008. Par conséquent, nous en reviendrons à une situation que la majorité de l’époque ne considérait pas comme une concentration abusive. Si cette mesure aura un effet immédiat dès 2017, je rappelle qu’elle se traduira en termes de trésorerie en 2018, et qu’il s’agit d’une mesure fondamentale que tout le monde soutient, M. Sansu également, et il va évidemment la voter. J’ai entendu des critiques de sa part qui sont bien sûr à la fois parfaitement légitimes et habituelles, mais aussi de la considération pour ce budget. S’il s’était laissé aller, et il aurait pu le faire, il aurait dit que celui-ci était au moins plus à gauche que les précédents. Je suis sûr qu’il y était prêt…
C’est aussi, monsieur le député, une autre manière de dire un peu plus à gauche – ce doit être mon côté optimiste par nature, même lorsque je vous écoute.
Sourires.
Bref, je n’ai entendu sur aucun banc une remise en cause fondamentale du budget pour 2017. Et j’en viens à un point important du débat.
Les principales critiques reposaient sur le thème des bombes à retardement, sachant que dans ce type de discussion chacun a souvent tendance à reprendre la même image que celle des orateurs précédents. J’ai donc beaucoup entendu parler de bombes à retardement cachées dans ce budget.
Le président de la commission des finances m’a confirmé qu’il en a vu beaucoup. Parlons donc de ces soi-disant bombes, et je vous remercie de votre présence parmi nous car cela nous permettra d’être un peu plus encore à la hauteur du débat entamé hier. Dans votre bouche, il s’agit d’une mesure votée maintenant et qui n’aurait des effets qu’à partir de 2018, voire en 2019 ou en 2020.

Et qui coûterait beaucoup plus cher que si elle avait été appliquée en 2017 !
Si j’écoute ce raisonnement, cela voudrait dire que le budget annuel, en l’occurrence celui voté pour l’année 2017, ne devrait jamais avoir le moindre effet sur les années suivantes, autrement dit qu’il faudrait avoir une vision de courte vue, presque une annualisation, certes seulement budgétaire, de la pensée politique en ce domaine.
Ne vous sentez pas immédiatement concerné, monsieur de Courson, quand je parle d’annualisation de la pensée : cela ne signifie pas rétrécissement de la pensée, mais tout de même dans le temps de la réflexion alors que le temps budgétaire, et il en a toujours été ainsi, consiste aussi à se projeter au-delà de l’année à suivre, c’est-à-dire en 2018, en 2019, en 2020… C’est même la grandeur du débat politique autour d’un budget que de ne pas trop le faire résonner sur une seule année mais sur plusieurs. La meilleure preuve, mesdames, messieurs les députés, en est que la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF oblige à juste titre le Gouvernement à inscrire notre budget dans un cadre pluriannuel. Vous avez eu par conséquent à débattre d’un projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Ce texte a-t-il prévu que rien ne changerait en 2018 par rapport à 2017 ? Non, d’autant qu’elle avait intégré deux éléments très importants auxquels je vous demande d’être attentifs les uns et les autres, et monsieur le président de la commission des finances, je suis sûr que vous l’êtes déjà parce que vous nous avez déjà réclamé des actualisations de la programmation pluriannuelle et que nous en avons débattues pour l’année 2018.
Le premier élément, c’est que nous avons intégré dans cette vision pluriannuelle les effets d’une baisse d’impôts. Il nous est arrivé par le passé, y compris à votre majorité de l’époque, de voter dans un budget des baisses qui avaient des effets progressifs sur plusieurs exercices – je pourrais en citer des exemples, et nous l’avons fait pour le CICE et par des baisses de cotisations étalées sur plusieurs années, étape après étape. Cela s’appelle donner la visibilité et donc de la capacité aux entreprises et aux foyers de savoir à peu près ce qu’il va se passer non seulement quarante-huit heures plus tard, douze mois plus tard, mais aussi vingt-quatre mois ou trente-six mois plus tard. C’est une bonne manière de faire. Elle nous est d’ailleurs réclamée par les acteurs économiques, qui veulent avoir de la stabilité dans la visibilité – en tout cas de la visibilité si on baisse leurs impôts. Le Gouvernement avait donc intégré dans ses perspectives pluriannuelles 5 milliards de baisses d’impôts… Monsieur le président Carrez, y aura-t-il des effets dépassant 5 milliards au terme de nos propositions en la matière ?
La réponse est non et je peux vous en faire la démonstration. Il y a un sujet que vous avez abordé régulièrement, et vous avez raison : le CICE, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. En effet, le crédit d’impôt n’est pas perçu l’année même de son application mais l’année suivante puisqu’il faut savoir quelles en ont été les conséquences pour pouvoir en calculer le montant. Il a donc par définition un effet l’année n+1. Ce n’est pas un tour de passe-passe mais la définition même du crédit d’impôt, qu’il s’agisse des entreprises, en l’espèce le CICE –, ou des foyers, en particulier des foyers modestes, je pense en particulier aux personnes âgées dans le cadre de la prise en charge partielle du coût du maintien à domicile pour favoriser l’embauche du personnel. Ces deux crédits d’impôt réunis représentent moins que 5 milliards. Ajoutons celui sur lequel nous allons discuter par voie d’amendement puisqu’il n’est pas inscrit dans le projet de loi de finances, à savoir celui sur la taxe sur les salaires… J’entendais parfois évoquer des bombes à retardement à hauteur de 10 milliards : non, ce sera de l’ordre de 5 milliards. Vous pourriez nous reprocher, monsieur le président de la commission des finances, de préempter l’étiquette « baisse d’impôts » pour 2017 par rapport à ce que nous avions prévu pour l’année suivante, mais je vous rappelle que vous ne nous avez pas fait ce reproche il y a deux ans. La proximité d’une élection interdirait-elle de se projeter dans l’avenir, dans l’année qui suit ou même dans les deux années d’après ? Ce n’est pas ma vision de la politique budgétaire. S’il doit y avoir une alternance, comme il y en a déjà eu dans le passé, la majorité en tirera les conséquences et prendra des décisions, mais en l’occurrence en toute connaissance de cause. Par conséquent, je le répète une fois encore : il n’y a aucune bombe à retardement s’agissant des baisses d’impôts qu’il vous est proposé, mesdames, messieurs les députés, de voter dès ce budget et qui auront des effets en 2018 ou en 2019, et elles entrent parfaitement dans notre programmation pluriannuelle.
J’en viens à la seconde caractéristique de ce budget à propos de laquelle vous-même, monsieur le président Carrez, ainsi que M. Mariton, avez formulé des remarques intéressantes : je veux parler de la question de l’évolution des dépenses publiques. Dans la loi de programmation, vous souvenez-vous quelle hypothèse nous avions prise pour 2018 ? Mais je sais que vous n’êtes pas obligé de l’avoir en mémoire…
En effet, il a parfaitement raison.
Il s’agit du même niveau que pour 2017, celui que vous trouvez malgré tout moins sérieux que les années précédentes. Le Gouvernement et la majorité qui seront alors en responsabilité devraient donc s’appliquer à eux-mêmes cette discipline : pas plus de 1,6 % d’évolution des dépenses publiques, discipline que nous allons nous appliquer à nous-mêmes en 2017. Il ne s’agit pas d’une bombe à retardement, mais seulement de la reproduction du sérieux que nous nous imposons aujourd’hui. Quelqu’un aurait-il ici envie d’être moins sérieux en 2018 que nous ?
En tous les cas ce ne sera pas notre cas quand nous aurons, dans la continuité de notre action, à agir toujours pour proposer des budgets, les faire voter et les appliquer, que ce soit en 2017 ou dans les années suivantes. Voilà ce que je tenais à rappeler car ceux qui n’ont plus rien ou quasiment à critiquer – en dehors des reproches habituels et convenus, qu’il nous est arrivé de formuler aussi dans l’opposition, notamment sur la sincérité ou non d’un budget, autrement dit en dehors de ce que nous avons tant l’habitude d’entendre tous les ans qu’on finit par s’en lasser – veulent reporter leurs critiques sur 2018 en évoquant des bombes à retardement. Il n’y en a aucune.
On était tranquilles, jusqu’à ce que vous vous réveilliez, madame la députée.
Protestations sur les bancs du groupe Les Républicains.
Je fais en effet preuve d’un comportement beaucoup trop désagréable car je vous ai écoutée hier avec attention et répondu avec respect. je vous ai d’ailleurs dit vous trouver cette année plus modérée dans vos critiques que les années précédentes, ce qui prouve que, parfois, l’approche des élections rend certains sages.
J’en terminerai sur les bombes à retardement : elles ne sont pas dans nos propositions mais, par anticipation, dans la série de propositions que je vois fleurir parmi ceux qui sont aujourd’hui concurrents dans une primaire et susceptibles d’être demain candidats à la présidentielle,…
…propositions où ne cessent de s’accumuler, pour des milliards et des milliards, des baisses d’impôts immédiates et des diminutions de dépenses publiques remises à plus tard ! Là est la vraie bombe à retardement : dans de telles propositions. Chez nous, on fait les choses sérieusement, elles peuvent parfaitement être discutées, c’est la démocratie et l’objectif de notre débat ; quant aux bombes à retardement, je les vois déjà de ce côté-là de l’hémicycle.
Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics.
Madame la présidente, je voudrais répondre à certains points précis que les orateurs de cette discussion générale ont soulevés.
Tout d’abord, plusieurs ont abordé la question de l’augmentation de l’impôt sur le revenu, en valeur. Vous nous avez dit, avec raison, mesdames et messieurs les députés, que le produit de l’impôt sur le revenu a augmenté de près de 14 milliards d’euros entre 2012 et 2017.
De 13,9 milliards, admettons ! Ce que vous n’avez pas dit, c’est d’où viennent ces 14 milliards. Premièrement, 2,1 milliards d’euros viennent de la suppression de la prime pour l’emploi – PPE –, qui a été transformée en prime d’activité.
Deuxièmement, 3 milliards viennent de l’intégration des prélèvements forfaitaires libératoires à l’impôt sur le revenu, puisque le barème de l’impôt sur le revenu s’applique désormais aux revenus du capital : ce qui était comptabilisé à part est aujourd’hui intégré à cet impôt.
Ainsi, personne ne peut contester que, sur les 14 milliards, 5,1 milliards sont liés à des mesures de périmètre et 5,5 milliards proviennent de mesures décidées avant mai 2012, alors que les mesures décidées après ont notamment conduit à une baisse de l’impôt sur le revenu, de 8,2 milliards.
Le reste provient de l’évolution spontanée de l’impôt sur le revenu. Ainsi, comme je l’évoquais hier, l’évolution de la masse salariale, de 2,5 % à 3 %, provoque immanquablement une hausse de l’impôt sur le revenu, supérieure à l’augmentation en valeur, compte tenu de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Cette augmentation s’élève à 6,2 milliards d’euros.
Mesdames et messieurs de l’opposition, cessez donc de dire que l’augmentation du produit de l’impôt sur le revenu, de 14 milliards, vient des décisions qui ont été prises après mai 2012. C’est factuellement faux : plus de 5 milliards proviennent de mesures de périmètre ; 6 milliards sont issus de l’évolution spontanée l’assiette ; le reste vient, pour l’essentiel, – et j’en suis désolé pour vous – de la montée en puissance des mesures prises avant mai 2012. J’en tiens le détail à votre disposition.
Beaucoup a par ailleurs été dit sur la dette, les risques, notamment la prise en compte des primes à l’émission, qui s’élevaient à 22 milliards d’euros en 2015 et à 17 milliards d’euros en 2016. C’est d’ailleurs dans ce projet de loi que, pour la première fois, mesdames et messieurs les députés de l’opposition, vous trouvez inscrit le montant des primes à l’émission que nous attendons pour 2017, soit 4 milliards d’euros. Celles-ci sont tout simplement dues aux taux négatifs des emprunts à 8 ou 9 ans. En émettant des emprunts à 10 ans, il est possible de bénéficier de primes, de façon à conserver des taux positifs. J’ai décrit à plusieurs reprises dans cet hémicycle les conséquences d’une émission à taux zéro.
S’agissant du taux d’intérêt inscrit dans ce projet de loi de finances, nous avons pris comme base de calcul le taux de 1,25 % pour la fin d’année 2017. Aujourd’hui, les taux d’émission avoisinent 0,3 %, soit près d’un point de moins. Nos prévisions sont prudentes. C’est d’ailleurs ce qui nous permet, comme vous le soulignez souvent, mesdames et messieurs les députés de l’opposition, de faire des économies de constatation : lorsqu’un taux de 1,25 % a été prévu, et que le taux réel s’élève à 0,3 %, de moindres dépenses sont à constater en fin d’année.
En ce qui concerne les mesures que vous contestez, mesdames et messieurs les députés de l’opposition, en évoquant tantôt des bombes à retardement, tantôt des recettes de poche, qui a inventé le cinquième acompte à l’impôt sur les sociétés ? Créé par le projet de loi de finances rectificative pour 2005, il a été durci quelques années plus tard. Aujourd’hui, les entreprises le considèrent comme une façon d’acquitter, par anticipation, des charges qui, de toute manière, seront imputées à l’exercice en cours.
Il en va de même des prélèvements forfaitaires obligatoires. Étant donné qu’ils sont perçus par les banques au moment du versement des intérêts ou des dividendes, faire intervenir leur reversement dans le budget de l’État à ce moment, mois après mois, ne pénalise ni les épargnants, ni les banques. Compte tenu des taux d’intérêt négatifs sur le court terme, ces dernières n’en sont finalement pas fâchées du tout.
Quant au prélèvement à la source, sur lequel j’aurai naturellement l’occasion de revenir en détail, il a fait l’objet de nombreuses postures.
Un site internet a été mis en ligne ce matin sur ce sujet.
Un excellent site !
Toutes les questions que vous vous posez, mesdames et messieurs les députés, y trouvent réponse. Certes, il est destiné au grand public, mais, compte tenu de ce que j’ai entendu, il n’est pas inutile que certains parlementaires puissent s’y informer, en dehors des postures que beaucoup peuvent prendre.
Enfin, tout a été dit sur les prévisions de consensus.
À Monique Rabin, pour laquelle le produit intérieur brut ne représente pas l’alpha et l’oméga, je répondrai qu’à la suite de l’adoption d’une proposition de loi déposée par l’une de ses collègues visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques, une seconde version comprenant d’autres paramètres sera donnée à l’ensemble des parlementaires dans les jours à venir.
Le débat sera certainement nourri. Je me suis contenté pour ma part d’apporter quelques précisions très factuelles et techniques aux questions soulevées.

Nous abordons l’examen de l’article liminaire.
Plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Éric Alauzet.

Monsieur le ministre, année après année, la question du caractère structurel ou conjoncturel du déficit est posée. Je m’interroge sur l’intérêt et la pertinence de ce débat, qui ne serait utile que si des excédents alternaient avec des déficits transitoires, donc s’il existait des cycles. Cela éviterait que des politiques de court terme ne soient menées, selon les résultats de l’année en cours, en lissant les hauts et les bas.
En réalité, il n’existe plus de cycle depuis quarante ans : cela fait quarante ans que nous enregistrons des déficits ! Certes, une ondulation subsiste, qui est non seulement de plus en plus faible, mais aussi inscrite dans une courbe baissière globale, avec cinquante ans de baisse de croissance – 1 point en moins tous les dix ans –, qui l’efface complètement.
Non content de m’interroger, je m’inquiète également car, depuis trois ans, le déficit conjoncturel s’accroche à 1,6 %. Finalement, depuis quarante ans, la France accumule de la dette – structurelle –, au nom du déficit conjoncturel. Au fond, je crains que, distraits par ce débat, nous ne minimisions le problème pour, en fin de compte, accroître l’endettement. Nous devons donc a minima nous interroger sur le positionnement du curseur entre déficit conjoncturel et déficit structurel puis, plus profondément, sur le sens même de cette différenciation.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, je vous répondrai sur trois sujets qui semblent vous avoir marqués : les bombes budgétaires, l’impôt sur le revenu et les primes d’émission.
S’agissant des bombes budgétaires, je n’évoquerai que celles à plus d’un milliard d’euros, en premier lieu le CICE. Vous oubliez de rappeler, monsieur Sapin, que, pour les grandes entreprises, la loi de programmation prévoyait la suppression de la contribution sociale de sécurité des sociétés – C3S – à hauteur de 3,2 milliards.

Or vous y avez renoncé, pour réaliser 3,2 milliards d’euros d’économies, une mesure qui ne figurait pas dans la loi de programmation.
C’est prévu… et cela ne dépasse pas le montant prévu !

Cela représente un avantage pour les entreprises en 2017, qui n’est répercuté dans le budget qu’en 2018. Cela s’appelle donc bien une bombe budgétaire de 3,2 milliards.
En outre, les quatre mesures d’anticipation des recettes, à hauteur d’1,3 milliard, poseront problème l’année prochaine, à moins de demander des acomptes de 120 %, pour ramener les recettes de 2018 en 2017.
Ce n’est pas ce qui a été fait.

Par ailleurs, vous lancez un crédit d’impôt pour les personnes âgées, afin de faciliter l’emploi à domicile, mesure largement approuvée par cet hémicycle, mais qui n’aura d’incidence qu’en 2018. Il reviendra donc à votre successeur de se débrouiller pour l’intégrer.
La réponse est : non !

Vous avez promis 5 milliards d’euros, monsieur le ministre. Ils ne figurent pas dans le budget. Selon vous, cela n’est pas grave : nous vendrons quelques actifs publics pour le financer. Mais là où le bât blesse, c’est que ces 5 milliards sont considérés comme des dépenses budgétaires. Aucun investisseur avisé ne placerait 5 milliards d’euros dans Areva.

Monsieur de Courson, les deux minutes sont écoulées.
La parole est à Mme Karine Berger.

L’article liminaire que nous examinons est directement lié à l’adoption par la France du TSCG. Il nous apprend qu’après deux années de report autorisé par la Commission européenne, le déficit public de la France se situera en deçà de 3 %. Je rappelle, notamment aux députés de l’opposition, que, l’année prochaine, la France, certainement le dernier pays en procédure de déficit excessif, pourra en sortir, notamment grâce à cette proposition.

Nous revenons à un déficit nominal inférieur à 3 %. En novembre dernier, à la suite des attentats du Bataclan, monsieur le ministre, vous aviez publiquement dit qu’une partie des dépenses du budget pour 2016 et 2017 pourrait bénéficier des mesures de flexibilité du pacte de stabilité et du TSCG. Ces pactes, rappelons-le, ne sont pas uniquement des règles, mais aussi des actes politiques. La sécurité et les crises, notamment en matière d’immigration, permettent aux pactes de ne pas s’appliquer de manière « bête », pour reprendre un terme utilisé il y a quelques années par M. Monti.
Vous aviez annoncé le 19 novembre, monsieur le ministre, que vous souhaitiez que la France bénéficie de cette flexibilité. M. Moscovici vous avait répondu publiquement que cela pourrait être le cas. Depuis lors, la Belgique et l’Italie en ont bénéficié. À ma connaissance, la France ne l’a pas demandée. Pourriez-vous en indiquer la raison aujourd’hui ? Quels taux de croissance potentielle, déficit structurel et déficit conjoncturel allez-vous notifier à la Commission européenne, sachant que vous ne recourez pas à cette flexibilité ?
Aucune des situations que vous avez décrites, monsieur de Courson, n’est une bombe à retardement.
Une bombe à retardement, c’est une bombe que l’on n’a pas vue…
…et qui explose à vos pieds. Aujourd’hui, ces mesures sont inscrites dans le budget. Chacun peut en mesurer les effets, les discuter et, éventuellement, les refuser, tout étant transparent, clair et net.
Les crédits d’impôt – vous en avez cité deux – qui auront des effets en 2017, soit pour les entreprises, soit pour les ménages, auront un effet budgétaire en 2018. Qui le cache ? Ni vous, ni nous ! Pourquoi cacherait-on la caractéristique même d’un crédit d’impôt ? Les effets de moindres recettes en 2018 sont donc connus par avance. Seront-elles supérieures aux 5 milliards déjà prévus ? La réponse est non. Nous sommes donc exactement dans les clous. Nulle surprise, nulle « bombe » dont l’effet serait supérieur à celui prévu !
Il n’y aura aucune surprise ! Vous ne serez pas surpris, en 2018 ou à la fin de 2017, monsieur de Courson, lorsque dans la même configuration qu’aujourd’hui vous discuterez en tant qu’opposant de talent…
…du budget pour 2018 que nous vous présenterons
Sourires
Je ne dis pas que je serai moi-même concerné ! À un moment donné, il faut savoir laisser la place aux jeunes – il ne faut pas qu’ils soient trop jeunes non plus car ils doivent avoir un peu d’expérience pour ces ministères difficiles que sont ceux de l’économie, des finances, des comptes publics !
Vous citez souvent, monsieur de Courson – et je ne vous en ferai pas le reproche – des mesures qui sont donc dans le budget, qui ne sont pas cachées, mais qui il est vrai avancent en 2017 des recettes qui auraient dû être perçues en 2018. Votre raisonnement reste néanmoins faux dès lors que vous considérez que les recettes attendues en 2018 baisseront. Ce n’est pas vrai ! Comme ce sont des mesures pérennes, elles auront le même effet de 2019 à 2018, etc.
Si vous voulez me faire dire que nous ne retrouverons pas en 2018 l’effet de 2017, c’est évident, personne ne le cache !
Mais si vous dites, comme c’est le cas, qu’une bombe à retardement explosera parce que les recettes baisseront en 2018, c’est faux ! C’est simplement et factuellement faux !
Cherchez autant que vous le voudrez, monsieur de Courson, mais vous ne parviendrez pas à me prendre en défaut sur ce sujet !
Enfin, je termine sur la question extrêmement importante d’Areva qui doit être traitée avec le sérieux nécessaire. Pourquoi ? Nous débattrons, éventuellement ici, du problème de la nécessaire recapitalisation d’EDF – nous l’avons déjà annoncée – mais personne ne conteste qu’il s’agit, comme on dit, d’un investissement avisé.
Cela n’a donc aucun effet « maastrichien » sur le déficit, aucun. Le financement est nécessaire et si vous me posez la question : « Avez-vous l’argent dans le CAS Transition énergétique ? », qui est un peu là pour cela, je vous répondrai positivement si c’est le cas et si cela ne l’est pas, je ferai en sorte de l’avoir – moi, nous ou d’autres en 2018, c’est normal, c’est le jeu même de la gestion des avoirs de l’État, c’est comme cela.
Qui aurait aujourd’hui l’imprudence, en particulier dans le cadre des négociations menées, d’affirmer que telle part, tant de milliards – puisque vous parlez de milliards – relèveront de l’investissement non-avisé, donc d’une « aide dite d’État », certes peut-être autorisée mais avec des effets sur le déficit ? Qui peut le dire ? Personne ! J’ai reproché précisément au Haut conseil des finances publiques de pointer que la somme nécessaire à la recapitalisation d’Areva ne figure nulle part, mais nulle personne avisée et responsable, nul négociateur d’une recapitalisation – dans ce domaine ou dans un autre – peut annoncer à l’avance les acteurs et le fruit d’une telle recapitalisation.
Vous évoquez chaque fois la somme de 5 milliards, et elle est exacte, mais elle inclura des investissements autres que ceux de l’État. Combien ? Vous le savez ? Non, et moi non plus – je dirais… le plus possible !
Écoutez-moi, monsieur de Courson ! Je sais que vous connaissez tout cela et que vous pouvez comprendre mon raisonnement. Plus les investisseurs avisés seront nombreux et moins l’apport de l’État sera considéré comme une aide publique. In fine, il est même possible qu’il soit nul – je ne dis pas que c’est cela qui se passera…
…mais, dans l’absolu, c’est possible. À combien s’élèvera donc l’aide de l’État ? Je l’ignore et je ne le dirais d’ailleurs pas car cela reviendrait à exposer à l’avance les résultats de négociations très subtiles et très complexes que nous menons en particulier avec les Chinois, les Japonais et bien d’autres investisseurs encore qui ont envie d’investir dans Areva.
Voilà pourquoi votre raisonnement, de ce point de vue-là, n’est pas valable et même dangereux eu égard aux intérêts de la France.

Nous en venons à la discussion des amendements.
La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 725 visant à supprimer l’article.

L’article liminaire occupe une place toute particulière suite, je le rappelle, aux dispositions fixées par la loi organique du 17 décembre 2012. En langage courant et comme l’on disait à l’époque : c’est la mise en oeuvre de la règle d’or…

…négociée lors du précédent mandat législatif par l’ancien Président de la République, M. Sarkozy, laquelle devait être renégociée par le Président Hollande et qui ne l’a pas été.
Cette règle d’or prévoit donc une trajectoire des finances publiques avec une loi de programmation visant à l’inscrire avant l’article 1er du PLF de manière à ce qu’elle y soit intégrée.
La non-renégociation du traité intergouvernemental européen, le TSCG, constitue à mes yeux de député du Mouvement républicain et citoyen le péché originel du quinquennat. Cela s’est traduit par une stratégie de redressement des finances publiques opérée à partir de 2012, certes, mais qui a échoué : croissance nulle ou faible, chômage croissant, redressement très lent des finances publiques, même la relative amélioration que pouvait être la prise en compte du solde structurel n’a pas été saisie puisque l’on s’est focalisé sur le solde effectif et sa composante conjoncturelle, grevés par la politique européenne d’austérité – la politique menée n’est pas à proprement parler d’austérité mais une logique a été imposée à la France, dont nous nous sommes accommodés.
Cet article liminaire reflète une obsession européenne des déficits aveuglément idéologique à l’heure où les résultats de l’économie allemande soulèvent de plus grands problèmes à l’Union européenne en termes de résultats économiques, ce qui n’est bon ni pour notre pays, ni pour l’Europe, d’où cet amendement de suppression.

La parole est à Mme Valérie Rabault, rapporteure générale de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, pour donner l’avis de la commission.

Comme toujours, cet article liminaire a suscité de longues discussions en commission des finances, laquelle a rejeté cet amendement.
Le déficit nominal résulte de la somme de deux composantes : le déficit structurel et le déficit conjoncturel. Cela me semble assez sain sur le plan économique parce que cela permet de déterminer ce qui relève de la crise et ce qui relèverait de notre incapacité à mobiliser tous les facteurs de production ou toute notre intelligence pour faire redémarrer la croissance. Avis défavorable, donc.
D’autres amendements, en commission, ont permis de discuter du fait qu’il n’y aurait plus de cycles économiques, la conjoncture comptant pour rien, ce qui revient ni plus ni moins à dire que notre croissance potentielle serait très faible, donc à ne pas croire aux capacités et aux atouts de notre pays.
Pour cette raison, avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances, pour donner l’avis du Gouvernement.
Exactement le même avis.
Nous ne menons pas une politique d’austérité. Un budget qui prévoit une augmentation des dépenses publiques de 1,6 % ferait envie à bien des pays que je connais et qui ont connu des restrictions budgétaires considérables !
Comme vous le savez, nous ne sommes pas aujourd’hui soumis à la contrainte de tel ou tel traité. Nous agissons parce que c’est l’intérêt de la France et parce que nous nous situons dans un mécanisme de coopération européenne, en particulier autour d’une monnaie. Nous pouvons débattre sans fin, nous pourrions même recommencer nos débats autour des vertus de la monnaie unique mais celle-ci implique que nous respections entre nous un certain nombre de règles.
Je souhaite profiter de la discussion de cet amendement, madame la présidente, pour donner quelques éléments de réponse à Karine Berger – même si les discussions pourraient être plus longues. Pourquoi n’avons-nous pas utilisé les flexibilités offertes par le traité en défalquant du déficit une partie ou la totalité des dépenses de sécurité ?
Tout d’abord, qu’est-ce que cela aurait changé pour notre budget de 2017 ?
Avez-vous le sentiment que nous ne mettons pas assez d’argent dans tel ou tel domaine ?
Parmi nos priorités : l’éducation. Il n’y aurait pas assez d’argent dans ce secteur ? Monsieur Cherki, vous voterez contre nos propositions augmentant de 3 milliards les crédits dédiés à l’éducation par rapport à ce qui était prévu. Ne consacrons-nous pas assez d’argent à la défense – puisque nous venons d’en parler ? Nous augmentons considérablement les crédits. Ne consacrons-nous pas assez d’argent au travail ?
Objectivement, je ne vois pas aujourd’hui ce que cela changerait. D’un point de vue juridique, du point de vue du traité, cela ne change pas grand-chose tant que le déficit nominal demeure au-dessus de 3 %.
Où je vous rejoins : lorsque le déficit se situe en deçà et dès lors que l’obligation européenne porte sur quelque chose de beaucoup plus complexe et subtil que les nombreux économistes, ici, parviennent à manier plus intelligemment que moi – le déficit structurel. À ceux ou celles qui me font remarquer que d’autres pays ont utilisé cette flexibilité, je leur fais remarquer à mon tour que c’est précisément dans ces cadres-là qu’ils ont agi – c’est notamment le cas de la Belgique mais, aussi, d’autres pays, et c’est parfaitement légitime.
De quelle flexibilité la France a-t-elle bénéficié ? De celle qui nous a permis de repousser de deux ans, en 2014, au début de 2015, le nécessaire passage sous la barre des 3 %. Cela, je l’ai voulu, cela, je l’ai négocié, cela, j’ai fait en sorte que nous puissions l’obtenir. La diminution si rapide des déficits initialement prévue était parfaitement contradictoire avec la reprise de la croissance que nous voulions. La preuve : nous sommes parvenus à réduire nos déficits et la croissance a repris en 2015 et 2016. Tel est le bon équilibre entre réduction des déficits et croissance supplémentaire.
C’est pourquoi, au-delà de l’intérêt méthodologique et pour ainsi dire « universitaire » de ce débat, ce que vous proposez n’aurait rien changé pour la France, rien. Demain, lorsque nous serons sous le seuil des 3 %, que d’autres le seront aussi et que l’on nous demandera si nous avons diminué notre déficit structurel – c’est déjà difficile de rencontrer un déficit au coin de la rue, mais un déficit structurel, c’est encore plus compliqué à croiser conceptuellement ! (Sourires) – lorsque le débat portera sur ce sujet, comme ce fut le cas pour les autres pays, ces discussions seront utiles. Il faut d’ailleurs commencer dès maintenant à les mener, et c’est ce que nous faisons. La discussion avec la Commission a évolué sur ces points-là et cette dernière prend en compte de telles flexibilités. Aujourd’hui, c’est un peu prématuré compte tenu de la situation : passons d’abord sous le seuil des 3 %, revenons à un état antérieur que la droite nous avait fait abandonner depuis longtemps et excessivement. C’est aujourd’hui la gauche qui est la garante du sérieux budgétaire !

Je voterai, bien entendu, l’amendement présenté par M. Laurent et je vais expliquer pourquoi car il en va de la philosophie même du budget.
Il est tout de même assez incroyable qu’un projet de loi de finances de notre État commence par inscrire un chiffre qui ressemble à un fétiche : l’article liminaire, en effet, explique que l’objectif du budget, c’est de faire moins de 3 % de déficit. Il est tout de même incroyable que cela soit le seul objectif et horizon des politiques publiques, que toutes les puissances de l’État y soient consacrées !
Quitte à inscrire un article liminaire, pourquoi ne disposerait-il pas que nous diminuerons le taux de pauvreté de 10 %, que nous préserverons l’égalité territoriale, que nous permettrons à nos services publics de se développer ? Vouloir conserver comme premier indicateur le respect des 3 % prouve que ce ne sont pas ceux qui pensent au destin collectif qui ont gagné mais ceux qui pensent d’abord au destin des marchés financiers.
Les marchés financiers sont contents lorsque l’on fait du déficit. Ils gagnent de l’argent !

M. Laurent n’a pas bien lu le traité budgétaire, qui prévoit un ajustement structurel de 0,5 point de PIB – pas annuel. Le projet, c’est écrit noir sur blanc, prévoit un ajustement de 0,3 point de PIB.
Nous ne sommes donc pas – que l’on s’en réjouisse, ou non – dans la trajectoire du traité budgétaire et, pour répondre à la question de Karine Berger, il y a bien une flexibilité de 0,2 % de PIB.
L’amendement no 725 n’est pas adopté.

La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 362 .

Comme le disait Mme la rapporteure générale, la distinction entre le déficit conjoncturel et le déficit structurel n’a de sens que si vous êtes tous persuadés de la théorie dite de Juglar. Vous le connaissez tous et vous avez tous lu ses oeuvres sur la théorie des cycles économiques, qui durent, grosso modo, cinq ou six ans – M. Pierre-Alain Muet a beaucoup enseigné ces théories. Dans ce modèle, on pouvait connaître le déficit structurel en fonction de la position dans le cycle.
Mais, mes chers collègues, si les cycles économiques existent toujours, le déficit conjoncturel doit être, grosso modo, positif pendant trois ans, et négatif pendant trois ans. Or, d’après l’article préliminaire, il est toujours à 1,6 %. C’est impossible ! Vous me direz que c’est moins mal que les trois années précédentes, où l’écart ne faisait que croître… Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que nous sommes dans une situation économique où il n’y a plus de cycles, du fait de la grande crise de 2008. Voilà ce que cela signifie ! Et c’est pour cela que je m’acharne à essayer de faire mûrir les esprits. Nous ne sommes pas ici dans une opposition entre les représentants de différents bords politiques. Le problème, c’est que la distinction entre solde conjoncturel et solde structurel n’a plus de sens. Le seul indicateur qui a un sens, c’est le déficit effectif.

Par cet amendement, nous voulons inciter le Gouvernement à faire valoir, au niveau communautaire, que ces indicateurs ne veulent plus rien dire.

Monsieur de Courson, si j’osais, je vous dirais que cet amendement, venant de vous, est structurel…
Sourires.

…car c’est au moins la quinzième fois que vous le déposez, depuis l’adoption du TSCG. Je ne sais pas s’il faut l’appeler structurel ou obsessionnel, mais c’est un fait.
Votre amendement signifie, économiquement, que vous mettez la croissance potentielle de notre pays à zéro.

Je ne peux pas l’accepter, et la commission ne l’a pas accepté non plus. En faisant le calcul à l’envers, comme vous le faites, la croissance potentielle de notre pays est à zéro. Eh bien, je trouve que vous manquez d’ambition, mon cher collègue. Si vous allez voir toute la matière grise dont dispose notre pays – les entrepreneurs, les créateurs, les chercheurs – et que vous leur dites que notre croissance potentielle est à zéro, je pense qu’ils seront très déçus.
Avis défavorable à cet amendement, qui tend à dire, ni plus ni moins, que la croissance potentielle de notre pays est nulle.

Je vous aime beaucoup, madame la rapporteure générale, mais vous ne répondez pas à la question.

Croyez-vous encore à l’existence de cycles économiques, hypothèse implicite de la distinction entre déficit conjoncturel et déficit structurel ? Vous n’expliquez pas comment le solde conjoncturel peut être stable à - 1,6 % depuis trois ans. Ce n’est pas possible ! Cela veut dire qu’il n’y a plus de cycles !

Le niveau de déficit structurel que vous mentionnez dépend du niveau de croissance potentielle, et je vous rappelle que cette assemblée a voté, il y a deux ans, un amendement de notre collègue Karine Berger, visant à corriger le niveau de croissance potentielle, c’est-à-dire à corriger notre vision de la partie qui vient du cycle et de celle qui tient à la structure de notre pays. Sur ce point précis, nous avons écrit, avec une quarantaine de parlementaires, à Pierre Moscovici, pour lui dire que la Commission européenne était la seule institution au monde à avoir une méthode de calcul aussi byzantine, et que nous souhaitions qu’elle fasse ce qu’a fait Olivier Blanchard au FMI en 2013. Nous lui avons indiqué qu’il était nécessaire que la Commission européenne redéfinisse ses méthodes de calcul de la croissance potentielle, afin que nous disposions d’une définition homogène, valable dans le monde entier.
Vous étiez là lorsque nous avons auditionné le commissaire à l’économie, qui nous a dit qu’il partageait notre point de vue et qu’à l’automne – c’est-à-dire maintenant – la Commission européenne devait se mettre à phosphorer pour trouver une méthode qui soit compatible avec ce que fait le FMI. Vous avez une partie de votre réponse là-dedans, cher collègue.

Dans ce débat de grands spécialistes, j’aimerais, même si je n’en suis pas une, apporter un élément de réflexion. D’un côté, M. de Courson fait une analyse qui pourrait effectivement aboutir au constat d’une croissance potentielle nulle et, de l’autre, Mme la rapporteure s’accroche à ce chiffre d’un solde conjoncturel à - 1,6 %. Son raisonnement n’est pas forcément frappé du sceau du bon sens, car on se demande d’où vient ce chiffre, et pourquoi on en fait une constante depuis des années, comme M. de Courson l’a justement noté.
Or on voit bien qu’il y a une limite à cette constance : en effet, pour la première fois, on voit apparaître des « mesures exceptionnelles et temporaires », dont on considère qu’elles représenteront un solde de - 0,1 %. L’introduction de ces mesures exceptionnelles et temporaires est, on le voit bien, une manière indirecte de corriger le solde structurel.
Or cela devient illisible pour l’ensemble des parlementaires. Il faudrait s’en tenir au solde effectif global, celui qui correspond au déficit réellement constaté par rapport au PIB. Il faudrait simplifier les choses, pour en arriver à la seule réalité qui vaille : le solde effectif de l’ensemble des administrations de l’État. Ce serait beaucoup plus simple. C’est donc une proposition que je fais pour l’avenir : l’ensemble n’en serait que plus lisible.
Ce n’est pas une bombe à retardement ?

Nous n’arriverons pas à convaincre notre collègue Charles de Courson qu’il existe bel et bien un cycle économique, un déficit conjoncturel, et un déficit structurel. C’est dommage.
Mais son amendement me donne l’occasion de vous demander à nouveau, monsieur le ministre, si nous sommes parvenus à un accord avec la Commission européenne sur l’évaluation de la croissance potentielle de la France. En vue du rapport spécial que je suis en train de rédiger, et qui portera justement sur les flexibilités de la règle budgétaire pour la France, j’ai auditionné à nouveau le commissaire européen. Il m’a dit, premièrement, qu’il y avait toujours un débat sur l’évaluation de la croissance potentielle de la France, donc sur l’évaluation du déficit structurel.

Il m’a dit, surtout, et c’est beaucoup plus inquiétant, que, malgré la lettre envoyée par Valérie Rabault et certains de nos collègues, il n’y avait toujours pas d’accord européen pour réévaluer la méthode de calcul de la croissance potentielle.
Monsieur le ministre, pourriez-vous nous en dire plus sur ce sujet ?
Ce débat extrêmement technique sur la croissance potentielle, le déficit structurel et le déficit nominal, passionne tout le monde, j’en suis sûr... Je ne dis pas cela pour minimiser l’importance de notre débat, car il s’agit là d’un sujet extrêmement important, qui a fait l’objet de thèses, et peut-être même d’ouvrages ayant valu à leur auteur le prix Nobel d’économie.
Pour répondre précisément à votre question, la définition de la croissance potentielle fait l’objet d’un débat gigantesque – ou du moins d’un débat à la mesure de cette question. La question est en effet d’importance, puisque c’est de la croissance potentielle que découlent, notamment, les raisonnements sur le déficit structurel. Le débat est maintenant ouvert au sein de la Commission européenne et du Conseil européen. Plusieurs fois par an, nous sommes plusieurs, dont le ministre italien, qui est d’ailleurs économiste, à dire que les méthodes de calcul de la Commission sont surréalistes, surtout quand on sait les conséquences que cela peut avoir pour des pays dont le déficit est inférieur à 3 % – ce qui n’est pas le cas de la France. Dans ces pays, la question du déficit dit « nominal » n’est plus l’élément cible, puisqu’il s’agit d’engager une réduction du déficit structurel – les fameux 0,5 % dont parlait M. Caresche.
J’ai vu des pays, dont le déficit était inférieur à 2 %, subir la vindicte de la Commission, parce qu’ils n’avaient pas suffisamment réduit leur déficit structurel par rapport à l’année précédente. Sur ces questions, les débats sont bien engagés, mais ils sont difficiles. Techniquement, la Commission travaille sur ce point, et j’y suis très attentif, car il me semble que c’est dans ce domaine que la question de la flexibilité est importante. Il faudrait pouvoir faire preuve d’un peu de souplesse et d’intelligence dans l’application des règles. Quand on est passé en dessous de 3 %, sans doute ne faut-il pas engager la réduction de la dette de façon trop brutale, en fonction de critères trop discutables idéologiquement. Ces critères sont en effet discutables, puisque ce ne sont pas les mêmes au FMI et à la Commission européenne.
Pour répondre à votre question, oui, le débat continue aujourd’hui à la Commission européenne, et vos lumières, ainsi que toutes vos suggestions techniques, seront extrêmement utiles à l’avancée de ces travaux.
L’amendement no 362 n’est pas adopté.

La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 726 .

J’ai bien compris, monsieur le ministre, quand vous vous êtes exprimé sur mon amendement tendant à supprimer cet article liminaire, que vous n’obéissiez à aucune obligation venue de l’extérieur, mais que vous meniez une politique que vous aviez vous-même voulue, sur la base de la coopération.
Je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, que nous avons voté une résolution sur la politique européenne, en vue d’obtenir de l’Union européenne une déduction, ou une prise en compte, notamment dans les dépenses d’investissement, des dépenses de défense. Aucun dialogue ne s’est engagé, la Commission n’ayant pas donné suite à notre résolution. Les efforts consentis par la France en matière de défense sont pourtant significatifs et, s’ils contribuent à notre défense et à notre indépendance, ils contribuent aussi à la sécurité de l’Europe. J’ajoute que les attentats que nous avons vécus nécessitent des efforts supplémentaires, qui visent à assurer la sécurité des Français, mais qui contribuent aussi à la sécurité de l’Union européenne.
C’est pourquoi je vous propose, de façon volontariste, sur la base de ce que nous pouvons décider, de modifier cet article liminaire, en faisant apparaître les dépenses de défense, qui pourraient être soustraites du déficit public.
L’amendement no 726 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.
L’article liminaire est adopté.

La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l’amendement no 363 .

Mes chers collègues, vous avez tous lu, bien entendu, le tome II des Évaluations des voies et moyens, dans lequel figure un tableau récapitulatif sur l’évolution des dépenses fiscales. Et vous avez tous été frappés par les chiffres suivants : 85,1 milliards en 2015, 85,8 milliards en 2016, et 89,9 milliards en 2017.
Or le programme du Parti socialiste avait pour ambition d’annuler 50 milliards d’euros de niches fiscales, qu’il jugeait « sans efficacité économique et injustes socialement ». Dans son programme du changement, le candidat François Hollande, était ensuite revenu sur ce chiffre, un peu excessif, pour ne promettre qu’une réduction de 29 milliards des dépenses fiscales.
En 2012, le coût des niches fiscales s’élevait à 70,9 milliards d’euros. Leur coût est estimé à 85,1 milliards d’euros en 2015, 86 milliards en 2016, et près de 90 milliards en 2017. Le Gouvernement a donc fait exploser les dépenses fiscales depuis le début du quinquennat, à hauteur de 19 milliards d’euros. Le décalage entre la promesse du candidat Hollande et la réalité s’élève à plus de 69 milliards. Même en retirant le CICE, le montant des dépenses fiscales ne baisse pratiquement pas. Et, lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances en commission des finances, nous avons encore ajouté trois ou quatre niches fiscales… Conscient de son échec, le Gouvernement n’ose même plus mentionner, comme il était de tradition, les prévisions de dépenses fiscales dans l’exposé des motifs de l’article 1er du projet de loi de finances.
Ce que je vous propose, avec cet amendement, c’est de plafonner le coût des dépenses fiscales en 2017 à leur niveau de 2016, afin d’enrayer leur dérive.
Le ministre ne manquera pas de m’opposer l’argument selon lequel un certain nombre de mes amendements auraient pour effet d’accroître le montant des dépenses fiscales ou d’en créer de nouvelles. D’abord, je voulais savoir ce que pensait le Gouvernement de certains d’entre eux et n’espérais pas les voir adoptés. Ensuite, je déconseille à la majorité d’utiliser cet argument, car elle a déjà adopté plusieurs amendements qui ont pour effet d’accroître le montant des dépenses fiscales ou d’en créer de nouvelles.

Je n’userai pas de cet argument, monsieur de Courson, car vous avez déposé en séance moins d’amendements visant à créer de nouvelles dépenses fiscales qu’en commission. Vous avez un peu refréné votre élan, et je vous en félicite ! Il n’empêche que vous avez contribué à augmenter les dépenses fiscales.

Oui, et nous avons bien compté ! Avis défavorable, car vous contribuez à raidir la pente !
Et la pente est déjà raide !
Je me demande si M. de Courson a des informations sur les fiches qui me sont préparées au banc ! Je n’utiliserai pas l’argument évoqué, même s’il est vrai qu’il y a des marottes et qu’on a l’habitude de se répondre par les mêmes arguments.
Sur la forme, il est vrai que l’évaluation des dépenses fiscales ne figure pas à l’article 1er, contrairement à l’usage, mais vous la trouverez dans l’annexe « Évaluation des voies et moyens », tome II. Cela s’explique par des raisons techniques liées à la finalisation tardive du document – postérieure au Conseil des ministres. Cela dit, vous ne niez pas l’existence de cette évaluation.
Sur le fond, vous l’avez dit vous-mêmes, si l’on défalque le CICE, le montant de la dépense fiscale baisse, certes peu, mais elle baisse tout de même. Alors arrêtez de dire qu’elle augmente de 19 milliards !
De plus, le montant de certaines niches augmente pour la simple raison que la référence augmente. Par exemple, l’augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – TICPE – entraîne un accroissement du coût des exonérations de TICPE applicables aux taxis et aux chauffeurs de poids lourds. Cela vaut aussi pour les exonérations de contribution climat énergie applicables à certains consommateurs de produits carbonés. De même, nous assumons l’augmentation de la fiscalité environnementale, mais les niches attachées à ces dispositifs augmentent mécaniquement.
Cela dit, j’ai repéré, monsieur le député, ceux de vos amendements qui ont pour effet d’augmenter le montant des niches, mais je les garde pour plus tard.
Sourires.

Je ne comprends pas bien le Gouvernement : la limitation à 85 milliards des dépenses fiscales proposée par M. de Courson permettrait d’augmenter les recettes de 4 milliards, donc d’améliorer le solde nominal de notre déficit. Je soutiens donc son amendement.
Vous êtes un austéritaire, contrairement à nous !
Sourires.

Par ailleurs, monsieur le ministre, dire que les dépenses fiscales n’augmentent pas si l’on défalque le CICE est un tour de passe-passe. C’est quand même une niche fiscale d’un montant considérable et nous ne pouvons l’accepter !
De plus, la Cour des comptes a dénoncé dans un rapport du mois de juillet le maquis de la fiscalité des entreprises : 233 niches leur rapportent 2,5 milliards d’euros. Puisque vous souhaitez réformer l’impôt sur les sociétés – nous en discuterons tout à l’heure –, il serait peut-être de bon aloi de définir une assiette plus stable et plus compréhensible.
L’amendement no 363 n’est pas adopté.
L’article 1er est adopté.

Mes chers collègues, je vous informe qu’à la demande du Gouvernement, nous allons examiner en priorité l’article 6, les amendements portant article additionnel après l’article 4, qui concerne les actions gratuites, les amendements portant article additionnel après l’article 11, relatifs à la taxe sur les transactions financières. Nous reprendrons ensuite le cours normal de nos débats.
La parole est à M. Pascal Cherki, premier orateur inscrit sur l’article 6.

Cet article me laisse perplexe. Il n’est pas sérieux d’aborder le débat sur l’impôt sur les sociétés – IS – de cette manière. D’abord, je le rappelle à titre liminaire, le précédent Premier ministre s’est heurté à un refus lorsqu’il a souhaité ouvrir le chantier de la réforme fiscale, que l’on aurait aimé voir engagé dès le début du quinquennat. Or, à l’article 6 du présent projet de loi, il est proposé, en fin de législature, de baisser de près de 5 points le taux de l’impôt sur les sociétés, au seul motif que sa valeur nominale serait trop élevée.
Mais un impôt, ce n’est pas qu’un taux ; ce sont aussi des bases. Si le taux nominal de l’impôt sur les sociétés apparaît très élevé par rapport à d’autres pays européens, j’aimerais que l’on compare les bases. Quel contraste entre les efforts qu’il faut déployer pour augmenter quelques dépenses utiles et la facilité avec laquelle cette réforme est proposée ! Aucune étude comparative des bases de l’impôt sur les sociétés au niveau européen ne figure dans les documents du Gouvernement. Notre réforme doit certes s’inscrire dans une réflexion européenne, mais la vraie question est celle de l’uniformisation des bases, car il ne sera jamais possible de disposer des mêmes taux.
Il n’est pas responsable de faire ce cadeau fiscal,…

…sans un débat approfondi sur cette question, et au moment où le Gouvernement essaie de respecter l’épure des 3 % de déficit – je ne partage pas sa philosophie –, ce qui implique de réaliser 50 milliards d’euros d’économie : c’est de l’argent en moins pour la culture, les quartiers, les classes populaires, et pour tous ceux qui ont espéré que la gauche au pouvoir changerait leur vie. C’est pourquoi je demande la suppression de cet article et une discussion approfondie sur ce que doivent être le taux et les bases d’un impôt sur les sociétés.

Cet article prévoit de ramener progressivement le taux de l’impôt sur les sociétés à 28 % en 2020 pour tous les bénéfices de toutes les entreprises, en quatre étapes. Ainsi, le taux d’IS sera abaissé à 28 % l’année prochaine pour les PME jusqu’à 75 000 euros de bénéfice. En 2018, ce taux s’appliquera aux 500 000 premiers euros de bénéfice, avant d’être étendu, en 2019, à l’ensemble des bénéfices des PME. Enfin, le taux de 28 % sera généralisé en 2020. En commission, un amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain a modifié, pour les années 2019 et 2020, la trajectoire de réduction du taux d’IS pour les entreprises. Ainsi, à compter de 2019, le taux de 15 % sera appliqué aux seules entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, alors qu’il ne s’applique à l’heure actuelle qu’aux entreprises de moins de 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Il aura donc fallu plus de quatre ans pour que le Gouvernement s’aperçoive que notre taux d’impôt sur les sociétés de 33,3 % nuisait à notre compétitivité en Europe. Certes, la réduction du taux de l’IS est plutôt une bonne nouvelle. Cependant, il convient de regretter la faible ampleur de la mesure envisagée et sa complexité. Ainsi, envisager une baisse d’impôt pour 2018, 2019 et 2020 est un peu surréaliste pour un Gouvernement qui ne sera probablement plus là dans moins d’un an.
Je pense également qu’en raison de cet échéancier sur trois ans, cette mesure n’aura pas la résonance escomptée. Le Gouvernement choisit d’introduire de nouveaux seuils et de nouvelles distinctions peu lisibles entre entreprises, avec trois taux différents. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Le plus simple ne serait-il pas de mettre toutes nos entreprises dès 2017 au même niveau de fiscalité ? Une telle mesure aurait au moins l’avantage d’avoir un impact bien plus fort en termes d’attractivité et de compétitivité.

Dans les deux interventions précédentes, on a entendu tout et son contraire. Il est évident que notre taux d’IS diverge de ceux appliqués par nos partenaires européens. Avec cet article, nous souhaitons non seulement améliorer notre attractivité mais également donner de la lisibilité aux entreprises, qui doivent pouvoir compter sur une réduction de l’IS par étapes, dans un contexte où tous doivent faire l’effort de contribuer à la maîtrise de la dette.
Pourquoi commençons-nous par les PME ? Tout simplement parce qu’elles sont implantées sur l’ensemble de nos territoires et qu’elles sont les plus dynamiques en matière de création d’emploi. Dès 2017, grâce à cet article, leurs efforts seront reconnus. Mais, restons mesurés : beaucoup d’entreprises ne sont pas soumises au taux de 33 % ; leur taux d’imposition est de 8 % – cela a été dit. Les entreprises ont besoin de cette lisibilité dans le temps : certaines prendront des décisions dès 2017, notamment en matière d’investissement, en comptant sur les réductions d’impôts prévues en 2018 et en 2019.
Enfin, en France, nous avons une faiblesse dans le secteur des entreprises de taille intermédiaire – ETI. Dès cette année, l’effort de réduction du taux d’imposition pour les PME contribuera peut-être à accroître le nombre d’ETI. Bien entendu, il faudrait réformer la niche Copé – on l’a fait, mais insuffisamment. C’est un autre débat, sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Vous l’aurez compris, je soutiens cet article 6.

Dans son discours du 31 décembre 2013, le Président de la République annonçait l’instauration du pacte de responsabilité et de solidarité, censé soulager la fiscalité des entreprises. Il a même annoncé un taux d’IS à 28 % dès 2020. En 2015 et 2016, il n’y a eu aucune baisse d’impôt. Les premières baisses auront lieu en 2017. Nous regrettons ce retard à l’allumage, parce que nos entreprises sont à la peine en Europe. Pire, une diminution de 2,5 milliards d’euros des charges pesant sur les entreprises était prévue pour 2017. En définitive, cela ne représentera que 330 millions d’euros. C’est un écart significatif !
En parallèle, vous allez chercher 1,3 milliard d’euros supplémentaires dans les poches des entreprises en 2017. En outre, vous avez décidé tout simplement de revenir sur la suppression de la C3S, qui représentait 3,3 milliards d’allégements de charges pour les entreprises.
Au total, vous aviez prévu de diminuer de 5,8 milliards d’euros les prélèvements pesant sur les entreprises. Au final, ils augmenteront d’1 milliard. C’est une faute économique. Or, pendant ce temps, les autres pays d’Europe ont fait un effort particulier pour minorer la fiscalité de leurs entreprises.
Je me souviens que Pierre Moscovici, qui a maintenant des responsabilités importantes au niveau européen, disait au début du quinquennat que la convergence fiscale était indispensable au rétablissement de la compétitivité de l’entreprise France. On aura réussi l’exploit d’avoir un taux d’IS à 38 % de 2013 à 2015. Il est urgent, monsieur le ministre, d’inverser la courbe et de faire en sorte que cette diminution de l’IS aille plus vite et plus fort.

Je suis très surpris des propos des collègues de l’opposition, car il faut tenir compte de la réalité et des chiffres, qui sont têtus.

Le graphique élaboré par France stratégie en 2015 sur la base des données de 2014 d’Eurostat et de l’INSEE place notre pays au vingt-et-unième rang dans l’Union européenne pour ce qui est du rendement de l’IS net de crédit d’impôt, avec 1,4 point de PIB. Avec la montée en charge du CICE, on atteint un rendement de 1,3 point de PIB, soit la moitié de la moyenne dans la zone euro. Telle est la réalité !
Notre impôt sur les sociétés a tous les défauts : taux élevé, assiette étroite. L’érosion de la base tient non seulement aux très nombreux crédits d’impôts – les principaux sont le crédit d’impôt recherche et le CICE, la niche Copé est le plus scandaleux – mais surtout à l’optimisation fiscale agressive. D’ailleurs, monsieur le ministre, je vous poserai tout à l’heure une question sur Engie, qui aurait transféré 27 milliards d’euros sur une holding au Luxembourg pour réduire sa contribution fiscale.
Monsieur Vigier, il est faux de dire que les entreprises sont plus taxées aujourd’hui.

Elles ont été soulagées sur le plan fiscal. L’Observatoire français des conjonctures économiques a montré que la pression fiscale sur les entreprises avait diminué de 0,9 point de PIB en 2016 par rapport à 2012 : les prélèvements sur les entreprises ont baissé de 20 milliards d’euros en cinq ans, alors que les prélèvements sur les ménages ont augmenté de 31 milliards.

Mes chers collègues le groupe de l’Union des démocrates et indépendants est favorable à la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés parce que tous les grands pays ont baissé le leur. C’est ainsi que l’Allemagne l’a baissé de 38,90 % en 2007 à 30 % aujourd’hui,…

Je vais y venir.
…que l’Espagne l’a baissé de 32,5 % à 25 %, l’Italie de 37 % à 31 % et le Royaume-Uni de 30 % à 20 %. Il faut donc baisser le taux de l’impôt sur les sociétés.
L’erreur politique et économique que le Gouvernement a commise est d’avoir préféré la suppression progressive de la C3S à la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, si bien que celle-ci a été reportée après la fin de la législature. En effet, cette première tranche est minuscule, puisqu’elle représente 330 millions – le taux étant abaissé de 33 % à 28 % pour la seule fraction de bénéfices comprise entre 38 000 et 75 000 euros –, alors que le coût de la mesure sur les quatre ans atteindra 7 milliards. Je n’ai pas cité cette bombe budgétaire parce que, celle-là, il est possible de l’arrêter assez facilement – n’est-ce pas monsieur le ministre ?
Votre seconde erreur est de ne pas baisser le taux de la fraction inférieure à 38 000 euros, qui concerne les petites entreprises. Vous auriez dû prendre une mesure visant à le baisser, par exemple, de 15 % à 10 %.

L’aberration est que les petites entreprises ne bénéficient d’aucune modification de leur taux. Seules la tranche comprise entre 38 000 et 75 000 profite d’une petite baisse et ce sera à la prochaine majorité de se débrouiller ! L’erreur stratégique – je vous l’ai déjà dit, y compris dans votre bureau, monsieur le ministre, –, est d’avoir choisi la suppression de la C3S au détriment de la baisse de l’IS.

Je tiens à rappeler que l’impôt sur les sociétés date de 1948. C’est l’article 205 du code général des impôts qui en règle l’ensemble du dispositif. Au fil des ans, cet impôt a subi de nombreuses variations et des mutations considérables. Durant le présent quinquennat, on a tout d’abord assisté à une forte augmentation du taux facial, avant une prise de conscience des difficultés auxquelles nos entreprises étaient confrontées et de leur incapacité à rester compétitives à l’exportation. Des mesures parallèles ont alors été adoptées : le CICE, le pacte de responsabilité. Toujours est-il que les chiffres ne mentent pas : ils traduisent des réalités. De 2011 à 2017, les prélèvements sur les entreprises, monsieur Sansu, auront augmenté de 16 milliards, en tenant compte du CICE et de tous les éléments de cet ordre.

C’est une réalité. Si je fais ce rappel, c’est parce que l’impôt sur les sociétés n’est pas seul en cause. Il convient également d’intégrer au calcul les nouvelles fiscalités, telles que la fiscalité écologique, la TASCOM – taxe sur les surfaces commerciales – ou la part de la fiscalité locale qui, compte tenu de l’impact de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, a vu ses taux varier : je pense au taux de CVAE – cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – ou à celui de la cotisation foncière. Tous ces prélèvements contribuent aujourd’hui à faire que l’impôt net de subvention des entreprises atteint en France 16,6 % par rapport à la valeur ajoutée, contre 10,4 % en Allemagne. Il est donc nécessaire de baisser l’impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises.

Nous ne pouvons que nous réjouir de cet article, parce qu’il nous faut redonner des marges de manoeuvre aux acteurs économiques et restaurer la confiance dont ont besoin les entreprises. Nous pouvons même regretter que vous n’alliez pas plus loin en retenant un taux inférieur à 28 % parce que nous partageons ce qui a été dit également sur les bancs de la majorité : il faudrait à la fois élargir la base et avoir des taux plus bas. Nous sommes tout à fait d’accord.
Alors cessez de parler et votez l’article !

Il faut aider nos entreprises qui vivent aujourd’hui dans un monde global et une économie mondiale et connectée. Il faut prendre en considération ce qui se passe dans les pays européens.
Nous pouvons également vous rejoindre, monsieur le ministre, sur le besoin de stabilité des entreprises. Du fait qu’il leur est nécessaire de se projeter, il faut leur donner une ligne directrice sur plusieurs années. C’est pourquoi nous pouvons regretter que vous n’ayez pas pris cette initiative dès le début du quinquennat, car une décision de cette nature aurait alors eu du sens.
Nous ne pouvions pas tout faire.

Vous la prenez à la fin de la législature : son impact essentiel – 7 milliards d’euros – se fera donc sentir en 2020. Voilà ce que nous appelons les bombes à retardement. Car, si nous pouvons être favorables au dispositif que vous mettez en place, ses effets ne s’en feront pas moins sentir après 2017. Il s’agit bien de bombes organisées, différées, avec une définition très précise de l’agenda, et programmées. Leurs effets sont connus. Elles n’en sont pas moins là.

Cette mesure est, avec le passage de 6 % à 7 % du CICE, l’aménagement le plus important qu’on ait connu depuis l’annonce, il y a trois ans, du pacte de responsabilité, dont les étapes ont été peu ou prou respectées. L’évolution est significative : il faut en observer les aspects tant positifs que négatifs. L’intérêt est que le Gouvernement a renoncé à la troisième phase de suppression de la C3S, qui représentait quelque 4,2 milliards et concernait les très grosses entreprises – l’année dernière et l’année précédente, sa suppression pour les petites entreprises puis pour les moyennes a représenté deux fois 1 milliard. L’avantage est donc moindre pour les très grosses entreprises. En revanche, la mesure proposée à l’article 6 concerne les petites et les moyennes entreprises : elle est positive et il convient donc de la saluer.
Parallèlement, même si le CICE concerne toutes les entreprises pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, sa bonification profitera plutôt aux petites et moyennes entreprises. Il est donc positif qu’une mesure strictement réservée aux grosses entreprises bascule sur les petites et moyennes entreprises. C’est ce que nous souhaitions tous.
Très bien !

J’ai une question très précise à vous poser, monsieur le ministre, sur le dispositif que vous nous proposez à l’article 6. Une étude de juin 2001 de la direction générale du Trésor, laquelle relève de vos services,…
C’était donc au temps d’Éric Woerth.

…calculait les taux effectifs d’impôt sur les sociétés en fonction de la taille des entreprises. Je n’en ai pas trouvé de mise à jour : si vous l’aviez, nous serions d’autant plus intéressés d’en prendre connaissance que cette étude révélait que le taux effectif des micro-entreprises ou TPE était alors de 37 %, celui des PME de 39 %, celui des ETI de 28 % et celui des grandes entreprises de 18 %. Ce sont les derniers taux réels d’impôt sur les sociétés connus en France. Ils sont liés, comme vous le savez tous, au mécanisme de report des déficits en avant et en arrière et à l’optimisation fiscale pour les grandes entreprises.
Monsieur le ministre, vous souhaitez diminuer de cinq points le taux pour toutes les entreprises. Voulez-vous faire passer le taux des PME de 39 % à 34 % et celui des grandes entreprises de 18 % à 13 % ou ne serait-il pas possible d’utiliser votre dispositif de telle manière qu’au terme de nos décisions le taux effectif de l’impôt des PME ne soit plus supérieur à 33 % et celui des grandes entreprises ne soit pas inférieur à 15 % ?

Il est possible de disserter longtemps sur l’impôt sur les sociétés qui pose, effectivement, un problème d’iniquité, lorsqu’on prend en considération la différence implicite des taux entre les grandes et les petites entreprises. Chacun peut construire son assiette d’IS comme il le veut en jouant de toutes les niches fiscales et de la complexité du dispositif.
Il est également possible de disserter des heures sur les taux et les bases : deux indicateurs me semblent pertinents à regarder. Le premier est celui de l’effet de l’IS sur le développement économique et l’emploi. Même si les marges se sont légèrement améliorées depuis quelque temps, cette amélioration n’a aucun effet d’entraînement sur l’emploi. Il convient donc encore de travailler sur le levier de l’IS si nous voulons que les entreprises dégagent des marges suffisantes pour avoir un effet d’entraînement sur l’emploi.
Le second indicateur qui devrait nous alerter est celui des parts de marché de la France. Le déficit commercial est encore important cette année et nos parts de marché continuent de dégringoler. Les charges, qui pèsent encore trop lourdement sur les entreprises, ont un effet sur les marges, donc sur l’emploi et sur les parts de marché de la France. Ne regardons pas seulement l’abondement de l’IS au budget de l’État : regardons également les effets de l’IS sur la dynamique économique.

Hier soir, dans la discussion générale, je vous ai dit, monsieur le ministre, que ce n’est pas avec ce projet de budget que vous inverserez la courbe du chômage et la courbe d’insatisfaction des Français.
Nous avons idéologiquement avancé.

Après le matraquage fiscal auquel vous avez procédé durant plusieurs années depuis que vous êtes aux commandes, après le détricotage fiscal, vous faites aujourd’hui de l’illusionnisme fiscal en nous faisant croire que vous allez baisser massivement tant l’impôt sur le revenu des ménages que l’impôt sur les sociétés.
La vérité est que même si l’article 6 va dans le bon sens, comme d’habitude vous vous arrêtez au milieu du chemin car vous devez composer avec une majorité hétérogène : nous le constatons encore ce soir. C’est la raison pour laquelle vous présentez tout d’abord un projet de loi de finances comprenant des baisses successives visant les grandes entreprises avant de rétablir l’équilibre en commission des finances au bénéfice des petites et moyennes entreprises.
La vérité est que le système est complexe, peu lisible et voué à l’instabilité du fait que les engagements sont pris pour plusieurs années, voire plusieurs législatures. Chacun le sait : ce n’est malheureusement pas avec de tels articles de baisse des impôts qu’il sera possible de corriger les défauts de la fiscalité française, notamment le fait que la France ait l’impôt sur les sociétés le plus élevé de l’Union européenne. Trop tard, trop peu et trop contradictoire : c’est malheureusement à l’image de votre politique fiscale depuis cinq ans.
Madame la présidente, je souhaite dès à présent éclairer la position du Gouvernement, afin d’être moins long sur chacun des amendements à l’article 6, qui est un des plus importants du projet de loi de finances en matière non pas budgétaire mais fiscale.
Ce débat sur l’impôt sur les sociétés est légitime, y compris lorsqu’il porte sur une éventuelle relation entre la base et le taux, qui existe effectivement, ou sur le montant du taux d’imposition pesant sur les entreprises en France, par rapport à ce qu’il est en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie ou en Espagne – les seules comparaisons qui comptent.
Monsieur Vigier, je tiens à vous rappeler que le taux a été porté une fois à 38 %, non pas de notre fait mais sur la proposition de M. Fillon, que vous avez alors adoptée : elle avait porté le taux d’imposition de 33% à 38% pour certaines entreprises.
Nous sommes redescendus à 33,3 % pour l’ensemble des entreprises. Ce taux est celui qui est affiché et donc regardé et connu de l’extérieur. Objectivement, il est un des plus élevés d’Europe, il est plus élevé en tout cas que celui de l’Allemagne, de la Belgique ou de nombreux autres pays. Un seul pays, me semble-t-il, a un taux plus élevé. Même s’il n’explique pas tout, cet élément est en lui-même dissuasif.
Que faut-il faire évoluer ? Monsieur Cherki, vous ne pouvez pas, de mon point de vue, avoir tort à 100 %. Vous avez donc raison sur un point : c’est celui de l’harmonisation nécessaire des bases.
L’harmonisation des bases en Europe est une nécessité. D’ailleurs, nous y travaillons de manière très précise. Vous devez connaître le projet ACCIS – assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés –, qui a eu du mal à progresser ces dernières années mais qui est en train d’avancer très rapidement, car le commissaire Moscovici est très actif en la matière. Avant la fin de cette année, une assiette commune européenne sera proposée : je pense qu’elle permettra d’harmoniser les bases en Europe au cours des prochains mois, l’année prochaine ou dans les deux ans à venir. Dès lors, les taux seront encore plus visibles ! Dans un contexte de bases harmonisées, un taux plus élevé sera néfaste pour notre économie. C’est pourquoi je vous propose de décider dès maintenant une diminution du taux d’imposition de l’ensemble des entreprises.
Certains nous reprochent de n’inventer cette mesure que maintenant, à la dernière année du quinquennat.
Nous n’inventons rien. Lorsque le Président de la République a présenté le pacte de responsabilité, ce dernier prévoyait des mesures pour chaque année. Pour 2017 était inscrite une mesure que nous n’avions pas décrite : la première phase de baisse de l’impôt sur les sociétés. Nous faisons donc ce qui était prévu.
Cependant, un point a évolué. Il y a deux manières de ramener le taux de 33 % à 28 %. La première, peut-être celle que beaucoup d’entre nous avaient en tête, consiste à baisser le taux chaque année – de 33 % à 32 % l’année prochaine, puis 31 % l’année suivante, ou pour aller plus vite de 33 % à 31 %, puis 29 % – pour arriver progressivement à 28 %. Toutes les entreprises seraient concernées en même temps. Cette solution est simple et tentante, mais nous vous proposons une autre méthode, qui consiste à afficher dès maintenant le taux cible de 28 % et à faire entrer progressivement les différentes entreprises de France dans ce nouveau dispositif. C’est le moyen de répondre à une préoccupation souvent exprimée sur les bancs de la gauche au sein de la commission, et de faire en sorte que les bénéficiaires de cette baisse de taux soient d’abord les plus petites entreprises, puis en 2018 la totalité des PME françaises, et enfin l’ensemble des entreprises de France.
Cela me paraît extrêmement important, d’autant que ces prochaines années seront marquées par l’harmonisation des bases en Europe. Or les entreprises qui profitent aujourd’hui le plus des bases différenciées, en particulier en France, sont les plus grandes. Vous avez d’ailleurs sans doute remarqué que le taux d’impôt effectif variait en fonction de la taille des sociétés, et qu’il était d’autant plus faible que l’entreprise est grande, compte tenu du manque d’harmonisation des bases.
Le dispositif proposé combine donc une harmonisation progressive des bases en quatre ans – ce sera la décision européenne – et une entrée progressive de toutes les entreprises de France dans le taux à 28 % – c’est ce qui vous est proposé dans cet article 6.
Je sais qu’il y a eu des débats très approfondis en commission, et que l’amendement finalement adopté a recueilli des avis favorables sur tous les bancs. Je vous le dis dès maintenant : je ne suis pas favorable à cet amendement, qui exclut les grandes entreprises du passage à 28 % pour augmenter encore – on pourrait le comprendre – l’avantage des plus petites.
Je n’entre pas dans les détails : vous voulez élargir le taux réduit de 15 % à des entreprises ayant un chiffre d’affaires plus élevé. Il s’agit d’un système très compliqué, qui aboutirait à la coexistence de trois taux – 15 %, 28 % et 33 %. Certes, il y a déjà trois taux aujourd’hui, mais nous proposons de passer progressivement à deux en faisant en sorte que toutes les entreprises de France soient imposées à 28 %.
On me dit parfois que les grandes entreprises sont, comme d’habitude, les dernières servies. D’ailleurs, il est vrai que les très grandes entreprises auraient dû bénéficier en 2017 de la dernière phase de suppression de la C3S. Cependant, nous avons considéré que cette mesure, qui aurait coûté plus de 3 milliards d’euros et aurait profité uniquement aux très grandes entreprises, n’était pas forcément une bonne chose, et nous avons préféré relever le taux du CICE, qui profite à toutes les entreprises. Je le revendique : là encore, nous avons pris une mesure favorable aux petites et moyennes entreprises. Malgré tout, il ne faut pas considérer que les très grandes entreprises françaises doivent toujours être imposées plus que les autres, alors qu’elles apportent aussi quelque chose à l’économie française.
Monsieur Sansu, vous êtes maire d’une commune qui connaît bien la sous-traitance, et vous savez bien que ce sont aussi les grandes entreprises qui permettent à toute une chaîne de sous-traitance de vivre.
Pour ma part, je propose donc d’adopter une disposition valable pour toutes les entreprises, qui entreraient progressivement dans le dispositif en quatre ans, en commençant par les plus petites. Cette solution est parfaitement cohérente avec le schéma économique de chaque type d’entreprises. Si une petite entreprise investit en 2016, elle a besoin que le retour sur investissement – le bénéfice procuré par cet investissement – soit le plus court possible. Plus l’entreprise est petite, plus elle souhaite que le retour soit rapide.
Aussi, si elle investit en 2016, elle sait aujourd’hui que les bénéfices tirés de cet investissement seront imposés à 28 % en 2017. En revanche, le cycle d’investissement d’une très grande entreprise ne dure pas un an, mais deux, trois ou quatre ans, et parfois davantage. Si elle décide de réaliser un investissement en 2016, elle attend un bénéfice supplémentaire dans trois ou quatre ans, c’est-à-dire en 2019 ou en 2020, et elle sait dès maintenant que cet investissement nouveau produira des bénéfices qui seront imposés à 28 %. Aussi cette disposition encourage-t-elle les entreprises à investir dès maintenant. Derrière l’investissement, il y a aussi l’emploi. C’est la raison pour laquelle la mesure que nous vous proposons est la plus pertinente, du point de vue économique, en termes d’emploi, mais aussi compte tenu de l’harmonisation fiscale qui est une préoccupation largement partagée à l’échelle européenne.


J’ai été à moitié convaincu par les propos du ministre. Je suis conscient qu’au regard des autres taux d’imposition en Europe, notre taux est facialement très élevé, ce qui soulève des questions – il n’était pas besoin de déposer un amendement pour m’en convaincre. Le ministre prétend que cela peut décourager les entreprises étrangères à investir dans notre pays. Cela dit, ces entreprises se renseignent sur la réalité de l’imposition : si elles peuvent s’inquiéter du taux, elles sont beaucoup plus rassurées lorsqu’elles voient les bases. Je ne crois donc pas qu’une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés enverrait un signal déterminant qui drainerait des flux d’investissements directs étrangers – IDE – très importants dans notre pays.
Vous dites aussi, monsieur le ministre, qu’il faut discuter des bases au niveau européen. Vous avez raison. D’ailleurs, le débat sur les bases est le plus important. Nous savons que nous n’arriverons jamais à déterminer un taux commun pour l’impôt sur les sociétés et que nous devrons laisser aux États une certaine latitude pour fixer des taux différents ; en revanche, il faudra définir des bases communes. J’aimerais savoir comment la France va entrer dans cette discussion. Si nous cherchons à étendre nos propres bases à l’ensemble de l’Europe, alors nous aurons beaucoup d’alliés, car certains pays dont les taux sont plus faibles mais les bases plus larges pourraient être tentés de s’inspirer des bases françaises. Il faut donc que nous réfléchissions à ces bases, qui sont un vrai gruyère et qui posent problème.
J’en viens à l’excellente intervention de notre collègue Nicolas Sansu, qui parlait du rendement de l’impôt sur les sociétés. En France, ce rendement n’est pas pénalisant pour les entreprises – ce n’est pas forcément ce que je cherche –, mais quelque chose me gêne : j’ai l’impression que vous lancez une opération de communication. Je ne souhaite pas qu’on fasse de la communication avec les impôts.
Nous aurions pu réfléchir à une modulation entre les bénéfices réinvestis et les bénéfices distribués. Si nous voulons vraiment aider les PME, alors baissons considérablement le taux de l’impôt sur les sociétés quand les bénéfices sont réinvestis, puisque nous savons que la quasi-totalité des PME réinvestissent leurs bénéfices dans la production, et taxons beaucoup plus fortement les bénéfices distribués. Ainsi, nous ferons oeuvre utile pour le tissu productif. Nous aurions pu faire beaucoup d’autres choses que de la communication avec les impôts !

La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 704 .

Notre discussion a montré que la baisse du taux nominal de l’impôt sur les bénéfices des sociétés apparaît pour beaucoup – même ici mais surtout en dehors de cet hémicycle – comme un totem patronal appuyé sur des comparaisons internationales ou européennes qui me semblent parfois un peu rapides. Si le taux nominal français est élevé, il ne faut pas oublier que la base sur laquelle il s’applique est grevée par un certain nombre de dispositions – j’en ai approuvé certaines, comme le crédit d’impôt recherche ou le CICE, mais d’autres sont moins heureuses, comme les dispositifs d’optimisation fiscale. À mon sens, il faut persévérer dans cette approche volontariste de la fiscalité.
L’argument de la comparaison européenne n’intègre pas la réaction de nos voisins, qui vont s’ajuster et sans doute baisser leur taux à leur tour. Nous risquons alors de nous engager dans une logique de concurrence fiscale.
Le financement de la protection sociale devrait être réformé pour poursuivre sa fiscalisation.
Je m’inscris dans la logique du rapport Gallois sur la compétitivité. La simple baisse du taux nominal de l’impôt sur les sociétés ne répond en rien à cet enjeu et ne saurait être considérée comme prioritaire. C’est la raison pour laquelle je propose la suppression de l’article 6.

Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements de suppression ?

Je voterai les amendements présentés par mes collègues Pascal Cherki et Jean-Luc Laurent. Je profite de cette intervention pour expliquer mon vote et poser quelques questions à M. le ministre.
Nous avons fait l’erreur de baisser les taux sans aucune modulation en fonction de l’utilisation des bénéfices ou de la taille des entreprises. Comme on l’a expliqué, il serait bon que les grandes entreprises paient au moins autant d’impôts que les petites – il ne s’agit pas de les faire payer plus, mais d’assurer l’égalité entre tous les agents économiques. Je défendrai un peu plus tard des amendements pour essayer de corriger cette erreur et élargir l’assiette.
Nous ne pouvons pas non plus nous contenter de nous inscrire dans la concurrence fiscale à laquelle commencent à se livrer tous les pays de l’Union européenne. Sinon, nous allons faire de l’impôt sur les sociétés une chimère. Cet impôt rapporte aujourd’hui 29 milliards d’euros ; son produit passera à 24 milliards avec le relèvement à 7 % du taux du CICE, et on nous annonce dans le rapport que l’on va encore perdre 7 milliards, ce qui ramènera son rendement à 17 milliards d’euros. Alors que cet impôt ne représente quasiment plus rien, on continue à en faire un objet de débat. C’est quand même un vrai problème !
Enfin, monsieur le ministre, je vous ai dit tout à l’heure que je vous poserais une question sur l’optimisation fiscale agressive. Comme tout un chacun sans doute ici, j’ai appris qu’Engie avait transféré, selon un journal luxembourgeois ou belge, 27 milliards d’euros à une filiale au Luxembourg pour tenter d’échapper à l’impôt.

Je souhaiterais savoir quelle est aujourd’hui la position du Gouvernement, sachant que l’État détient 32 % d’Engie en sa qualité d’actionnaire principal.

Prochaine séance, ce soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2017.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly