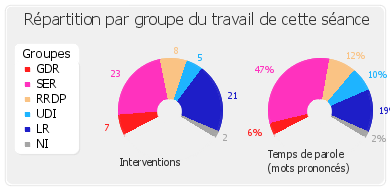Séance en hémicycle du 11 février 2015 à 15h00
Sommaire
- Questions au gouvernement préalables au conseil européen relatif à la lutte anti-terroriste (voir le dossier)
- Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes (voir le dossier)
- Questions sur l'amélioration des relations de travail entre le gouvernement et le parlement (voir le dossier)
- Amélioration du régime de la commune nouvelle (voir le dossier)
- Ordre du jour de la prochaine séance (voir le dossier)
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à quinze heures.

L’ordre du jour appelle les questions au Gouvernement préalables au Conseil européen relatif à la lutte anti-terroriste.

La parole est à M. Pierre Lequiller, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le Premier ministre, dans la lutte contre le terrorisme, l’affaire étant trop grave, nous n’avons, à l’UMP, jamais dévié. Ce n’est pas le cas de la gauche, qui n’a voté aucun de nos textes en la matière durant la législature précédente !

Nos voix ne vous ont pas manqué pour voter les deux textes que vous avez proposés depuis 2012, même si vous vous avez refusé tous nos amendements – lesquels sont aujourd’hui pleinement d’actualité.
Même si nous considérions que ces textes étaient insuffisants – ce en quoi nous avions raison –, nous avons alors pris nos responsabilités.
À la suite des attentats, monsieur le Premier ministre, vous avez appelé ici même à adopter rapidement la mise en place du système d’échange de données sur les passagers aériens, dit « PNR unique européen ». Mais à qui exactement vous adressiez-vous ? Nous, membres de l’UMP et du PPE au Parlement européen, avons toujours été logiques et donc favorables au PNR.

Au contraire, en décembre dernier, les députés européens socialistes et leurs alliés ont refusé un accord entre l’Union européenne et le Canada sur le transfert et le traitement des données sur les passagers et sont allés jusqu’à saisir pour avis la Cour européenne de justice.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Les Français doivent le savoir : vous dites une chose à Paris, mais vos parlementaires font le contraire à Strasbourg.
Nous sommes aujourd’hui devant un double dilemme : soit nous proposons des amendements et une renégociation du texte, avec un risque de blocage, soit nous attendons la décision de la Cour européenne de justice, ce qui pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.
Monsieur le Premier ministre, ce texte est d’une urgence absolue. Comment la France va-t-elle sortir l’Union européenne de cet imbroglio que nous devons aux parlementaires socialistes de Strasbourg ? Après les terribles attentats, la sécurité des citoyens, français et européens, est une priorité !
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.
Monsieur le député, comme l’a indiqué le Premier ministre après les tragiques attentats du début du mois de janvier, face au terrorisme, il faut que toutes les forces politiques de cet hémicycle restent unies.
Je sens poindre ici ou là la tentation d’instaurer des clivages ou des antagonismes, mais ce qui fait la force de notre pays dans la lutte anti-terroriste, c’est notre capacité à rester rassemblés.
Par conséquent, je considère qu’il n’est pas nécessaire de vous répondre sur l’aspect polémique de votre question.
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.
En revanche, sur le fond, vous posez un certain nombre de questions précises auxquelles je tiens à répondre.
J’ai reçu il y a quelques jours la délégation française au Parlement européen, toutes sensibilités confondues. À cette occasion, j’ai senti chez les parlementaires, qu’ils soient socialistes, du PPE ou libéraux, la volonté de faire en sorte que les choses avancent sur ce texte pour peu que des garanties soient apportées.
Par ailleurs, le jour suivant, je me suis rendu devant la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, dite LIBE, du Parlement européen pour y rencontrer l’ensemble des coordonnateurs. J’ai constaté là aussi que le clivage sur le PNR transcendait celui qui existe entre les conservateurs et les progressistes. Par exemple, quelques libéraux, qui siègent non loin du PPE, sont défavorables à la mise en place du PNR.
Nous souhaitons, nous, que le PNR aboutisse car nous en avons besoin pour lutter contre le terrorisme, notamment en établissant la traçabilité des terroristes qui circulent à l’intérieur de l’espace Schengen après avoir traversé les frontières extérieures de l’Union européenne.
Nous pensons qu’il est possible de trouver un chemin. Comment ? Tout d’abord, en faisant en sorte que cet outil soit essentiellement consacré à la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme ; ensuite, en garantissant la protection des données. Pour cela, le service à compétence national qui sera chargé de gérer les données récupérées dans le cadre du PNR sera soumis à des règles déontologiques et protégé.
Ce dispositif devrait permettre de convaincre l’ensemble des groupes du Parlement européen de statuer positivement afin que nous disposions rapidement de cet outil dont nous avons besoin.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

La parole est à M. Jean-Marc Fournel, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.

Monsieur le Premier ministre, les fins de mois difficiles sont une réalité pour beaucoup de nos concitoyens.

Ils continuent pourtant à s’acquitter de leur impôt. Cet effort est pour eux un devoir et un geste citoyen. Nous partageons tous ici l’indignation qu’ils ressentent lorsqu’ils découvrent un système permettant aux mieux lotis d’échapper au paiement de l’impôt et à leur devoir de Français.

L’affaire Swissleaks n’est pas un hasard mais la conséquence d’un combat que mènent la plupart des gouvernements de gauche de la planète. La France, depuis 2012, en est à la pointe. Rappelons-le, le manque à gagner résultant de l’évasion fiscale n’est pas seulement financier, il est aussi moral. Depuis 2012, le Gouvernement et le Parlement sont pleinement mobilisés pour lutter contre l’évasion fiscale. Ce sont en effet plus de soixante-dix nouvelles mesures législatives qui ont été prises à cette fin, du renforcement des techniques d’enquête à l’alourdissement des sanctions correctionnelles dont sont passibles les fraudeurs et évadés fiscaux les plus compromis. Au sein des institutions européennes, au G20, au G8 et dans toutes les instances internationales, la France mène un combat inlassable, qui porte ses fruits.
Les moyens de contrôle et de coopération internationale ont été considérablement renforcés depuis 2012. Parce qu’on sait que la France est désormais intraitable en la matière, 35 000 demandes de régularisation ont déjà été enregistrées et ont rapporté en 2014 plus de 2 milliards d’euros. Et parce que le Gouvernement place l’impôt au coeur de l’égalité républicaine, ces 2 milliards d’euros ont permis de financer la baisse de l’impôt pour quatre millions de ménages modestes en 2014. De même, depuis 2012, le Gouvernement se bat pour la fin du secret fiscal. Ce combat avance : cinquante-et-un États pratiqueront l’échange automatique d’informations financières en 2017. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc simple : pouvez-vous nous dire quelles seront les prochaines actions dans ce combat contre la fraude et l’évasion fiscales ?
Applaudissements sur quelques bancs du groupe SRC.
Depuis 2012, la détermination du Gouvernement à lutter contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux est totale, monsieur le député Jean-Marc Fournel, en raison du préjudice fiscal mais aussi moral, sur lequel vous avez insisté à juste titre. Le Gouvernement veut être intraitable avec les fraudeurs mais aussi avec ceux qui les aident.
Le bilan mérite en effet d’être souligné. Aux soixante-dix mesures nouvelles adoptées pour lutter contre la fraude et aux 2 milliards d’euros récupérés grâce au service de traitement des déclarations rectificatives s’ajoute le fait qu’un accord prévoyant la mise en place de l’échange automatique d’informations a été signé, Suisse incluse.
Mais l’actualité démontre que les efforts de la France, notamment sur le plan international, ne doivent pas s’interrompre. Le chantier que nous devons maintenant mener à bien, c’est celui de la lutte contre l’optimisation fiscale agressive pratiquée par les grands groupes. Elle exploite les failles du droit et la concurrence, parfois peu loyale, que se livrent les États. Dès lors, elle ne peut passer que par une action collective au plan international.
C’est pourquoi les discussions que nous menons à l’OCDE et à Bruxelles ont pour but de permettre que chaque État adopte des règles du jeu loyales et communes. Il faut aussi aller plus loin en Europe, en plaidant par exemple pour une imposition effective des redevances de brevet et des dividendes et en travaillant sur la pratique du « rolling ». Je tiens à vous préciser, monsieur le député, que l’Europe est à l’écoute de ces propositions : à la suite d’une action de Michel Sapin, Wolfgang Schäuble et Pier Carlo Padoan, une directive sur la transparence doit être proposée en mars. Michel Sapin l’a encore plaidé hier à Istanbul dans le cadre du G20 et le fera encore cet après-midi et demain à Bruxelles.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

La parole est à M. Marc Dolez, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Monsieur le Premier ministre, avant la réunion de l’Eurogroupe cet après-midi à Bruxelles et à la veille du Conseil européen, ma question porte sur la demande de renégociation de la dette grecque formulée par le gouvernement d’Aléxis Tsípras. Celui-ci affiche clairement sa volonté de trouver avec les gouvernements européens « un compromis viable mutuellement acceptable pour notre futur commun », selon ses propres termes. Pourtant, alors que les négociations ne font que commencer, la Banque centrale européenne décide la semaine dernière de suspendre le financement des banques grecques, au risque de pousser la Grèce vers la sortie et de précipiter l’Europe dans un terrible engrenage. Un tel chantage à l’austérité n’est pas acceptable. Le mandat du peuple grec donné à son gouvernement doit être respecté.

Monsieur le Premier ministre, le rôle de la France peut être déterminant, tant pour faire entendre la voix de la démocratie et de la souveraineté des peuples que pour engager véritablement la réorientation de l’Europe vers la croissance. Autrement dit, et parce que l’Europe ne doit pas s’obstiner dans la poursuite d’une politique menée aux dépens des peuples, la France va-t-elle porter une parole forte, agir, et agir vite pour s’opposer à tout diktat des institutions financières et exiger que le processus de négociation se poursuive sans pression, afin de soutenir résolument le gouvernement grec dans sa lutte contre l’austérité et l’accompagner dans son projet de reconstruction et de développement du pays ?
Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.
Monsieur le député Marc Dolez, la position de la France est simple. Elle poursuit un double objectif. Le premier, c’est de respecter le choix souverain du peuple grec, qui a marqué une volonté très claire lors des dernières élections. Le second, c’est de concilier ce respect avec celui de règles fixées au niveau d’une communauté qui s’est engagée au travers d’un certain nombre de traités. En ayant ces deux objectifs, qui peuvent parfois paraître contradictoires, la France se doit de jouer un rôle de trait d’union entre des positions qui peuvent, par moments, sembler divergentes mais qui finiront, j’en suis sûr, par converger. La dette est en effet un sujet important. J’observe d’ailleurs qu’elle atteint 175 % du PIB, parce que sont montant est élevé, mais aussi et surtout parce que le le PIB de la Grèce s’est effondré, il faut le souligner. Mais si la question de la dette est importante, celle des réformes à mener en Grèce l’est également.
Sur ce point, les premières propositions du Premier ministre grec vont dans le bon sens et la France est prête à accompagner, à soutenir en particulier les réformes de la fiscalité en Grèce où chacun sait que beaucoup de citoyens échappent à l’impôt. C’est tout l’objet des discussions que vous avez évoquées, auxquelles prend part Michel Sapin cet après-midi, au moment où nous parlons. Tel est le sens de notre position. Nul doute que nous saurons parvenir à une solution qui permettra la croissance et le retour à…

La parole est à M. Jacques Moignard, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Monsieur le ministre de l’intérieur, l’ordre du jour du Conseil européen de demain, à Riga, a été bousculé après les attentats des 7 et 9 janvier derniers à Paris. Il sera consacré, non plus à l’union économique et monétaire mais, principalement, à la réponse européenne au terrorisme. Ainsi, le débat relatif à l’Europe de la défense est enfin relancé, ce dont tout Européen convaincu doit se féliciter.
La France est en pointe dans la lutte contre le terrorisme et il est regrettable que l’Europe n’ait pas été plus solidaire des opérations extérieures que notre pays a conduites, au Mali comme ailleurs.
Toutefois, des points de convergence semblent se dessiner, à la veille du Conseil européen, en faveur d’un renforcement de la coopération judiciaire et policière – particulièrement en matière de lutte contre le trafic illégal d’armes à feu –, du développement de la prévention du terrorisme – par la multiplication des initiatives en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’intégration, qui sont susceptibles de mobiliser les fonds structurels européens – et de l’établissement par les États membres d’un cadre pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Monsieur le ministre de l’intérieur, concernant l’adoption de la directive PNR – Passenger Name Record –,…

…le groupe RRDP vous assure de son soutien entier concernant les propositions équilibrées que vous avez présentées au Parlement européen sur la question épineuse de la protection des données personnelles. En effet, comme vous le dites justement, sans le PNR, sans traçabilité des parcours, nous sommes désarmés. Des règles de déontologie solides peuvent être établies en la matière.
J’en viens à l’évolution de l’espace Schengen, également au menu du Conseil de Riga et, plus précisément, de la systématicité des contrôles. Le groupe RRDP est favorable au renforcement de l’espace Schengen : des contrôles systématiques doivent être effectués sur les mouvements des combattants étrangers aux frontières extérieures de l’Union européenne.
Monsieur le ministre, dans quelle mesure pensez-vous que cette évolution de Schengen aboutira, demain, à Riga ?
Applaudissements sur les bancs du groupe RRDP.
Monsieur le député, vous avez soulevé les principales questions qui seront à l’ordre du jour, demain, du Conseil européen de Riga, pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Je voudrais reprendre les points que vous avez évoqués en détaillant l’agenda de demain et les demandes formulées par la France.
Premièrement, pour ce qui concerne le PNR, vous avez évoqué, comme l’a fait Pierre Lequiller à l’instant, la nécessité de nous doter de cet outil. La France est très volontariste sur ce sujet, parce qu’elle considère que, si nous ne disposons pas du PNR et d’un dispositif particulier de signalement, au sein du fichier d’information Schengen, des personnes parties sur les théâtres d’opérations terroristes, nous serons totalement dépourvus pour retracer le parcours de ceux qui franchissent les frontières extérieures de Schengen au retour de ce théâtre d’opérations. Nous voulons donc le PNR, et nous le voulons rapidement.
Pour cela, nous considérons que la discussion doit se nouer avec le Parlement européen sur la base de la proposition faite par la Commission et le Conseil : il n’est pas nécessaire de rouvrir la voie menant à une nouvelle proposition de la Commission et du Conseil, ce qui reporterait l’adoption du PNR à une date lointaine.
Deuxièmement, dans le cadre de l’actuel code Schengen, il est possible, aujourd’hui, d’exercer des contrôles systématiques dans les États, mais cela n’a d’intérêt que si ces derniers sont opérés de façon coordonnée dans tous les États de l’Union européenne. Il faut donc sortir du Conseil de Riga avec l’idée de contrôles systématiques et coordonnés, qui préfigureraient une modification du code Schengen afin, dans un second temps, de rendre ces contrôles obligatoires. C’est la seule solution pour faire en sorte qu’à travers la réforme de Schengen et du PNR, nous soyons armés pour établir la traçabilité du parcours des terroristes.
Troisièmement, il faut inciter l’Union européenne, à l’instar de ce qui s’est fait sur la pédopornographie, à adopter des directives en ce qui concerne internet, de manière à ce que les appels et la provocation au terrorisme soient davantage régulés et que les opérateurs internet soient plus sensibilisés. Tel est l’agenda de demain à Riga.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Ma question, à laquelle j’associe mon collègue Sergio Coronado, s’adresse au secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Le Président de la République a reçu dimanche dernier, le 8 février, Asiya Abdellah, coprésidente du parti de l’union démocratique, principal parti kurde de Syrie, et Nassrin Abdalla, commandante de la branche féminine des unités de protection du peuple. Nous saluons cette rencontre historique. Hier soir encore, c’était au tour du président de la région autonome du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, d’être reçu une nouvelle fois à l’Élysée.
Les peshmergas, les combattants et combattantes kurdes, défendent le peuple kurde, mais aussi les minorités chrétiennes et yézidies en Irak et en Syrie. Le Kurdistan d’Irak accueille des centaines de milliers de réfugiés syriens depuis le début du conflit et sert d’abri aux minorités menacées. Nul doute que les Kurdes sont nos alliés contre les djihadistes de Daech. À Kobané, ce sont les combattants du parti des travailleurs du Kurdistan – le PKK – qui ont brillamment résisté.
Or, le PKK demeure sur la liste des entités considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne, alors même que ce parti a proclamé un cessez-le-feu unilatéral en Turquie, et que son chef, Abdullah Öcalan, mène depuis son île-prison d’mral des négociations directes avec Ankara pour la fin du conflit et le règlement politique de la question kurde en Turquie.
Au regard du rôle joué par le PKK dans la lutte contre le terrorisme islamiste et de la volonté clairement affirmée par ce groupe d’arriver à une sortie de crise pacifique et démocratique en Turquie, il est légitime de questionner sa présence sur la liste européenne des organisations terroristes, alors que Daech n’y figure pas en tant que tel.
Sortir le PKK de cette liste, c’est aussi donner la meilleure chance au dialogue en Turquie et mettre fin à l’interdiction à laquelle s’astreignent la France et l’Union européenne d’être des facilitateurs dans ce dossier. Les organisations kurdes et, plus largement, le peuple kurde, doivent être reconnus et accompagnés par l’Union européenne comme un facteur de stabilisation.
Dès lors, monsieur le secrétaire d’État, comptez-vous oeuvrer pour que l’Europe retire le PKK de sa liste des entités considérées comme terroristes ?
Applaudissements sur les bancs des groupes écologiste, RRDP et GDR, et sur plusieurs bancs du groupe SRC.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Monsieur le député, comme vous l’avez rappelé, le Président de la République a reçu, dimanche, deux représentantes du parti de l’union démocratique pour honorer les combattants et, singulièrement, les combattantes de Kobané, et les féliciter de leur victoire sur Daech dans cette ville du nord de la Syrie, à la fin du mois de janvier.
Cette victoire des forces kurdes, remportée avec l’aide de la coalition internationale, a permis de stopper les offensives du groupe terroriste à Kobané. Il s’agit donc d’une nouvelle positive, très importante, qui s’ajoute à d’autres revers récents de Daech en Irak, même si le combat, nous le savons, sera encore long.
Sur l’initiative du Président de la République, la France, vous le savez, soutient depuis plusieurs mois les Kurdes de Syrie dans la région de Kobané, notamment grâce à une contribution à l’équipement et à la formation des forces kurdes irakiennes, dont certaines sont venues combattre à Kobané, et à un appui aux forces d’opposition modérée en Syrie, qui aspirent à un pays libre, démocratique, unitaire et respectueux des droits de l’homme.
Si nous honorons les combattants qui ont vaincu Daech à Kobané, nous n’oublions pas que Bachar el-Assad n’a, de son côté, rien fait pour sauver la ville. Au contraire, il continue à s’acharner contre Alep, Idleb, Hama et d’autres villes de Syrie, en bombardant, en affamant leur population. Voilà pourquoi nous restons aujourd’hui mobilisés contre deux adversaires : Daech, qu’il faut éliminer, et Bachar el-Assad, encore et toujours, qui entretient ce chaos et qui, par une répression aveugle de sa population et le refus de toute transition politique, contribue à alimenter l’extrémisme.
Je terminerai en rappelant la position claire et constante de la France concernant le PKK : cette organisation est inscrite sur la liste des entités terroristes de l’Union européenne, et les conditions qui ont présidé à son inscription restent valables.
Nous défendons partout les droits du peuple kurde, mais nous nous sommes toujours opposés, et nous nous opposerons toujours à toute forme d’utilisation du terrorisme.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

La parole est à M. Guillaume Larrivé, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le Premier ministre, pour que la voix de la France soit entendue en Europe, il faut qu’elle soit forte et cohérente. Mais notre pays est affaibli depuis bientôt trois ans par le désarmement pénal qui a été engagé par les gouvernements qui se sont succédé. C’est une réalité.

La première faute consiste à laisser en liberté des milliers de malfrats, de trafiquants, d’agresseurs.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Mes chers collègues, ne tombez pas dans les provocations, s’il vous plaît !

Tel était l’objet de la loi qui a supprimé les peines planchers et qui a multiplié les réductions de peine.
La deuxième faute est de faire semblant de croire que la délinquance de droit commun et la criminalité terroriste n’auraient pas de rapport. C’est une erreur tragique, bien sûr, et les parcours de Coulibaly ou de Kouachi l’ont, hélas, démontré.
La troisième faute, monsieur le Premier ministre, c’est de refuser obstinément d’augmenter le nombre de places de prison ; il y en a 96 000 au Royaume-Uni, et seulement 57 000 en France.
Parce que nous respectons l’autorité judiciaire, nous vous appelons à rompre avec cette politique pénale qui entrave le travail des magistrats. Nous vous demandons de donner à l’autorité judiciaire tous les moyens de condamner fermement les terroristes à des peines de prison sans aucune forme de libération anticipée. Nous voulons que l’administration pénitentiaire ait enfin les moyens d’isoler tous les détenus radicaux.

Nous voulons créer une rétention de sûreté pour que les terroristes condamnés restent isolés à leur sortie de prison, et nous vous appelons aussi, bien sûr, à expulser tous les terroristes étrangers.

Nous vous appelons aussi, monsieur le Premier ministre, à tirer toutes les conséquences politiques de la guerre contre le terrorisme en vous posant une question simple : Mme Taubira a-t-elle encore sa place au sein de ce gouvernement ?
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP. – Vives protestations sur les bancs des groupes SRC et RRDP.

Mes chers collègues, veuillez retrouver votre sérénité ; le Premier ministre va répondre.
La parole est à M. le Premier ministre.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Guillaume Larrivé, Mme Christiane Taubira est actuellement en déplacement aux États-Unis…
…où, avec son homologue américain, comme nous le faisons depuis deux ans et demi et comme cela a été fait par le passé, elle discute de la lutte contre le terrorisme. À l’évidence, Français et Américains doivent faire face ensemble.
Puisque c’était l’objet de votre dernière remarque, je pense qu’il est tout à fait légitime que les événements que nous avons connus suscitent débats et questionnements. Cela étant dit, notre pays sera d’autant plus fort que sur ces questions nous utiliserons, les uns et les autres, les bons mots et que nous ne nous affaiblirons pas collectivement. Vous avez toute légitimité à poser des questions, mais je crois avoir pour ma part toute légitimité à vous dire que ce gouvernement, avec, je n’en doute pas un seul instant, le soutien de la représentation nationale, fait tout et fera tout pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme et l’islamisme radical. Et nous le faisons avec les armes du droit, avec la force de la République.
Monsieur Larrivé, puisque je ne veux pas succomber, moi, à la tentation de la polémique, je peux vous dire qu’en tant que chef du Gouvernement, je suis fier de compter sur deux ministres tout à fait essentiels sur ces questions-là : Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira.
Vifs applaudissements sur les bancs des groupes SRC, RRDP, écologiste et GDR.
Vous ne m’entraînerez jamais dans ce vieux débat, que j’ai connu aussi lorsque j’étais ministre de l’intérieur : c’est tellement facile d’opposer l’action de la police, de la gendarmerie et des services à l’action de la justice !
À chaque fois, monsieur Larrivé, vous ou vos amis essayez d’affaiblir la garde des sceaux, le ministère de la justice, qui jouent pourtant un rôle essentiel.
Permettez-moi de vous rappeler que toutes les enquêtes antiterroristes sont menées sous l’autorité du parquet. Ce n’est pas le rôle du Parlement, ce n’est pas le rôle de l’Assemblée nationale d’affaiblir la justice et la garde des sceaux !
Vifs applaudissements sur les bancs des groupes SRC, RRDP, écologiste et GDR.
J’entends bien sûr votre préoccupation d’assurer la sécurité des Français, mais parler ici de fautes, celles du Gouvernement ou d’un ministre de la République, alors qu’il y a toujours une menace et un danger terroristes, ce n’est pas à la hauteur de la situation que nous connaissons, monsieur Larrivé !
Applaudissements sur les mêmes bancs.
Je vais vous rappeler quelques vérités : chacun ici sait que la politique pénale est le fruit d’un travail mûri, scientifique, éclairé, dont l’objectif est l’efficacité. Et l’efficacité – vous le savez parfaitement puisque vous connaissez ces sujets –, c’est la peine individualisée, le suivi serré des condamnations. C’est ce que nous faisons.
J’ai en outre annoncé ici même, à la tribune, à la suite du conseil des ministres au cours duquel, sous l’autorité du Président de la République, des mesures contre le terrorisme ont été adoptées, qu’il fallait non seulement assurer ce suivi individualisé, mais aussi, sur la base des expérimentations que nous avons déjà menées, isoler, en effet, tous ceux qui représentent un danger en matière de terrorisme.
Je me dois de vous rappeler, monsieur Larrivé, que la réforme dite pénale est entrée en vigueur, selon les dispositions, le 1er octobre dernier ou le 1er janvier dernier. Il n’y a donc aucun lien entre la situation que nous avons connue et la loi pénale ; et n’en cherchez pas, parce que c’est mentir aux Français, ce n’est pas leur dire la vérité.
C’est un mensonge, à des fins uniquement politiques.
Plus vous tirerez la corde sur ce sujet-là, plus vous connaîtrez les déconvenues que vous avez connues il y a une semaine dans le Doubs.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.
Il faut être rigoureux, parler des faits, et seulement des faits. Un des assassins, par exemple, avait été placé sous surveillance électronique de fin de peine en mars 2014. Je ne peux que vous rappeler qu’à cette date, la réforme pénale n’était même pas en cours de discussion au Parlement ; à l’époque, et je ne vous le reproche pas, ce sont les lois que vous avez votées, en l’espèce la loi pénitentiaire de 2009, qui étaient en application.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.
Quand on veut critiquer, on regarde l’ensemble des faits et on assume aussi ses propres responsabilités, monsieur Larrivé.
Le Gouvernement veut faire toute la lumière sur ce qui s’est passé, en tirer toutes les leçons. Dans quelques semaines, le Parlement sera saisi d’un texte de loi sur le renseignement ; ce sera l’occasion d’avancer ensemble sur tous ces sujets. De grâce, face à l’attente des Français, le rôle du Gouvernement et de la majorité, mais aussi, j’ose vous le dire, celui de l’opposition, c’est d’être à la hauteur des responsabilités…
… et de ne pas polémiquer sur ce qui n’intéresse personne.
Vifs applaudissements sur les bancs des groupes SRC, RRDP, écologiste et GDR. – Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

La parole est à M. Philippe Folliot, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Monsieur le ministre de la défense, le Président de la République a martelé l’idée selon laquelle la France agit à l’extérieur de son territoire pour défendre non pas son seul intérêt mais l’intérêt global.
Si elle doit être globale, la lutte contre le terrorisme doit aussi être partagée. En particulier, cette « responsabilité de protéger » les citoyens, français comme européens, implique des droits et des devoirs pour tous.
La présence sur le territoire européen de plus de 5 000 profils djihadistes, combattants potentiels au coeur de l’Europe, oblige désormais l’Union à affronter ces derniers de manière plus unie et solidaire sur les fronts intérieurs comme extérieurs : Mali, Niger, Nigeria, Libye, Syrie, etc.
À l’UDI, nous pensons qu’une mutualisation des coûts des opérations extérieures à l’échelle européenne doit rapidement se mettre en place, car la France ne peut pas seule supporter, au-delà du prix du sang, le coût financier des OPEX. Une ligne budgétaire dédiée commune pourrait y remédier.
Nous pensons qu’il est également indispensable d’oeuvrer à une meilleure coordination des alertes précoces sur le plan de l’acquisition du renseignement, par la création d’un véritable service de renseignement européen mutualisé. De plus, l’harmonisation des réponses judiciaires doit enfin aboutir à la mise en place effective d’un parquet et d’un procureur européens, comme le permet l’article 86 du traité de Lisbonne.
Monsieur le ministre, avons-nous fait, en tant qu’Européens, tout le travail de prévention nécessaire face aux actes terroristes, par nature volatiles ? N’y a-t-il pas aujourd’hui manière et matière à travailler davantage en commun avec notre voisinage européen ? À l’aune du prochain Conseil européen, allez-vous ainsi poser clairement les bonnes questions à nos vingt-sept partenaires, afin qu’ils remplissent, comme le Président de la République les y a incités, leur devoir ?
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UDI.
Monsieur le député, vos questions sont particulièrement opportunes. La menace terroriste que nous combattons au Levant, au Sahel, en République centrafricaine ne concerne pas uniquement la sécurité des Français, mais celle de l’ensemble des citoyens européens. Comme vous, j’estime qu’il existe une obligation de solidarité européenne.
Des progrès ont été réalisés. Un conseil européen a été consacré aux questions de défense en décembre 2013 – ce n’était plus arrivé depuis cinq ans. Les Européens sont présents au Mali – un général espagnol commande l’EUTM, la mission de formation de l’Union européenne au Mali, à Bamako – et en République centrafricaine, avec pour mission de protéger les quartiers les plus sensibles de Bangui. La brigade franco-allemande est intervenue au Mali ; des Suédois et des Néerlandais sont présents sur les théâtres d’opérations. Mais tout cela n’est pas suffisant.
Face aux défis auxquels l’Europe est confrontée, la réponse n’est pas au rendez-vous. Il faut prendre de nouvelles initiatives. Parmi les points que vous avez évoqués, deux me paraissent majeurs. La participation financière de l’Union aux opérations extérieures doit être accrue – le dispositif Athena ne concerne aujourd’hui que 10 % des opérations. Le renseignement doit faire l’objet, non pas d’une mutualisation, mais d’une coopération renforcée, avec un mécanisme bien identifié.
Nous voulons aborder ces deux sujets lors du Conseil européen de défense qui aura lieu en juin. J’espère que nous réaliserons des avancées significatives.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Monsieur le Premier ministre, la France a connu en janvier des événements on ne peut plus dramatiques. Au premier rang de la grande marche républicaine du 11 janvier se trouvait le secrétaire général du Conseil de l’Europe. Quelques jours après, lors de la première partie de session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, nous avons organisé un débat sur le terrorisme selon notre procédure d’urgence.
Mes collègues et moi qui siégeons à l’Assemblée parlementaire avons pu noter que l’émotion était grande et sincère. Nous avons entendu les représentants des quarante-six autres États membres de l’organisation appeler de leurs voeux une solution globale pour lutter contre le terrorisme.
Mais le mal français, qui consiste à vouloir toujours recréer des organismes existants, touche aussi l’Europe. Pourquoi l’Union européenne veut-elle recréer ce qui existe au Conseil de l’Europe ?

Je pense à la Convention pour la prévention du terrorisme, à la Convention pour la répression du terrorisme, à l’accord partiel, Moneyval, créé il y a quelques années pour lutter contre le blanchiment d’argent, l’une des causes principales du terrorisme, ou encore au GRECO, le Groupe d’États contre la corruption.
Le Gouvernement a-t-il l’intention de montrer l’exemple et d’utiliser les outils dont nous disposons déjà ?
Je suis intimement convaincu que la réponse au terrorisme sera globale. C’est ensemble que les États – non seulement les vingt-huit de l’Union européenne mais aussi les quarante-sept membres du Conseil de l’Europe – pourront lutter contre le terrorisme.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Monsieur le député, le Conseil de l’Europe, par son rôle unique de protecteur des droits de l’homme et des valeurs démocratiques sur l’ensemble du continent européen, est en première ligne dans le combat que nous menons contre le terrorisme.
Je vous remercie d’avoir suscité la mobilisation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, au lendemain des attentats à Paris,…
…et après que le secrétaire général de l’organisation, M. Jagland, a montré son engagement, par sa présence le 11 janvier à Paris, aux côtés des Français et du Président de la République.
La France abrite le siège de cette organisation et est pleinement consciente de son importance.
C’est la raison pour laquelle nous soutenons les propositions de son Secrétaire général, qui portent notamment sur la ratification de la Convention pour la prévention du terrorisme – à ce jour, seuls trente-deux des quarante-sept États membres l’ont ratifiée –, sur l’élaboration d’un protocole additionnel spécifique à cette convention, consacré à la question des « combattants étrangers », qui sont en réalité des terroristes, et sur le lancement d’une réflexion sur les mesures qui doivent être engagées dans les écoles, dans les prisons et sur internet pour endiguer le fléau de la radicalisation.
Vous avez raison, les outils créés par le Conseil de l’Europe doivent être pleinement mobilisés. L’objectif est de doter le Conseil de l’Europe, lors de la réunion ministérielle qui se tiendra le 19 mai, d’un plan d’action pour lutter contre la menace terroriste et la radicalisation en Europe. La menace est globale, la riposte doit être globale : le Conseil de l’Europe y jouera un rôle éminent.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Monsieur le ministre de l’intérieur, les attentats qui ont meurtri la France en janvier ont renforcé, c’est peu de le dire, notre détermination à lutter implacablement contre le terrorisme. Notre sécurité intérieure a été renforcée grâce au plan Vigipirate écarlate, qui mobilise nos soldats, nos policiers et nos gendarmes. Qu’ils en soient ici remerciés.
Mais le terrorisme contre lequel nous nous battons ne relève pas que du territoire national. Dans ce contexte, l’Union européenne doit pouvoir garantir un maximum de sécurité à tous ses citoyens.
Le Conseil européen qui aura lieu demain et après-demain semble prendre le sujet à bras-le-corps. Système d’information, partage des données sur les casiers judiciaires, partenariats entre les forces de l’ordre et mandat d’arrêt européens sont autant d’outils pour lutter contre le terrorisme. Il faut aller plus loin.
Nous devons accélérer la mise en place du registre européen des données de passagers aériens, le PNR. Je sais que la France pèse de tout son poids pour que les États européens mettent en place le PNR. Jusque-là, et dans des circonstances qui ont été rappelées, ce dossier était bloqué. J’espère désormais qu’il avancera au plus vite.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire en quoi le Conseil européen permettra d’intensifier la mise en place des partenariats et des outils permettant de lutter efficacement contre le terrorisme ?
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.
Monsieur le député, permettez-moi de rappeler l’importance du phénomène auquel la France et, au-delà, l’Union européenne, sont confrontées. Près de 2 000 de nos ressortissants sont concernés par un engagement dans des opérations terroristes, notamment en Irak et en Syrie ; près de 700 se sont rendus sur des théâtres d’opérations ou en reviennent ; plus de 250 ont manifesté la volonté de s’y rendre et à peu près autant sont quelque part, au sein de l’Union européenne, entre la France et la Syrie.
Il est impossible de procéder à la prise en charge judiciaire de ceux qui reviennent, généralement guidés par le seul instinct de la violence, si nous ne disposons pas d’outils. Quels sont-ils ?
D’abord, une très bonne coopération au sein d’Europol et d’Eurojust, qui permette de mieux identifier les messages appelant à la haine ou provoquant au terrorisme. C’est le rôle de la plate-forme « Check the Web », qui travaille avec la plate-forme PHAROS, en France, et d’autres, initiées par des pays de l’Union européenne.
Ensuite, nous devons disposer des outils permettant de rétablir la traçabilité des passagers qui franchissent les frontières extérieures de l’Union européenne et peuvent représenter un danger. C’est pourquoi nous avons besoin d’installer un système d’information Schengen avec un signalement des « combattants étrangers », de réformer le code Schengen pour permettre des contrôles plus systématiques, et de mettre en place le PNR, qui permet aux pays d’être informés, dès la réservation des billets, du parcours de terroristes dangereux.
Si nous disposons de ces trois outils, nous serons en situation de faire face au retour des terroristes beaucoup plus efficacement, en permettant leur prise en charge judiciaire. Ce sera l’objet du Conseil européen de demain. La France est déterminée à le faire aboutir.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

La parole est à Mme Marie-Louise Fort, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le Premier ministre, les graves attentats terroristes qui ont secoué notre pays au début du mois de janvier ont mis en lumière les différentes filières permettant à de jeunes Français radicalisés de rejoindre les terres de djihad, essentiellement en Syrie et en Irak.
Qu’il s’agisse de Moussa Coulibaly, l’auteur de la très grave agression de nos soldats à Nice, de Mehdi Nemmouche, l’assassin du musée juif de Bruxelles, de Hayat Boumeddiene, la compagne de Coulibaly – le meurtrier de Montrouge et de l’Hypercacher – ou encore de la soeur de Mohammed Merah, des jeunes de Lunel et des centaines de personnes qui se rendent en Syrie, tous ont un point commun : ils sont à un moment donné de leur parcours passés par la Turquie, véritable sas d’entrée vers le djihad.
Je rentre de Turquie, où la commission des affaires étrangères a mené une mission. Nous y avons rencontré des autorités qui nous ont fait part du nombre important et croissant de Français refoulés à leur arrivée en Turquie.
Monsieur le Premier ministre, notre coopération en matière sécuritaire avec la Turquie est essentielle. Les ratés du système CHEOPS et la mascarade médiatisée du retour en France de trois djihadistes, dont le mari de Souad Merah, en septembre dernier, ont permis de renouer efficacement avec les Turcs, en particulier suite au déplacement dans ce pays du ministre de l’intérieur.

Quels moyens de coopération mettons-nous en oeuvre avec les Turcs pour répondre à ces enjeux, sachant qu’ils ont recensé 7 000 individus – dont 600 ressortissants français – interdits d’entrée sur leur territoire ? Comment expliquer que l’accompagnateur de Hayat Boumeddiene, Mehdi Belhoucine, connu et surveillé par nos services, ait pu entrer avec elle en Turquie au début du mois de janvier dernier ? Enfin, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer combien de Français revenant du djihad ont été renvoyés vers la France depuis la Turquie ces derniers mois ?
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et sur quelques bancs du groupe UDI.
Madame la députée, vous soulevez la question essentielle de la coopération entre la France et la Turquie pour lutter contre le terrorisme. Vous avez eu raison de souligner qu’il s’était produit des manquements dans cette coopération depuis de nombreuses années, pour des raisons qui tenaient d’abord au fait que la discussion entre nos services concernant l’identification par les autorités turques des ressortissants européens se rendant sur leur territoire était compliquée par un déficit de communication.
Nous communiquons désormais aux autorités turques l’identité de tous ceux dont nous savons qu’ils sont partis pour la Syrie et qu’ils peuvent transiter par la Turquie, de manière à faciliter leur refoulement avant même qu’ils ne rejoignent le théâtre des opérations terroristes ou à les interpeller au moment de leur retour.
Nous souhaitons également que les autorités turques nous informent de l’identité des Français qui ont traversé la frontière turco-syrienne et qui sont placés en centre de rétention en Turquie avant d’être renvoyés en France, de manière à sécuriser le retour de ces combattants étrangers et à assurer leur judiciarisation en France.
C’était l’objet de mon déplacement en Turquie. Nous avons établi des règles et un protocole. Désormais, il se produit chaque semaine plusieurs retours de ressortissants français en provenance de la Turquie, retours qui se déroulent dans des conditions parfaites et au terme desquels la judiciarisation de ces personnes, ou à tout le moins leur audition par les services de renseignement, est possible.
Je veux ensuite insister sur la nécessité d’aller plus loin dans cette coopération, par des échanges entre nos services de renseignement concernant le profil de ceux qui sont partis et de leurs accompagnateurs, lesquels ne sont pas nécessairement français, et concernant aussi l’activité d’un certain nombre de cellules dormantes en Turquie.
C’est sur ces sujets que nous travaillons de façon confiante et renforcée avec les autorités turques, pour lutter efficacement contre le terrorisme.

La parole est à Mme Marie-Anne Chapdelaine, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.

Monsieur le secrétaire d’État aux affaires européennes, si le prochain Conseil européen doit principalement traiter de la lutte contre le terrorisme, la situation économique du continent sera également au centre des attentions.
À cet égard, la décision de la Banque centrale européenne du 22 janvier, qui permet de procéder à un assouplissement quantitatif, constitue un bouleversement majeur. En effet, la Banque centrale va progressivement racheter l’équivalent de 1 000 milliards d’euros de dette publique. C’est la meilleure arme contre la déflation et contre l’atonie de la croissance – deux maux qui, aujourd’hui, sont intimement liés.
Chers collègues, si les effets à long terme de cette mesure sont encore mal identifiés, nous en connaissons l’origine. Dès 2012, le Président François Hollande a prôné une rupture avec les logiques anciennes pour refonder le fonctionnement de l’Union. La persévérance de la France à défendre une réorientation européenne porte ses fruits sur tous les fronts : sur le front budgétaire d’abord, avec le plan Juncker, sur le front réglementaire ensuite, avec la lutte contre la fraude et le développement de nouvelles régulations, et sur le front monétaire, enfin, avec les décisions de la BCE.
En effet, outre la politique de rachats de titres publics, la politique de la BCE permet également de sortir du carcan de l’orthodoxie libérale en matière de parité et de taux d’intérêt : la baisse de l’euro face au dollar favorise la compétitivité et la relance de l’emploi, et la baisse des taux d’intérêt permet à la France de bénéficier de taux historiquement bas et de ne pas étouffer sous les charges financières.
Monsieur le secrétaire d’État, quels résultats attendez-vous de la nouvelle donne monétaire européenne ?
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Vous avez raison, madame la députée, de souligner l’importance des mesures très spectaculaires qu’a annoncées la Banque centrale européenne. Ces mesures d’assouplissement quantitatif – ou quantitative easing en anglais – prennent concrètement la forme d’une injection de liquidités de l’ordre de 1 000 milliards d’euros sur une période de dix-neuf mois.
Cela signifie tout simplement que les banques pourront prêter davantage aux entreprises et aux ménages, et que l’accès au crédit bancaire et le financement des investissements, de l’immobilier et des dépenses des ménages s’en trouveront facilités dans l’ensemble de la zone euro.
Cela permettra aussi de maintenir l’euro à un faible niveau, ce que nous souhaitions – comme le Premier ministre l’avait indiqué dans sa déclaration de politique générale – parce que cela est plus favorable à nos exportations.
Enfin, ces mesures contribuent à restaurer la confiance en Europe parce qu’elles favorisent l’investissement et la consommation.
C’est donc une décision que nous devons saluer et dont nous pouvons nous féliciter, tout en respectant évidemment l’indépendance de la Banque centrale. Mais comme le Président de la République l’avait indiqué à Davos, nous pensons qu’il s’agit de l’un des éléments d’une nouvelle orientation des politiques économiques en Europe. Il va de soi que tout ne peut pas relever de la seule politique monétaire. Il faut combiner cette action très forte de la Banque centrale européenne avec l’action de soutien aux investissements – à hauteur de 315 milliards d’euros – conduite dans le cadre du plan Juncker, et avec l’utilisation du budget européen. Corina Creu, la commissaire européenne à la politique régionale, était en France aujourd’hui même : la France va bénéficier de 26 milliards d’euros de fonds structurels européens et de fonds européens d’investissement, et elle est le premier pays à avoir signé le programme opérationnel. En outre, toutes les régions françaises ont d’ores et déjà signé leur contrat avec la Commission européenne.
C’est donc la combinaison de ces différents éléments avec les réformes structurelles et avec l’orientation vers la croissance qui permettra le redémarrage que nous sentons poindre dans la zone euro. Vous avez vu que la production industrielle était en hausse au…

La parole est à M. Alain Suguenot, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Monsieur le ministre de l’intérieur, le Conseil européen qui se réunira demain à Riga abordera notamment la question du PNR européen – que vous avez vous-même évoqué à plusieurs reprises, en particulier hier –, c’est-à-dire le fichier, dont on parle beaucoup actuellement, qui est destiné à regrouper les données des voyageurs passés par nos aéroports, dans le but de renforcer les moyens des services de renseignement.
La lutte impérative et ferme contre le terrorisme – pour reprendre les termes que vous avez employés – ne peut souffrir d’approximations, fût-ce de la part de Mme Taubira et n’en déplaise à M. le Premier ministre, ni de calculs politiciens.
Exclamations sur les bancs du groupe SRC.

Nous avons noté votre soutien à la mise en place de directives ayant trait au système d’échange de données sur les passagers aériens et, comme l’a très justement relevé M. Pierre Lequiller, nous ne pouvons rester spectateurs pendant plusieurs mois de cet imbroglio qui bloque le processus, en raison surtout de l’opposition des eurodéputés socialistes, Verts et même Front national.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et sur plusieurs bancs du groupe UDI.

Plusieurs pays ont mis en place leur propre système de PNR – c’est le cas du Royaume-Uni, depuis 2008. D’autres y adhèrent également, comme la Belgique, la Suède ou le Danemark.
Cet outil est très utile, vous l’avez rappelé, car il permet de détecter des comportements inhabituels, comme l’achat d’un aller simple pour une destination sensible ou un vol réservé à la dernière minute avec des escales multiples, pour brouiller les pistes.
En France, la loi de programmation militaire permet l’exploitation de la collecte des données PNR par les services de police et de renseignement. La délégation parlementaire, dans son rapport d’activité de 2014, appelait d’ailleurs de ses voeux la mise en place d’un système « PNR France », c’est-à-dire d’un système français, en attendant le système européen.
Monsieur le ministre de l’intérieur, en attendant de convaincre vos amis politiques au Parlement européen, désirez-vous la mise en place de ce système national ou voulez-vous que nous attendions encore de longs mois, avec les risques que vous connaissez pour la sécurité de nos concitoyens ?
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.
Monsieur le député, comme vous le savez, il y aura un PNR français – tous les textes ont été pris, y compris les dispositions réglementaires – et il sera en vigueur à partir de la rentrée prochaine, en septembre ou octobre 2015. Votre demande est donc totalement satisfaite par le travail que nous avons fait. Nous considérons en effet que, sans attendre ce que l’Union européenne peut faire, chaque État européen doit se doter d’un PNR qui, si l’Union européenne décide de ne pas statuer, permettra aux différents membres d’échanger entre eux des informations.
Le premier inconvénient d’un dispositif qui verrait les différents pays se doter chacun d’un PNR et nouer entre ces PNR des relations conventionnelles sans qu’il existe un PNR européen, c’est qu’il y aurait moins de garanties pour la protection des données. Avec une directive européenne permettant d’allier plus de sécurité et plus de garanties pour les libertés publiques, l’Europe, dans sa globalité, y gagnera.
Nous aurons donc un PNR, les Britanniques en ont déjà un, mais un PNR européen permettra un meilleur équilibre. Tous ceux qui, au sein de l’Union européenne, sont favorables à ce qu’il y ait davantage de garanties pour la protection des données devraient donc se précipiter pour voter ce PNR, qui en est la condition.
Par ailleurs, si nous voulons que le PNR soit efficace, il doit exister dans tous les pays de l’Union européenne, faute de quoi les terroristes se détourneront des aéroports où les accords Schengen sont mis en oeuvre et où un PNR s’appliquera, pour aller vers ceux où ces dispositifs n’existent pas, créant ainsi en Europe de véritables sanctuaires pour les terroristes. Il faut donc être très déterminés.
Je veux vous confirmer, monsieur le député, que je le suis totalement pour obtenir avec d’autres ministres, notamment avec mon homologue allemand Thomas de Maizière, l’accord du Parlement européen sur ce point. Cela suppose du temps, des garanties et du rassemblement. C’est la raison pour laquelle il n’est pas utile de nous diviser sur ce sujet. Je suis convaincu qu’armés de cette volonté, nous y parviendrons.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

La parole est à M. Meyer Habib, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Monsieur le Premier ministre, le drame des attentats de janvier a été pour nous une sorte de 11 septembre. Face à ces crimes, vous avez eu des paroles très fortes. Mais après les paroles, il est urgent de passer aux actes : radicalisation dans les prisons, déchéance de nationalité, PNR, renseignement, internet, coopération européenne, mais aussi prévention et éducation – les chantiers sont immenses et notre commission d’enquête sur le djihadisme présentera d’ailleurs prochainement ses conclusions.
Permettez-moi cependant de m’arrêter sur deux points. L’un est sémantique – mais d’une portée symbolique fondamentale –, l’autre géopolitique.
Les terroristes islamistes sont régulièrement désignés comme des « combattants » par vos ministres et dans les notes de service, françaises ou européennes. Or, l’utilisation de ce terme est une faute sémantique et morale : comment ose-t-on utiliser le même terme pour qualifier les héros de la France, anciens combattants, et ces lâches barbares ? Non ! Ces hommes qui lapident et violent des femmes, qui égorgent des innocents, qui brûlent vifs des otages, sont tout sauf des combattants.
Comme nous l’enseigne Austin, philosophe du droit, nommer et dire, c’est déjà faire. Et nommer notre ennemi est un premier pas indispensable dans la lutte contre ce fléau.
Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous imposer une directive formelle pour qu’à partir de ce jour, ces assassins soient appelés « terroristes », « djihadistes » ou « islamistes », mais en aucun cas « combattants » ? Soyons aussi à l’initiative d’une instruction européenne en ce sens.
Deuxième inquiétude : le terrorisme se développe parce que des pays lui apportent leur concours logistique, militaire et financier. Ces États, hélas ! nous les connaissons, nous les fréquentons, et flirtons même avec certains d’entre eux.
L’un de ces États, en particulier, m’inquiète : l’Iran, dont huit dirigeants actuels sont visés par des mandats d’Interpol parce qu’impliqués directement dans les attentats de 1994 à Buenos Aires, où 84 personnes ont été assassinées ; l’Iran, qui met à profit le fait que nous nous concentrions sur Daech, pour nous endormir et obtenir à tout prix l’arme nucléaire, avec les conséquences que l’on peut imaginer.
Hélas, les États-Unis baissent la garde. Comment empêcher l’Iran…

Merci, monsieur le député.
La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Protestations sur les bancs du groupe UDI.
Monsieur le député, la sémantique est importante et, en effet, il ne faut pas tout confondre. Le Premier ministre et le Gouvernement ont très clairement dénoncé l’islamisme radical, le djihadisme et le terrorisme, le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, parlant même de « djihado-terrorisme ». Quant à l’expression de « combattants étrangers », il s’agit de la traduction de l’anglais « foreign fighters », utilisée dans le débat international.
Vous avez cependant raison de procéder à cette mise en garde, car il s’agit à de nombreux égards d’une tournure abusive : ces « combattants étrangers » sont en fait des terroristes et c’est pour cette raison que nous les poursuivons et les combattons. La loi française ne fait d’ailleurs aucune référence à cette expression, mais uniquement à celle de « terroristes » et, lorsqu’ils reviennent sur le sol national, ils sont poursuivis pour « participation à une entreprise terroriste ». Il n’y a donc aucune ambiguïté.
Pour ce qui est de l’Iran, M. Laurent Fabius a toujours été très clair : il n’y a pas de mélange des genres entre les négociations sur le nucléaire et les enjeux régionaux. Nous mettons là un cloisonnement absolu et la France ne baisse pas la garde sur le nucléaire iranien : l’Iran ne doit pas accéder au nucléaire militaire. Les agissements de l’Iran et son jeu régional sont un sujet de préoccupation, mais c’est précisément ce qui rend nécessaire de parler avec ce pays.
Notre diplomatie cherche donc à faire en sorte que tous les acteurs prennent leurs responsabilités dans la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. Nous parlons donc avec l’Iran mais, en même temps, nous participons avec la plus grande fermeté aux négociations sur le nucléaire iranien, car il ne doit pas y avoir d’accès de ce pays au nucléaire militaire.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

La parole est à M. Didier Quentin, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Ma question s’adresse à M. le Premier ministre. Comme cela a déjà été abondamment dit cet après-midi, la protection des frontières de l’espace Schengen est un enjeu crucial et l’échange d’informations entre États européens est primordial si nous entendons anticiper de nouvelles menaces. C’est tout l’enjeu du fichier des passagers aériens, dit PNR, sur lequel Pierre Lequiller et Alain Suguenot ont eu l’occasion de vous interroger.
C’est également l’enjeu du système d’information Schengen II, dit SIS II, institué pour permettre aux États européens d’échanger des informations, pour encadrer l’accès à l’Union européenne, mais aussi pour signaler des personnes susceptibles d’avoir participé à des actes criminels graves. Aussi, monsieur le Premier ministre, une actualisation du SIS II est-elle envisagée en matière de terrorisme ?
Le contrôle des frontières extérieures est d’autant plus difficile, il faut le reconnaître, que les jeunes Européens qui reviennent de Syrie ou d’Afghanistan sont précisément des Européens et sont donc peu contrôlés à leur retour.
À ce titre, le « code frontières Schengen », prévu par un règlement européen de 2006, laisse apparaître certaines dispositions perfectibles, notamment son article 7 qui prévoit que les ressortissants de l’espace Schengen qui sont de retour peuvent uniquement – je dis bien : uniquement –faire l’objet d’une vérification minimale. Il nous semble donc que l’amélioration de l’article 7 est un objectif que la France devrait défendre à Bruxelles.
Plus largement, pouvez-vous nous indiquer, monsieur le Premier ministre, les moyens que la France entend mobiliser, en liaison, bien sûr, avec nos principaux partenaires, pour un contrôle effectif – je dis bien : effectif – des frontières extérieures de l’Union européenne ? L’enjeu est trop grave, comme on l’a vu cet après-midi, et le contrôle de nos frontières indispensable. Il est donc plus que temps d’agir, et d’agir efficacement !
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.
Monsieur le député Quentin, vous êtes trop informé pour ne pas savoir que ce que vous demandez est exactement ce que nous faisons – nous allons peut-être même au-delà. Je vais prendre des exemples extrêmement concrets. Cet été, pour des raisons qui tenaient aux inquiétudes que nous avions concernant le contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne, notamment en raison de la situation en Méditerranée centrale, j’ai, à la demande du Premier ministre, effectué une tournée au sein des pays de l’Union européenne avec des propositions françaises : fin de Mare Nostrum, substitution à Mare Nostrum, engagée par l’Italie de façon unilatérale au sein de l’Union européenne, d’une opération FRONTEX de contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne et engagement d’une réflexion européenne sur la réforme du code Schengen.
Pourquoi ? Exactement pour les raisons que vous venez d’indiquer et qui me conduisent à vous rejoindre en tout point dans l’argumentation. Nous avons ainsi besoin de contrôles systématiques au moment du franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne, y compris pour nos ressortissants et ce, en tout pays du territoire de l’Union. Sinon, il y aura un déport des terroristes d’aéroports où ces contrôles se font vers des aéroports où ces contrôles ne se font pas.
Est-ce que l’actuel code Schengen permet de faire ces contrôles systématiques ? Oui, dans chaque pays, mais pas de façon obligatoire au sein de la totalité des pays de l’Union européenne. Est-ce que nous devons obtenir une modification du code Schengen pour atteindre ce but ? La réponse est oui. Est-ce que tous les pays de l’Union européenne y sont prêts ? La réponse est non : c’est la raison pour laquelle l’Allemagne et la France agissent ensemble au sein de l’Union européenne pour convaincre tous les pays de l’Union, y compris ceux qui ne sont pas touchés par le terrorisme, du risque qui s’attache, au regard de la menace terroriste, à ne pas mettre en place ces mesures pour l’ensemble des pays de l’Union.
Nous voulons atteindre ce but et, dans l’attente d’obtenir le résultat, nous pouvons d’ores et déjà mettre en place des contrôles systématiques et coordonnés dans le cadre de l’actuel code Schengen. C’est l’objectif de la réunion de demain.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe SRC.

La parole est à Mme Maud Olivier, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.

Ma question s’adresse à Mme la secrétaire d’État chargée des droits des femmes. L’égalité femmes-hommes s’est peu à peu imposée comme l’un des piliers du modèle social européen et des valeurs qui nous unissent. On peut citer la Charte des droits fondamentaux, qui mentionne explicitement que « l’égalité femmes-hommes doit être assurée dans tous les domaines ».
Mais il nous faut aller plus loin. Les violences faites aux femmes sont toujours extrêmement importantes : une Européenne sur cinq a subi des violences physiques ; une sur dix des violences sexuelles ; 500 000 femmes ou filles ont subi des mutilations génitales en Europe. Si notre Assemblée a réaffirmé il y a quelques semaines le droit fondamental à l’avortement, il est toujours illégal dans plusieurs pays européens et la législation espagnole a été sauvegardée de justesse grâce à une mobilisation féministe de toute l’Europe.
Les sociétés, les cultures, s’influencent mutuellement. Les régressions de l’égalité dans un pays peuvent engendrer un recul des droits ailleurs dans le monde. Au contraire, les avancées des droits des femmes dans une société peuvent être porteuses d’espoir et d’inspiration pour d’autres luttes féministes.
De belles lois en matière d’égalité, en Europe, il y en a : en France d’abord, notre législation contre les violences, sans cesse complétée et améliorée, peut servir de référence. La loi espagnole en matière de publicité sexiste, les lois suédoises relatives aux congés parentaux rémunérés ou au service public de l’enfance, et bien sûr celle interdisant l’achat d’actes sexuels : les États membres ne manquent pas d’inspiration, mais dans chaque pays, les législations sont partielles.
Aussi, madame la secrétaire d’État, n’est-ce pas le moment de remettre à l’ordre du jour de l’Union la clause de l’Européenne la plus favorisée, proposition initiée dès 1979 par Gisèle Halimi et qui consiste à faire le choix dans chaque État membre du statut des femmes au niveau le plus élevé et d’en doter l’Européenne en un statut unique ?
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée des droits des femmes.
Madame la députée Maud Olivier, l’égalité entre les femmes et les hommes est un des principes fondateurs de l’Union européenne ; elle est, pour le Gouvernement, au coeur de toutes nos politiques.
L’idée d’une clause de l’Européenne la plus favorisée rejoint notre volonté d’unir par le droit, d’unir par la liberté des femmes, d’unir vers le progrès social.
L’harmonisation doit donc se faire par le haut, dans l’esprit de ce que propose l’association Choisir la cause des femmes fondée par Gisèle Halimi. C’est le message que le Gouvernement porte auprès des instances européennes : la France a ratifié la Convention d’Istanbul, premier texte international contraignant contre les violences faites aux femmes. Nous avons directement saisi, avec Laurent Fabius, Marisol Touraine et Harlem Désir, la commissaire européenne chargée de l’égalité des genres pour que cette convention soit largement ratifiée en Europe.
En termes de parité, la France soutient la proposition de directive pour un meilleur équilibre femmes-hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées en bourse. Cette mesure fait ses preuves en France : nous enregistrons une progression des femmes plus importante et plus rapide que la moyenne de l’Union européenne.
Enfin, concernant les droits sexuels, la France reste exigeante : nous avons lancé il y a quelques semaines, avec Marisol Touraine, un plan pour améliorer l’accès à l’IVG. Nous devons aussi être solidaires face aux réactionnaires en soutenant les avancées féministes pour toutes les femmes, partout dans le monde. C’est pourquoi, le 9 mars prochain, comme je l’ai déjà fait en septembre dernier, j’irai porter la voix de la France à l’ONU pour défendre la nécessité de promouvoir les libertés de toutes les femmes.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.
La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Marc Le Fur.

L’ordre du jour appelle le dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes.
Mes chers collègues, je souhaite en votre nom à tous la bienvenue au Premier président de la Cour des comptes.
Monsieur le Premier président, le dépôt de votre rapport est un moment fort dans cette assemblée, où le contrôle et l’évaluation des politiques publiques occupent une place essentielle et constituent, notamment depuis 2008, une mission constitutionnelle du Parlement.
La Cour des comptes assiste le Parlement. Cette exigence, qui emprunte des modalités diversifiées, est devenue une réalité quotidienne. Au moment où notre pays est engagé dans un effort sans précédent de réduction de ses déficits, la bonne utilisation des fonds publics est un impératif catégorique. Vos travaux y contribuent et sont, pour l’Assemblée nationale, une source de réflexion.
La commission des finances, que vous avez présidée, la commission des affaires sociales ainsi que le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques s’appuient sur l’expertise de votre institution. La Cour des comptes est ainsi associée au tiers des évaluations auxquelles procèdent le CEC et sur un an, ce ne sont pas moins de huit enquêtes qui ont été demandées par la commission des finances sur la gestion des services ou organismes sous le contrôle de la Cour.
À cette utile collaboration s’ajoute, pour la deuxième année consécutive, la certification des comptes de notre assemblée. Cette contribution de la Cour répond à l’objectif de transparence et d’exemplarité que notre institution a choisi de s’imposer, de sa propre initiative.
Le dépôt de votre rapport constitue donc pour nous un rendez-vous important. Je sais qu’il trouvera prochainement son prolongement dans un débat qui lui sera consacré lors de la semaine de contrôle qui suivra la suspension prochaine de nos travaux.
La parole est à M. le Premier président de la Cour des comptes.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les députés, même s’il ne s’agit plus de la seule publication de la Cour, le rapport public annuel reste la plus emblématique de sa mission d’information des citoyens et des décideurs publics que vous êtes. Les thématiques abordées dans plusieurs de ses chapitres traduisent le souci de couvrir des problématiques et des enjeux proches du quotidien de nos concitoyens : la qualité des services effectivement rendus, les performances réelles, mesurées à l’aune des objectifs des politiques publiques et de la dépense effectuée.
Avant d’évoquer les observations et recommandations du rapport public annuel de 2015, je veux revenir rapidement sur la contribution des juridictions financières aux efforts de modernisation des services publics.
Profondément attachées au principe de séparation des pouvoirs, elles sont au service de la République, dans le respect des textes fondamentaux qui régissent leur mission. Elles apportent une contribution indépendante, grâce à une programmation libre de leurs travaux et à la publicité donnée à leurs observations. Elles veulent, de manière constructive, soutenir, dans leurs démarches, celles et ceux qui ont pour objectif d’améliorer l’action publique.
En 2014, la Cour des comptes a rendu publics 63 travaux. Au-delà des six rapports annuels sur les finances publiques, elle a réalisé, en 2014, 17 enquêtes à la demande de l’Assemblée nationale ou du Sénat, et elle a été auditionnée une cinquantaine de fois par vos commissions. Cette mission d’assistance au Parlement, la Cour y est très attachée et s’efforce d’être utile à la représentation nationale. Je vous ai également adressé 25 référés qui ont été communiqués aux membres du Gouvernement et cinq rapports particuliers concernant des entreprises publiques.
Les juridictions financières veillent à exercer leur mission avec un haut niveau d’exigence éthique et professionnelle. Comme vous l’aviez souhaité en votant fin 2011 une disposition expresse en ce sens, j’ai arrêté en décembre dernier le recueil des normes que les équipes de contrôle doivent respecter, conformément aux règles nationales et internationales en vigueur. Ce recueil comporte en annexe notre charte de déontologie. Ces documents sont accessibles sur le site Internet de la Cour et peuvent être consultés par tous, élus, agents publics, citoyens.
Si elles sont plus souvent conduites à souligner les dysfonctionnements, les juridictions financières savent aussi reconnaître les efforts consentis pour améliorer l’action publique. Le rapport met ainsi l’accent sur le suivi des recommandations et développe deux situations en progrès, grâce à des dispositions législatives récemment votées.
La Cour est, à ce titre, revenue sur la gestion des avoirs bancaires et les contrats d’assurance-vie en déshérence, et sur le recours au chômage partiel. Dans les deux cas, le législateur a largement repris à son compte les propositions formulées par la juridiction. La Cour continuera d’assurer un suivi de la mise en oeuvre des dispositifs, qui doivent être complétés au niveau réglementaire.
Ces propos préliminaires achevés, j’en viens aux messages portés cette année par le rapport de la Cour : un décalage est trop souvent observé entre les annonces, les engagements et les résultats réellement obtenus. Il est préjudiciable à la crédibilité des politiques publiques.
Certains services publics doivent être gérés avec un niveau d’exigence plus élevé. Des marges d’économies et d’efficience existent et peuvent être mobilisées pour le redressement de nos comptes publics, mais aussi pour des politiques publiques mieux ciblées, plus adaptées aux besoins et aux attentes de la société.
Nous accumulons les déficits depuis près de quarante ans – depuis 1974 sans discontinuer s’agissant du budget de l’État. Le chômage demeure à des niveaux inquiétants. La part de nos dépenses publiques dans le PIB est parmi les plus élevées, sans que les résultats soient à la hauteur. Dans ce contexte, l’effort devrait être plus résolu en faveur d’une gestion plus rigoureuse des finances et des services publics et davantage tourné vers la recherche d’efficacité.
Or, cette année encore, la Cour observe, à de nombreuses reprises, un décalage entre les engagements pris, les objectifs affichés, les moyens qui leur sont consacrés et les résultats obtenus. C’est le premier message de la Cour.
La confiance dont jouit notre pays dans les instances politiques, économiques et financières, aux niveaux européen et international, est étroitement liée à la crédibilité de sa politique budgétaire. L’actualité récente montre que les débats de politique économique sont nourris quant à l’approche à retenir dans un contexte encore difficile et alors que les dettes publiques de plusieurs États européens, dont le nôtre, continuent de se creuser.
Le rôle de la Cour des comptes n’est bien sûr pas de trancher ces débats. Il n’est pas de se substituer aux pouvoirs publics dans la prise de décision, les choix à retenir ou les engagements à prendre vis-à-vis de nos partenaires. Cela relève de votre responsabilité. En revanche, le rôle de la Cour est bien d’informer sur la situation et les perspectives des finances publiques et sur le respect des engagements pris.
La Cour fonde ainsi son appréciation sur une réalité observable : les lois que vous votez, les hypothèses du Gouvernement, les résultats des lois de finances, ainsi que la statistique publique nationale et européenne. Comme chaque année, dans un chapitre de son rapport public annuel, la Cour livre à nos concitoyens et à vous-mêmes son regard sur la situation des finances publiques.
Deux grandes observations s’en dégagent cette année : le mouvement de réduction des déficits s’est interrompu en 2014 ; la capacité de la France à tenir ses engagements reste incertaine en 2015.
Le chapitre consacré aux finances publiques met en évidence le dérapage des prévisions successives de déficit public pour 2013 et 2014. Le mois dernier, lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour, j’ai salué l’opération-vérité de septembre 2014, par laquelle le Gouvernement a, tardivement selon nous, reconnu la réalité de l’ampleur des déficits.
Les résultats de 2014 devraient s’avérer meilleurs que la prévision de 4,4 % inscrite dans la loi de finances de décembre 2014. Mais quand bien même ils se rapprocheraient de 4,1 %, cela resterait encore bien supérieur aux 3,6 % prévus initialement. En tout état de cause, ces résultats ne marqueraient pas une amélioration par rapport à 2013, au contraire de ce qui se passe dans pratiquement tous les autres pays de l’Union européenne, dont le déficit dépasse 3 %.
Malgré un objectif de réduction du déficit limité par rapport à celui prévu initialement en 2014, la capacité de la France à tenir ses engagements reste incertaine pour 2015. La Cour identifie en effet plusieurs risques, en dépenses comme en recettes, liés notamment aux perspectives de baisse de l’inflation.
Un premier risque pèse sur la réalisation des 21 milliards d’euros d’économies annoncées en avril 2014. Ces économies sont conçues pour leur très grande part, je le rappelle, non comme une diminution de la dépense publique mais comme un effort de ralentissement par rapport à son évolution tendancielle.
Un second risque pèse sur le montant des recettes fiscales attendues pour 2015. Le risque ne se situe pas, comme les autres années, sur la croissance ou les hypothèses d’élasticité des recettes fiscales, mais là encore sur l’inflation prévue. Les lois financières s’appuient sur une hypothèse de 0,9 %, largement supérieure aux dernières prévisions. La Commission européenne envisage ainsi une inflation voisine de 0 % pour la France.
Les pouvoirs publics doivent se pencher sans tarder sur les enjeux que soulève la période actuelle de très faible inflation. Elle remet en cause les perspectives d’équilibre des finances publiques et le cadre budgétaire triennal sur lequel reposent notamment le budget de l’État et l’objectif national des dépenses d’assurance-maladie.
Si les risques identifiés se concrétisent, le retour sous le seuil de 3 % du PIB en 2017 sera probablement compromis. À cet horizon, la dette publique pourrait approcher, voire dépasser 100 % et l’équilibre structurel des comptes publics serait encore repoussé au-delà de 2019. Attention à ne pas se laisser abuser par le très faible niveau des taux d’intérêt auxquels l’État se finance actuellement : la dette supplémentaire que nous continuons d’accumuler va devoir être financée et refinancée pendant de nombreuses années. Et elle ne le sera sans doute pas éternellement aux taux exceptionnellement bas que nous connaissons aujourd’hui. Ces déficits et cette dette supplémentaire pèseront lourdement sur les générations futures et sur les marges de manoeuvre des gouvernements dans l’avenir.
Le rééquilibrage durable de nos finances publiques dépend des choix de politique économique susceptibles de renforcer le potentiel de croissance de l’économie. Il implique aussi de faire des choix clairs pour une organisation plus performante des services publics, une meilleure répartition des compétences et des moyens. L’ensemble de ces choix ne s’imposent pas au nom d’une contrainte, subie ou importée. Ils s’imposent, si j’ose dire, de l’intérieur, si nous voulons préserver notre souveraineté, c’est-à-dire notre capacité à faire des choix. Les politiques de rabot ne peuvent pas tenir lieu de stratégie de redressement des comptes publics ni surtout d’horizon pour les services publics de demain.
Dans son rapport public annuel de 2015, la Cour s’interroge à plusieurs occasions sur la cohérence de l’action de tel ou tel organisme public avec les objectifs visés. Parfois même, elle met en doute la conduite de l’action publique au regard des objectifs qu’elle est censée remplir. Ce sont en effet les résultats atteints par une politique publique qui garantissent sa crédibilité. Nos concitoyens exigent, à juste titre, puisqu’ils y contribuent, que l’action publique débouche sur des résultats tangibles, concrets, dans leur vie de tous les jours. Cela est encore loin d’être le cas au regard des crédits consacrés. De nombreux sujets de ce rapport touchent à la vie quotidienne des habitants, qu’il s’agisse des transports, de l’eau, de l’électricité, de l’emploi, du sport ou de la vie étudiante. Sans les citer tous, j’évoquerai devant vous les exemples les plus saisissants.
Premièrement, les agences de l’eau, organismes qui sont les principaux financeurs de la politique de l’eau en France, collectent des taxes ou redevances dans le respect théorique du principe pollueur-payeur. En réalité, ces redevances sont largement déconnectées de ce principe : ceux qui polluent le plus ne sont pas ceux qui paient le plus.
Deuxièmement, le bilan de l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence est contrasté dans les faits. Plusieurs dispositions du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, dont vous débattez en ce moment, mesdames et messieurs les députés, vont dans le sens des préconisations de la Cour sur ce sujet.
Troisièmement, la gestion des trains Intercités offre un exemple d’atermoiement entre volonté affichée de réforme et indécision persistante et préjudiciable au service public. La Cour appelle les pouvoirs publics à sortir de l’impasse pour offrir à ces lignes un horizon pérenne.
Dans un contexte économique difficile, des signes de défiance sont perceptibles à l’égard du secteur public. C’est pourquoi, dans son deuxième message, la Cour veut insister sur l’impératif de rigueur et d’exigence qui s’impose aux agents et aux services publics.
La Cour a voulu rendre publics des cas et des situations qui appellent davantage de rigueur et de retenue dans l’usage des deniers publics ou dans les comportements, sans préjudice des irrégularités qu’elle pourra constater et qui pourraient être sanctionnées par ailleurs.
Dans son rapport, la Cour évoque d’abord la mise en place d’un dispositif importé du secteur privé, l’attribution gratuite d’actions aux salariés de CDC Entreprises, filiale à 100 % de la Caisse des dépôts et consignations. C’est un cas de dérive, choquant, qui révèle plusieurs dysfonctionnements. Au regard du caractère tout à fait anormal de cette situation, la Cour de discipline budgétaire et financière a été saisie par le Procureur général.
Par ailleurs, la Cour a procédé à un contrôle de suivi du Conseil économique, social et environnemental. Elle s’est à nouveau intéressée à la gestion budgétaire et comptable de l’institution, à sa gestion du personnel et au régime spécial de retraite des anciens conseillers.
L’exigence de rigueur concerne aussi les collectivités territoriales. Après examen de plusieurs contrats de partenariat signés par des collectivités territoriales depuis 2004, la Cour recense les conditions qui devraient à l’avenir être réunies si l’on veut avoir recours à ce mode dérogatoire de gestion des services publics.
La Cour s’est également penchée sur les compléments de rémunération dont bénéficient les fonctionnaires d’État outre-mer. Une réforme de ce système à bout de souffle est souhaitable.
La Cour adresse enfin un troisième et dernier message : des marges importantes d’économies, d’efficacité, d’efficience existent et doivent être davantage mobilisées. Le maillage des services publics doit mieux répondre aux besoins et aux attentes. Ainsi, la révision du réseau et des missions des oeuvres universitaires et scolaires est indispensable, à la fois au regard de l’offre territoriale, des choix d’investissement, de la simplicité et de l’efficacité du ciblage de son action.
Un service public de qualité passe aussi, parfois, par une refonte des cartes administratives. La gestion des services d’eau et d’assainissement l’illustre parfaitement. La France compte 31 000 services d’eau et d’assainissement, dont 22 000 sont gérés en régie. Symboles d’une gestion communale de proximité, près de 92 % des régies concernent un territoire de moins de 3 500 habitants. Dans ce cas comme dans d’autres, proximité ne rime pas nécessairement avec efficacité de l’action publique. En l’espèce, trop de proximité tue l’efficacité.
La conduite d’une réforme territoriale d’ampleur n’est pas une tâche impossible. L’État en a d’ailleurs fait la preuve en procédant à la refonte de la carte judiciaire.
En ce qui concerne en revanche le réseau des sous-préfectures, le ministère de l’intérieur se positionne entre le statu quo et l’expérimentation. Or les services publics de demain doivent être orientés vers les besoins de demain, qui ne coïncident pas forcément avec le maillage administratif du XXe, voire du XIXe siècle. Une refonte expérimentale de la carte des arrondissements d’Alsace et de Moselle vient d’entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Le ministre de l’intérieur a annoncé la poursuite de l’expérimentation dans cinq régions. La Cour y sera attentive.
Les recommandations de la Cour portant sur le maillage territorial des services publics ont aussi pour objectif une réduction des inégalités d’accès lorsque la répartition des moyens et des infrastructures n’est pas assez liée aux besoins. Le chapitre du rapport sur la prise en charge des soins palliatifs, toujours très incomplète et caractérisée par de très fortes inégalités territoriales, en offre une illustration.
Dans des travaux récents portant notamment sur les finances locales ou sur la grande vitesse ferroviaire, la Cour a eu l’occasion d’appeler les pouvoirs publics à adopter une attitude plus réaliste et plus rationnelle, y compris en ce qui concerne les investissements publics. Le rapport public annuel de 2015 met ainsi en évidence de nouvelles situations où les décisions d’investissement ne sont pas satisfaisantes du point de vue de la gestion publique. Tous ces exemples rappellent qu’un investissement n’est pas vertueux par principe. Il est vertueux s’il est produit avec le souci de l’efficacité et de l’efficience, s’il répond à des besoins, s’il améliore réellement le service rendu et si les dépenses de fonctionnement qu’il entraîne ont été correctement anticipées.
La refonte du circuit de paie des agents de l’État offre un contre-exemple calamiteux d’investissement. Entre 2008 et 2013, 346 millions d’euros ont été dépensés au titre de ce programme, pratiquement en pure perte. Cet échec n’est pas rassurant, au regard des enjeux soulevés par la modernisation des processus de paie. La Cour s’inquiète des difficultés récurrentes que rencontrent les grands projets informatiques menés par l’État.
Ce qui est vrai pour l’action de l’État l’est également pour l’action locale. Je cite fréquemment le cas des deux gares construites à quelques dizaines de kilomètres d’écart sur la ligne à grande vitesse Est – TGV Lorraine et Meuse TGV –, sans interconnexion avec le réseau de transport régional. Le cas des aéroports de Dole et de Dijon, distants de moins de cinquante kilomètres, à peine, est à bien des égards comparable. Leur bilan financier est choquant, ce qui amène la Cour à recommander la fin du soutien public aux deux équipements.
Sans pour autant être placées au même niveau que les investissements que je viens de mentionner, d’autres situations appellent la vigilance des pouvoirs publics. Ainsi, alors que les contraintes budgétaires s’accentuent chaque année davantage, les offres proposées en matière de transport public urbain de voyageurs continuent de s’étoffer, sans coordination ni mutualisation des efforts.
S’agissant des stations de ski des Pyrénées, il est souhaitable que les collectivités territoriales acceptent de les restructurer, de repenser leur modèle économique, notamment en moyenne montagne. Le contribuable ne peut subventionner éternellement des stations de ski présentant des difficultés structurelles.
En conclusion, comme elle l’a toujours fait, la Cour appelle les pouvoirs publics à s’engager résolument en faveur du redressement des comptes publics et d’une action publique plus exigeante, plus rigoureuse, plus efficace, plus efficiente. Cela est possible et, selon nous, nécessaire. Nous essayons de le démontrer. Des marges de manoeuvre existent. Des réformes sont attendues par nos concitoyens qui savent pertinemment que la qualité des services publics ne se confond pas avec l’augmentation de la dépense publique.
Je veux rappeler en ce lieu l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi… » Le consentement à l’impôt est le fondement de notre démocratie. C’est à vous, mesdames et messieurs les députés, qu’il appartient de convaincre nos concitoyens de la nécessité de consentir à l’impôt. Pour cela, il n’est pas de meilleure méthode que d’arrêter des priorités, de prendre les décisions qui en découlent, de veiller à leur mise en oeuvre effective alors que, trop souvent, une fois la loi votée ou la décision prise, le regard se détourne de l’évaluation effective du résultat.
Chacun, dans le rôle qui est le sien, peut contribuer aux réformes qui s’imposent. Par son rapport public annuel, et plus généralement par ses travaux, la Cour s’efforce pour sa part de contribuer, à sa place, sans se substituer aux décideurs publics que vous êtes, mesdames et messieurs les députés, à ce qu’une attention plus grande soit portée au résultat. Veiller à l’article 14 de notre Déclaration de 1789, c’est accorder plus d’importance à la performance réelle de l’action publique.
Applaudissements.

La parole est à M. le président de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, madame la rapporteure générale de la commission des finances, mes chers collègues, la loi organique relative aux lois de finances – LOLF –, que vous connaissez si bien, monsieur le Premier président, a profondément modernisé nos finances publiques en engageant le Parlement, en particulier notre Assemblée, dans l’évaluation des politiques publiques.
La réforme constitutionnelle de 2008 a consacré le rôle d’évaluation du Parlement. Elle a confié à la Cour des comptes une mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement dans cette fonction. Aussi, la remise du rapport public annuel de la Cour des comptes constitue-t-elle un moment important dans le déroulement de nos travaux budgétaires.
En outre, elle est l’occasion pour moi de saluer une nouvelle fois la qualité du travail des magistrats de la Cour et l’apport capital de leur travail d’évaluation et de contrôle de la dépense publique, tout au long de l’année. Vous me permettrez donc, monsieur le Premier président, de rappeler les principaux travaux qui ont marqué l’année 2014.
En effet, la coopération entre la Cour et le Parlement, en particulier notre Assemblée, se concrétise dans les relations que les commissions, notamment celles des finances ou des affaires sociales, ainsi que le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, entretiennent toute l’année avec les magistrats de la Cour.
L’an passé, la commission des finances a reçu à six reprises le Premier président et les présidents de chambre. Comme de coutume, la présentation des rapports de la Cour sur la certification ainsi que sur la situation et les perspectives des finances publiques a donné lieu, en son sein, à des débats particulièrement riches.
Cette année, la Cour a adressé 21 référés au Parlement, ainsi que 25 rapports particuliers, que je transmets systématiquement aux différents rapporteurs spéciaux concernés. Comme de coutume, les recommandations présentées par la Cour, complétées par les réponses du Gouvernement, se sont révélées précieuses pour les rapporteurs spéciaux, du fait de leur caractère opérationnel, fondé sur une analyse précise et critique des sujets abordés.
Ainsi, le référé sur les prévisions de recettes fiscales de l’État a donné lieu à un approfondissement : la commission des finances a en effet reçu, au cours d’une séance très intéressante, les différentes directions du ministère des finances compétentes en matière de prévision de recettes.
Comme chaque année, elle a souhaité que la Cour réalise des enquêtes et soit associée aux travaux de notre mission d’évaluation et de contrôle. Ainsi, l’an passé, la Cour a participé aux deux missions d’évaluation et de contrôle, ainsi qu’à de très nombreuses réunions.
En outre, au titre du désormais célèbre 2° de l’article 58 de la LOLF, la Cour a remis cinq enquêtes demandées par nos rapporteurs spéciaux – sur le Défenseur des droits, sur les frais de justice, sur le recours par Pôle emploi aux opérateurs privés, sur les aides de l’État aux territoires concernés par les restructurations militaires et sur les organismes de gestion agréés.
Ces enquêtes donnent lieu non seulement à des échanges fructueux entre les membres de la commission, mais aussi, chaque fois que nous le pouvons, à des modifications législatives. Ainsi, dans le dernier collectif budgétaire, une série d’amendements a été adoptée à mon initiative, visant à mettre en oeuvre certaines des recommandations formulées dans l’enquête sur les organismes de gestion agréés.
Je n’oublie pas non plus la contribution de la Cour aux missions du Haut conseil des finances publiques, dont les avis sur les projets de programme de stabilité, de loi de programmation, de loi de finances, de loi de financement ou les appréciations sur le si difficile concept de solde structurel, se sont immédiatement imposés comme des références importantes, préalablement à nos travaux parlementaires, notamment budgétaires.
Enfin, je mentionnerai les travaux du Conseil des prélèvements obligatoires, qui a répondu en 2014 à notre demande sur la fiscalité locale, celle des entreprises, et qui vient de remettre un nouveau rapport relatif aux réformes de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée – CSG.
En 2015, notre programme est également très fourni. Nous avons adressé à la Cour trois nouvelles demandes d’enquête, relatives au coût du transfert à Metz d’une partie des services de l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’évolution du montant des contributions internationales versées par la France et à la rationalisation de l’organisation territoriale en ce qui concerne les nombreux groupements sans fiscalité propre, qu’il s’agisse des syndicats intercommunaux à vocation unique – SIVU –, des syndicats intercommunaux à vocation multiple – SIVOM –, des syndicats mixtes, très nombreux dans notre paysage institutionnel local.
Enfin, deux enquêtes ont été précédemment demandées dont les résultats seront bientôt connus s’agissant, d’une part, du bilan des conventions et des crédits de revitalisation des territoires, d’autre part, des dispositifs et crédits mobilisés pour les jeunes sortis sans qualification du système scolaire.
Quant à la mission d’évaluation et de contrôle, elle travaillera – avec la participation de magistrats de la Cour – sur les missions et les financements des chambres consulaires ainsi que sur les financements et la maîtrise de la dépense des organismes extérieurs de langue française.
Vous constatez, chers collègues, combien les travaux entre notre Assemblée et la Cour sont nourris, divers, et donnent lieu – j’insiste sur ce point – à des résultats opérationnels. Je souhaite donc que perdure cette association à la fois très constructive et très diversifiée entre la Cour des comptes et notre Assemblée.
Pour terminer, puisque vous avez évoqué ce sujet, monsieur le Premier président, je souhaite faire quelques observations rapides sur l’exécution des comptes de l’État en 2014 et sur les prévisions de 2015.
Nous avons reçu ce matin en commission des finances M. le secrétaire d’État au budget.
Quelques questions se posent, tout d’abord, comme vous l’avez vous-même souligné voilà un instant, s’agissant de la dégradation en exécution du déficit budgétaire de 2014 par rapport à 2013.
J’insiste sur ce point : il n’est pas question de prévisions mais d’exécution – nous passons en effet énormément de temps à discuter de prévisions, d’ailleurs, très souvent contredites par la réalité.
En l’occurrence, il s’agit donc de la réalité : en 2014, le déficit budgétaire de l’État s’est aggravé par rapport à 2013, à la différence de la quasi-totalité des autres pays européens, ce qui constitue donc une singularité française.
Cela risque d’être confirmé lorsque nous disposerons de la consolidation des comptes publics puisqu’à ce jour nous ne savons pas ce qu’il en est, pour 2014, de l’exécution des comptes des collectivités locales et de celle des comptes sociaux.
Comme le secrétaire d’État l’a confirmé ce matin, le déficit public serait de 4,4 points, peut-être de 4,3 points de PIB mais, là encore, il doit être comparé à l’exécution de 2013 qui était seulement – si je puis dire, puisque cela représente tout de même plus de 80 milliards – de 4,1 points.
Il est donc extrêmement préoccupant de voir que, d’exécution en exécution, la situation s’est dégradée.
Encore plus préoccupant : les raisons d’une telle dégradation.
La principale d’entre elles est la très inquiétante érosion de nos recettes fiscales.

Le secrétaire d’État a eu raison, ce matin, d’insister sur le fait que globalement, en exécution, la dépense d’État – je ne parle que d’elle – a été à peu près tenue.

Même si entre 2014 et 2013, la dépense d’État, qui s’est élevée grosso modo à 370 milliards, n’a augmenté d’exécution en exécution que d’un milliard en valeur courante – c’est un bon résultat –, il faut aussitôt ajouter que, par rapport à 2013, nous avons enregistré l’année dernière une économie de plusieurs milliards par rapport aux prévisions et, d’exécution en exécution, une économie de plusieurs centaines de millions sur les intérêts de la dette.

Le paradoxe est en outre extraordinaire – mais chacun sait que cela ne pourra pas durer : plus nous nous endettons, moins cela nous coûte. Notre endettement a augmenté de plus de quatre points de PIB – plus de 80 milliards – en stock, en volume et, dans le même temps, les intérêts de la dette ont diminué. Je le répète : cela ne peut pas durer.
En outre – c’est un élément exogène – nous avons assisté en 2014 à une baisse des prélèvements sur recettes, notamment au profit de l’Union européenne, à quoi s’ajoute l’effort – tout à fait justifié au demeurant – qui a été demandé aux collectivités locales ainsi que la baisse sensible de l’inflation.
Ce sont là autant d’éléments très favorables mais, malgré tout, la dépense publique d’État a augmenté d’un milliard. Même si la situation s’est grandement améliorée, je ne le conteste pas, cela ne suffit pas.
Vous avez donc raison, monsieur le Premier président, de souligner à quel point il est impératif de dépenser moins en dépensant mieux. Le rapport annuel de la Cour des comptes est très précieux parce qu’il comporte de multiples exemples montrant que c’est possible.
Un dernier mot, pour terminer, sur ce problème très préoccupant de l’érosion des recettes.
Ne sommes-nous pas confrontés à un problème structurel de modification des comportements, liée peut-être à un niveau de fiscalité excessif ?
Deux éléments m’interpellent sur lesquels je souhaiterais que la Cour des comptes se penche particulièrement.
S’agissant, tout d’abord, de l’impôt sur le revenu, question qui a été pointée par la rapporteure générale dans ses excellents rapports : il faut que nous regardions de plus près ce qui se passe, notamment, dans les tranches de revenus les plus élevés. Il ne faut pas oublier, en effet, que 10 % des foyers fiscaux acquittent 70 % de l’impôt sur le revenu et que 1 % en paie 10 %.
L’hyper-concentration étant massive, il suffit qu’il se passe des choses sur ces tranches-là…

… pour que nous nous retrouvions avec des milliards en moins.
S’agissant, ensuite, de l’impôt sur les sociétés, le phénomène est le même. Sans exagérer, j’en viens à me demander si notre impôt sur les sociétés n’est pas en train de disparaître.
Il rapportait environ 50 milliards et il n’est plus aujourd’hui, à peu près, que de 35 milliards, ce qui représente tout de même une diminution de 15 milliards !
Certes, il faut tenir compte du CICE mais même en réintégrant les 6 milliards effectivement payés en 2014, cette érosion demeure inexplicable.
Pourquoi, et ce sera ma conclusion, insisté-je sur ce point ?
Si le phénomène d’érosion des recettes est bien effectif, nos prévisions pour 2015 – comme la Cour des comptes semble d’ailleurs le dire – sont à prendre avec d’infinies précautions.
Nous nous montrons en effet assez optimistes quant à l’évolution de la recette fiscale – je ne parle pas du taux de croissance, dont nous espérons tous qu’il atteindra 1 % : il s’agit bien de la prévision de recettes fiscales associée à ce taux de croissance.
Le Haut conseil des finances publiques, notamment, doit examiner la situation.
Dans son intervention, M. le Premier président a dit une chose très importante en reconnaissant l’effort du Gouvernement qui, à l’automne, a lancé une opération-vérité, tout en considérant qu’elle aurait pu être menée un peu plus tôt. C’est aussi mon cas : je considère qu’elle aurait pu avoir lieu dès les mois de juin ou de juillet, plutôt qu’au mois d’octobre.
Si nous assistons au même phénomène en 2015, il faudra absolument prendre des mesures en matière de dépenses dès le milieu de l’année.
Dans le cas contraire, que se passera-t-il ? Nous perdrons crédibilité et souveraineté budgétaires.
J’espère que tout se passera bien avec Bruxelles où nous irons tout de même plaider notre cause dans les prochaines semaines en étant le seul pays dont le déficit, en 2014, s’est dégradé par rapport à 2013.
Si la situation est la même en 2015, il est évident que cela pourrait entraîner de graves difficultés.
Il ne faut pas se laisser endormir par le fait que les taux d’intérêt sont de 0,3 % ou 0,5 % pour des emprunts à dix ans. Je le dis en effet avec gravité à cette tribune : ce niveau des taux ne durera pas.
Il ne faut absolument pas que la France rencontre des difficultés quant à son besoin de financement – le premier en Europe puisque nous devrons trouver 220 milliards en 2015. J’espère que nous les trouverons dans les meilleures conditions.
Je vous remercie.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

La parole est à Mme Valérie Rabault, rapporteure générale de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, je salue le dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes, monsieur le Premier président, qui comme chaque année propose une présentation de la situation générale de nos finances publiques ainsi qu’une analyse extrêmement détaillée et précise de certaines politiques publiques.
Avec ce rapport, d’une très grande richesse, d’une très grande qualité et qui contient de nombreuses informations – je salue une nouvelle fois le travail accompli –, la Cour remplit ainsi sa mission constitutionnelle d’assistance du Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement, notamment, au titre de l’exécution des lois de finances et de l’évaluation des politiques publiques.
Je souhaiterais aborder quelques aspects du rapport et, dans un premier temps, revenir sur le pilotage des finances publiques.
En étant synthétique, je dirais que le rapport présente deux volets.
Tout d’abord, la présentation d’ensemble des finances publiques – la principale préoccupation concernant la fiabilité des prévisions, ce qui est assez récurrent dans les écrits de la Cour des comptes même si, cette année, vous pointez d’une manière un tout petit peu plus appuyée les risques relatifs à l’inflation, en particulier pour 2015.
De surcroît, vous estimez que ces derniers n’ont pas été suffisamment anticipés ou, peut-être, pris en compte, au regard de l’exécution du budget pour 2014.
Ensuite, les thèmes et les constats concernant la politique publique, qui sont peut-être un peu plus positifs ou un peu moins négatifs même si vous pointez naturellement de nécessaires améliorations en termes de pilotage.
Lorsque l’on veut mener une politique budgétaire, monsieur le Premier président, il faut en effet tenir compte de deux aspects : l’appréciation de l’environnement économique, qui se traduit par des prévisions d’inflation et de croissance, ainsi que la mise en oeuvre des pilotages de l’ensemble des politiques publiques avec, d’un côté, les dépenses publiques et, de l’autre, la définition des niveaux d’imposition.
Si, vous l’avez dit, ce second point fait l’objet d’un relatif satisfecit, je souhaite revenir sur le premier, les développements de la Cour des comptes à ce propos étant assez importants.
Il est nécessaire d’évaluer la position de notre Assemblée et de notre Parlement car nous sommes parfois entre deux chaises…
En effet, lorsque nous prenons des décisions économiques, nous devons qualifier le moment économique, le moment dans lequel nous nous trouvons, ce qui implique d’apprécier la croissance potentielle.
Nous en avons longuement débattu, vous le savez et, aujourd’hui, notre Parlement doit utiliser soit la prévision de croissance potentielle de la Commission européenne – qui a été reprise par le Gouvernement –, soit les calculs d’organismes indépendants comme, par exemple, l’OFCE.
Notre commission des finances a interrogé à plusieurs reprises le Haut conseil des finances publiques sur le niveau de croissance potentielle. Le rapport présente à ce propos un assez long développement et précise que le Gouvernement l’a révisé, ce qui vous interdit de réaliser des comparaisons historiques puisque les niveaux ont changé. Sur ce point, monsieur le Premier président, je partage vos constats.
Néanmoins, il me semblerait indispensable qu’en la matière notre Assemblée et notre Parlement puissent disposer d’une véritable analyse.
Qu’est-ce que la croissance potentielle, sinon la capacité d’évaluer l’ensemble des potentialités de notre pays, utilisées ou non ? Quelle est donc notre capacité économique, qu’elle soit ou non mobilisée ?
Alors que les finances publiques sont contraintes, nous devons faire des choix millimétrés, voire chirurgicaux. Il est indispensable que notre Assemblée puisse disposer de bons indicateurs, notamment, s’agissant de la croissance potentielle.
Votre rapport comportant donc plusieurs parties, je souhaite comme M. le président de la commission des finances, revenir sur l’exécution 2014.
Je rappelle que l’objectif de déficit n’a pas été tenu, ce qui est selon vous vraisemblablement imputable à deux phénomènes : la non-réalisation de la croissance et de l’inflation prévues.
Parallèlement, vous saluez les efforts importants que le Gouvernement et sa majorité ont engagés, notamment, en termes de maîtrise de la dépense publique, ce qui a permis de compenser dans une moindre mesure ces deux effets – croissance et inflations moindres en 2014.
En 2015, monsieur le Premier président, vous nous interpellez sur deux points.
Tout d’abord, l’objectif de déficit à moins de 4,1 % du PIB, qui reste fragile, puisqu’il repose en premier lieu, vous l’avez dit, sur la correction des 3,6 milliards intervenue au mois de décembre dernier, laquelle est essentiellement composée d’efforts supplémentaires en matière de recettes fiscales, notamment, à travers la lutte contre la fraude fiscale.
Nous serons bien entendu très attentifs à ce point-là afin que l’objectif de 3,6 milliards soit atteint.
Ensuite, vous pointez le caractère « peu étayé des 21 milliards d’euros de dépenses en moins pour 2015 ».
Je tiens à rappeler que le Gouvernement a réalisé un effort sans précédent et qu’il relèvera bien entendu de notre responsabilité de députés de faire en sorte que chacun, dans la mesure de ses capacités, participe au sérieux budgétaire en travaillant pour que la réduction des dépenses soit effective en 2015.
Vous abordez, enfin, les années 2016 et 2017, en rappelant que le Gouvernement et la majorité se sont fixé un objectif de retour sous le seuil des 3 % de déficit nominal dès 2017, et de retour à l’équilibre budgétaire en 2019. Comme je l’ai déjà dit à l’automne dernier, lors de l’examen des textes financiers, le rétablissement de nos finances publiques ne pourra se faire que si la croissance économique est de retour. Et ce retour passera par un soutien à l’activité économique, auxquels plusieurs dispositifs contribuent déjà.
Au-delà de la présentation de la situation des finances publiques, la Cour des comptes attire notre attention, comme chaque année, sur la conduite de certaines politiques publiques, comme les agences de l’eau, les partenariats public-privé des collectivités locales, l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence, les trains Intercités et le transport public de voyageurs, ainsi que les stations de ski des Pyrénées, auxquelles je suis très sensible.
Je tiens à souligner l’intérêt que présentent ces développements pour le travail parlementaire et j’en donnerai quelques exemples.
Nous avons, à l’automne dernier, adopté une mesure qui vise à effectuer un prélèvement de 175 millions d’euros, au titre des années 2015, 2016 et 2017, sur le fonds de roulement des agences de l’eau. La Cour des comptes constate, sur la base des contrôles qu’elle a menés sur les six agences de l’eau entre 2007 et 2013, que « les importants moyens dont elles disposent pourraient être employés de manière plus efficace au regard des objectifs de la politique de l’eau ». Surtout, la Cour pointe une vraie hétérogénéité dans l’attribution des aides. Ce fait nous interpelle en tant que députés et notre commission des finances y sera très sensible.
La Cour présente par ailleurs une analyse critique – vous l’avez dit, monsieur le Premier président – du plan d’attribution gratuite d’actions mis en place à la fin de l’année 2007 au profit des salariés de CDC Entreprises, filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Le jugement que vous formulez sur cette distribution étant très sévère, nous l’analyserons dans le détail.
S’agissant des trains Intercités, la Cour pointe le vieillissement du matériel et le manque de stratégie. Ce constat, que vous étayez dans votre rapport, rejoint celui que nous avions fait avec une quinzaine de députés concernés, lors d’un colloque qui s’est tenu en mars 2013 et qui portait sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Il est urgent – nous l’avions constaté et vous étayez encore ce constat – que des décisions concertées soient prises et que des investissements adéquats soient faits, conformément à la décision qui sera arrêtée par le Gouvernement.
Un chapitre très important de votre rapport est consacré aux partenariats public-privé qui ont été noués par les collectivités territoriales. La Cour conclut, au terme de ses analyses, que « sur le long terme, l’équilibre économique du contrat est souvent défavorable aux collectivités locales », et que les risques sont insuffisamment pris en compte. Vous évoquez notamment le cas de Montauban, qui m’est cher, et que nous examinerons évidemment dans le détail.
Pour conclure, je veux souligner que la diversité des sujets abordés dans ce rapport annuel témoigne de la richesse et de la qualité des travaux de la Cour des comptes. Vos analyses sont toujours étayées d’une manière rigoureuse et précise. Il est donc de notre responsabilité de députés et de parlementaires de nous en inspirer – sous réserve, évidemment, des réponses apportées par le Gouvernement – à la fois pour faire des propositions politiques et pour exercer notre mission de contrôle.
Pour tout cela, je vous remercie à nouveau, monsieur le Premier président de la Cour des comptes. Nous vous retrouverons prochainement, pour l’examen définitif de l’exercice 2014 et des perspectives financières.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Monsieur le Premier président, l’Assemblée nationale vous donne acte du dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes et vous remercie.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures dix.

L’ordre du jour appelle les questions sur l’amélioration des relations de travail entre le Gouvernement et le Parlement.
Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à deux minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse, sans droit de suite.
Nous commençons par le groupe RRDP.
La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg.

Le recours très fréquent à la procédure accélérée d’examen des textes de loi pose un problème. Certes, l’on peut comprendre que le Gouvernement veuille faire aboutir rapidement certaines réformes, mais cela ne peut se faire au détriment des droits du Parlement et du bon exercice de la fonction législative, car cette procédure d’urgence présente deux inconvénients.
D’une part, tandis que la procédure normale donne lieu, comme chacun sait, à deux lectures dans chaque assemblée, favorisant ainsi la qualité du travail législatif, la procédure accélérée limite cet examen à une seule lecture, ce qui est peu opportun quand il s’agit d’une législation complexe requérant une analyse minutieuse. D’autre part, au stade initial, cette procédure d’urgence prive les commissions parlementaires du temps nécessaire à l’examen approfondi des textes de loi. En effet, si elle est engagée, le délai de six semaines entre le dépôt du texte et sa discussion en séance ne s’applique pas.
Cette méthode expéditive, qui restreint le temps de délibération du Parlement, produit ce que l’on pourrait appeler une LGV, ou législation à grande vitesse, de qualité parfois moyenne. Pourtant, dès le début de cette législature, le recours à la procédure accélérée est devenu très fréquent, voire systématique.
Le président de notre Assemblée soulignait déjà, le 6 décembre 2012, qu’il fallait abandonner cette mauvaise manière de procéder, au risque de voir la mauvaise humeur s’installer. Malgré cela, le recours à la procédure accélérée n’a cessé de se développer : le Gouvernement y a recouru cent quinze fois entre 2012 et 2014 !
En mai 2014, monsieur le secrétaire d’État, vous avez déclaré que, vu la volonté du Gouvernement de donner un rythme plus soutenu à sa politique, il y aurait vraisemblablement un recours un peu plus fréquent à la procédure accélérée. Alors, où va-t-on ? En 2015, le Gouvernement va-t-il enfin renoncer à un usage excessif de la procédure accélérée, qui tend à restreindre les droits du Parlement et à affecter la qualité des lois ?

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur le président Schwartzenberg, avant la révision constitutionnelle de juillet 2008, la procédure d’urgence n’avait qu’un seul objectif : permettre la réunion de la commission mixte paritaire après une seule lecture dans chaque assemblée. La révision de 2008, en mettant en place un délai minimal entre le dépôt d’un texte, sa transmission et son examen en séance publique a donné un nouvel objectif à la procédure accélérée : donner au Gouvernement la possibilité de déroger à ces délais minimaux.
C’est cette situation juridique nouvelle qui explique que la procédure accélérée soit plus souvent déclenchée que l’urgence ne l’était avant 2008.
Pour autant, nous ne nous en tenons pas à cette explication et nous tentons de limiter les effets négatifs de la procédure accélérée de deux manières.
Tout d’abord, nous tentons de maintenir les délais proches de ceux qui sont fixés par la Constitution en procédure normale. Pour ne prendre qu’un exemple, le projet de loi relatif à la transition énergétique a été examiné en séance publique deux mois après son dépôt, soit un délai supérieur au délai minimal de six semaines hors procédure accélérée. De plus, lorsque cela est possible, nous préservons les deux lectures dans chaque assemblée avant la convocation de la commission mixte paritaire. Nous l’avons notamment fait pour le projet de loi portant délimitation des régions.
Je vous rappelle également que notre Constitution prévoit depuis 2008 que les deux conférences des présidents peuvent s’opposer conjointement au déclenchement de la procédure accélérée. Il s’agit d’une garantie importante pour le Parlement qui, par cette procédure, estime que le texte visé ne présente aucun caractère d’urgence ou qu’il est trop complexe pour être examiné dans des délais resserrés. Il me semble d’ailleurs que cette possibilité a déjà été utilisée.
J’en viens plus précisément à votre question. Lors de la dernière réforme du règlement de l’Assemblée, vous avez adopté un amendement prévoyant que même en procédure accélérée, le texte de la commission devait être diffusé au moins sept jours avant la séance publique. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition en rappelant qu’aucun délai minimal ne pouvait être imposé en cas d’engagement de la procédure accélérée. À l’inverse, le Conseil a validé la nouvelle règle selon laquelle l’Assemblée nationale doit être informée de l’engagement de la procédure accélérée, en principe lors du dépôt du projet de loi. Cette rédaction, inspirée du règlement du Sénat, est parfaitement conforme à la Constitution. Il va de soi que le Gouvernement fera tout son possible pour respecter cette règle, même si comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, elle n’a aucune valeur impérative.

La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg, pour poser la deuxième question du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Le 5 février, lors de sa dernière conférence de presse, le Président de la République a prôné la rapidité de l’action publique et a engagé le Parlement à voter les lois beaucoup plus vite.
C’est un peu inverser les responsabilités car, en réalité, la lenteur de l’élaboration des lois, qui sont généralement des projets de loi, tient souvent aux méthodes dysfonctionnelles utilisées par l’exécutif. Certains projets de loi sont d’une longueur très excessive, comme le projet de loi Macron dont les cent six articles initiaux sont devenus deux cents au fil du temps.
Ce texte bric-à-brac, ou vide-greniers, aborde de multiples sujets hétéroclites et sans lien véritable : autocars, commissaires-priseurs, permis de conduire, notariat, travail dominical, péage autoroutier, tout y passe ou presque ! De plus, ce texte entre dans les moindres détails et comporte beaucoup de dispositions qui sont en réalité d’ordre réglementaire et non législatif. Plusieurs autres projets de lois présentent ces mêmes défauts qui ralentissent évidemment leur examen par le Parlement, comme la loi ALUR ou la loi sur la transition énergétique. Ce sont eux aussi des textes fleuves, prolixes, diffus.
De plus, ces textes étant souvent insuffisamment préparés en amont, le Gouvernement doit fréquemment introduire pendant le débat parlementaire des amendements modifiant ses propres projets de loi. Ainsi, entre juin 2012 et septembre 2014, le Gouvernement a fait adopter 1 767 amendements.
Bref, s’il souhaite comme il le prétend que le Parlement légifère plus vite, l’exécutif est-il prêt à renoncer à certains projets de loi monumentaux mais un peu creux qui encombrent assez inutilement l’ordre du jour ?
Applaudissements sur les bancs des groupes RRDP et UMP.
Monsieur Schwartzenberg, vous estimez que les projets de loi sont trop longs et trop bavards, et que cette situation dont le Gouvernement serait le seul responsable empêche le Parlement de travailler sereinement et efficacement.
Le secrétaire d’État aux relations avec le Parlement ne peut évidemment que s’associer à votre volonté de raccourcir la loi. Pour vous répondre, je voudrais néanmoins m’appuyer sur les propos tenus par le président Bartolone dans un texte récent. Vous conviendrez – je l’espère – que ce dernier peut difficilement être accusé de ne pas être un défenseur des pouvoirs du Parlement. Dans ce texte, intitulé « Le temps de la loi », Claude Bartolone souligne : « Entre le moment où un projet de loi est annoncé et le moment où la loi entre en vigueur, il faut en moyenne compter près de vingt mois. » Il ajoute à juste titre que : « Le monde imprévisible dans lequel nous vivons exige davantage de réactivité. » Il impute cette situation à la longueur des textes, qui bien qu’ils ne soient pas plus nombreux que par le passé, sont trop bavards, trop confus, et se perdent dans des précisions qui ne relèvent pas du domaine de la loi.
Le président Bartolone rappelle aussi que face à un tel constat, nul ne peut se dédouaner de sa responsabilité : la majorité comme l’opposition, le Parlement comme le Gouvernement. Certes, le Gouvernement a déposé un nombre important d’amendements depuis le début de législature – environ 1 200 pour les sessions 2012-2013 et 2013-2014 – mais cette dynamique ne concerne pas que l’exécutif, elle est généralisée. Je tiens ainsi à rappeler que pour les mêmes sessions, ce ne sont pas moins de 53 600 amendements qui ont été déposés par les députés, ce qui constitue un record.
Les amendements du Gouvernement, bien que nombreux, ne représentent que 2,2 % de ce flux d’amendements. C’est moins que sous la législature précédente : entre 2007 et 2012, les amendements du Gouvernement représentaient 3,4 % du total.
Mais je n’exonère pas le Gouvernement de sa responsabilité. Souvent, les amendements sont déposés après le délai limite, ce qui nuit à la qualité du travail législatif. Des dépôts tardifs peuvent être justifiés lorsqu’ils sont la traduction d’un consensus formé après l’expiration du délai limite ou d’une difficulté technique lourde. Mais ils ne sauraient être systématiques, c’est pourquoi j’ai demandé aux membres du Gouvernement d’éviter autant que possible les dépôts hors délai. Notre responsabilité est partagée dans les difficultés, il nous appartient de faire ensemble le bilan de la révision constitutionnelle de 2008.

Nous en venons aux questions du groupe écologiste. La parole est à Mme Laurence Abeille.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je remercie tout d’abord le groupe RRDP de nous permettre d’aborder ce sujet très pertinent, qui nous rappelle la nécessité de faire évoluer notre système politique.
Ma première question porte sur la préparation des projets de loi. Le Parlement crée très régulièrement des comités d’experts qui réunissent tous les pans de la société civile : scientifiques, ONG, milieu économique, syndicats, et ainsi de suite. Ces comités sont essentiels à l’élaboration de la loi et permettent de ne pas adopter des textes qui pourraient parfois être coupés des acteurs de terrain.
Néanmoins, nous basculons de plus en plus d’une démocratie basée sur des représentants du peuple – qui ne sont pas experts dans tous les domaines – à une démocratie d’experts. En effet, les ONG et autres acteurs de la société civile ont souvent une connaissance approfondie des politiques publiques car ils sont spécialisés dans un domaine particulier.
Ce décalage est renforcé par la procédure d’élaboration des projets de loi et le rôle de ces comités qui sont souvent consultés très en amont, au stade du préprojet de loi. Le parlementaire n’est quasiment jamais associé à cette élaboration, et nous découvrons très souvent les projets de loi quelques semaines avant l’examen en commission.
Surtout, il arrive fréquemment que les ONG ou les experts de la société civile soient mieux informés que les parlementaires sur le calendrier d’élaboration des projets de loi et sur leur contenu, ce qui, convenons-en, met très souvent dans l’embarras le parlementaire. Personnellement, cela me choque et m’agace. Ils sont également mieux informés des enjeux qui auront été discutés dans le cadre de ces comités, et les parlementaires qui formulent des propositions s’entendent alors très souvent dire que le sujet a déjà été discuté et tranché dans tel ou tel comité.
Ma question est donc simple : comptez-vous mieux associer les parlementaires – au moins ceux des commissions compétentes – à la procédure d’élaboration des projets de loi ?
Madame la députée, je voudrais tout d’abord vous apporter certaines précisions. Lorsque nous consultons certains comités d’experts, c’est non seulement parce que leur avis est utile mais aussi et surtout parce que cette consultation est devenue obligatoire car elle résulte le plus souvent de la loi.
Je constate aussi qu’en règle générale, les parlementaires sont associés aux travaux de ces comités. La plupart de ces instances comprennent parmi leurs membres des députés et des sénateurs nommés par leur assemblée. Tel est par exemple le cas du Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales, ou encore du Conseil national de la transition écologique.
Vous avez raison de souligner qu’il appartient aux parlementaires et à eux seuls de voter la loi. Cette compétence leur est confiée à titre exclusif par la Constitution. Les comités consultatifs, comme leur nom l’indique, ont pour mission d’éclairer le travail législatif, d’apporter leur expertise pour améliorer la qualité des projets de loi, mais ils ne sauraient se substituer aux parlementaires qui sont les seuls à disposer d’une compétence décisionnelle en matière législative.
Pour répondre plus précisément à votre question, je m’accorde à vous pour considérer que les députés et les sénateurs devront, à l’avenir, être davantage associés à l’élaboration des projets de loi. Cette association est un gage de qualité et de sérénité du dialogue entre le Parlement et le Gouvernement au moment de l’examen des projets de loi. C’est d’ailleurs pour recueillir l’avis des parlementaires que le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont organisé des débats préparatoires à l’élaboration de certains projets de loi. Je pense notamment au débat qui s’est tenu en juin 2013 sur l’immigration professionnelle et étudiante, et plus récemment encore au débat qui a eu lieu sur le numérique au sein de cette assemblée. À cet égard, soyez assurée que les conclusions de ce débat seront prises en compte pour la rédaction des futurs projets de loi.

Ma seconde question porte sur la préparation des propositions de loi. De très nombreuses propositions de loi sont déposées sur le bureau de l’Assemblée. Très souvent, ce sont des propositions de loi que l’on qualifie d’affichage. Mais avec la possibilité d’inscription de textes lors des journées d’initiative parlementaire, de nombreuses propositions de loi ont vocation à être débattues, et même adoptées.
Le groupe écologiste a ainsi pu expérimenter ce long processus législatif lors de l’examen de la proposition de loi sur les ondes électromagnétiques que j’ai déposée, et dont j’ai été rapporteure. Le parcours n’est pas simple pour une raison principale : le manque de travail et d’échanges avec le Gouvernement. Nous savons tous que sans l’accord du Gouvernement, dans notre système parlementaire rationalisé, il est impossible de faire adopter une loi. Les parlementaires désireux de travailler en amont avec le Gouvernement sur un texte ont les plus grandes difficultés à trouver un interlocuteur, notamment lorsque le texte ne dépend pas d’un seul ministère. Surtout, il est très compliqué de travailler sur le long terme et d’obtenir des arbitrages permettant d’avancer.
De même, un parlementaire n’a évidemment pas le même appui technique que le Gouvernement pour préparer un texte. Ne pourrait-on imaginer un droit de tirage de chaque groupe afin de demander l’avis du Conseil d’État sur l’une de ses propositions de loi ? Aussi, monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement compte-t-il prendre en compte le travail parlementaire et s’associer davantage à l’élaboration des propositions de loi qui ont vocation à être débattues ?
Applaudissements sur les bancs des groupes écologiste et RRDP.
Madame la députée, je comprends votre interrogation. Elle repose sur votre volonté légitime de donner à l’initiative parlementaire toute la place qui lui revient. La révision de juillet 2008 a permis de développer considérablement le poids du Parlement dans l’élaboration des lois. Entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014, une centaine de lois ont été adoptées définitivement par le Parlement, parmi lesquelles vingt-sept sont issues d’une proposition de loi. D’ailleurs, je crois que vous-même avez eu l’occasion d’expérimenter ce bonheur.
Le Parlement est donc aujourd’hui à l’origine d’une loi sur quatre, c’est un progrès considérable par rapport à une période pas si ancienne pendant laquelle le Gouvernement avait en pratique l’exclusivité de l’initiative des lois.
Votre question porte sur deux éléments. Vous souhaitez que le Gouvernement prenne davantage part à l’élaboration des propositions de loi, et vous voulez pouvoir disposer de l’expertise du Conseil d’État.
Sur le premier point, il me semble opportun de rappeler un principe : respecter les parlementaires, c’est leur donner toutes les informations dont ils ont besoin pour mener à bien leurs travaux, mais c’est aussi éviter toute ingérence dans leurs prérogatives. Le Gouvernement ne saurait donc avoir une influence excessive sur la rédaction des propositions de loi. En revanche, une fois que ces propositions sont déposées et inscrites à l’ordre du jour, le dialogue se noue évidemment avec le rapporteur.
Vous m’interrogez également sur la création d’un droit de tirage des groupes auprès du Conseil d’État. Notre Constitution permet déjà aux présidents des assemblées de solliciter l’expertise du Conseil sur des propositions de loi. On pourrait donc imaginer, et il appartient à l’Assemblée nationale d’en décider, que les groupes fassent davantage appel à la présidence pour que leurs textes soient transmis au Conseil d’État. Cependant, le Conseil fait face à une charge de travail considérable et il ne serait sans doute pas opportun de multiplier les saisines sur des propositions de loi qui n’ont peut-être pas toutes vocation à être adoptées définitivement.

Nous en venons aux questions du groupe GDR. La parole est à M. Marc Dolez.

Je voudrais dire en préambule que pour notre groupe, il n’y aura pas de véritable amélioration des relations de travail entre le Gouvernement et le Parlement sans une révision constitutionnelle d’ampleur qui vienne corriger le déséquilibre introduit en 1958 par le parlementarisme dit « rationalisé ».

Ma première question, monsieur le secrétaire d’État, porte sur la banalisation du recours aux ordonnances. Le projet de loi sur la croissance et l’activité, en cours de discussion, ne compte pas moins de dix-sept articles qui autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dans des domaines aussi divers que : le financement des entreprises ; les règles applicables en matière de concentration économique ; le contrôle de l’application du droit du travail ; la création de structures capitalistiques multiprofessionnelles du droit et du chiffre ; la création d’un contrat de bail de longue durée ; la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets ou encore les modalités des enquêtes publiques. Je pourrais aussi mentionner, dans un autre projet de loi, la modification par ordonnance de l’ensemble du droit des obligations – excusez du peu !
Cette banalisation du recours aux ordonnances et la dévalorisation du rôle du Parlement qui en découle confinent au déni de démocratie.
Selon un rapport du Sénat, entre 2004 et 2013, 357 ordonnances ont été publiées sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, soit 2,3 fois plus que le nombre d’ordonnances publiées pendant les vingt années précédentes.
Monsieur le secrétaire d’État, ma question est simple. Le Président de la République a fait savoir, il y a quelques jours, qu’il voulait que le Parlement aille encore plus vite pour voter les lois. Est-ce à dire que le recours aux ordonnances deviendra encore plus fréquent ?
Monsieur le député, je suis conscient de la sensibilité de la question des ordonnances pour les parlementaires, qui peuvent percevoir le recours à l’article 38 de la Constitution comme une forme de dépossession de leurs compétences. C’est pourquoi je tiens à rappeler que la Constitution a prévu des garanties visant à préserver le pouvoir des parlementaires.
En effet, il leur appartient de consentir de manière explicite et non équivoque au recours à l’article 38. Ce consentement est matérialisé par l’adoption d’un article d’habilitation borné dans le temps et devant indiquer avec précision le périmètre de la future ordonnance. Cette exigence de précision est appréciée de manière stricte par le Conseil constitutionnel, qui vérifie que le Parlement n’a pas donné un blanc-seing au Gouvernement et qui n’hésite pas à censurer les habilitations qui lui paraîtraient trop larges, trop floues ou insuffisamment détaillées.
Par ailleurs, depuis 2008, la Constitution ne reconnaît plus que les ratifications expresses. Cette innovation permet de rompre avec une pratique du passé, celle des ratifications implicites.
C’est même mieux que la pratique des décrets-lois, sous la IIIe République.
Avant 2008, dès que le Parlement visait une disposition modifiée par une ordonnance, on considérait qu’il avait approuvé la ratification de cette dernière dans son ensemble, même s’il n’en avait pas contrôlé le contenu. Aujourd’hui, cette pratique n’est plus autorisée.
Enfin, le Parlement reprend la main sur le contenu des ordonnances au moment de l’examen du projet de loi de ratification. Il peut alors en modifier le contenu : il retrouve ainsi la plénitude de ses compétences, notamment son droit d’amendement.

Ma seconde question porte sur l’organisation des travaux et le respect du Parlement. La discussion, ces jours-ci, du projet de loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques illustre de nombreux écueils tenant au non-respect du Parlement par le Gouvernement : engagement de la procédure accélérée, mise en place d’une commission spéciale qui a travaillé sept jours et sept nuits d’affilée, instauration du temps législatif programmé, dépôt hors délai d’amendements gouvernementaux qui pourraient constituer à eux seuls des projets de loi – il en va ainsi, par exemple, de l’amendement permettant une plus grande déréglementation de la profession des marins –, contournement de l’obligation constitutionnelle de produire des études d’impact par le dépôt d’amendements par le Gouvernement ou par la commission, recours massif aux ordonnances – je l’ai évoqué dans ma première question –, doublement du nombre d’articles du texte après l’examen en commission. Sur un texte comprenant plus de 200 articles, un groupe comme le nôtre dispose en moyenne de 53 secondes par article pour s’exprimer. Vous conviendrez que cela pose problème !

Monsieur le secrétaire d’État, ma question est simple. Comme je l’ai déjà dit, le Président de la République a souhaité que le Parlement aille encore plus vite pour voter la loi. Il ne faudrait pas confondre vitesse et précipitation. À la lumière de notre expérience sur le projet de loi dit « Macron », le Gouvernement envisage-t-il de prendre le temps d’examiner nos conditions de travail et de faire des propositions pour une meilleure organisation de nos travaux ?
Monsieur le député, votre question est très centrée sur l’actualité, ce que je comprends parfaitement, puisqu’elle touche notamment à l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Ce texte a un caractère particulier, ne serait-ce que parce qu’il a été examiné par une commission spéciale.
Parmi vos propos et vos critiques, on retrouve certains points évoqués par le président Schwarzenberg, s’agissant notamment du nombre d’articles et de la diversité des sujets traités par le projet de loi. Le ministre de l’économie a déjà eu l’occasion de répondre et de s’expliquer, assez longuement, d’ailleurs, mais avec pédagogie et avec beaucoup de respect à l’égard de tous les parlementaires, en évoquant le fond des sujets. Il est vrai que le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement que je suis a parfois été un peu débordé par le temps que tout cela a pris, d’autant que tout le monde reconnaît que le travail en commission a été très intense, fatigant – je le reconnais –, mais aussi d’une extraordinaire qualité. Tous les parlementaires, de la majorité comme de l’opposition, ont eu le sentiment d’être respectés, entendus, écoutés : ils ont reçu des réponses argumentées, même s’ils n’étaient pas forcément toujours d’accord.
Monsieur Dolez, vous avez aussi formulé une critique, que j’ai entendue en conférence des présidents, concernant les conséquences du temps législatif programmé.
Alors que le nombre d’articles est beaucoup plus important, cette procédure pose évidemment une difficulté aux plus petits groupes, qui ne peuvent s’exprimer autant qu’ils le souhaiteraient sur tous les articles et tous les amendements.
Cette difficulté est réelle, mais elle renvoie davantage à la pratique, à l’organisation interne et au règlement de l’Assemblée nationale qu’à des dispositions législatives.
Sur le fond, le Gouvernement a pris la responsabilité de rassembler en un seul projet de loi de nombreux sujets différents et importants pour l’activité économique de notre pays. Sans ce projet de loi, ces sujets n’auraient pas pu être débloqués, puisqu’ils ne relèvent pas du domaine réglementaire : nous étions donc bien obligés de passer par la voie législative.
Quant à l’organisation des travaux du Parlement, il est tout à fait loisible à l’Assemblée nationale de continuer à y réfléchir.

Nous en venons aux questions du groupe socialiste, républicain et citoyen.
La parole est à M. Pascal Popelin.

Monsieur le secrétaire d’État, les avis formulés par les formations consultatives du Conseil d’État à l’adresse du Gouvernement, dans le cadre du processus de préparation des projets de loi, sont régulièrement au coeur de nos débats. Ce qui est contesté n’est pas leur utilité pour contribuer à la bonne qualité juridique de nos textes, mais le statut singulier de ces avis, frappés par tradition du sceau du secret. Le huis clos des séances au cours desquelles ils sont élaborés est la règle. Quant à la publicité de leur contenu, elle est à ce jour laissée à la discrétion du Gouvernement.
Lors de ses voeux aux corps constitués, le 20 janvier dernier, le chef de l’État a annoncé son intention de mettre un terme à ce que l’on peut considérer comme une anomalie difficilement compatible avec les objectifs et les mesures de transparence et de modernisation de nos institutions qui sont ceux la majorité depuis le début de cette législature.
Je suis de ceux qui se réjouissent de la concrétisation de toutes les mesures qui contribuent à faire progresser notre démocratie. Je veux donc vous poser deux questions.
La première concerne les modalités concrètes de la mise en oeuvre de cette annonce. Comment le Gouvernement entend-il la traduire en actes, et dans quel délai ?
La seconde porte, paradoxalement, sur les évolutions que ce changement pourrait induire. La publicité des avis du Conseil d’État ne pourrait-elle pas conduire cette prestigieuse institution à faire preuve de frilosité, d’excès de prudence, à s’autocensurer ou à réserver la partie la plus critique de ses avis à des échanges plus informels, ce qui atténuerait alors grandement l’intérêt de la mesure ?
Monsieur le député, votre question est très importante : je prendrai donc un tout petit peu de temps pour y répondre.
La question est courte, mais elle est très importante et touche à des sujets complexes ! Vous l’avez dit : lors de ses voeux, le Président de la République a demandé que les avis du Conseil d’État sur les projets de loi soient dorénavant rendus publics.
Comme vous le savez, le Conseil d’État est le conseiller juridique du Gouvernement, notamment dans le cadre de la préparation des projets de loi. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, il peut aussi être saisi d’une proposition de loi par le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Les avis du Conseil d’État sont un outil très précieux d’aide à la décision : pour reprendre les termes du chef de l’État, ils sont « d’intérêt public ». Ils apportent des éclaircissements sur les questions juridiques que peuvent soulever les projets de loi, concernant notamment leur conformité à la Constitution, au droit européen et aux engagements internationaux de la France, sur des points relatifs à la qualité des textes, à leur cohérence interne, à leur clarté et à l’efficacité des réformes. Le Conseil d’État peut ainsi être amené à apprécier l’adéquation entre l’objectif poursuivi et les dispositifs retenus pour y parvenir.
Par conséquent, nous avons tout à gagner à ce que ces avis soient sortis du secret qui les entoure aujourd’hui, à ce qu’ils soient rendus publics pour être connus non seulement des parlementaires, mais aussi des citoyens.
Vous m’avez demandé comment et à quelle échéance cette réforme serait mise en oeuvre. Tout d’abord, la publicité des avis du Conseil d’État sur les projets de loi n’appelle pas de modification du cadre juridique existant et n’impliquera donc aucune modification législative ou réglementaire. Ensuite, il appartiendra au Premier ministre de définir les modalités de publication des avis du Conseil d’État. Sous cette réserve, je peux vous indiquer que l’engagement du Président de la République devrait être appliqué pour les projets de loi qui seront soumis au Conseil des ministres au mois de mars. Les avis seront vraisemblablement publiés lors du dépôt au Parlement des projets de loi, à l’issue du Conseil des ministres, et diffusés comme ces derniers sur Légifrance.
Vous vous êtes également interrogé sur les effets pervers que cette publication pourrait entraîner, notamment parce qu’elle pourrait amener le Conseil d’État à une certaine forme de frilosité ou d’autocensure. Il est bien sûr difficile de prévoir avec précision les effets de cette réforme. Toutefois, la publicité constituera sans nul doute un changement très important pour le Conseil d’État, dont les avis sont réservés au Gouvernement depuis plus de 200 ans.
Pour ma part, je suis persuadé que le Conseil d’État, lui-même très attaché à la transparence de l’action publique, fera tout son possible pour éviter que cette nouvelle publicité n’affecte la qualité et l’exhaustivité de ses avis.
Plus encore, pourquoi ne pas imaginer, à l’inverse, que cette publicité aura des effets vertueux, qu’elle poussera le Conseil d’État à être encore plus complet et exhaustif qu’il ne l’est aujourd’hui, si cela est possible ?

La parole est à Mme Cécile Untermaier, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.

Avec un certain nombre de parlementaires, nous avons mené à l’Assemblée nationale une mission d’information sur la simplification législative, dont la présidente était Laure de La Raudière et le rapporteur Thierry Mandon, puis Régis Juanico. Nous avons travaillé pendant six mois sur la question de la simplification législative et produit un rapport dont je recommande la lecture au Gouvernement, car il contient des conclusions très intéressantes dont vous avez sans doute eu écho, monsieur le secrétaire d’État.
Dans le cadre de cette mission d’information, nous avons beaucoup travaillé sur l’étude d’impact, dont nous avons souligné la nécessaire qualité. L’étude d’impact est encore très souvent jugée insuffisante : il faut donc prendre les mesures qui s’imposent pour garantir sa qualité, ce qui permettra au législateur de gagner du temps et peut-être d’aller un peu plus vite en besogne lorsque le texte sur lequel elle porte sera débattu dans l’hémicycle. Si la qualité de l’étude d’impact était garantie, le débat pourrait s’engager en amont de la discussion parlementaire, ce qui permettrait d’éviter qu’un certain nombre d’amendements parasites viennent encombrer le débat en séance publique. Tel est l’objet de ma première question.
Ma seconde question porte sur les amendements déposés sans étude d’impact. Il faudrait permettre la réalisation d’une telle étude lorsque le président de la commission saisie au fond juge cette demande fondée.
Voilà, monsieur le secrétaire d’État, les réflexions que je souhaitais vous exposer. Je vous remercie de me faire part de vos remarques sur ces questions fondamentales relatives à la qualité des études d’impact et aux amendements impliquant une étude d’impact.
Madame Untermaier, votre question porte sur un sujet tout à fait essentiel, qui a déjà été débattu dans cette assemblée : celui de l’amélioration de la qualité des études d’impact. Vous l’avez dit, un travail de très grande qualité a déjà été réalisé en la matière par la mission d’information sur la simplification législative. Je tiens à m’associer à vos félicitations et à rendre hommage à Régis Juanico, qui entre dans l’hémicycle en ce moment même…
… et à Mme de La Raudière, dont je veux saluer l’excellent travail.
Votre première question porte sur la quantification des charges administratives. Le principe selon lequel une charge administrative doit être supprimée dès qu’une nouvelle charge est créée est un outil intéressant et il doit être développé.
Cependant, le dispositif est récent et doit être perfectionné. La quantification des charges administratives est un exercice moins simple qu’il n’y paraît. Il serait dès lors prématuré d’intégrer cet outil aux études d’impact.
Vous m’interrogez également sur la possibilité de contre-expertiser des études d’impact. Nous avons déjà accompli de grands progrès grâce à deux organismes qui ont entre autres pour mission de vérifier que l’impact des normes nouvelles a été correctement quantifié par le Gouvernement : le Conseil national d’évaluation des normes pour les projets de loi ou de décrets qui touchent les collectivités territoriales et le Conseil de la simplification pour les entreprises.
À l’automne 2014, le Président de la République a annoncé qu’il était favorable à la mise en place d’une autorité indépendante chargée d’expertiser la qualité des études d’impact. Nous travaillons actuellement sur cette question et nous ne manquerons pas de vous en rendre compte.
Enfin, vous estimez que le président de la commission saisie au fond doit pouvoir demander une étude d’impact sur les amendements substantiels. S’agissant d’une question interne à l’Assemblée nationale et qui touche à l’organisation de ses travaux, vous comprendrez que le Gouvernement ne prenne pas position.

Nous en venons aux questions du groupe UMP.
La parole est à Mme Laure de La Raudière.

Ma question porte également sur la qualité des études d’impact et sur la préparation des projets de loi.
Dans son discours de voeux pour 2014, le président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré déclarait : « … le Conseil constitutionnel a en effet aujourd’hui à connaître de lois aussi longues qu’imparfaitement travaillées. Il fait face à des dispositions incohérentes et mal coordonnées. Il examine des textes gonflés d’amendements non soumis à l’analyse du Conseil d’État. Il voit revenir chaque année, notamment en droit fiscal, des modifications récurrentes des mêmes règles. Bref, il subit des bégaiements et des malfaçons législatives qui ne sont pas nouvelles mais sont fort nombreuses. »
Parallèlement à ce constat, le président de l’Assemblée nationale a voulu qu’une mission d’information soit créée pour travailler sur la simplification législative, Mme Untermaier l’a rappelé.
Avec Thierry Mandon, puis Régis Juanico et certains collègues comme Cécile Untermaier ici présente, nous avons fait le constat que si les lois étaient mieux préparées en amont de la procédure législative et si le Parlement était mieux éclairé, nous pourrions éviter certains des bégaiements dénoncés par le président Jean-Louis Debré.
La loi ALUR est l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire, monsieur le secrétaire d’État : une loi-fleuve de cent cinquante pages et quatre-vingt-quatre articles quand elle sort du Conseil des ministres – l’étude d’impact associée est à peine moins importante que la loi elle-même – pour arriver à cent neuf articles à l’issue de son examen en commission et cent cinquante articles en sortant de l’hémicycle.
Depuis son adoption en mars 2014 – il y a quelques mois seulement –, nous sommes revenus par deux fois sur des dispositifs de la loi ALUR : une première fois dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, présenté par Thierry Mandon en juillet 2014, et maintenant dans le cadre du projet de loi Macron en cours d’examen.
Un tel phénomène n’aurait pas eu lieu si les textes étaient mieux préparés. Il tend à une complexification de la loi qui va à l’inverse de ce que vous préconisez en matière de simplification. Je dénonce donc ici votre double discours.
Le Gouvernement a annoncé la création d’outils très intéressants visant à améliorer les études d’impact – et je ne reprends pas la question de Mme Untermaier, ni celle de M. Popelin –, notamment la réalisation de « tests PME » s’agissant des dispositions applicables dans les entreprises afin d’évaluer concrètement leur déclinaison. Cela aurait été très utile avant l’adoption du compte pénibilité pour les entreprises par exemple, qui, nous le savons tous, pose de nombreuses difficultés d’application.
Monsieur le secrétaire d’État, le test PME, c’est quand et comment ?
Madame de La Raudière, je répondrai d’abord à la dernière partie de votre question portant sur les tests PME, lesquels ont été mis en place de façon expérimentale pour l’instant. Je rappelle que nous avons également lancé le Conseil de la simplification pour les entreprises ainsi que le Conseil national d’évaluation des normes. Le Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique est le garant de la mise en oeuvre du test PME. Ces instances visent toutes à contribuer à la bonne écriture de la loi. S’agissant des tests PME, le processus n’est pas encore stabilisé, mais les choses avancent.
L’amélioration de la qualité des études d’impact était l’un des principaux axes de travail de votre mission d’information sur la simplification législative, madame de La Raudière, et vos propositions sur le sujet étaient particulièrement pertinentes.
Je rappelle que l’article 39 de la Constitution prévoit une forme de contrôle de la qualité de ces études par les assemblées et le quatrième alinéa de cet article dispose que, si un projet de loi ne respecte pas les conditions de présentation, la Conférence des présidents de la première assemblée saisie peut refuser l’inscription de ce texte à l’ordre du jour.
Comme vous le savez, ces dispositions visent en pratique la loi organique du 15 avril 2009, qui impose au Gouvernement de réaliser une étude d’impact complète et précise sur chacun des projets de loi qu’il dépose.
Je rappelle également qu’en cas de refus d’inscription, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée ou par le Premier ministre afin d’apprécier si les critères organiques ou non ont été respectés par le Gouvernement. Il est donc d’ores et déjà possible pour les assemblées de contrôler la qualité des études d’impact.
Se pose aussi la question de l’extension des études d’impact aux propositions de loi. Sur ce sujet, la mission d’information avait évoqué deux pistes. Elle avait envisagé que ces études d’impact soient réalisées soit par les services de l’Assemblée, soit par l’administration centrale. Le rapport de la mission indiquait que dans ce dernier cas, il conviendrait de constituer un pôle d’expertise auquel le Parlement pourrait faire appel dans le cadre d’un conventionnement entre l’exécutif et les deux assemblées.
Le choix entre ces deux options relève de la libre appréciation de votre assemblée, je n’ai pas à émettre d’opinion sur cette question. Si vous choisissez la seconde option, le Gouvernement sera ouvert à vos suggestions pour définir les termes du conventionnement évoqué par la mission.

La parole est à Mme Laure de La Raudière, pour poser sa seconde question.

Permettez-moi de revenir sur la question des études d’impact. Nous sommes en train d’examiner la loi Macron. Or nous avons profondément modifié l’équilibre du texte par l’adoption d’amendements émanant des parlementaires issus de tous les groupes politiques, mais aussi des amendements du Gouvernement. De ce fait, l’étude d’impact initiale devient obsolète. Il serait utile et sage, avant l’examen du texte au Sénat, de réviser l’étude d’impact au regard des modifications qui y ont été apportées.
Cela suppose un délai suffisant entre l’examen d’un texte à l’Assemblée nationale et au Sénat, afin que l’étude d’impact soit révisée et approfondie par le Gouvernement en cas de besoin.
S’agissant des questions orales sans débat, j’ai une suggestion à faire. Les séances consacrées aux questions orales sans débat sont un moment précieux pour nous, parlementaires. Elles permettent de faire avancer des questions qui restent en suspens, souvent des questions écrites auxquelles nous n’avons pas eu de réponse.
Or nous sommes souvent frustrés de ne pas être en présence du ministre ou du secrétaire d’État en charge des questions que nous soulevons. Nous aimerions en effet pouvoir en débattre avec lui.
Ma suggestion est la suivante : serait-il possible de regrouper par séance les questions relatives à un même sujet et relevant d’un même ministère ? Nous serions ainsi en présence du ministre concerné pour répondre à nos questions.
S’agissant du caractère obsolète de l’étude d’impact, lorsqu’un texte vient à être profondément modifié après son examen en séance publique, que ce soit à l’Assemblée ou au Sénat, vous proposez la révision de cette étude d’impact. Pour ma part, je suis relativement ouvert à une telle suggestion, à condition que cela n’allonge pas les délais de production et de vote de la loi.
Il va sans dire que nous devons être sensibles à la qualité du texte de loi produit et le Gouvernement peut être conduit à proposer des modifications en cours d’examen, même si d’aucuns peuvent le déplorer. Mais pour autant, notamment dans les domaines économiques et sociaux, notre action législative doit être relativement rapide, vous pouvez en convenir avec moi. Or si nous allongions les délais, nous n’irions pas dans ce sens. Ces remarques étant faites, il n’est pas interdit de réfléchir à vos suggestions.
Pour ce qui concerne les questions orales sans débat, je fais remarquer que ce n’est pas un ministre qui répond, mais le Gouvernement.
Le principe est le suivant : c’est le Gouvernement qui répond à la question d’un parlementaire, pas un ministre. Cela étant, j’imagine la frustration qui peut être la vôtre lorsque le ministre qui vous répond n’est pas le ministre en charge de votre dossier. Mais comme vous le savez, les réponses sont préparées par les services du ministre concerné.

Nous en venons maintenant aux questions du groupe UDI.
La parole est à M. Michel Zumkeller.

Le groupe UDI souhaite vous interroger sur l’amélioration de nos conditions de travail, préoccupation qui transcende les courants politiques. Si nous avons été plusieurs à citer le projet de loi Macron, c’est qu’il est symbolique à cet égard. Le ministre de l’économie a, incontestablement, pris le temps de nous répondre, et les rapporteurs et la commission spéciale ont effectué un travail de fond, il faut le souligner. Mais au final, des amendements d’importance ont été débattus en séance publique et je ne citerai que l’affaire du canal Seine-Nord avec un amendement à 5 milliards, ce qui n’est pas rien !
En dépit d’un certain nombre d’améliorations de nos conditions de travail, plusieurs choses sont à revoir. Me revient en mémoire ce qui s’est passé en commission spéciale autour de l’article 17 qui a fait l’objet de nombreux amendements et qui s’est transformé en article 13 bis, ce qui a fait tomber tous les amendements à l’article 17 !
Certes, ce ne sont pas des pratiques nouvelles, il faut le reconnaître honnêtement. Mais cela devrait nous conduire à faire un travail en commun sur ces sujets, et c’est le cas dans le cadre des missions d’information.
Il faudrait peut-être, et c’est la suggestion du groupe UDI, associer les groupes de la majorité et de l’opposition en amont sur les sujets importants afin de mieux travailler ensemble et d’éviter les amendements de dernière minute.
Votre question, monsieur le député, est parfaitement légitime. Dans le cas du projet de loi Macron, nous sommes dans la contradiction permanente : d’un côté, on se félicite du travail dont il a fait l’objet et qui est apprécié sur tous les bancs et de l’autre, on met en avant des frustrations.
Permettez-moi de vous faire part des frustrations du Gouvernement lorsqu’il voit revenir en séance publique des amendements qui ont fait l’objet de longs débats en commission spéciale et que le débat est rouvert comme s’il n’y avait pas eu le moindre travail en commission. Cela demande du reste des efforts à tous, parlementaires et Gouvernement, je ne le nie pas. Mais je vous invite à réfléchir pour l’avenir à une évolution des pratiques. La volonté de modifier un texte émane tant du Gouvernement que des parlementaires, mais cela implique d’y consacrer le temps nécessaire.
Vous signalez à juste titre que des amendements importants peuvent être présentés. Il peut s’agir d’amendements d’opportunité – comme c’est précisément le cas de la disposition relative au canal Seine-Nord. Le débat sur le coût de l’opération n’a pas surgi pendant l’examen de la loi Macron. La question était notoire et devait faire l’objet d’une décision très lourde.
Dès lors que cette décision était instruite et argumentée, l’exécutif était en droit de profiter d’un texte de loi de portée économique pour y présenter cet amendement, saisissant ainsi l’opportunité de bénéficier du plan Juncker afin de financer les travaux. Vous comprenez parfaitement pourquoi nous avons été amenés à présenter un tel amendement dans ce texte. On peut discuter du choix politique qui a été fait, mais il est clair que cet amendement ne présentait pas de difficultés techniques de nature à interpeller le Parlement.

La parole est à M. Michel Zumkeller pour exposer sa seconde question au nom du groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

La seconde question du groupe UDI concerne la transposition des directives européennes.
Notre pays se situe dans la moyenne européenne en matière de transposition des directives européennes. Cela étant, nous pourrions améliorer encore le taux des transpositions, faire en sorte que les directives soient transcrites le plus rapidement possible et que nous disposions d’informations complètes.
Il serait également intéressant de savoir dans quelles conditions elles sont transposées dans les pays voisins, car nous avons parfois l’impression que nous agissons avec beaucoup de rigueur mais que ce n’est pas le cas dans les autres pays. Lorsque nous procédons à la transposition d’une directive, savoir ce qu’en ont fait les pays voisins ne nuirait pas à nos débats et nous permettrait d’adopter une position plus équilibrée et plus efficace.
Les performances de notre pays en matière de transposition des directives européennes sont en effet satisfaisantes puisque notre déficit en la matière n’est que de 0,6 %, ce qui nous place en bonne position par rapport aux autres États membres de même taille et de même culture juridique que nous, comme par exemple l’Allemagne.
Toutefois, dans un contexte où les citoyens sont perplexes, voire critiques, vis-à-vis de l’Union européenne, ce bilan ne saurait être suffisant. Nous devons repenser les modalités de transposition des directives pour satisfaire deux impératifs : le respect des délais de transposition, car la France s’expose à de lourdes sanctions financières en cas de défaut de transposition, et la préservation des prérogatives du Parlement, qui doit pouvoir examiner attentivement tous les textes de nature législative, qu’ils résultent d’initiatives nationales ou de décisions européennes.
Nous devons donc transposer plus vite mais également permettre aux assemblées de vérifier que la transposition répond aux spécificités de notre pays. Nous devons aussi, dans le même temps, éviter de céder à la tentation de la sur-transposition, problème souligné par de nombreux responsables sociétaux ou politiques.
Pour atteindre cet objectif, la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la simplification législative a proposé de développer le recours à la législation par ordonnance. Cette idée est intéressante mais elle ne me semble pas assez nuancée. Certes, le recours aux ordonnances se justifie pour les directives les plus techniques ou qui ne laissent pas de marges de manoeuvre aux États membres, mais beaucoup de directives, qui portent sur des sujets sensibles, laissent lors de leur transposition une grande latitude aux États membres.
Pour ces textes, il me semble essentiel de continuer à procéder comme nous le faisons aujourd’hui, en passant par des projets de loi, soit dans le cadre de réformes plus vastes, comme c’est le cas de certains articles du projet de loi relatif à la transition énergétique, soit par le biais de projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, les DDADUE.

La parole est à Mme Gilda Hobert, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Monsieur le secrétaire d’État, lors de ses voeux aux corps constitués et aux membres des bureaux des deux assemblées parlementaires, le 20 janvier dernier, le Président de la République a déclaré vouloir rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets de loi qui, en vertu de l’article 39 alinéa 2 de la Constitution, sont délivrés avant délibération desdits projets de loi en Conseil des ministres.
Cette annonce importante mérite d’être précisée. À partir de quand les avis du Conseil d’État seront-ils rendus publics ? Avant ou après l’adoption du projet de loi en Conseil des ministres ? Sous quelle forme ? La nature de cet avis s’en trouvera-t-elle modifiée ? Le législateur en aura-t-il officiellement connaissance, auquel cas ce serait un élément des travaux préparatoires servant à interpréter la loi ?
On le voit, l’avis du Conseil d’État, s’il est rendu public, pourrait ne pas rester celui qui auparavant pouvait fuiter… Et c’est justement parce que certains, par des voies détournées, avaient accès à ces avis tandis que d’autres ne l’avaient pas que les rendre publics aurait le mérite de placer sur un plan d’égalité l’ensemble des parlementaires.
Il existe cependant un risque que l’avis du Conseil d’État fasse le lit d’argumentations d’autorité de part et d’autre lors de l’examen législatif du projet de loi, à moins qu’il ne lie le Gouvernement, désireux d’éviter une censure par le Conseil constitutionnel une fois l’examen achevé.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir éclairer la représentation nationale sur ces points.
Applaudissements sur les bancs du groupe RRDP.
Votre question, madame la députée, me permet d’apporter une précision technique.
L’avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi prend habituellement la forme d’une note au Gouvernement et d’un projet de rédaction alternative.
La note expose l’analyse du Conseil d’État sur les principales difficultés du texte et les questions sur lesquelles il lui paraît utile d’attirer l’attention du Gouvernement. C’est sur note qu’est développée l’argumentation juridique adoptée par le Conseil d’État lorsqu’il se prononce sur la conformité du projet de loi à la Constitution ou le respect des engagements internationaux de la France.
Si cette note devait être rendue publique, la rédaction alternative du projet de loi n’aurait pas, quant à elle, vocation à être rendue publique car sa publicité conduirait à saisir le Parlement de deux rédactions concurrentes du projet de loi, celle du Gouvernement et celle du Conseil d’État.
L’objectif défini par le Président de la République est bien de permettre au Parlement de bénéficier de l’expertise du Conseil d’État et non de lui donner à choisir entre deux rédactions du projet.
Je profite de l’occasion pour rappeler que l’annonce du Président de la République ne concerne que les projets de loi et nullement les propositions de loi, pour lesquelles les parlementaires qui en sont les auteurs garderont la possibilité de rendre l’avis public ou d’en conserver la confidentialité. Je relève que dans le cas des propositions de loi, le Conseil d’État rédige une note mais ne propose pas de rédaction alternative au texte qui a été déposé.
En tout état de cause, madame la députée, je ne manquerai pas de vous apporter dans les prochaines semaines des éléments d’information complémentaires sur la manière dont l’annonce du Chef de l’État sera mise en oeuvre.

La parole est à Mme Gilda Hobert, pour exposer sa seconde question au nom du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Ma question concerne les études d’impact.
Monsieur le secrétaire d’État, l’une des innovations de la réforme constitutionnelle de 2008 a été de soumettre la présentation des projets de loi devant l’Assemblée nationale ou le Sénat à des conditions précises, conditions renvoyées par l’article 39 alinéa 3 de la Constitution à la loi organique du 15 avril 2009.
Désormais les projets de loi sont accompagnés d’études d’impact censées éclairer les objectifs du texte gouvernemental. Or, ces études sont souvent présentées comme étant insuffisantes s’agissant de leur contenu et s’apparentant à du bavardage pour ce qui est de leur développement.
De ce point de vue, la décision du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2014 est éclairante. Saisi cinq jours plus tôt par le Premier ministre, en application de l’article 39-4 de la Constitution, à l’initiative de la Conférence des présidents du Sénat, le Conseil constitutionnel avait à juger du caractère suffisant ou non de l’étude d’impact du projet de loi portant réforme territoriale. Or le Conseil a purement et simplement refusé de s’engager dans une mesure sourcilleuse ou tatillonne de l’étude d’impact concernée en rappelant que celle-ci devait s’apprécier par rapport à l’exposé des motifs du projet de loi, ce que résume le constitutionnaliste Didier Maus par la formule suivante : « On ne peut pas mesurer l’impact de quelque chose qui n’existe pas ».
Il n’en reste pas moins que le législateur, noyé sous les informations disparates des études d’impact annexées à des projets de loi peu ou mal motivés, et soumis, pour les examiner, à des délais de plus en plus court, reste particulièrement mal informé des conséquences de ce qu’il est amené à voter. Il sait pourquoi on le saisit mais il ne sait pas en mesurer l’impact – ce qui est précisément l’objet des études d’impact.
Les études d’impact n’ont-elles pour objet que de mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à l’adoption d’un projet de loi, pour reprendre les termes du Conseil constitutionnel, ou peut-on espérer qu’à l’avenir leur contenu soit moins lapidaire, pour ne pas dire lacunaire, comme le demande très souvent le Conseil d’État dans ses avis, lesquels seront bientôt rendus publics ?
Applaudissements sur les bancs du groupe RRDP.
Madame la députée, les études d’impact ne doivent pas être des exposés des motifs bis car dans ce cas elles ne sauraient être un véritable outil d’évaluation des projets de loi. C’est un risque que j’avais souligné en juillet 2014 lors de mon audition par votre mission d’information sur la simplification législative.
Nous nous efforçons de donner une grande portée aux études d’impact en faisant de celles-ci le point de départ de notre action et en les utilisant comme un véritable outil d’évaluation de la faisabilité, de l’utilité et de l’opportunité d’une réforme.
Par le passé, les études d’impact ont trop souvent été vues comme une contrainte purement formelle et il n’était pas rare qu’elles soient rédigées après les projets de loi qu’elles étaient censées justifier.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Chaque arbitrage interministériel est basé non sur un projet de texte déjà ficelé mais sur une étude d’impact objective, chiffrée et précise. Tel a été le cas de l’ensemble des mesures figurant dans le projet de loi de finances pour 2015 : chaque dispositif a été soumis à l’arbitrage interministériel sous la forme d’une fiche d’impact et c’est sur cette base que les décisions ont été prises.
Cette nouvelle manière de procéder à d’ores et déjà mené à l’abandon de certaines réformes dont l’utilité n’avait pas été démontrée a priori.
Nous pouvons aller plus loin pour garantir l’utilité des études d’impact, par exemple en renforçant leur contenu, comme l’ont recommandé Régis Juanico et Laure de La Raudière dans leurs propositions pour améliorer la fabrique de la loi.
Je m’associe pleinement aux conclusions de la mission sur deux points : le bilan entre les coûts et avantages économiques des réformes doit être évalué de manière plus précise et plus argumentée ; les mesures transitoires prévues par les projets de loi doivent être mieux justifiées.

La parole est à Mme Françoise Descamps-Crosnier, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.

Monsieur le secrétaire d’État, plusieurs rapports parlementaires récents soulignent la nécessité d’améliorer la qualité du travail législatif. Sans reprendre les termes utilisés par le Conseil d’État dès 1991, chacun convient que nous produisons trop de lois, dont la qualité se dégrade de plus en plus, à rebours du principe constitutionnel de clarté de la loi et des objectifs également à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Le rapport présenté en 2014 par notre collègue Régis Juanico dans le cadre de la mission d’information sur la simplification législative, présidée par Laure de La Raudière, nous l’a rappelé. Ce rapport contient des propositions intéressantes pour améliorer nos pratiques et la fabrique de la loi.
Lors du colloque « Mieux légiférer » du 28 novembre 2014, Thierry Mandon, secrétaire d’État à la réforme de l’État et la simplification, a proposé à son tour plusieurs pistes qui seront expérimentées à l’occasion de l’examen du projet de loi sur le numérique.
Quelles sont les mesures qui ont été prises et celles qui sont en voie de l’être pour illustrer la nouvelle démarche collaborative ?
Le Gouvernement a par ailleurs décidé la création d’un comité indépendant chargé d’évaluer l’impact des nouveaux projets de loi. A-t-il été mis en place ? Un calendrier a-t-il été arrêté ?
Par ailleurs, comment cette nouvelle instance s’articulera-t-elle avec le Conseil de simplification pour les entreprises et le Conseil national d’évaluation des normes ?
Enfin, le Parlement devra prendre toute sa part dans l’amélioration du travail législatif et appliquer la diététique parlementaire prônée en son temps par Guy Carcassonne.
Dans la foulée de la réforme constitutionnelle votée en 2008 et au prétexte de l’introduction des études d’impact, l’office parlementaire d’évaluation de la législation a été supprimé. Il me semble à titre personnel qu’une telle décision était prématurée. Même s’il s’agit d’affaires parlementaires, quelle serait la position du Gouvernement au sujet de la création d’une instance similaire ?
Vous avez posé plusieurs questions, madame la députée Descamps-Crosnier. Je tenterai de répondre brièvement à chacune.
À propos de la dégradation de la qualité des lois, le constat est unanime et nous partageons tous en la matière une forme de responsabilité collective, selon les termes du président Bartolone. Une réponse adaptée à ce problème, qui fait l’objet de critiques récurrentes depuis plus de vingt ans, consisterait certainement à rénover les procédures d’élaboration et d’examen des textes.
Vous avez ensuite évoqué la nouvelle démarche de consultation du public inaugurée à l’occasion de la discussion du projet de loi relatif au numérique. La concertation pilotée par le Conseil national du numérique a pris fin il y a quelques jours et une synthèse en sera disponible à la mi-mars. Il est donc trop tôt pour en dresser un bilan mais je serai à votre disposition pour tirer les leçons de cette expérience très enrichissante en temps utile. La consultation citoyenne organisée par votre assemblée à propos de la fin de vie pourrait également faire l’objet d’un bilan. À l’aune de ces expériences, nous devons déterminer les moyens d’associer davantage le public à l’élaboration des lois à chaque étape du parcours législatif.
Vous m’avez par ailleurs interrogé sur la création, souhaitée par le Président de la République, d’un comité indépendant chargé de contre-expertiser les études d’impact. Comme vous l’avez vous-même indiqué, cette nouvelle instance soulève des questions sensibles, en particulier celle de son articulation avec le Conseil de la simplification pour les entreprises et le Conseil national d’évaluation des normes qui n’ont que quelques mois d’existence. Devons-nous créer un organisme unique par souci de cohérence ou préserver l’expertise des organes sectoriels qui ont déjà fait la preuve de leur bon fonctionnement ? Tel est l’enjeu actuel de notre réflexion.
Vous souhaitez enfin connaître mon sentiment au sujet de la création d’une instance chargée des missions jadis exercées par l’office parlementaire d’évaluation de la législation. Sans prendre parti sur ce point qui est en effet du ressort du Parlement, je constate que la dernière réforme du règlement de l’Assemblée nationale l’a dotée de nouveaux outils d’évaluation de l’application des lois sous forme de rapports d’évaluation établis trois ans après la promulgation d’un texte. Il vous appartiendra, mesdames et messieurs les députés, de tirer les leçons de cette expérience.

Les décrets précisant les modalités d’application d’une loi sont indispensables à l’effectivité du travail parlementaire car la loi ne produit ses effets qu’après publication des décrets d’application éventuellement nécessaires. La longueur des délais de publication des décrets constitue une vraie difficulté au point parfois de rendre le travail du Parlement caduc et suspendu dans le temps voire même oublié.
Il arrive en effet qu’une loi n’entre jamais en vigueur faute de décret d’application. Ce fut par exemple le cas d’une disposition de la loi du 14 mars 2011 dite « LOPPSI 2 », qui affichait pourtant une sévérité de façade, prévoyant un décret autorisant le blocage des sites Internet comportant des contenus pédopornographiques. Le décret n’a pas été publié par le gouvernement de l’époque et il a fallu attendre le vendredi 6 février 2015 pour que la mesure soit mise en oeuvre par notre gouvernement.
Cependant, le rapport annuel sur l’application des lois du Sénat note une certaine amélioration à ce sujet. Par exemple, le décret d’application de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires précisant les conditions de mise en oeuvre du triple objectif de la loi a été publié le 30 novembre 2014 au Journal officiel, soit moins de cinq mois après le vote des parlementaires. Tel n’est pas le cas en revanche de certaines dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové – ALUR – du 24 mars 2014, dont certains décrets d’application se font toujours attendre. Que pouvez-vous faire, monsieur le secrétaire d’État, pour améliorer la publication des décrets d’application des lois votées par le Parlement et donc renforcer l’effectivité des lois et du travail parlementaire ?
Comme l’a souligné le Président de la République lors de ses voeux, le bilan du Gouvernement en matière d’application des lois n’est pas satisfaisant. Le taux d’application est d’environ 60 %, ce qui n’est pas satisfaisant, je le répète. Une telle situation n’est acceptable ni par les citoyens qui attendent des politiques publiques des effets concrets et rapides sur leur vie quotidienne ni par les parlementaires qui sont en droit d’attendre l’application intégrale des lois six mois après leur promulgation. Pour pallier cette défaillance, le Président de la République et le Premier ministre ont pris des décisions fortes. Chaque membre du Gouvernement devra passer en revue l’ensemble des mesures d’application non publiées relevant de son champ de compétences et faire en sorte que son administration produise des textes marquants dans les plus brefs délais.
Deuxièmement, à l’initiative du Président de la République, un bilan de l’application des lois sera dressé chaque mois en Conseil des ministres. Le premier, effectué le 4 février dernier, a mis l’accent sur les secteurs les plus en retard et permis d’appeler la vigilance des ministres concernés sur le sujet. Nous avons en outre décidé de mettre en place certaines mesures techniques visant à raccourcir le circuit d’élaboration des décrets. Il s’agit en particulier de faciliter le recueil des contreseings afin d’aller plus vite en matière de consultation. Je ne doute pas que ces mesures d’apparence modeste produiront rapidement leurs effets.

Notre projet de société se traduit en actes législatifs. Il importe donc que le parcours d’une loi soit clairement perçu par nos concitoyens. Il en va du lien de confiance qui les unit à leurs représentants politiques et que nous devons repriser tant il s’est distendu. Deux voies sont susceptibles d’être empruntées, celle du travail parlementaire en lui-même et celle du contrôle de l’action du Gouvernement par les deux chambres. Certaines modifications du règlement de l’Assemblée nationale ont déjà été prises en compte, comme la composition du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. L’examen d’autres pistes semble opportun afin d’améliorer la transparence et l’efficience législatives tout en organisant et valorisant mieux les actions de contrôle du Gouvernement par le Parlement. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d’État, formuler des propositions en la matière ?
Je considère comme vous, madame la députée Chapdelaine, que les actions de contrôle du Gouvernement par le Parlement sont un outil essentiel de notre démocratie et suis persuadé que la prochaine législature, qui verra l’émergence du Parlement du non-cumul, instaurera un nouvel équilibre entre les institutions au bénéfice du pouvoir législatif.
Plus disponibles pour l’exercice de leur mandat national, les parlementaires accorderont davantage de place au contrôle et à l’évaluation, ce qui les rendra plus forts face au Gouvernement. Ils voteront des lois plus efficaces et mieux adaptées aux attentes de nos concitoyens.
Il ne m’appartient pas de prendre position sur l’exercice par l’Assemblée nationale des pouvoirs que lui confie notre Constitution ni sur ses compétences en matière de contrôle de l’action du Gouvernement. Votre président Claude Bartolone a d’ailleurs émis des propositions sur ce sujet. Il me semble néanmoins, pour évoquer un sujet auquel je suis particulièrement attentif, que le suivi de l’exécution des lois pourrait être renforcé. En cette matière, le Parlement a un grand rôle à jouer en vertu de ses pouvoirs de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.
Je tiens à saluer l’initiative que vous avez prise lors de la dernière réforme de votre règlement, mesdames et messieurs les députés. Vous avez en effet prévu la publication, trois ans après la promulgation des lois, d’un rapport d’évaluation de leur impact rédigé conjointement par un député de la majorité et un député de l’opposition. Cet exercice novateur permettra non seulement de s’assurer que les lois sont comprises et acceptées par les acteurs concernés mais aussi et surtout de corriger les textes ne produisant pas les effets escomptés. Une sorte de révolution culturelle reste à opérer sur ce sujet. Elle aura lieu au fur et à mesure que les parlementaires et plus largement les citoyens constateront que l’action de contrôle du Parlement moderne est décisive et accélère d’ailleurs in fine la préparation de la loi, rétroactivement en quelque sorte. La question que vous avez posée est donc tout à fait essentielle, madame la députée. J’espère y apporter quelques réponses et vous assure en tout cas de mon soutien entier en la matière.

Merci de vos réponses, monsieur le secrétaire d’État. La séance de questions sur l’amélioration des relations de travail entre le Gouvernement et le Parlement est terminée.
La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.

L’ordre du jour appelle la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, de la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (no 2524).

La parole est à Mme Christine Pires Beaune, rapporteure de la commission mixte paritaire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale, mes chers collègues, trois mois après l’examen en première lecture des propositions de loi identiques déposées par Jacques Pélissard et par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, je me réjouis de pouvoir vous présenter un texte sur lequel un consensus a pu rapidement se dégager, au sein de notre Assemblée comme au Sénat.
Il y avait en quelque sorte urgence, car cette proposition contient des dispositions qui seront applicables aux communes nouvelles dont le principe de création aura été validé avant le 31 décembre 2015 ; il importe donc de pouvoir fournir aux élus municipaux intéressés – et nous savons tous qu’ils sont nombreux – un cadre leur permettant de mettre en place dans les dix mois restants un projet de création d’une commune nouvelle.
Je rappellerai brièvement que si les 36 767 communes représentent la base de notre organisation territoriale, les trois quarts d’entre elles comptent moins de 1 000 habitants et ont parfois beaucoup de mal à entretenir leur patrimoine et, surtout, à proposer de réels services à la population.
Face à cet émiettement, le développement de l’intercommunalité a pallié le maintien de la carte communale héritée des paroisses de l’Ancien Régime, mais nous arrivons aux limites de l’intégration intercommunale. Même si les structures intercommunales ont permis de mettre en place des services à la population et des actions de développement inenvisageables à l’échelon d’une commune, la mutualisation des équipements et des moyens reste insuffisante. Il convient donc de renouer avec un mouvement de grande ampleur visant au rapprochement des communes, sur la base du volontariat et de l’expérience du travail en commun.
Rappelons les grands traits du régime de la commune nouvelle, mis en place par la loi du 16 décembre 2010. Pour relancer le rapprochement volontaire des communes, le législateur a tiré les leçons de l’échec de la loi dite « Marcellin ». Malgré les tentatives pour réaliser des fusions à grande échelle, le nombre de communes n’a diminué en soixante ans que de 5 %.
La loi du 16 décembre 2010 a remplacé ce dispositif des communes associées par celui de la commune nouvelle. Cette commune à statut particulier est créée en lieu et place des communes anciennes, sur la base d’un consensus local exprimé par les conseils municipaux. À défaut de cet accord unanime, la création ne peut être décidée qu’après consultation des électeurs. Tous les projets qui ont abouti à ce jour se sont réalisés sur la base de l’accord unanime des conseils municipaux.
En outre, le législateur a spécifiquement prévu la faculté pour des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale – EPCI – à fiscalité propre, de se transformer en commune nouvelle. Dans ce cas, l’EPCI et ses communes membres fusionnent pour créer une seule commune nouvelle.
Si les anciennes communes ne forment plus de sections électorales, elles peuvent toutefois conserver une identité dans le cadre de la mise en place de communes déléguées. La commune déléguée dispose de droit d’une mairie annexe, compétente notamment en matière d’état-civil et où pourront continuer à être célébrés les mariages, et d’un maire délégué, élu par le conseil municipal, qui peut lui adjoindre un conseil de la commune déléguée. La plupart des dispositions relatives aux arrondissements de Paris, Marseille et Lyon sont applicables aux communes déléguées.
La commune nouvelle reçoit le montant des dotations perçues l’année précédente par les anciennes communes. Si un EPCI est fusionné au sein de la commune nouvelle, celle-ci conserve le bénéfice de la dotation d’intercommunalité précédemment versée, à titre de dotation de consolidation.
En outre, grâce à une disposition introduite à l’initiative de M. Pélissard, la loi de finances pour 2014 permet aux communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016 et regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, ainsi qu’à toutes les communes nouvelles créées avant mars 2014, de bénéficier d’un montant garanti de dotation globale de fonctionnement pendant trois ans. Elles ne peuvent se voir appliquer, pour les exercices budgétaires 2014 à 2017, la baisse des dotations des collectivités territoriales.
Enfin, sur délibération concordante ou à la demande d’une commune ayant une pression fiscale inférieure de 20 % à celle de la commune la plus imposée, la commune nouvelle peut mettre en place un dispositif d’intégration fiscale progressive.
Cependant, il faut le reconnaître, le bilan reste modeste : en quatre ans, seules dix-huit communes nouvelles ont été créées.
Aussi avons-nous décidé de rendre le régime des communes nouvelles plus attractif en levant certains obstacles institutionnels, financiers, voire psychologiques, qui expliquent les hésitations des élus locaux et des populations.
Quand nous les avons auditionnés, les maires ou représentants de six communes nouvelles ont souligné les difficultés liées à la peur de voir disparaître l’échelon communal, notamment la représentation de chaque commune déléguée au sein du conseil municipal de la commune nouvelle. Ils ont pourtant souligné que cette solution permettait une mutualisation des moyens et des économies sans commune mesure avec celle liée à la mise en place de structures intercommunales. De fait, dès la première année, dans plusieurs communes nouvelles, les frais de fonctionnement ont diminué de 6 % à 8 % mais, surtout, on a pu étendre les services à la population. Enfin, les élus ont regretté que le droit existant exclue certains conseillers municipaux, appelés à se prononcer sur la création de la commune nouvelle, dès sa mise en place.
C’est pourquoi les propositions de loi, issues de travaux convergents de M. Pélissard et de votre rapporteure, proposaient, non de modifier les conditions de création d’une commune nouvelle, mais d’en faciliter la constitution.
Les dispositions les plus importantes ont fait l’objet d’un consensus avec le Sénat, voire d’un vote conforme, pour certaines d’entre elles.
Dans un premier temps, elles visent à améliorer les dispositions organisant les premières années de vie commune et la place des élus municipaux dans les institutions. Le conseil municipal transitoire sera ainsi composé, jusqu’aux élections municipales suivantes, de l’ensemble des conseillers municipaux en fonction. De la même manière, la commission des lois a décidé, en première lecture, que le premier conseil municipal élu comporterait, pour un seul mandat, quelques membres supplémentaires. Afin que le rôle des maires délégués ne se limite pas au territoire de chaque commune déléguée, le texte leur accorde de droit la qualité d’adjoint au maire de la commune nouvelle. Ils pourront ainsi recevoir des délégations couvrant l’ensemble du territoire de la commune nouvelle.
Dans un deuxième temps, elles garantissent le maintien d’une identité communale, notamment en disposant que la création des communes déléguées serait dorénavant de droit, sauf si les communes préexistantes en ont décidé autrement.
Dans un troisième temps, elles assouplissent les modalités de rattachement à un EPCI à fiscalité propre, en fixant un délai de deux ans pour les communes nouvelles créées dans le cadre d’un EPCI préexistant.
Enfin, en proposant un pacte financier, elles garantissent pendant trois ans le niveau des dotations budgétaires des communes qui se lanceraient en 2015 ou en 2016 dans la création d’une commune nouvelle regroupant moins de 10 000 habitants, ou de toutes les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. De plus, pendant trois ans, les communes nouvelles regroupant entre 1 000 et 10 000 habitants pourraient bénéficier d’un supplément de dotation forfaitaire de 5 %.
Aussi, dans les faits, les travaux de la commission mixte paritaire se sont-ils attachés à régler des différences d’appréciation entre les deux assemblées sur des points relativement secondaires. Ils ont permis de conforter trois points auxquels tenait l’Assemblée.
Premièrement, le conseil transitoire pourra être renouvelé en cours de mandat, en revenant au format habituel du conseil municipal ; le dispositif adopté par le Sénat excluait de fait cette possibilité avant le renouvellement général, alors que l’on ne peut exclure que des dissensions nécessitent de dissoudre un conseil municipal transitoire.
Deuxièmement, le texte organise un régime d’extension de la commune nouvelle, qui n’avait pas été prévu par le législateur en 2010. Il permettra également que cette faculté d’extension soit distincte de la création, évitant ainsi les effets d’aubaine.
Troisièmement, ont été supprimées des dispositions introduites par le Sénat, sans rapport avec le texte, relatives aux schémas départementaux de coopération intercommunale. Bien entendu, cela a nécessité de prendre en compte les souhaits exprimés par nos collègues sénateurs s’agissant, notamment, de la limitation de l’extension des communes littorales et de l’abandon de la possibilité pour les communes déléguées de demander la création d’un plan de secteur au sein du plan local d’urbanisme.
La commission mixte paritaire a également permis de résoudre des questions plus ponctuelles, en prévoyant un mode de consultation spécifique sur la question du nom de la commune nouvelle, en organisant la transition des trois syndicats d’agglomération nouvelle subsistant en grande couronne francilienne, en constatant, enfin, que l’assouplissement du dispositif de lissage des taux d’imposition avait d’ores et déjà fait l’objet d’une disposition intégrée dans la dernière loi de finances.
Mesdames, messieurs, ce texte ne constitue pas une révolution mais une véritable avancée pour faire de la commune nouvelle un cadre d’évolution de nos communes. Il s’agit, avec cette proposition de loi, de renforcer les communes dans le cadre d’une intercommunalité appelée à grossir, et sans perte d’identité, puisque les communes historiques restent des communes déléguées.
Il appartiendra désormais aux associations d’élus et aux services de la préfecture d’en faire la promotion nécessaire, afin que les élus municipaux s’en saisissent et décident, avant le 31 décembre 2015, de franchir le pas pour moderniser la commune, qui est et doit rester notre plus forte institution territoriale.
Permettez-moi enfin de remercier très sincèrement les services de la commission des lois ainsi que ceux de la direction générale des collectivités locales.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et UMP.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale.
Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les députés, votre assemblée examine ce soir les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative aux communes nouvelles.
Votre rapporteur ayant exposé à l’instant, très précisément, le contenu du texte, je me contenterai d’en rappeler l’ambition en le resituant dans la réforme territoriale que nous avons engagée.
Cette réforme, vous le savez, poursuit trois objectifs : la clarté, la compétitivité et la proximité. La clarté, tout d’abord, est nécessaire pour simplifier et rendre plus lisible l’organisation territoriale de notre pays. Plus lisible par les citoyens, bien sûr, mais aussi par les élus locaux, dont l’action est trop souvent freinée par l’empilement des structures territoriales et l’enchevêtrement de leurs compétences.
Le deuxième objectif de notre réforme, c’est la compétitivité des régions, qui assumeront demain des compétences importantes et cohérentes, leur permettant de devenir de vrais moteurs de croissance économique.
Enfin, le troisième objectif de notre réforme, c’est l’efficacité – celle des collectivités locales et de leurs services publics. Or, cette efficacité passe par la proximité.
Pour atteindre cet objectif, l’intercommunalité doit monter en puissance. Le regroupement des communes doit donc s’amplifier, s’approfondir, de sorte, notamment, que la taille des communautés de communes corresponde davantage qu’aujourd’hui aux réalités de la vie de nos concitoyens.
Cela étant, les communes vont demeurer l’échelon démocratique auquel chaque Français, nous le savons, reste très attaché. Cela ne s’explique pas seulement par le fait que, comme l’a rappelé Mme Pires Beaune à l’instant, elles plongent leurs racines dans notre histoire, depuis l’Ancien Régime, avec les paroisses, jusqu’à la IIIe République et la loi de 1884, en passant, bien sûr, par la Révolution française. Cela est également dû au fait que les élus municipaux constituent des repères essentiels, parfois les derniers de notre vie collective.
Or, nous le savons, plus de la moitié de nos communes ont moins de 500 habitants, 86 % moins de 2 000 habitants, 92 % moins de 3 500 habitants, et 97 % moins de 10 000 habitants. Comment pourraient-elles alors relever les défis nombreux que pose la gestion des services de la vie quotidienne, y compris dans les petites communes où nos concitoyens sont, on le sait tous, de plus en plus exigeants ?
Depuis la loi de 2010, les fusions de communes ont été remises à l’ordre du jour, mais le succès escompté n’a pas été au rendez-vous. Le Gouvernement a donc soutenu les initiatives convergentes de Jacques Pélissard et de Christine Pires Beaune pour rendre le régime de la commune nouvelle plus attractif. Et cet essor des communes nouvelles que nous souhaitons impulser avec vous n’est pas contradictoire avec le développement et l’agrandissement des intercommunalités, au contraire ; il permettra de concilier l’extension nécessaire des périmètres intercommunaux avec la proximité irremplaçable qu’offre l’échelon communal, a fortiori si ce dernier est renforcé par le texte sur lequel vous allez vous prononcer.
En effet, les communes nouvelles, là où elles existent, ont déjà permis de rationaliser le fonctionnement communal, de mutualiser les dépenses, de développer les services et en plus, souvent, d’endiguer la hausse de la fiscalité locale, voire même d’amorcer une diminution des impôts locaux.
Pour encourager les maires – nombreux, il est vrai – qui hésitent encore mais qui sont prêts à s’engager dans cette voie, il faut leur dire qu’en unissant leur commune à sa ou à ses voisines, ils ne la feront pas disparaître ; ils lui donneront une vie nouvelle et chacun d’entre eux restera dans l’histoire de sa commune d’origine comme celui qui lui aura fait épouser son siècle.
Cette proposition de loi est un texte d’avenir qui va permettre aux communes de France d’assurer plus que jamais la solidité de notre édifice républicain. C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, mesdames, messieurs les députés, madame Pires Beaune, monsieur Pélissard, je vous remercie de voter ce texte, qui fera date dans l’histoire de notre démocratie locale.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteure, mes chers collègues, avec 36 700 communes, la France rassemble à elle seule – M. le secrétaire d’État l’a rappelé – 40 % des communes de l’Union européenne. Plus de 30 000 de nos communes sont ainsi peuplées de moins de 2 000 habitants.
Cette « fragmentation du paysage français », comme l’ont dénommée récemment d’illustres collègues, constitue pourtant une richesse pour notre pays, même si nous avons bien conscience de ses défauts. Héritées de 225 ans d’histoire, les communes sont plus que de simples collectivités territoriales, monsieur le secrétaire d’État, et vous l’avez très bien exprimé. Elles forment une part de notre identité ; elles sont une spécificité française, avec ses avantages et ses inconvénients.
Indéniablement, pour répondre à l’exigence de proximité, l’échelon communal mérite d’être préservé, et il doit l’être. Porteur d’une authenticité et d’une sincérité que d’autres échelons, tel l’échelon intercommunal, n’ont plus, il doit assumer des missions de proximité dans le cadre d’une montée en puissance progressive de l’intercommunalité.
Pour autant, ce phénomène d’émiettement communal a un coût non négligeable, qui a été dénoncé à plusieurs reprises par la Cour des comptes, avec le prisme qui est le sien. Il est vrai que pour les acteurs politiques que nous sommes, cette organisation communale peut parfois s’avérer inadaptée à la conduite de politiques publiques puissantes, stratégiques et efficaces.
Ainsi que vous l’avez rappelé, madame la rapporteure, un certain nombre de dispositions ont été prises sous la Ve République, notamment la loi Marcellin, et des améliorations ont été apportées ; je n’y reviendrai pas. Toutefois, en dépit de ces réformes, le dispositif de fusion des communes n’a connu jusqu’à présent qu’un succès modeste : en quatre ans, seules treize communes nouvelles, regroupant au total trente-cinq communes, ont vu le jour.
Ce dispositif constitue un potentiel outil d’avenir pour préserver et défendre l’échelon communal. Il présente quelques avantages. Tout d’abord, il permet de tendre vers une meilleure efficacité et une meilleure efficience des dépenses publiques, en regroupant des moyens financiers, humains, intellectuels ou immobiliers tout en sauvegardant les identités communales, auxquelles nous sommes très attachés. Ensuite, il répond aux difficultés rencontrées par les petites communes mitoyennes, que nous connaissons bien. Il permet également de libérer les maires délégués des nouvelles communes des contraintes administratives, les rendant ainsi plus disponibles pour recevoir les administrés et gérer les projets communaux. Enfin, il donne la possibilité à nos communes rurales de peser davantage à l’échelon intercommunal.
Ce dernier point est essentiel au moment où nous discutons du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République – dit NOTRe – qui, par la révision du seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale, devrait imposer la constitution de très grandes intercommunalités au détriment des petites communes. Ma collègue Françoise Descamps-Crosnier le sait bien : dans la vallée de la Seine, nous sommes contraints de créer une intercommunalité de 400 000 habitants qui aura 35 kilomètres d’envergure ; cette dimension peut vous paraître peu importante, monsieur le secrétaire d’État, mais c’est une procédure compliquée pour un certain nombre de maires, et on peut le comprendre.
En dehors de ce volet de la réforme territoriale qui, comme vous le savez, monsieur le secrétaire d’État, passe assez mal, cette proposition de loi intervient alors que les dotations budgétaires ont baissé de 27 % sur trois ans, ce qui est considérable, et également mal accepté. On ne pouvait pas imaginer qu’un gouvernement ferait cela un jour, mais vous l’avez fait. De ce fait, de nombreuses communes, petites ou moins petites, ne disposent plus des moyens leur permettant d’assurer la gestion de leur collectivité.
À ce titre, si on est de bonne volonté – et nous le sommes tous –, la présente proposition de loi constitue une innovation plutôt intéressante. Fondée sur une démarche volontaire, elle privilégie, contrairement à d’autres réformes, monsieur le secrétaire d’État, la souplesse et préserve l’identité des territoires. Concernant les territoires, elle est totalement en accord avec la philosophie du groupe UDI : nous devons avant tout favoriser la mise en oeuvre de réponses différenciées et adaptées aux réalités de chaque territoire.
Par ailleurs, cette proposition de loi permet de clarifier certains points relatifs aux communes nouvelles, comme l’a très bien expliqué la rapporteure. Elle tend en particulier à améliorer leur gouvernance ; conditions de composition du conseil municipal, statut des maires délégués, création de communes déléguées, ainsi que de communes interrégionales ou interdépartementales. En outre, la création d’une commune nouvelle est intégrée dans la carte intercommunale.
Si le groupe UDI approuve cette proposition de loi, il estime cependant que nous ne devons pas, et la rapporteure l’a souligné, en surestimer les effets. Son principal objectif est d’améliorer l’attractivité du régime de la commune nouvelle en renouant avec un mouvement de rapprochement des communes existantes, sur la base du volontariat.
Alors que la création de communes nouvelles n’a eu que peu de succès par le passé, le dispositif proposé rendra cette possibilité plus attractive. Ces seules mesures seront-elles cependant suffisantes pour remédier à l’émiettement communal qui caractérise notre organisation territoriale ? On peut légitimement s’interroger sur la pertinence de la multiplication des échelons locaux et la mise en avant de deux systèmes de simplification du maillage territorial au niveau local ; la commune nouvelle et l’intercommunalité. Vous me répondrez sans doute que ces deux systèmes peuvent coexister, monsieur le secrétaire d’État. Une fois que le schéma intercommunal élaboré à la hussarde aura pris forme sur notre territoire après 2017, que toutes les intercommunalités auront été créées, le Gouvernement, quel qu’il soit, ne proposera pas aux élus intercommunaux de les transformer en communes nouvelles. Cette question pourra être débattue à une autre occasion.
Il est vrai que cette mutualisation est difficile, complexe pour les élus, en particulier ceux qui en sont à leur premier mandat, car la réforme territoriale leur confisque un certain nombre de compétences.
Vous affirmez, monsieur le secrétaire d’État, que ces rapprochements permettront d’endiguer la hausse des impôts locaux ; je prie pour que vous ayez raison, car cette imposition est certainement la plus lourde de toutes pour les Français aujourd’hui.
Quant à la clarté de la réforme territoriale, elle n’est pas évidente, alors même qu’un scrutin local doit avoir lieu dans quelques semaines : il est compliqué pour les Français de savoir quelles seront les compétences de telle ou telle collectivité, en particulier des conseils départementaux, et les élus peinent à l’expliquer sur le terrain.
Mes chers collègues, le groupe UDI milite avant tout pour une réforme territoriale d’envergure, qui touche également la sphère d’intervention de l’État. Or le Gouvernement est assez peu éclairant sur la nouvelle organisation de l’État à l’échelon local qui découle notamment de la grande réforme régionale. Nous souhaitons également que ce projet inclue une réforme en profondeur de la fiscalité locale des bases, mais celle-ci avance, bien que discrètement ; j’imagine que vous vous préoccupez comme moi de ce que l’administration fiscale locale fait en ce moment à ce sujet.
Si ce texte prévoit des modifications à la marge, nous considérons cependant que, dans l’ensemble, il va dans le bon sens. C’est la raison pour laquelle nous le voterons.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP, ainsi que sur quelques bancs du groupe SRC et sur les bancs du groupe écologiste.

Permettez-moi de remercier tout d’abord nos collègues socialistes à l’origine de la proposition de loi, ainsi que notre collègue Jacques Pélissard, dont je veux saluer le travail et l’état d’esprit avec lequel il l’a accompli en tant que président de l’Association des maires de France.
La commission mixte paritaire est parvenue, le 27 janvier, à un accord, et c’est heureux. C’est également tout à votre honneur, madame la rapporteure Christine Pires Beaune. Le fait est si peu courant que nous pouvons nous en féliciter, avec l’espoir que cela puisse se renouveler, au-delà de nos différences, le plus souvent possible.
Les deux assemblées parlementaires partageaient l’objectif poursuivi par les auteurs de ces textes – favoriser la création de communes nouvelles – et le pacte financier entériné par les deux chambres – maintien pendant trois ans, ce qui n’est pas mince, des dotations budgétaires précédemment perçues par les communes nouvelles regroupant moins de 10 000 habitants ou créées à partir d’un EPCI à fiscalité propre – devrait susciter la création de ces communes, du moins je l’espère car, ne le nions pas, cette incitation est réellement un argument fort.
Les conséquences, notamment en termes d’intercommunalités, en particulier l’évolution des syndicats d’agglomération nouvelle en commune nouvelle ou en communauté d’agglomération, ont été réglées et la consultation des conseils municipaux intéressés a été confortée. En effet, le renforcement de l’intégration des anciennes communes est une condition de l’attractivité du nouveau régime juridique des communes nouvelles. Seules 12 communes nouvelles auront été créées depuis le nouveau régime né de la loi du 16 décembre 2010, pour un regroupement de 53 communes comptant une population totale de 43 640 habitants. Le bilan est maigre.
L’assouplissement des modalités de composition du conseil municipal de la commune nouvelle, la création d’une conférence des maires – c’est un point important –, le statut du maire de la commune nouvelle et des maires délégués, la rationalisation de la création des communes nouvelles vont dans la bonne direction, tout comme l’intégration fiscale progressive. Je note que l’article 4 bis a assoupli le dispositif de modification des limites territoriales des départements ou régions d’implantation des anciennes communes fusionnées situées dans des départements différents, ce qui illustre la nécessité de ne plus raisonner à frontières administratives inchangées si l’on veut véritablement aboutir à une réforme territoriale cohérente et efficace. Au-delà des frontières, la prise en compte des bassins de vie est indispensable pour mieux répondre aux attentes de la vie quotidienne de nos habitants.

Nous aurons, mes chers collègues, l’occasion de revenir sur cette question dans quelque temps ; elle me tient tant à coeur. Je fais bien évidemment allusion à la carte des régions et au débat sur le droit d’option, mesure que nous souhaitons voir assouplir et dont nous discuterons dans peu de temps. Puissions-nous là aussi trouver un accord !
Je rappelle également que députés et sénateurs ont insisté sur la nécessité de conforter l’institution communale, « cellule de base de la démocratie de proximité », même si celle-ci, dans nos communes rurales comme ailleurs, est bien malmenée aujourd’hui. Surtout, l’institution communale est un horizon indépassable du maillage territorial. Le présent qu’il nous est proposé d’approuver – les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste le feront – vise à renforcer l’échelon communal en préservant son identité, en lui donnant, là où le besoin s’en fait sentir, les moyens de financer des projets à son niveau et d’assurer un fonctionnement régulier et efficace des services publics locaux.
Les leçons de l’échec des procédures de fusion nées de la loi Marcellin de 1971 semblent avoir été tirées. Il n’est plus question ici de mariages forcés, lesquels se sont terminés par des divorces, comme cela a été le cas dans ma circonscription. Ainsi, ce dispositif de la commune nouvelle s’appuie sur la seule décision des conseils municipaux des communes, et je tiens à saluer cet élément, très important à mes yeux.
Les autres pays européens, on nous le rappelle souvent, et cela a été dit voilà quelques instants, ont réussi une réforme communale profonde par une diminution souvent drastique du nombre de communes, alors que la France compte toujours plus de 36 700 collectivités locales de base, dont 86 % ont moins de 2 000 habitants. Soulignons que le régime des collectivités de base n’est pas le même partout en Europe, et que l’attachement à la commune, qui peut être un village de quelques habitants en France, est historiquement très fort dans notre pays. C’est le cas en particulier dans ma circonscription qui, je le rappelle, compte 236 communes, dont la commune de Tannières, laquelle, avec ses 14 habitants, monsieur le secrétaire d’État, a une identité bien marquée et ne manque pas de particularités.
Si la famille constitue encore la cellule de base de notre société, la commune demeure l’échelon premier de notre démocratie. En facilitant le lien direct entre mandant et mandataire, la commune rend la démocratie « réelle », au sens propre.
Cependant, une collectivité reste « réelle » tant qu’elle vit ! Il n’y a souvent pas d’alternative à l’association et la coopération, pour que les collectivités puissent continuer à vivre et assurer les missions qui sont les leurs. C’est pour cette raison qu’en période de disette budgétaire, le régime de la commune nouvelle rénové, tel qu’il nous est proposé, doit être soutenu.
D’autant plus que cela restera de la volonté et du choix des élus locaux. Au-delà des aspects budgétaires, c’est cet élément qui est déterminant. Si cette proposition de loi, madame la rapporteure, ne constitue pas une révolution, elle ne comporte aucune disposition contraignante ou obligatoire, ce qui est un fait novateur dans l’élaboration des textes de loi ! Elle prévoit cependant des incitations financières, pour mieux faire vivre la commune nouvelle, tout en maintenant l’ensemble des communes, grâce au concept de communes déléguées. La commune nouvelle sera respectueuse de la décision des élus ; ainsi conçue, elle pourrait être une amélioration pour l’ensemble et apporter un mieux à chacune des communes.
En ces temps difficiles pour tous, plus que jamais, « Il se faut s’entraider, c’est la loi de la nature », comme l’écrivait Jean de La Fontaine, dans la fable L’Âne et le Chien. Ainsi, nos communes rurales pourront, si elles le décident, instiller encore plus de solidarité et de proximité entre elles.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteure, mes chers collègues, les Français éprouvent un fort attachement – qui parfois frise l’excès – à la commune, lieu de la démocratie locale. De fait, les maires sont les plus appréciés du personnel politique ! Nous ne sommes pas là pour supprimer les communes ou les forcer à se regrouper, mais pour prendre en compte certaines évolutions. C’est là que réside l’intérêt de cette proposition de loi.
Les communes françaises sont nombreuses – elles représentent 40 % des communes de l’Union européenne – et petites – 85 % d’entre elles rassemblent moins de 2 000 habitants. Il en résulte un émiettement des moyens financiers. Un certain nombre de maires se plaignent de ne pas avoir les moyens de leur politique et de voir, finalement, tout passer par l’intercommunalité. Il est vrai que 80 % des investissements du bloc communal sont réalisés au niveau des intercommunalités. Les maires des petites communes, ou du moins une grande partie des conseillers municipaux, ne sont pas payés et travaillent gracieusement pour la collectivité. Malgré toute l’efficacité de leur travail, ils s’aperçoivent que la mutualisation est nécessaire.
La même évolution s’est produite chez nos voisins européens, de façon toutefois plus rapide et, parfois, autoritaire. En Belgique, au Danemark ou en Allemagne, la loi a fixé à 5 000 habitants le seuil plancher d’une commune.
Le législateur a pris acte des lois existantes. La loi Marcellin prévoyait une procédure par trop complexe, à rebours de la simplicité nécessaire dans ce domaine. Notez qu’il en va de même pour les départements : la procédure était bien trop compliquée pour que les deux départements alsaciens parviennent à fusionner ; un grain de sable a suffi pour empêcher la machine d’aller jusqu’au bout.
La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, quant à elle, a institué un nouveau régime permettant la création d’une commune nouvelle en lieu et place d’anciennes communes, sur la base d’un consensus local exprimé par les conseils municipaux ou à travers une consultation référendaire. Mais le bilan de cette loi est très maigre, puisque seules 13 communes nouvelles, regroupant 35 communes au total, ont vu le jour. Autant dire qu’avec nos 36000 communes, il reste de la marge…
D’un caractère peu autoritaire, je ne suis pas favorable à des mesures coercitives. Mais bien que plusieurs dispositifs incitatifs, y compris sur le plan financier, soient prévus, je ne suis pas certain qu’ils suffisent à amener un grand nombre de communes à se fédérer et à former une nouvelle commune. Je note les grandes précautions qui ont été prises et m’étonne qu’un seuil minimum n’ait pas été établi, alors que certaines communes comptent seulement trente, vingt, voire six habitants. Est-ce bien raisonnable ? J’avais fait en commission des lois un parallèle avec le projet de loi relatif à la délimitation des régions, dans lequel on n’a pas hésité à fusionner certaines régions de force, voire à en découper une pour en créer une autre. Je constate que la considération que l’on porte aux collectivités locales peut changer selon leur niveau. Vous me pardonnerez ce trait d’ironie.
Dans le contexte de la montée en puissance des intercommunalités, et même si le projet de loi NOTRe prévoit un certain nombre d’aménagements, le seuil de 20 000 habitants devrait s’imposer pour les EPCI dans la plupart des départements. Dans ma circonscription, des EPCI atteignent tout juste 6 000 habitants. Certains d’entre eux se demandent donc s’il ne serait pas préférable de créer une commune nouvelle, de façon à entrer dans un EPCI plus large, mais avec leurs spécificités et en gardant un certain poids démographique et financier. La réflexion est en cours dans certaines communes, et je ne sais pas encore si ce phénomène gagnera en importance.
Au passage, lorsqu’un EPCI est important – certains EPCI ruraux comptent jusqu’à 60 000 habitants –, les différents maires ne peuvent plus figurer dans l’exécutif. Certains ont donc pris l’initiative de constituer un conseil des maires, qui se réunit avant le conseil communautaire. Ne conviendrait-il pas d’institutionnaliser un fonctionnement de ce type ?
Notre groupe revendique qu’il soit fait une distinction entre les territoires et la population, ce qui existe dans beaucoup d’autres pays et fonctionne plutôt bien. On aurait pu imaginer les EPCI avec une réunion des maires d’un côté et une réunion des délégués élus au suffrage universel de l’autre, ce qui permettait d’instaurer une élection au suffrage universel dans les EPCI – niveau où se fait aujourd’hui l’investissement public. Il serait assez logique, et démocratique, que les électeurs votent directement pour des élus communautaires, qui portent un projet communautaire.
En commission, j’ai soulevé le problème des intercommunalités qui se situent à cheval sur plusieurs départements ou régions, comportant des communes souhaitant fusionner. C’est le cas de la communauté de communes du pays de Redon, à cheval sur l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique, et sur deux régions programmes, les Pays de la Loire et la Bretagne. Jean-René Marsac, Yves Daniel et moi-même avons tenté d’y remédier en première lecture, avant de constater que cette problématique semblait présenter trop de complexité à la rapporteure et au Gouvernement.
Il n’y a pourtant pas de raison objective à ne pas reconnaître de commune nouvelle dans un contexte géographique interdépartemental ou interrégional. L’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales exige pour ce faire une modification des limites territoriales des départements ou régions concernés, après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Cette disposition est tout de même très contraignante ! Néanmoins, un amendement de notre collègue Jacques Pélissard, que je salue, adopté en première lecture, prévoit en lieu et place d’un accord préalable, l’absence d’opposition motivée. Cela constitue une avancée, utilement améliorée par les amendements de la rapporteure.
Par ailleurs, un amendement au projet de loi NOTRe adopté la semaine dernière en commission des lois prévoit, à titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans, un assouplissement des seuils de constitution des communautés d’agglomération. Il permettra, dans le cas précis du pays de Redon, une mutualisation plus importante des compétences.
Un point de désaccord subsiste, puisqu’il est prévu que la loi littoral ne s’applique qu’au territoire des anciennes communes considérées comme communes littorales. Soucieux de préserver les côtes et l’environnement, nous aurions préféré une application plus large, car cette disposition pourrait permettre de passer outre la loi littoral.
Nous estimons que cette proposition de loi n’aura qu’une portée limitée, mais nous espérons être contredits par les faits. Nous ne voyons pas de raison de ne pas la voter.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteure, mes chers collègues, mon propos sera très bref, car, comme notre groupe l’a indiqué dès la première lecture, nous ne partageons pas la philosophie du texte en discussion, qui s’inscrit dans la lignée de la réforme territoriale de 2010. Au risque de vous décevoir, madame la rapporteure, notre groupe ne participe pas du consensus sur le texte issu de la CMP – ce qui n’enlève rien, évidemment, à la qualité de votre rapport.
Dans le contexte de baisse brutale des dotations budgétaires – 27 % sur trois ans – et d’élargissement des intercommunalités prévu par le projet de loi NOTRe, qui sera examiné en séance publique à partir de la semaine prochaine, assouplir les dispositions en vigueur afin de favoriser les fusions de communes ne constitue pas une avancée à nos yeux.
Nous réfutons la logique de ces textes qui anticipent en quelque sorte la demande de l’État, en tentant de réduire le nombre de communes – une logique de repli, qui s’inscrit dans le processus d’affaiblissement, voire de disparition à terme, de la commune.
Le raisonnement est clair : les communes rurales, économiquement fragilisées, n’auront guère le choix de procéder autrement face à ce que M. Pélissard a nommé les « assauts » de l’État contre les finances locales. Alors que le Gouvernement s’apprête à tailler dans la délégation globale de fonctionnement, le pacte de stabilité proposé aux communes nouvelles pendant trois ans constitue, davantage qu’une incitation financière, un risque d’intégration forcée des petites communes.
En effet, les nouvelles dispositions fiscales et incitations financières visant à encourager le processus de fusion ne garantissent nullement le maintien des dotations au-delà de la période transitoire et conduiront mécaniquement à la baisse de la dotation des communes qui n’enclenchent pas de processus de fusion. Plus le succès de la commune nouvelle sera grand, plus la dotation des autres collectivités diminuera, puisque le montant de l’enveloppe globale ne changera pas. À l’évidence, cela ne peut qu’accroître les inégalités territoriales, éloigner les centres décisionnels des citoyens et affaiblir le lien que ceux-ci entretiennent avec la commune.
Personne ne s’étonnera que, pour notre part, nous continuions à considérer que le fait de disposer de plus de 36 000 communes et d’un réseau de 500 000 élus locaux couvrant l’ensemble du territoire est un atout essentiel pour la République et pour la démocratie. Notre attachement à la commune est absolument indéfectible, même si nous sommes naturellement conscients des difficultés que connaissent de nombreuses communes de petite taille, aux capacités financières limitées, pour répondre aux attentes des citoyens et assumer pleinement leurs compétences. La seule réponse possible nous semble à cet égard devoir passer par une coopération volontaire et utile dans le cadre d’une intercommunalité de projet, par une audacieuse réforme de la fiscalité locale et par un approfondissement toujours plus important de la démocratie.
Vous l’aurez donc compris, les députés du Front de gauche voteront résolument contre ce texte !

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteure, chers collègues, je vais tâcher de redonner le moral à M. Dolez, qui me semble fort abattu et d’un caractère quelque peu réactionnaire – vous ne prendrez pas mal ce terme, cher collègue –, arc-bouté qu’il est sur des certitudes anciennes.

Je lui rappelle simplement qu’il s’agit d’une démarche volontaire, que les maires pourront s’approprier pour répondre aux préoccupations des territoires sur lesquels ils exercent leur mission.
Évoquer ce texte, c’est aborder de manière directe et indirecte les problématiques de décentralisation, d’aménagement du territoire et de ruralité ; c’est prendre en compte la diversité ; c’est avoir toujours à l’esprit les déséquilibres et les fractures qui existent entre les territoires qui s’en sortent et ceux qui font face à certaines difficultés. Je pense en particulier aux territoires hyperruraux où l’enclavement et la faiblesse de certaines infrastructures sont des freins au développement économique. Je pense également aux territoires périurbains, qui sont frappés par la désindustrialisation et le chômage.
Évoquer ce texte, c’est reprendre une nouvelle fois l’étude du mille-feuille administratif de notre pays. C’est aussi constater qu’aujourd’hui, c’est dans les métropoles que se bâtit la croissance de demain. C’est pourquoi – disons-le d’emblée – les métropoles devront être solidaires des territoires, tant il est vrai qu’elles rayonnent et attirent, et que les richesses qu’elles créent devront être partagées. Il appartiendra aux régions de jouer ce rôle de péréquation. En effet, aux côtés de ces grandes métropoles, il faudra des régions fortes pour renforcer la cohésion territoriale.
Dans cette nouvelle organisation du territoire, le Gouvernement a également choisi – comme cela vient d’être dit – de renforcer les intercommunalités, car c’est à cet échelon que pourront être menées des politiques publiques de proximité efficaces. Ces intercommunalités devront avoir les moyens de répondre aux attentes des habitants en matière de services publics du quotidien à l’échelle d’un bassin de vie et d’un bassin d’emploi cohérent, souvent au-delà des limites ancestrales des départements.
Plaider en faveur d’intercommunalités fortes, cependant, ne revient nullement à remettre en cause les communes, bien au contraire.

Dans le nouveau système territorial qui s’esquisse, elles demeureront le seul échelon à disposer de la clause générale de compétences. Pour mener à bien le troisième acte de la décentralisation, il faudra donc des communes partenaires des intercommunalités.
Depuis la loi du 2 mars 1982, déjà ancienne, toutes nos communes, qu’elles aient 20 habitants ou qu’elles en aient 200 000, disposent des mêmes compétences. Cependant, nous savons bien que les petites communes n’ont pas les moyens humains, techniques et financiers leur permettant de s’investir de leurs missions essentielles et de les assumer.
Comme d’autres, je rappelle que la France regroupe près de 40 % des communes de l’Union européenne, et 90 % de ses 36 000 communes comptent moins de 2 000 habitants.
Au fil de notre histoire, les pouvoirs publics ont tenté en vain de remédier à cet émiettement communal. Après le bilan très modeste de la loi du 16 juillet 1971, dite loi Marcellin, sur le régime de fusion des communes, la loi du 16 décembre 2010 instituant les communes nouvelles a entraîné la création de dix-huit communes nouvelles seulement – certains disent dix-neuf, d’autres treize.

Quoi qu’il en soit, le constat de l’insuffisance de cette réforme est manifeste.
On peut donc se féliciter des dispositions de la présente proposition de loi, qui visent à assouplir le dispositif actuel en renforçant – cela me semble important – les incitations financières.
Ce texte prévoit notamment de mieux prendre en compte les mandats préexistants pendant le régime transitoire, et de renforcer l’intégration des anciennes communes par les dispositions suivantes : meilleure articulation des fonctions, création d’une conférence des maires, rationalisation de la création des communes déléguées ou encore organisation du choix du nom de la nouvelle commune. D’autre part, le texte simplifie la procédure de mise en place d’une commune nouvelle couvrant plusieurs départements, comme vient de l’indiquer M. Molac ; il prend en compte les spécificités urbanistiques des communes déléguées, rattache les communes nouvelles à un établissement public intercommunal de fiscalité propre et, surtout, garantit transitoirement leurs ressources budgétaires.
Cette proposition de loi permettra donc de créer les outils nécessaires pour que les élus, notamment les élus ruraux, puissent – car c’est là le point le plus important – construire par eux-mêmes le développement de leur territoire et de leur commune nouvelle.
Chers collègues, lorsqu’il est question des territoires ruraux, refusons toute approche résignée et cessons d’opposer la France des métropoles et la France rurale, la France des grandes villes et celle des petites villes, car nous avons besoin des deux.
Cependant, nous constatons tous dans nos départements que les petites communes ne peuvent aujourd’hui plus agir seules. L’articulation essentielle entre les blocs communal et intercommunal doit être repensée. C’est précisément tout l’intérêt de cette proposition de loi. La véritable réforme est donc celle du bloc communal, qui est le socle de l’ensemble.
Cette proposition de loi s’inscrit dans une conception moderne de l’État. Le rôle de l’État, chers collègues, n’est pas de dire aux collectivités locales comment elles doivent fonctionner, mais de leur fournir les outils adaptés pour créer les synergies nécessaires. La commune nouvelle pourrait être – ou deviendra – l’un de ces outils essentiels qui permettent un maillage efficace de notre territoire.
Le rôle de l’État, c’est aussi le maintien de la cohésion territoriale. Or, la cohésion territoriale, c’est la solidarité financière. Il n’est pas d’ambition pour des communes sans moyens et sans prise en compte des difficultés spécifiques de certains territoires. Je rappelle que l’article 10 du texte permet la bonification de 5 % de la DGF pendant trois ans, sachant par ailleurs que la stabilité de ladite dotation est acquise. J’irai plus loin : à l’avenir, il nous appartiendra de réformer la DGF afin d’inciter plus fortement le développement des communes nouvelles et de permettre plus de justice, plus de solidarité et plus de péréquation.

Permettez-moi de conclure ainsi : vous constaterez que nos interventions, cet après-midi, ont beaucoup porté sur les communes, sur les intercommunalités, sur les régions et sur les métropoles, mais personne n’a cité les départements.

Dès lors, je me dis qu’il faudra demain, dans le cadre de l’allégement du mille-feuille administratif, envisager très sérieusement – je m’en excuse auprès de M. Dolez – la suppression des départements.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteure, chers collègues, après ces quelques interventions et suite à la conclusion positive de la commission mixte paritaire, le temps n’est plus guère aux discours, mais je veux simplement donner un coup de projecteur sur cinq points qui me paraissent importants.
Tout d’abord, ce texte est né d’une proposition de loi que j’avais rédigée parce que j’ai toujours considéré qu’il fallait un acte de foi républicaine dans les communes. C’est en effet dans les communes que s’exerce la solidarité ; les communes sont un lieu d’efficacité de la gestion publique. Surtout, la commune est le lieu de la démocratie par excellence.
Aujourd’hui, pourtant, les communes sont en situation de fragilité, monsieur le secrétaire d’État. D’une part, elles ont souvent été vidées de certaines de leurs compétences déléguées au profit d’intercommunalités. Ensuite, la dotation globale de fonctionnement connaît une diminution de l’ordre de 27 %, soit une baisse de 11 milliards d’euros entre 2013 et 2017, et une baisse cumulée de 28 milliards ; il y a là un motif de fragilité financière. Enfin, la fragilité des communes est humaine. À ma connaissance, aucun candidat ne s’est présenté lors des élections municipales de mars dernier dans 64 communes, et dans plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de communes, les listes municipales étaient incomplètes.
À mon sens, pour disposer de communes fortes, il faut donc regrouper les moyens non seulement financiers, bien entendu, mais aussi humains, afin de les doter d’une assiette démographique plus large et plus solide, et d’étoffer les équipes élues en termes tant qualitatifs que quantitatifs. Cela doit conduire à concevoir un texte renforçant le rôle de communes qui doivent s’inscrire dans de véritables intercommunalités de projets.
C’est dans ce contexte – c’est le deuxième point de mon intervention – que les propositions de loi que nous évoquons aujourd’hui ont suivi un processus d’élaboration tout à fait intéressant. La première phase fut associative et s’est déroulée dans le cadre de l’Association des maires de France. Lors de son congrès de novembre 2013, j’ai annoncé devant M. Ayrault que je soumettrais une proposition de loi à l’avis du Bureau de l’AMF en vue de renforcer les communes nouvelles. Cette décision a été intégrée à la résolution que l’Association a adoptée au terme dudit congrès.
Une fois la proposition de loi validée par le Bureau constitué en formation pluraliste, à raison d’une moitié d’élus de droite et d’une moitié d’élus de gauche, j’ai obtenu l’accord du Gouvernement – et je l’en remercie – pour faire inscrire dans la loi de finances pour 2014, comme l’a rappelé Mme la rapporteure, plusieurs dispositifs permettant de « sanctuariser » la DGF pendant trois ans.
À cette phase associative a succédé une phase parlementaire tout à la fois intéressante et réconfortante. J’ai déposé une première proposition de loi en janvier 2014 et Mme Pirès-Beaune, pourtant d’appartenance politique différente, a déposé après les élections municipales un texte très voisin. Nos deux propositions ont ensuite cheminé de concert et nous nous sommes efforcés l’un comme l’autre de parvenir à des accords sur l’ensemble des articles pour aboutir à un texte unique. C’est important, car cela montre qu’au-delà des différences politiques, nous pouvons, lorsqu’il s’agit de l’intérêt général, bâtir ensemble des textes qui sont ensuite soumis à l’approbation du Parlement tout entier.
Puis le Gouvernement a donné son accord pour déclarer l’urgence, afin d’éviter tout gaspillage d’énergie et de temps dans les navettes. Enfin, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord.
En somme, le laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la première proposition de loi et le vote d’aujourd’hui – puis celui du Sénat demain – a été relativement court. Je remercie chacune et chacun de sa participation constructive afin que nous puissions ensemble aboutir à un résultat positif.
Troisième point : comme le montre un très bon rapport sur lequel je ne reviendrai pas, madame la rapporteure, des avancées intéressantes ont été réalisées en termes de gouvernance. Ainsi, permettre à l’ensemble des élus issus du scrutin de mars 2014 de rester en fonction jusqu’à la fin de leur mandat est une bonne démarche.
De même, le fait de permettre aux communes nouvelles de bénéficier du nombre d’élus de la strate de population immédiatement supérieure permet de lisser sur deux mandats une baisse du nombre d’élus.
Quant à la proposition que les maires délégués soient de droit adjoints de la commune nouvelle, il s’agit également d’une démarche intéressante en termes de gouvernance.
Quatrième point : le financement, sur lequel je ne reviens pas, avec la sanctuarisation de la DGF pour trois ans. En fait, pour les communes nouvelles de 1 000 à 10 000 habitants, cet apport de 5 % de DGF supplémentaire et la perpétuation de l’application du coefficient à la DGF sont un autre élément important. En un mot, des avancées intéressantes ont été réalisées en termes de gouvernance et de statut financier des collectivités nouvelles.
Dernier point : l’environnement législatif. Monsieur le secrétaire d’État, comme je le redirai dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, le chiffre de 20 000 habitants me paraît contestable. Nous ne devons pas, en effet, adopter une approche comptable ou arithmétique, mais une approche axée sur les bassins de vie, car tout dépend de la densité des territoires considérés.
Si cependant ce chiffre de 20 000 habitants était retenu, il renforcerait encore la pertinence des communes nouvelles car, dans l’espace très vaste d’une intercommunalité de 20 000 habitants, une petite commune serait marginalisée et n’aurait aucun poids.

Pour peser sur les décisions et sur la localisation des investissements, il faut en effet que les petites communes se renforcent et se regroupent, et qu’elles soient plus toniques au sein d’intercommunalités plus vastes.

Chers collègues, cette approche en termes de gouvernance et d’avantages financiers est certes intéressante, mais elle ne doit pas être la condition du passage à la commune nouvelle. Ce qui compte pour ce faire, en effet, c’est qu’il y ait une volonté de travailler ensemble et de porter ensemble des projets structurants pour le territoire, une volonté de meilleure efficacité et de meilleure rationalité de la dépense publique pour faire ensemble, comme l’observait tout à l’heure M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, davantage avec des moyens financiers qui se restreignent. C’est là un premier élément de conclusion.
En deuxième lieu, madame la rapporteure, j’ajouterai que notre texte est attendu. Pour avoir parcouru plusieurs départements, je sens en effet un frémissement de la part des élus locaux, qui veulent se regrouper, qui y pensent et qui commencent à engager des démarches de rapprochement – et demain de regroupement, de fiançailles, puis de mariage. Il faut cependant que cela aille vite, car le Sénat se détermine, me semble-t-il, le 19 ou le 20 février. J’espère donc que nous disposerons avant la fin du mois d’une loi opérationnelle.
Mon troisième et dernier élément de conclusion, monsieur le secrétaire d’État, est un fait intéressant, et même amusant : alors que, très souvent, les réformes territoriales sont portées par les gouvernements et que les associations représentatives des élus locaux – départements, régions et communes – mènent souvent un combat visant à retarder ou à démolir le projet gouvernemental, c’est un peu l’inverse qui se passe ici, car ce projet de réforme vient de la base. C’est en effet la base qui l’a conçu, l’a testé devant ces organisations représentatives et le propose. Cela prouve que, dans notre démocratie, on peut faire le pari de l’intelligence collective, qui nous permettra d’avancer plus efficacement ensemble.
Merci à chacun et chacune de sa contribution. Bien entendu, le groupe UMP votera ce texte.
Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et SRC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteure, mes chers collègues, la richesse que constitue la multitude des territoires communaux de la France est aussi une faiblesse pour l’administration de notre pays. Celui-ci comptait en effet, au 1er janvier 2014, 36 681 communes, dont 90 % comptent moins de 2 000 habitants. Cette exception territoriale française représente, à titre de comparaison, 40 % de l’ensemble des communes de l’Union européenne à vingt-huit. Il existe donc de manière indéniable un problème de rationalisation à l’échelle communale.
En France, toutes les politiques visant à la réduction du nombre des collectivités communales ont été des échecs. Ces différentes tentatives avortées s’expliquent par un attachement très fort à l’échelon de base de la pratique de la démocratie.
Pourtant, si certains voient dans la proximité un atout, elle n’est pas sans comporter des inconvénients. De fait, les plus petites communes n’ont pas les moyens de supporter les coûts liés à l’exercice de certaines de leurs compétences et leur capacité à fournir des services publics de qualité est remise en cause. Ainsi, certaines ont même rencontré des difficultés pour organiser des élections municipales en 2014. La loi du 16 décembre 2010 s’inscrirait donc dans une certaine continuité.
La création de communes nouvelles a pour objet, selon les termes de l’exposé des motifs, de substituer un nouveau dispositif de fusion de communes, plus simple, plus souple et plus incitatif que celui qui est issu de la loi de 1971. Cette création, qui reste largement fondée sur le volontariat des communes existantes, a été un échec, car une douzaine de communes nouvelles seulement ont été créées au 31 décembre 2013. La jeunesse de ce dispositif et l’impossibilité de créer une commune nouvelle l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux expliquent en partie la faiblesse quantitative de ce résultat.
La proposition de loi présentée aujourd’hui devant nous et relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle reprend la proposition no 10 du rapport Malvy-Lambert d’avril 2014, visant à encourager et à faciliter le dispositif des communes nouvelles pour faire face aux difficultés que rencontrent les plus petites de nos communes.
Cette proposition de loi offre un assouplissement des conditions de composition du conseil municipal de la commune nouvelle pendant la période transitoire, permettant jusqu’au prochain renouvellement municipal que l’ensemble des membres des anciens conseils municipaux puissent être présents dans le conseil municipal de la commune nouvelle et que chaque maire délégué soit également adjoint au maire de cette dernière, de telle sorte que l’ensemble des sensibilités et des listes présentes continueront d’être représentées.
La possibilité de création d’une « conférence municipale » permettra de faciliter le fonctionnement de la commune nouvelle en regroupant dans une même instance le maire et les maires délégués.
La possibilité pour les communes intégrant la commune nouvelle d’acquérir le statut de « commune déléguée » est simplifiée, sauf opposition renforcée du conseil municipal à la majorité des deux tiers, et non pas seulement à la majorité simple, comme précédemment. Afin de permettre plus facilement aux territoires des anciennes communes de conserver la nécessaire proximité entre les élus et la population, les anciennes communes qui composent la commune nouvelle peuvent garder le statut de commune déléguée.
La création des communes nouvelles interrégionales ou interdépartementales est également facilitée en prévoyant que les conseils départementaux et régionaux ne puissent s’opposer à leur création que par une délibération motivée.
L’existence d’un régime financier favorable aux communes nouvelles constitue un aspect très important pour l’efficacité de ce dispositif, créant un véritable pacte financier incitatif.
La principale incitation à créer une commune nouvelle contenue dans cette proposition de loi est le pacte de stabilité de la DGF pour les trois premières années suivant cette création, dès lors que cette commune compte moins de 10 000 habitants. Ainsi, toutes les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants créées avant le 1er janvier 2016 bénéficieront de l’exonération de la baisse des dotations de l’État, ce qui leur assure un montant de DGF au moins égal à la somme des montants perçus à ce titre par les anciennes communes l’année précédant la création.
Ce pacte de stabilité concernerait également les dotations de péréquation – dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation et dotation de solidarité urbaine.
Cette proposition de loi est, vous l’admettrez, mes chers collègues, assez consensuelle, tant dans le but poursuivi de simplification et d’efficience du bloc communal, que politiquement. La stratégie semble désormais être de s’appuyer sur l’essor des structures intercommunales en leur permettant de se transformer en communes nouvelles avec des incitations fiscales.
L’intérêt de cette disposition est donc indéniable.
Elle permettra à des EPCI dont les communes membres connaissent déjà les avantages qu’il y a à exercer en commun certaines de leurs compétences de mutualiser leurs moyens et de se transformer en réelles collectivités. Habituées à fonctionner au sein d’un EPCI, les communes membres pourraient être moins réticentes à une telle fusion.
Cette proposition de loi me semble être une réponse pragmatique qui permettra de remédier à ce mal français que constitue l’émiettement communal dans notre pays. Nous devrons toutefois être attentifs à l’efficacité réelle de ce dispositif.
Il nous appartient, si nous le votons – comme je l’espère et comme je vous appelle tous à le faire –, de communiquer et de promouvoir ce texte par l’intermédiaire des associations départementales des maires et les commissions départementales de coopération intercommunale. En d’autres termes, il faudra le faire savoir, afin que cette démarche puisse trouver une issue positive et se multiplier.
Mais avant tout, mes chers collègues, il faut le voter ce soir.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous arrivons au bout du processus législatif dans l’examen de cette proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.
Ancien trésorier général de l’Association des maires de France, je souhaite au préalable souligner la pugnacité et l’esprit républicain qui ont animé M. Jacques Pélissard, ancien président de l’AMF, qui avait largement débroussaillé le sujet, lors de l’examen de ce texte. Je souhaite également souligner le travail de précision réalisé par notre rapporteure, Mme Christine Pires Beaune, qui a permis d’aboutir à ce texte relativement équilibré et consensuel – il a en effet abouti en commission mixte paritaire. La connaissance des réalités de terrain, qu’ils partagent, a guidé leur réflexion de manière pragmatique.
La réforme territoriale mise en oeuvre par le gouvernement actuel est un acte majeur de cette législature et ce texte d’initiative parlementaire y participera.
Je ne détaillerai pas davantage le fait que ces « communes nouvelles » sont issues de réflexions anciennes sur le regroupement de communes, et me bornerai à rappeler le succès limité de la loi Marcellin et des réalisations de communes nouvelles depuis que ce terme est inscrit dans la loi – le chiffre a été cité.
Avec cette proposition de loi, nous souhaitons réaffirmer notre volonté de prendre en compte la diversité des territoires, en particulier des territoires ruraux, et reconnaître le rôle essentiel de la commune dans la construction d’une nouvelle organisation territoriale.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles – ou « loi MAPTAM » – du 27 janvier 2014 avait permis d’inscrire la reconnaissance du fait urbain dans notre organisation. Cette proposition de loi relative aux communes nouvelles adresse un signal fort aux territoires ruraux et à ceux qui ne s’inscrivent pas dans la logique de la loi MAPTAM.
Ce texte est donc pragmatique : il complète et améliore des dispositions préexistantes et renforce l’ensemble des réformes relatives aux collectivités territoriales engagées depuis 2012 et qui se sont jusqu’à présent concentrées sur les échelons supracommunaux.
Le texte propose de faciliter la gouvernance des communes nouvelles, assouplit les conditions de composition du conseil municipal jusqu’en 2020, donne la faculté de maintenir l’ensemble des élus issus des communes fondatrices, renforce la place des maires délégués au sein de la municipalité et crée un véritable pacte financier incitatif de stabilité de la DGF pendant trois ans. Il a également été enrichi, durant les débats, de divers amendements qui doivent permettre d’adapter la gouvernance de la commune nouvelle après 2020, de clarifier la procédure d’institution de droit des communes déléguées – sauf si les communes fondatrices y ont renoncé –, de prévoir une procédure spécifique de détermination d’un nouveau nom pour la commune nouvelle et de faciliter la création d’une commune nouvelle à cheval sur plusieurs départements ou régions – on ne sait jamais.
Plus récemment, le Gouvernement a précisé ses priorités d’emploi de la dotation d’équipement des territoires ruraux : les projets d’investissements des communes nouvelles feront partie des opérations prioritaires identifiées par le ministère de l’intérieur dès 2015. Cette annonce nous conforte dans l’esprit que nous avons souhaité insuffler dans cette proposition de loi.
Comme l’avait évoqué Mme la ministre Marylise Lebranchu, le 31 octobre dernier, ce texte fait confiance aux élus : rien n’est imposé, tout s’inscrit dans le volontariat.
La commune doit rester et restera l’échelon de proximité, de solidarité et de citoyenneté ; mais en évoluant, ce que nous lui permettons par ce texte, elle ne disparaîtra pas. Ce cadre communal rénové offrira de réelles opportunités d’organisation, de maintien de services, voire de développement de nouveaux services répondant aux besoins d’une population attachée à la commune.
J’utiliserai les quelques secondes qu’il me reste pour convaincre notre collègue Marc Dolez de nous rejoindre dans un vote qui serait alors unanime.

Je veux simplement citer l’exemple des cinq communes du canton de Sousceyrac, dans le nord du Lot, aux portes du Massif central, qui comptent 1 500 habitants et travaillent activement à la mise en place d’une commune nouvelle. C’est pourtant l’hyper ruralité telle que décrite par le sénateur Alain Bertrand dans son récent rapport : c’est la montagne mais c’est surtout – je l’avais ressenti en travaillant avec eux sur ce sujet – le besoin de travailler ensemble pour peser dans les intercommunalités de demain, qui seront évidemment plus importantes.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi, compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.
L’ensemble de la proposition de loi est adopté.

Prochaine séance, à vingt et une heures trente :
Questions sur la politique de sécurité.
La séance est levée.
La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly