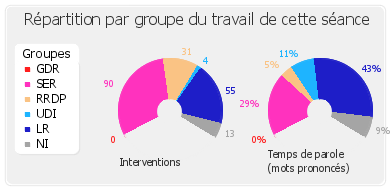Séance en hémicycle du 2 avril 2015 à 9h30
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à neuf heures trente.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution, en application de l’article 34, alinéa 1, de la Constitution, de M. Pierre Lellouche et plusieurs de ses collègues invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l’Homme, sur des questions touchant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme (no 2601).

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’entends déjà le choeur des belles âmes, les voix des « droits de l’hommistes » professionnels mêlées aux cris d’orfraie des inconditionnels de l’Europe, celle des cabris dont parlait le général de Gaulle : « Comment ! Un parti de gouvernement, comme l’UMP, qui succombe ainsi aux instincts les plus bas du souverainisme, invitant le gouvernement en place, par le biais d’une résolution déposée à l’Assemblée nationale, à revoir sa politique vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l’Homme, ce totem sacré de l’Union ? Comment ! Un ancien ministre des affaires européennes qui s’en prend frontalement à cette « conscience de l’Europe » que représente cette vénérable institution ? »
Passe encore que le Parlement britannique vote de telles résolutions, comme il l’a fait en février 2012 – par 234 voix contre 22, excusez du peu ! – contre la jurisprudence de la CEDH qui exigeait du Royaume-Uni qu’il concède le droit de vote à ses détenus emprisonnés, ce qui est pourtant interdit par la loi britannique ! Passe encore que David Cameron s’exclame en clôturant le congrès du parti conservateur : « Nous n’avons pas besoin de recevoir d’instructions des sages de Strasbourg » !
Passe encore – ou plutôt, pire encore ! – que le nouveau tsar de toutes les Russies, Vladimir Poutine,en août 2014, menace la CEDH d’un retrait de la Russie, après que la Cour a condamné le gouvernement russe à rembourser 2,6 milliards de dollars aux anciens actionnaires de la compagnie pétrolière Ioukos !
Mais la France ! La France patrie des droits de l’homme, la France pionnière de la construction européenne, la France siège de la CEDH ! Que notre France emboîte ainsi le pas aux eurosceptiques anglo-saxons et aux nostalgiques de l’URSS : voilà qui, selon nos bons esprits, témoignerait à coup sûr de la « droitisation » en marche, d’une frénésie souverainiste, ou, au minimum, d’une manoeuvre éhontée de démagogie anti-européenne !
« Et tout ça pour quoi ? », ajouteront sans doute nos procureurs. Pour proposer l’impensable : demander à la France – seule option possible aujourd’hui, au regard des textes de la Convention européenne des droits de l’homme – de dénoncer cette Convention, parce que l’on contesterait telle ou telle décision. Une démarche vaine, contre-productive pour l’image de la France – en un mot, impensable !
Je ne doute pas que ce sera l’argument que vous m’opposerez tout à l’heure. Pourtant, mes chers collègues, c’est bien à un exercice de réflexion que je voudrais vous inviter ce matin, dans l’intérêt même de notre démocratie ; une réflexion apaisée, loin de toute volonté de confrontation idéologique ; un simple appel au bon sens, fondé sur notre tradition juridique et politique, sur l’évolution de notre droit, sur la notion de souveraineté chère à tous les républicains.
Mesdames et messieurs, nous devons avoir le courage de dénoncer aux Français ce qu’il faut bien appeler une dérive inquiétante de la jurisprudence de la CEDH.

Jusqu’où sommes-nous prêts à aller dans la soumission progressive de la République à un gouvernement des juges supranational ? Peu à peu, celui-ci grignote la totalité des domaines de compétence législative de cette assemblée, au point de menacer, y compris dans les domaines qui touchent à la sécurité nationale, la capacité de la République à mener à bien les missions régaliennes qui sont les siennes, à commencer par la protection des Français contre le terrorisme.
Loin d’être sacrilèges, mes collègues du groupe UMP et moi-même avons la conviction que le moment est venu de porter un regard lucide sur ce qu’est devenue la Cour européenne des droits de l’Homme depuis sa fondation, en gardant en mémoire les traditions juridiques qui sont les nôtres. Cette cour, on le sait, est un organe juridictionnel supranational créé en 1959 par le Conseil de l’Europe pour assurer le respect des engagements souscrits au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est compétente pour traiter des recours portés contre un État membre du Conseil de l’Europe, y compris par le biais de recours individuels contre les États qui ne respecteraient pas les droits et libertés reconnus dans la Convention et ses protocoles additionnels.
Depuis un certain nombre d’années, la saisine de la Cour a dérivé vers une quasi-automaticité une fois épuisées les voies de recours internes. Alors qu’elle n’était saisie que de 5 000 requêtes en 1990, le nombre de requêtes atteignait 35 000 douze ans plus tard. Elle connaît à présent 60 000 requêtes par an, le nombre des affaires pendantes atteignant 150 000 !
La Cour est donc menacée d’asphyxie, mais son influence n’a fait que croître depuis des années, la Convention européenne des droits de l’Homme pouvant désormais être invoquée directement en France devant les tribunaux. Désormais, toute personne physique, indépendamment de sa nationalité et du lieu de sa résidence actuelle, peut saisir la Cour, dès lors qu’elle se considère comme victime directe, indirecte ou potentielle d’une violation des droits de l’homme résultant d’un État membre.
Ce droit, on va le voir, s’étend aux terroristes binationaux, voire étrangers, condamnés par des juridictions européennes, et qui ne se privent pas de saisir la Cour de Strasbourg en même temps qu’ils demandent l’asile politique pour éviter leur expulsion vers leur pays d’origine.de
Depuis l’entrée en vigueur du protocole 11, le recours individuel est en effet automatique, sans que les États membres puissent s’y opposer. Cette évolution a entraîné une jurisprudence souvent contestable et contestée dans plusieurs pays. Au fil du temps, en effet, avec la saisine directe de la Cour et l’introduction dans notre propre droit, en 2008, de la question prioritaire de constitutionnalité – la QPC –, les justiciables se tournent directement vers la CEDH.
Ainsi, la Cour a progressivement envahi tous les domaines du droit et de la société française. De la modification de leur état civil, octroyée aux transsexuels en 1992, en passant par la protection absolue des sources des journalistes, l’obligation de la présence d’un avocat dès les premiers instants d’une garde à vue, la garantie du regroupement familial et le contrôle de la politique de l’immigration en général, jusqu’à l’appréciation de l’indépendance du parquet français au regard du juge du siège – ce qui, au passage, a remis en question l’unicité de notre corps judiciaire –, la totalité, ou à peu près, de la vie quotidienne des Français relève désormais des pouvoirs des 47 juges de Strasbourg.
Cette Babel juridique décide un jour, contre l’avis du Conseil d’État, que Vincent Lambert ne doit pas mourir, interdisant même qu’il change d’hôpital. Un autre jour, elle décide du bout des lèvres que la burqa peut demeurer interdite en France dans les lieux publics, parce que la nature de la sanction prévue – 150 euros – n’est que symbolique.
La même cour s’empare du droit de la famille dans ses arrêts du 26 juin 2014, obligeant la République française à reconnaître sans délai tous les actes d’état civil effectués à l’étranger pour les enfants nés à l’étranger d’un père français et d’une mère porteuse étrangère. Ce faisant, la Cour piétine l’interdiction, pourtant d’ordre public, de la gestation pour autrui prévue à l’article 16-7 du code civil, et le principe fondamental dans notre droit de la non-marchandisation du corps humain. On notera au passage que le gouvernement français a refusé de faire appel de cette décision, alors que j’avais déposé, le 12 septembre, au nom du groupe UMP, une résolution en ce sens.
Un peu plus tard, le 2 octobre 2014, la Cour, tout en reconnaissant à la France le droit de préserver l’ordre et la discipline nécessaires aux forces armées, dont la gendarmerie nationale fait partie, a estimé que la République française devait reconnaître les syndicats de soldats. Dans la foulée, un premier syndicat a été créé au sein de la Gendarmerie nationale.

Mais là ne s’arrête pas la créativité juridique des juges de Strasbourg. S’intéressant à la fraude fiscale et à la criminalité financière, un arrêt de la Cour européenne du 4 mars 2014 – Grande Stevens et autres contre Italie – aboutit, en vertu de l’application du principe non bis in idem, à exclure pour le gouvernement – en l’espèce italien, mais demain français – le droit de poursuivre au pénal des personnes déjà condamnées par une juridiction financière.
Jusqu’à présent, la double condamnation était possible, en matière boursière notamment, le principe du cumul des actions administratives et pénales ayant été consacré par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, le dernier en date remontant au 22 janvier 2014. C’est ainsi que les juridictions françaises autorisaient le prononcé d’une sanction pénale contre un contrevenant déjà sanctionné par l’Autorité des marchés financiers, l’AMF. La plus haute juridiction française avait explicitement écarté le recours du plaignant, fondé sur le principe du non bis in idem, au motif que la France avait déposé une réserve à l’article 4 du protocole additionnel no 7. C’est précisément cette possibilité de sanctionner lourdement les fraudeurs, à la fois par des sanctions administratives et par l’application du code pénal, que la Cour européenne des droits de l’homme vient de supprimer par l’arrêt du 4 mars 2014.
On notera que, dans cet arrêt, la Cour a fait litière de la réserve déposée par l’Italie lors de la signature de la Convention, réserve quasiment identique à celle déposée par la France. Cela revient à bafouer le droit d’un État souverain de déposer une réserve, ce qui est sans précédent dans le droit international. Désormais, les moyens de la République française de lutter contre la grande criminalité financière sont considérablement réduits, tout cela au nom des droits de l’homme, ou plutôt de l’interprétation qu’en font les juges de Strasbourg.
Une telle créativité jurisprudentielle forcerait presque l’admiration ! Jean Giraudoux ne disait-il pas que « le droit est la plus puissante école de l’imagination » ? L’ennui, comme l’a souligné notre collègue Guillaume Larrivé, est que ce « progressisme juridique a accouché au fil des années d’une régression démocratique ». Une régression qui nourrit à son tour le sentiment de dépossession du destin national, de la vacuité de nos propres institutions représentatives, chargées pourtant de faire la loi ou de l’appliquer, confirmant ainsi l’image d’une Europe à la fois lointaine et tyrannique.
Ce qui est en marche, mes chers collègues – et cela mérite d’être regardé en face, avec lucidité et sans excès – n’est rien d’autre qu’un pouvoir juridictionnel supranational, dénué de tout contrepoids politique. Cette constatation n’a rien de souverainiste, puisque la notion de « gouvernement des juges » est intimement liée à l’histoire de notre tradition juridique.
En effet l’auteur de cette expression est un grand juriste français, Édouard Lambert, qui avait dénoncé dans les années 1930 les dérives de la Cour suprême américaine contre les mesures prises par le Président Roosevelt au lendemain de la crise de 1929. Le fait que cette expression soit française ne doit rien au hasard. Notre tradition, celle de Montesquieu, n’a rien à voir avec celle de laCommon law britannique. Tandis que Locke voyait dans le juge le garant des libertés, nos lois révolutionnaires sont fondées sur une conception inverse. La loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire indique que : « les juges ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Il faudra attendre 1879 pour voir le Conseil d’État transformé en organe juridictionnel susceptible de contrôler les actes administratifs restrictifs des libertés. Je passe sur l’histoire de la conception française, influencée par Carré de Malberg, mais sachez que pour le général de Gaulle, qui s’est toujours refusé à accepter la compétence de la CEDH, « en France, la seule Cour suprême, c’est le peuple français ».
Certes, le paysage juridique a changé depuis le début de la Ve République et le contrôle de constitutionnalité s’est développé, notamment depuis l’instauration de la QPC, mais prenons garde que le gouvernement des juges ne vienne obérer gravement les moyens de l’État !
Vous trouverez dans l’exposé des motifs de cette proposition de résolution une analyse détaillée de quatre décisions concernant des terroristes emprisonnés en Europe et que la Cour protège mieux que leurs victimes.
Est-il normal par exemple, que la France ait été condamnée par la Cour à verser 52 000 euros aux pirates ayant intercepté des bateaux au large de la Somalie et qui ont été capturés par des commandos français ? Est-il normal que Kamel Daoudi, franco-algérien déchu de sa nationalité française pour avoir fomenté une attaque contre l’ambassade des États-Unis à Paris, n’ait pas pu être expulsé vers son pays d’origine en raison d’un arrêt du 3 décembre 2009 selon lequel « vu le degré de son implication dans les réseaux de la mouvance de l’islamisme radical, il était raisonnable de penser que, du fait de l’intérêt qu’il pouvait représenter pour les services de sécurité algériens, M. Daoudi pouvait faire l’objet, à son arrivée en Algérie, de traitements inhumains et dégradants ». Autrement dit, plus le terroriste est dangereux, moins il peut être expulsé !
C’est sur le même raisonnement qu’elle fonde sa décision du 6 septembre 2011 concernant Djamel Beghal. Vous n’êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que celui-ci était l’émir des frères Kouachi et de Coulibaly, qu’il a reçus dans un hôtel de Murat, dans le Cantal, où il était logé aux frais de la princesse parce que la Cour européenne de justice avait refusé son expulsion alors même que nous l’avions déchu de sa nationalité française !
Que dire aussi de l’arrêt Othman contre Royaume-Uni en raison duquel un citoyen jordanien ne disposant même pas de la double nationalité et condamné pour deux actions terroristes en Jordanie n’a pas pu être expulsé de Grande-Bretagne malgré un accord entre le Royaume-Uni et la Jordanie prévoyant que la peine de mort ne lui serait pas infligée ! Malgré cet accord, la Cour a considéré qu’Othman ne pouvait pas être expulsé du Royaume-Uni.
Que dire enfin de la décision la plus récente du 7 octobre 2014 Trabelsi contre Belgique par laquelle la Belgique, après avoir poursuivi pour une série d’attentats, condamné à l’expulsion et expulsé Trabelsi, a été condamnée par la Cour pour avoir violé les mesures conservatoires interdisant son expulsion vers les États-Unis, où il était poursuivi pour d’autres faits ! De telles décisions sont franchement consternantes et se passent de tout commentaire !
Alors que de graves menaces pèsent sur la sécurité de la France et que le Gouvernement prépare un projet de loi relatif au renseignement, il est incompréhensible de laisser se développer une jurisprudence de ce genre, et d’abord au regard du droit international. Je rappelle que le Conseil de sécurité de l’ONU a voté le 24 septembre 2014 une résolution, promue par la France, invitant expressément les États à veiller à ce que le statut de réfugié ne soit pas détourné à leur profit par les auteurs, organisateurs et complices d’actes terroristes, y compris les combattants terroristes étrangers.
Cette jurisprudence est également insupportable au regard de l’équilibre des pouvoirs, fondement même de nos principes démocratiques. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme n’étant pas susceptibles de recours, les États n’ont d’autre choix que de s’incliner ou comme certains, notamment la Russie et la Turquie, de les ignorer purement et simplement. Pour les premiers, les bons élèves dont la France fait partie, la sentence de Montesquieu selon laquelle « pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » s’avère vide de sens, car il n’existe pas de telles dispositions. Quant aux seconds, ils ignorent tout simplement la Cour. Drôle de justice à deux vitesses ! Ici des terroristes sont protégés par les juges de Strasbourg, ailleurs des journalistes et des hommes politiques sont assassinés en pleine rue !
On comprendra donc que l’objectif premier de la présente résolution est d’inviter le gouvernement français à mettre fin à ces dérives inquiétantes en ouvrant un débat avec nos partenaires européens. Elle n’a pas vocation à remettre en cause les principes fondamentaux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Elle n’a pas davantage pour objectif de sous-estimer les avancées obtenues en matière de libertés publiques, comme le régime de la garde à vue ou la protection des journalistes.
Toutefois, les élus nationaux comme les citoyens qu’ils représentent ne peuvent accepter que certains juges s’arrogent le droit, au nom d’une interprétation dévoyée des droits de l’homme, d’affaiblir l’impératif de sécurité nationale. Afin de rappeler la solidité des institutions françaises, j’invite donc, au nom du groupe UMP, le Gouvernement à ouvrir des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme en vue d’en réviser la composition et les compétences et à tout le moins d’interdire les recours individuels prévus dans le cadre de l’article 34 de la Convention aux individus condamnés pour actes de terrorisme par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l’hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues, la présente résolution invite le Gouvernement français à faire savoir à ses partenaires que la France serait prête à dénoncer la Convention...

… et à la réécrire de façon à rendre impossible un gouvernement supranational des juges vidant de son sens le travail législatif des Parlements nationaux.
Je compte que notre débat ne soit pas caricatural mais serve au contraire l’intérêt de notre démocratie, qui est d’éviter une interférence excessive de juges autoproclamés vidant de son sens le consentement des peuples à la construction européenne à laquelle je suis, monsieur le secrétaire d’État, aussi attaché que vous.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est toujours difficile de trouver le juste équilibre entre le respect des droits et des libertés de chacun et la protection de la population. Cette délicate recherche du compromis est d’autant plus complexe à l’heure où notre nation traverse, au lendemain des attentats de janvier dernier, des moments particulièrement éprouvants et bouleversants. Dans ce contexte particulier, qui fait de la lutte contre la radicalisation un enjeu majeur, la présente proposition de résolution invite le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la CEDH, notamment dans des cas relevant de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme. Avant d’évoquer l’hypothèse d’une telle révision, il me semble important de rappeler le contexte de la naissance de la CEDH et sa vocation première.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, caractérisée par la barbarie et la violence, l’ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme. Nous sommes alors en 1948 et le monde émerge avec peine d’années d’atrocités pratiquement innommables. Les États prennent conscience de l’importance de reconnaître universellement les droits de l’homme. La Déclaration est un premier pas non négligeable vers le renforcement de la protection des droits de chacun au niveau international.
Par ailleurs, la Seconde Guerre mondiale a fait prendre conscience aux États européens de l’importance de créer une communauté soudée ayant pour priorité d’opposer un rempart aux idéologies les plus néfastes. En 1949, la création du Conseil de l’Europe à Londres réaffirme l’attachement de notre continent aux libertés fondamentales, racines mêmes de nos démocraties européennes. En 1950, la Convention européenne des droits de l’Homme est adoptée et la CEDH est créée en 1959 afin de veiller à son respect. Elle a vocation à constater les atteintes subies par les victimes et à leur attribuer, si elle le juge nécessaire, une réparation appropriée. Sur la base du texte de la Convention, elle garantit de nombreux droits et interdit les détentions illégales, les discriminations, l’esclavage et plus généralement toutes les formes de torture et de traitement inhumain.
Indéniablement, nous devons veiller à la préservation du rôle de protection des droits de l’homme de la CEDH. Les garde-fous que constituent les conventions que nous avons signées doivent perdurer, faute de quoi nous risquerions de répondre à la barbarie par des actes ne nous plaçant pas au-dessus de ceux qui nous attaquent.
Mes chers collègues, alors que la menace terroriste pèse sur l’Europe, la lutte contre la radicalisation est devenue l’un des enjeux les plus importants de nos démocraties. La proposition de résolution de notre collègue Pierre Lellouche s’inscrit justement dans la démarche visant à faire en sorte que les États trouvent des solutions pour progresser dans leur combat contre une menace de plus en plus importante. Depuis le début de l’année, l’Europe a été particulièrement touchée par des attentats qui ont marqué nos populations. De Paris à Copenhague, ce sont nos valeurs, celles de l’Union européenne, qui ont été attaquées !
Dans ce contexte, on peut aisément comprendre qu’une population encore traumatisée par les récents attentats soit scandalisée qu’une institution créée pour sauvegarder les droits de l’Homme protège des terroristes et qu’ainsi une personne condamnée pour terrorisme par une juridiction nationale passe pour une victime aux yeux de la Cour européenne. L’auteur de la proposition de résolution vient de rappeler les décisions par lesquelles la CEDH s’est opposée à plusieurs reprises aux jugements de juridictions nationales en interdisant aux gouvernements d’expulser certains individus vers leur pays d’origine. Citons notamment la décision du 17 janvier 2012, Othman contre Royaume-Uni, par laquelle la Cour a jugé que l’expulsion du requérant, déclaré coupable en 1999 d’organisation d’attentat, était illégale et emportait violation de la Convention malgré l’accord conclu entre le Royaume-Uni et la Jordanie.
Si le principe de protection de tout individu contre des expulsions entraînant des violences ou des comportements inhumains est primordial, la CEDH ne semble pas, dans ces cas précis, avoir pris en compte l’ensemble des éléments reprochés à l’accusé et les précautions prises par les États. Or la multiplication par trente du nombre des recours individuels en seulement quinze ans systématise une pratique qui ne devrait pas l’être. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du protocole 11, le recours individuel automatique auquel les États membres ne peuvent s’opposer semble être devenu la règle.
Cependant, protéger les personnes susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains constitue l’un des fondements de la Cour européenne des droits de l’homme. Réviser les conditions de saisine de la CEDH n’est pas une décision que l’on peut prendre à la légère. Si une réforme doit être menée, elle doit l’être après une longue réflexion, en coordination avec l’ensemble des pays européens et loin de tout affect : nous devons prendre garde de ne pas arrêter de décisions à la hâte, sous le coup de l’émotion.
À ce titre, nous émettons une réserve sur la formulation du premier alinéa de la présente proposition de résolution, selon lequel notre assemblée affirmerait « sa volonté de voir la France maîtresse de ses décisions politiques et juridiques notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ». Cette disposition ne doit pas être interprétée comme la volonté de nous soustraire au contrôle de la CEDH, indispensable à la préservation des droits de l’Homme. Nous avons souvent insisté sur la nécessité de lutter contre le terrorisme au niveau européen. C’est par la coordination avec nos voisins que nous serons réellement efficaces pour lutter contre ce fléau.
Vous le savez, mes chers collègues, les députés du groupe UDI sont profondément européens et attachés aux engagements pris par la France au niveau européen. Nous savons aussi combien il est important que notre pays mette tout en oeuvre pour lutter contre la progression du terrorisme. En ce sens, il nous semble opportun que le Gouvernement engage des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme afin de discuter des compétences et des modes de saisine de la Cour. Par conséquent, le groupe UDI votera la proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de résolution du groupe UMP « invite le Gouvernement français à entamer des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme afin de réviser la composition et les compétences de la Cour et notamment interdire les requêtes individuelles aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l’hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues, la présente résolution invite le Gouvernement français à faire savoir à ses partenaires que la France serait prête à dénoncer la Convention ». Par une telle proposition de résolution, M. Lellouche et ses collègues de l’UMP attaquent frontalement la Cour européenne des droits de l’Homme de manière démagogique !
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Faire de la CEDH un bouc émissaire, c’est méconnaître le cadre général du droit européen en matière de droits de l’homme ! En effet, les principes de la convention de 1949 sont pleinement intégrés dans le droit communautaire et dans les droits nationaux.
À ses débuts, la Communauté européenne ne s’est pas vraiment souciée des droits de l’homme. Les auteurs des traités pensaient qu’en raison de leur nature économique, il n’y aurait pas d’interférence entre législation communautaire et droits de l’homme. Dès les années 1970, pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne a élaboré une jurisprudence très protectrice des droits fondamentaux. Cette évolution a été parachevée par la rédaction en 2000 de la charte des droits fondamentaux, à laquelle le traité de Lisbonne de 2009 confère une force juridique.
La construction de cet espace communautaire des droits de l’homme ne s’est pas faite en concurrence avec la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg mais dans un réel esprit de convergence. Depuis le traité de Maastricht, les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’Homme sont considérés comme des « principes généraux du droit de l’Union ». Le traité de Lisbonne est allé beaucoup plus loin en prévoyant à son article 6 que « l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». L’adhésion prochaine, nous l’espérons, de l’Union européenne à la CEDH constituera une étape primordiale de la construction de cet espace européen des droits de l’homme.
Enfin, il est faux de proclamer, comme le fait l’auteur de cette proposition de résolution, que l’Europe des droits fondamentaux se construit contre les ordres juridiques nationaux. La jurisprudence de la Cour s’appuie au contraire sur ce que le traité de Lisbonne consacre sous le nom de « traditions constitutionnelles nationales ».
Le sujet que vous mettez en exergue dans votre proposition de résolution en est une preuve éclatante : votre texte vise à « interdire les requêtes individuelles aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes ».

Cette proposition viole à la fois l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 47 de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le droit au recours n’est pas une invention de la CEDH : c’est avant tout un principe du droit français, reconnu tant par le Conseil d’État que par le Conseil constitutionnel. D’ailleurs les critiques que vous adressez aujourd’hui à la CEDH ne sont-elles pas semblables à celles qu’essuya le Conseil d’État lorsqu’en 1962, il annula la décision du général de Gaulle instituant une Cour militaire de justice chargée de juger selon une procédure spéciale et sans recours possible les auteurs et complices de certaines infractions en relation avec les événements algériens ?
En clair, la philosophie de votre texte, comme des autres textes inscrits à l’ordre du jour dans le cadre de votre niche parlementaire, joue sur la démagogie et sur les peurs, notamment sur la crainte que la France ne soit plus maîtresse chez elle, même dans le domaine de la loi.

Votre exposé des motifs invoque l’exemple de la liberté d’association des militaires, qui nous aurait été imposée par une décision la CEDH. À la suite de cette décision, une association professionnelle de gendarmes a en effet été créée pour la première fois au sein de la gendarmerie nationale. Au lieu d’y voir une avancée pour notre pays et pour notre armée, comme M. Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, pour qui il s’agit d’une « opportunité de moderniser encore plus la chaîne actuelle de concertation et de participation et de faire évoluer les modalités du dialogue interne », vous y voyez une perte de souveraineté inacceptable.

Avouez qu’il serait curieux que le pays qui se vante si souvent d’être la patrie des droits de l’homme et qui leur confère une universalité s’imposant à l’ensemble des habitants de cette planète veuille s’en exonérer lorsque ces principes sont défendus par une institution communautaire !
De même, les auteurs de la proposition de résolution estiment que les arrêts concernant des personnes condamnées pour terrorisme qu’ils citent dans l’exposé des motifs sont une illustration du caractère contestable des décisions de la Cour. Pourtant, les raisons qui justifient l’opposition de la Cour à l’expulsion vers des pays où ces personnes encourraient la torture semblent difficilement réfutables.

Dans le cas de Kamel Daoudi, la CEDH note qu’il « ressort de sources à la fois multiples, concordantes, fiables et récentes, notamment des rapports du comité des Nations Unies contre la torture, de plusieurs organisations non gouvernementales, du département d’État américain et du ministère de l’intérieur britannique, qu’en Algérie, les personnes impliquées dans des faits de terrorisme sont arrêtées et détenues par les services de sécurité de façon peu prévisible et sans base légale clairement établie, essentiellement afin d’être interrogées ou pour obtenir des renseignements et non dans un but uniquement judiciaire ». Selon les mêmes sources, « ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l’extérieur peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris la torture. Le Gouvernement n’a pas produit d’indications ou d’éléments susceptibles de réfuter ces affirmations et, de plus, la Cour nationale du droit d’asile a également considéré qu’il était raisonnable de penser que, du fait de l’intérêt qu’il peut représenter pour les services de sécurité algériens, M. Daoudi pourrait faire l’objet, à son arrivée en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants ».
Notre pays est confronté à une menace terroriste grave et la question de l’expulsion des étrangers ou des personnes déchues de la nationalité qui sont condamnés pour terrorisme est une question difficile. Néanmoins, nous ne pouvons l’évacuer en nous exonérant nous-mêmes du respect des droits de l’homme. Des solutions, parfois d’urgence, ont été trouvées ; d’autres peuvent l’être dans le respect des droits fondamentaux.

Il faut donc savoir faire preuve d’un peu d’humilité et considérer que la France peut présenter des carences dans le domaine du respect des droits de l’homme. Il est ainsi une catégorie de droits de l’homme que la France refuse obstinément de prendre en compte : celui des minorités, y compris les minorités d’origine. La France a beau s’autoproclamer pays des droits de l’homme, elle a bien du mal à en mettre certains en pratique. Le pire est qu’elle enjoint à d’autres pays de respecter leurs minorités !
Cela pourrait faire sourire – comme le fait, par exemple, que la France demande à l’État chinois d’accorder un statut officiel à la langue tibétaine tout en continuant à ne pas reconnaître ses propres langues régionales. La France ne reconnaît ni ne protège ces langues, qui ne bénéficient toujours pas d’un statut juridique ni de quelle que forme de protection que ce soit, tandis que le nombre de leurs locuteurs ne cesse de baisser d’année en année, à tel point que l’UNESCO les considère comme en danger, voire en grand danger d’extinction. Certaines personnalités politiques, et non des moindres, ainsi que les gardiens du temple de la francité que sont le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État s’opposent même à ce que la France ratifie la très anodine charte européenne des langues minoritaires : faites ce que je dis, pas ce que je fais ! Le comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’UNESCO recommande d’ailleurs régulièrement à la France de reconnaître ses minorités.
La France devrait donc faire preuve d’humilité et accepter de devoir respecter les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux de gens qui ne le méritent pas. Une justice d’exception, en vigueur dans d’autres pays et qui donne lieu à de graves dérives – je pense notamment aux États-Unis, à la tristement célèbre prison de Guantánamo et aux prisons secrètes disséminées dans le monde – n’est pas une réponse souhaitable à la menace qui pèse sur nous.

C’est précisément ce genre de justice d’exception qui met à mal les fondements de notre ordre juridique démocratique et transparent que souhaitent détruire les terroristes. Ne tombons pas dans ce piège qui consisterait à renier nos valeurs démocratiques pour mieux combattre l’absence de ces mêmes valeurs chez nos ennemis.
Au fond, vous pensez qu’il y a trop de droits fondamentaux.

Vous pensez aussi que certains êtres humains ne méritent pas d’en bénéficier, ayant, par leurs actes, perdu ce privilège. Il est évidemment impopulaire de défendre les droits des prisonniers et des terroristes. Je crois cependant, pour reprendre les mots de la CEDH elle-même, que « la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons » : le propre des droits fondamentaux est justement qu’ils sont inaliénables. Il n’y a pas, à côté de la déclaration universelle des droits de l’homme, une déclaration universelle des droits de l’homme soupçonné de terrorisme.
Voici donc pourquoi, chers collègues, tant pour des raisons juridiques que pour des raisons de fond, mon groupe parlementaire votera contre cette proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, nous sommes aujourd’hui, dans le cadre de la niche parlementaires du groupe UMP, saisis de trois textes : une proposition de résolution, un texte permettant aux forces de l’ordre de recourir à la légitime défense ; enfin un texte visant à rétablir le crime d’indignité nationale que nous présentera M. Meunier.
La parenté qui existe entre ces trois textes est évidente et je suppose que l’UMP a voulu qu’il en soit ainsi.

Autant les deux textes suivants peuvent donner lieu à débat, autant cette proposition de résolution me semble extraordinairement dangereuse.

Au fond, monsieur Lellouche, pour vous, la CEDH et l’Europe, voilà l’ennemi !

Jusqu’ici, ces cris d’orfraie, pour reprendre vos mots, étaient réservés à l’extrême-droite : on mesure la porosité qui existe désormais entre les idées souverainistes de l’extrême-droite et celles de la droite !
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

C’est tout l’État de droit que vous attaquez et que vous remettez en cause au profit de l’exception souverainiste en vous attaquant aux fondements même de l’Europe.

Globalement vous lui reprochez tout et n’importe quoi, qu’il s’agisse de la procédure ou du fond.

Si l’on vous suivait, il faudrait renoncer au procès équitable, notion qui a été développée, voire créée par la CEDH.

Ce sont en effet deux des principaux apports de la CEDH et qui, en l’espèce, nous semblent essentiels.

En somme, votre article unique affirme la volonté de la France d’être maîtresse de l’ensemble de ses décisions politiques et juridiques,…

…et ce sans aucune exception, la lutte contre le terrorisme n’étant qu’un cas particulier, comme l’indique l’emploi de l’adverbe « notamment ». Dès lors, c’est l’ensemble de la hiérarchie des normes que vous remettez en cause !
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

En vertu de la hiérarchie des normes, le juge français est tenu de respecter la norme européenne. Sou vous voulez poursuivre sur la voie du souverainisme, pourquoi ne proposez-vous pas tout bonnement le retour à la lettre de cachet ? Ce serait plus simple !
Même mouvement.

En ciblant ainsi la CEDH, c’est aux droits de l’homme que vous voulez vous attaquer.
« Mais non ! » sur les bancs du groupe UMP.

Les « droits-de-l’hommistes », voilà l’ennemi ! Or les droits de l’homme sont l’une des garanties de nos libertés ! Si votre duo avec le Front national vous conduit à renoncer à ces garanties, alors vous renoncerez à l’essentiel de ce que vous êtes vous-mêmes car, au fond, l’UMP est européenne.

Pourquoi donc cédez-vous à de telles dérives ? Vous vous attaquez à la garantie même de la défense de nos libertés, dont la défense des droits de l’homme est une condition.

A partir de là vous finirez par tout remettre en cause : vous en viendrez à contester la présomption d’innocence
« Allons ! » sur les bancs du groupe UMP.

Après avoir remis en cause la présomption d’innocence pour les terroristes, vous descendrez encore un peu plus bas et remettrez en cause tout le bloc des libertés !
Protestations sur les bancs du groupe UMP.

Vous allez finalement dégrader la justice de l’État. En matière de légitime défense, vous verrez que vous en viendrez à revendiquer la possibilité de ce que M. Guéant appelait lui-même un « droit à tuer ».
Ce qui me semble invraisemblable, c’est que vous déniiez le droit de saisir la CEDH à tout terroriste, quel que soit le motif de sa condamnation. Ainsi, un justiciable ayant participé à une organisation terroriste sans commettre d’acte de violence et sans avoir versé de sang serait moins bien traité qu’un autre qui aurait commis les actes les plus abominables !

Vous utilisez les moments terribles que nous traversons pour tenter de passer pour les plus droitiers dans une course à l’échalote avec l’extrême-droite.

Il ne faut pas oublier non plus que c’est souvent dans les affaires de terrorisme que le droit est le plus torturé et les preuves les plus bafouées.

Je me souviens des prétendus terroristes de l’affaire des Irlandais de Vincennes. Aurait-on dû leur dénier le droit de saisir la CEDH ?

Méfiez-vous, car vous vous infiltrez ici dans une brèche qui ouvrirait la voie à la remise en cause de l’ensemble de notre système juridique.

Les terroristes doivent naturellement être poursuivis et condamnés avec toute la rigueur de la loi, mais en bénéficiant des mêmes garanties juridiques que les autres.

L’État de droit impose que tous bénéficient des mêmes garanties. Renforcer l’État de droit, c’est renforcer la République. Accepter votre proposition de résolution serait porter un mauvais coup à la France et à l’Europe !
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, après MM. Molac et Tourret, je défendrai avec M. Le Borgn’ l’opposition forte et déterminée du groupe SRC à la résolution qui nous est proposée.
Cette proposition de résolution comporte un article unique, selon lequel l’Assemblée nationale -– je cite votre phraséologie – « affirme sa volonté de voir la France maîtresse de ses décisions politiques et juridiques notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme » et « invite le Gouvernement français à entamer des négociations avec les pays signataires de la convention européenne des droits de l’homme afin de réviser la composition et les compétences de la Cour, et notamment à interdire les requêtes individuelles aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l’hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues », la résolution « invite le Gouvernement français à faire savoir à ses partenaires qu’elle serait prête à dénoncer la convention ».
Cette résolution propose d’une manière assez approximative un changement pourtant fondamental.
Faut-il rappeler que la Convention européenne des droits de l’homme, signée à Rome le 3 novembre 1950, sous l’égide du Conseil de l’Europe, fut d’abord, et de façon remarquable, la première des réponses du monde libre à la barbarie et au nazisme, celui-ci considérant que c’était à l’aune de la défense des droits individuels que devaient être tracés le chemin du retour à la liberté ?
Selon les termes de l’article 19 de la Convention, « afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’Homme ». Cette juridiction internationale, qui a été créée en 1959 et dont le siège se situe à Strasbourg, a pour mission d’assurer le respect des engagements souscrits par les états signataires. La Convention confie à la Cour le soin de se prononcer à la fois sur la recevabilité des requêtes des personnes physiques ou morales se plaignant d’une violation de leurs droits essentiels et sur le fond des litiges, dans l’hypothèse où la tentative de conciliation préalable prévue par le texte aurait échoué.
La Cour est une juridiction unique et permanente, composée de juges dont le nombre est égal à celui des États parties à la Convention – 47 actuellement. Je vous rappelle que ces juges sont élus par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à partir de listes de trois noms proposées par chaque État et pour un mandat non renouvelable de neuf ans. Voilà ce dont nous parlons.
J’approuve les propos tenus par notre collègue Alain Tourret sur les circonstances dans lesquelles cette résolution a été déposée. Il a parfaitement raison de faire le parallèle avec les argumentaires utilisés par d’autres formations politiques.

Je rappelle que la construction européenne avait pour objectif l’instauration d’une paix durable en Europe et la création d’un espace européen des droits fondamentaux et des libertés, mais aussi la construction d’une vision et d’un projet de société communs à l’échelle européenne.
Nous voulons réaffirmer notre attachement au modèle de société promu par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui, faut-il le rappeler dans cet hémicycle, s’inscrit dans la continuité de la Déclaration universelle des droits de l’homme…

…déclaration elle-même inspirée par de grands citoyens français, en particulier René Cassin, prix Nobel de la Paix.

La manoeuvre qui sous-tend la présente résolution est flagrante : faire croire que la Cour est un organe juridictionnel satellite, sans ancrage démocratique et institutionnel, qui menacerait notre pays…

…ce qui nécessiterait de renégocier les conditions dans lesquelles elle est saisie.
Nous ne sommes pas dupes de cette manoeuvre. Nous répondons qu’au contraire, la Cour européenne des droits de l’Homme est d’abord l’émanation des États, de leur souveraineté…

…aussi bien quant au mode de désignation des juges, comme je viens de le rappeler, que quant à sa composition et aux conditions de sa saisine. Chaque État est représenté en son sein.

Je rappelle que ces juges sont élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
Il est un autre point que vous oubliez, alors qu’il est extrêmement important : le juge naturel des femmes et des hommes protégés par ce dispositif est leur juge national.

Vous attribuez à la Cour européenne une mission et une compétence qui ne correspond pas à la réalité, car le juge des citoyens est leur juge national !

En vertu de l’article 35 de la Convention, la Cour n’a qu’une compétence subsidiaire, sa saisine n’étant possible qu’une fois épuisées toutes les possibilités de recours internes.

En outre, les conditions de recevabilité protègent les États contre les recours fantaisistes et abusifs.

Il existe un filtre qui permet de rejeter les requêtes manifestement mal fondées.

Toute saisine de la Cour européenne exige une violation de la Convention et un préjudice important, et elle doit respecter la règle non bis in idem.
Les arrêts de la Cour ont une portée déclaratoire, la Cour ne pouvant abroger les lois des États ni annuler leurs décisions internes.

Une marge d’appréciation est laissée aux États condamnés pour qu’ils remédient à la violation constatée par la Cour.
Au vu de tous ces éléments et garanties, votre crainte que s’impose un gouvernement des juges n’est pas fondée.

Vous avez d’ailleurs beaucoup de mal à mesurer la portée symbolique de notre engagement européen. En signant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la France a manifesté son adhésion à ces valeurs et principes fondamentaux.

L’article 19 est le bras armé de la Convention européenne. Remettre en cause la Cour, c’est écorcher le sens de cette adhésion, à un moment décisif où les États doivent rester solidaires.

La jurisprudence de la Cour européenne contribue à l’harmonisation de la législation des États membres dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales : droit à la vie, à un procès équitable, à la liberté d’expression, à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et de religion. Vous croyez vraiment que nous n’avons pas besoin de cette harmonisation en ce moment…
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

C’est un renforcement du socle démocratique, en Europe mais surtout en France, que nous recherchons à travers notre adhésion à la Cour et à ses valeurs.

La Cour est le meilleur rempart contre toute aspiration régressive et réactionnaire.

Elle nous permet de partager un projet européen, des valeurs et des principes fondamentaux pour faire progresser l’État de droit et préserver la paix.

La France a plus que jamais besoin de la Cour européenne et de la Convention qui lui donnent la possibilité de s’inscrire, avec les autres États membres, dans cette grande démarche de liberté individuelle et de paix sociale.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, mes chers collègues, mes chers confrères, je m’attendais de la part de notre collègue à un discours plus juridique et moins politique. Je rappelle que la tradition française n’a pas toujours été favorable à la Cour européenne…

…puisqu’elle n’a fait paraître le décret de publication qu’en 1974, avant de reconnaître le droit au recours individuel en 1981.

Le problème vient de ce que la Cour a beaucoup changé et qu’elle va beaucoup trop loin dans l’interprétation de ses droits. Il ne s’agit pas de la supprimer : la résolution ne le demande pas et d’ailleurs nous n’avons pas la possibilité juridique de le faire. J’ai recherché moi-même un moyen d’en sortir, en vain. L’article 34 ne le permet pas. Quant à l’article 57, nous ne pouvons plus l’utiliser.

En réalité, la Cour européenne a gravement excipé de ses pouvoirs. Le protocole no 11 bis, en particulier, lui a donné des pouvoirs très supérieurs à ceux prévus par les accords de 1974 et 1981, notamment du fait d’une certaine automaticité des recours, monsieur Le Bouillonnec. Si vous plaidez de temps en temps, vous savez très bien qu’un bon avocat peut toujours, en cas de difficulté, envisager un recours devant la Cour européenne. Cela permet de gagner du temps. Actuellement 150 000 dossiers sont en instance devant la Cour ! On ne peut pas dire que sa compétence est subsidiaire, alors qu’elle est aussi encombrée, sinon plus, que la plupart des tribunaux français, sur lesquels d’ailleurs elle pose une chape de plomb – que les magistrats supportent difficilement.

Le problème de la Cour européenne va au-delà de ce problème de fonctionnement, et même au-delà du droit. J’en veux pour preuve deux exemples.
Tout d’abord, la Cour européenne s’est permis d’interpréter le droit des traités lorsque, dans un arrêt de 2014 déjà cité, elle a jugé insuffisantes les réserves déposées par l’Italie, alors que celles-ci relèvent du droit international et que la Cour n’est pas compétente pour les interpréter. La Cour s’est ainsi arrogé le droit de ne pas tenir compte de ces réserves.
Par ailleurs, dans son arrêtOthman, en dépit d’un mémorandum d’entente anglo-jordanienne affirmant que toute personne extradée serait traitée convenablement et ne serait pas soumise à des tortures, la Cour européenne a décidé de son propre chef, motu proprio, que cet accord n’avait pas lieu d’être et a refusé au Royaume-Uni la possibilité d’extrader vers la Jordanie une personne pourtant protégée par cet accord. D’où la Cour européenne de justice tient-elle le pouvoir d’interpréter un accord international signé en bonne et due forme ?
En réalité, mes chers collègues, vous savez très bien que la saisine de la Cour est devenue automatique en cas de difficulté judiciaire et lorsqu’on veut faire traîner la procédure et faire accepter des décisions tout fait contraires à notre tradition juridique.
Nous sommes en droit de nous demander, en toute conscience, pourquoi il reviendrait à la Cour européenne de réorganiser l’armée française. En a-t-elle tout simplement le droit ?
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

D’où tiendrait-elle le droit de juger de l’organisation de la famille et de la gestation pour autrui ?
Mais là où le danger est le plus grand, mes chers collègues, c’est en matière de terrorisme. Désormais en effet aucune mesure d’extradition ne sera permise à l’encontre d’un terroriste.
Que se passe-t-il en effet lorsqu’un terroriste étranger est incarcéré, si, comme c’est souvent le cas, il est originaire d’un pays qui ne respecte pas les droits de l’homme dans la même mesure que l’Europe ou l’Amérique ? Il est évident que son avocat, s’il a un peu de connaissances juridiques – il est vrai que ce n’est pas le cas de tous les avocats, nous avons pu le constater tout à l’heure…
Protestations sur les bancs du groupe SRC.

C’est peut-être méchant, mais c’est vrai. D’ailleurs c’est un débat entre confrères : vous n’avez rien à voir là-dedans !
Protestations sur les bancs du groupe SRC.

Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas ! Les problèmes juridiques sont complexes.
Désormais, mes chers collègues, nous ne pourrons extrader personne dès lors qu’il y aura un recours devant la Cour européenne, car celle-ci n’autorisera pas l’extradition !
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

C’est tout un pan de notre droit qui est remis en cause et un certain nombre de textes, notamment ceux portant sur la nationalité, seront caduques avant même d’avoir été votés !

Les arrêts de la Cour européenne vont toujours dans le même sens : la conception des droits de l’homme qui est la sienne prive les États de la possibilité d’extrader.

Mes chers amis, vous devez avoir conscience du fait qu’à travers la Cour européenne, vous bloquez un vecteur de lutte contre le terrorisme.
Nous reviendrons sur ce point lorsque nous débattrons de la proposition de loi de Philippe Meunier, mais l’affaire est la même, monsieur Tourret : il y a effectivement une certaine continuité entre les textes que nous vous proposons. Nous sommes hostiles à tout ce qui nous prive des moyens de lutter contre le terrorisme. Ce n’est pas un problème d’extrême-droite : c’est un problème de souveraineté nationale !
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, il nous revient ce matin de débattre de la proposition de résolution portée par Pierre Lellouche au nom du groupe UMP, invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l’homme. C’est un sujet majeur du fait de l’intensité politique de l’objectif poursuivi par les signataires de la proposition. Majeur, ce sujet l’est aussi dès lors que l’on s’attaque, malheureusement ici dans le mauvais sens du terme, à l’oeuvre jurisprudentielle de la Cour, construite au cours de plus de soixante années, brassant tant et tant de questions emblématiques des libertés conquises par les Européens à l’issue de guerres tragiques ou de décennies de dictatures. La Cour européenne des droits de l’homme est le coeur vivant de la démocratie, ce lieu citoyen, solennel et noble, cher aux femmes et aux hommes de notre continent amoureux de la paix et de sa construction par le droit.
La paix comme l’Europe sont des édifices fragiles et toujours inachevés. Rien ne peut ni ne doit être entrepris qui les ébranle. Or de quoi est-il question dans votre proposition de résolution, monsieur Lellouche ? D’une charge inédite, d’une attaque en règle, fort peu nuancée, contre la jurisprudence récente, et parfois aussi ancienne, de la Cour européenne des droits de l’homme.

Il est écrit, à la page 10 de l’exposé des motifs de votre proposition, que vous vous opposez à ce que « certains juges s’arrogent la possibilité d’octroyer des droits en bafouant des dispositions démocratiques établies et en détournant les principes du droit en faveur du terrorisme contre l’impératif de sécurité nationale des États ».

Elle fait procès à la Cour et à ses juges de faire le choix des terroristes contre le droit ! Je trouve une telle expression aussi hallucinante que consternante : hallucinante parce que la lecture objective de la jurisprudence y apporte le plus absolu des démentis ; consternante parce que la Cour ne devrait jamais être sujet de démagogie.

Je n’ai pas envie d’engager le débat sur ce terrain, monsieur Lellouche, d’abord parce que je n’en ai pas le goût.

Ensuite je juge la question soulevée bien trop cruciale pour céder à mon tour à la facilité des phrases tonitruantes ou péremptoires.

La Cour européenne des droits de l’homme vaut bien mieux que cela, cet hémicycle aussi d’ailleurs. Je vous répondrai donc sur le fond, vous parlant d’une institution que je connais, d’une jurisprudence que j’ai étudiée, comme d’autres.

La Cour existe depuis 1949. Sa mission est de garantir le respect par les États membres du Conseil de l’Europe, aujourd’hui au nombre de quarante-sept, de leurs engagements au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Les juges à la Cour, ces femmes et ces hommes à qui vous faites ici procès de tant de turpitudes, sont proposés par les gouvernements et élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ce qui garantit leur légitimité.

Le système de la Convention européenne des droits de l’Homme est un mécanisme subsidiaire, comme l’a rappelé Jean-Yves Le Bouillonnec : c’est le juge national qui assure en premier lieu le respect de la Convention. Dans notre pays, la Convention est appliquée par toutes les juridictions.

Pour assurer le respect des droits qu’elle consacre, les États membres jouissent d’une marge d’appréciation, reconnue par la Cour. C’est en vertu de cette doctrine que la Cour a estimé l’an passé, dans l’arrêt S.A.S, que la France n’avait violé aucune disposition de la Convention en légiférant contre le port du voile intégral dans l’espace public.

Me permettrez-vous de rappeler quelques exemples marquants des progrès de l’État de droit dans notre pays consécutifs à des arrêts de la Cour ?
Je pense notamment à l’encadrement par la loi des écoutes téléphoniques suite à l’arrêt Kruslin, à la possibilité de poursuivre et punir l’esclavage domestique grâce à l’arrêt Siliadin, à la consécration de l’égalité des droits successoraux de tous les enfants, quelle que soit leur filiation, issue de l’arrêt Mazurek.
Cela fait du bien de se dire qu’il existe à Strasbourg une Cour pétrie d’humanisme, creuset des traditions juridiques européennes, dont les arrêts portent sur des sujets aussi concrets et sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. Cela fait du bien également de savoir que, depuis le 1er novembre 1998 et l’entrée en vigueur du protocole no 11, le droit de recours individuel y est permis,...

… droit de recours que votre proposition de résolution entend limiter,…

….sans mentionner bien sûr qu’un tel projet ne relève pas d’un amendement à la marge, mais d’une remise à plat de l’ensemble des dispositions sur les voies de recours. Sans doute est-ce d’ailleurs pour mieux condamner le recours individuel que vous fantasmez sur une prochaine asphyxie de la Cour,…

…citant des chiffres fantaisistes pour accréditer l’idée d’un flot ininterrompu de recours individuels, chiffres que dément la réalité : ce ne sont pas 150 000 arrêts qui sont prononcés, Monsieur Lellouche,…

…mais 65 000, grâce à la mise en oeuvre de la section de filtrage et de la formation en juge unique.

J’en viens maintenant aux commentaires caricaturalement à charge des arrêts cités dans votre exposé des motifs, en commençant par la jurisprudence de la Cour relative à la gestation pour autrui : la Cour a consacré le droit de tous les enfants à leur filiation, en vertu des dispositions internationales sur les droits de l’enfant. Elle n’a pas cherché à contourner l’interdiction de la GPA en France.

Pour ce qui est de la création de syndicats dans l’armée, la Cour a jugé que les militaires devaient pouvoir bénéficier du droit d’association. Elle a laissé à la France une large marge d’appréciation concernant les restrictions à apporter à l’exercice de cette liberté.

S’agissant de la fraude fiscale et de la criminalité financière et du principe non bis in idem, la Cour a sanctionné la possibilité d’être condamné deux fois pour les mêmes faits par deux autorités différentes, comme d’ailleurs le Conseil constitutionnel l’a fait le 18 mars dernier pour le cumul des sanctions en matière financière.

C’était la position de la Cour de cassation pour punir les fraudeurs ! Vous prétendez lutter contre la fraude mais vous protéger les fraudeurs !

Elle n’a aucunement remis en cause la sévérité des sanctions à infliger aux délinquants financiers et fiscaux.
Concernant la piraterie, la Cour a rappelé que la garantie de présentation à un juge dans les premières heures suivant une arrestation est un droit inaliénable, quels que soient les faits reprochés aux personnes concernées.

Quant au terrorisme, depuis l’arrêt Soering de 1989 – cette jurisprudence n’est donc pas nouvelle –, la Cour s’oppose à ce qu’une personne, quels que soient ses agissements, soit soumise à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Elle ne s’est pas opposée à l’expulsion des terroristes dès lors que les garanties étaient apportées par l’État de renvoi que de tels traitements ne seraient pas appliqués.

Les pirates somaliens pourront vous remercier ! Comment osez-vous dire une chose pareille ? Pas moins de vingt-cinq morts en janvier !

Mes chers collègues, appeler les États membres du Conseil de l’Europe, comme le fait la proposition de résolution, à réviser la composition et les compétences de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’à limiter les recours individuels revient, ces révisions n’intervenant qu’à l’unanimité, à dénoncer la Convention et de ce fait à annoncer le retrait de la France du Conseil de l’Europe.
Comment peut-on proposer pareille perspective au regard de l’oeuvre du Conseil de l’Europe en faveur de l’État de droit sur notre continent depuis la fin de la Seconde guerre mondiale ?
Veut-on sacrifier Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe et donc de la Cour européenne des droits de l’homme ? Qu’en disent les députés alsaciens membres du groupe de l’UMP, en particulier ceux d’entre eux qui ont signé cette proposition, sans doute sans avoir pris le temps d’en mesurer toutes les conséquences ?

Et comment justifier l’absence parmi les signataires des membres du groupe UMP qui sont membres de la délégation française à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, si ce n’est par leur embarras, voire leur désaccord envers votre initiative, monsieur Lellouche ?
La démagogie est mauvaise conseillère ; l’irresponsabilité aussi. Si la composition de la Cour européenne des droits de l’homme et la qualité des juges qui y siègent est à ce point insupportable à l’UMP, pourquoi aucun de ses députés et sénateurs, membres comme moi de l’Assemblée parlementaire, ne siège comme titulaire ou même comme suppléant au sein de la commission de sélection des juges à la Cour ?

J’y suis le seul parlementaire français ; le seul qui veille à ce que les candidats juges puissent s’exprimer et travailler dans notre langue. J’ai siégé lundi et mardi cette semaine pour la présélection des candidats de six États membres. Où était l’UMP ces jours-là ? Pas moins de quinze juges sur quarante-sept seront renouvelés en 2015. Ne vaudrait-il pas mieux travailler plutôt que discourir, pontifier et s’égarer dans des polémiques consternantes ?
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Certes, le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme doit s’améliorer sur de nombreux points, qu’il s’agisse de la qualité des juges, de sa communication, de l’absence d’avocats généraux, de son budget. Encore faut-il, pour y parvenir, s’engager auprès d’elle et pour elle, en se gardant de tout procès d’intention, de toute accusation éculée de gouvernement des juges.
Laissez-moi conclure (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP) par les mots très justes prononcés en 2009 par le secrétaire d’État français chargé des Affaires européennes devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : « Je suis ici devant vous pour rendre hommage au rôle joué par la Convention européenne des droits de l’Homme, avec son champ d’application inégalé, son mécanisme de contrôle tout à fait original qui institue un ordre juridique commun aux États membres, au travers du droit de saisine individuel reconnu à tous les justiciables des États membres ainsi qu’au travail normatif accompli dans le sillage de la Convention. Je me suis rendu voici trois semaines à la Cour européenne des droits de l’Homme. Et je voudrais saluer ici, non pas seulement le professionnalisme juridique des sages de cette institution, mais également la vision philosophique de la construction de la paix par le droit du Président Jean-Paul Costa » – alors président, français, de la Cour. Ce secrétaire d’État, dont les paroles résonnent sans doute encore dans l’hémicycle du palais de l’Europe, c’était vous, monsieur Lellouche.

C’est parce que je me reconnais dans ce que vous disiez le 1er octobre 2009 que j’appelle notre Assemblée à rejeter la résolution que vous nous proposez ce 2 avril 2015.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC, écologiste, GDR et RRDP.

Je vous invite, chez collègues, à un peu plus de calme. Vous avez vous-même appelé à la sérénité des débats, monsieur Lellouche. Il est extrêmement désagréable d’entendre des glapissements lorsque l’orateur s’exprime à la tribune.
La parole est à Mme Marion Maréchal-Le Pen.

Je comprends un peu mieux l’énergie déployée pour faire croire à un péril de l’extrême-droite car qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser en vie. Il s’agit là d’indépendance nationale, dont je crois profondément qu’il n’est ni de droite ni de gauche, comme le révèlent les positions aujourd’hui défendues.
Combien de nos concitoyens connaissent la Cour européenne des droits de l’Homme, son président, sa composition et surtout son pouvoir ? La méconnaissance de cette juridiction est inversement proportionnelle au poids qu’elle exerce sur notre pays.
Partie d’une louable intention, la défense des droits de l’homme au sein des États signataires, cette juridiction s’est peu à peu érigée en gouvernement des juges étrangers dont les décisions s’imposent aux législations nationales.
Alors que l’article 46 de la Convention consacre l’effet obligatoire et relatif des arrêts, en réalité le caractère général de leurs énoncés leur confère une portée dépassant largement le cas d’espèce traité dans l’arrêt. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme sur lequel s’appuie la cour, était pourtant à l’origine un texte général, une proclamation de principes abstraits, quasi philosophiques. Ce texte a cependant été constamment interprété et surtout politisé par la pratique et la jurisprudence des juges de Strasbourg, qui en ont fait un levier de pouvoir sans limite, grâce à une interprétation extensive au service d’un « politiquement correct » affirmé qui permet de faire dire à peu près tout et n’importe quoi au texte en se rattachant vaguement à l’un de ses articles.
De très nombreuses législations nationales sont désormais élaborées sous la tutelle indirecte de la Cour européenne et de ses jurisprudences. C’est patent dans le domaine de l’immigration dont l’approche est particulièrement favorable au droit des étrangers. Brice Hortefeux, alors ministre de l’intérieur et de l’immigration, le reconnaissait lorsqu’il déclarait, lors de la conférence préfectorale et consulaire du 14 février 2011 : « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme conduit trop souvent, de facto, à privilégier les droits des migrants sur le droit des États à maîtriser l’immigration ».
Le comble est atteint avec les décisions qui conduisent aujourd’hui à la résolution que nous étudions et qui interdisent à des États souverains d’expulser de leur territoire des étrangers ou des nationaux déchus de leur nationalité condamnés pour terrorisme.
Mais l’atteinte à la souveraineté nationale ne se limite pas à l’immigration ou à la sécurité intérieure, comme le révèlent les exemples cités à l’appui de la proposition de résolution, et comme le montrent ces quelques exemples édifiants.
En 2014, la CEDH a condamné les autorités françaises à verser, au titre du dommage moral, des indemnités allant de 2 000 à 5 000 euros aux pirates somaliens interpellés pour les détournements des navires français Le Ponant et Le Carré d’As, estimant que « rien ne justifiait » leur placement en garde à vue pour 48 heures supplémentaires après les jours passés en mer aux mains de l’armée française.
Les Britanniques subirent deux condamnations en 2010 et 2011 pour avoir privé du droit de vote leurs détenus.
Très libertaires, les juges n’ont pas osé imposer frontalement leur vision sur les sujets dits sociétaux, mais se sont néanmoins appliqués à permettre le contournement des législations nationales qui leur déplaisaient. C’est ainsi que la CEDH ne remet pas en cause l’interdiction française de la gestation pour autrui, mais la vide de sa substance en obligeant l’État français à inscrire au registre d’état civil tout enfant né à l’étranger d’une mère porteuse.
Les exemples aussi scandaleux qu’humiliants pour notre pays se multiplient sans fin. Le législateur vote ainsi la loi dans la crainte permanente de la censure du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, qui s’adossent eux-mêmes à l’interprétation des jurisprudences de la CEDH. Il en vient ainsi à pratiquer l’auto-censure, quand il n’est pas contraint de modifier la législation nationale.
L’opinion parfois militante de quelques juges est-elle plus légitime que la tradition d’une nation, le vote d’un Parlement ou le suffrage direct d’un peuple ? La question mérite d’être posée, alors que la CEDH n’est plus seulement un système de défense des droits fondamentaux, mais un moyen de contrecarrer les décisions de justice nationales, par un recours devenu trop fréquent après l’épuisement des voies de recours internes, comme le montre l’explosion du nombre des recours ces dernières années.
La résolution proposée est donc un premier pas, mais un pas bien timoré, dont on connaît déjà le destin sans lendemain. Les atteintes à notre souveraineté nationale nous sont devenues tellement habituelles que l’interdiction qui nous est faite d’expulser des terroristes étrangers cause à peine un frémissement. Bien plus que l’impossibilité d’un recours individuel devant la CEDH pour les terroristes, c’est tout notre droit, notre indépendance et nos traditions que nous devrions chercher à préserver de l’ingérence de magistrats sans aucune légitimité démocratique.
Je voterai cette résolution, mais indépendamment d’une éventuelle dénonciation de la Convention européenne des droits de l’homme ou d’une réforme de la CEDH, la voie la plus urgente à ouvrir est celle de la réaffirmation du primat du droit national élaboré démocratiquement sur le droit européen et international, sauf à se résigner à l’impuissance de la politique française.

La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Pierre Lellouche, la proposition de résolution invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l’Homme sur des questions touchant notamment à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme nous donne l’occasion d’un débat important sur la conciliation entre la protection des libertés et des droits de l’Homme et la lutte contre le terrorisme, et entre notre action au plan national et notre action dans le cadre international, en particulier européen.
C’est un débat légitime, qui mérite un examen approfondi, car il y va de questions essentielles : la sécurité des Français, nos engagements internationaux et le rôle international de la France.
Je suis heureux que ce débat nous donne l’opportunité de mettre en lumière l’importance de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’Homme. Cela a été rappelé par plusieurs d’entre vous, sur tous les bancs : entrée en vigueur en 1953, elle a été le premier instrument concrétisant et rendant contraignants plusieurs des droits essentiels consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. C’est pourquoi la France y est particulièrement attachée.
Elle est également un des piliers du Conseil de l’Europe, dont la France est l’un des principaux membres fondateurs.
L’importance de la Convention réside, non seulement dans l’étendue des droits fondamentaux qu’elle protège, mais aussi dans le mécanisme de protection établi à Strasbourg pour examiner les violations alléguées et veiller au respect par les États des obligations découlant de la Convention. C’est là toute la mission et tout le sens de l’action de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a été instituée en 1959.
La Convention s’applique dans les 47 États parties membres du Conseil de l’Europe, mais les 28 pays membres de l’Union européenne y sont particulièrement attachés, car c’est à la fois une source de leurs propres droits et socles de droits fondamentaux et un ensemble de valeurs, de principes et de règles auxquels adhèrent les autres États parties et qui doit garantir une approche commune des droits de l’Homme sur l’ensemble du continent et à ses frontières. C’est aussi un des instruments et une des conditions de la paix sur le continent depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, paix aujourd’hui si fragile aux frontières de l’Union européenne. C’est donc un pilier auquel il ne faut pas s ’attaquer, sauf à prendre le risque de voir l’édifice du Conseil de l’Europe dans son entier s’effriter, se fragiliser, voire s’effondrer.
Or la proposition de résolution que vous présentez aujourd’hui cherche à mettre en opposition deux missions essentielles qui incombent aux démocraties européennes : la garantie de la paix et de la sécurité de nos citoyens et de nos nations, et, d’autre part, la protection des libertés et des droits de l’Homme, et ce dans une période où nous devons collectivement, en France comme en Europe, faire face à une menace terroriste sans précédent, dont nous sommes tous conscients qu’elle est loin d’être derrière nous.
Vous avez fait état d’un certain nombre de décisions rendues récemment par la Cour européenne des droits de l’Homme qui, selon vous, remettraient en cause la souveraineté des États et les empêcheraient de lutter efficacement contre le terrorisme. C’est évidemment le point essentiel du débat que vous soulevez.
Vous proposez donc de limiter le droit de recours individuel devant cette même Cour, en en privant les personnes condamnées pour terrorisme dans l’un des États parties à la Convention européenne des droits de l’Homme. Nous sommes engagés dans une lutte sans merci contre le terrorisme.
Jamais, je l’ai dit, la menace n’a été aussi grande, jamais les moyens mobilisés n’ont été aussi importants, sur le plan extérieur comme sur le plan intérieur…
… et nous ne devons surtout pas opposer cette lutte contre le terrorisme aux droits de l’Homme, ces mêmes droits de l’Homme que les terroristes veulent anéantir parce qu’ils sont au coeur de nos démocraties.
Ce n’est pas en faisant reculer la démocratie que nous ferons mieux barrage au terrorisme, fait de haine, d’obscurantisme et de violence aveugle.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.- Protestations sur les bancs du groupe UMP.
Je ne fais le procès à personne de vouloir le faire…
…mais je veux traiter des sujets qui sont soulevés par votre proposition de résolution, et je prends vos arguments au sérieux.
Cette exigence de concilier démocratie et sécurité a été clairement rappelée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans une autre résolution que celle que vous avez citée, la résolution 1456 adoptée en 2003, ainsi que dans des résolutions ultérieures. Je cite la résolution de 2003 : « Lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme, les États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’Homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire. »

Sans qu’ils soient détournés ! C’est le sens de la résolution suivante.
La Convention européenne des droits de l’Homme marque l’attachement profond de nos démocraties à la défense et à la protection d’une conception commune et ambitieuse des droits de l’homme. La Cour est l’outil clé pour assurer le respect effectif de ces droits par les 47 États parties. Elle permet l’existence d’un standard minimum commun en matière de protection des droits de l’homme. L’intégrité dont elle fait preuve dans le traitement de chaque requête lui permet de jouer pleinement le rôle qui lui a été confié.
Je tiens à souligner ici, monsieur le député, la réalité de la situation de la Cour européenne des droits de l’Homme. Je répondrai par la même occasion à M. Goasguen et aux autres intervenants qui ont évoqué un engorgement de la Cour.
Tout d’abord, la Cour européenne des droits de l’Homme n’est nullement menacée d’asphyxie.
J’ai pu constater moi-même à l’occasion d’une visite au siège du Conseil de l’Europe et de la Cour que des mesures énergiques avaient été prises pour remédier à la situation d’engorgement qu’elle connaissait auparavant. Les résultats sont là : alors qu’en 2011, plus de 160 000 requêtes étaient pendantes devant la Cour, leur nombre a substantiellement diminué, puisqu’il ne s’établit plus qu’à 65 000.
En outre, contrairement à ce que suggèrent les termes de votre proposition de résolution, le recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’Homme est loin d’être automatique. Il suffit d’analyser les chiffres concernant la France pour s’en convaincre. En 2014, le nombre de requêtes déposées contre notre pays devant la Cour s’est élevé à 1 142, mais seules 122 ont été jugées recevables, ne donnant lieu qu’à dix-sept condamnations. Car la mission de la Cour est également de rejeter toute requête considérée comme abusive. Je rappelle que ce droit de recours individuel constitue la clé de voûte de la protection des droits de l’homme voulue par les auteurs de la Convention. Tous les États parties avaient d’ailleurs admis son caractère fondamental avant même l’entrée en vigueur du protocole no 11 portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention.

Le protocole no 11 est venu trente ans après, monsieur le secrétaire d’État !
C’est pourquoi la France y est profondément attachée, et sans restriction.
La critique portée par cette proposition de résolution selon laquelle certains arrêts de la Cour relèveraient d’un gouvernement des juges n’est pas plus fondée. Le principe de subsidiarité garantit que chaque État partie conserve la responsabilité première d’identifier les mesures les plus adaptées pour mettre en oeuvre la Convention, en tenant compte des particularités du pays – point sur lequel a insisté Jean-Yves Le Bouillonnec. Ce principe de subsidiarité permet notamment aux décideurs nationaux de prendre en compte les pratiques nationales, les systèmes juridiques, les conditions et spécificités culturelles sans pour autant encourir une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Dès ses premiers arrêts, la Cour n’a eu de cesse de rappeler ce principe de subsidiarité inhérent au mécanisme européen de protection des droits de l’Homme…
… reconnaissant ainsi aux États une marge d’appréciation dans leur façon d’appliquer les droits reconnus par la Convention.
J’ajoute que le droit qu’applique la Cour est le même que celui qu’appliquent les juridictions nationales, qui sont les premières à garantir la mise en oeuvre de la Convention au plan national. La Cour ne se substitue donc pas aux autorités nationales, qui demeurent libres de choisir les mesures qu’elles estiment les plus appropriées dans les domaines régis par la Convention.
Le contrôle de la Cour ne porte que sur la conformité de ces mesures avec les exigences de la Convention.
Enfin, je voudrais faire un sort à l’idée que la protection des droits de l’Homme n’est pas conciliable avec la lutte contre le terrorisme, qu’il faudrait choisir entre l’un et l’autre de ces objectifs, ou que la Cour n’est pas consciente des impératifs de sécurité qui s’imposent aux États parties.
Je voudrais à ce propos revenir sur plusieurs des affaires que vous avez mentionnées. Contrairement à ce qui est affirmé à l’appui de la proposition de résolution, les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les affaires Beghal et Daoudi ne sont pas la cause première de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’expulsion prise à leur encontre.
La réalité des faits doit être rappelé. S’agissant de M. Beghal, vous indiquez que la Cour avait suspendu la mise à exécution de la mesure d’éloignement le temps de se prononcer sur le fond de la requête. C’est en effet ce qu’elle a fait. Mais vous oubliez de dire qu’une juridiction française, le tribunal administratif de Paris, a également suspendu, quasiment au même moment, la procédure d’expulsion visant M. Beghal. Cette décision du tribunal administratif de Paris a d’ailleurs été confirmée en appel par le Conseil d’État. Par conséquent, même si la CEDH n’avait pas invoqué l’article 39 de son règlement…
…l’expulsion de M. Beghal n’aurait pas pu se faire, en raison des questions de principe qui ont été soulevées par nos juridictions nationales.
S’agissant maintenant de M. Daoudi, si la Cour a jugé que son expulsion vers l’Algérie serait contraire à l’article 3 de la Convention interdisant la torture et les traitements inhumains et dégradants, cette interdiction d’éloignement de M. Daoudi résultait déjà d’une décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile, qui avait reconnu que l’intéressé risquait d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
L’arrêt de la Cour européenne n’a donc fait que réaffirmer une interdiction d’éloignement qui avait déjà été prononcée par une juridiction française.
Quant à l’arrêt Othman contre Royaume-Uni, même si cette affaire nous concerne moins directement, je rappelle que la Cour y a admis qu’un État puisse recourir à la pratique des assurances diplomatiques afin de pouvoir expulser ou extrader un individu vers un État dans lequel il serait exposé à des risques de mauvais traitements. Il est vrai que dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’expulsion de M. Othman vers la Jordanie emporterait violation de l’article 6 de la Convention, en raison du risque que soient admis à nouveau à son procès en Jordanie des éléments de preuve obtenus par torture sur des tiers. Toutefois, à la suite de l’arrêt de la Cour européenne, le mémorandum d’accord entre les gouvernements britannique et jordanien a pu être modifié en vue d’exclure une telle possibilité et le Royaume-Uni a pu expulser M. Othman vers la Jordanie le 7 juillet 2013.
Cependant, il est vrai que la Cour européenne des droits de l’Homme doit elle-même veiller, dans ses décisions et sa jurisprudence, à prendre en compte les objectifs légitimes, fondés et conformes aux résolutions du Conseil de sécurité des États lorsqu’ils luttent contre le terrorisme et les auteurs d’actes terroristes.
Nous sommes convaincus que la Cour en est consciente et qu’elle y veillera. J’aimerais que vous en soyez aussi convaincus, parce que je suis sûr que, comme nous, vous êtes attachés au Conseil de l’Europe et à la défense des droits de l’homme à laquelle il oeuvre.
La Cour est d’ailleurs consciente du défi que représente pour elle l’acceptabilité de ses décisions, comme elle l’a rappelé dans l’arrêtSAS contre France du 1er juillet 2014, que certains d’entre vous ont mentionné, en estimant que l’acceptation ou non du port du voile intégral dans l’espace public relevait d’un choix de société qui devait la conduire à faire preuve de réserve dans l’exercice de son rôle de conventionnalité.
Par conséquent, affirmer que la Cour empêcherait de lutter efficacement contre le terrorisme n’est pas fondé.
Bien sûr, nous préférerions qu’elle suive toujours les positions défendues par l’État français et ne nous condamne jamais, mais il arrive aussi que l’administration soit condamnée par une juridiction française. C’est la conséquence même du principe de séparation des pouvoirs, qui est à la base de notre démocratie, et cela ne saurait en aucun cas suffire à justifier une remise en cause du système de protection des droits de l’homme, de la composition et des compétences de la Cour, ainsi que du droit au recours individuel, qui participe d’une protection effective des droits de l’homme dans notre pays.
Voilà pourquoi vous comprendrez que le Gouvernement, tout en étant prêt à discuter des arguments que vous avez soulevés, invite la représentation nationale à rejeter cette proposition de résolution et à rester pleinement engagée au service de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et sur plusieurs bancs du groupe écologiste.
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.
La proposition de résolution n’est pas adoptée. – Nouvelles exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Je vous ai appelés à exprimer votre opinion : des bras se sont levés à la droite comme à la gauche de cet hémicycle.
La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à onze heures dix.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à faire perdre la nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité (nos 2570, 2679).

La parole est à M. Philippe Meunier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

Madame la présidente, madame le secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est la deuxième fois que le groupe UMP décide d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de loi ayant pour objet de priver de la nationalité française les terroristes qui ont pris les armes contre la France et de créer un crime d’indignité nationale.
Le 4 décembre dernier, la majorité et le Gouvernement se sont opposés à cette mesure, au motif que le droit en vigueur serait suffisant, qu’elle serait « stigmatisante » et que cette sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité des faits. Les amendements que nous avions déposés lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme, en septembre 2014, ont également été rejetés. Le 25 mars dernier, la majorité a persisté, en commission, dans son refus d’adopter des mesures pourtant si nécessaires.
Ce nouveau rejet démontre que les appels du Président de la République et du Premier ministre à l’unité nationale et au dialogue avec l’opposition, au lendemain des attentats de janvier 2015, pour adopter les mesures nécessaires au renforcement de la lutte contre le terrorisme, étaient de pure forme. L’unité nationale invoquée fonctionne à sens unique : elle implique, selon le Gouvernement, que l’opposition soutienne les réformes qu’il présente, sans que lui-même soit tenu d’étudier avec honnêteté et sérieux les propositions de l’opposition.
Les attentats odieux qui ont frappé notre pays en ce début d’année et le nombre croissant de Français engagés en Syrie et en Irak dans les rangs de l’organisation terroriste Daech démontrent pourtant tragiquement que la mesure que nous proposons est indispensable.
Selon le dernier état des lieux dressé par le ministère de l’intérieur, à la fin du mois de février, 413 Français étaient engagés dans les zones de combat en Syrie et 294 de nos compatriotes seraient en transit vers ces zones. Selon le Premier ministre, plus de 1 250 Français étaient engagés fin janvier dans les filières irako-syriennes et le nombre des Européens sur place devrait plus que tripler d’ici la fin de l’année.
Ces milliers de Français radicalisés, devenus des ennemis de notre pays, disposent d’un droit au séjour sur notre territoire ainsi que de celui de circuler librement dans toute l’Union européenne. La menace constituée par ces individus à leur retour est considérable. Elle exige qu’ils fassent l’objet d’une surveillance continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Imagine-t-on les effectifs policiers qu’une telle surveillance mobiliserait, au détriment des autres missions de sécurité publique incombant aux forces de l’ordre ?

La seule mesure susceptible d’assurer la sécurité de nos concitoyens est de priver les individus concernés de la nationalité française, afin de pouvoir leur interdire l’accès à notre territoire à leur retour ou les expulser, le cas échéant après qu’ils eurent purgé une peine de prison.
Si nous ne parvenons pas, d’une manière ou d’une autre, à empêcher le retour de ces centaines, voire de ces milliers de Français radicalisés sur notre sol, la sécurité de nos concitoyens ne pourra pas être assurée. Même si les symboles ont leur importance, la privation de la nationalité n’est pas qu’une mesure symbolique : c’est une mesure aux conséquences concrètes, indispensable pour assurer notre sécurité.
Le gouvernement britannique l’a parfaitement compris et a agi en conséquence : une première loi a étendu, en juillet 2014, la possibilité de priver un citoyen britannique, même de naissance, de sa nationalité, et autorisé la perte de nationalité d’un citoyen naturalisé, quand bien même cela le rendrait apatride. Une seconde loi antiterroriste, en date du 12 février 2015, autorise désormais le ministre de l’intérieur à interdire temporairement l’accès au territoire britannique de citoyens britanniques engagés dans des activités terroristes à l’étranger.

On n’est pas en Grande-Bretagne, ici, on est en France, ici on défend les droits et les libertés !

D’autres États, tels que le Canada ou la Belgique, envisagent de réformer ou ont réformé leur droit de la nationalité pour lutter contre le terrorisme.
Lors de l’examen de la précédente proposition de loi que nous avions déposée et du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme, le Gouvernement a affirmé que le droit de la nationalité française en vigueur serait suffisant sur ce point. C’est malheureusement inexact. En effet, en application des articles 25 et 25-1 du code civil, seuls les Français d’acquisition – par exemple par la voie de la naturalisation ou du mariage – possédant une autre nationalité peuvent être déchus de leur nationalité française pour actes de terrorisme, dans des délais encadrés par la loi. Deux catégories de Français échappent donc totalement, aujourd’hui, à ce dispositif : les Français de naissance, d’une part, et les Français d’acquisition ne possédant pas une autre nationalité, d’autre part. Aucun d’entre eux ne peut se voir retirer sa nationalité pour acte de terrorisme.
Ce sont deux graves lacunes de notre droit. Il suffit, pour s’en convaincre, de se pencher sur le profil de certains terroristes français ayant frappé notre pays et la Belgique au cours de la période récente : Mohamed Merah, Mehdi Nemmouche, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly étaient ou sont tous Français de naissance.
Certains d’entre eux n’étaient en outre pas binationaux. Aucun d’entre eux n’aurait donc pu faire l’objet d’une procédure de déchéance de la nationalité française, les conditions légales n’étant pas remplies.
Le second argument qui nous a été opposé, tout aussi inexact, est que notre proposition serait inconstitutionnelle. Dans une décision récente rendue le 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel, confirmant une décision du 16 juillet 1996, a validé le recours à la déchéance de nationalité à l’encontre des terroristes « eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme ». Si la privation de nationalité est constitutionnelle, parce que proportionnée, lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’un Français par acquisition pour les actes de terrorisme, elle l’est donc nécessairement lorsqu’elle est prononcée à l’encontre des Français de naissance. Si le Conseil constitutionnel en jugeait autrement, cela reviendrait à contraindre le législateur à traiter les Français différemment selon qu’ils le sont de naissance ou par acquisition, alors qu’il a lui-même jugé que tous les Français étaient égaux au regard du droit de la nationalité. Prétendre que notre proposition, dans sa nouvelle rédaction, soulèverait une difficulté constitutionnelle, c’est considérer qu’il y a deux catégories de Français au regard de la privation de nationalité : les Français de fraîche date et les Français de naissance.
C’est la raison pour laquelle, au lieu de recourir à la déchéance de nationalité, qui est réservée aux Français d’acquisition, nous avons retenu la perte de nationalité, qui vise tous les Français, sans distinction. Ce qui importe, c’est la particulière gravité des faits ; peu importe que l’intéressé soit Français depuis quinze générations ou depuis trois ans. Notre proposition de loi met fin à une inégalité de traitement, ce qui devrait tous nous réunir. J’observe d’ailleurs, mais nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’examen des amendements, que la distinction entre déchéance et perte de nationalité est, de toute évidence, ignorée par les auteurs de l’amendement de suppression de l’article premier, alors qu’elle est essentielle.
Dans le détail, notre proposition de loi comporte deux articles.
Le premier crée un nouveau cas de perte de la nationalité française, qui s’appliquera au Français ayant participé à des opérations armées contre les forces armées françaises ou contre un civil français, ou s’étant rendu complice de telles opérations, à l’étranger ou en France. Un nouvel article 23-8-1 serait ainsi créé dans le code civil. Tout Français, d’acquisition ou de naissance, pourra être privé de sa nationalité, à condition qu’il possède une autre nationalité. Ce nouveau cas de perte de nationalité sera prononcé par décret pris après avis conforme du Conseil d’État – l’un de mes amendements vise à prévoir un avis non plus simple mais conforme – après avoir été entendu ou invité à présenter ses observations, comme le prévoit l’article 23-8 du code civil. L’intéressé fera alors l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire national s’il s’y trouve, ou d’une mesure d’interdiction administrative du territoire s’il est à l’étranger.

L’article 2 modifie le code pénal afin de créer un crime d’indignité nationale, accompagné d’une peine complémentaire de dégradation nationale, à l’encontre de tout Français auteur ou complice des mêmes faits que ceux qui sont visés à l’article 1er. Il complète à cette fin la section du code pénal relative aux « intelligences avec une puissance étrangère ».
Ce nouveau crime s’inspire du dispositif mis en place à la fin de la Seconde guerre mondiale par l’ordonnance du 26 août 1944 pour sanctionner les Français ayant collaboré avec l’ennemi. Ce crime était lui aussi assorti d’une peine de dégradation nationale emportant la privation de tous les droits civiques, civils et politiques, ainsi que certaines interdictions professionnelles. Notre proposition reprend cette peine, et la complète par une peine de trente ans de détention criminelle, ce qui n’était pas envisageable en 1944 compte tenu du caractère nécessairement rétroactif du crime créé par l’ordonnance du 26 août 1944.
Avant de conclure, je souhaiterais d’ores et déjà dire un mot sur l’un des amendements que j’ai présentés pour améliorer le dispositif. Comme je l’ai exposé précédemment, notre proposition de loi comble l’une des deux lacunes du dispositif actuel, en permettant de priver également les Français de naissance de leur nationalité française s’ils ont perpétré des actes de terrorisme. Elle ne permet cependant pas, dans sa rédaction actuelle, de priver de leur nationalité les Français d’acquisition ou de naissance si cela avait pour effet de les rendre apatrides. C’est une lacune importante, car beaucoup de nos compatriotes qui combattent dans les rangs de Daech n’ont pas d’autre nationalité.
Nous avons prévu cette exception parce qu’il a toujours été affirmé que le droit international interdisait de rendre l’un de ses propres ressortissants apatride. Or, une expertise approfondie a révélé que cette idée répandue était fausse. Le droit international n’interdit pas à la France de rendre l’un de ses ressortissants apatrides. L’instrument de référence en la matière est la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, adoptée dans le cadre des Nations unies. La France a signé cette convention le 31 mai 1962, mais ne l’a pas ratifiée. Elle n’est donc pas liée par cette dernière.
Au surplus, ladite convention n’interdit aucunement aux États parties de priver un individu de sa nationalité, y compris si cette privation doit le rendre apatride, si cette privation est motivée par un manque de loyalisme envers l’État concerné ou s’il a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État concerné ou encore s’il a manifesté par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l’État contractant ; ces éléments figurent à l’article 8, paragraphe 3 de la convention. La France, lors de la signature de la Convention, a effectué une déclaration par laquelle elle a indiqué qu’elle se réservait le droit d’user, en cas de ratification, de la faculté qui lui est ouverte par ces dernières dispositions.
L’article 23-8 du code civil permet d’ailleurs déjà de rendre un Français apatride s’il a apporté son concours à l’armée ou au service public d’un autre État ou à une organisation internationale dont la France ne fait pas partie malgré l’injonction du Gouvernement de cesser son activité. La législation de nombreux États européens comporte des dispositions similaires les autorisant à rendre leurs ressortissants apatrides. Tel est le cas de l’Autriche, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Grèce, de l’Italie, de la Lettonie et de la Lituanie ainsi que du Royaume-Uni.
L’amendement no 6 que je propose prévoit donc d’insérer un nouvel article 23-8-2 dans le code civil, afin de prévoir un nouveau cas de perte de la nationalité française, applicable aux Français d’origine comme d’acquisition, qu’ils possèdent ou non une autre nationalité. Ce nouveau cas de perte de la nationalité française concernera les Français condamnés pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Cette perte prendra la forme d’un décret pris après avis conforme du Conseil d’État, comme en matière de déchéance de nationalité.
Le sujet dont nous débattons est un sujet grave, sur lequel aucun d’entre nous ne devrait adopter de posture politicienne. Tel est malheureusement le cas des amendements de suppression déposés par les diverses composantes de la majorité et dont la lecture révèle une volonté délibérée de caricaturer les propositions qui vous sont soumises sans avoir pris la peine de lire le dispositif ou de regarder ce qui se fait au-delà de nos frontières. Pour lutter contre le terrorisme, il nous faut au contraire dialoguer pour parvenir à une solution susceptible de faire consensus. Ce dialogue, malheureusement, vous le refusez ce matin en déposant une motion de rejet préalable qui, si elle est adoptée, coupera court à toute forme de discussion.

Nos compatriotes jugeront ainsi par eux-mêmes de l’hypocrisie des propos tenus par François Hollande et Manuel Valls au lendemain des attentats de janvier dernier.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, cher Philippe Meunier,…
…mesdames, messieurs les députés, vous avez déjà eu l’occasion de vous pencher sur des dispositions quasiment identiques, proposées par les mêmes, le 4 décembre dernier. Il s’agissait alors d’inclure dans le code civil un nouveau cas de déchéance qui visait les personnes ayant porté les armes contre les forces de l’ordre.
Certains amendements qui avaient été proposés sur ce texte envisageaient déjà de recourir, vis-à-vis de ces mêmes personnes, à la procédure non plus de la déchéance, mais de la perte de nationalité ou au crime d’indignité nationale. L’Assemblée nationale avait rejeté et la proposition de loi et tous les amendements que vous proposiez, en estimant que la solution que vous apportiez méconnaissait un certain nombre de principes constitutionnels et n’apportait pas de réponse satisfaisante au problème qu’elle visait à résoudre.
Vous proposez aujourd’hui un texte très similaire à celui de la proposition de loi du 4 décembre dernier et qui contient deux dispositions. Premièrement, vous proposez d’étendre la perte de nationalité aux personnes portant les armes ou se rendant complices d’un tel acte à l’encontre de l’armée française, de forces de sécurité ou de simples civils, dès lors qu’elles le font sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ou bien sur le territoire national « au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement ». Deuxièmement, vous proposez de créer un nouveau crime d’indignité nationale dans les mêmes cas de figure.
Il suffirait peut-être de rappeler que le Gouvernement vous objectait en décembre dernier l’inconstitutionnalité de votre proposition, car ce qui était inconstitutionnel hier l’est toujours aujourd’hui.
Répéter une erreur n’en fait pas une vérité. Toutefois, je comprends les raisons qui motivent votre proposition de loi. En réalité, une même volonté nous anime : que l’État et la République utilisent tous les moyens constitutionnels et juridiques à leur disposition pour mettre les terroristes, où qu’ils se trouvent, hors d’état de nuire. Nous avons un devoir de protection à l’égard des Français. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’a cessé, depuis des mois, avant même les tragiques attentats de janvier, de renforcer notre arsenal répressif et préventif contre le terrorisme.
Nous avons donné des moyens supplémentaires à nos services de sécurité et de renseignement. Avec la loi du 13 novembre dernier, nous nous sommes également dotés d’outils juridiques nouveaux pour lutter contre l’action et la propagande des organisations terroristes. Nous allons maintenant élaborer, avec le Parlement, une loi sur le renseignement à la mesure des enjeux de sécurité auxquels nous sommes confrontés.
Nous ne reculerons devant aucune mesure pour protéger les Français, pourvu que celle-ci soit efficace et qu’elle respecte notre cadre constitutionnel.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.
Si face à une telle menace notre mobilisation doit être exceptionnelle, il n’est toutefois pas question, et c’est sur ce point que les réponses que vous suggérez sont inacceptables aux yeux du Gouvernement, de recourir à une législation d’exception, car céder sur les principes, c’est tomber dans le piège que les terroristes nous tendent.

Mais l’exception, par définition, est dérogatoire aux règles de droit commun ! Ce que vous dites n’a pas de sens !
C’est la raison pour laquelle je veux vous apporter une réponse juridique aussi précise que possible – c’est la juriste qui vous parle –, tout en vous expliquant pourquoi, à mes yeux, votre proposition de loi n’est pas adaptée.
La procédure que vous proposez de créer ajoute de nouveaux cas de perte de la nationalité française en plus de ceux qui sont déjà prévus par l’article 23 du code civil. Le raisonnement que vous semblez tenir est le suivant : la déchéance de nationalité est enserrée dans un cadre constitutionnel contraignant. Selon le droit en vigueur, il faut que le Français concerné ait acquis cette nationalité, que les faits justifiant la déchéance soient d’une particulière gravité, que ces faits surviennent dans un temps limité après l’acquisition de la nationalité – dix ou quinze ans – et que la déchéance n’ait pas pour effet de rendre la personne apatride. Enfin, cette déchéance ne peut survenir elle-même que dans un temps limité après les faits justifiant son prononcé.
Vous étiez à l’époque sceptiques sur l’existence de ce cadre constitutionnel strict et vous souhaitiez que nous nous en détachions. Nous aurions eu tort de le faire : le Conseil constitutionnel a rappelé de la manière la plus solennelle qui soit, lors de sa décision du 23 janvier dernier, l’encadrement constitutionnel de la déchéance.
Il a notamment rappelé que le législateur ne saurait prononcer, sans porter atteinte à nos principes, une déchéance pour des faits survenus plus de quinze ans après l’acquisition de la nationalité.
Prenant acte de cette jurisprudence, vous tentez aujourd’hui ce qui est en réalité un tour de passe-passe : le cadre de la déchéance est inadapté, par conséquent vous essayez d’utiliser un autre cadre juridique pour parvenir exactement aux mêmes fins. Vous proposez d’appeler « perte de la nationalité française » ce que, dans votre proposition du 4 décembre 2014, vous appeliez « déchéance ». Pour le reste, votre proposition est quasiment identique.
Ce faisant, vous estimez, sans doute, avoir comblé le vice d’inconstitutionnalité qui grevait votre rédaction initiale ; contrairement à la déchéance, la perte s’applique à tous : Français de naissance comme personnes ayant acquis la nationalité française. Dès lors, le Conseil constitutionnel ne pourra plus invoquer une rupture du principe d’égalité, nous dites-vous en substance. Vous omettez au passage que, dans votre proposition initiale, la déchéance s’appliquait déjà à tous, Français de naissance et Français par acquisition.
En réalité, la rédaction que vous proposez demeure tout aussi inadaptée, pour trois raisons.
La première, c’est qu’une perte de nationalité prononcée à l’encontre d’une personne née française risque fort d’être jugée disproportionnée par le Conseil constitutionnel ; il n’y a pas de raison a priori pour que la déchéance soit limitée dans le temps, là où la perte ne le serait pas ; juridiquement, c’est la même chose, il s’agit d’abroger le lien de nationalité.
La deuxième raison est la suivante : la perte de nationalité n’est pas un cadre juridique adapté pour ce que vous souhaitez faire ; contrairement à la déchéance, la perte de nationalité ne s’analyse pas comme une sanction juridique, mais comme le simple constat par l’administration qu’une personne n’est plus française ; ces dispositions sont en outre inusitées aujourd’hui ; or, la rédaction que vous proposez s’apparente clairement à une sanction ; dans ce cas, c’est la déchéance qui doit s’appliquer, avec toutes les garanties constitutionnelles prévues par cette procédure, et non la perte pour ainsi dire « administrative » de la nationalité.
Enfin, votre proposition est également insatisfaisante dans la définition de son champ d’application, et manque de rigueur et de précision juridique : que signifie par exemple « être identifié » comme étant « complice par la fourniture de moyens […] contre tout civil Français » ou « au profit […] d’une organisation contre laquelle la France est engagée militairement ?

C’est très précis, madame la secrétaire d’État : c’est dans le code pénal.
On le voit, ces dispositions se prêtent à de trop nombreuses interprétations ; or, à lire votre texte, l’administration serait placée en situation de compétence liée ; il y a ici une réelle difficulté au regard d’un autre principe constitutionnel, celui de la légalité des délits et des peines.
Je pense que votre proposition de loi pose les mêmes difficultés juridiques que celle du 4 décembre dernier, difficultés juridiques dont nous avions déjà eu l’occasion de discuter. Par là même, le dispositif que vous prévoyez est à la fois impraticable et inconstitutionnel, notamment en raison de son imprécision et de son champ d’application trop large et inadapté.
Je ne doute pas de la sincérité de votre participation à la mobilisation collective contre le terrorisme.
Mais l’efficacité commande de ne pas nous doter d’armes juridiques inconstitutionnelles ou inapplicables. L’efficacité, en la matière, c’est d’user de l’ensemble de notre arsenal juridique actuel pour mettre les terroristes hors d’état de nuire.
Nous ne le faisons pas ? Dois-je vous rappeler, monsieur le député, qu’aucune déchéance de nationalité n’avait été prononcée contre des terroristes entre 2007 et 2012 ?
Une déchéance a été prononcée en 2014 et a donné lieu à la jurisprudence constitutionnelle que je vous rappelais. Maintenant que notre cadre juridique est définitivement stabilisé, le Gouvernement et le ministre de l’Intérieur sont résolus à en faire tout l’usage que la Constitution autorise.
Nous ne le faisons pas ? Pas moins de six procédures de déchéance viennent d’être engagées par les services du ministre de l’intérieur. Le Gouvernement veillera avec la plus grande détermination à ce que ces procédures soient menées à leur terme.
Ceux qui, par leurs actes, se sont rendus indignes d’être français seront déchus de la nationalité française, dès que lors que notre Constitution le permet.

Vous n’y arriverez pas. La Cour européenne des droits de l’homme y fera obstacle.
Ce n’était pas la pratique de la majorité précédente. En revanche, c’est la nôtre. De même, ce Gouvernement n’hésitera pas à expulser les terroristes étrangers. Sachez que deux fois plus de personnes étrangères sont expulsées pour des faits de terrorisme ou pour des prêches radicaux sous cette majorité que sous la majorité précédente.
Ce Gouvernement est résolu à faire un usage déterminé de toutes les armes juridiques dont il dispose contre le terrorisme. Il le fera avec d’autant plus de force et d’efficacité qu’il veillera, pour chacune de ses décisions, à se conformer strictement aux règles de l’État de droit.
Le deuxième article de votre proposition de loi a une portée plus symbolique.
La peine d’indignité nationale a été créée par l’ordonnance du 26 août 1944 et abrogée dès 1951. Nul besoin d’insister sur le contexte historique dans lequel elle a été établie. En 1944, la République se réinstalle. Elle veut laver l’affront de Vichy et de la collaboration. L’objectif du Gouvernement provisoire du général de Gaulle est de mettre en place, au-delà du droit pénal classique, une procédure de dégradation nationale à même de restaurer l’honneur du pays en écartant de la communauté nationale ceux qui ont pactisé avec l’occupant. Il voulait par là même affirmer avec force que ceux qui s’étaient rendus coupables de collaboration étaient indignes de l’appartenance à la communauté nationale, tout en limitant, par ce recours à une justice symbolique, les pièges et les fractures dans lesquels la communauté nationale risquait alors de s’abîmer, de sombrer, en raison des rancoeurs personnelles et des règlements de compte de la Libération.
L’exposé des motifs de l’ordonnance du 26 août 1944 assume d’ailleurs explicitement « que le système de l’indignité nationale […] s’introduit délibérément sur le terrain de la justice politique ».
Les peines prononcées, dont on comprend aisément que le contexte politique de l’époque les ait justifiées, ont créé des situations personnelles juridiques à ce point compliquées que l’ordonnance du 26 novembre 1944 a été abrogée par la loi d’amnistie du 5 janvier 1951.
Le texte qui est examiné aujourd’hui se propose de rétablir ce crime d’indignité nationale sinon dans des formes complètement identiques, du moins en présentant des objectifs similaires. Son champ d’application est du reste identique à celui de l’article 1er de l’ordonnance.
Vous souhaitez en effet punir un tel crime de trente ans de réclusion criminelle et l’assortir obligatoirement d’une peine complémentaire d’indignité nationale perpétuelle, qui comprendrait notamment la privation des droits civiques, l’exclusion de la fonction publique, l’interdiction d’exercer un certain nombre de professions, d’administrer ou de gérer une société, de séjourner dans des lieux précis…
Je veux d’abord souligner qu’il existe déjà des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées pour des infractions de nature terroriste, très similaires à celles que vous envisagez. J’y insiste, il s’agit d’utiliser l’ensemble de l’arsenal juridique solide et puissant qui est à notre disposition pour lutter contre les terroristes. La portée de votre proposition de loi est avant tout symbolique – vous le reconnaissez d’ailleurs vous-même.
Par ailleurs, en sanctionnant automatiquement celui qui serait reconnu coupable du crime d’indignité nationale de l’ensemble de toutes les peines prévues par l’article 2, cette proposition de loi, telle qu’elle est rédigée, est en contradiction avec un autre principe à valeur constitutionnelle, celui de l’individualisation des peines.
Au-delà de la nécessité d’instaurer une telle peine, non caractérisée au regard de notre arsenal juridique actuel, et des risques d’incompatibilité avec d’autres normes fondamentales, je veux mettre en garde sur deux points majeurs, d’ordre politique cette fois.
Quand, à la Libération, est instauré ce crime d’indignité nationale, la République cherche alors à asseoir sa légitimité. Elle souhaite marquer une rupture fondamentale avec le régime de Vichy. La République se sait fragile, elle est lucide : elle se souvient qu’en juin 1940, il suffit de quelques jours pour qu’elle fût emportée. Bien sûr, nous devons toujours être vigilants. La République est une oeuvre de longue haleine et un combat de chaque instant. Mais la menace est aujourd’hui – comme le président de la commission des lois l’a reconnu dans un récent rapport – d’une nature fort différente. On ne saurait comparer la France de 1944, libérée mais traumatisée par quatre années de collaboration avec l’occupant, avec celle d’aujourd’hui, dont les citoyens ont rappelé encore dernièrement, par une mobilisation collective sans précédent durant les jours tragiques que nous avons connus en janvier, leur attachement aux principes et aux valeurs qui fondent notre démocratie.
Enfin, si l’indignité nationale est censée être une peine infamante, croit-on réellement qu’un terroriste, qui cherche à miner notre société de l’intérieur, pourrait y être sensible ? Une telle mesure risque bien de manquer son but, et peut-être même, paradoxalement, de décerner en quelque sorte des brevets de terrorisme à ceux qui d’eux-mêmes s’excluent de la communauté nationale et dont l’unique objectif est de mettre à bas la nation. Or l’enjeu est de mettre les terroristes hors d’état de nuire. L’indignité nationale n’apporte à cet égard aucun début de solution.
Mesdames et messieurs les députés, évitons les lois d’affichage et les lois d’exception, vite votées mais jamais appliquées.
Protestations sur les bancs du groupe UMP.

C’est le Premier ministre lui-même qui a parlé d’exception ! « À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles », a-t-il dit.
L’urgence est de renforcer nos moyens ensemble. L’urgence est d’appliquer le cadre juridique existant. Sachons utiliser les armes de la République pour lutter contre le terrorisme, en appliquant avec fermeté et avec la plus grande détermination le cadre légal existant. Telle est et demeurera la position du Gouvernement.
Pour toutes les raisons que je viens d’exposer, le Gouvernement est défavorable à la présente proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et RRDP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les moments extrêmement difficiles qu’a traversés notre pays en ce début d’année 2015 donnent à la discussion qui nous rassemble aujourd’hui un relief tout particulier. Avant d’évoquer en détail la proposition de loi, je souhaite rappeler que, face aux attaques dont notre nation a fait l’objet, et malheureusement pourrait encore faire l’objet à l’avenir sous quelque forme que ce soit, la sauvegarde de notre cohésion nationale est un préalable incontournable, un préalable qui ne doit souffrir aucune discussion dans cet hémicycle.
La France est exposée depuis des décennies au phénomène du terrorisme, qu’il soit international, en lien le plus souvent avec les conflits du Proche et du Moyen-Orient, ou d’origine nationale, voire régionale : je pense aux attentats perpétrés par Action directe, au terrorisme basque ou corse. Afin de lutter contre ce phénomène multiforme et mouvant, elle a, dès le milieu des années 1980, mis en place un arsenal juridique permettant de lutter contre les actes de terrorisme tout en respectant les principes de l’État de droit.
Cet arsenal, efficace dans la plupart des cas, est aujourd’hui devenu en partie obsolète. Il ne correspond pas à une nouvelle menace qui porte un nom : le djihadisme.
S’il n’est ni nouveau ni spécifique à la France, le développement du djihadisme violent dans notre pays s’est très fortement accentué ces derniers mois. La France est aujourd’hui confrontée à des départs importants, notamment en Syrie, de jeunes gens, mais parfois aussi de familles entières, aux profils très divers. Les Français seraient, parmi les combattants étrangers, l’une des communautés les plus représentées. Près de quatre-vingts d’entre eux auraient déjà trouvé la mort en Syrie. Ils participent activement aux mises en scènes barbares orchestrées par l’État islamique et sont actifs sur les réseaux sociaux, détruisant leur passeport français ou participant activement à la réalisation de vidéos macabres d’exécutions de ressortissants occidentaux.
Si de nombreux pays européens sont concernés par ce phénomène, la France est l’un des rares pays, voire le seul, à intervenir militairement dans ces zones, où des ressortissants français djihadistes peuvent donc être au contact direct de nos forces armées. Ceci est particulièrement vrai au Mali et dans la bande sahélo-saharienne.
Nos forces de l’ordre, quels que soient leur niveau et leur lieu d’intervention, sont tout particulièrement exposées. Or nous ne pouvons accepter que des ressortissants français prennent les armes contre les forces armées et de sécurité françaises et continuent de bénéficier des bienfaits et droits attachés à la qualité de citoyen français, alors même qu’ils bafouent les droits les plus élémentaires que l’on doit à sa patrie et à la République.

C’est pour répondre à cette situation scandaleuse que la proposition de loi « visant à faire perdre la nationalité à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français et à rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité », est présentée par notre collègue du Rhône, Philippe Meunier. Elle fait suite à une première proposition de loi rejetée par la majorité le 4 décembre 2014. L’article 1er de cette proposition de loi prévoit la perte de la nationalité pour tout individu qui aura été arrêté ou identifié portant les armes contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou contre tout civil français. Elle propose par ailleurs, dans son article 2, de rétablir le crime d’indignité nationale, assorti d’une peine de dégradation nationale, pour les Français sans double nationalité.
L’article 1er prévoit la perte de la nationalité française – et non la déchéance – quels que soit le mode et la date d’acquisition de ladite nationalité, et complète le code civil, en y insérant un article 23-8-1 après l’article 23-8, afin d’élargir l’incrimination à tout individu « arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité française ou tous civils Français ».
La procédure de perte de nationalité présente, à mes yeux, trois avantages majeurs. Premièrement, elle peut concerner tous les Français quelle que soit la façon dont ils ont acquis ou se sont vus attribuer la nationalité, sauf si elle a pour effet de les rendre apatrides – elle concerne donc tous les binationaux. Deuxièmement, elle ne comporte aucune contrainte de limitation dans le temps pour sanctionner les faits reprochés, contrairement à la procédure de déchéance, enserrée dans un délai de dix ou quinze ans. Troisièmement, cette sanction ne doit pas être prise par décret après avis conforme du Conseil d’État, comme c’est le cas pour la déchéance de nationalité, mais après un avis simple, que le Gouvernement peut surmonter, s’il est négatif, en adoptant le décret en Conseil des ministres.
Cet article propose par ailleurs que l’individu, devenu étranger à la suite de la perte de nationalité française, fasse l’objet d’une mesure d’expulsion lorsqu’il est présent sur le territoire national, ou d’une interdiction administrative de territoire lorsqu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national.
L’article 2, quant à lui, vise à rétablir le crime d’indignité nationale, assorti d’une peine de dégradation nationale. Le rétablissement de ces peines viserait tout Français qui trahirait notre pays en portant les armes ou en se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations menées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises, soit sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée, soit sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre laquelle la France est engagée militairement.
Le crime d’indignité nationale serait puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende. La peine de dégradation nationale devrait obligatoirement être prononcée à titre complémentaire par le juge à titre définitif, ou par décision spécialement motivée, pour une durée de trente ans. Elle implique un certain nombre d’interdictions pour le condamné : privation de tous ses droits civiques et politiques ; privation de ses droits publics ; diverses interdictions professionnelles dans le secteur public et privé ; impossibilité de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Mes chers collègues, je regrette, comme l’ensemble du groupe UMP, que la commission des lois ait adopté les amendements déposés par les députés écologistes. Je regrette également qu’elle ait rejeté un amendement du rapporteur tendant à insérer dans le code civil un nouvel article 23-8-2, prévoyant un nouveau cas de perte de nationalité française. Ce nouvel article concernait les Français condamnés pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.
Certains d’entre vous se sont gaussé, lors de l’examen du texte en commission ou dans cet hémicycle, de la portée trop symbolique de cette proposition de loi.
Je tiens à leur rappeler deux choses.
Premièrement, que les symboles ont toujours leur importance, et particulièrement sur le sujet qui nous intéresse. N’oublions pas que l’attitude de notre propre opinion publique fait partie de la lutte contre le fléau qui nous gangrène. Il est de notre responsabilité de montrer à nos concitoyens que la représentation nationale s’adapte aux menaces et donne les moyens à notre justice de remplir son rôle. Nos concitoyens ne comprendraient pas qu’après les événements dramatiques du début d’année, tout continue comme si de rien n’était. Huit Français sur dix sont favorables à la déchéance ou à la perte de nationalité française pour les binationaux condamnés pour des actes de terrorisme sur le sol français ; et sept Français sur dix sont favorables à l’interdiction du retour en France de Français que l’on soupçonnerait d’être allés se battre dans un pays ou une région contrôlés par des groupes terroristes.
Ma deuxième observation va au-delà du symbole. La peine de trente ans d’emprisonnement pour crime d’indignité nationale et la déchéance de nationalité qui la complète ont toute leur importance en termes de graduation. Une fois ces peines appliquées à une personne binationale, il n’existera plus aucune entrave à son expulsion définitive.
Que des hommes nés dans notre pays, de nationalité française, placés sous la responsabilité de la République et de l’école républicaine, sombrent dans la plus barbare des violences n’est pas tolérable. Il y a aujourd’hui, dans notre pays, une fraction de jeunes Français islamistes terroristes, instrumentalisés par l’État islamique, qui veulent soumettre la France, en particulier, et l’Occident, en général, à des idéaux barbares et infamants. Voilà l’ennemi ! Il faut le neutraliser par tous les moyens, en nous gardant bien de faire le moindre amalgame avec l’islam modéré que pratique la majorité des musulmans de France.
Je me souviens d’avoir entendu ici même, en décembre dernier, un de nos collègues dire que les peines complémentaires incluses dans cette proposition de loi étaient disproportionnées. Trois mois après l’horreur de Charlie et l’horreur de l’Hyper Cacher, ce député fait-il toujours le même raisonnement ? Trois mois après avoir défilé dans les rues de France, comme 7 millions de nos compatriotes, peut-il nous dire ce qu’est une réponse proportionnée à un fanatique qui tue des journalistes, des Juifs, des policiers, des touristes innocents, comme à Tunis, ou des soldats de son propre pays ?
Mes chers collègues, la situation nous interdit de rester enfermés dans des dogmes bien pensants, dans une culture de l’excuse et de l’angélisme, qui conduiront nos démocraties à leur perte.
Vous l’aurez compris, le groupe UMP soutient sans ambiguïté la proposition de loi de notre collègue Meunier. Et je tiens à dire, pour conclure, que le groupe UMP est profondément choqué de voir que le groupe socialiste a déposé sur ce texte une motion de rejet préalable.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le terrorisme djihadiste a frappé la France et continue de la menacer. Il occupe nos travaux, alimente les angoisses de nos concitoyens, ébranle et défie notre modèle de société. Ce phénomène, inédit par sa nature et par son ampleur, mute comme un cancer et appelle des réponses fortes et innovantes.
Les conflits armés se multiplient à travers le monde. Dans une grande partie du Moyen-Orient, dans le Sahel, au Nigeria, les États se sont effondrés et les sociétés sont déchirées par des guerres civiles. Partout, c’est l’islam radical djihadiste, qu’il soit sunnite ou chiite, qui est la source de ces conflits et qui menace la paix et la stabilité internationales.
La France et l’Europe ne sont hélas plus à l’abri, comme le montrent les attentats commis à Toulouse en 2012, et plus récemment à Paris, mais aussi à Copenhague. Mais il y a plus, et c’est un comble : un nombre croissant de citoyens français s’engagent aux côtés des terroristes islamistes, parfois contre nos propres forces, et se livrent eux aussi à des exactions innommables. Ils sont l’un des nouveaux visages de la barbarie la plus abjecte, et le phénomène va en s’aggravant. Ils étaient cinquante en mars 2013, et le ministère de l’intérieur dénombre aujourd’hui plus de 1 400 Français impliqués dans des filières djihadistes. Parmi ceux-ci, une bonne moitié, soit environ 700 personnes, serait actuellement présente en Syrie et en Irak. Mais combien ne sont pas répertoriés ? Combien exactement sont rentrés sur le territoire national ? Combien d’émules ont-ils fait ? Nul ne le sait vraiment.
Le djihad est devenu l’échappatoire de toutes sortes de déséquilibrés en quête de repères et en mal de gloire. Nombre de ces djihadistes français – plus de 25 % d’entre eux, semble-t-il – sont des convertis. Et cette tendance déconcertante frappe les hommes comme les femmes, les citadins comme les ruraux, les jeunes insérés comme les désoeuvrés. On leur promet aventure, argent, armes, puissance, sexe même ! Ils sont légions, en Syrie, en Irak, dans le Sahel, en France même, chez nous, dans les prisons, dans les cités, au coeur de nos villes où, à l’instar des Nemmouche, Kouachi ou Coulibaly, ils sont déterminés à poursuivre leur lutte barbare, sans limites ni concessions, contre la France et ses symboles. Ouvrons les yeux : le djihad a été importé sur le sol national.
Quelques rappels, d’abord.
Le groupe UDI a pris depuis longtemps conscience de l’ampleur et de la gravité du phénomène, et nous avons fait des propositions pour répondre aux défis posés par ces terroristes djihadistes de l’intérieur. C’est ainsi qu’avec Jean-Christophe Lagarde, nous avons évoqué, dès septembre 2014, l’opportunité d’une loi visant à étendre la déchéance de la nationalité française à tout individu portant les armes ou assistance aux côtés de terroristes, dans le respect des principes fondamentaux du droit de la nationalité. En décembre 2014, notre groupe avait apporté son soutien – avec quelques réserves, certes – à la proposition de loi déposée par Philippe Meunier « visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police ». J’avais personnellement, comme beaucoup de collègues de l’opposition, proposé plusieurs amendements, dont un portant interdiction des drapeaux d’organisations terroristes, l’autre privant du droit aux prestations sociales les djihadistes et leurs familles. Tous ces amendements de l’opposition furent hélas rejetés par l’Assemblée nationale.
La présente proposition de loi reprend certains des amendements rejetés en décembre dernier. Le texte que nous examinons aujourd’hui définit ainsi, à l’article 1er, une nouvelle situation pouvant entraîner la perte – et plus seulement la déchéance – de nationalité. Il rétablit par ailleurs, à l’article 2, le crime d’indignité nationale. Le groupe UDI soutient la présente proposition de loi, même s’il estime qu’elle doit être complétée pour en renforcer l’effectivité et l’efficacité. Par-delà le symbole et la réaffirmation de l’idéal républicain face à la barbarie du terrorisme djihadiste, ce sont des réponses concrètes qu’il faut apporter, et des moyens opérationnels qu’il convient d’accorder à l’État, dans le respect des droits et libertés qui sont au coeur de notre modèle républicain.
L’article 1er de la proposition de loi prévoit la perte de nationalité, applicable à tout individu binational, arrêté ou identifié portant les armes, ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français. Et ce, aussi bien sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée que sur le territoire français, si l’individu agit au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.
Notre groupe considère que l’article 1er de la proposition de loi permet de pallier une carence de notre droit positif et qu’il apporte une réponse efficace à ce nouveau phénomène. En l’état actuel du droit, le code civil permet de retirer la nationalité aux individus qui se seraient livré « au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France » Or, si le droit mentionne les actes accomplis au profit d’un État étranger, il ne prévoit pas explicitement le cas de ceux qui portent les armes contre nos soldats, nos forces de police et nos concitoyens. L’acquisition de la nationalité française, quel que soit son mode, est et doit demeurer un acte fort et symbolique. La perte est, et doit demeurer, l’exception.
Pour autant, des individus qui s’affichent ouvertement comme des ennemis de la France et qui la vomissent peuvent-ils encore se revendiquer français ? Au-delà de la portée purement symbolique qu’on a bien voulu lui prêter, cette disposition serait aussi une mesure utile de prévention et de protection, puisqu’elle permettrait d’identifier et d’éloigner les djihadistes binationaux. Cette mesure, la République la doit à l’armée française, à nos forces de police, aux journalistes et libres-penseurs, et plus généralement à tous les citoyens, et plus particulièrement aux Français juifs, qui sont à chaque fois ciblés par les djihadistes, uniquement parce qu’ils sont juifs.
En ce qui concerne les personnes visées, il s’agit uniquement de binationaux. Aucun risque donc de porter atteinte aux principes fondamentaux du droit français de la nationalité : personne ne sera privé du droit d’avoir une nationalité, personne ne sera apatride. Ce texte est pleinement compatible avec les engagements internationaux de la France. De plus, il ne crée pas de rupture d’égalité devant la loi, selon que le terroriste en cause a été naturalisé ou qu’il a acquis la nationalité française en naissant sur le sol national ou par filiation. Contrairement à la proposition rejetée en décembre dernier, la mesure s’applique de manière égale à tous les binationaux.
S’agissant de l’introduction d’un crime d’indignité nationale à l’article 2, le groupe UDI soutient cette mesure répressive, même s’il estime qu’elle devrait être complétée par un volet préventif, consistant à imposer un contrôle administratif des personnes soupçonnées de s’être engagées dans des groupes terroristes à l’étranger. Cette peine a une fonction de cohésion nationale. Ce texte permet de viser et d’exclure les détenteurs de la seule nationalité française se rendant coupables des faits mentionnés dans l’article 1er. En effet, ces derniers échappent, hélas, conformément aux engagements internationaux de la France, aux risques de perte ou de déchéance de nationalité du fait qu’ils deviendraient apatrides. Logiquement, ce crime serait lourdement puni : jusqu’à trente ans de détention criminelle et 450 000 euros d’amende, et une peine complémentaire de dégradation nationale qui serait systématiquement appliquée, et qui implique toute une série de privations de droits.
Certains affirment que s’inspirer de l’héritage de la Libération serait anachronique, que le contexte de l’après-seconde guerre mondiale était trop particulier pour inspirer le législateur en 2015. Pour notre part, nous avons la conviction que le combat se situe sur le terrain des valeurs, de la civilisation. Et nous sommes d’accord avec le rapporteur de la proposition de loi : les principes qui ont inspiré les rédacteurs de l’ordonnance de 1944 sont plus que jamais valables et d’actualité : « Tout Français qui s’est rendu coupable d’une activité antinationale caractérisée » est « un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs ».
On a parlé de portée purement symbolique, mais les symboles comptent, mesdames et messieurs les députés ! Les djihadistes, eux, l’ont, hélas, bien compris. C’est le rôle de la représentation nationale de définir le cadre du vivre ensemble, le domaine de la République.
D’aucuns soutiendront que, les djihadistes ayant une psychologie très éloignée des vichystes, la portée symbolique serait nulle. Pire : cette mesure aurait l’effet pervers d’alimenter la martyrologie djihadiste en faisant de ces terroristes des héros. Je rappellerai une chose simple : en légiférant, nous ne cherchons pas à nous mettre dans l’état d’esprit de ces djihadistes, ce serait vain. Nous voulons envoyer un message clair et sans ambiguïté aux apprentis ou aspirants djihadistes : on ne trahit pas impunément sa patrie ! Faire le choix du djihad contre la République, c’est quitter la famille nationale et c’est un aller simple, sans retour possible.
Mais il faut aller plus loin. Le pape François le rappelait récemment : le monde actuel vit une sorte troisième guerre mondiale. Il faut donc être dans l’anticipation plutôt que dans la réparation. À cet effet, il faut aussi développer des instruments de prévention efficaces. C’est pourquoi, comme nous l’avons fait par l’intermédiaire de Jean-Christophe Lagarde en novembre dernier, le groupe UDI propose de mettre en place un dispositif de contrôle administratif des personnes sans double nationalité, soupçonnées de s’être engagées dans des groupes terroristes à l’étranger.
Concrètement, il s’agit de renforcer la prévention des actes terroristes et du développement des filières djihadistes. L’État pourrait ainsi refuser l’accès au territoire, contrôler les conditions d’un retour et surtout imposer un dispositif strict de surveillance administrative, voire un suivi socio-éducatif sous la forme d’un processus de déradicalisation pour les éventuels repentis. La présente loi devrait être complétée dans ce sens dans les mois à venir.
La France se doit de réagir. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous soutenons cette proposition de loi. Je vous invite tous à oublier nos clivages politiques. La lutte contre le terrorisme n’est ni de droite, ni de gauche, c’est bien une cause nationale, Manuel Valls le rappelait ici dans un grand discours. Face à cette menace, nous devons présenter un front uni. L’ennemi menace nos soldats, nos policiers, nos concitoyens, notre modèle républicain.
Avant de rendre la parole, je tenais néanmoins à ajouter deux remarques d’importance.
Tout d’abord, notre diplomatie doit aussi être pleinement mobilisée dans ce combat. On ne peut avoir de politique à géométrie variable lorsqu’il s’agit de lutter contre le terrorisme. Je le rappelais de façon prémonitoire le 13 mai dernier : on ne peut adopter des lois contre le terrorisme et, dans le même temps, entretenir des relations, quelles qu’elles soient, avec des États qui soutiennent, abritent et financent le terrorisme.
Il faut être lucide : le terrorisme ne se développe que parce que des États lui apportent leur concours logistique, financier, idéologique, et militaire. Ces États, nous les connaissons et, hélas, les fréquentons quand on ne flirte pas avec eux : l’Iran, théocratie djihadiste ; la Syrie, son vassal ; l’Arabie Saoudite et le Qatar, champions du salafisme wahhabite ; et d’autres encore.
Je vous demande de bien avoir cela à l’esprit alors que nous négocions, aux côtés de nos alliés, sur le dossier nucléaire iranien. Sur ce front, nous sommes le dernier rempart, nous ne pouvons donc pas céder.
Enfin, un travail considérable reste à accomplir dans le champ de l’éducation et c’est là-dessus que je voudrais clore mon propos : un enfant, quel qu’il soit, ne naît pas terroriste, raciste ou antisémite.

Une stratégie de prévention efficace commence en amont par l’école, creuset de la République.

Le défi est considérable et global. Il exige de nous une mobilisation totale sans faille pour un combat de longue haleine qui requiert lucidité, détermination, persévérance et efficacité. Notre République, nos valeurs, notre civilisation sont en jeu.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, la proposition de loi qui a été déposée par M. Meunier mérite qu’on l’étudie. Elle pose deux problèmes : celui de la perte ou de la déchéance de nationalité, et celui de la création d’une nouvelle infraction. Étudions-les un par un.
Je pense que la perte de nationalité est, parfois, une des réponses qui doit être apportée.

Simplement, il faut arriver à repenser et à redéfinir les limites de cette perte de nationalité. Premièrement, alors que le rapport semble envisager la possibilité d’aller jusqu’à l’apatridie, cette possibilité doit être clairement rejetée. Une telle mesure ne peut avoir pour effet de rendre qui que ce soit apatride. J’ai entendu votre tentative de justification, monsieur le rapporteur, et vos motifs ne correspondent pas tout à fait à votre dispositif. C’est le premier élément : il faut éliminer toute possibilité de rendre quelqu’un apatride.
Deuxièmement, rappelons que la déchéance de nationalité existe déjà. Son application est très restreinte, mais cela existe déjà, et j’ai entendu madame la secrétaire d’État dire que ce serait l’un des éléments qui pourraient désormais être pris en considération.

Troisièmement, la jurisprudence et les magistrats aiment pouvoir répondre par des sanctions adaptées aux crimes ou aux délits qui leur sont soumis. Chacun comprend bien que lorsqu’il y a un accident de voiture, le responsable est susceptible d’être privé de son permis de conduire. De même, chacun comprend bien que lorsqu’il y a une attaque contre la nation, le problème de la nationalité se pose.
Dans quelles situations appliquer cette sanction ? Vous évoquez simplement ceux qui portent les armes. C’est à mon avis une définition beaucoup trop large. J’estime que, pour tous les crimes de sang – qui constituent une catégorie que nous connaissons bien – la perte de la nationalité peut être envisagée.
Comment les magistrats peuvent-ils être saisis ? La sanction doit-elle être automatique, ou bien doit-elle être en fonction d’une motivation spécifique de la décision ? Je pense que c’est bien évidemment le second cas qui doit s’imposer. Cela doit-il s’imposer simplement pendant la période de la détention, ou au-delà ? Vous avez prévu que la peine puisse s’appliquer durant trente ans, cela peut se discuter, mais je crois qu’elle doit à l’évidence couvrir la période de la détention, et même aller un peu au-delà. Mais la perte de la nationalité ne doit pas obligatoirement durer toute la vie.

En ce qui concerne maintenant le crime d’indignité nationale, que vous souhaitez récréer, je voudrais d’abord rappeler que la France a eu à affronter des menaces aussi graves que le djihadisme. C’est notamment le cas des anarchistes et des nihilistes. Ici, dans cet hémicycle, une bombe a été lancée par Vaillant.

Nous sommes bien d’accord, monsieur le ministre ! Les attaques contre la République étaient très importantes : ils ont tué un Président de la République, Sadi-Carnot, et un ministre des affaires étrangères, Louis Barthou. Et la Troisième République a réussi à lutter avec ses propres armes.

Sous la Quatrième République, nous avons connu tous les problèmes liés au FLN. Sous la Cinquième République, tous les problèmes liés à l’OAS. Nous avons essayé de répondre en utilisant l’ensemble du code pénal tel qu’il existe. Pourquoi créer un nouveau crime d’indignité nationale alors même qu’existe déjà toute la panoplie pour réprimer les meurtriers, les assassins, et qu’il est prévu dans deux cas la possibilité de condamner à une perpétuité « réelle » ? Tout cela existe déjà.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de recréer ce que le président Urvoas a qualifié de « laïcisation de l’excommunication ».

Il faut l’écouter, le rapport qu’il a rendu sur la question est de grande qualité, et M. le rapporteur de la présente proposition de loi l’a souligné. En revanche, je vous écoute lorsque vous indiquez qu’il est nécessaire de prévoir des peines complémentaires qui concernent tous les droits civiques, tous les droits civils et tous les droits politiques. À ce niveau, c’est une réponse qui doit être apportée.

Vous le voyez, il y a dans ce texte des propositions qui sont acceptables à condition de mieux les définir et de laisser un certain pouvoir d’appréciation aux magistrats à ce niveau. C’est pourquoi, compte tenu du fait que j’estime nécessaire de repenser véritablement le risque que nous connaissons et l’attaque que la République subit, je m’opposerai à la motion de procédure et je souhaite que nous ayons la possibilité de discuter jusqu’au bout de votre proposition.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, au lendemain des attentats de janvier, une réflexion collective a été lancée par le Premier ministre pour chercher des pistes et définir les dispositions adéquates de lutte contre le terrorisme.
La proposition de loi sur la perte de la nationalité française et le crime d’indignité nationale est une des douze mesures phares prônées par l’UMP pour lutter contre le terrorisme.
Le Gouvernement, quant à lui, a préféré agir, je crois que c’est important de le rappeler.
Il a d’abord décidé de renforcer le renseignement. Les moyens humains et matériels des services de lutte contre le terrorisme vont être accrus : 1 400 emplois seront créés au ministère de l’intérieur dans les trois ans, dont 1 100 pour le renseignement intérieur ; et cinq cent trente personnes seront recrutées en 2015.

Le Gouvernement a également décidé de renforcer les effectifs à la justice, à la défense et à Bercy : neuf cent cinquante nouveaux emplois seront créés dans les trois ans et répartis entre les juridictions, l’administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse.
Les services du ministère de la défense et des finances qui participent à la lutte contre le terrorisme ou les trafics alimentant les réseaux bénéficieront également d’un renfort en personnels : deux cent cinquante au ministère de la défense et quatre-vingts au ministère des finances, dont soixante-dix pour les douanes.
Le Gouvernement a également augmenté les moyens à hauteur de 736 millions d’euros sur trois ans. Il a aussi décidé de renforcer et d’encadrer nos services de renseignement, la commission des lois a terminé l’examen du projet de loi présenté par le Gouvernement à ce sujet. Il a encore décidé de lancer des programmes de « déradicalisation » et de lutter contre la diffusion de messages terroristes sur internet avec la mise en place d’une plate-forme de signalement, qui a commencé à fonctionner.
Il a décidé également de renforcer la coopération internationale, et notamment européenne. Enfin, je crois qu’un collègue l’a rappelé à la tribune, le Gouvernement a décidé de relancer la mobilisation contre le racisme et l’antisémitisme.
l’Assemblée nationale s’était déjà prononcée sur une proposition de loi de l’UMP similaire, visant à déchoir de la nationalité française tout individu portant les armes contre les forces armées françaises et de police. Pour l’essentiel, nous avons déjà tenu ce débat.
Le Premier ministre a également missionné Jean-Jacques Urvoas et Philippe Bas, les présidents des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, pour réfléchir à la question de l’indignité nationale. Le travail qui a été remis au Premier ministre par notre président de la commission des lois est de qualité, équilibré, il a été salué par l’ensemble de notre commission. Il est néanmoins sans appel dans son refus de réhabiliter dans notre droit une telle mesure, qui a eu une période de vie très courte, dans l’immédiate après-guerre.
Selon les termes de ce rapport, réactiver une telle incrimination risquerait : « d’alimenter la martyrologie djihadiste » et d’aller ainsi à « rebours de l’effet recherché », car cette sanction serait vécue « comme une confirmation glorieuse de la non-appartenance à la communauté nationale ».
Il faut donc s’épargner l’absurdité d’une telle situation, car à rebours même de l’effet recherché, la crainte d’être frappé de dégradation civique ne détourne pas les terroristes de la préparation et de la commission de leurs actes.
Le texte qui nous est soumis prévoit la perte de la nationalité française après simple avis du Conseil d’État pour « tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français ». Le texte prévoit aussi une peine de dégradation nationale.
Mes chers collègues, dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui, la déchéance de la nationalité a fait place à la perte de nationalité. Je ne suis pas sûr que cette astuce change quoi que ce soit à l’économie globale du texte, et dans cet esprit, je partage en tout point les propos de Mme la secrétaire d’État.
La déchéance de nationalité n’étant applicable qu’aux Français ayant acquis la nationalité française, dans cette seconde proposition de l’UMP, une procédure de perte de nationalité a été substituée à la déchéance pour que les Français binationaux, nés Français ou bien ayant acquis la nationalité soient tous concernés. On ne peut rendre apatrides les Français qui n’ont pas la double nationalité, mais ils pourraient être sanctionnés pour crime d’indignité nationale.
Je rappelle que l’article 1er de la Constitution dispose que tous les Français sont égaux, sans distinction d’origine. D’ailleurs, dans une récente décision datée du 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu une nouvelle fois que l’application de la procédure de déchéance portait atteinte au principe d’égalité entre les Français. Tout en validant la constitutionnalité d’une déchéance, il a de nouveau insisté sur la nécessité de prévoir un délai maximal entre la date d’acquisition de la nationalité et celle de la commission des faits reprochés, ainsi que des motifs exceptionnellement graves. Sans surprise, les sages ont réaffirmé la jurisprudence de 1996 tout en contrôlant l’application des principes de nécessité et de proportionnalité de la peine. À la différence de la déchéance, la perte de nationalité se présente comme une mesure générale, s’appliquant à tous, sans distinction. Dans les faits, ce ne serait pas le cas.
Reste à savoir comment sanctionner les terroristes et si les moyens prévus par cette proposition de loi parviendront à les dissuader. Chers collègues, si le rétablissement d’un crime d’indignité nationale et donc d’une peine de dégradation nationale ne pose aucune difficulté juridique, cette réponse me semble dérisoire, vaine et inadaptée face au terrorisme nouveau. En somme, cette réponse pénale me semble totalement inopérante. La commission des lois a pris en considération cette réflexion et a donc écarté le rétablissement du crime d’indignité nationale en adoptant, comme l’a rappelé M. le rapporteur, mes amendements de suppression.
Pensez-vous sérieusement que le candidat terroriste, notamment djihadiste, qui aspire au martyre, puisse craindre une loi qui l’empêcherait de voter ou d’être élu, ou encore de devenir fonctionnaire, notaire ou banquier ?
Sourires.

Si tel était le cas, l’article 131-26 du code pénal relatif à l’interdiction des droits civiques, civils et familiaux serait suffisamment dissuasif.
Le dispositif proposé par l’UMP s’appuie ouvertement sur l’ordonnance du 26 août 1944 prise à la Libération à l’encontre des collaborateurs de Vichy.

Selon l’historienne Anne Simonin, qui a inspiré les travaux du président de notre commission des lois, 98 436 personnes avaient alors été condamnées pour indignité nationale alors que 54 % des personnes poursuivies avaient été acquittées. Mais ce dispositif a été abrogé en 1951 et les peines infamantes ont finalement été retirées du code pénal en 1994.
Ce crime d’indignité nationale entraînait une privation des droits civiques, familiaux et patrimoniaux, une disparition comme personne juridique, une mort civile, sans le droit de voter ni d’exercer un certain nombre de professions, une incapacité quasi-absolue, la confiscation générale des biens présents et à venir, l’impossibilité de recevoir des héritages et de transmettre, une interdiction de résidence. À l’époque, la création de ce crime d’indignité nationale correspondait au remplacement rétroactif d’une peine plus lourde, la peine de mort pour crime d’intelligence avec l’ennemi et de lèse-nation.
Rappelons-nous que la déchéance de nationalité a également été instituée, le 23 juillet 1940, par le régime de Vichy et a entraîné la perte de nationalité de 446 personnes, dont le général de Gaulle, René Cassin ou Pierre Mendès France. L’histoire nous enseigne donc que ce dispositif peut aussi tomber entre les mains de régimes scélérats.
Chers collègues, la tentation est forte d’avoir recours à des dispositifs symboliques, sans efficacité aucune. Or, comme Mme la secrétaire d’État l’a dit très brillamment, la meilleure réponse est de réaffirmer la valeur de notre droit,…

…d’autant que notre code pénal prévoit déjà des mécanismes assez proches tels que la privation des droits civils, civiques et familiaux, les interdictions professionnelles ou sociales – c’est l’objet de l’article 131-28 – ou encore l’assignation à résidence.
Se référer à l’histoire de la République est toujours utile. Comme le souligne Jean-Jacques Urvoas dans son excellent rapport, le fait de créer des « non-sujets de droit » ne peut être qu’une mesure inopérante. La référence à l’histoire doit nous conduire à une réflexion sur l’efficacité et la pertinence des mesures proposées et nous éviter de légiférer sous l’emprise de l’émotion, sous le coup des événements.
Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les événements de janvier 2015 nous imposent de porter un nouveau regard sur le terrorisme et sur le défi mondial majeur auquel nous devons répondre. On ne peut ignorer l’absolue nécessité d’une réaction de l’État pour combattre les nouveaux visages de cette guerre et, évidemment, pour protéger nos concitoyens. C’est pourquoi je n’écarte pas d’un revers de main la question de l’indignité nationale, car toutes les manières possibles d’aider à combattre le terrorisme doivent être étudiées.

Je ne m’exprimerai que sur le sujet de l’indignité nationale.
La présente proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale aux fins, notamment, de rétablir le crime d’indignité nationale pour les Français sans double nationalité. Issue de l’ancien droit et de la législation révolutionnaire avant d’être reprise à la Libération dans les ordonnances de 1944 réprimant les faits de collaboration, cette peine vise à déshonorer publiquement un citoyen, non à l’exclure de la communauté politique. C’est la citoyenneté qui est affectée, non la nationalité.
Ainsi, aux termes des ordonnances de 1944, était inculpé d’indignité nationale le Français ou la Française qui avait, principalement, adhéré à un parti politique pro-collaborateur, participé au gouvernement de Vichy, qui s’était livré à une activité de propagande raciste ou fasciste, ou qui avait occupé une fonction de direction au Commissariat aux questions juives. L’antisémitisme était explicitement visé par le législateur résistant.
À ce crime nouveau correspondait une peine elle aussi nouvelle, infamante, la dégradation nationale. Or, vous le savez, les peines infamantes ont disparu du code pénal depuis 1994. Il s’agissait d’une peine symbolique et provisoire adaptée à une période particulière et qui, rappelons-le, a permis d’éviter la peine de mort à de nombreux vichystes. Cette indignité nationale était fondée sur un tout autre objectif et a permis d’éviter l’application de peines beaucoup plus cruelles.
La proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui ajoute à une peine de trente ans de prison et à une amende de 450 000 euros une peine de dégradation nationale, c’est-à-dire, entre autres, la privation des droits civiques et l’interdiction d’exercer un emploi dans la fonction publique.
Or, après réflexion, cette indignité nationale ne me semble pas appropriée pour répondre aux dangers de la société du XXIe siècle. L’horreur des actes terroristes appelle une tout autre démarche que celle de construire l’avenir en regardant un passé, qui plus est un passé récent qui n’a rien à voir avec la période que nous vivons.
D’une part, l’intervention du législateur doit être efficace. Or cette proposition de loi aurait-elle permis d’éviter les attentats de janvier dernier ou les tentatives d’attentats déjouées dernièrement par nos services de police ? La réponse est évidemment non. On sait qu’aucune peine du code pénal, aussi sévère soit-elle, n’arrête le fanatisme. Les peines les plus dures ne sont pas dissuasives. Celle-ci l’est évidemment moins encore : par son caractère inadapté, elle résonne à mon sens comme un aveu d’impuissance. Par ailleurs, le droit pénal offre suffisamment d’outils pour réprimer les actes terroristes. L’arsenal répressif à disposition des juges n’appelle pas une mesure supplémentaire de cette nature, inopérante.
D’autre part, cette peine d’indignité nationale risquerait d’être beaucoup plus un motif de gloire pour des terroristes en mal de martyre qu’une souffrance que leur infligerait le regard réprobateur de leurs concitoyens. En d’autres termes, en arrachant aux terroristes la dignité nationale, on ne ferait que leur donner ce qu’ils recherchent eux-mêmes. Les punir très lourdement, oui ; les exclure pour en faire des martyrs, non.
Par conséquent, je rejette cette proposition de loi, que je considère inefficace pour combattre ce contre quoi elle est censée lutter – le terrorisme –, et qui pourrait même produire des effets inverses à ceux qu’elle recherche. Nos concitoyens doivent le savoir : on ne doit pas les laisser penser que cette mesure est nécessaire pour lutter contre le terrorisme. Au contraire, comme on vient de le dire, cette proposition de loi présente des risques, sans parler des malentendus ou des incompréhensions négatives qui ne pourraient être évités. C’est dans une action globale recherchant résolument l’efficacité, telle que celle que mène actuellement le Gouvernement et à laquelle participe activement le législateur, au sein même de l’Assemblée nationale, dans une approche d’ailleurs constructive et partagée, que nous devons continuer à travailler.
Pour ces motifs, mes chers collègues, je ne voterai pas cette proposition de loi et j’appelle la représentation nationale à la rejeter.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Cette proposition de loi traduit de toute évidence une inquiétude des parlementaires, de droite comme de gauche, et de la population française, à laquelle le Gouvernement aurait tort de ne pas s’attacher.
La majorité prétend que le projet de loi relatif au renseignement permettra de renforcer la lutte contre le terrorisme. C’est vrai. Mais le renseignement, c’est la prévention – on attrape. Sans le pénal, le renseignement n’est rien.
Permettez-moi de vous dire qu’en matière de droit pénal, la France est très en retard. Même si nous l’avons adoptée à l’unanimité, la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est très insuffisante. Une fois l’infraction reconnue, la peine maximale encourue par un terroriste actif, qui a porté les armes contre la France, est un emprisonnement de neuf ans. Avec la réforme de Mme Taubira, neuf ans de prison, cela signifie trois ans de prison ferme,…

…puisque le juge d’application des peines est maître de l’application de cette peine…

…et que le pôle antiterroriste n’a pas les moyens d’influencer sa décision.
En réalité, des criminels ne passeront donc que trois ou quatre ans en prison.

C’est largement insuffisant.
Vous nous accusez de proposer des lois d’exception. Non, nous n’en avons pas besoin ! J’ai sous les yeux un livre magnifique, dont je recommande la lecture : c’est le code pénal. Le livre IV de ce code, qui comprend cinquante pages, s’intitule : « Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique ». Mes chers collègues, pourquoi ce livre IV du code pénal n’est-il pas appliqué, revendiqué, et n’a-t-il pas fait l’objet d’une circulaire du garde des sceaux ?

Pourtant, un certain nombre d’articles du code pénal, que je vous lirai rapidement, permettent de donner un certain corps à un délit ou à un crime. Il en est ainsi de l’article 411-4, qui concerne, d’abord, « le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ». Le terme « puissance » peut convenir, à la rigueur. Le droit de la guerre n’existe plus : la quasi-totalité du monde est en guerre, mais personne ne le sait ni ne respecte les règles du droit de la guerre. C’est un sujet dont nous devrons discuter à l’avenir.
Ainsi, l’article 411-4 du code pénal dispose : « Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France. »

C’est ce qu’on appelle le service de Français contre la France. En la matière, il n’est pas nécessaire de réformer le code pénal. Nous n’avons pas besoin de mesures d’exception : il suffit d’appliquer le droit pénal. Mais encore faut-il vouloir l’appliquer.

Pour ce faire, nous avons besoin de circulaires de droit pénal. Or nous n’en avons pas.

Je parle ici d’intelligence avec l’ennemi, un crime qu’il faut bien distinguer de la notion de terrorisme. Aujourd’hui, on met n’importe quoi sous l’appellation de terrorisme. Sur le territoire français, on peut admettre que l’incrimination de terrorisme se justifie – et encore, ça se discute… J’ai moi-même évoqué ce sujet avec les magistrats du pôle antiterroriste, dans le cadre de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Mais ce n’est certainement pas le cas en Irak – je ne parle pas de la Syrie, puisque le gouvernement français ne veut pas prendre de mesures contre ce pays, ce que je suis le premier à regretter. En Irak, donc, le gouvernement français est engagé dans des hostilités contre Daech. Parmi ceux qui tirent contre les avions français, il y a des Français… Leur peine devra bien entendu être individualisée, puisqu’il s’agit d’un principe constitutionnel.

Mais pour cela, le code de procédure pénale prévoit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent. Tout Français pris en train de lutter contre les armées françaises peut forcément faire l’objet d’une incrimination prévue par le code pénal. Tout le monde l’a oublié ! C’est curieux comme l’amnésie a frappé le garde des sceaux, dont c’est pourtant le métier.

L’instauration d’un crime d’indignité nationale et la limitation de la binationalité se heurteront à la fameuse Cour européenne des droits de l’homme dont nous parlions tout à l’heure. À ce sujet, je veux citer un article qu’on a aussi oublié – c’est incroyable comme nous sommes amnésiques !

Je vous demande une minute supplémentaire, madame la présidente. Tout à l’heure, M. Le Borgn’ s’est exprimé pendant quatorze minutes ; pour ma part, je n’en ai eu que cinq.

Me permettez-vous de lire simplement l’article 15 de la convention européenne des droits de l’homme ? Il s’intitule : « Dérogation en cas d’état d’urgence ».
Je cite : « En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante – c’est-à-dire les États – peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. » Elle doit en informer le secrétaire général du Conseil de l’Europe.
En réalité, nous disposons de moyens juridiques considérables qui ne sont pas appliqués. Que le Gouvernement ne vienne pas nous dire, mise à part la loi sur le renseignement qui est souhaitable, qu’il veut appliquer des mesures pénales contre le terrorisme, alors qu’il le pourrait avec les deux propositions concernant l’indignité nationale et la recherche sur les conditions d’acquisition et de retrait de la bi-nationalité.
Les Français se rendent compte que le Gouvernement se borne à faire des discours. Le Premier ministre nous dit que nous sommes en situation de guerre. Mais en situation de guerre, encore faut-il appliquer le code pénal ! Nous n’avons même pas besoin de prévoir des lois d’exception, car dans leur grande sagesse, les législateurs précédents ont tout prévu. Appliquez le droit pénal et nous aurons un pays qui sait se défendre !
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons ce matin une proposition de loi visant à réintégrer dans notre ordre juridique, le crime d’indignité tel qu’il fut pratiqué aux heures les plus sombres de l’histoire de notre pays. Ce crime de lèse-nation, nouveauté de cette proposition de loi, ajouté au retrait de la nationalité proposé par le premier article de la proposition, constitue selon l’opposition, l’arsenal juridique adéquat pour lutter contre la propagation du terrorisme.
Permettez-moi, mes chers collègues d’en douter,…

…tant ces propositions désuètes semblent aux antipodes d’une politique fondée sur le discernement et la raison.
L’article 1er vise à inscrire dans le code civil la révocation de nationalité française à tout individu arrêté ou identifié portant les armes contre l’armée, la police ou un civil français à condition qu’il possède une autre nationalité.
La résurgence d’organisations terroristes transnationales et la multiplication de crimes terroristes ont entraîné ces dernières années dans plusieurs États, un débat sur la déchéance ou la perte de nationalité afin de lutter contre le terrorisme. Il est tout de même édifiant de constater que malgré un clivage entre conservateurs et libéraux sur la notion même de citoyenneté comme droit ou comme privilège, seuls le Royaume-Uni et le Canada sont effectivement passés aux actes en mettant en oeuvre des dispositions aussi restrictives que celles qui sont proposées par cette proposition de loi.
Le gouvernement canadien a défendu que le retrait de la nationalité avait aussi pour but, concomitamment à l’impératif de sécurité publique de renforcer le principe de citoyenneté, ce qui au contraire a plutôt pour objectif de dénaturer l’irrévocabilité du statut de citoyen par rapport à celui plus éphémère de résident permanent.
Par ailleurs, en tant que député d’une circonscription dans laquelle nombre de nos concitoyens sont binationaux, je suis particulièrement choqué par cette disposition qui fait implicitement une distinction entre les Français.
Le second article vise à réintroduire dans notre droit un crime « d’indignité nationale » constitué des mêmes actes pour les personnes auxquelles la nationalité française ne peut pas être retirée car elles n’en ont pas d’autre.
Cette disposition de la proposition de loi fait explicitement référence au crime d’indignité nationale instaurée par l’ordonnance du 26 août 1944 afin de condamner les actes de collaboration active des Français avec l’ennemi. Cette référence historique, vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, est non seulement anachronique, mais inopportune sachant que l’indignité ne peut avoir la même résonance dans un État de droit dans lequel les lois respectent les principes républicains par rapport à une période où précisément le législateur avait souhaité marquer sa différence avec le gouvernement de Vichy.
Comme l’a remarquablement analysé le président de la commission des lois dans son rapport sur la peine d’indignité nationale – et comme l’a exprimé avant moi, M. Alain Tourret, il faut au contraire traiter les terroristes actuels de la même manière que l’avait fait le législateur au XIXe siècle en refusant le statut de martyr judiciaire aux anarchistes, les condamnant pour des crimes et délits de droit commun.
Les crimes commis aujourd’hui par les terroristes ne méritent pas d’être distingués par une peine particulière. Ils doivent être sanctionnés sans faiblesse pour ce qu’ils sont et il faut réaffirmer la force de l’État de droit face à la tyrannie et la barbarie.
Face à cette loi d’affichage, remettant au goût du jour de vieilles lubies droitières, le Gouvernement a choisi au contraire de renforcer l’arsenal pénal de répression avec la loi antiterroriste pénalisant l’entreprise terroriste individuelle ou collective, l’interdiction administrative de sortie ou d’entrée du territoire, le plan de lutte contre les filières terroristes, dispositifs qui seront bientôt complétés par un projet de loi relatif au renseignement. Que voulez-vous de plus ?

Plutôt que de céder aux tentations démagogiques et aux solutions d’affichage, tentons dans ce débat contre le fléau du terrorisme de réaffirmer nos principes.
Nos adversaires tentent par leurs crimes et leurs provocations abjectes de déstabiliser notre État de droit. Ils croient que leurs atrocités viendront à bout de notre modèle fondé sur la rationalité et sur la justice.
Monsieur le rapporteur, puisque vous demandez des exemples, je citerai celui de la Norvège. Le 22 août 2011, Anders Breivik faisait exploser une bombe dans le quartier des ministères à Oslo, puis tuait de sang-froid soixante-dix-sept adolescents sur l’île d’Utoya. Il avait affirmé avoir agi pour des motifs politiques et pour protéger son pays des dangers du multiculturalisme.
À l’issue d’un procès long et douloureux, les facéties insupportables de l’accusé n’avaient pas ébranlé l’idéal démocratique de l’état de droit norvégien. Les audiences publiques avaient pu révéler au grand public l’ampleur de son projet criminel et malgré l’émotion nationale, le tribunal avait procédé à une condamnation pour « actes de terrorisme » et « homicides volontaires » avec une peine de vingt et un ans de prison non compressible.
Le procureur avait alors déclaré que « Breivik avait peut-être atteint son but, mais l’État de droit aussi. Et nous ne pouvons pas sacrifier l’État de droit uniquement pour que Breivik n’obtienne pas ce qu’il veut."

C’est cela qu’il faut viser, l’exposition est la fierté du fonctionnement de nos institutions. Les citoyens norvégiens ont ainsi dépassé la pénibilité des débats…

…pour comprendre en profondeur et respecter le fonctionnement de leurs institutions. Mettons cela en avant plutôt que de céder à des lois qui, en dépit de ce que vous prétendez, sont des lois d’exception dictées par l’émotion et une idéologie sécuritaire. Je vous invite donc, mes chers collègues, à rejeter cette proposition de loi.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Permettez-moi tout d’abord de remercier M. Habib de son soutien. M. Coronado a eu le mérite de faire preuve de cohérence même si nous ne partageons pas le même point de vue. Madame Untermaier, si vous n’écartez pas d’un revers de main le rétablissement du crime d’indignité nationale, ne votez pas la motion de rejet préalable de votre groupe.

Monsieur Goasguen, vous faites toujours autant honneur à notre Assemblée nationale avec la clarté et la justesse de vos analyses.

Quant aux propos de M. Tourret, j’y reviendrai plus tard.
Plusieurs séries d’arguments et de reproches ayant été invoqués par la majorité et par le Gouvernement à l’encontre de notre proposition de loi, je souhaite y répondre.
S’agissant de la perte de la nationalité à l’encontre des terroristes, le premier de ces arguments consiste à mettre en doute la constitutionnalité de notre proposition de loi. Il faut, me semble-t-il, être très précis sur cette question.
Le Conseil constitutionnel a examiné à deux reprises, en 1996 et en 2015, la constitutionnalité des dispositions du code civil relatives à la déchéance de nationalité.
Il a tranché trois questions.
Premièrement, est-il conforme au principe d’égalité de traiter de manière différenciée les Français de naissance et les Français d’acquisition, en prévoyant un dispositif spécifique à ces derniers ? Il a répondu positivement.
Deuxièmement, est-il conforme au principe de proportionnalité de déchoir de leur nationalité les Français d’acquisition qui ont été condamnés pour des actes de terrorisme ? Oui, eu égard à la gravité particulière de ces actes.
Troisièmement, peut-on prévoir de les déchoir de leur nationalité quinze ans après l’acquisition de leur nationalité ? Oui, mais il ne faut pas aller au-delà.

Ces trois questions sont très différentes de celles soulevées par la présente proposition de loi lesquelles sont de trois ordres.
Peut-on priver de leur nationalité des Français de naissance pour acte de terrorisme, ou est-ce contraire au principe de proportionnalité ?
Peut-on priver de leur nationalité tout Français, de naissance ou d’acquisition, pour terrorisme, mais uniquement s’il possède une autre nationalité ? En d’autres termes, peut-on prévoir un régime différencié selon qu’un Français est ou non binational, ou est-ce contraire au principe d’égalité ?
Peut-on, à l’inverse, priver un Français de sa nationalité s’il n’en possède pas une autre, ce qui le rendra apatride ou est-ce contraire au principe de proportionnalité ?
Aucune de ces questions n’a été tranchée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci ne s’est jamais penché sur les articles actuels du code civil qui prévoient des pertes de nationalité à l’initiative du Gouvernement pour sanctionner certains comportements, à savoir les articles 23-7 et 23-8 du code civil.

On peut extrapoler dans un sens ou dans l’autre à partir de la jurisprudence constitutionnelle relative à la déchéance, mais la vérité est que les raisonnements que l’on tient, dans un sens ou dans l’autre, sont purement spéculatifs.
Au regard de la jurisprudence actuelle, personne ne peut prétendre que ce que nous proposons est inconstitutionnel, madame la secrétaire d’État, pas plus que nous ne pouvons affirmer que ces mesures seraient dépourvues de tout risque constitutionnel.

Les trois questions que j’ai évoquées n’ont pas encore été tranchées : une fois que l’on a dit ça, on a tout dit.
Plusieurs raisons me font cependant penser que le risque constitutionnel est faible.
Premièrement, répondre par la négative à la première question et considérer que priver de sa nationalité un Français de naissance est impossible, cela revient à déclarer inconstitutionnels les deux dispositifs de perte de nationalité prévus par les articles 23-7 et 23-8, qui existent déjà dans notre droit depuis 1889.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a déjà examiné le cas de perte de la nationalité française par acquisition d’une nationalité étrangère, dans une rédaction qui n’est plus en vigueur aujourd’hui, qui était celle de l’article 87 du code de la nationalité française. Cette perte était automatique et pouvait donc se faire contrer la volonté de l’intéressé, ce qui en faisait une sanction.

Le Conseil a admis sa conformité à la Constitution, dans une décision du 9 janvier 2014.
Deuxièmement, distinguer entre les Français ayant cette seule nationalité ou binationaux, c’est prendre en compte une différence objective et en rapport avec l’objet de la loi qui opère cette distinction. En effet, priver un individu de sa nationalité alors qu’il en possède une autre, ce n’est pas la même chose que de rendre un Français apatride.
Troisièmement, rendre un Français apatride ne me paraît pas pour autant contraire au principe de proportionnalité, dès lors que l’on prévoit, dans cette hypothèse, des garanties supérieures, ce que nous faisons avec l’article 23-8-2, qui exige une condamnation pénale préalable. L’instrument international de référence en la matière, la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, dont l’ambition est de limiter l’apatridie, l’autorise.
Pourquoi le Conseil constitutionnel se montrerait-il plus exigeant que l’instrument de référence en la matière ? Beaucoup d’autres États membres de l’Union européenne – l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, etc. – peuvent rendre leurs citoyens apatrides : pourquoi serions-nous plus restrictifs qu’eux sur ce point ?
En outre, j’ai déposé plusieurs amendements qui renforcent la solidité juridique du dispositif, nul ne peut le nier. J’ai proposé de remplacer le décret en Conseil d’État par un décret pris après avis conforme du Conseil d’État ; j’ai aussi proposé de renforcer les droits de la défense en précisant que les décrets de perte de la nationalité devront être pris, l’intéressé entendu ou appelé à produire ses observations, comme c’est le cas en matière de déchéance.
Les garanties procédurales accordées seraient donc fortes.
Le groupe SRC regrette, dans l’exposé sommaire de son amendement de suppression, que les garanties que je prévois ne soient pas identiques à celles prévues par l’article 23-8 du code civil. C’est – pardonnez-moi – un argument qui manque singulièrement de sérieux.
L’article 23-8 prévoit, d’abord, qu’il est possible au Gouvernement de passer outre un avis défavorable du Gouvernement, par la voie d’un décret en conseil des ministres : c’est bien moins protecteur que l’avis conforme du Conseil d’État que je vous propose !
Ensuite, l’article 23-8 prévoit que l’intéressé dispose d’un « droit de repentir », c’est-à-dire qu’il ne peut perdre sa nationalité que si le Gouvernement lui a préalablement adressé une injonction. J’ai évidemment écarté cette garantie lorsque j’ai élaboré mon dispositif : s’il est concevable de mettre en garde l’intéressé qui s’est mis au service d’un État étranger ou d’une organisation intergouvernementale dont la France ne fait pas partie avant de lui faire perdre sa nationalité, peut-on imaginer avec sérieux être obligé d’adresser une telle mise en garde préalable à quelqu’un qui s’est mis au service d’une organisation terroriste telle que Daech ?

Enfin, pour apaiser les craintes de ceux qui seraient paralysés par le risque constitutionnel, madame la secrétaire d’État, et n’oseraient rien entreprendre sur ce sujet par crainte de la censure du Conseil, j’ai aussi déposé deux amendements de repli, qui prévoient tous deux que la perte pourrait intervenir non seulement après condamnation pour acte de terrorisme, mais être décidée par jugement, comme cela est déjà prévu pour un cas de perte de la nationalité et comme cela était le cas pour la déchéance de nationalité, entre 1917 et 1938. Je préférerais, à titre personnel, que la perte résulte d’un décret pris après avis conforme du Conseil d’État.
L’un de mes amendements de repli exclut en outre que la perte puisse rendre l’intéressé apatride. Toutes les options sont ainsi sur la table.
Dans ces conditions, le choix que nous devons opérer est politique. Nous n’avons pas le droit de nous retrancher derrière de pseudo-arguments constitutionnels, alors que les questions dont nous traitons n’ont pas été tranchées par le Conseil constitutionnel.
Soit nous souhaitons pouvoir retirer leur nationalité aux Français condamnés pour actes de terrorisme, et il faut voter cette proposition de loi, éventuellement amendée, soit on considère qu’il ne faut pas les priver de leur nationalité parce que ce serait une sanction disproportionnée, ce que je réfute pour ma part. Chacun d’entre nous doit assumer ses responsabilités et ses choix.
À supposer même que le Conseil constitutionnel, in fine, nous donne tort, le choix serait encore politique, car nous ne vivons pas dans un gouvernement des juges : le sujet mériterait alors que nous révisions la Constitution pour surmonter l’obstacle que représenterait la jurisprudence constitutionnelle.

Le deuxième argument invoqué contre le dispositif de perte de la nationalité française que nous proposons est que le droit actuel serait suffisant. Je crois m’être suffisamment expliqué sur ce point dans mon intervention. Les articles 25 et 25-1 du code civil ne permettent pas de priver de leur nationalité les Français de naissance et les Français qui ne possèdent pas une autre nationalité. Ce sont deux graves lacunes.
Le troisième argument utilisé par la ministre et par la majorité contre le crime d’indignité nationale, également utilisé en commission, consiste à nous accuser de faire preuve de discrimination : il s’agirait de « stigmatiser » une partie de la population. En commission, par exemple, Mme Pochon m’a ainsi demandé pourquoi on n’avait jamais envisagé de telles mesures face au terrorisme basque ou corse.
Je vais être très clair à ce propos. Un acte terroriste est toujours inacceptable et il est délicat d’établir une forme de hiérarchie dans l’horreur. Tout ne se vaut cependant pas et il me paraît erroné de ne pas reconnaître que le terrorisme djihadiste auquel nous sommes confrontés aujourd’hui présente une spécificité. Le Premier ministre lui-même l’a reconnu, en employant les termes d’« islamo-fascisme ».
À ma connaissance, aucun terroriste basque ou corse n’a jamais tiré à bout portant dans la tête d’un enfant dans une école parce qu’il avait le tort, à ses yeux, d’être juif. À ma connaissance, aucun terroriste basque ou corse n’a jamais égorgé quelqu’un, puis diffusé la vidéo de cette atrocité.
Reconnaître qu’il y a une spécificité du terrorisme djihadiste, ce n’est pas minimiser la gravité des attentats perpétrés par les terroristes basque et corse. C’est reconnaître que certains actes, par leur barbarie, appellent des réponses spécifiques.
Cela me conduit naturellement aux arguments invoqués cette fois contre le crime d’indignité nationale.
Je salue, tout d’abord, la qualité du rapport que le président de la commission, Jean-Jacques Urvoas, a rendu sur le sujet.

L’historique de l’indignité nationale qu’il a retracé est particulièrement intéressant. Je n’en tire cependant pas les mêmes conclusions.
Il affirme, en substance, que s’inspirer de cet héritage de la Libération serait anachronique. Je ne partage pas du tout cet avis, comme du reste M. Habib.

Les principes qui ont inspiré les rédacteurs de l’ordonnance de 1944, à savoir « que la nation fasse le partage des bons et des mauvais citoyens » et que « tout Français qui s’est rendu coupable d’une activité antinationale caractérisée » est « un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs » sont plus que jamais valables et d’actualité.
La dernière fois que l’on avait tué des enfants en France en raison de leur religion, c’était durant la Seconde Guerre mondiale. Rétablir le crime d’indignité nationale pour sanctionner ceux qui, par leurs actes, se sont exclus de la nation, ce n’est pas un anachronisme.

Le président Urvoas évoque dans rapport la possibilité de renforcer la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 422-3 du code pénal et de lui donner un nouveau nom : la « dégradation républicaine, alors que je l’appelle pour ma part « dégradation nationale ».
Il me semble que les enjeux sont trop importants pour qu’on joue sur les mots à seule fin d’éviter de voter une mesure proposée par l’opposition. Mais si ce changement sémantique est suffisant pour que la majorité accepte de voter notre proposition, je me rallie sans difficulté à la vôtre, monsieur le président. Je pourrais également soutenir votre proposition d’étendre la perpétuité incompressible aux actes de terrorisme.
Monsieur Tourret, faisant preuve de l’esprit d’unité nationale qui devrait tous nous animer face au terrorisme, j’aurais également été prêt à soutenir l’amendement déposé par les membres du groupe RRDP, qui vise à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille. Son dispositif ne correspond cependant pas, sans doute à la suite d’une erreur de plume, à la volonté que ses auteurs ont exprimé dans leur exposé sommaire et il ne rendrait pas obligatoire le prononcé de cette peine complémentaire. Les projets de sous-amendements que j’avais envisagé de déposer n’étant pas recevables, je vous propose, si vous le souhaitez, que nous déposions un amendement commun sur ce sujet lors de l’examen en séance du projet de loi relatif au renseignement.
Comme vous le voyez, l’opposition est prête à faire preuve de l’esprit d’unité nationale et de dialogue constructif auquel le Président de la République et le Premier ministre nous ont appelés en janvier dernier. Malheureusement, le dépôt par le groupe socialiste d’une motion de rejet préalable démontre que cette prétendue main tendue à l’opposition n’était qu’une imposture visant à mentir une nouvelle fois aux Français.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

Avant de conclure, je rappellerai les propos d’un homme qui a perdu son fils et ses deux petites-filles, assassinés par Mohammed Merah :…

…« Mon petit cousin a été déporté à Auschwitz à l’âge de huit ans en 1943. Je pensais que les enfants ne seraient plus assassinés en France ». Je rappellerai aussi les mots de cette grand-mère dont la petite-fille de sept ans a été tout aussi lâchement assassinée par ce même Mohammed Merah : « Il a mis ma petite-fille par terre, il lui a tiré les cheveux, lui a mis une balle dans la tête ».
Des individus, ayant acquis la nationalité française ou Français de naissance, ont décidé de faire la guerre à la France. L’UMP ne les laissera pas prospérer sans qu’ils en paient le prix. C’est l’objet de notre proposition de loi, qui vise à les condamner à une peine de prison de trente ans, à leur faire perdre la nationalité française et à rétablir le crime d’indignité nationale.
L’UMP et l’UDI prennent leurs responsabilités.
Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et UDI.

J’ai reçu de M. Bruno Le Roux et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen une motion de rejet préalable déposée en application de l’article 91, alinéa 5, du règlement.
La parole est à Mme Paola Zanetti.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, permettez-moi tout d’abord d’excuser Mme Marie-Anne Chapdelaine, qui aurait dû vous présenter cette motion de rejet préalable, mais a dû regagner ce matin tôt, en urgence, sa circonscription. Je resterai fidèle à ce qu’elle vous aurait dit.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui met à notre ordre du jour la question du crime d’indignité nationale et de la perte de nationalité. C’est un sujet majeur pour notre République, consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme dans les deux alinéas de son article 15 : « Tout individu a droit à une nationalité » et « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ».

Elle s’inscrit dans un calendrier actif sur la question sécuritaire : celui, très récent, de la loi antiterroriste et du plan de lutte contre la radicalisation violente et, demain, de la loi sur le renseignement. Il importe donc de peser chacune de nos propositions à la lumière de la gravité de la situation, mais également de la cohérence et de l’efficacité de nos propositions.
L’idée de retirer la nationalité à des personnes ou de les en déchoir ne date pas d’hier. La disposition proposée s’inspire de peines qui existaient déjà : le bannissement de dix ans dans l’Antiquité, le crime de lèse-majesté sous la royauté ou le crime de « lèse-nation » appliqué par les constituants de 1789 à 1791.

La déchéance de nationalité, apparue sous le régime de Vichy, a impliqué des personnages de notre République tels que le général de Gaulle, Pierre Mendès France ou René Cassin. Cela ne les aura, fort heureusement, pas empêché de se battre pour la liberté de leur pays et de concourir à son destin, tout simplement parce qu’ils se savaient Français, quelles que soient les peines qui pesaient sur eux, que la nationalité française, avant d’être une question administrative, est avant tout une histoire d’amour pour leurs pays et pour les valeurs de la République.

Quels que soient son lieu de naissance ou ses origines, une personne qui se considère française l’est par essence et aucune forme de peine ne pourra le lui retirer. C’est, au-delà de la question juridique, une question de respect pour ceux qui aiment notre pays et qui se retrouvent dans ses valeurs. Ils sont nombreux, nés Français d’origine immigrée ou encore naturalisés Français, et bien plus nombreux que les individus visés par cette proposition de loi.
Madame la présidente, chers collègues, notre présence dans cet hémicycle a pour but de donner du sens, non seulement à notre action, mais surtout au bien vivre dans notre société.

Cette proposition n’y répond pas, et cela pour plusieurs motifs qui justifient, selon nous, son rejet.
Le premier est d’ordre juridique. Bien que retravaillée, cette proposition ne présente toujours pas les garanties procédurales nécessaires et suffisantes.
Le code civil, à l’article 23-8, prévoit que la perte de nationalité correspond à des cas où un Français serait ressortissant d’un autre pays, possède une autre nationalité et demande à perdre la nationalité française, qu’il se comporte comme le national d’un pays étranger dont il a la nationalité, ou encore parce qu’il sert dans l’armée ou un service public étranger contre l’avis de la France. La question du manque d’équilibre entre code civil et code pénal est pendante. Le texte ne résistera pas aux contentieux futurs qui pourraient en découler.
D’autre part, rappelons qu’en ce qui concerne les binationaux européens, la perte de la nationalité française, dans les faits, ne les empêchera pas de venir en France. L’espace Schengen est une zone de libre circulation :…

…si des individus européens veulent perpétrer des actes terroristes sur notre territoire, rien juridiquement ne peut les arrêter.

Le prochain motif est sans doute le plus important, car il s’agit de la question de l’efficacité de la mesure, qu’il s’agisse du retrait de nationalité ou du crime d’indignité.
Celles et ceux qui font le choix, par des actes terroristes, de porter atteinte à notre nation et à nos valeurs républicaines n’ont que faire de ne plus en être membres.

Leur action est inscrite dans une telle démarche de folie absolue, que la perte du lien qui les relie à leur pays d’origine ou d’accueil est assurément une menace qui ne provoquera chez eux aucun questionnement sur le sens des actes meurtriers qu’ils construisent.
Bien au contraire, elle pourrait agir négativement dans une situation déjà complexe. La perte de la nationalité ou le crime d’indignité seraient le symbole de leur abandon par notre pays.
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Elle pourrait devenir un instrument de propagande et viendrait s’ajouter aux justifications personnelles des individus dont la volonté est de se battre contre leur ancienne patrie.
J’imagine que les recruteurs de Daech profiteraient de l’aubaine pour démontrer que la France abandonne ou méprise ses enfants, qu’elle n’est pas digne d’eux
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

et que le combat qu’ils mèneraient contre l’Occident est entièrement légitime, puisque ce n’est pas, ou plus, leur pays.
La proposition de M. Meunier prévoit aussi l’expulsion hors du territoire, mais cela ne les empêchera pas de continuer la lutte armée dans un autre pays, alors que leur neutralisation relève de notre responsabilité.
Ces personnes étaient considérées comme françaises avant leurs actes mais, une fois leurs crimes perpétrés, vous proposez que nous nous défaussions de notre responsabilité, tout simplement en faisant d’eux des étrangers. S’il fallait résumer de manière caricaturale, cela consisterait, lorsque votre enfant se conduit bien, à le récompenser et à en revendiquer la paternité, mais s’il commet des actes inqualifiables, à dire qu’il ne dépend plus de votre responsabilité, mais de celle de votre voisin.
Exclamations et rires sur les bancs du groupe UMP.

Si nous agissons ainsi, nous nous conduisons en républicains inconséquents, sans aucune remise en cause de la manière dont notre système a pu produire ces événements.
À ces motifs, j’ajouterai celui de l’inutilité de la création de peines d’exception.

Rappelons que l’histoire de notre pays, comme celle des autres nations, n’a pas encore fourni d’illustration probante quant à l’opportunité de faire reculer l’État de droit pour lutter contre la barbarie.
Appliquée de manière exceptionnelle à la Libération, cette peine de « mort civile », contestable, a fait l’objet d’une loi d’amnistie en 1951 puis, en 2003, a été considérée comme abolie par le Conseil d’État. La réintroduire aujourd’hui serait significatif d’une régression gratuite et dangereuse.
En effet, notre connaissance de ceux qui prennent les armes est maintenant assez fine pour savoir que nous ne parlons pas de descendants d’immigrés ou de doubles nationaux, mais bien souvent des personnes ayant peu de convictions religieuses ou de jeunes sans liens récents avec l’immigration. Le sujet est trop complexe pour le restreindre à un public sommairement défini.
À une mauvaise définition, ce texte ajouterait, même si cela n’est pas clairement indiqué, la stigmatisation de certaines catégories de nos concitoyens.
Protestations sur les bancs du groupe UMP.

C’est avec de tels raisonnements que nous en arrivons à ce qu’un journaliste de renom d’une radio nationale cherche à savoir si, après le récent crash aérien, des noms à consonances « déplaisantes » étaient sur le registre d’embarquement.
Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Dans l’état où, suite aux attentats du 7 janvier 2015, des milliers de Français, quelles que soient leurs origines, ont manifesté leur colère dans différentes villes de France, comment peut-on imaginer aujourd’hui mettre en place un dispositif aussi vexatoire pour une partie de la population, qui se sentirait indéniablement ciblée ?

À cet égard, cette proposition de loi n’est pas un coup d’essai. Déjà en 2010, la précédente majorité avait envisagé de retirer la nationalité française aux ressortissants naturalisés accusés de polygamie ou de fraude aux prestations sociales.
Aujourd’hui c’est par la porte du terrorisme et de la sécurité nationale que vous tentez, encore une fois, de remettre ce projet obstiné au goût du jour, en utilisant les blessures qu’a subies notre pays. C’est une forme d’instrumentalisation que l’on ne saurait accepter.
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Nous le disons avec force : le lien entre immigration et terrorisme n’a pas de sens. Il ne fait qu’alimenter les fantasmes les plus extrêmes et les plus abjects, qui n’ont rien de bon pour les valeurs de notre République.

Des fantasmes qui font aujourd’hui le lit de certains partis antirépublicains, français ou européens.
Protestations sur les bancs du groupe UMP.

Ces affirmations donnent ainsi une image négative de la France dans le monde.
Plus largement avez-vous imaginé un seul instant l’impact que de telles mesures pourraient avoir sur les familles des personnes concernées ? Par cette loi, si elle voyait le jour, des familles seraient constamment pointées du doigt ou, pire, ostracisées socialement pour des actes dont elles ne seraient pas directement responsables.

Je pense aux cas poignants où des familles – celles des 657 jeunes détectés – qui, par intelligence, par obligation et par respect pour les valeurs de la République, ont accepté de signaler l’égarement de leurs proches.

Je vous laisse imaginer le traumatisme que cela amènerait pour ces personnes. Et nous les laisserions entrer dans un « cercle d’abandon » où leur nom serait constamment mis en avant parce qu’elles auraient un lien de parenté avec tel ou tel individu ? Voilà une belle manifestation de la République qui accueille, qui aide et qui protège les siens. Si c’est le modèle que vous prônez, nous, nous n’en voulons pas.

Enfin, je dirais que le fondement même de notre Assemblée et de la politique du Gouvernement est de faire avancer la société, de la faire progresser continuellement. Or, ce que vous proposez est une forme de régression.
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Ce que vous proposez, c’est d’utiliser des méthodes du passé pour résoudre des phénomènes actuels – je parle évidement de la sanction d’« indignité nationale ».
Vous me direz que le crime d’indignité nationale avait été institué par le général de Gaulle après la Libération. Or, comme cela a été rappelé, c’était une autre époque, où la République était en péril imminent et à reconstruire dans l’urgence.
Aujourd’hui, ce sont nos concitoyens qui sont en danger, qui sont les cibles, quelles que soient leurs origines. Encore une fois, cette sanction pour des individus ayant participé à des actes terroristes ne les empêchera pas de repasser à l’action.
Aussi, les dispositions proposées dans le présent texte ne peuvent s’appliquer efficacement aux terrorismes du XXIe siècle. Ceux-ci ont tout un arsenal à leur disposition pour embrigader des personnes en perdition, à commencer par internet. Aujourd’hui, n’importe quel recruteur au djihad peut utiliser ce vecteur pour entrer en contact avec des personnes isolées ou enclines à rejoindre la lutte armée. De nombreux exemples, depuis la prise de contact sur les réseaux sociaux ou encore les vidéos postées faisant l’apologie du djihad, nous démontrent que le terrorisme est internationalisé et que son espace de dialogue est pour ainsi dire « déterritorialisé ».
Alors, pouvons-nous penser que retirer la nationalité serait un moyen efficace au niveau national pour combattre un phénomène mondial ? Dans ce cas, la meilleure solution n’est pas de placer une épée de Damoclès virtuelle au-dessus de nos concitoyens : notre meilleure arme reste et restera toujours l’intégration des personnes au sein de la République,…

…la fermeté et la sanction qui l’accompagnent, et la prévention contre toutes tentatives de recrutement au djihad – vous feriez mieux d’écouter exactement ce que je dis, mes chers collègues !
En dehors des propositions faites par le présent texte, d’autres mécanismes existent déjà. Je fais référence à la privation des droits civils, civiques et familiaux, les interdictions professionnelles ou sociales, l’interdiction de détention ou de port d’arme, l’assignation à résidence, l’obligation de remise du passeport, la mention de la condamnation dans un fichier, les mesures de sûreté ou encore la confiscation du patrimoine, sans oublier notre projet de loi à venir.
En conclusion, nous avons tous été meurtris par les attentats de janvier 2015.

Ne dites pas « Ah bon ? », cela voudrait dire que certains seraient y seraient plus sensibles que d’autres !
Cette émotion collective ne doit pas nous empêcher de garder à l’esprit que nous sommes, dans cet hémicycle, les serviteurs d’une République une et indivisible, assise sur les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

Notre responsabilité est de légiférer pour renforcer et faire avancer l’état de droit et les droits de l’homme, car c’est sur ce seul terrain que nous pouvons gagner la bataille contre l’ignominie.
Entre la déchéance de la nationalité pour les personnes naturalisées condamnées pour terrorisme et l’arsenal pénal de répression du terrorisme, nous disposons d’outils importants, complémentaires et, pour l’heure, plus efficaces que le rétablissement du crime d’indignité nationale. Or la proposition de loi qui nous est présentée prévoit des mesures qui nous paraissent inefficaces, passéistes et qui risquent de stigmatiser plus que de dissuader et de punir.
Exclamations sur les bancs du groupe UMP.

Aussi, je vous invite, comme vous l’aurait demandé notre chère collègue Marie-Anne Chapdelaine, au nom du groupe socialiste, à voter pour cette motion de rejet.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.

Dans les explications de vote sur la motion, la parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Je suis consterné ! Il est toujours dangereux de s’approprier un texte que l’on n’a pas écrit. Je salue, madame Zanetti, l’énergie avec laquelle vous vous êtes approprié un texte dont vous n’étiez pas l’auteur.

Avant de reprendre plusieurs éléments de votre intervention, je souhaite commencer par un propos plus général. Il est vrai, cher collègue Tourret, que les trois textes que nous examinons aujourd’hui ont un point commun, consistant à savoir si l’évolution de la jurisprudence et des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, doit faire changer notre appréciation de l’autorité de cette Cour sur notre propre législation.
Il consiste à savoir si l’existence de terroristes français et la prolifération de ce phénomène chez nos ressortissants doivent nous faire évoluer dans notre perception de la signification de l’appartenance à la communauté nationale et de la manière dont on la sanctionne.
S’agissant du troisième texte, les circonstances ont-elles changé depuis une trentaine d’années concernant les difficultés et les criminels auxquels sont aujourd’hui confrontés les policiers, cher Daniel Vaillant ? Ou bien ces circonstances nous permettent-elles de maintenir en l’état la législation actuelle ?
À ces trois questions, le groupe UMP répond par l’affirmative : les circonstances ont changé, non pas au point de faire reculer l’état de droit, comme le prétend Mme Zanetti – c’est plus un fantasme qu’autre chose, pour vous dire les choses clairement ! –, mais au point que la communauté doit inventer d’autres moyens pour se protéger contre des phénomènes qui sont radicalement nouveaux. Voilà les questions que nous posons aujourd’hui !

J’entends dire que l’effet de dissuasion serait inefficace : je n’en sais rien ! Vous demandez quelle importance cela aurait pour les gens qui sont concernés d’être privés de la nationalité : la même, chère madame, que l’importance que revêt l’incarcération pour des délinquants qui se font une gloire d’être mis en prison !

Doit-on pour autant supprimer les peines d’emprisonnement du code pénal ? Bien sûr que non ! Je ne prétends pas que c’est ce que vous dites, mais faites attention à ne pas tirer trop fort sur cette pelote !
Quant à stigmatiser les terroristes eux-mêmes, très franchement, il ne s’agit que de les incriminer !

Je conclus en quelques secondes, madame la présidente.
Enfin, sur notre capacité à traiter avec des outils d’hier des problèmes d’aujourd’hui, vous auriez raison si les circonstances n’avaient pas changé : or elles ont changé. Il est regrettable que la position du groupe socialiste que vous avez exprimée à la tribune n’en tienne aucun compte. Nous voterons donc contre cette motion de rejet.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

La parole est à M. Meyer Habib, pour le groupe de l’Union des démocrates et indépendants.

Je suis un nouveau député, n’étant à l’Assemblée que depuis deux ans. Comme vous tous, je suis un député libre : c’est pourquoi j’ai voté par exemple le pacte de responsabilité, même si je suis dans l’opposition ; je devais voter la loi Macron, même si je suis dans l’opposition. Je me dis en effet que les Français nous regardent et qu’ils veulent que les politiciens soient à leur écoute.
Or, après avoir écouté le discours de ma collègue tout à l’heure, je suis déçu et consterné. Triste privilège, ainsi que je l’ai rappelé en décembre dernier, j’ai connu le moment le plus difficile de ma vie dans un avion de nuit, assis aux côtés d’Eva Sandler, avec Alain Juppé. Nous partions en Israël enterrer ce papa, ses deux enfants et la petite Myriam. Cela reste, à ce jour, le moment le plus difficile de ma vie et je ne pensais pas me trouver de nouveau dans un avion, comme ce fut le cas au mois de janvier, pour accompagner encore une fois quatre corps pour leur enterrement.
Dans une période d’une telle gravité, il y a eu un discours extraordinaire : celui de Manuel Valls, qui a dépassé tous les clivages, de droite comme de gauche. Sur des sujets aussi sensibles, on attend de la représentation nationale de voir la réalité. De quoi s’agit-il ? De déchoir de sa nationalité quelqu’un qui vomit la France : il faut évidemment le faire ! Demandez aux Français : la réponse serait oui ! L’indignité nationale pour quelqu’un qui vomit la France, qui veut tuer des Français, qui rejette toutes nos valeurs : oui, il est indigne ! C’est aussi simple que cela ! Et je regrette qu’aujourd’hui, on en revienne à nos clivages gauche-droite : c’est la raison pour laquelle notre groupe ne votera pas cette motion.
Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.

La parole est à M. Alain Tourret, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.

Mais je voudrais souligner que l’adoption d’une motion de rejet est une remise en cause des droits mêmes de l’opposition et, par conséquent, un certain affaissement de la démocratie. Cela, je ne peux pas l’admettre, je vous le dis, mes chers amis socialistes !
Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP.

Sur cette matière si délicate, nous devons nous écouter jusqu’au bout. Il n’est pas concevable, alors même que nous allons adopter ensemble la loi sur le renseignement, que nous puissions, par un artifice de procédure, rompre la discussion qui doit exister entre nous. Nous aurions peut-être pu nous rapprocher, dégager une majorité d’idées et vaincre ainsi, grâce à cette majorité d’idées, le terrorisme. Je crois que c’est justement par cette écoute mutuelle que nous gagnerons contre le terrorisme. Alors, je vous en prie, ne votez pas cette motion !

Ce n’est pas la première fois que nous avons ce débat, ainsi que l’a rappelé le rapporteur lui-même. Je n’ai donc pas l’impression que cet « artifice de procédure » soit une volonté d’empêcher ce débat.

Depuis plusieurs mois, j’ai même l’impression inverse : vous ne cessez de poursuivre ce débat ! D’autres débats sont possibles aujourd’hui dans le pays mais, sur la question de la déchéance et sur la question de la dégradation, vous revenez à la charge de manière très insistante.
Ainsi que je l’ai dit tout à l’heure dans mon intervention, il existe d’autres façons de mener le combat contre le terrorisme. J’ai rappelé d’ailleurs les efforts accomplis par le Gouvernement sur le plan financier – plus de 700 millions seront déployés – et les efforts en personnel pour les douanes, pour Bercy, pour le ministère de la justice, pour le ministère de l’intérieur.
Avec le président de la commission des lois, nous avons étudié hier soir, tard, les amendements au projet de loi relatif au renseignement visant à lutter contre le terrorisme, notamment sur l’une des sept finalités qui sont explicitées dans le texte. J’aurais souhaité que nous fussions plus nombreux parce que certaines dispositions de ce texte me posaient problème : je ne suis pas certain que vous auriez soutenu mes amendements, mais au moins le débat aurait pu avoir lieu. J’ai toutefois été agréablement surpris parce que notre collègue Morin a exprimé des préoccupations similaires aux miennes : dans le débat parlementaire, on peut parfois rencontrer des convergences qu’on ne soupçonnait pas !
J’ai dit mon opposition au texte. Comme l’a rappelé Jean-Jacques Urvoas dans son rapport, la mesure de dégradation est inopérante. J’ai dit également qu’il me semblait que le tour de passe-passe effectué par le rapporteur sur le remplacement de la déchéance par la perte de la nationalité ne réglait pas l’ensemble des questions que ce dispositif pouvait soulever.
Par ailleurs, si les textes d’affichage permettent de faire campagne – je ne doute pas que, dans le cadre de la préparation des régionales et d’autres échéances, ce sont des éléments très importants pour votre affichage politique, de plus en plus à la traîne d’un autre parti, d’ailleurs !,…

…ces dispositions ne me paraissent pas adéquates aujourd’hui pour lutter contre le terrorisme : je préfère qu’on se concentre sur les mesures qui sont annoncées,…

… dont certaines peuvent être discutables, comme le projet de loi. C’est de cela que je veux discuter, et non des propositions que vous faites de manière récurrente ici dans cette assemblée.

La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen.

Nous allons bien entendu voter cette motion de rejet présentée par Paola Zanetti et je vais expliquer très simplement pourquoi. Le pire des dangers menaçant le Parlement, c’est de légiférer là où le résultat sera contraire à ses intentions. Lutter contre le terrorisme, lutter contre la barbarie, lutter contre les idéologies insupportables et totalitaires, comme c’est notre volonté à tous, ne peut pas se traduire par des artifices.

La loi contre le terrorisme, la loi sur le renseignement que nous avons travaillée cette nuit, en l’absence de l’opposition – je le regrette, même si je ne la mets pas en cause, parce qu’il fallait être présent sur ce vrai sujet –, les mesures qui sont projetées par le Gouvernement pour entrer dans ce combat-là, qui est notre combat à tous, constituent ce chemin de la loi, qu’il faut emprunter.

Le texte que vous proposez est totalement à côté de cette réalité parce que l’on n’y retrouve pas cette finalité. Concernant la déchéance de la nationalité, vous avez accepté – cela n’a pas toujours été le cas – de reconnaître que la loi ne peut pas provoquer la situation d’apatride, et vous êtes revenus dans le droit commun que nous visons tous : à tout moment, le Gouvernement peut prononcer une peine de cette nature. Le texte est donc inutile.

S’agissant enfin de l’indignité, nous savons ce qu’il est advenu de ce dispositif : il a été supprimé par le double effet de l’amnistie et de la loi parce qu’il ne peut être que temporaire. Est-ce cela que vous voulez ?

Votre dispositif est donc inefficace.
Je vais vous dire ce qui est le plus important : la démocratie, c’est l’organisation la plus fragile qu’un corps social puisse se donner. Le plus grand risque qu’elle encourt, c’est de se donner les armes de ceux qui veulent l’anéantir. Là est le fond du débat, depuis le début, et c’est notre responsabilité commune à tous…

… de ne jamais emprunter les armes de ceux qui veulent anéantir la démocratie et de ne jamais s’éloigner des valeurs de la République.
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Ces valeurs, vous en êtes les gardiens, comme nous, car seules les valeurs de la République nous permettront de vaincre.

Il y a dans le monde des millions de gens qui souffrent autant que les Français du djihadisme et de ses abominations, et qui veulent toujours entendre la voix de la République et de la démocratie.
Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.
La motion de rejet préalable, mise aux voix, est adoptée.

L’Assemblée ayant adopté la motion de rejet préalable, la proposition de loi est rejetée. Il n’y aura pas lieu de procéder au vote solennel décidé par la conférence des présidents.
La parole est à M. Sergio Coronado.

Je souhaite faire une remarque très rapide : je rappelle que j’ai l’oreille assez fine. Alors que nous allions procéder au vote rejetant la motion de procédure qui nous était présentée, un député de l’opposition s’est permis de nous qualifier de « Munichois » !

Dans ce débat qui a été plutôt de qualité, non seulement vous faites injure à l’histoire de France, mais vous ne respectez aucunement l’enceinte de ce Parlement. C’est véritablement honteux de votre part !
Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.

Prochaine séance, cet après-midi, à quinze heures :
Proposition de loi relative à la légitime défense des policiers.
La séance est levée.
La séance est levée à treize heures quinze.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly