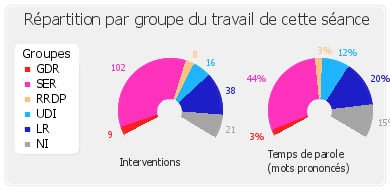Séance en hémicycle du 8 février 2016 à 16h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
La séance est ouverte à seize heures.


Vendredi après-midi, l’Assemblée a commencé d’entendre les orateurs inscrits sur l’article 1er.
suite

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le garde des sceaux, monsieur le ministre de l’intérieur, monsieur le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, mes chers collègues, ce que je vais demander, cela ne vous étonnera pas, c’est la suppression pure et simple de l’article 1er, de même que je demanderai celle de l’article 2.
Nous avons eu l’occasion de l’annoncer à la tribune de cette assemblée, nous nous opposons à la constitutionnalisation de l’état d’urgence comme à celle de la déchéance de nationalité, parce que nous estimons que, dans les deux cas, il s’agit d’un recul de nos libertés et, en quelque sorte, d’un effacement du juge judiciaire, garant de nos libertés individuelles.
La constitutionnalisation de l’état d’urgence va permettre en effet d’inscrire dans le droit commun un certain nombre d’exceptions qui devraient justement ne relever que de l’urgence et ne devraient donc être possibles que pendant une période très limitée dans le temps.
Vous avez durci la loi de 1955 le 16 novembre dernier. Derrière la prolongation de l’état d’urgence, se dissimulait d’ailleurs un dessein beaucoup plus funeste : changer l’un des aspects les plus importants de cette loi pour vous permettre de réquisitionner ou d’assigner quelqu’un à résidence sur son simple comportement alors que, jusqu’à maintenant, on s’appuyait sur ses activités. Pour les juristes et tous ceux qui sont attachés à la défense de nos droits, vous le comprendrez, il s’agit d’un recul inacceptable.
Il faut également regarder le projet de loi que vous nous proposez dans un cadre plus large. Il fait en effet suite aux lois antiterroristes qui ont été votées par cette assemblée mais n’ont malheureusement servi à rien, et s’inscrit avant la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, laquelle fera passer le juge judiciaire derrière le procureur, derrière le policier et derrière le préfet et ouvrira la porte non seulement à l’arbitraire, mais aussi à une société du soupçon où chacun se dira : « Je n’ai rien à me reprocher ».
Applaudissements sur quelques bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, monsieur le président et rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, mes chers collègues, je vais m’exprimer sur l’ensemble du texte, n’ayant guère eu l’occasion de le faire pendant la discussion générale, et évoquerai plus précisément l’article 1er en défendant mon amendement de suppression.
Il n’est pas surprenant, monsieur le Premier ministre, qu’ayant voulu jouer avec la Constitution et la réforme constitutionnelle, le chef de l’État, votre gouvernement, votre majorité se retrouvent aujourd’hui dans une forme d’impasse.

Ce n’est pas très compliqué : il suffit de regarder ce qui se passe et d’écouter ce qui se dit dans les couloirs.
En réalité, vous êtes en train ni plus ni moins de ravaler la Constitution au rang d’une loi ordinaire, et le problème de fond est là, car, ainsi que l’ont souligné un très grand nombre de juristes, et notre collègue sénateur Robert Badinter, dans les colonnes du journal Le Monde, vendredi après-midi, il suffisait d’apporter une modification ou deux à la loi ordinaire pour atteindre votre objectif et faire en sorte que le dispositif que vous souhaitez – et dont je continue, par ailleurs, à ne pas comprendre l’efficacité – puisse être adopté.
Avec l’article dont nous discutons maintenant, nous allons assister à une réduction significative des libertés individuelles puisque tel sera l’effet de la constitutionnalisation de l’état d’urgence. Quant à la déchéance de nationalité, vous vous apprêtez à inscrire dans la Constitution un dispositif inefficace, parfaitement dangereux, inapplicable et sans le moindre intérêt.
Vous mobilisez le Parlement alors qu’il y a tant d’autres sujets à traiter, beaucoup plus urgents, pour finalement voter une révision constitutionnelle dont je suis prêt à prendre le pari qu’elle n’ira même pas jusqu’à son terme.
Il aurait fallu arrêter ce processus maintenant, c’est même déjà un peu trop tard et c’est fort dommage. En tout cas, je regrette beaucoup qu’à cette occasion et dans la période où nous sommes, les libertés individuelles et la Constitution soient ainsi affaiblies. C’est la raison pour laquelle, quoi qu’il arrive, je ne voterai pas ce texte.

En 2015, la France a été meurtrie, frappée par le terrorisme djihadiste contre lequel elle est entrée en guerre.
Dans la nuit du 13 au 14 novembre, après les attentats, le Président de la République a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national. Trois jours plus tard, il annonçait devant le Congrès que la France était entrée en guerre.
Face à cette guerre nouvelle, nous devons adapter notre loi fondamentale. La constitutionnalisation de l’état d’urgence est une nécessité parce que, face à des situations exceptionnelles portant atteinte à la Nation, les prérogatives reconnues au pouvoir exécutif doivent pouvoir être renforcées, une nécessité parce que l’état d’urgence est le seul régime de circonstances exceptionnelles qui ne soit pas inscrit dans notre norme juridique la plus haute.
Contrairement à ce que certains défendent, la constitutionnalisation de l’état d’urgence ne signifie pas état d’urgence permanent. Au contraire, lui octroyer une place parmi les normes les plus hautes, c’est empêcher sa banalisation ou tout recours excessif.

Le nouvel article 36-1 de la Constitution fixera les conditions de mise en oeuvre de l’état d’urgence, qui sera déclaré par le Président de la République et prorogé si besoin par le Parlement. L’état d’urgence implique une limitation des libertés fondamentales, principes à valeur constitutionnelle. Son inscription dans notre Constitution permettra de l’asseoir dans le droit et de le protéger contre des emballements causés par les circonstances.
Enfin, le deuxième alinéa de l’article 36-1 autorisera une révision par le biais d’une loi ordinaire des mesures dérogatoires prévues par la loi du 3 avril 1955, ce qui permettra de préciser les conditions de déroulement des perquisitions administratives et de l’assignation à résidence.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de l’intérieur, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quand un État est attaqué, il se défend.
L’état d’urgence voté à l’unanimité à la suite du Congrès de Versailles comme sa constitutionnalisation annoncée alors par notre Président de la République répondent à une nécessité politique et juridique. Contrairement à ce que j’ai pu l’entendre ici et là, ce n’est pas une réponse précipitée aux drames terroristes subis par la France.
Les régimes d’exception que constituent les pleins pouvoirs de l’article 16 et l’état de siège de l’article 36 sont tous deux constitutionnalisés, et il serait aussi dangereux qu’incompréhensible de maintenir l’état d’urgence hors la loi fondamentale, qui constitue notre pacte social, notre acte fondateur, alors qu’il représente aujourd’hui le seul régime d’exception utilisable et adapté face à la menace terroriste.
Il serait donc attentatoire à l’État de droit de maintenir en dehors de la Constitution ce régime d’exception. Certes, il existe à ce jour un troisième régime d’exception, la théorie des circonstances exceptionnelles, purement jurisprudentielle, mais elle ne débouche que sur un contrôle a posteriori du juge administratif et ne satisfait donc pas notre exigence de garantie et de contrôle.
Ce projet de loi doit nous permettre de prévoir un contrôle rigoureux de l’Assemblée nationale. L’autorisation du Parlement n’est pas un blanc-seing, et le pouvoir législatif doit pouvoir, d’une part, contrôler la mise en oeuvre de l’état d’urgence sur le territoire national et, d’autre part, apprécier si son maintien se justifie toujours, quitte à retirer avant son terme le bénéfice de ce régime d’exception au pouvoir exécutif. C’est donner ainsi tout son sens au contrôle parlementaire.
Ce contrôle pourrait d’ailleurs être utilement complété par un travail de suivi sur le terrain mené par les députés en lien avec les préfets et les procureurs de la République.
Il conviendrait au surplus, comme à l’article 16, de permettre la saisine du Conseil constitutionnel, qui, lui aussi, pourrait évoluer, afin qu’il puisse apprécier si les conditions d’application de l’état d’urgence sont toujours réunies.
Nous ne manquons pas et nous ne manquerons pas de moyens pour faire face à la menace terroriste. Dans une démocratie, il faut les encadrer, et c’est l’objet même de l’article 1er et des amendements que nous allons examiner.

Monsieur le président, mes chers collègues, je suis contre ce projet de loi constitutionnelle pour de très nombreuses raisons.

La première est que le texte ne cesse de varier d’une semaine à l’autre et qu’il est bien difficile de suivre le Gouvernement dans ses allers et retours.
Ensuite, ce projet porte la signature d’une ministre qui l’a renié, ce qui me paraît singulièrement paradoxal.
Je suis également contre ce texte parce qu’il est inutile. Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 décembre 2015, le régime d’état d’urgence n’a pas besoin d’être constitutionnalisé, il peut rester dans le champ de la loi ordinaire, tout comme est inutile, d’ailleurs, l’article relatif à la déchéance de nationalité, le problème étant réglé par le code civil.
Par ailleurs, je suis contre un texte dont on me dit qu’il n’a qu’une portée symbolique, parce que telle n’est pas la conception que je me fais de la Constitution. La Constitution, pour moi, est le pilier de droits réels et non le panneau électoral sur lequel tout un chacun viendrait inscrire son slogan.
Je suis également contre ce texte parce qu’il en annonce et accompagne d’autres et que nos libertés individuelles rétrécissent au lavage de la grande peur que l’on entretient dans la société.
Enfin, je suis contre ce texte parce qu’il en a déjà été fait un mauvais usage, contre des personnes même pas suspectées de terrorisme, et parce qu’il n’établit pas de lien direct entre les personnes qu’il vise et auxquelles il a été appliqué et la menace terroriste invoquée.

Monsieur le Premier ministre, je voudrais d’abord réaffirmer ce que j’ai indiqué à plusieurs reprises : je voterai ce texte.
Je le voterai d’abord parce que je ne veux pas oublier le 13 novembre…

…ni l’élan avec lequel, au Congrès à Versailles, nous avons tous salué les propositions faites, au nom de la Nation, par le Président de la République dans le but de répondre aux actes barbares de violence qui ont mis dans la peine notre pays.
L’état d’urgence, je l’ai déjà souligné, c’est au Gouvernement, au ministre de l’intérieur de nous dire si, oui ou non, il doit être prolongé. En tant que parlementaire, qui plus est de l’opposition, je ne me sens pas, moi, capable de savoir si le danger auquel notre pays est exposé justifie ou non une telle prolongation. Je fais donc confiance au Gouvernement de mon pays.
S’agissant de la déchéance de nationalité, je voudrais dire une nouvelle fois que, pour moi, c’est un faux débat absolu. Les gesticulations ou les postures des uns et des autres sur la prétendue remise en question de notre tradition viennent se heurter à la réalité toute simple du code civil.

Il suffit d’y lire les articles 25, 23-7 ou 23-8. En réalité, tout est dit dans le code civil, y compris la possibilité de l’apatridie.

Tout à fait !
Tous ces débats me semblent dénués d’intérêt. Nous devons, pour nos compatriotes, entrer aujourd’hui dans le vif du sujet. Sur cette question de la déchéance de nationalité, je déposerai bientôt une proposition de loi.

Si l’on peut discuter de la nécessité de constitutionnaliser la nationalité et les conditions de sa déchéance comme le prévoit l’article 2, tel n’est pas le cas de l’inscription de l’état d’urgence dans notre texte suprême, laquelle est d’une impérieuse nécessité : par principe, d’abord, car il n’est pas souhaitable qu’un régime d’exception relève d’une simple loi ; par prudence, ensuite, dans la mesure où nous apportons dans cet article des garanties relatives au déclenchement et à l’usage de l’état d’urgence.
L’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution ne perpétue pas son application. Il demeure, bien évidemment, un régime d’exception. Il ne s’agit pas d’une mesure permanente, pas plus que ne le sont les pleins pouvoirs de l’article 16 ni l’état de siège de l’article 36. Il s’agit d’une mesure à notre disposition pour faire face aux menaces de notre temps.
Elle accorde, certes, des pouvoirs hors du droit commun à l’exécutif, mais elle conserve intact, contrairement aux deux autres régimes d’exception, le fonctionnement de nos institutions, notamment le principe, qui est l’un des plus importants en démocratie, de la séparation des pouvoirs, imposant que la force, la loi et la justice ne soient pas tenues dans les mêmes mains.
Ce souci d’équilibre nous conduit d’ailleurs à rendre plus puissante la main du Parlement, lorsque celle de l’État sera plus forte. Cela répond en partie à ceux qui ont pu objecter qu’un contrôle du Conseil constitutionnel pouvait suffire. À interroger le constituant de 1958 ou le législateur de 1955 sur les nouveaux enjeux du XXIe siècle, nous nous trouvons rapidement devant des énigmes. Il s’agit aujourd’hui de prendre nos responsabilités, en ayant bien à l’esprit que nous modifions une loi prééminente, afin de ne déroger en rien au socle des principes de la République.
Sur cet article 1er, nous devons nous réunir, comme nous nous étions réunis, dans un même élan, pour dire notre horreur devant les massacres de janvier et de novembre derniers. Nous disions alors que nous ne renoncerions à aucun des principes, ni à aucun des droits qui étaient attaqués. L’article 1er grave cette détermination dans le marbre constitutionnel.

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’inscription de l’état d’urgence dans notre Constitution, proposée par cet article 1er, me semble une mesure légitime et utile pour faire face au risque terroriste qui pèse sur notre nation. J’y suis donc favorable pour plusieurs raisons. Premièrement, ajouter à notre texte fondamental l’état d’urgence donne une base solide et légitime aux mesures exceptionnelles qui peuvent être prises par l’exécutif, lorsqu’il est décrété. Je précise néanmoins que, si l’état d’urgence est utile et nécessaire, il doit rester exceptionnel et ne pas devenir un état permanent.
Cette inscription dans la Constitution permet de l’encadrer précisément. Sa durée doit être limitée. Le groupe UDI a proposé de limiter sa prorogation à quatre mois, ce qui est un délai raisonnable et équilibré, que le Premier ministre a approuvé sur le principe dans son discours, mais que la commission des lois n’a, hélas, pas adopté. J’espère que notre assemblée, avec l’appui du Gouvernement, reviendra sur ce vote. À défaut, nous pourrions inventer, chers collègues, l’état d’urgence permanent.
Pour ce qui est de l’application des mesures exceptionnelles liées à l’état d’urgence, un véritable contrôle des actions de l’exécutif par le Parlement est particulièrement nécessaire. L’adoption d’un amendement de la commission des lois allant dans ce sens est salutaire pour la protection des libertés publiques, qui ne sauraient être négligées en raison de l’état d’urgence.
Le troisième volet de l’encadrement de cet état consiste à établir le contrôle du juge administratif. Le groupe UDI a proposé de préciser dans ce texte que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence soient soumises au contrôle dudit juge. L’amendement adopté en commission va dans le bon sens.
Enfin, pour éviter tout abus et donner à l’état d’urgence sa juste place dans le fonctionnement de notre démocratie, je suis favorable à interdire toute dissolution pendant la durée de l’état d’urgence et à permettre au Parlement de se réunir de plein droit pendant sa durée. C’est ce qu’a accepté la commission en adoptant deux amendements. En conclusion, je suis favorable à la constitutionnalisation de l’état d’urgence, mais non pas à un état d’urgence permanent. Oui à un état d’urgence encadré, équilibré et qui s’inscrive dans le respect des libertés fondamentales garanties par notre Constitution !

Il est proposé dans l’article 1er du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation d’insérer dans notre Constitution un article relatif à l’état d’urgence. Si je considère, pour ma part, que tout doit être fait pour protéger les Français contre la menace terroriste, je n’entends pas les arguments qui justifient l’inscription de cette mesure dans la Constitution. Protéger les Français, c’est effectivement votre responsabilité, monsieur le Premier ministre. C’est ce qu’ils attendent, de vous comme de nous. Nous devons pouvoir les rassurer sur ce point.
Toutefois, la Constitution est le texte fondateur de notre Ve République et, à ce titre, nous ne devons la modifier qu’avec une infinie précaution, et surtout pas dans la précipitation. Nous sommes actuellement en état d’urgence. La situation vécue par notre pays depuis les terribles attentats de 2015 le justifie pleinement. Le Parlement a autorisé le Gouvernement à le proroger pour une période de trois mois. Le risque terroriste justifie pleinement que nous vous autorisions à le faire une nouvelle fois à compter du 28 février.
Cet état d’urgence, prévu par la loi de 1955, vous autorise à procéder à des perquisitions administratives et à des assignations à résidence. Il vous autorise à interdire certaines réunions ou certaines manifestations et à restreindre la liberté de circulation dans certaines zones. Le contrôle parlementaire de cet état d’urgence s’exerce pleinement et des parlementaires ont été désignés à cet effet. Vous souhaitez améliorer le régime juridique des perquisitions administratives. Une modification de la loi de 1955 suffit pour cela.
La meilleure démonstration en est d’ailleurs la situation d’état d’urgence dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Elle ne rencontre aucun obstacle constitutionnel. Dans sa décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a clairement admis la possibilité pour la loi d’organiser un régime d’état d’urgence sans violer la Constitution. Le Conseil d’État a d’ailleurs rendu un avis identique. Dès lors, je ne vois pas quel serait l’apport d’une telle inscription dans la Constitution.

Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que je suis également opposée à cet article 1er. Quoi que l’on pense du contenu de ce texte, c’est un problème de réformer la Constitution, alors que nous sommes en plein état d’urgence, soit dans des conditions de sérénité qui ne sont pas optimales. Quoi que l’on pense de l’état d’urgence, on sait que cette réforme de la Constitution n’est pas nécessaire à sa mise en oeuvre.
Il me semble que nous avons suffisamment de choses essentielles et utiles à faire pour ne pas gâcher notre temps et ne pas nous donner les moyens de nous protéger du terrorisme et de résoudre des problèmes comme le chômage, le réchauffement climatique ou l’accueil des réfugiés, lesquels sont, contrairement à ce qu’on dit parfois, ceux qui subissent quotidiennement ce que nous avons subi aux mois de janvier et de novembre et contre lequel nous cherchons à nous protéger.

La Constitution de la Ve République a été modifiée à vingt-quatre reprises. Devons-nous engager la révision une vingt-cinquième fois pour cette question, posée à l’article 1er, de la constitutionnalisation du régime de l’état d’urgence ? Je pense que ce n’est pas absolument nécessaire, mais que c’est utile. Je souhaite pouvoir voter l’article 1er pour trois raisons. Premièrement, cela permet d’inscrire dans la Constitution le principe d’un régime puissant de police administrative pour faire face à un péril extrêmement grave.
Deuxièmement, cela permet de conforter le contrôle juridictionnel de ce régime de police administrative, qui est dans les mains du juge administratif dont le métier est, par définition, de concilier les nécessités de l’ordre public avec le respect des libertés. Troisièmement, cela nous permet d’asseoir pleinement le contrôle politique du Parlement sur l’exécution et l’application de l’état d’urgence. Ce sont autant de raisons qui m’incitent à souhaiter pouvoir voter cet article 1er.

Je voterai contre ce projet de loi, essentiellement à cause des dispositions relatives à la déchéance de nationalité. Quant à l’état d’urgence, l’incertitude qui ressort de nos débats sur l’intérêt de l’inscrire ou non dans la Constitution est un peu perturbante. En effet, les décisions de justice prises ces dernières semaines ne démontrent pas que cette inscription soit indispensable. Notre débat est néanmoins le bienvenu, non pour revenir sur la décision du Gouvernement de décréter l’état d’urgence, ni sur celle, tout aussi justifiée, du Parlement de le proroger, mais pour répondre à l’emballement manifeste de ceux qui se projetaient dans une sorte d’état d’urgence permanent ou qui, tout au moins, souhaitaient l’état d’urgence le plus long qui soit et envisageaient volontiers une succession de prolongements, sans bien en déterminer les bornes.
Il est aussi important de répéter que nous ne devons jamais renoncer au contrôle parlementaire sur l’état d’urgence. La responsabilité de l’exécutif est essentielle dans une période de cette nature, y compris et en particulier en état d’urgence, mais le contrôle du Parlement l’est tout autant. Il ne suffit pas de dire « péril », « état d’urgence » ou « Gouvernement » pour priver le Parlement de sa responsabilité.
S’il est important de répondre au péril par des dispositions qui relèvent de la logique de l’état d’urgence, notre pays doit être également capable de répondre d’autres manières. La France est grande face au péril ; elle est grande face à l’urgence. Elle doit aussi être grande dans la conception et la mise en oeuvre de dispositions ordinaires, capables de faire face aux situations extraordinaires.

Cet article a suscité moins de controverses que celui qui a trait à la déchéance de nationalité. Pourtant, je pense qu’il est tout aussi problématique et qu’il mérite un vrai débat. Les raisons avancées en faveur de la constitutionnalisation de l’état d’urgence sont connues, et plusieurs de mes collègues en ont fait part lors de la discussion générale. C’est d’abord la décision du Conseil constitutionnel de 1985, faisant suite à une requête de parlementaires, qui reconnaissait la possibilité au législateur ordinaire d’instaurer un état d’urgence. C’est ensuite la décision du même Conseil, récemment saisi par une question prioritaire de constitutionnalité, reconnaissant la constitutionnalité de l’une des mesures phares de l’état d’urgence, celle de l’assignation à résidence.
Je voudrais aller un peu plus loin dans le débat et m’adresser directement au rapporteur de cette révision constitutionnelle. Il nous dit, avec le Gouvernement, qu’il s’agit de constitutionnaliser pour mieux encadrer. Je comprends cette volonté. Mais j’ai beau lire le texte très attentivement, je n’y vois aucune mesure d’encadrement. Qu’en est-il du contrôle parlementaire ? C’est peut-être la seule avancée que nous ayons obtenue le 20 novembre dernier : la possibilité que les parlementaires de toutes les familles politiques aient un droit de regard sur les mesures de police administrative mises en place.
Qu’en est-il de la durée de l’état d’urgence ? Il n’en est rien dit dans la rédaction de l’article 1er. Ce qui inquiète le plus, à juste titre, c’est que le champ d’application de cet état d’exception dans la Constitution sera déterminé par une loi ordinaire, et non pas par une loi organique. Je me souviens, monsieur le président de la commission, qu’avant d’être le rapporteur de ce texte, vous aviez une préférence pour la loi organique. Elle suppose un contrôle de constitutionnalité a priori et offre ensuite aux parlementaires la possibilité de disposer de quinze jours de réflexion et de débat, après son dépôt. Quelle est votre position actuelle, monsieur le rapporteur ?

La constitutionnalisation de l’état d’urgence soulève une première difficulté : le principe même d’un état d’exception est que celui-ci peut déroger à la Constitution. En hissant l’état d’urgence au niveau constitutionnel, on écrase un certain nombre d’éléments relatifs à l’État de droit, et ce alors même que c’est inutile puisqu’à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a reconnu la possibilité qu’une loi ordinaire puisse déroger à des principes du droit commun dans des circonstances très particulières. On pourrait objecter que certains amendements, s’ils étaient adoptés, encadreraient durablement les dispositions relatives à l’état d’urgence, mais la fragilité du dispositif réside dans le fait qu’une nouvelle loi d’exception qui ne remplirait pas les critères de l’encadrement de l’état d’urgence pourrait tout à fait être votée. Je pense donc qu’il serait bien mieux d’en rester à la situation actuelle, de fait stabilisée, et de supprimer l’article 1er.

Je trouve que constitutionnaliser l’état d’urgence est une mauvaise chose. Nous avons déjà cette loi de 1955. Si sa constitutionnalité était discutable, on aurait pu ainsi justifier d’insérer son dispositif dans la Constitution. Mais le Conseil constitutionnel, interrogé à plusieurs reprises, a décidé qu’elle était conforme à la Constitution. Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que cette réforme constitutionnelle permettra d’améliorer la loi de 1955. Dont acte, mais une loi ordinaire suffirait.
Toucher à la Constitution parce qu’on traverse des moments d’angoisse ou d’urgence est une mauvaise chose. Bien sûr que ce qui s’est passé au Bataclan a été épouvantable, dramatique, et c’est pourquoi le Gouvernement a réagi en appliquant la loi de 1955. Y a-t-il eu des difficultés ? La majorité de l’Assemblée nationale s’y est-elle opposée ? Pas du tout. Vous vous apprêtez d’ailleurs à prolonger l’état d’urgence et nous, à vous suivre. Le Conseil constitutionnel n’a rien trouvé à y redire. Dès lors, pourquoi tout à coup transformer la Constitution ? Je demande donc que l’on abandonne cet article. Et puis l’on pourrait éventuellement travailler sereinement tous ensemble pour améliorer la loi de 1955.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 70 .

Monsieur le garde des sceaux, nous avons consacré du temps, ces dernières semaines, à voir comment l’État, à travers vos services et ceux du ministre de l’intérieur ici présent, appliquait les dispositions de la loi de 1955 revue en novembre dernier par notre Parlement. Nous sommes tombés d’accord en commission des lois, il y a quelques semaines, sur le fait qu’aucune liberté fondamentale n’était remise en cause par l’état d’urgence et ni vous ni moi n’avions constaté quelque forme de débordement ou de dérapage que ce soit au regard du respect des libertés publiques et des libertés individuelles. J’ajoute qu’à aucun moment le juge, en particulier le Conseil d’État saisi au contentieux, n’a établi qu’il fallait invalider le principe même d’une des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence – ce qui n’exclut pas d’éventuelles modifications. Je ne vois pas de meilleure preuve qu’il n’est pas nécessaire de constitutionnaliser l’état d’urgence. De surcroît, dans l’avis qu’il a rendu sur ce projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État a rappelé que la loi de 1955 n’a pas été abrogée ni même modifiée par la Constitution de 1958.
En outre, l’idée même d’inscrire dans la Constitution un régime général de restriction de libertés me paraît contradictoire : la Constitution est davantage destinée à garantir les libertés fondamentales qu’à les réduire ou à en restreindre le champ d’application, ce qu’une loi ordinaire mais encadrée peut faire.
Enfin, deux derniers arguments : premièrement, dans quelle mesure la constitutionnalisation de l’état d’urgence ne priverait-il pas le Parlement de sa liberté d’appréciation quant à sa mise en oeuvre ? Deuxièmement, dans quelle mesure n’évacuerait-on pas ainsi définitivement la possibilité pour le juge judiciaire d’intervenir ?
Pour toutes ces raisons, je demande la suppression pure et simple de cet article.

La parole est à M. Pierre Lellouche, pour soutenir l’amendement no 87 .

Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mon argumentation rejoint tout à fait ce que vient d’exprimer M. Poisson. Je voudrais, chers collègues de la majorité, rafraîchir la mémoire de certains d’entre vous. Lorsque la loi de 1955 proposée par Edgar Faure a été adoptée, au début de l’insurrection algérienne, voici ce qu’en disaient les députés de gauche à l’époque : « loi scélérate », « loi de la terreur », « état de siège aggravé », « loi stigmatisante, violente et inutile, synonyme de guerre civile », et j’en passe. Et c’est ce que maintenant la gauche veut mettre dans la Constitution.
Mais de quelle gauche parlez-vous ? Elle a voté les pleins pouvoirs à l’époque !
Sourires.

En vérité, cette loi de 1955, encadrée par le contrôle du Parlement quant à sa durée, par le juge constitutionnel au regard du respect de la Constitution et par le juge administratif quant à sa mise en oeuvre, fonctionne parfaitement. Elle a servi deux républiques, dans des circonstances tout à fait différentes, et est aujourd’hui en action, à la demande du Gouvernement, parce que nous sommes confrontés à des attaques fomentées par des organisations terroristes. Il n’y a aucune raison de constitutionnaliser ce qui fonctionne déjà très bien ainsi, sinon pour faire une opération politique, pour servir d’alibi au fameux serment du Président de la République selon la formule du Premier ministre – bien que je rappelle que ce serment portait sur l’article 2, à savoir la déchéance de la nationalité – ou encore pour servir de base légale au texte que le garde des sceaux va bientôt nous proposer, c’est-à-dire une série de limitations des libertés individuelles au nom de la lutte contre le terrorisme qui trouverait ainsi son fondement dans la Constitution ainsi révisée. Dès lors, cette réforme constitutionnelle, loin d’être une garantie supplémentaire pour nos libertés, marquera un recul parce qu’elle signifiera l’exclusion ad vitam aeternam du juge judiciaire. Si tel est votre objectif, monsieur le garde des sceaux, ayez au moins le courage de le dire.

Cette constitutionnalisation de l’état d’urgence a été beaucoup commentée par les juristes, dont des constitutionnalistes. Ils ne sont pas tous d’accord. Certains d’entre eux estiment qu’elle n’aurait aucune espèce d’intérêt car cela n’apporterait rien de plus, et je partage leur opinion. La loi de 1955 a pu s’appliquer, nous y avons apporté des modifications le 16 novembre dernier, modifications que je n’ai pas votées car elles restreignent à mon sens les libertés. Le Premier ministre nous a annoncé que la guerre contre Daech sera longue, ce qui suppose donc que ce régime d’exception pourrait se prolonger extrêmement longtemps. Nous devrons débattre prochainement de la prorogation de l’état d’urgence et chacun se déterminera à ce moment-là. Pour ma part, je considère qu’il y a un risque significatif pour nos libertés et que l’intégrer dans la Constitution n’amène rien à la lutte contre Daech. Je souhaite donc la suppression de l’article 1er.

La parole est à Mme Isabelle Bruneau, pour soutenir l’amendement no 125 .

L’état d’urgence a été déclaré sur la base de l’article 412-1 du code civil, qui dispose que « constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ». Or, l’article 89 de la Constitution interdit de procéder à une révision constitutionnelle lorsque les institutions sont en péril ou lorsqu’il y a menace sur l’intégrité territoriale.
Par ailleurs, la loi no 55-385 du 3 avril 1955, qui organise le régime d’état d’urgence, prévoit le mode de gouvernement et l’ensemble des dispositifs institutionnels quand il est déclaré. Sa constitutionnalisation n’apporte donc juridiquement rien en tant que telle. Il convient donc de supprimer l’article 1er.

La parole est à M. Pouria Amirshahi, pour soutenir l’amendement no 136 .

Je reste stupéfait, monsieur le Premier ministre, que vous n’ayez toujours pas répondu à l’interpellation sur le fait de modifier la Constitution en plein état d’exception. Cette interrogation est légitime car l’exécutif semble aller un peu vite en besogne et perdre son sang-froid alors même qu’il s’agit, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, de le garder et de prendre le temps de faire le bilan de l’état d’urgence, d’autant plus que vous allez nous proposer de le proroger une nouvelle fois sans que nous n’en connaissions à ce jour les raisons précises et étayées.
J’ajoute que le Président de la République a pris la responsabilité de nous déclarer en guerre – terme discuté et discutable – ; que, selon l’article 89 de la Constitution, « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » ; et qu’aux termes de l’article 412-1 du code pénal, « Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national. » Nous serons tous d’accord pour reconnaître que nous avons subi des attentats le 13 novembre dernier. Dès lors, en application même de l’article 89 susmentionné, je ne vois pas ce qui nous autoriserait légalement aujourd’hui à voter une modification constitutionnelle alors que nous sommes en état de guerre, suivant les propres mots du Président de la République, et qu’il y a mise en danger de l’intégrité du territoire du fait des attentats. Il faut donc supprimer l’article 1er.

La parole est à M. Jean-Pierre Blazy, pour soutenir l’amendement no 161 .

Lors de mon intervention sur l’article 1er, j’ai indiqué que j’étais pour sa suppression. Il complète l’article 36 de la Constitution, relatif à l’état de siège, qui, lui, n’est pas modifié alors qu’il aurait besoin d’évoluer. J’ai écouté tout le débat, et je maintiens ma position. J’ai entendu le Gouvernement et beaucoup de collègues dire que cette disposition permettra de sécuriser l’état d’urgence au regard des libertés publiques en le constitutionnalisant.

Or, on sait que le Conseil constitutionnel a indiqué qu’il n’était pas utile de le faire. Je n’ai pas compris les arguments développés tant par le Gouvernement que par mes collègues. Il y a là bien évidemment un vrai différend entre nous. Mais je serai très attentif aux amendements visant à enrichir l’article 1er – si c’est possible – pour participer de façon constructive au débat et éventuellement modifier quelque peu ma position. En attendant, je suis pour la suppression de cet article car il est urgent avant tout de lutter contre le terrorisme et certainement pas de nous diviser en débattant de tels sujets qui ne nous rassemblent pas.

La parole est à M. Gilbert Collard, pour soutenir l’amendement no 203 .

J’ai déposé cet amendement visant à la suppression de cet article pour des raisons philosophiques et juridiques.
Sur le plan philosophique, je considère que la Constitution, et je me situe ici dans le droit fil de Montesquieu, est le document suprême. On ne peut pas y toucher en dehors de situations qui l’exigent. Or, nous sommes devant un projet de révision constitutionnelle d’une inutilité totale. L’état d’urgence a été décrété et appliqué légitimement, et pas un juriste, pas un député, n’a considéré que la Constitution avait été violée. Dès lors, pourquoi vouloir maintenant l’introduire dans la Constitution ? Ce serait pour mieux l’encadrer mais, cela a été dit, aucun élément de droit ne renforcerait ainsi son encadrement.
En réalité, nous sommes en train d’amoindrir gravement l’idée même de constitution, et nous risquons de le payer cher sur le plan des libertés publiques. S’en prendre ainsi à l’acte fondamental, le manipuler au nom de raisons juridiques que l’on ne comprend pas, c’est particulièrement grave pour le fonctionnement d’une démocratie.
J’ai dès lors l’impression que la Constitution devient la maison de retraite des serments perdus prononcés par le Président lors du Congrès. Cela est particulièrement dommage : notre Constitution mérite mieux que cela, d’autant que l’état d’urgence fonctionne. Nous sommes prêts à le reconduire, mais à la condition qu’il ne devienne pas une situation permanente.

La parole est à M. Dominique Raimbourg, président et rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

La commission a rejeté l’ensemble de ces amendements, en invoquant plusieurs arguments.
Premièrement, la Constitution peut parfaitement être révisée parce que l’article 89 ne trouve pas à s’appliquer. En effet, cet article interdit une révision lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Nous ne sommes pas dans cette hypothèse.
Deuxièmement, il a paru utile et nécessaire de constitutionnaliser l’état d’urgence. Bien qu’étant le régime d’exception qui a été le plus utilisé ces dernières décennies, l’état d’urgence n’a jamais été constitutionnalisé.

C’était le souhait, rappelons-le, des comités Vedel et Balladur.
Troisièmement, cette constitutionnalisation est d’autant plus nécessaire qu’elle renforce l’état d’urgence et accroît son efficacité. En effet, elle met à l’abri les mesures qui peuvent être prises en application de l’état d’urgence de toute question prioritaire de constitutionnalité. Celles-ci ne peuvent alors plus être contestées dans leur principe, ce qui les sécurise.

Quatrièmement, la constitutionnalisation a le mérite d’encadrer l’état d’urgence. C’est ainsi que nous pouvons inscrire dans la Constitution l’obligation d’un contrôle parlementaire.

Nous pouvons statuer sur la durée de l’état d’urgence et sur sa prolongation, ou inscrire dans la Constitution le fait que l’état d’urgence est placé sous le contrôle du juge.

Cela ne figurait pas, je le rappelle, dans la loi de 1955. Il est vrai que nous avons la possibilité de l’inscrire dans toute loi ordinaire, mais l’inscrire dans la Constitution en fera une obligation.

Nous pouvons aussi nous pencher sur la question de la réunion de plein droit du Parlement dès l’instant où l’état d’urgence est prononcé.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l’avis du Gouvernement.
Sans surprise, le Gouvernement est hostile à ces amendements de suppression, puisqu’il a présenté cet article à l’Assemblée nationale et au Sénat et parce qu’il lui paraît illogique, alors que notre législation comporte plusieurs états dérogatoires, donc nécessairement momentanés, qu’un seul d’entre eux ne soit pas constitutionnel.
Il est vrai que cet article ne vise pas à faire évoluer grandement le droit existant. Mais j’appelle l’attention de l’Assemblée nationale sur le fait qu’en complétant le titre V de la Constitution, consacré aux relations entre le Gouvernement et le Parlement, il confère ainsi explicitement à ce dernier une compétence que cette assemblée, je l’imagine, ne manquera pas d’approfondir.
Par ailleurs, même si cela n’est pas en soi un élément déterminant, dans toutes les législations européennes où figure l’état d’exception, celui-ci est inscrit dans la constitution. C’est pourquoi, comme l’a très bien dit le rapporteur, le doyen Vedel ou le premier ministre Balladur, il est assez logique de faire figurer l’état d’urgence dans la Constitution, parce que ce texte est solennel et qu’il garantit la pérennité de l’état d’urgence, hors d’interprétations hasardeuses.
L’argumentation des auteurs des amendements montre une part de posture car, lorsque l’état d’urgence a été utilisé par le Gouvernement, au mois de novembre, bien des voix se sont élevées pour lui reprocher de n’être pas constitutionnel et souligner de possibles interprétations extensives, voire de dérives. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, l’Assemblée avait prévu un contrôle parlementaire. Du moins, nous figeons là un droit existant : les libertés publiques s’en porteront mieux.

J’observe que l’Assemblée et le Sénat sont parfaitement en état de délibérer : aucun parlementaire n’est empêché de se rendre dans les hémicycles, le pays n’est pas occupé. Nous pouvons donc parfaitement modifier la Constitution. Voilà qui répond à un argument entendu à répétition, bien qu’il paraisse assez surréaliste.

Par ailleurs, il est vrai que notre droit prévoit trois états de crise, dont l’un n’est pas inscrit dans la Constitution.

Il mériterait pourtant de l’être puisqu’il est, des trois, le plus souvent utilisé. L’UDI est donc favorable à cette inscription, à condition, monsieur le Premier ministre, monsieur le garde des sceaux, de saisir l’occasion pour l’encadrer véritablement, ce que, à nos yeux, le projet de loi initial ne fait pas suffisamment. Il faut d’abord l’encadrer dans le temps, pour qu’il soit obligatoire de revenir devant le Parlement – la Constitution peut donner cette garantie à toutes les assemblées futures et aux Français. Mais il faut également l’encadrer par un contrôle parlementaire que je souhaite équilibré.
De fait, c’est grâce à la volonté des présidents des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat et avec l’accord du Gouvernement que nous pouvons actuellement vérifier que telle ou telle mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence ne traduit pas une dérive autoritaire de la part de l’administration ou du pouvoir politique. Sous une autre majorité ou dans d’autres circonstances, un tel contrôle parlementaire pourrait ne pas exister, car son exercice n’est pas automatique. Il doit le devenir, sans quoi nous serions exposés à de dangereuses dérives.
Enfin, si nous acceptons qu’un gouvernement, ayant décrété l’état d’urgence et obtenu sa prolongation, puisse exercer davantage de pouvoirs pendant une durée limitée et sous le contrôle du Parlement, nous ne pouvons pas, en revanche, lui permettre de dissoudre l’Assemblée nationale et d’organiser des élections législatives. Il serait en effet dangereux pour la démocratie qu’une campagne électorale soit organisée dans de telles circonstances puisque, pendant ces quarante jours, il serait possible de restreindre les libertés publiques – dont celle de communication –, voire d’assigner à résidence des personnes jugées un peu trop agitées. Il faut au contraire qu’une campagne électorale soit libre et démocratique, donc que l’état d’urgence cesse automatiquement à ce moment.

Parce que, comme je l’ai indiqué, je voterai cette modification de la Constitution, je suis naturellement opposé aux amendements de suppression qui viennent d’être discutés. Mais, je l’ai dit aussi, il nous faut à présent nous pencher sur certaines questions, qui sont dans le droit fil de la logique sous-tendue par le projet de loi constitutionnelle.
J’ai ainsi rédigé une proposition de loi, que je soumettrai aujourd’hui même à l’ensemble de mes collègues, destinée à étendre aux terroristes la peine de sûreté incompressible lors d’une condamnation à perpétuité. L’article 221-3 du code pénal le prévoit pour le meurtre avec viol ou torture d’un mineur de moins de quinze ans, ainsi que pour le meurtre en bande organisé d’un policier –monsieur le ministre de l’intérieur – ou d’un magistrat – monsieur le garde des sceaux. Dès lors qu’ils représentent un danger permanent, les terroristes susceptibles de viser notre pays à l’avenir – à l’image des assassins qui l’ont frappé il y a quelques semaines – doivent également être concernés par une telle disposition.
Au cours de ce débat, nous avons pu entendre – sur l’ensemble des bancs, d’ailleurs – de nombreuses arguties. Il me semble qu’il faudrait revenir à l’essentiel et se préoccuper de sujets extrêmement concrets – tels que les moyens d’empêcher les terroristes d’agir dans le futur.

Je vois deux objections à l’argumentation développée il y a quelques instants par le garde des sceaux. S’agissant du Parlement, tout d’abord, la constitutionnalisation de l’état d’urgence aura pour effet d’en limiter le rôle à celui voulu par la commission des lois de l’Assemblée nationale et par son président, c’est-à-dire à une simple fonction de contrôle. En définitive, si nous adoptons la nouvelle rédaction proposée pour l’article 36-1, le Parlement n’aura, en définitive, même plus à décider de la durée de l’état d’urgence : il ne pourra que s’interroger sur la manière dont celui-ci est appliqué.
Il est donc regrettable de vouloir ainsi figer les termes de la loi de 1955 – même si des adaptations seront sans doute adoptées à la marge –, car cela revient à réduire le rôle du Parlement. S’agissant de sujets qui touchent aux libertés fondamentales, une telle évolution me paraît malvenue.
Quant à l’argument selon lequel la constitutionnalisation de l’état d’urgence permettrait de se prémunir de toute dérive, je lui opposerai que, jusqu’à preuve du contraire, toute majorité peut réviser la Constitution : ce n’est donc pas parce qu’une formulation y est inscrite qu’elle est plus solide qu’une autre. Il n’y a pas de garantie supplémentaire par rapport à des régimes futurs – en l’espèce, tous sont susceptibles de dérives, pas seulement ceux auxquels vous pensez, monsieur le garde des sceaux.
Je maintiens donc ma volonté de supprimer cet article.

Pour le groupe SRC, si quelque chose doit être constitutionnalisé dans notre république, c’est bien l’état d’urgence. Contrairement à ce que prétendent quelques députés à droite, à l’extrême droite aussi – nous venons de le voir –, et parfois, malheureusement, à gauche,
Murmures sur certains bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

Une constitutionnalisation de l’état d’urgence – qui est le moyen d’exception le plus utilisé sous la Ve République –…

Cela prouve que ce n’est pas la peine de l’inscrire dans la Constitution !

…serait plus protectrice pour nos libertés que le droit actuel. Tous les autres sont constitutionnalisés, et il serait inutile de constitutionnaliser celui-là ? Cela nous paraît tout à fait contradictoire. À cet égard, je renvoie nos collègues aux travaux des comités Vedel et Balladur.
Nous avons au contraire le sentiment que la constitutionnalisation de l’état d’urgence, telle qu’elle est prévue par l’article 1er et compte tenu des amendements dont nous allons débattre – en particulier ceux relatifs au contrôle exercé par l’Assemblée nationale – constitue une avancée très importante pour les libertés publiques.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Sur les amendements de suppression nos 15, 17, 23, 70, 87, 120, 125, 136, 161 et 203, je suis saisi par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Gérard Bapt.

Également opposé à ces amendements, je souhaiterais reprendre un argument développé par Patrick Mennucci : ne pas inscrire dans la Constitution le régime exceptionnel le plus fréquemment utilisé sous la Ve République, alors même que d’autres régimes y figurent aux articles 16 et 36, me paraît un contresens. Vous affirmiez, monsieur Poisson, que cette constitutionnalisation n’était pas nécessaire. Or c’est non seulement l’état d’urgence qu’il est nécessaire d’inscrire dans la Constitution, mais aussi sa prolongation, jusqu’à ce qu’une nouvelle loi vienne renforcer les pouvoirs des autorités administratives.
Le 12 novembre, la veille du sinistre jour des attentats, un Français converti, sa femme, également française, et leur bébé de six mois sont partis de Tarbes pour s’envoler vers Istanbul depuis l’aéroport de Toulouse. Ils étaient en possession d’une grosse somme d’argent, sous le prétexte de partir fonder un orphelinat en Syrie. La fiche S, bien qu’ayant conduit à une alerte à l’aéroport de Toulouse, n’a pas empêché leur départ. Rapatriés en France après que, le 14 novembre, la Turquie leur a refusé le séjour sur le territoire turc, ces personnes sont aujourd’hui assignées à résidence dans les Hautes-Pyrénées.
Voilà pourquoi l’état d’urgence est nécessaire, aujourd’hui : pour la sécurité des Français et pour empêcher de nouveaux candidats djihadistes d’aller combattre en Syrie, une préoccupation à laquelle, monsieur Poisson, nous sommes tous les deux sensibles.

Fondé, monsieur le président, sur l’article 58… Je suis absolument estomaqué d’entendre maintenant évoquer la nécessité de l’état d’urgence. Mais oui, monsieur Bapt, vous avez tout à fait raison, l’état d’urgence est indispensable ; et bien entendu, il faut actualiser la loi de 1955. Mais il ne faut pas le mettre dans la Constitution ! Vous avez dit qu’une constitutionnalisation donnerait plus de force au dispositif – mais on peut proposer vingt-cinq textes de loi à inscrire dans la Constitution pour qu’ils aient plus de force !
Qu’est-ce que cela veut dire ? On ne va pas faire de la Constitution un nouveau code de travail, avec ses 15 000 pages – j’exagère à peine. Elle deviendrait incompréhensible !
Nous sommes le seul pays à modifier ainsi en permanence notre constitution.

On était loin du rappel au règlement, monsieur Debré – mais cela nous aura permis de gagner un peu de temps pour préparer le scrutin.
Je mets donc aux voix les amendements de suppression nos 15, 17, 23, 70, 87, 120, 125, 136, 161 et 203.
Il est procédé au scrutin.

La parole est à M. Michel Pouzol, pour soutenir l’amendement no 176 deuxième rectification.

S’il nous fallait inscrire l’état d’urgence dans la Constitution – ce dont certains d’entre nous doutent –, il conviendrait de supprimer l’article 16 de cette même Constitution, qui est l’une des dispositions engendrant le plus grand sentiment d’anachronisme au regard de l’évolution ultérieure du droit français.
Je rappelle que cet article n’a donné lieu qu’à une seule utilisation, par le général de Gaulle à la suite du putsch de généraux à Alger au printemps 1961. Il est considéré comme l’un des plus dérogatoires et attentatoires aux libertés publiques ; il a d’ailleurs fait à de nombreuses reprises l’objet de propositions de réforme. La suppression de l’article 16 éviterait également la confusion des pouvoirs exceptionnels.
Le deuxième objectif de l’amendement est d’offrir des garanties pour la protection de nos libertés fondamentales, en précisant notamment, conformément à l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, les conditions du déclenchement de l’état d’urgence. On ne peut conserver la référence au « péril imminent », alors que la menace terroriste est évolutive et protéiforme ; de surcroît, le motif d’« atteintes graves à l’ordre public » est trop large et susceptible de porter atteinte à nos libertés. Il nous semble important de préciser que l’on ne peut déroger à certaines garanties en matière de droits humains que dans des circonstances bien définies.
L’amendement tend aussi à instaurer un contrôle parlementaire a priori en reprenant la formulation utilisée à l’article 16, à renvoyer à une loi organique le soin de fixer les mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles – c’est-à-dire à rendre automatique le contrôle du Conseil constitutionnel – et à limiter dans le temps et dans l’espace la prorogation de l’état d’urgence : une durée de six mois nous paraîtrait justifiée tant par l’histoire – la seule fois où l’article 16 a été utilisé en France, cela a duré six mois – que par le droit comparé : aux États-Unis, la durée n’excède pas cent vingt jours, en Lituanie et en Turquie, elle ne dépasse pas six mois.

Il est défavorable, pour deux raisons. La première est que l’article 16 et l’état d’urgence ne correspondent pas aux mêmes régimes d’exception. L’article 16 ne s’applique que si le fonctionnement des institutions est paralysé et qu’une menace pèse sur le pays. D’ailleurs, la seule occurrence d’utilisation de cet article remonte à 1961, et c’était pour prolonger l’état d’urgence : c’est dire si nous avons affaire à deux régimes distincts !
Quant à l’idée de soumettre l’état d’urgence à un contrôle juridictionnel, elle est séduisante sur le papier, mais serait extrêmement difficile à mettre en oeuvre, car le temps du contrôle par le juge est beaucoup trop long. Si un contrôle devait être prévu, il devrait se faire a posteriori.
L’avis est défavorable. En sus des arguments du rapporteur, le Gouvernement considère qu’il existe un risque de confusion entre la rédaction proposée et le régime de l’état de guerre.
L’amendement comporte des éléments intéressants, tels que ceux relatifs au contrôle parlementaire ou à la prorogation de l’état d’urgence, mais ceux-ci se retrouvent dans d’autres amendements, que nous examinerons ultérieurement.
L’amendement no 176 deuxième rectification n’est pas adopté.

L’article 1er fait référence à des « événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Nous pensons qu’il est préférable de parler d’« événements dommageables d’une exceptionnelle gravité ». Il nous semble en effet que la « calamité publique » fait plutôt référence à des événements tels qu’un tsunami ou un tremblement de terre et que cela n’a rien à voir avec la tradition juridique de l’exceptionnelle gravité.

Ce n’est pas le bon amendement qui a été défendu. L’amendement no 61 tend à remplacer l’expression d’« état d’urgence » par celle d’« état de nécessité ». La commission y a émis un avis défavorable.
Nous reviendrons sur la question des calamités publiques ultérieurement.
Sur l’amendement no 61 , dont vient de parler le rapporteur mais qui n’est pas celui qui a été défendu, le Gouvernement a émis un avis défavorable – même si Alain Tourret aurait été brillant dans sa démonstration. Nous l’avons déjà évoqué : « l’état de nécessité » est une notion bien connue en droit administratif et en droit pénal, mais qui est différente de ce que l’on vise ici. Le Gouvernement ne souhaite donc pas la retenir – au risque de ne pas avoir de débat avec Alain Tourret.

On démontre là par A plus B qu’il suffirait de modifier la loi de 1955 : on peut aménager, actualiser, moderniser l’état d’urgence !

Ce qui est dit est très intéressant, mais cela n’a rien à voir avec le fait de constitutionnaliser !
Monsieur Mennucci, vous avez dit qu’il fallait constitutionnaliser le dispositif parce que cela lui donnerait du poids : eh bien, donnons du poids à toutes nos lois et constitutionnalisons-les, cela nous fera une Constitution merveilleuse !
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Je rectifie bien évidemment mon argumentation, ayant inversé les amendements nos 61 et 62 .
Il existe trois notions : l’état d’urgence, l’état de crise et l’état de nécessité. Il m’apparaît bien supérieur, en termes de droit public, de faire référence à l’état de nécessité plutôt qu’à l’état d’urgence. L’état d’urgence, c’est ce qui existe en droit civil : cela permet de faire à tout moment par exemple un constat. L’état de nécessité, on a cru par le passé qu’il s’agissait d’une notion qui renvoyait au droit pénal et à l’invocation de la nécessité en vue de justifier un acte délictueux, mais dans ce cas précis, cela n’a rien à voir. L’état de nécessité, tel que Mme Camus l’a présenté dans sa thèse « L’état de nécessité en démocratie », est une notion essentielle qui vise à répondre, dans le cadre des pouvoirs publics, à une situation exceptionnelle, par nécessité. C’est beaucoup plus fort, et cela ne s’insère pas dans un délai prédéterminé comme l’état d’urgence.
L’amendement no 61 n’est pas adopté.

La parole est à M. Dominique Raimbourg, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 41 .

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à substituer au mot « déclaré » le mot « décrété », de manière à aligner le dispositif sur celui des autres régimes d’exception : l’état d’urgence sera institué par décret en Conseil des ministres.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement : cette précision sur la nature de la norme applicable est un facteur supplémentaire de protection des libertés dans la mesure où le décret est la plus élevée des normes de nature réglementaire.
L’amendement no 41 est adopté.

Cet amendement vise, à l’alinéa 2, à substituer aux mots : « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », les mots : « guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la Nation ».
En effet, le critère de déclenchement de l’état d’urgence mentionné dans le texte initial nous semble beaucoup trop large. La notion de « péril imminent » est trop floue. Par exemple, le péril terroriste est constamment imminent ; si l’on se basait sur ce critère, cela suffirait à justifier in fine un état d’urgence permanent.
La référence à l’ordre public est elle aussi trop large et surtout totalement subjective, puisque les atteintes à l’ordre public s’apprécient différemment selon le contexte, l’époque et parfois même les moeurs, comme le rappelle la jurisprudence du Conseil d’État. Il serait hasardeux de fixer un critère subjectif au déclenchement de l’état d’urgence.
Il conviendrait à notre sens de se fonder plutôt sur l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui fait autorité puisqu’elle a été validée et ratifiée par la France, et qui fixe un critère standard justifiant une dérogation à la protection des droits de l’homme en cas d’état d’urgence.

Défavorable. Si l’on se réfère aux attentats qui ont eu lieu au Bataclan, la formulation proposée par l’amendement n’aurait pas permis de déclencher l’état d’urgence,…

…puisque nous n’étions pas dans une situation de guerre au sens propre…

…et qu’aussi dramatiques qu’aient été ces événements, la vie de la nation n’était pas directement menacée : les assassins ont tous été soit neutralisés, soit tués. Je pense qu’il vaut mieux conserver la formulation initiale.
Il est défavorable. Le Gouvernement estime que l’amendement apporterait plus de confusion que de clarification dans la mesure où la notion d’« atteinte grave à l’ordre public » est bien connue en droit et que les juridictions administratives ont l’habitude de la contrôler. En outre, la prévention des atteintes à l’ordre public est un objectif à valeur constitutionnelle, reconnue par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et donc conforme à la sécurité juridique.

Je crois qu’il faut voter contre l’amendement : il n’aurait effectivement pas permis d’instaurer l’état d’urgence après le Bataclan.
Toutefois, monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous signaler une chose qui me choque profondément : vous faites constamment référence au Bataclan, et vous oubliez tous les autres. Dans l’exposé des motifs du projet de loi, on évoque 130 morts ; mais où sont passés ceux de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher ? Cela ne fait pas 130, mais beaucoup plus !
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Là, une fois de plus, on ne parle que du Bataclan ; il serait nécessaire d’élargir et d’avoir une pensée pour tous les autres morts.

Quand on constitutionnalise, il faut être précis. Or on sait bien que le mot « guerre » fait polémique, certains disant que nous sommes en guerre, d’autres répondant que nous ne le sommes pas. Si l’on utilisait ce mot, cela provoquerait un débat au moment de la publication du décret instaurant l’état d’urgence : ce n’est pas concevable !
Le groupe socialiste est bien évidemment contre l’amendement, mais le mieux serait que celui-ci soit retiré par ses auteurs. Il me semble que les arguments avancés par le Gouvernement et le rapporteur sont de bonne qualité et ne remettent pas en cause, sur le fond, leurs idées.
L’amendement no 177 n’est pas adopté.

Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 159 rectifié , 62 , 121 et 122 , pouvant être soumis à une discussion commune.
La parole est à M. Dominique Raimbourg, pour soutenir l’amendement no 159 rectifié .

Il s’agit de faire en sorte que l’état d’urgence couvre non seulement les atteintes à l’ordre public mais aussi ce que l’on appelle les « calamités publiques » : catastrophes écologiques, catastrophes naturelles, catastrophes liées à des épidémies.

Mon amendement est proche de celui de M. Raimbourg : il propose, lui aussi, une nouvelle rédaction de la fin de l’alinéa 2 supprimant la référence aux calamités publiques.

La parole est à Mme Isabelle Bruneau, pour soutenir l’amendement no 121 .

Il s’agit d’insérer, à la fin de l’alinéa 2, les mots « de catastrophe naturelle ou écologique ».
Au lendemain de la Conférence de Paris 2015 sur le climat, qualifiée d’historique et organisée dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, il apparaît indispensable que l’ensemble des textes parlementaires, quelle que soit leur visée, prenne en compte l’impératif écologique. C’est ce que propose cet amendement.

Vous gardez la parole, madame Bruneau, pour soutenir l’amendement no 122 .

Il a le même objectif que l’amendement précédent, mais il n’insère que les mots « de catastrophe écologique » à la fin de l’alinéa 2.
Défavorable. Le Gouvernement souhaite que ces amendements soient retirés, dans la mesure où la rédaction proposée de l’alinéa 2 permet déjà de répondre à toutes les craintes exprimées par le rapporteur. La notion de calamité publique englobe les événements d’une gravité extrême, y compris ceux dans lesquels l’activité humaine aurait joué un rôle, comme un accident dans une centrale nucléaire, par exemple. De notre point de vue, tout est sécurisé.

Il est tout à fait extraordinaire de vouloir insérer dans la Constitution les tremblements de terre ! Où sommes-nous arrivés ? Qu’allons-nous mettre dans notre Constitution ? Dans ce cas, pourquoi ne pas faire référence aux accidents de car ? Lorsqu’il y a un accident de car grave – on en a déjà connu –, on pourrait peut-être aussi demander la mise en oeuvre de l’état d’urgence…

Et les épidémies, en effet. Tout pourrait être ajouté dans la Constitution ! Nous suivons une pente absurde.

Nous sommes extrêmement opposés à l’amendement no 159 rectifié et aux suivants. L’expression « calamité publique », prévue par la rédaction actuelle, englobe tous ces événements.
Sous prétexte d’élargir les possibilités de recours à l’état d’urgence, tous ces amendements le restreignent en réalité, dans la mesure où ils le soumettent à une interprétation ultérieure du Conseil constitutionnel. Plus nous allons dans ce sens, moins nous donnons au Gouvernement la capacité de juger en conscience de la nécessité de déclencher l’état d’urgence, et moins nous donnons aux futurs parlementaires la liberté d’apprécier l’opportunité de sa prolongation. Je rappelle en effet que la réaction immédiate est entre les mains du pouvoir exécutif et que la prolongation est entre les mains du pouvoir législatif : ces verrous sont suffisants.
Si nous venions à rendre plus précise la description des raisons justifiant le déclenchement de l’état d’urgence, nous pourrions nous retrouver dans une situation non prévue par notre loi fondamentale et qui rendrait impossible la mise en oeuvre de cette mesure, empêchant l’État de réagir avec les moyens exceptionnels dont il pourrait avoir besoin.
Il faut donc en rester à la rédaction proposée par le Gouvernement. Nous voterons contre l’ensemble de ces amendements.

Monsieur le président de la commission des lois, le remplacement du mot « événements » par les mots « dommages majeurs » empêcherait de déclencher l’état d’urgence pour prévenir les conséquences d’une catastrophe naturelle ou d’un accident technologique majeur, en termes d’ordre public et de protection de la population.

La rédaction proposée par M. Tourret, qui conserve le mot « événements » mais le précise en le qualifiant de « dommageables d’une exceptionnelle gravité », me paraît meilleure. À défaut, mieux vaudrait garder le texte proposé par le Gouvernement.
Parler de « dommages majeurs » empêcherait de recourir à l’état d’urgence lorsqu’un accident nucléaire ne s’est pas encore produit mais qu’il faut d’ores et déjà prendre des décisions visant à assurer l’ordre public.

Les interventions de Mme Batho et de M. Lagarde m’ont convaincu. Dès lors que le Gouvernement précise que l’expression « calamité publique » englobe tous les événements que nous avons évoqués, il vaut mieux conserver la rédaction initiale. Je retire donc mon amendement.
« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.
L’amendement no 159 rectifié est retiré.
L’amendement no 62 n’est pas adopté.

Cet amendement vise à compléter l’alinéa 2 en reprenant la formulation de l’article 16 de la Constitution, lequel prévoit la consultation a priori du Parlement. Les parlementaires, en qualité de représentants de la nation, doivent pouvoir se prononcer sur la déclaration de l’état d’urgence.

Défavorable. Les parlementaires se prononcent nécessairement, puisqu’au bout de douze jours, ils doivent proroger l’état d’urgence.
Défavorable. La comparaison des deux états de crise n’est pas pertinente. Le recours à l’article 16 suppose l’interruption du fonctionnement des pouvoirs publics : il est donc logique de prévoir la consultation du Parlement et l’information de la nation. Or, dans le cadre de l’état d’urgence, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics n’est pas interrompu : l’équilibre des pouvoirs n’est donc pas modifié et le Parlement peut continuer à exercer l’ensemble de ses prérogatives. La mesure proposée par l’amendement no 175 n’est donc pas justifiée.
Par ailleurs, l’article 4 de la loi de 1955 dispose que l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. La constitutionnalisation du contrôle parlementaire nous paraît plus pertinente que l’amendement proposé par M. Pouzol.
L’amendement no 175 est retiré.

Il vise à assurer que la constitutionnalisation du régime de l’état d’urgence corresponde au meilleur équilibre possible entre l’impératif de sécurité publique et la garantie des libertés individuelles. Il propose donc de modifier la rédaction de l’article 1er du projet de loi constitutionnelle de manière à préciser que le décret portant déclaration de l’état d’urgence est motivé, que les mesures prises à ce titre doivent correspondre à ces motifs et objectifs, et qu’elles ne sont pas nécessairement des mesures de police administrative – il appartiendra à la loi organique de vérifier les conditions d’intervention de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles.

Mon amendement précise également qu’une loi organique – et non une loi ordinaire – organise le régime de l’état d’urgence, auquel le Parlement peut mettre un terme à tout moment.

Défavorable, pour les raisons exposées tout à l’heure. Les consultations ou les précautions prises au moment du déclenchement de l’état d’urgence alourdissent le système.
Même avis, pour les raisons qui ont déjà été développées.
Permettez-moi de donner mon point de vue sur le recours à une loi organique pour organiser le régime de l’état d’urgence, que Mme Buis vient de réclamer et qui revient dans plusieurs amendements. Quel est l’avantage de la loi organique par rapport à la loi ordinaire ?

Quel est l’avantage de la Constitution par rapport à la loi ordinaire ?
Il est double. D’une part, le Conseil constitutionnel contrôle a priori les lois organiques. D’autre part, certaines majorités spécifiques sont requises pour l’adoption de ces lois. Dans le cas d’espèce, cela ne nous paraît pas indispensable, dans la mesure où le Conseil constitutionnel peut être saisi, depuis 1974, par soixante députés ou soixante sénateurs avant la promulgation de la loi : l’effet bénéfique d’un contrôle par le Conseil constitutionnel est donc assuré.
L’amendement no 181 n’est pas adopté.

Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai conjointement les amendements nos 36 et 25 . Nous avons déjà eu ce débat en commission des lois, et l’amendement no 25 est un amendement de repli par rapport à l’amendement no 36 .
Je peux entendre qu’on ne veuille pas réécrire l’intégralité de l’article 1er, mais je veux insister sur un point très précis : celui du recours à la loi organique. M. le garde des sceaux vient d’expliquer que nous n’avions plus besoin de lois organiques, puisque les parlementaires ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Supprimons donc la possibilité d’adopter des lois organiques !
À mon sens, la définition des mesures que les autorités civiles peuvent prendre pendant l’état d’urgence doit figurer dans une loi organique. Il ne faut pas confondre la loi de prorogation de l’état d’urgence, qui valide et poursuit la décision prise par décret en conseil des ministres, et la loi qui définit les mesures applicables durant l’état d’urgence. Au mois de novembre, nous avons fait les deux choses en même temps : il peut donc y avoir confusion.
En l’occurrence, le Gouvernement a annoncé qu’une loi viendrait imaginer de nouvelles mesures susceptibles d’être prises dans le cadre de l’état d’urgence, notamment la saisie d’objets ou la rétention de personnes à leur domicile pour une durée limitée. Il nous semble tout à fait raisonnable qu’une telle loi soit adoptée par une majorité spécifique, qu’elle soit discutée par le Parlement dans un délai minimal de quinze jours après son dépôt, et qu’elle fasse l’objet d’une évaluation. Je parle bien de la loi définissant les nouvelles mesures, et non de la loi de prorogation de l’état d’urgence.
Monsieur le garde des sceaux, nous avons adopté de telles modifications dans le cadre de la loi du 20 novembre 2015, dans la précipitation et en téléphonant au président de la commission des lois du Sénat pour nous assurer du vote conforme de la seconde chambre. Évidemment, cette loi n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et d’aucune évaluation réelle ; le Premier ministre avait même évoqué un risque constitutionnel lié à l’ajout de mesures coercitives majeures comme celle du bracelet électronique.
Pour faire les choses de manière convenable, il m’apparaît tout à fait raisonnable que ce soit une loi organique qui définisse les mesures susceptibles d’être prises pendant l’état d’urgence. Tel est l’objet de mon amendement no 36 . Mais, par souci de simplicité, j’ai également déposé un amendement no 25 , qui consiste à n’ajouter que le mot « organique » sans toucher au reste du texte.

Sur l’amendement no 36 , je suis saisi par le groupe écologiste d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
Mes chers collègues, je vous informe d’ores et déjà que l’amendement no 25 et les amendements identiques feront également l’objet d’un scrutin public, à la demande du groupe écologiste.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement no 36 ?

Il est défavorable.
Quant à l’amendement no 25 , la commission lui a également donné un avis défavorable, mais je tiens à préciser qu’à titre personnel, j’y suis favorable. En effet, le fait d’encadrer les mesures à venir par la loi organique permet de les sécuriser.
La loi organique et la loi ordinaire présentent chacune des avantages et des inconvénients.
L’avantage de la loi organique est, à l’évidence, de sécuriser les mesures et de donner des garanties aux défenseurs des libertés, en leur expliquant que le catalogue des mesures susceptibles d’être prises sera défini préalablement à toute déclaration de l’état d’urgence et qu’il pourra être soumis au Conseil constitutionnel.
La loi organique a cependant un inconvénient : si nous nous apercevons qu’une mesure nouvelle est nécessaire au moment de voter la prorogation de l’état d’urgence, ou si des techniques nouvelles ont été découvertes entre-temps – nous avons été confrontés à ce cas lorsque nous avons dû rénover la loi de 1955 –, alors nous serons condamnés à voter une loi organique, à moins que nous n’ayons pris la précaution de toiletter la loi cadre au fur et à mesure. Mais l’expérience montre qu’il est difficile de toiletter une loi et qu’en temps de paix, on ne se préoccupe pas des situations de crise. Par ailleurs, le législateur qui voudra ajouter de nouvelles mesures à cette loi organique sera forcément accusé, en temps de paix, de prendre des mesures liberticides.
Nous voilà confrontés à cette difficulté. Les deux options présentent des avantages et des inconvénients.
Défavorable. J’ai dit tout à l’heure que le contrôle de constitutionnalité nous paraissait déjà garanti. À cet argument s’ajoute la question des délais – il s’agit là d’un débat malheureusement paradoxal. Chacun sait ici que l’adoption d’une loi organique est soumise à une procédure particulière : des délais s’appliquent à la navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat, et le texte doit être adopté à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale en cas de désaccord entre les deux chambres. Cet allongement des délais ne nous paraît pas nécessairement compatible avec l’urgence des situations qui peuvent amener à décider l’état d’urgence.

L’amendement de Mme Duflot mérite un examen approfondi, et les arguments du rapporteur étaient très clairs à cet égard ; j’ajouterai personnellement, contre cet amendement, une objection qui tient aux délais. L’existence d’une loi organique, lorsque fut pris le décret relatif à l’état d’urgence, aurait empêché certaines saisies informatiques une semaine seulement après les attentats de novembre. En prorogeant, ici même, l’application de la loi de 1955, nous avons notamment permis aux services de police d’effectuer des recherches dans les mémoires des ordinateurs de suspects.
Le débat existe, madame Duflot, mais les exigences de rapidité, dans une situation relevant par définition de l’urgence, ne me paraissent pas compatibles avec une loi organique.

Je comprends mal la réponse faite par M. le garde des sceaux relativement aux inconvénients d’une loi organique par rapport à une loi simple. Si l’état d’urgence, inscrit dans la Constitution, n’est défini que par une loi simple – échappant donc à un contrôle a priori du Conseil constitutionnel –, des questions prioritaires de constitutionnalité – QPC – pourront à tout moment être soulevées et remettre en cause les mesures prises dans ce cadre.
Je ne vois donc pas quel serait, sur ce sujet, l’avantage absolu d’une loi simple. Au vu de ce que devrait être la position du Sénat, nous serons sans doute conduits, pendant un bon moment encore, à proroger les dispositions du 20 novembre dernier, lesquelles relèvent d’une loi simple, celle de 1955 : nous ne serons donc pas dans le cadre d’une loi simple ou organique qui déclinerait la constitutionnalisation de l’état d’urgence. Bref, monsieur le garde des sceaux, je ne suis pas convaincue des avantages d’une loi simple au regard des garanties offertes par une loi organique.

Le débat entre les députés de la majorité, le président de la commission des lois et le garde des sceaux, qui ne disent pas la même chose, montre bien la difficulté en germe dans la constitutionnalisation de la loi de 1955.
Je le répète : j’ai voté l’état d’urgence sans état d’âme, comme la totalité des membres de mon groupe. Le Premier ministre et le Président de la République nous ont expliqué que nous sommes en guerre et qu’il importe de protéger à tout prix nos concitoyens, ce que permet justement la loi de 1955, relative à l’état d’urgence.
La constitutionnalisation est à mes yeux inutile, et j’ai du mal à trouver des juristes qui la trouvent nécessaire ; elle implique, en tout état de cause, d’ouvrir le débat sur l’application de la Constitution. La loi simple de 1955, je le répète, a fonctionné sous deux Républiques, dans des cas de figure complexes, et elle a permis à l’exécutif de travailler, sous le contrôle du Parlement ; bref, elle a permis l’entrée comme la sortie de l’état d’urgence, le contrôle parlementaire et juridictionnel : pourquoi ajouter encore de la complexité ?
Proposer cette constitutionnalisation, c’est ouvrir le débat posé par Mme Duflot : pourquoi pas, en effet, une loi organique, à ceci près que celle-ci, M. le garde des sceaux vient de le rappeler, ajouterait encore de la complexité.
De grâce, restons-en à ce qui fonctionne : pourquoi vouloir le « casser » ? La loi de 1955 a permis à l’exécutif d’adopter des mesures utiles pour la protection de nos concitoyens : pourquoi ouvrir le débat de la constitutionnalisation, sinon pour des raisons de politique politicienne ? C’est le soupçon que je nourris depuis le 16 novembre, et le débat qui dure depuis trois mois ne fait malheureusement que le confirmer.
Puisque mes propos ont visiblement été mal compris, je veux redire la position, très simple, du Gouvernement.
Par principe, celui-ci n’aurait pas été hostile à une loi organique, comme le proposait d’ailleurs le comité Balladur. L’argument en faveur de cette solution tient à la certitude que, par définition, toute mesure contenue dans une loi organique est conforme à la Constitution. Mais le Gouvernement estime qu’une loi ordinaire le permet tout autant dès lors que le Conseil constitutionnel en est saisi a priori, autrement dit avant la promulgation, ou a posteriori via une QPC, sur le fondement de l’article 61-1.
Si l’argument est celui de la solidité constitutionnelle, une loi ordinaire est donc suffisante.

Contrairement à ce que pense M. Lellouche, l’intervention que vient de faire M. le garde des sceaux montre que nous touchons au point crucial s’agissant de la constitutionnalisation de l’état d’urgence. L’argument de la complexité objecté à la loi organique sous-entend, à l’inverse, que l’état d’urgence pourra être décidé – et avec lui n’importe quelle nouvelle mesure – via une loi simple, en quarante-huit heures, comme nous l’avons fait récemment par notre vote. La différence est que, aujourd’hui, l’état d’urgence est régi par une loi simple dont on peut vérifier, comme l’a dit M. le garde des sceaux, la conformité à la Constitution. Dès lors que – et c’est là le sens de mon amendement et de mon opposition à l’article – l’état d’urgence est lui-même constitutionnalisé, les dispositions de la loi déclinant cette constitutionnalisation sont difficilement contestables au regard de la Constitution.

C’est là qu’est le piège : la constitutionnalisation de l’état d’urgence offre une grande largesse dans la définition des mesures qui peuvent être prises. Si celles-ci, votées dans l’urgence, sont très dérogatoires à l’État de droit et attentatoires aux libertés publiques, un conflit de constitutionnalité peut apparaître : comme je l’ai dit, le présent article expose à un danger d’écrasement partiel de l’État de droit.
D’autre part, monsieur Mennucci, il me paraît légitime d’empêcher le vote de certaines mesures sous le coup de l’émotion et suite à un événement très grave, notamment si l’état d’urgence est constitutionnalisé. Jusqu’à quel niveau de dérogation à l’État de droit et aux libertés publiques irait-on, dans une loi simple votée en vingt-quatre ou quarante-huit heures par les parlementaires, sans réflexion approfondie et dans le bruissement de l’événement ? Nul ne le sait. Dès lors que l’état d’urgence est constitutionnalisé, l’amendement que je propose est la seule garantie contre des dérapages sans fin.
Je veux ajouter quelques mots sur la nécessité de constitutionnaliser l’état d’urgence. Cette constitutionnalisation, avance-t-on en premier lieu, ne serait pas nécessaire dès lors que le Conseil constitutionnel a établi, dans sa décision de 1985, la constitutionnalité de l’état d’urgence.
Mais, dans cette décision, le Conseil constitutionnel dit tout autre chose : il se déclare incompétent pour apprécier la constitutionnalité d’un texte promulgué avant la Constitution de 1958. Bref, cette objection à l’article 1er repose sur un faux raisonnement, qui ne correspond pas au contenu de la décision de 1985.
Le raisonnement de Mme Duflot ne tient pas davantage au regard du droit. Une fois l’état d’urgence constitutionnalisé, dit-elle, tout serait permis dans la loi ordinaire qui le mettrait en oeuvre dans la précipitation, y compris des mesures anticonstitutionnelles. Mais ce n’est pas possible puisque le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une loi ordinaire par un nombre déterminé de parlementaires, et la censurer pour sa non-conformité avec notre loi fondamentale.
Votre raisonnement ne tient pas non plus, madame Duflot, en ce qu’il est contradictoire de définir l’état d’urgence comme un état d’exception qui justifie les plus grandes précautions tout en refusant d’inscrire celles-ci dans la Constitution afin, justement, de préserver les libertés publiques et de définir les limites au-delà desquelles le législateur ne peut pas aller. Votre raisonnement est quelque peu bizarre : si l’état d’urgence vous semble poser problème au regard des libertés publiques, alors vous devriez être la première à soutenir sa constitutionnalisation, car elle garantit qu’il ne remettra jamais en cause ces libertés.
Troisième argument : on n’est pas obligé, dans une loi relative à l’état d’urgence, d’adopter toutes les mesures envisageables dans un tel cadre. L’inscription de l’ensemble de ces mesures au sein d’une loi organique enlèverait donc de la souplesse, cette souplesse que permet justement la loi ordinaire, que l’on doit par conséquent préférer si l’on est soucieux de la juste proportionnalité des mesures adoptées.
Bref, l’article 1er est très protecteur des libertés publiques ; d’où mon total désaccord avec le raisonnement que l’on vient d’entendre.
Il est procédé au scrutin.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants: 132 Nombre de suffrages exprimés: 123 Majorité absolue: 62 Pour l’adoption: 27 contre: 96 (L’amendement no 36 n’est pas adopté.)

L’amendement tend à substituer aux mots : « la loi », les mots : « Une loi organique ».
Je suis en désaccord avec le ministre de l’intérieur : le conflit de constitutionnalité est évident dès lors que les mesures ne sont plus évaluées au regard de la Constitution et de ses principes, mais au regard de l’article qui constitutionnalise l’état d’urgence.

La parole est à M. Pouria Amirshahi, pour soutenir l’amendement no 96 .

La constitutionnalisation de l’état d’urgence, vient d’expliquer M. le ministre de l’intérieur, serait nécessaire pour préserver les droits fondamentaux et les libertés. Mais je n’ai pas souvenir que l’octroi des pleins pouvoirs au Président de la République – à l’article 16 de la Constitution –, l’état de siège et l’octroi des pleins pouvoirs à l’armée aient été constitutionnalisés pour préserver ces droits et ces libertés : cela a plutôt été décidé, me semble-t-il, dans des circonstances exceptionnelles, non sans poser beaucoup de problèmes. Ces problèmes, nous y reviendrons, tiennent à l’équilibre, au sein de notre État de droit, entre la protection générale de nos droits et libertés et des mesures exceptionnelles pouvant être prises dans des circonstances elles-mêmes exceptionnelles.
M. le garde des sceaux, ancien président de la commission des lois, connaît nécessairement les distinctions subtiles entre les différents genres de lois. Or, à l’entendre, une loi simple satisferait au contrôle de constitutionnalité. Il n’en est rien, monsieur le garde des sceaux, vous le savez bien : ce contrôle n’est possible que dans le cadre d’une saisine ou d’une QPC, lesquelles n’ont rien d’obligatoire ou d’automatique.
La loi organique, elle, garantit automatiquement le contrôle de constitutionnalité. Nous étions d’accord – du moins le croyais-je – pour renforcer les moyens de contrôle du Parlement sans modifier ou ajouter aucune disposition à cette fin : la mise en oeuvre d’une loi organique permet justement au Parlement, autrement dit à l’Assemblée nationale et au Sénat, de bénéficier d’un délai de quinze jours pour s’exprimer, étant entendu que le Conseil constitutionnel peut très bien être saisi en urgence par ailleurs. Je ne comprends donc pas vos arguments, et propose moi aussi de substituer aux mots : « la loi », les mots : « Une loi organique ».

Un point me paraît curieux. Beaucoup des partisans de la constitutionnalisation de l’état d’urgence ont mentionné la proposition no 10 du comité Balladur. Or, le garde des sceaux l’a souligné, ce comité préconisait une loi organique. Bref, il faudrait tout prendre du « Balladur », et non se contenter d’y picorer.
Sourires.

La parole est à Mme Isabelle Bruneau, pour soutenir l’amendement no 124 .

Cet amendement, identique aux précédents, vise, au début de l’alinéa 3, à substituer aux mots : « La loi », les mots : « Une loi organique ».
Une loi organique est en effet obligatoirement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, qui devra ainsi vérifier si les mesures de police administrative autorisées dans le cadre de l’état d’urgence portent ou non une atteinte excessive aux libertés et droits fondamentaux.

Cet amendement va dans le même sens que les précédents puisqu’il vise à permettre un contrôle de constitutionnalité systématique et donc à vérifier que les mesures de police prises ne portent pas une atteinte excessive aux libertés et droits fondamentaux.
Même s’il est vrai qu’il implique des délais plus longs, en définitive, le choix d’une loi organique permet d’obtenir un texte totalement opérationnel.

La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 186 .

Dès lors que le Gouvernement nous propose de constitutionnaliser la procédure de l’état d’urgence, ce que je soutiens également, il me semble qu’il convient de respecter l’esprit de la Constitution en en précisant les modalités d’application au moyen d’une loi organique et non d’une loi ordinaire.
Le choix d’une loi organique nous permettrait d’obtenir une architecture à trois étages ancrant juridiquement un tel état d’exception : la Constitution, la loi organique, et la loi ordinaire de prorogation.
Je souligne que, lors de l’examen du projet de loi prorogeant l’application de la loi relative à l’état d’urgence, nous avons essuyé certaines critiques. Il nous a notamment été reproché de fixer les modalités de l’état d’urgence dans la loi ordinaire en modifiant la loi de 1955, et, dans le même temps, d’en proroger l’application.
Nous gagnerions à tenir compte de ce qui a été proposé par le comité Balladur – nous avons longuement évoqué ses travaux au cours de la discussion générale et des interventions sur l’article 1er – en rendant obligatoire la définition des modalités prises en application de la Constitution par une loi organique.

L’avis de la Commission a été donné tout à l’heure. Quel est celui du Gouvernement ?
Défavorable.

La teneur d’un certain nombre de nos échanges révèle une confusion que Mme Duflot a légitimement jugée regrettable. Nous parlons bien de l’alinéa 3, c’est-à-dire de ce que la loi va définir comme cadre possible pour l’état d’urgence. Ensuite, s’agissant de sa prorogation, l’alinéa 4 prévoit qu’elle ne peut effectivement être autorisée que par la loi.
En clair, la Constitution dit qu’il est possible de déclarer l’état d’urgence, et une loi – à laquelle Mme Duflot souhaite conférer le caractère de loi organique – fixe les mesures qui peuvent être prises dans ce cadre. Cela ne signifie pas que toutes doivent être retenues au moment de l’application de l’état d’urgence : ainsi, alors que la loi de 1955 prévoyait la possibilité de restreindre toutes les libertés de communication, l’Assemblée – à ma demande, d’ailleurs – a choisi de ne toucher qu’aux communications électroniques, auxquelles, nous le savons, ceux qui agressent la France ont recours.
Monsieur le garde des Sceaux, il me semble nécessaire, ou à tout le moins utile, et pas du tout contradictoire, que la loi destinée à encadrer l’état d’urgence soit de nature organique. Nous voterons donc pour les amendements identiques no 25 et suivants.
Le fait de rendre obligatoire le contrôle de constitutionnalité est bien un avantage de la loi organique, même si ce n’est pas le seul. Vous m’objecterez sans doute, monsieur le garde des Sceaux, que toute loi peut être déférée au Conseil constitutionnel par soixante députés ou soixante sénateurs. Mais dans les faits, cette possibilité est réservée, à l’Assemblée comme au Sénat, à deux groupes politiques seulement. À l’heure où la question prioritaire de constitutionnalité permet à n’importe quel citoyen d’exercer un recours similaire, ce déséquilibre est regrettable.
Autre caractéristique de la loi organique : faute d’accord entre les deux assemblées, celle-ci ne peut être adoptée par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. Or, pour fixer ce qu’il est possible de conférer, occasionnellement, comme moyens exceptionnels à l’État en cas de crise, la majorité absolue des membres de notre assemblée vaut mieux qu’une courte majorité de circonstance.

Je voterai, bien évidemment, en faveur de l’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution : elle correspond en effet à une nécessité d’intérêt général.
Je suis par ailleurs sensible à l’argumentation du rapporteur, et, surtout, à celle du ministre de l’intérieur. Mais, en l’espèce, la loi organique semble préférable à la loi ordinaire.
On me dira que les conditions particulières de majorité attachées à la loi organique ne permettraient pas d’agir suffisamment vite. Pourtant, ces conditions sont importantes, parce qu’elles permettent d’exprimer un certain consensus, entre les deux chambres comme au sein de l’Assemblée nationale, où la majorité absolue serait requise.
Par ailleurs, une loi ordinaire dépend de la majorité du moment. Si un jour – hypothèse d’école –, est élue au sein de cette assemblée une majorité non seulement différente de celle d’aujourd’hui, mais influencée par des idées extrêmes, celle-ci n’aura aucune difficulté à refaire ou à défaire des lois ordinaires. Le choix d’une loi organique, qui requiert une majorité importante pour être abrogée ou remplacée, est donc bien plus protecteur.

Si je soutiens également l’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution, c’est essentiellement dans le but d’encadrer cette procédure et de protéger les libertés publiques, et parce qu’il n’est en effet pas normal que le seul état d’exception réellement applicable ne figure pas dans la Constitution. Pour autant, un point m’inquiète : je ne crois pas qu’il soit une bonne chose de légiférer sous le coup de l’émotion.

Certes, nous l’avons fait en novembre, mais la réponse que nous avons apportée une semaine après les attentats, sous le coup de l’émotion, je ne suis pas sûr que nous l’aurions donnée une semaine plus tard, en prenant le temps de la réflexion.
Les sujets relatifs aux libertés publiques sont extrêmement sensibles. Nous avons déjà largement rénové la loi de 1955, et il se passera du temps avant qu’une nouvelle modification majeure de ses dispositions n’apparaisse nécessaire – pour des raisons technologiques, par exemple. Un tel délai nous permettra de revenir un tant soit peu à la raison et d’élaborer de bonnes lois, ce qui est préférable au fait d’agir en quarante-huit heures sous le coup de l’émotion.

Certains évoquent le comité Balladur et appellent à reprendre toutes ses propositions, y compris le choix d’une loi organique. Ils oublient cependant de préciser que selon le Conseil d’État, interrogé par ce même comité Balladur, il n’est pas nécessaire de constitutionnaliser l’état d’urgence.

Nous nous interrogeons sur le fait de savoir s’il est de bonne politique de légiférer sous le coup de l’émotion. Mais je ne crois pas que nous ayons eu le choix : dans certaines circonstances, comme celles que nous avons malheureusement connues il y a trois mois, il faut décider, parce qu’il faut combattre. En l’occurrence, il fallait répondre à certaines menaces, ce qui impliquait notamment, je l’ai dit, d’autoriser la fouille des ordinateurs utilisés par les individus soupçonnés d’être liés à Daech. D’ailleurs, il y a quelques jours, il a été indiqué que, grâce à l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, de telles recherches avaient permis de déjouer au moins un attentat en préparation.

Mais justement : cela a été possible alors même que l’état d’urgence n’est pas constitutionnalisé !

Même si j’entends parfaitement les arguments avancés sur la question de la loi organique, c’est un élément à prendre en compte.
D’autant que si nous faisons le choix d’une loi organique, nous nous lions les mains. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai toujours trouvé surprenants les propos destinés à donner plus de place au Conseil constitutionnel. Ce dernier est habitué à contrôler a posteriori la conformité de la loi à la Constitution, soit parce qu’une question prioritaire de constitutionnalité lui est posée, soit parce qu’il est saisi par la voie parlementaire. Doit-il avoir l’autorité pour juger, avant même le Parlement et le Gouvernement, de ce qu’il faut faire ?
Je ne crois donc pas que, sur une question aussi grave que celle de l’état d’urgence, le Parlement doive se lier les mains par une loi organique. Le Parlement, et particulièrement l’Assemblée nationale, peut parfaitement prendre ses responsabilités. En outre, le Gouvernement dispose, sur la situation du pays, d’informations bien plus nombreuses que les juges du Conseil constitutionnel, lesquels pourront toujours censurer une loi a posteriori, comme c’est habituel sous la Ve République.

La parole est à M. Pascal Cherki pour conclure cette série d’interventions.

Je serai bref, mais je voudrais tout de même dire à notre garde des Sceaux, qui est un excellent juriste, que je ne comprends pas son refus d’une loi organique.
L’état d’urgence est un état d’exception que nous allons, en l’inscrivant dans la Constitution, élever au même rang que les autres états similaires, qu’il s’agisse de l’article 16 ou de l’état de siège. Je ne vois donc pas ce qu’il y a de problématique à faire découler les modalités de son application d’une loi organique. Cela me semble même cohérent, et ce, quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir sur cet article 1er. Au contraire, il paraîtrait décalé de constitutionnaliser l’état d’urgence, aujourd’hui organisé par une loi ordinaire, sans en renvoyer les modalités à une loi organique.
Je m’en veux de rallonger les débats sur une question sur laquelle l’assemblée est, me semble-t-il, largement éclairée.
Je n’ai évidemment rien, sur le principe, contre les lois organiques, dont l’existence est prévue par la Constitution.
Mais nous parlons de procédures marquées par l’urgence. Mathieu Hanotin nous a mis en garde contre la tentation de légiférer sous le coup de l’émotion. Mais en novembre, nous avons été confrontés à la réalité, pas à l’émotion !
Le Président de la République a pris, parce qu’il pouvait le faire, un décret. Douze jours après la publication de celui-ci, l’état d’urgence ne pouvait être prorogé que par la loi seule. S’il avait fallu recourir à une loi organique, nous n’aurions pas pu le proroger dans les délais requis.
Exclamations sur les bancs du groupe écologiste.
C’est matériel ! Il ne nous aurait pas été possible de légiférer dans les délais requis.
Vous pouvez décider de supprimer le délai prévu pour l’examen d’une loi organique, mais en l’état actuel du droit, nous n’aurions pas pu proroger l’état d’urgence si une telle loi était requise. Il ne s’agit pas d’émotion : c’est la réalité !
Il est procédé au scrutin.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 36 de la Constitution, relatif à l’état de siège, précise que sa « prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement » – le Parlement, et non la loi. Il s’agit donc, par cet amendement, de mettre l’alinéa 3 du projet de loi en cohérence avec l’article 36 dont il relève et de souligner, dans le texte même de l’article, l’importance du Parlement, lequel doit constituer une étape indispensable dans la définition des pouvoirs affectés aux autorités civiles et de police administrative pendant l’état d’urgence.
Même avis. Le premier alinéa de l’article 24 de la Constitution dispose en effet que : « Le Parlement vote la loi. » L’amendement est donc inutile : je demande son retrait.

Lors du débat relatif à la lutte contre le terrorisme qui s’est tenu au Conseil de l’Europe, de nombreux parlementaires ont mis en exergue le fait que les États occidentaux adoptent des lois dérogeant plus ou moins aux principes démocratiques de protection des libertés publiques.
Le point commun entre tous ces textes réside dans l’absence de définition réelle du terrorisme. Or la lutte contre celui-ci légitime un renforcement considérable des pouvoirs de police, sans réelle garantie quant à leur usage.
En France, l’état d’urgence a donné à la police le pouvoir d’assigner des personnes à résidence et de perquisitionner sur simple décision administrative.
Face à ces attentats meurtriers, les services de police demandent toujours plus de pouvoirs d’intervention, en France comme ailleurs, en se fondant sur la peur compréhensible des citoyens et sur la volonté des gouvernants de faire quelque chose faute de produire des résultats visibles. À présent, le Gouvernement entend intégrer l’état d’urgence dans la Constitution. Il me semble que la voix du Parlement doit être prépondérante. C’est pourquoi il importe de voter cet amendement.
L’amendement no 214 n’est pas adopté.


Nous devons prendre la précaution de rappeler que l’article 1er n’a pas pour objet de constitutionnaliser l’état d’urgence mais le cadre juridique qui lui est applicable. Cette différence est notable. Tel est tout le sens de l’article 1er : prévoir des précautions et fixer des limites garantissant l’exercice des libertés fondamentales. Le contrôle du juge en fait partie et la loi du 20 novembre 2015 consacre pleinement son rôle. Il me semble utile de mentionner le contrôle juridictionnel dans le texte constitutionnel, fût-ce superflu en termes strictement juridiques. S’en suit un débat visant à déterminer de quel juge il s’agit. D’autres amendements, déposés dans le même esprit, proposent de confier ce contrôle à l’autorité judiciaire. Mais comme il porte sur des décisions administratives, il devrait naturellement être confié à un juge administratif.
Il faut selon moi se ranger à l’avis du Conseil d’État selon lequel il n’est pas utile de préciser qu’il s’agit du juge administratif : d’une part parce que c’est donc naturellement de lui qu’il s’agit, d’autre part parce qu’il me semble inopportun de constitutionnaliser l’existence d’un second ordre juridictionnel par amendement. En droit, l’existence du juge administratif découle du principe révolutionnaire de séparation des autorités administratives et judiciaires. La rédaction que je propose me semble préférable à celle de M. le rapporteur, notamment parce qu’elle est conforme à l’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi transmis par le Gouvernement.

La parole est à M. Pouria Amirshahi, pour soutenir l’amendement no 95 .

Dans la continuité de ce qui vient d’être dit, je pense que nous devons en effet réfléchir à la nécessité de soumettre à un contrôle juridictionnel effectif de nature à garantir leur nécessité et leur proportionnalité toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, et ce pour des raisons de principe évidentes. L’instauration d’un contrôle juridictionnel engage un principe essentiel de notre droit. Elle est d’abord nécessaire. Si le droit commun ne suffit pas au rétablissement de l’ordre public, alors des mesures dérogatoires peuvent être prises. En l’espèce, dans le cadre de la mise en oeuvre de l’état d’urgence, il n’a pas été démontré que le droit commun ne pouvait pas assurer le rétablissement de l’ordre public. Les opérations menées à Saint-Denis elles-mêmes l’ont montré.
Par ailleurs, seules 5 des 3 289 perquisitions effectuées au cours des derniers mois ont débouché sur l’ouverture d’une procédure pour des infractions directement liées au terrorisme. Il en résulte la nécessité de garantir un autre principe général de notre droit : la proportionnalité des mesures prises sous le régime de l’état d’urgence, laquelle est au coeur du contrôle juridictionnel. C’est pourquoi je présente cet amendement.

La parole est à M. Pierre-Yves Le Borgn’, pour soutenir l’amendement no 54 rectifié .

Je m’interroge sur l’accès au juge des libertés individuelles qui, selon les termes mêmes de l’article 66 de la Constitution, est le juge judiciaire. L’état d’urgence le met à l’écart et la constitutionnalisation proposée renforcerait davantage encore cet état de fait. Le Conseil constitutionnel a établi que les perquisitions non autorisées par un juge, y compris dans le cadre d’affaires de terrorisme, peuvent porter atteinte à la liberté individuelle. Il doit être possible de contester les assignations à résidence et les perquisitions administratives devant le juge judiciaire.
Telle est la raison pour laquelle je propose par cet amendement, en me référant en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et en attendant l’avis que la commission de Venise sur le projet de révision constitutionnelle sollicité par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe doit rendre à la mi-mars, de compléter l’alinéa 3 d’une phrase selon laquelle les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sont en tout état de cause soumises au contrôle de l’autorité judiciaire.

La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour soutenir l’amendement no 224 .

L’état d’urgence est un état d’exception qui a malheureusement montré son intérêt au cours des derniers mois après les tragiques événements qui ont bouleversé notre pays. Je suis favorable à son usage s’il est nécessaire, et c’est pourquoi j’ai voté sa prolongation. Nous débattons à présent de son inscription dans la Constitution. Il me semble que cette constitutionnalisation est sans intérêt si son objectif n’est pas d’en encadrer l’usage, la modification d’une loi simple étant plus aisée que celle d’une loi constitutionnelle. Notre constitution est bien là pour garantir nos libertés fondamentales. Et, selon moi, l’article 1er ne présente un intérêt que s’il sert à protéger nos libertés.
C’est pourquoi Éric Alauzet et moi-même proposons cet amendement visant à garantir les compétences de l’autorité judiciaire sous le régime de l’état d’urgence. En effet, l’éviction complète du juge judiciaire, notamment en matière d’assignation à résidence, a suscité un important débat. J’ajoute que le Conseil d’État a appelé l’attention sur ce point dans l’avis rendu le 17 novembre dernier, au sujet des perquisitions comme des assignations à résidence. Il semble donc nécessaire de garantir que le juge judiciaire restera compétent dans les matières qui le concernent, dès lors que la protection des libertés est en jeu.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement de la commission no 42.
Je suggère que vous donniez également l’avis de la commission sur les amendements soumis à cette discussion commune, monsieur le président de la commission.

Volontiers, monsieur le président, d’autant que l’amendement no 42 que je propose d’adopter tend à mettre fin à la discussion. Il précise en effet que les mesures sont soumises au contrôle du juge administratif.

Il s’agit de mesures de police administrative. Ce sont des mesures extraordinaires qui normalement ne relèvent pas du pouvoir administratif, précisément en raison de ce caractère extraordinaire. Le contrôle de leur proportionnalité revient naturellement au juge administratif.

Il n’est pas question ici de mesures privatives de liberté. Il s’agit uniquement de mesures restrictives de liberté. Le juge administratif est compétent pour en apprécier la proportionnalité et le bien-fondé. Il se livre continuellement au même exercice à propos d’autres mesures relatives par exemple au maintien de l’ordre public lors de manifestations ou à la salubrité publique. Bref, c’est un exercice qu’il connaît parfaitement. Personne n’a l’intention de mettre à l’écart le juge judiciaire, puisque le but de toutes ces opérations est de déboucher sur une judiciarisation et des poursuites pénales. Le juge judiciaire retrouve son pouvoir sitôt ces poursuites diligentées contre les individus qui ont été identifiés et à l’encontre desquels ont été accumulées un certain nombre de charges. Cette articulation me semble normale, et préférable à tout renvoi au juge judiciaire.
En outre, dès l’instant où l’état d’urgence prend fin, le juge judiciaire redevient compétent. Plus aucune perquisition ni assignation à résidence ne sont décidées sans autorisation d’un juge. Seules des mesures de contrôle judiciaire, prononcées par un juge, sont envisageables. Il y a là un équilibre. Il me semble absolument nécessaire d’inscrire dans la Constitution que tout est fait sous le contrôle d’un juge. J’entends les arguments selon lesquels cela va de soi mais il me semble que cela va aussi bien en l’inscrivant dans le texte. Avis défavorable aux autres amendements.

La parole est à M. Philippe Vigier, pour soutenir l’amendement no 145 .

L’amendement présenté par M. le rapporteur nous convient. Notre amendement no 145 propose simplement d’aller un peu plus loin en précisant qu’à l’exception des mesures relevant de l’article 66 de la Constitution, placées sous la responsabilité du juge judiciaire, toutes les mesures administratives sont placées sous le contrôle du juge administratif. Ainsi, cette précision figurera comme telle dans la Constitution.

Certes, l’avis du Conseil d’État précise qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans le texte que ces mesures doivent être prises sous le contrôle du juge administratif. C’est la raison pour laquelle nous nous rallions à l’amendement no 42 qui constitue selon nous une solution efficace.
Je remercie les députés qui ont présenté ces amendements grâce auxquels nous allons au fond du débat juridique. Tout d’abord, le contrôle des mesures de police administrative par le juge administratif date d’une époque très ancienne, la Révolution française. Les mesures proposées ne sont donc pas du tout de nature à remettre en cause les libertés publiques : ceux qui s’inquiètent de l’absence du juge judiciaire se réfèrent volontiers à la Révolution française ! D’après les principes définis lors de la Révolution française et confirmés en 1874 par l’arrêt Blanco, il appartient au juge administratif et non au juge judiciaire de procéder au contrôle juridictionnel lorsque la puissance administrative intervient.
Que ce soit un juge administratif qui y procède ne signifie pas qu’aucun juge n’intervient ! J’ai d’ailleurs constaté avec beaucoup d’intérêt que la plupart de ceux qui répètent que le contrôle du juge administratif n’est pas de nature à garantir les libertés publiques sont les mêmes qui se sont précipités sur le Gouvernement il y a quinze jours lorsque le juge administratif a cassé une assignation à résidence afin de lui reprocher de ne pas avoir pris les précautions nécessaires !
C’est bien le signe qu’un juge contrôle ! Ces principes ont été formulés il y a très longtemps, en 1791, puis confirmés par l’arrêt Blanco et en 1987 par une décision du Conseil constitutionnel qui a considéré comme normal le contrôle des actes de police administrative par le juge administratif dès lors qu’ils ne sont pas dans le champ de l’article 66 de la Constitution. Tel est l’état du droit en France. Il découle des grands principes du droit, qui n’ont rien de choquant car ils ont fondé le fonctionnement de la République et des institutions de notre pays depuis des années, pour ne pas dire des décennies et des siècles.
Par conséquent, arguer que le contrôle effectué par un juge administratif est gravement attentatoire aux libertés parce que le juge administratif n’est pas un juge, comme on l’a déjà entendu lors de l’examen de la loi relative au renseignement, est faux en droit et ne correspond ni à l’histoire de notre pays ni aux textes définissant les principes généraux de notre droit. On aimerait, sur ces sujets, que la lecture des textes suffise à forger la conviction.
D’autre part, vous avez tenu des propos très intéressants, monsieur Amirshahi, selon lesquels l’état d’urgence est totalement arbitraire puisqu’il vise des gens qui n’ont rien à voir avec le sujet à traiter, c’est-à-dire le terrorisme. C’est complètement faux. Voici des chiffres très précis : 83 % des personnes assignées à résidence sont fichées pour radicalisation et 61 % des perquisitions administratives hors préfecture de police de Paris ont visé des personnes inscrites aux mêmes fichiers.
Autrement dit, entre 61 % et 83 % des mesures de police administratives qui ont été prises concernent des personnes relevant de l’islamisme radical. Quant au solde, il s’agit de réseaux délinquants dont les activités semblent susceptibles d’alimenter les activités des islamistes radicaux. Il existe en effet une porosité entre ces milieux, comme le montrent toutes les affaires de terrorisme.
Vous affirmez par ailleurs, monsieur le député, que peu d’affaires relèvent de l’islamisme radical. Je ne sais pas comment vous parvenez à ces chiffres car ceux qui ont fait l’objet d’une interpellation, d’une mise en garde à vue et d’une judiciarisation de leur situation voient leur dossier couvert par le secret de l’instruction. En outre, les instructions sont en cours et tous les éléments saisis à l’occasion des perquisitions n’ont pas encore été complètement étudiés.
Par conséquent, il n’est pas possible d’évoquer des chiffres qui sont couverts par le secret de l’instruction et portent sur des instructions encore inachevées. Je ne sais pas à quoi ils correspondent, mais en tout cas en rien à la réalité.
Enfin, j’insiste sur un point : grâce aux mesures autorisées par l’état d’urgence, nous avons démantelé un très grand nombre de réseaux délinquants dont l’instruction judiciaire montrera les liens qui les unissent à l’activité terroriste.
Je le dis à tous ceux qui s’inquiètent des libertés publiques – comme si le danger résidait dans l’état d’urgence et non dans le terrorisme : depuis le début du mois de janvier, nous avons procédé à quarante interpellations d’individus impliqués dans des activités à caractère terroriste. Ces interpellations ont abouti à dix-sept mises en examen, sous écrou ou sous contrôle judiciaire. L’ensemble des personnes interpellées l’ont été pour des activités de recrutement de terroristes sur un théâtre d’opérations terroristes, pour des actes à caractère terroriste ou pour apologie du terrorisme. Quarante, en un mois : ce sont des chiffres qui n’ont jamais été atteints jusqu’à présent et qui témoignent de l’activité des services !
Effectivement, nous considérons qu’il vaut mieux prévenir les actes de terrorisme par des mesures de police administrative contrôlées par le juge administratif plutôt que d’avoir à les judiciariser, après que les crimes ont été commis, faute d’avoir été capable de les prévenir.
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen, du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, vous êtes nombreux à demander d’intervenir. J’essaie, lorsqu’il y a plusieurs amendements, de donner la parole à tous ceux qui peuvent éclairer l’Assemblée, mais je ne pourrai pas laisser s’exprimer tout le monde !
La parole est à M. Pierre Lellouche.

À l’avance, je demande pardon à mes collègues de la majorité de m’immiscer dans ce qui ressemble à un débat interne du parti socialiste, ou entre les différentes tendances de la majorité.
Quelques exclamations.

J’ai beaucoup apprécié que le ministre de l’intérieur remplace le ministre de la justice pour expliquer que le juge administratif est un juge, et qu’il est parfaitement compétent en matière d’urgence, de puissance publique et de police administrative.

Ce qui me fait penser qu’il est pour le moins curieux, pour rester poli, d’écrire dans la Constitution que le juge administratif contrôle des actes de police administrative. C’est ce que l’on appelle une tautologie. Voulez-vous vraiment bidouiller la Constitution au point d’écrire ce qui figure déjà dans notre droit positif ? Cela me paraît extravagant.
Mais dans la mesure où vous avez décidé de modifier la Constitution pour y inscrire une loi qui fonctionne parfaitement, comme le montre la jurisprudence du Conseil d’État, et qui est soumise au contrôle juridictionnel du juge administratif, ne vous étonnez pas de rentrer dans une usine à gaz !
Mme Duflot n’a pas tort d’affirmer qu’une loi organique pourrait se justifier. Le garde des sceaux a répondu que la loi organique s’applique à la prorogation de l’état d’urgence, quand notre collègue parlait du contenu de la loi. Ce n’est pas la peine de biaiser, monsieur Urvoas !

Dès lors que vous entrez dans cette logique, attendez-vous à ce genre de problèmes !
Je le dis et le répète, au nom de ceux qui connaissent un peu le droit, qui ont un peu de bon sens et qui partagent les mêmes objectifs que le Gouvernement : le système fonctionne ! Pourquoi diable, et en vertu de quels principes allez-vous l’inscrire dans la Constitution, alors qu’il donne les bons résultats que vient de rappeler le ministre de l’intérieur ? Cela fait trois mois que vous amusez les Français avec ce qui est un non sujet ! Vous êtes en train de vous enferrer. Pardon de me mêler de vos affaires, mais tout de même, cela me regarde un peu !

Les députés du Front de gauche estiment nécessaire de mentionner expressément le contrôle du juge administratif à l’article 36-1 de la Constitution. Pour autant, nous voudrions insister sur l’insuffisance du contrôle des juridictions administratives sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.

D’abord, à la différence du contrôle opéré par le juge judiciaire, le contrôle du juge administratif n’est qu’un contrôle a posteriori. Le recours à une mesure de police administrative, telle que l’assignation à résidence, est décidé sans le contrôle préalable d’un juge. Le juge administratif intervient alors que l’atteinte aux libertés est déjà constituée. Ainsi, il confine son contrôle à la vérification d’une illégalité manifeste, l’autorité administrative ayant le choix de décider ou non d’une mesure de police administrative.

En outre, la constitutionnalisation de l’état d’urgence paralyse le contrôle du juge administratif. Celui-ci est mis face à un acte administratif dont l’origine indirecte n’est autre que la norme suprême. Eu égard au poids que ce juge accorde à une loi légitimée par la Constitution – la loi qu’il ne peut contrôler – sa marge d’appréciation est considérablement réduite.
Nous pensons que le contrôle du juge administratif est limité à un examen restreint et considérons que le contrôle du juge judiciaire serait plus étroit et exigeant. Le contrôle a priori qu’exerce le juge judiciaire en autorisant la mise en oeuvre des mesures les plus attentatoires aux libertés se révèle par nature plus efficace et plus protecteur qu’un contrôle a posteriori.
Enfin, garantir une protection adéquate contre les abus lors du recours à des mesures d’exception ou à des mesures de surveillance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme relève des obligations internationales de la France. Je pourrais citer, pour conclure, et entre autres, les prises de position du vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé.

Nous ne parlons pas ici de droit classique ; nous débattons de l’état d’urgence, en tentant de réguler les rôles respectifs des juges administratif et judiciaire. Je ne voudrais pas qu’après les propos du ministre de l’intérieur, qui a fait état des mesures immédiates prises sous le contrôle a posteriori du juge administratif, nous donnions l’impression que, parce qu’il y a état d’urgence, nous oublions totalement la partie judiciaire. Ce n’est pas du tout ce qui est recherché par le Gouvernement.
C’est pourquoi je vous rappelle l’objet de l’amendement no 224 de M. Alauzet et Mme Massonneau, qui vise à préciser que le juge judiciaire reste compétent dans les matières qui le concernent. Bien évidemment, dans le cadre de l’état d’urgence et des mesures exceptionnelles, beaucoup de choses dépendent du juge administratif. Mais le système judiciaire continue de fonctionner. Compléter l’alinéa 3 par les mots « dans le respect des compétences qui appartiennent à l’autorité judiciaire » permettrait d’équilibrer les rôles et de ne pas donner l’impression que le judiciaire a purement et simplement disparu avec l’instauration de l’état d’urgence.

Nous sommes rassemblés ici en tant que constituant, et non en tant que législateur ordinaire. S’il nous appartient de déterminer que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence le sont sous le contrôle du juge, c’est au législateur ordinaire de fixer quel est l’ordre juridictionnel compétent.
À titre principal, les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, Mme Bechtel me corrigera au besoin, sont des mesures de police administrative qui relèvent du juge administratif. Mais des contentieux de droit commun peuvent naître à l’occasion des perquisitions, qui relèveront de l’ordre judiciaire. Introduire une confusion dans des procédures qui peuvent être plus complexes que ce que l’on dit ici me semble préjudiciable.
Nous devons rester simples et prévoir, en tant que constituant, que les mesures sont prises sous le contrôle du juge. Soyons modestes, et rangeons-nous à l’avis du Conseil d’État : la juridiction suprême de l’ordre juridictionnel administratif, excusez du peu, a estimé inutile de préciser que les mesures sont prises sous le contrôle du juge administratif !

Pendant que nous parlons, un autre débat a lieu sur la plateforme Parlement et citoyens, qui a rassemblé jusqu’ici plus de 1 500 de nos concitoyens.
Protestations sur quelques bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Les amendements dont nous discutons sont assez divergents. Pour notre part, nous ne disons pas que les actions de police et de gendarmerie qui ont eu lieu depuis le 13 novembre étaient inutiles – nous sommes tous convaincus que la plupart d’entre elles s’imposaient. Mais interrogeons-nous : aurait-on pu mener les mêmes actions avec le contrôle préalable du juge judiciaire ? Aurait-on pu procéder à des perquisitions et à des assignations à résidence en dehors de l’état d’urgence ? Oui.
Je ne sais pas si M. Mennucci a posé la question aux maraîchers bio perquisitionnés en Dordogne, mais je pense que si un juge judiciaire avait mis son nez dans la demande de perquisition, jamais personne dans cette famille n’aurait été réveillé à sept heures du matin ! Il est important de replacer les juges judiciaire et administratif dans leurs rôles respectifs. La consultation sur la plateforme l’a confirmé : nos concitoyens ont l’impression que confier le contrôle au juge administratif revient à laisser les pleins pouvoirs à l’exécutif, ce qui menace grandement la séparation des pouvoirs.
Pour vous être agréable, monsieur le président. J’évoquerai les principaux points qui ressortent des interventions des différents parlementaires.
Dans le cadre de la séparation des pouvoirs, principe essentiel en France, et comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987, le juge administratif est seul compétent pour connaître la légalité des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’une des matières réservée par nature à l’autorité judiciaire. Or l’autorité judiciaire, ainsi que le prévoit l’article 66 de la Constitution, est gardienne de la liberté individuelle : les matières qui lui sont réservées ont trait aux mesures privatives de liberté et à la procédure pénale.
C’est pour cette raison que le Gouvernement, dans la modification de la loi de 1955, a prévu que c’est le code des juridictions administratives qui s’appliquerait aux contestations effectuées par les personnes concernées par les mesures de police administrative.
Le Conseil constitutionnel a estimé qu’aucune des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence n’est privative de liberté. Ces mesures, ainsi que l’a très justement rappelé M. le rapporteur, sont restrictives de liberté ; elles relèvent donc du Conseil d’État.
Le Gouvernement a donc estimé que les amendements défendus étaient tous inutiles dans la mesure où, qu’il s’agisse du contrôle du juge administratif ou du rôle du juge judiciaire, la Constitution, au travers de l’article 66, prévoit déjà tout cela.
Enfin, l’amendement de M. Denaja, sur le principe, était le plus intéressant. Malheureusement, il comporte un a contrario : en consacrant le rôle du juge en période d’état d’urgence, il laisse entendre que le juge ne joue pas le même rôle lors des autres états de crise. Vous savez combien le Gouvernement est réticent aux a contrario, qui ont des conséquences en cascade. Son avis est donc défavorable sur tous les amendements.

Nous avons étudié la moitié des amendements relatifs à l’article 1er, pour un projet de loi qui en compte deux, et les débats sont plutôt de bonne tenue. Vous présidez l’Assemblée d’une main ferme, monsieur le président, mais votre capacité à élargir le nombre des interventions est relativement limitée.
Étant donné l’importance du sujet, il serait bon que ceux qui souhaitent s’exprimer puissent le faire. Ces questions ne sont pas anodines, même si, vu de l’extérieur, le débat semble extrêmement juridique et pointilleux. Nous abordons au contraire des domaines essentiels et il serait judicieux d’ouvrir plus largement le champ des interventions. Je ne parle pas pour moi mais pour l’ensemble des parlementaires.

Madame Duflot, je m’attache, en tant que président, à faire entendre l’ensemble des points de vue qui émergent dans cet hémicycle, mais je me dois aussi de faire respecter le règlement. Je continuerai à présider ainsi afin que l’Assemblée soit éclairée, mais je ne peux pas donner la parole à tout le monde. Rien que pour les amendements précédents, une douzaine de députés s’étaient inscrits ! Ce n’est pas possible, vous le comprendrez aisément.

Permettez-moi de vous répondre : il n’est que dix-huit heures trente et, sur les deux articles que comporte ce projet de loi, nous avons déjà examiné la moitié des amendements de l’article 1er.

Ce qui n’est pas du tout impossible à réaliser, puisque nous sommes censés être en séance ce soir et demain.

Justement, je continuerai de permettre à l’Assemblée d’être éclairée, mais elle ne peut se transformer en assemblée générale !
Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen et sur quelques bancs du groupe Les Républicains.
suite

Je vous rends la parole, madame Duflot, pour soutenir l’amendement no 26 .

Puisque nous avons évoqué le serment de Versailles, un petit rappel historique s’impose : c’est le serment du Jeu de paume, celui que prirent les parlementaires de ne pas se séparer tant qu’une Constitution ne serait pas élaborée. Il ne s’agissait sûrement pas pour eux d’une assemblée générale ! Ils n’en avaient pas, en tout cas, cette vision négative. Je ne pense pas que l’expression des parlementaires sur un sujet aussi grave puisse être qualifiée avec ce dédain d’assemblée générale.

L’ensemble des points de vue de l’Assemblée sera entendu, madame, mais dans le respect de son fonctionnement. Veuillez à présent présenter votre amendement, ou je vous retire la parole.
Exclamations sur divers bancs.

Le ministre de l’intérieur ayant affirmé que les mesures prises au titre de l’état d’urgence étaient directement liées aux motifs qui ont présidé à sa déclaration, j’ai bon espoir de recevoir son soutien. Cet amendement tend en effet à insérer à l’alinéa 3 le terme « directement », afin que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence aient un lien direct avec les événements ou le péril imminent.
Nous savons par expérience comment peuvent être mises en oeuvre les mesures décidées dans le cadre de l’état d’urgence. De surcroît, le Conseil d’État a une vision extrêmement large du choix qui peut être fait de ces mesures, lesquelles sont des mesures privatives de droits fondamentaux. La liberté d’aller et venir, mise en cause par l’assignation à résidence, en est une, tout comme l’inviolabilité du domicile, à laquelle les perquisitions administratives portent atteinte.
Quand on s’engage sur le débat de fond des principes de l’État de droit, on ne peut nier que l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et venir sont des libertés fondamentales de notre démocratie. Lier directement leur restriction aux motifs qui ont présidé la déclaration de l’état d’urgence me paraît de bonne politique et conforme aux engagements du ministre de l’intérieur.

Avis défavorable, car il faut laisser au dispositif une certaine souplesse. Le terme « directement » est beaucoup trop restrictif. Nous en avons d’ailleurs eu la démonstration dans les récents événements.
J’en profite pour répondre à M. Debré. Bien évidemment, je ne veux oublier aucune des victimes, ni celles du Bataclan, ni celles de Saint-Denis, ni celles de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l’Hyper Cacher. Il n’était pas dans mon intention de négliger quiconque et si ma formule quelque peu elliptique a pu blesser, je le regrette.
À l’occasion de ces attentats, de ces assassinats, nous avons lancé une série de perquisitions qui ont permis de découvrir des faits relevant de la délinquance de droit commun. Mais il existe une certaine porosité entre la délinquance de droit commun et la constitution de groupes activistes susceptibles de basculer dans le terrorisme.
Dans ces conditions, il suffit d’un lien pour justifier la mise en oeuvre de telles mesures, ce lien devant être vérifié par le juge administratif qui contrôle la proportionnalité entre la mesure prise et son motif.
Avis défavorable pour les mêmes raisons, mais je voudrais profiter de l’interpellation de Mme Duflot pour répondre à un certain nombre de ses légitimes interrogations.
Tout d’abord, y a-t-il eu, pendant l’état d’urgence, des assignations à résidence ou des perquisitions inappropriées ?
Oui, en effet, cela s’est produit. Quand on décide près de 3 000 assignations à résidence et perquisitions, des manquements ou des erreurs peuvent survenir. Ne pas les reconnaître devant la représentation nationale quand on a le souci de faire scrupuleusement respecter le droit ne témoignerait pas de l’attachement aux principes républicains qui guide l’action du ministère de l’intérieur dans la mise en oeuvre des mesures de police administrative qu’il déclenche.
Ainsi, l’intervention chez un agriculteur biologique en Dordogne ne m’a pas semblé être une mesure très pertinente et j’ai fait savoir au préfet concerné, dès que vous m’avez signalé cette affaire, madame Duflot, ce que j’en pensais.
Des manquements peuvent donc se produire, mais ce n’est pas une raison pour penser que c’est la règle. Dès lors que c’est arrivé, j’ai adressé une circulaire, le 25 novembre, à l’ensemble de ceux en charge de la mise en oeuvre de ces mesures administratives. Extrêmement rigoureuse, elle définit les principes qui doivent présider à la mise en oeuvre de ces mesures, et j’ai veillé à ce que les préfets s’y conforment rigoureusement.
Par ailleurs, j’entends souvent dire que les mesures administratives que nous avons décidées ne se justifiaient pas, puisque nous n’avons rien trouvé. Mais, madame la députée, si nous y étions certains de trouver quelque chose avant de les déclencher, nous ne prendrions pas des mesures de police administrative : nous ordonnerions des perquisitions judiciaires ! La caractéristique d’une mesure administrative est justement d’être déclenchée pour lever un doute, en raison d’un risque concernant un certain nombre d’acteurs. Il arrive que la perquisition administrative ne donne pas le résultat escompté. Il arrive aussi qu’elle le donne, ou qu’elle mette à jour des éléments qui, examinés par le juge, permettront d’en savoir davantage sur l’exacte connexion de ces personnes avec les réseaux terroristes.
Je voudrais dire un mot d’un dernier point, car je vois très bien à quoi vous avez fait référence : les assignations à résidence d’un certain nombre de personnes que vous avez qualifiées de militants écologistes, qui posent problème. Je serai très clair. Le risque terroriste était, à ce moment-là, considérable. Un très grand nombre de chefs d’État et de gouvernement se trouvaient à Paris. Je ne pouvais pas assurer la protection des Français contre le terrorisme en mobilisant des unités de force mobile contre des individus susceptibles de causer des troubles graves à l’ordre public. Dès lors, je considère qu’il y a un lien entre ma décision et le risque terroriste. Si je n’avais pas pris cette décision, j’aurais dû mobiliser des unités de force mobile pour éviter que des troubles à l’ordre public, comme il en avait déjà été occasionnés par des casseurs, ne se produisent, et ces unités n’auraient pas été mobilisées pour protéger les Français contre le terrorisme.

Je voudrais tout d’abord regretter que l’amendement no 42 n’ait pas été adopté. Je crois qu’il est passé dans le reste de la liasse sans que tous les parlementaires ne l’examinent réellement.
Je regrette également que l’on ait pu, dans un tel débat, opposer le magistrat administratif au magistrat judiciaire. Un certain nombre d’entre eux liront nos débats et considérer que l’un serait juge et l’autre non me semble incorrect et indigne de l’Assemblée nationale. Ou alors on retire aux juges administratifs le droit de juger ! Mais si on les reconnaît en tant que juges, c’est bien qu’ils défendent eux aussi les institutions de la République.
Pour en revenir à l’amendement no 26 , la volonté de restreindre très fortement les possibilités d’action dans le cadre de l’état d’urgence ne nous satisfait pas. En effet, les circonstances peuvent conduire à ce que, de façon indirecte, des manifestations qui mobiliseraient des forces de police empêchent de sécuriser d’autres événements.
Nous l’avons vu à l’occasion de la COP21. Je le dis d’autant plus volontiers que ma circonscription était concernée, quelques semaines après que notre département a été le théâtre de nombreuses interventions de police qui sont à saluer. Il faut savoir définir ses priorités. Je me souviens du débat que nous avons eu au lendemain des attentats : fallait-il ou non maintenir un événement, la COP21, dont on ne savait pas si l’on pourrait en assurer la sécurité ? Il fallait trouver une solution équilibrée, quitte à interdire des manifestations que l’on ne serait pas capable d’encadrer, même si elles sont sans lien direct avec les attentats.

Les députés du Front de gauche sont favorables à cet amendement car le constat a été fait, notamment par l’Observatoire de l’état d’urgence, collectif citoyen composé de juristes ou de journalistes bénévoles, que l’appréciation du champ d’application des mesures d’état d’urgence avait donné lieu à de nombreux abus.
Ajoutons que le tribunal administratif a déjà commencé à censurer des mesures prises dans ce cadre pour manque manifeste de motivation. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle parlementaire ou à l’occasion des contacts que nous avons pu avoir les uns et les autres dans nos départements, nous avons observé que la plupart des interventions avaient lieu pour des motifs de police, à la demande de la police ou de la gendarmerie, mais rarement en lien direct avec le terrorisme.
L’inscription du principe de ce lien direct dans la Constitution serait une garantie bien supérieure à un simple contrôle qui s’exercerait a posteriori. Nous voterons par conséquent cet amendement.

Je suis favorable à cet amendement. Nous avons bien entendu le ministre de l’intérieur faire amende honorable au sujet des perquisitions et des assignations ordonnées en Dordogne, mais faut-il lui rappeler que, si le préfet de Dordogne a fait preuve d’un très grand zèle dans la mise en oeuvre de ces mesures, on ne l’a pas vu lorsque les agriculteurs ont bloqué l’accès à un certain nombre de centres commerciaux de Bergerac, obligeant le président de la communauté d’agglomération et le président de la chambre de commerce à intervenir pour négocier avec eux ? Il faut faire la part des choses dans votre argumentation, monsieur le ministre.
Vous oubliez également de nous parler des perquisitions décidées chez d’autres familles que celles des agriculteurs biologiques, à qui l’on reprochait sans doute leur pratique de la religion musulmane.
Mme la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, Mme Lazerges, qui a siégé comme député sur ces bancs, l’a très bien dit ce matin : la constitutionnalisation de l’état d’urgence et de la déchéance de nationalité contribue à détruire la cohésion sociale et à renforcer la division dans notre pays.
Par ailleurs, vous voulez constitutionnaliser l’état d’urgence en nous expliquant que la sécurité des Français en sortira renforcée. Ce que vous ne nous dites pas, c’est que le 16 novembre, en plus de voter la prorogation de l’état d’urgence, nous avons durci la loi de 1955, et avec un vice originel : alors que la loi de 1955 permettait de perquisitionner ou d’assigner à résidence des personnes sur la base de leurs activités, il sera dorénavant possible de le faire sur la base de simples notes blanches, pas signées ni même datées, ou sur la base de simples comportements. C’est là que réside la dérive et c’est pourquoi nous sommes un certain nombre à refuser de voter et l’article 1er, et l’article 2.

J’ai voté la prorogation de l’état d’urgence de trois mois. Les mesures qui en ont découlé ont été appliquées dans ma circonscription avec le plus grand discernement et j’ai eu l’occasion d’en remercier publiquement les responsables de la préfecture de police.
Cependant, l’amendement de Mme Duflot présente un double intérêt. Il a tout d’abord un intérêt politique, car des doutes s’élèvent aujourd’hui quant à l’utilité de l’état d’urgence, sans même parler de sa constitutionnalisation. Je ne les partage pas mais le Gouvernement devrait tout de même en tenir compte et faire un geste en direction de ceux qui, en toute bonne foi, s’interrogent.
Le second argument me semble plus important encore. Dans un dispositif comme celui de l’état d’urgence, des écarts peuvent évidemment se produire. Je note d’ailleurs, monsieur le ministre de l’intérieur, que le Gouvernement a fait tout ce qu’il fallait pour y mettre un terme dès qu’il en a eu connaissance et que le contrôle parlementaire a permis également de beaucoup avancer sur le sujet. Mais quand l’état d’urgence est instauré, pour une durée de douze jours, c’est en général en réponse à un événement très grave, alors qu’on ne sait pas encore quelles seront l’ampleur et la durée de la menace. Après les attentats du 13 novembre, par exemple, nous ne savions pas s’il y avait encore des cellules terroristes en activité. Il fallait simplement que le Gouvernement agisse très vite pour éviter la réitération d’attentats à très court terme.
En revanche, quand l’état d’urgence dure trois mois, voire plus s’il est à nouveau prorogé, on peut considérer que, même si la menace existe et même s’il faut être extrêmement vigilant, la mise en oeuvre du dispositif dans les premiers temps a tout de même produit certains résultats. Comme l’a d’ailleurs dit le rapporteur, on découvre au fur et à mesure des perquisitions des infractions connexes de droit commun – trafic de stupéfiants, voire trafic d’armes – dont on ne peut établir le lien direct avec la commission d’attentats mais dont on peut penser que peut-être, à terme, elles auraient pu en faciliter la commission.

Je conclus, monsieur le président. Inscrire le mot « directement » dans la Constitution, je le dis à notre rapporteur, n’empêchera pas la jurisprudence d’interpréter cette rédaction et ne constituera pas une entrave à l’activité des services de police. Mais, comme la durée de l’état d’urgence peut désormais atteindre plusieurs mois, il est bon que l’on y mette un certain nombre bornes. Je pense donc que l’amendement de Mme Duflot est bienvenu.

Je donne acte au ministre de l’intérieur des précisions qu’il a apportées au sujet de ce qui s’est passé dans cette exploitation agricole et des agissements violents qu’il convenait de prévenir.
Tout en comprenant l’intention des auteurs de l’amendement, j’estime que, juridiquement, leur proposition ne répond pas à l’objectif qu’ils indiquent dans l’exposé sommaire. Voici en effet la rédaction qui en résulterait : « […] que les autorités civiles peuvent prendre pour directement prévenir ce péril ou faire face à ces événements. » L’adverbe « directement » ne porte pas sur le « faire face », si bien que l’objectif de l’amendement n’est pas atteint.
En outre, la modification constitutionnelle porte effet pour l’avenir. Or, dans d’éventuelles situations d’état d’urgence, par exemple une catastrophe naturelle ou un accident technologique grave, comme on l’évoquait tout à l’heure, on peut être amené à prendre des mesures d’ordre public qui ne sont pas directement liées à l’événement mais qui sont nécessaires pour protéger la population.
Bref, du point de vue de la rédaction, le mot « directement » ne porte pas sur la deuxième hypothèse de la phrase, « faire face à ces événements », et il me paraît d’autre part nécessaire que les pouvoirs publics, dans des circonstances exceptionnelles, disposent de la latitude nécessaire pour protéger la population.
Vous affirmez, monsieur Chassaigne, que des mesures de police administrative auraient été prises sans être directement corrélées au risque terroriste. Pour vous répondre, je citerai les chiffres des contentieux. Car si ce que vous dites est vrai, il doit y avoir des contentieux en masse, suivis d’annulations tout aussi massives ! Or les assignations à résidence ont fait l’objet de 118 référés liberté, lesquels ont donné lieu à 10 suspensions. Il y a également eu 83 recours au fond, qui ont abouti à une seule annulation.
Je ne fais que mettre en rapport le nombre des mesures que nous avons prises – plus de 3 700 – le nombre des recours et le nombre des annulations. Car il n’est pas ici question de rumeurs, d’impressions, de on-dit, mais de mesures de police administrative qui peuvent faire l’objet de recours. Cela a été le cas de plusieurs d’entre elles et un certain nombre ont été annulées. Les chiffres très précis que je vous ai donnés témoignent, s’il en était besoin, de la rigueur avec laquelle ces sujets ont été traités.
Vous estimez pour votre part, monsieur Cherki, qu’il faudrait tenir compte de l’inquiétude de ceux qui émettent des réserves et faire une concession. Je ne suis pas a priori fermé à cette démarche. C’est bien pourquoi je suis allé il y a quatre jours devant la Commission nationale consultative des droits de l’homme, où j’ai passé près de deux heures pour rendre le compte précis de notre action au titre de l’état d’urgence. Et je le ferai aussi souvent que ce sera nécessaire, devant toutes les commissions, commissions consultatives ou rapporteurs. Je me propose même d’aller devant le Conseil de l’Europe pour bien expliquer ce que nous faisons, parce ce que nous faisons peut être parfaitement assumé.
Si l’amendement me pose un problème, c’est que l’adverbe « directement » peut créer des difficultés considérables pour l’autorité administrative lorsque celle-ci veut prévenir des actes à caractère terroriste. Prenons l’exemple des attentats de janvier 2015 : outre leurs auteurs, ils impliquent aussi, comme l’enquête le révèle – et cela contribuera à la définition des cibles des perquisitions administratives ou des assignations à résidence – des individus appartenant à la sphère de la délinquance et ayant procédé, pour le compte des terroristes, à des ventes de véhicules ou à des trafics divers destinés à alimenter le financement de l’opération à caractère terroriste, sans que ces individus aient nécessairement été informés de l’objectif final de leurs activités.
J’appelle votre attention sur cette réalité nouvelle à laquelle, en tant que ministre de l’intérieur, je dois faire face et qui pose un problème considérable. La porosité entre certains milieux, liés au trafic de drogue ou d’armes par exemple, et les milieux terroristes nous contraint, au titre des mesures destinées à prévenir la commission d’attentats, à investir des réseaux plus larges que ceux qui sont strictement liés à l’activité terroriste elle-même. Or, comme une mesure de police administrative est une mesure préventive, l’introduction de cet adverbe me privera de la possibilité d’être totalement efficace.
L’amendement no 26 n’est pas adopté.

Cet amendement vise à conforter le principe essentiel de proportionnalité. Les mesures prises doivent être proportionnées : cela semble évident, mais il nous paraît utile de le préciser à l’alinéa 3, de manière à encadrer les mesures de police administrative potentiellement à risque et restrictives de liberté.

Défavorable. C’est le travail habituel du juge que de vérifier la proportionnalité de la mesure restrictive de liberté à l’objectif poursuivi.
Il est conforme au propos initial de M. Sebaoun : il n’est pas besoin de rappeler dans la loi ce qu’énonce la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment en ses articles 10 et 11 ! Avis défavorable.

Nous sommes contre cet amendement, non seulement parce qu’il s’agit là d’un principe général du droit, mais surtout parce que, et nous avons tendance à l’oublier dans ce débat, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, les questions prioritaires de constitutionnalité sont source d’innombrables contentieux. Or ce type de rédaction peut donner lieu à des recours, voire à des arguties n’ayant pour autre but que de noyer le Conseil constitutionnel et de bloquer les procédures.

Je crois comprendre, monsieur Sebaoun, que ces explications vous ont convaincu de retirer votre amendement…
L’amendement no 116 est retiré.

La parole est à M. Jean-Luc Laurent, pour soutenir l’amendement no 187 .

Cet amendement vise à définir des bornes en disposant, à l’alinéa 3 : « Ces mesures ne peuvent viser que des personnes physiques ou morales ayant un lien direct ou indirect avec le péril ayant conduit à déclarer l’état d’urgence. »
Il convient en effet de préciser que les mesures de police administrative, telles que l’assignation à résidence ou les perquisitions administratives, ne peuvent viser des individus dont l’activisme, quel qu’il soit, ne serait pas directement lié aux menaces pour lesquelles l’état d’urgence a été déclaré.
Ces derniers mois, il y a eu, on l’a dit, des mesures concernant des militants écologistes, depuis le mois de novembre, mais aussi des supporters de football. L’argument avancé en commission des lois de la nécessité de garder les forces de l’ordre disponibles me semble un peu faible. Il n’est en tout état de cause pas recevable, à moins de suspendre systématiquement toute manifestation pendant l’état d’urgence.
Restreindre le champ de l’état d’urgence, messieurs les ministres, renforcerait de beaucoup sa pertinence ainsi que la légitimité des procédures mises en oeuvre. D’où cette proposition d’y mettre des bornes, qui répond, je crois, à la juste préoccupation du Gouvernement et contribue à la légitimation des décisions prises.
Défavorable également.
Juste un mot pour le jour où, peut-être, des étudiants feront des thèses sur l’état d’urgence et citeront ce que nous nous sommes dit. Aucune mesure de police administrative au titre de l’état d’urgence n’a été prise à l’encontre de supporters de football.
De grâce, monsieur Laurent, sur un tel sujet, soyons précis ! Si vous avez eu connaissance d’un seul cas de cette sorte, dites-moi quel il est. Les mesures d’interdiction de déplacement de supporters que j’ai prises ne sont en rien liées à l’état d’urgence. J’en avais pris avant l’état d’urgence, j’en prendrai après l’état d’urgence s’il existe un risque de trouble à l’ordre public, mais jamais je n’en ai pris au titre de l’état d’urgence.

Merci pour cette précision utile, monsieur le ministre.
La parole est à M. André Chassaigne.

Je soutiens cet amendement qui vise à mieux encadrer l’état d’urgence dans le cadre de la Constitution.
Monsieur le ministre de l’intérieur, les chiffres que vous avez produits au sujet des recours sont indiscutables. Pourtant, on sait bien que toutes les personnes concernées, notamment par les perquisitions, n’engagent pas forcément un recours. L’état d’urgence a par exemple permis d’intervenir contre de petits malfrats locaux qui n’étaient pas en lien direct avec le terrorisme, moyennant des perquisitions qui, sur le terrain, n’auraient pas pu se faire dans un autre cadre. Inutile de dire que, dans ce cas-là, les personnes visées n’engageront pas de recours !

Même si cela n’invalide pas vos chiffres, c’est la réalité : l’état d’urgence a été utilisé pour régler le problème posé par certains malfrats qui étaient jusqu’alors bien tranquilles et contre lesquels il était compliqué pour la police d’intervenir.

Je ne crois pas du tout que le ministre de l’intérieur ait utilisé l’état d’urgence contre des malfrats. Vraiment, certaines choses me dépassent dans ce débat !
Ce qui nous convainc, nous, c’est qu’il ne faut pas limiter la possibilité dévolue au ministre de l’intérieur de juger de l’emploi des forces de l’ordre, notamment des forces mobiles de CRS et de gendarmes, et de demander, du fait de l’état d’urgence, l’annulation ou le contrôle de telle ou telle manifestation lorsqu’il n’est pas en mesure d’envoyer ces forces sur place. Cela n’a rien à voir avec l’état d’urgence de manière directe, j’en conviens : cela tient au fait que les forces sont largement mobilisées sur le terrain, notamment pour assurer la garde des écoles confessionnelles, des lieux de culte ou des ambassades.
Lorsque l’état d’urgence mobilise ainsi la totalité de nos forces de police et de gendarmerie, on ne saurait empêcher le ministre de l’intérieur – et il est proposé ici de constitutionnaliser cet empêchement ! – de décider en son âme et conscience si, oui ou non, il doit déplacer les forces qu’il a affectées à la sécurité d’une école ou d’une ambassade pour les envoyer encadrer une manifestation.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas voter ce type d’amendement.

Monsieur le ministre, vous avez donné un exemple du problème que poserait l’exigence d’un lien direct, sujet également soulevé par l’amendement de M. Laurent. Mais dans cet exemple, il n’y aurait aucun obstacle à considérer que les activités de ces personnes ont un lien direct avec la commission d’actes terroristes, puisqu’elles fournissent des moyens d’agir aux terroristes !
Vous avez peut-être administrativement raison s’agissant de ce qui a motivé l’interdiction totale de déplacement des supporters grenoblois le 18 janvier. Mais permettez-moi de vous citer la déclaration du préfet du Haut-Rhin : « En situation d’état d’urgence, nous avons beaucoup moins de moyens disponibles pour faire accompagner ce genre de fantaisie par les forces mobiles ».
Je ne suis pas une spécialiste des supporters de football, mais je considère qu’il est grave d’interdire à l’ensemble des supporters de faire le déplacement. En l’espèce, la motivation avancée par le préfet dans son explication publique est la situation d’état d’urgence. Même si son arrêté n’est pas fondé sur l’état d’urgence, le préfet reconnaît explicitement que sa motivation, d’ailleurs généralement utilisée, se base sur le fait que les forces mobiles et les forces de police étant utilisées ailleurs, il peut, de façon discrétionnaire, interdire certaines manifestations publiques. Une jurisprudence implicite est en train de s’installer qui me paraît dangereuse.

Je comprends l’intention de M. Laurent, mais je voudrais appeler votre attention sur un point et apporter un témoignage. Car certes, il ne faut pas légiférer sous le coup de l’émotion, mais je crains que nous ayons perdu de vue ce qui s’est produit dans les jours qui ont suivi les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, et les attentats du 13 novembre. J’en porte témoignage en tant que parlementaire et en tant que maire.
Le 13 novembre, tout le monde est ébranlé par ce qui se passe. Au cours de la nuit du 14 novembre, nous apprenons l’instauration de l’état d’urgence et les préfets prennent un certain nombre de dispositions. À ce moment-là, personne ne sait ce qui se passera ensuite, si ces attaques vont cesser ou si elles vont se renouveler.
De la même façon, lorsque survient l’attaque de Charlie Hebdo, tout le monde s’étonne de l’assassinat de la policière municipale et de la prise d’otage de l’Hyper Cacher. Personne ne connaît l’étendue des attentats.
Pardon de le dire, mais au cours de ces journées, en particulier au mois de novembre, la question s’est posée, en tout cas dans mon département, de savoir s’il convenait d’interdire telle ou telle manifestation. Il ne s’agissait pas de perquisitions, de mesures de police administrative ni d’assignations à résidence, mais simplement de manifestations dont nous devions décider si elles allaient être maintenues ou pas. Jusqu’aux marchés de comestibles du dimanche !
Je veux également témoigner, monsieur le ministre de l’intérieur, que si les dispositions prises par le préfet de Seine-Saint-Denis étaient très restrictives, elles ont été très rapidement élargies au fur et à mesure de la montée en charge de la présence policière et militaire sur notre territoire.
Je pense que les choses doivent pouvoir être graduées. Au lendemain d’un événement, il convient peut-être de prendre des mesures très larges, quitte à ensuite les restreindre progressivement en fonction de la situation. À force de vivre au rythme de l’actualité, on oublie qu’on a été surpris par les événements et que personne ne savait ce qui allait se passer. Nous jugeons a posteriori, mais le ministre de l’intérieur, celui d’aujourd’hui comme celui de demain, est obligé de décider a anteriori, dans le but de prévenir un certain nombre d’événements.

Monsieur le ministre, mon amendement vise justement à fixer des bornes. Je comprends votre argument de l’autorité, dans le bon sens du terme, et la nécessité, en état d’urgence, de pouvoir mobiliser les forces de l’ordre pour prévenir le péril des attentats terroristes et faire face à la situation dans laquelle se trouve notre pays.
Mais dans les jours qui ont suivi, nous avons assisté à un certain nombre d’annulations. Je partage la préoccupation qui a été exprimée : les décisions doivent être justes et appréciées. C’est vrai pour les militants écologistes, mais aussi pour beaucoup d’initiatives qui ont fait l’objet d’une interdiction préfectorale. Il y a eu par exemple des matchs de CFA dont les préfets ont demandé l’annulation au motif qu’il était nécessaire de concentrer les forces de l’ordre. L’appréciation doit être nuancée. Vous avez d’ailleurs pris vous-même des mesures d’adaptation qui ont été transmises par circulaire.
Mon amendement ne vise pas à entraver l’action des préfets mais à fixer des bornes, directes et indirectes.
Je n’ai jamais souhaité que l’état d’urgence devienne un état d’exception qui irait jusqu’à interdire toute manifestation relevant du droit de revendiquer ou d’exprimer son opinion. D’ailleurs, je vous rappelle qu’à l’occasion des questions au Gouvernement, j’ai très souvent été interpellé par des parlementaires me reprochant de ne pas avoir interdit des manifestations qu’en droit je ne pouvais pas interdire car j’aurais été cassé par le juge administratif et l’État s’en serait trouvé affaibli – ce qui nous renvoie, monsieur le député Debré, à la manifestation des taxis.
Je ne l’ai pas fait et j’ai donné des instructions très claires aux préfets pour que l’état d’urgence ne soit pas un état attentatoire aux libertés publiques et à la liberté d’expression. Et lorsque l’état d’urgence sera prorogé, le pays continuera à fonctionner selon ces principes.
Mme Duflot invoque le fait que l’état d’urgence a empêché des supporters d’assister à un match parce qu’un préfet y a fait référence. Mais cette décision n’est pas du tout liée à l’état d’urgence, madame, elle résulte du fait que lorsqu’un préfet prend une mesure d’interdiction, il ne peut la fonder que sur sa capacité, compte tenu des forces dont il dispose, d’assurer l’ordre public en cas de troubles. Ce n’est donc pas l’état d’urgence qui a dicté cette interdiction, mais le contexte, apprécié par le préfet. Il en est ainsi depuis l’arrêt Benjamin de 1933 qui n’est en rien lié à l’état d’urgence mais qui, depuis cette date, oblige les préfets qui prennent des mesures d’interdiction à les justifier au regard de leur possibilité de maintenir l’ordre public. Tel a été l’état du droit depuis 1933, cela fonctionne ainsi pendant l’état d’urgence et fonctionnera encore ainsi après l’état d’urgence.
La doctrine du Gouvernement est la suivante : il n’y a d’interdiction de manifester que dès lors que le trouble à l’ordre public est garanti au regard des moyens dont dispose l’autorité préfectorale pour maintenir l’ordre. Dans tous les autres cas, la manifestation peut avoir lieu.
L’amendement no 187 n’est pas adopté.

Nous avions deux occasions dans ce débat de consacrer dans la Constitution des avancées réalisées dans la loi que nous avons votée et qui a été promulguée le 20 novembre dernier.
Dans le cadre juridique applicable à l’état d’urgence, deux types de garantie peuvent en effet être apportées. La première est le contrôle du juge, mais c’est une occasion que nous venons malheureusement de rater. La seconde occasion s’offre à nous maintenant : il s’agit de consacrer pleinement le rôle du Parlement durant la période d’exception qu’est l’état d’urgence.
C’est ce que je propose à travers cet amendement, qui prévoit d’abord que pendant toute la durée de l’état d’urgence, le Parlement se réunit de plein droit. D’aucuns me répondront que c’est déjà ce que prévoit l’article 24 de la Constitution, qui donne au Parlement un pouvoir de contrôle de l’action du Gouvernement.

Mais dans la mesure où il s’agit d’un état d’exception, il me semble qu’au risque d’être surabondante, cette précision pourrait néanmoins être utile.
Je précise que cette première partie de mon amendement est conforme à ce que propose le rapporteur et qui a été voté à l’unanimité par la commission des lois.
Dans sa deuxième partie, l’amendement précise que l’Assemblée nationale ne peut pas être dissoute pendant la période de l’état d’urgence. Qui pourrait imaginer que l’Assemblée, aujourd’hui, demain ou après-demain, puisse être dissoute alors même, comme nous le rappelons souvent, que le Parlement doit exercer son contrôle plein et entier tout au long de l’état d’urgence ? On imagine mal organiser une élection générale, le contrôle du Parlement ne reposant alors que sur le Sénat.
Avant que le Gouvernement me rétorque qu’il existe un a contrario, car cette impossibilité n’est pas prévue pour l’état de siège, j’objecte qu’elle est prévue par l’article 16 de la Constitution. Je pense qu’il faut une gradation dans les états d’exception : d’abord l’état d’urgence, puis l’état de siège, et enfin le régime de l’article 16. Si bien qu’on ne se retrouve plus devant un a contrario, mais un a fortiori : si la dissolution est interdite pour l’état d’urgence, elle l’est tout autant pour l’état de siège !


Comme pour M. Denaja, il s’agit de la réunion de plein droit du Parlement pendant l’état d’urgence. L’amendement no 43 utilise l’expression « pendant la durée de l’état d’urgence ». Je propose, par le sous-amendement no 274 , de la remplacer par « lorsque l’état d’urgence est en vigueur », rédaction qui me paraît préférable.
Par ailleurs, s’agissant de la dissolution, un amendement gouvernemental remet en question le cadre de notre réflexion. Il propose un autre système, en recopiant la disposition de la loi de 1955 selon laquelle la loi portant prorogation de l’état d’urgence devient caduque dès lors qu’il y a dissolution. Je vous suggère d’adopter la rédaction que je vous propose, avant d’engager une discussion sur les notions de dissolution et de caducité.

Je trouve l’amendement du Gouvernement bien curieux. En effet, si l’on considère qu’il y a une menace terroriste grave et que l’on instaure l’état d’urgence, pourquoi le déclarerait-on caduc dès lors qu’une dissolution a lieu ? Dans la hiérarchie des priorités, la protection du territoire et des habitants passe avant la décision de dissoudre l’Assemblée nationale sous prétexte qu’il y a des frictions au sein de la majorité ou entre la majorité et l’opposition !
Mon amendement tente de mettre en cohérence nos régimes d’exception dans la Constitution. Ce que nous sommes en train de faire, chers collègues, c’est élever l’état d’urgence au rang de régime d’exception dérogatoire du droit commun à valeur constitutionnelle, alors que jusqu’alors il relevait de la loi de 1955.
Il existe aujourd’hui deux régimes : le régime de l’état de siège et celui de l’article 16. À partir du moment où se dégage une large majorité pour faire de l’état d’urgence un régime d’exception à caractère constitutionnel, profitons-en pour homogénéiser les choses ! Si ces régimes correspondent, pour ce qui est de leur déclenchement, à des situations différentes, ils poursuivent la même finalité qui est de revenir à une situation telle que nous n’ayons plus besoin de recourir à des mesures dérogatoires au droit commun.
Or, que dit l’article 16 de la Constitution ? Que l’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux. Je propose donc qu’il en soit de même à la fois pour l’état de siège et pour l’état d’urgence. C’est pourquoi mon amendement propose d’insérer l’alinéa suivant : « L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la mise en oeuvre de l’état d’urgence et pendant la mise en oeuvre de l’état de siège ».
Profitons de cette « montée en constitutionnalisation » de l’état d’urgence pour homogénéiser, du point de vue du droit de la dissolution, les trois régimes d’exception qui seront désormais inscrits dans la Constitution.


Cet amendement, adopté par la commission, se trouve en contradiction avec celui que va nous présenter le Gouvernement dans quelques instants. Il interdit la dissolution de l’Assemblée nationale pendant l’état d’urgence. Il faudra donc engager une discussion sur ce point. Comme précédemment, le sous-amendement vise à supprimer l’expression « pendant la durée de l’état d’urgence ».
L’amendement de M. Cherki, lui, précise que l’interdiction de la dissolution concerne aussi la période de l’état de siège. Je suis favorable à cet amendement car pendant l’état de siège, une autorité militaire prenant la direction des opérations, il ne peut être question d’une dissolution de l’Assemblée nationale. Je pense qu’il conviendrait de scinder la discussion et de reporter ce sujet bien précis.

Je voudrais d’abord que notre collègue rapporteur nous dise à quand serait reportée la discussion. Je veux bien accéder à sa demande de la scinder, car un petit pas en avant vaut mieux que mille programmes, comme disait un grand ancien, mais je voudrais savoir quand ce pas en avant sera concrétisé.
L’amendement no 103 est un amendement de repli : si par extraordinaire nous n’homogénéisions pas les trois régimes d’exception du point de vue du droit de la dissolution, qu’au moins nous fassions ce pas en avant de l’interdiction de la dissolution pour l’état d’urgence !

La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l’amendement no 276 .
Le Gouvernement n’est pas favorable à l’insertion d’une disposition interdisant la dissolution de l’Assemblée nationale pendant l’état d’urgence.
Contrairement à M. Cherki, nous pensons qu’il faut, non homogénéiser les différents régimes de crise, mais maintenir dans la Constitution une gradation entre eux. En effet, à la différence de la situation permettant le déclenchement de l’article 16, l’état d’urgence n’entraîne aucune interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il ne serait pas bon de tracer un signe d’équivalence entre article 16 et état d’urgence, ce dernier devant demeurer à sa juste proportion.
Par ailleurs, le régime constitutionnel de la Ve République repose sur un équilibre entre la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement et le pouvoir de dissolution conféré au Président de la République. Rendre impossible toute dissolution alors même que la possibilité de censure du Gouvernement demeurerait poserait problème. Il faut maintenir l’équilibre voulu en 1958 entre les pouvoirs exécutif et législatif.
En revanche, le rapporteur l’a rappelé : le Gouvernement est sensible aux arguments avancés par les députés en commission des lois et à leur volonté de mettre en place des garde-fous pour l’avenir. C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, de constitutionnaliser l’article 4 de la loi de 1955, qui prévoit la caducité de la loi prorogeant l’état d’urgence en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de démission du Gouvernement.
Il suffirait de compléter l’article par l’alinéa : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale. »

Sur l’amendement du Gouvernement, je ne puis émettre qu’un avis personnel, puisque la commission n’en a pas eu connaissance.
Le mécanisme que propose le Gouvernement me semble le plus équilibré, puisqu’il prévoit la possibilité d’une dissolution, qui peut mettre fin à une situation de crise,…

…et conserve la possibilité d’un renversement du Gouvernement.
Cette solution me semble plus efficace que celle que nous avions élaborée lorsque la commission des lois s’est réunie, et qui visait essentiellement au contrôle parlementaire. Avis défavorable aux autres amendements.

N’ayant pas obtenu de réponse du Gouvernement, je réitère la question que j’ai posée vendredi dans mon intervention sur l’article 1er quant aux risques d’a contrario qui existent, notamment s’agissant du contrôle parlementaire.
Le Gouvernement s’est montré favorable à ce que nous inscrivions le contrôle parlementaire de l’état d’urgence dans la Constitution. Y a-t-il un risque d’a contrario concernant d’autres articles de la Constitution qui évacueraient le contrôle parlementaire ? Y a-t-il un risque d’exclusivité ? En d’autres termes, le contrôle parlementaire pourrait-il se substituer à tout autre contrôle, y compris du juge ?

Par ailleurs, l’adoption de l’amendement no 276 du Gouvernement, que nous venons de découvrir, ne risque-t-il pas, en rendant l’état d’urgence caduc quinze jours après la démission du Gouvernement, de faire tomber toutes les mesures qui en découlent, comme les assignations à résidence ?

À nouveau, je demande à nos excellents collègues de la majorité de pardonner mon irruption dans un débat interne à la gauche.
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Nous, nous pensons depuis le début que la constitutionnalisation de l’état d’urgence est inutile. Le garde des sceaux vient de le confirmer : avec son amendement, il en revient exactement au libellé de l’article 4 de la loi de 1955. C’est la preuve par neuf que nous avons raison depuis le début. Vous réinventez la roue !
Votre argument selon lequel il faudrait constitutionnaliser l’état d’urgence parce qu’on l’a fait pour les deux autres régimes extraordinaires mentionnés dans la Constitution ne tient pas. Les deux autres régimes – article 16 et état de siège – sont vraiment des régimes d’exception, dans lesquels il n’y a plus d’institutions mais une sorte d’état de guerre. Dans le premier, c’est l’armée qui a le pouvoir. Dans le second, le chef de l’État légifère à la place du Parlement. L’état d’urgence ne ressemble pas du tout à ces deux situations. Je vous rappelle qu’après les attentats du 13 novembre 2015, nous avons tenu des élections régionales de manière parfaitement régulière, preuve que le cours de nos institutions était en ordre !
L’état d’urgence permet des mesures de police préventives, dont a parlé le ministre de l’intérieur, pour essayer de prévenir un risque terroriste. En aucun cas, il ne permet d’entrer dans une société d’exception, hors contrôle.
La preuve, c’est que M. Urvoas, alors président de la commission des lois, a pu exercer un contrôle parlementaire, fort bien mené d’ailleurs, et que le contrôle du juge administratif s’est appliqué pendant toute la durée de l’état d’urgence, dont les parlementaires décident du début et de la fin.

L’argument selon lequel il faudrait mettre les trois régimes de crise au même niveau tombe, ce qui amène aujourd’hui le Gouvernement à revenir à l’intitulé initial de la loi de 1955.
On ne peut vous donner raison quand vous tournez en rond autour de dispositions qui existent déjà. Comprenez-moi : je pense que vous commettez une faute de droit. Personne ne comprend rien au dispositif que vous proposez. Vous vous compliquez la vie, vous construisez une usine à gaz.

Je suis d’autant plus d’accord avec la formulation retenue par M. Raimbourg qu’elle correspond à un amendement que nous avons défendu, M. Tourret et moi-même, lorsque le texte a été examiné, le 28 janvier, par la commission des lois. Celle-ci, suivant sur les conseils de son rapporteur du reste, n’a cependant pas voté cet amendement.
Je voudrais qu’on évite les confusions juridiques, même secondaires. Contrairement à ce qui a été dit, ce n’est pas l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 qui parle de caducité, mais l’ordonnance du 15 avril 1960 prise par le général de Gaulle. J’en rappelle les termes : « La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale. »
On comprend bien les principes qui ont inspiré ce texte. Comme l’état d’urgence vise à sécuriser les pouvoirs publics, il serait paradoxal d’en arriver à ce que le Parlement soit dissous ou à ce que le Gouvernement se démette.
Comme nous tenons à garder un gouvernement, quel qu’il soit – mais l’actuel plutôt qu’un autre ! – et comme nous tenons aussi à conserver une Assemblée nationale, de manière générale et pérenne, référons-nous plutôt à la réalité, c’est-à-dire à l’ordonnance du 15 avril 1960, qu’à ce qui ne figure pas dans la loi du 3 avril 1955, fût-ce à son article 4, où l’on trouve tout autre chose.
« Très bien ! » sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, et sur plusieurs bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Je ne voterai aucun amendement tendant à priver le Président de la République de la faculté de dissoudre notre assemblée pendant l’application de l’état d’urgence. Ce disant, je ne plaide naturellement pas pour que le Président actuel dissolve l’Assemblée nationale ! Je vous mets seulement en garde contre le risque d’affecter, au détour d’un amendement, l’équilibre inhérent à la Ve République.
Je rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la Constitution, le Président de la République « assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. » Dès lors que l’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, il est fondamental que le chef de l’État ait toujours la faculté de la dissoudre, à la seule exception de l’application de l’article 16, car dans ce cas, le chef de l’État se substitue à l’Assemblée nationale. Je le répète : veillons à ne pas compromettre l’équilibre de nos institutions.
En revanche, l’amendement no 276 que présente le Gouvernement me semble extrêmement raisonnable. Il a pour seul effet d’élever au niveau constitutionnel la disposition qui figure déjà dans la loi de 1955 et qui prévoit la caducité de l’application de l’état d’urgence en cas de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale, ce qui est conforme à l’esprit des institutions.
Je voterai par conséquent l’amendement no 276 et non les autres, qui dénatureraient la Ve République.

À l’inverse de ce qu’explique M. Lellouche, c’est là qu’il faut constitutionnaliser, puisque c’est là qu’on peut encadrer ! Ce que la loi de 1954 et l’ordonnance de 1960 prévoient, une loi simple peut le défaire. Une loi peut décider que l’état d’urgence n’empêche pas une dissolution ni la tenue d’élections. Cela prouve que nous avons besoin de constitutionnaliser, afin d’éviter toute dérive.
C’est ce à quoi tend l’amendement no 45 , que la commission a adopté et dont nous sommes les auteurs : il faut éviter la concomitance de l’état d’urgence et de la dissolution, laquelle entraîne des élections générales qui, à la différence des élections régionales ou départementales, déterminent la majorité de l’Assemblée nationale, et décident donc de la majorité gouvernementale et des lois qui régissent le pays.
L’amendement no 45 n’ayant pas été déposé en mon nom, je ne sais si je peux le retirer, mais je lui préfère l’amendement no 276 du Gouvernement, qui procède d’un double équilibre. D’abord, en cas de démission, l’état d’urgence ne continue pas à s’exercer, alors que le Gouvernement a par définition rencontré des problèmes et qu’il est sans doute devenu minoritaire à l’assemblée. Et, en cas de dissolution, l’état d’urgence prend aussi fin de plein droit. La campagne électorale qui s’ensuit dure quarante jours : quinze jours pendant lesquels l’état d’urgence s’applique encore, et vingt-cinq pendant lesquels on est assuré qu’aucun gouvernement ne pourra ni empêcher des réunions publiques ou la diffusion d’informations, ni arrêter des militants ou les assigner à résidence, ce qui serait inadmissible.
En résumé, je suis favorable au retrait de l’amendement no 45 et à l’adoption de l’amendement no 276 .

Avec cette série d’amendements, on touche les limites de l’exercice. Je comprends parfaitement l’intention de M. Denaja ou du président Raimbourg, mais je trouve significatif que certains collègues éprouvent le besoin de rappeler que, pendant l’état d’urgence, la Constitution continue à s’appliquer, et que le Parlement existe et fonctionne à plein. Évidemment qu’en dehors des périodes de dissolution et d’élections générales, il se réunit comme il veut et de plein droit ! Cela montre le danger qu’il y a à constitutionnaliser un état qui ne le nécessite pas.
Quant à votre amendement, monsieur le garde des sceaux, il prend habilement le problème à l’envers. Sans doute est-ce une habitude en Bretagne, mais nous n’y sommes pas habitués, dans les zones rurales de l’Île-de-France…
Sourires.

Je comprends votre intention, mais je distingue une faille. Au reste, je partage la position de M. Larrivé sur la limitation des pouvoirs du chef de l’État, qui ne me paraît en l’espèce pas défendable. Donc, que se passerait-il si l’on en venait à constitutionnaliser le contrôle du Parlement sur l’état d’urgence ? Si celui-ci continue quinze jours après la dissolution de l’Assemblée, qui le contrôlera pendant cette période ?

Pour ma part, je tiens à rappeler que je ne me satisfais pas de l’équilibre entre l’exécutif et le législatif que propose la Constitution de 1958…

Quoi qu’il en soit, de ce point de vue, on avance vers une rupture d’équilibre puisqu’en constitutionnalisant l’état d’urgence, on confère des pouvoirs supplémentaires à l’exécutif, inscrits dans la Constitution. Pour ma part, je défends vivement l’amendement présenté par Pascal Cherki. En effet, sans faire référence évidemment à la situation actuelle mais en me projetant à long terme, j’ai des craintes quant à l’application que l’on pourrait faire de notre Constitution, qui est inscrite dans le marbre. Je ne voudrais pas qu’à l’avenir, un exécutif, quel qu’il soit, exerce une forme de chantage, de pression sur sa majorité, en menaçant de la dissoudre en cas de non-reconduction de l’état d’urgence.
Sourires.

C’est pourquoi la disposition interdisant la dissolution pendant l’état d’urgence me paraît de bon aloi.

Monsieur Denaja, qu’avez-vous décidé s’agissant de votre amendement no 172 ?

Je ne le retirerai certainement pas, monsieur le président, car, comme beaucoup ici, je suis attaché à la réaffirmation du rôle et du contrôle du Parlement pendant l’état d’urgence. Or, si on veut le contrôle, on ne peut pas volontairement laisser subsister la possibilité de dissoudre l’Assemblée nationale. Ce n’est pas possible.

L’amendement no 276 du Gouvernement valide cette faculté de dissolution, ce qui me gêne au plus haut point. Je suis également gêné par l’idée de constitutionnaliser la règle de caducité des mesures prises en cas de démission du Gouvernement. Imaginons – hypothèse d’école – qu’un remaniement intervienne dans deux jours.
Sourires.

Il pourrait se traduire, nouvelle hypothèse d’école, par la démission du Gouvernement, quand bien même le Président de la République renommerait le même Premier ministre tout de suite après, comme cela arrive parfois. Cela reviendrait donc à ce que, dans quinze jours, des règles qui ont été prorogées la semaine dernière par le conseil des ministres deviennent caduques ! On voit bien que, dans ce cas d’espèce, cet amendement aboutirait à une impasse.

J’ai bien entendu le parallélisme établi par le garde des sceaux, le pouvoir de dissolution ne pouvant disparaître si le pouvoir de censure du Gouvernement perdure, mais je propose que ce soit au cours de la navette que vous régliez ce détail.

Quelle que soit votre position sur l’amendement gouvernemental, je vous invite à voter l’amendement no 43 sous-amendé, aux termes duquel le Parlement se réunit de plein droit pendant l’état d’urgence.

Ce n’est pas superfétatoire, car il existe des périodes autres que la session ordinaire, au cours desquelles l’Assemblée doit pouvoir se réunir. Quelle que soit la décision que nous prendrons ensuite sur l’interdiction ou non de la dissolution de l’Assemblée, je vous invite à voter l’amendement no 43 sous-amendé.

Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 143 , 170 rectifié , 38 , 144 , 216 , 100 , 188 , 185 , 44 , 232 et 82 , pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 38 , 144 et 216 sont identiques.
L’amendement no 44 fait l’objet de deux sous-amendements, nos 273 rectifié et 275 .
La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir l’amendement no 143 .

C’est le premier d’une série d’amendements visant à garantir l’effectivité du contrôle parlementaire. J’ai entendu quelques collègues expliquer qu’il ne fallait pas que ce contrôle parlementaire soit constitutionnalisé. Il est pourtant nécessaire de le faire, et de façon effective, sans s’en tenir à une simple formule, banale pour ne pas dire « bateau », comme « Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement. » De fait, c’est ce qu’il est censé faire en permanence, et chacun ici sait combien nous le faisons peu, ou trop peu ! Or, nous ne pouvons le faire peu ou trop peu au cours des périodes où nous accordons des moyens exceptionnels au pouvoir exécutif.
Il faut donc, monsieur le président de la commission, prévoir dans la Constitution, ou, en tout état de cause, dans le bloc constitutionnel, la façon dont le contrôle s’exercera. On voit bien que si, demain, une majorité souhaite voter la prolongation de l’état d’urgence mais ne désire pas laisser à l’opposition la possibilité d’en contrôler l’exécution, un risque réel existe. En effet, la même majorité qui vote la prolongation pourrait, à l’Assemblée, se refuser à elle-même – ça la regarde – mais aussi refuser à l’opposition la possibilité de contrôler l’état d’urgence.
Certes, monsieur le garde des sceaux, ce n’est pas ce qui s’est fait sous votre impulsion lorsque vous étiez président de la commission des lois, mais cela peut advenir demain, sous une majorité qui n’aurait pas la même prévention ou sous un gouvernement qui exercerait des pressions.
Aussi l’amendement no 143 vise-t-il à ce qu’une commission composée de cinq députés et de cinq sénateurs se voie automatiquement confier le contrôle de l’état d’urgence, ce qui permettrait de garantir qu’une majorité de circonstance n’empêchera pas les uns et les autres de vérifier que le pouvoir n’abuse pas des prérogatives qui lui sont confiées.

Vous gardez la parole, monsieur Lagarde, pour soutenir l’amendement no 170 rectifié .

C’est, dans la même philosophie que le précédent, un amendement de repli. En commission des lois, d’aucuns l’ont jugé bavard. Il est donc ici présenté sous une forme raccourcie. Il vise à la constitution d’une commission non permanente de contrôle de l’état d’urgence, comme il existe d’ailleurs d’autres commissions non permanentes convoquées à chaque fois qu’une situation donnée le justifie. Une loi organique déterminerait les règles d’organisation et de fonctionnement de cette commission. Si cette rédaction abrégée ne détermine plus le nombre de parlementaires la composant, du moins prévoit-elle son existence, ce qui empêchera une majorité du moment de décider de s’en passer.

Nous en venons à des amendements identiques. La parole est à M. François de Rugy, pour soutenir l’amendement no 38 .

Petite remarque de forme : le fait qu’un certain nombre d’amendements soient débattus et parfois adoptés montre tout l’intérêt de l’inscription dans la Constitution de la procédure de déclaration de l’état d’urgence. Non seulement cela renforce la solidité du dispositif, mais cela nous permet de peaufiner la rédaction des dispositions constitutionnelles et des garanties qu’elles peuvent offrir.
Au sein du groupe écologiste, nous sommes très attachés au contrôle parlementaire. Nous nous étions d’ailleurs battus pour qu’il soit renforcé dans le cadre de la réforme de la loi de 1955. Nous pensons qu’à partir du moment où la procédure relative à l’état d’urgence figure est prévue dans la Constitution, le contrôle parlementaire doit également y figurer. J’approuve les propos de Jean-Christophe Lagarde : il est évident qu’il ne suffit pas de parler de ce qui se fait déjà ; il faut le garantir dans la Constitution.
Par ailleurs, nous pourrions nous accorder sur l’amendement du rapporteur ; nous verrons ce qu’il en est au cours de la discussion. En tout état de cause, ce qui compte est que la Constitution affiche d’entrée de jeu que le Parlement, qui, de surcroît, se réunira de plein droit, pourra mettre en oeuvre des moyens de contrôle du Gouvernement. En effet, l’état d’urgence étant une action du Gouvernement, de l’autorité administrative, les contre-pouvoirs résident dans la liberté de la presse, le contrôle du juge administratif et le contrôle du Parlement.

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde, pour soutenir l’amendement identique no 144 .

Il ne s’agit plus là d’un amendement de repli mais, si j’ose dire, d’un amendement de dépit ! En l’adoptant, nous proclamerions objectivement que nous avons envie de contrôler l’état d’urgence, avant de nous en remettre pour la suite aux envies, aux foucades, aux diktats de telle ou telle majorité. En effet, je le confesse volontiers, les dispositions contenues dans cet amendement sont déjà appliquées concernant l’ensemble de l’action gouvernementale.
Mes chers collègues, je veux appeler votre attention sur l’importance que nous attachons au contrôle parlementaire de l’état d’urgence. La France, le Parlement français n’a pas la culture d’un contrôle réel et effectif du Gouvernement. Il doit l’acquérir face à une situation exceptionnelle comme celle de l’état d’urgence. C’est en tout cas notre conviction. Cela paraît essentiel. Les Anglo-Saxons ont bien davantage cette culture. Mais, à l’occasion de notre débat constitutionnel, ce serait une vraie avancée que de garantir à tous les Français que le contrôle politique s’ajoutera effectivement au contrôle juridique.
Nous avons tenu tout à l’heure un débat sur le contrôle du juge administratif et du juge judiciaire. Nous devons aussi avoir un débat sur la sécurisation, à l’avenir, de l’ensemble des Français. De fait, la Constitution n’est pas faite pour maintenant, mais pour demain, après-demain et plus loin encore. Il faut garantir aux Français que jamais un état d’urgence ne se mettra en place sans que députés et sénateurs n’exercent un contrôle politique effectif – effectif ! – comme vous l’avez fait à l’époque, monsieur le garde des sceaux, lorsque vous avez demandé, avec Jean-Frédéric Poisson, quelle était l’origine ou la motivation de telle ou telle mesure individuelle, de telle ou telle perquisition, en vous assurant de leur caractère sérieux. C’est cela, le contrôle parlementaire, lorsqu’il ne se paie pas que de mots, comme c’est malheureusement trop souvent le cas depuis 1958 dans notre pays.

La parole est à M. Yann Galut, pour soutenir l’amendement identique no 216 .

Je crois que nous pouvons collectivement saluer le travail qui a été fait, à l’époque, par le président Urvoas et les autres membres de l’Assemblée nationale pour le contrôle de l’état d’urgence. Cela a eu un effet, me semble-t-il, sur notre réflexion concernant la constitutionnalisation de l’état d’urgence. L’équilibre auquel nous devons parvenir impose que soit inscrit dans la Constitution le contrôle par l’Assemblée nationale et le Sénat. C’est pourquoi j’ai présenté cet amendement et soutiens l’ensemble des amendements semblables.

La parole est à M. Jean-Frédéric Poisson, pour soutenir l’amendement no 100 .

Cet amendement est inspiré par la même idée, qu’il formule de la manière la plus sobre et la plus courte possible : « Le Parlement contrôle la mise en oeuvre de l’état d’urgence. La loi en fixe les modalités. » Je rejoins les arguments qui viennent d’être développés par nos collègues. Les modalités du contrôle que nous avons exercé au sein de la commission des lois se sont révélées efficaces et parfaitement opérationnelles. Il suffit que la Constitution rende ce contrôle obligatoire et que le Parlement décide ensuite lui-même de ses modalités d’exercice.


L’amendement no 188 a également pour objet la constitutionnalisation du contrôle parlementaire, au vu de ce que nous avons vécu et mis en place dans le cadre du contrôle exercé par les deux commissions des lois de l’Assemblée et du Sénat. Il vise à indiquer dans la Constitution qu’une loi organique prévoit les conditions dans lesquelles le Parlement exerce son contrôle. En effet, dès lors que l’on inscrit dans la Constitution le principe du contrôle, encore faut-il en déterminer les modalités au moyen d’une procédure supérieure à celle de la loi ordinaire, de telle sorte que le dispositif soit solidifié.
L’amendement no 185 est un amendement de repli. J’espère, comme notre collègue Jean-Christophe Lagarde, que ce ne sera pas un amendement de dépit !

Je suis saisi d’un amendement no 44 de la commission, qui fait l’objet de deux sous-amendements, nos 273 rectifié et 275 .
La parole est à M. le rapporteur, pour les soutenir.

Je partage, à l’instar de la commission, l’objectif consistant à faire en sorte que le contrôle parlementaire soit effectif, rapide et qu’il s’exerce tout au long de l’état d’urgence. La rédaction que propose l’amendement no 44 , qui fait l’objet des sous-amendements nos 273 rectifié et 275 , est quelque peu différente des autres. Je propose en effet que la Constitution renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée le soin de définir les conditions du contrôle du Parlement, de façon à ce que chaque assemblée se détermine elle-même et puisse exercer son contrôle selon des modalités propres. Il faut en effet s’efforcer de tirer parti des avantages du bicaméralisme. Cette disposition peut être utile en cas d’opposition entre les deux assemblées, ou, par exemple, en présence d’une majorité très autoritaire à l’Assemblée nationale : dans ce dernier cas, le Sénat doit pouvoir s’organiser d’une façon différente. Il faut éviter que la loi n’enferme les règles dans un cadre trop rigide. Si l’idée est la même, les modalités de mise en oeuvre sont donc quelque peu différentes.

La parole est à Mme Kheira Bouziane-Laroussi, pour soutenir l’amendement no 232 .

Cet amendement va dans le même sens que les précédents : il vise à inscrire dans la Constitution le principe du contrôle parlementaire.

La parole est à M. Christophe Cavard, pour soutenir l’amendement no 82 .

Qu’il y ait sur tous les bancs de cette assemblée l’envie de trouver une solution a de quoi ravir. Je ne sais pas si tout le monde est d’accord et je ne voudrais pas m’immiscer dans un débat qui ne me concernerait pas mais, pour ma part, je me réfère plutôt à l’amendement de M. Poisson. Il faut écrire que le Parlement doit pleinement jouer son rôle de contrôle. Le nouveau garde des sceaux, qui a eu à l’assurer dans le cadre de sa précédente fonction, sait mieux que quiconque l’importance de ce contrôle, surtout compte tenu des risques de dérive que certains ont évoqués tout à l’heure. Il est essentiel que le Parlement, que les deux chambres soient dans l’obligation de remplir pleinement leur rôle et que ce ne soit pas seulement une option.
Parce que nous sommes nombreux à avoir déposé des amendements, monsieur le président, je vous informe dès à présent que je me rangerai volontiers à celui du rapporteur, sous-amendé selon ses termes, qui renvoie aux règlements des assemblées. Je retire donc mon amendement.
L’amendement no 82 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements en discussion commune ?

Avis favorable à l’amendement no 44 de la commission, avec ses deux sous-amendements, et défavorable à tous les autres amendements en discussion commune.
Comme vous pouvez aisément l’imaginer, le Gouvernement est extrêmement favorable au point de vue défendu par la commission.
Il est logique que le Parlement se soit saisi de cette question. Il ne paraît cependant pas opportun d’inscrire des détails dans la Constitution puisque, à l’heure actuelle, la seule disposition relative au fonctionnement interne du Parlement qui y figure est le nombre des commissions. Se lier les mains en précisant dans la loi fondamentale un certain nombre de modalités qui relèvent de la seule responsabilité du Parlement me paraît inopportun. Il fut un temps où, occupant une autre fonction, j’étais souvent le défenseur de la souveraineté du Parlement : celui-ci dispose de tous les pouvoirs, il ne lui reste qu’à les utiliser ! En l’espèce, l’amendement de la commission des lois sous-amendé suffit largement au but que chacun poursuit ici.

Le débat prend une tournure un peu particulière. La majorité est en train, à coups d’amendements, de modifier profondément notre loi fondamentale. L’amendement qui vient d’être adopté, qui interdit au Président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale pendant l’état d’urgence, modifie profondément l’équilibre de nos institutions. Progressivement le débat dérape, dérive. Je veux mettre en garde la majorité et le Gouvernement contre le danger que représente le fait de s’éloigner de la vocation initiale de cette réforme.

Sur le principe, nous ne pouvons qu’approuver l’exercice du contrôle parlementaire de l’état d’urgence. Il faut toutefois réintroduire, en les revisitant, les garde-fous prévus par la loi de 1955, à la suite entre autres du rejet de plusieurs amendements de nos collègues Duflot et Laurent, notamment, qui souhaitaient introduire des garanties quant à la mise en oeuvre de l’état d’urgence.
Pour moi, il ne s’agit d’amendements ni de repli, ni de dépit, mais d’amendements « INPI » – Institut national de la propriété intellectuelle !
Sourires.

Vous êtes tout simplement en train d’inventer la Constitution bavarde. À persévérer dans cette absurdité qu’est la constitutionnalisation de l’état d’urgence, vous êtes contraints, par un enchaînement que nous voyons bien, d’ajouter toujours plus de dispositions dans la Constitution. Déposez donc le brevet de la Constitution bavarde auprès de l’INPI, vous aurez ainsi déjà franchi une étape !
Je voudrais rappeler les propos de Bertrand Mathieu, professeur de droit constitutionnel à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et vice-président de l’Association internationale de droit constitutionnel : selon lui, la Constitution a vocation à être un texte stable et concis.

Il explique qu’il y a deux types de réformes constitutionnelles dangereuses : celles qui sont émotionnelles, et celles qui sont improvisées. Et il ajoute que celle d’aujourd’hui coche les deux cases ! Cette réforme constitutionnelle est proposée sous le coup de l’émotion et de manière improvisée. La solution la meilleure, la plus sage, serait tout simplement de la rejeter en bloc.

Mes chers collègues, je voudrais rappeler avec un peu de solennité que ce projet de loi constitutionnelle ne pourra être adopté au Congrès qu’à la condition de recueillir trois cinquièmes des voix des membres du Parlement.

Au fur et à mesure que des amendements créatifs, pour ne pas dire bizarres, sont soumis à la discussion et, pour certains, adoptés, cette perspective s’éloigne. En particulier, l’amendement socialiste supprimant le droit de dissolution du Président de la République pendant l’état d’urgence pose une grave difficulté à l’ensemble du groupe Les Républicains. Parce que nous sommes attachés à l’équilibre de la Ve République, l’adoption de cet amendement nous pose une difficulté majeure.
S’agissant des présents amendements, je rappelle que la Constitution doit être concise. Rappeler que, depuis 1958, le Parlement a pour mission de contrôler l’action du Gouvernement n’a tout de même rien d’une nouvelle extraordinaire ! C’est déjà inscrit en toutes lettres à l’article 24 de la Constitution : « [Le Parlement] contrôle l’action du Gouvernement. » Vous réinventez la roue ! Pourquoi ne pas écrire aussi, tant que nous y sommes, que l’eau bout à cent degrés ? Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement ; il n’est nul besoin de multiplier les amendements bavards pour énoncer cette vérité inhérente à la Ve République.

Tout le monde ici estime, à juste titre, que le contrôle parlementaire est absolument nécessaire. La formulation proposée par le désormais président de la commission des lois à ce sujet me semble présenter moins de risques que les autres. Je réitère néanmoins ma question, monsieur le garde des sceaux : n’y a-t-il pas un risque d’a contrario ou un risque d’exclusivité ? Ne risque-t-on pas d’exclure d’autres types de contrôle de l’état d’urgence ? Merci de me répondre.

Monsieur le ministre, ce point est important car, comme cela a été rappelé à l’instant par Guillaume Larrivé, il s’agit de la capacité de contrôle du Gouvernement par le Parlement. Qu’avez-vous à craindre, mes chers collègues, de cette faculté de contrôle par le Parlement de l’action du Gouvernement, en particulier dans cette situation exceptionnelle que constitue l’état d’urgence ? Puisque vous voulez inscrire l’état d’urgence dans la Constitution, donnez donc les moyens au Parlement d’exercer ce contrôle en l’inscrivant dans la loi fondamentale ! Ce serait une vraie garantie pour le Parlement que nous représentons, Sénat et Assemblée nationale, en vue de l’application demain par des gouvernements de cet état d’urgence.
Monsieur le rapporteur, j’entends votre argument renvoyant aux règlements intérieurs des assemblées, voire à une loi. Mais une loi pourra être défaite demain par un autre gouvernement, qui ne voudra pas de ce contrôle de l’état d’urgence. L’inscription dans la loi fondamentale, c’est la garantie absolue que ce contrôle parlementaire s’exercera jusqu’au bout.

Monsieur Larrivé, monsieur Ciotti, je suis un peu étonné par vos interventions. Vous avez réagi quelque peu après la bataille, s’agissant de l’amendement relatif à la dissolution.

Vous auriez pu le faire plus tôt. D’ailleurs, vous n’êtes pas très présents, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est votre choix, et nous le respectons, mais veuillez respecter le fait que, pour notre part, nous faisons notre travail de constituant.
Par ailleurs, monsieur Chassaigne, je me félicite que notre Constitution se soit, au fil des années, enrichie d’un certain nombre de précisions. Je rappelle qu’à une certaine époque, le bloc de constitutionnalité, comme on l’appelle maintenant, ne comprenait pas la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou la Charte de l’environnement. Ces textes ont été ajoutés.

Que le Conseil constitutionnel les intègre aux normes sur lesquels il se fonde est une bonne chose. Et l’expérience a permis de préciser un certain nombre d’éléments. M. Larrivé avait dit en commission, je lui reconnais à cet égard une grande constance, qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire le contrôle parlementaire dans la Constitution puisque il y est déjà écrit que le Parlement contrôle l’action du Gouvernement. Mais vous savez pertinemment, au vu de l’expérience, monsieur Larrivé, que cela ne suffit pas à l’exercice effectif du contrôle, et que les outils se construisent pas à pas.
Enfin, puisque le rapporteur a été assez clair au sujet de l’amendement no 44 sous-amendé, nous nous y rallions et retirons l’amendement no 38 .
L’amendement no 38 est retiré.

Pour ma part, je suis favorable à l’inscription du contrôle du Parlement dans ce nouvel article de la Constitution, car cela constituerait une garantie importante pour les libertés publiques. Certes, ainsi que le rappelait M. Larrivé, une disposition générale prévoit déjà que le Parlement contrôle l’action du Gouvernement.

Cependant, quand nous avons voté tout à l’heure un amendement relatif au contrôle du juge administratif sur les mesures de police administrative, cela revenait également à enfoncer des portes ouvertes !

Si. Je plaide pour l’effraction de portes ouvertes dans les deux cas, tant pour le contrôle du juge administratif que pour le contrôle du Parlement. Insérer dans l’article relatif à l’état d’urgence cette disposition n’est pas inutile pour avoir toutes les garanties nécessaires.

Nous allons bientôt clore la discussion sur cette série d’amendements… La parole est à M. Patrick Mennucci.

L’amendement de la commission sous-amendé règle la question de la valeur de la loi, monsieur Vigier. Le texte exact sera : « Les règlements des assemblées prévoient les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle la mise en oeuvre de l’état d’urgence. »
Cela permet de répondre à la fois à nos collègues du parti communiste français…
Sourires.

Il s’agit non pas de verbiage, comme l’ont affirmé MM. Ciotti et Larrivé, mais d’une formulation très nette. L’amendement de la commission sous-amendé de cette façon me semble parfaitement répondre à l’objectif que nous poursuivons.

Permettez-moi de rappeler simplement qu’il s’agit de l’amendement no 44 sous-amendé par les sous-amendements nos 273 rectifié et 275 .
Monsieur Vigier, il s’agit bien d’inscrire clairement dans la Constitution que ce sont les règlements des assemblées qui prévoient le contrôle du Parlement sur la mise en oeuvre de l’état d’urgence. Cela n’a rien de flou.
Je ne voudrais pas oublier la question que m’a posée deux fois Mme Mazetier.
Faut-il inscrire ou non les dispositions de l’article 3 de la loi de 1955 dans la Constitution ? C’est un débat permanent. Moi, contrairement à Napoléon, je ne pense pas que la Constitution a vocation à être courte et obscure. D’ailleurs, quand il disait cela, il préparait un régime autoritaire ! Il ajoutait du reste que la Constitution n’avait pas vocation à empêcher le Gouvernement de gouverner.
Si le Parlement, dans sa sagesse, décide d’élever des éléments au rang constitutionnel, le Gouvernement respecte sa volonté. Cela dit, madame Mazetier, nous avons pu construire un contrôle parlementaire sans que cela figure dans la Constitution, et cela continuera à être possible !
L’amendement no 216 est retiré.
Les sous-amendements nos 273 rectifié et 275 , successivement mis aux voix, sont adoptés.

Prochaine séance, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation.
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures.
La Directrice du service du compte rendu de la séance
de l’Assemblée nationale
Catherine Joly