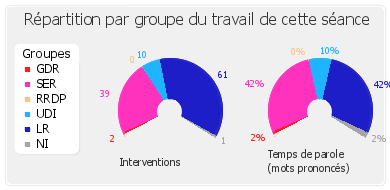Séance en hémicycle du 11 octobre 2012 à 15h00
Sommaire
La séance

La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)


Ce matin, l'Assemblée a entendu le rapporteur et le Gouvernement. Nous en venons à la discussion générale.
La parole est à M. Guy Geoffroy.

Madame la présidente, madame la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, monsieur le vice-président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le présent texte est loin d'être anodin. Il mérite même un grand intérêt de la part des représentants du peuple.
Depuis dix ans, s'il est une politique publique qui a marqué des points, qui a donné des résultats – parce qu'elle a été guidée par un volontarisme assumé, par une vraie clairvoyance, par le recours à part égale aux outils de prévention et de répression – c'est bien celle qui vise à lutter contre le malheur que constituent tous ces morts et tous ces blessés dus aux accidents de la route.
Beaucoup d'entre nous se rappellent cette campagne télévisée déjà ancienne, filmée dans une commune du Sud-Ouest d'environ 12 000 habitants, tous à terre, gisant, pour faire comprendre ce que représentent 12 000 morts par an sur les routes. Et il y en avait eu davantage, plus de 16 000 par an…
En 2011, nous en sommes à moins de 4 000. C'est le fruit de cette politique, de l'effort collectif, de la prise de conscience, du volontarisme des deux chefs d'État qui ont initié puis accompagné la réforme. C'était au départ le grand projet de Jacques Chirac, et je le salue pour cette volonté et pour cette réussite.
Mais il ne faut pas s'arrêter là. L'objet de la proposition de loi de Bernard Gérard est justement de prendre appui sur l'ensemble des outils dont nous disposons déjà pour faire un pas supplémentaire. Mais un pas qui peut avoir des conséquences importantes.
Il s'agit de prévention. À entendre, sur beaucoup de sujets, en particulier ceux de l'école, le Gouvernement s'étendre sur l'urgence de privilégier la prévention sur la répression et la sanction, on peut s'étonner de la forme de tiédeur qu'il a manifestée ce matin, de sa timidité certes constructive, mais néanmoins bien perceptible.
Les outils de la répression existent. Les radars ont été très contestés mais les pouvoirs publics n'ont pas cédé, et je sais qu'il est dans l'intention de votre gouvernement de continuer ainsi, parce que ce sont des outils nécessaires.
Alors pourquoi traiter avec autant de frilosité cet autre outil que vous propose Bernard Gérard ? Il s'agit tout simplement de déployer un dispositif qui existe déjà, les cinq gestes qui sauvent, à l'occasion de cet événement important pour la vie de tout jeune, et encore plus par les temps actuels, qu'est le permis de conduire.
Le permis, ce n'est pas un brevet de bonne conduite : c'est une autorisation à conduire. Les jeunes conducteurs, on le sait, sont à la fois très pressés de savoir conduire – et de le faire reconnaître ! – mais également très attentifs, si l'on veut bien les écouter, à ce qui peut leur permettre de bien conduire et d'être plus responsables sur la voie publique.
Il est une évidence que, dans la majeure partie des accidents, ceux qui interviennent les premiers sont d'autres automobilistes, se trouvant à proximité. Ceux qui ont eu un jour l'occasion de vivre un épisode de cet ordre, toujours douloureux, parfois dramatique, savent combien est importante cette première présence, combien on attend de celui qui intervient et qui, pourtant, ne sait souvent que faire pour porter secours.
Il ne s'agit pas de remplacer les professionnels des secours, d'acquérir une formation exhaustive, mais simplement de savoir accomplir les actes indispensables qui peuvent sauver. Ce qui est en jeu, c'est de réduire le bilan actuel – un peu moins de 4 000 morts, je le rappelle – d'un peu moins de 10 %. On estime en effet à 250 à 300 le nombre de morts qui seraient évitées si ces gestes qui sauvent étaient accomplis dans les premières minutes, des gestes de bon sens, de lucidité, de simple efficacité.
C'est pourquoi nous sommes quelque peu désarmés devant l'argumentaire du Gouvernement et de la majorité, dont nous avons en vain essayé en commission de démontrer le manque de pertinence.
Premier argument : ces dispositions relèvent du règlement. Chiche ! Le fruit de notre travail reste pertinent. Reprenez-le à votre compte et faites dans le règlement ce que n'a pas fait le décret d'application de la loi de 2003. Mettez rapidement en place ce dispositif, parmi d'autres. Le galop d'essai parlementaire aura été utile.
Mais je crains que cet argument cache des raisons plus gênantes, à commencer par le fait que cette disposition coûterait cher. Mais 300 vies, n'est-ce pas aussi un prix à payer ? Ne valent-elles pas les 20 ou 25 euros qui s'ajouteraient au prix du permis de conduire, qui dépasse largement le millier d'euros ? Cet argument n'est pas totalement infondé, mais il semble de tellement peu de poids par rapport aux enjeux que je vous propose d'y renoncer.

Deuxième argument contre lequel nous avons essayé de nous prémunir, notamment grâce aux amendements que proposera tout à l'heure notre rapporteur : le ministre de l'intérieur nous reprochait ce matin de vouloir toucher à l'épreuve du permis de conduire. Mais pas du tout ! Peut-être notre formulation était-elle maladroite, mais ce que nous souhaitons, c'est que le candidat produise au moment de l'inscription à l'examen une attestation selon laquelle il a bien été formé aux cinq gestes qui sauvent. Cette proposition a rencontré l'accord de tous les acteurs concernés. Je suis donc sûr que nous parviendrons à trouver des solutions.
Au nom de mon groupe, j'adresse tous nos remerciements à Bernard Gérard pour cette excellente initiative, suivie par un grand nombre de nos collègues. Et je demande au Gouvernement et à la majorité de sortir de cette écoute intéressée, mais un peu dispersée qu'ils ont montrée jusqu'alors. Prenez des initiatives, madame la ministre. Essayez d'éviter qu'une nouvelle fois l'opposition, faisant preuve d'une volonté d'agir pour le bien public, ne rencontre qu'une majorité convaincue que, par principe, puisque venant d'elle, le texte ne mérite pas d'être retenu.
Depuis le début de la législature, aucun amendement venant de l'opposition, sur aucun texte, même pas celui relatif au harcèlement sexuel sur lequel nous étions totalement d'accord avec vous, n'a été retenu. C'est dommage. Vous avez ici l'occasion de montrer qu'il ne peut s'agir d'un début de sectarisme inquiétant de votre part. De grâce, prouvez-le. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comment sauver des vies sur la route ? C'est une question qu'en tant que législateur et que citoyen nous devons nous poser, quelles que soient nos convictions politiques.
Il est important de rappeler les chiffres : 69 000 accidents de la route ont lieu chaque année, 100 000 personnes sont blessées, 4 000 d'entre elles sont handicapées à vie et 4 000 meurent. Au total, en plus de quarante ans, plus de 380 000 personnes sont décédées des suites des accidents de la route. Derrière ces chiffres, il y a des drames humains, des familles déchirées, que ce soit à cause d'une conduite à risque ou d'une simple faute d'inattention.
Il y a des années que la prise de conscience a eu lieu et les gouvernement successifs, depuis les années 1970, ont beaucoup fait évoluer les choses : limitations de vitesse, ceinture de sécurité, permis à points… On ne compte plus les réformes, les comités interministériels, les missions visant à endiguer le fléau. Malgré tout cela, aujourd'hui, il faut encore franchir une étape supplémentaire.
Entre 2000 et 2010, le nombre des tués sur la route a diminué de moitié. En 2006, notre pays est passé sous la barre des 5 000 morts par an.
Ainsi, en quarante ans, ces dispositions ont permis de sauver, en quelque sorte, 320 000 vies.
Le bilan reste cependant lourd et le coût social est énorme : 23,4 milliards d'euros, soit environ 1,3 % du PIB. Indéniablement, en matière de sécurité routière, l'enjeu social et humain s'ajoute à l'enjeu politique.
À tout moment, en tous lieux, chacun d'entre nous peut être confronté à un accident de la circulation. Combien d'entre nous sauraient alors quelle attitude adopter ? Combien d'entre nous sauraient avoir les bons gestes alors même que la vie de la victime est en jeu ?
En pareilles circonstances, chaque geste compte, chaque minute qui passe est cruciale pour la survie de la victime. L'exemple des arrêts cardiaques est flagrant : sans prise en charge immédiate, plus de 90 % d'entre eux sont fatals. Chaque minute passée équivaut à 10 % de chances de survie en moins.
Aujourd'hui, moins de la moitié de la population française est formée aux premiers secours. Il est paradoxal qu'un pays comme le nôtre, compétent en matière de médecine hospitalière, puisse être défaillant en matière d'apprentissage des gestes de premiers secours.
Il est regrettable que nous n'ayons jamais perçu comme une évidence la nécessité d'intégrer à l'examen du permis de conduire une formation à ces gestes. Aujourd'hui, nous avons enfin l'occasion de le faire, en adoptant une mesure de bon sens, l'occasion de faire oeuvre utile en faveur de la sécurité routière, d'apporter une vraie réponse à un problème récurrent par une formation dont on souligne qu'elle a déjà été mise en place dans plus de quinze pays d'Europe. La disposition proposition est simple et concrète : il s'agit d'ajouter aux deux épreuves actuelles de l'examen du permis de conduire une troisième épreuve, ou un certificat – quelque chose qui permette de valider l'acquisition des notions élémentaires de premier secours.
S'y former est un acte citoyen et quelques heures suffisent pour apprendre ces gestes qui permettent de sauver des vies. Cette idée, déjà évoquée à de multiples reprises depuis 1974, qui a fait l'objet de nombreuses propositions parlementaires depuis cette date, pourrait avoir des effets positifs immédiats : entre 250 et 350 vies pourraient être sauvées.
Certes, l'article 16 de la loi du 12 juin 2003 mentionne déjà une formation aux gestes qui sauvent mais, dans les faits, celle-ci n'existe pas, le décret n'a pas été pris et l'application de cette disposition reste, pour l'instant, très marginale. Or c'est de favoriser une diffusion de masse de cette formation que nous avons besoin aujourd'hui.
Ce texte est également l'occasion de poser des problèmes plus larges, comme celui de la formation et de la prévention en matière de sécurité routière.
Ainsi que l'ont rappelé les membres de la mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation, la sécurité routière s'apprend. La formation, à tout âge de la vie et en toutes circonstances, est donc primordiale. Elle demeure cependant perfectible.
L'apprentissage de la conduite dans notre pays doit être encouragé et facilité. Considéré comme un véritable passeport de l'insertion professionnelle, le permis de conduire tel qu'il est conçu actuellement est très coûteux et les délais d'attente sont assez longs : il est donc très important d'inscrire cette mesure de formation aux gestes de premiers secours dans un cadre global.
Ces éléments peuvent expliquer en partie une augmentation importante du nombre de conducteurs sans permis de conduire, estimé – même si c'est toujours très délicat – à 450 000.
Enfin, nous devons garder à l'esprit que le permis de conduire n'est pas un sésame à vie que l'on obtiendrait à dix-huit ans : c'est, en réalité, une autorisation de conduire. Il ne constitue pas une garantie de sécurité, le taux de mortalité des jeunes conducteurs demeurant très élevé.
Il est donc primordial que les titulaires du permis de conduire puissent prendre conscience des conséquences que peut entraîner une mauvaise conduite et se responsabiliser. La formation aux gestes qui sauvent est l'étape suivante, l'étape indispensable pour améliorer encore la sécurité de nos routes.
Mes chers collègues, parce que la lutte contre la mortalité routière et la diminution du nombre de blessés graves constituent un enjeu capital, le groupe UDI soutient la proposition de notre collègue d'intégrer à l'examen du permis de conduire la formation aux cinq gestes qui sauvent.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la sécurité routière est l'affaire de tous. Tous les députés ici réunis sauront le reconnaître au-delà des querelles partisanes.
La baisse de la violence routière est continue depuis quarante ans : 18 000 morts en 1972, 13 000 en 1982, 10 000 en 1992, 7 700 en 2002 et, enfin, 3 900 en 2011. Le nombre de tués sur les routes de France a donc été divisé par 4,5 en quarante ans. C'est une belle performance, collective puisque tous les gouvernements successifs s'y sont attachés. Nous n'en sommes, certes, pas au niveau des Britanniques, mais nous allons dans le bon sens.
Cette baisse continue s'explique par des progrès importants dans la fiabilité des voitures, la qualité du réseau routier, ainsi que la prévention, laquelle fut le fait tant des pouvoirs publics que des associations.
L'évolution de la législation explique aussi cette baisse continue. Il fut un temps où l'état d'ébriété d'un conducteur qui provoquait un accident était considéré comme une circonstance atténuante ; c'est aujourd'hui une circonstance aggravante. La sévérité des peines et l'instauration du permis à point en 1992 ont aussi eu des résultats positifs.
Le législateur n'a cependant pas toujours fait preuve de sagesse dans ce domaine, et encore très récemment.
Alors qu'aujourd'hui 95 % des conducteurs conservent plus de la moitié de leurs points de permis, on pourra regretter l'assouplissement du permis, en 2010, au cours de la précédente législature. Les associations avaient tiré la sonnette d'alarme. Las, au mois de janvier 2011, on comptait 21 % de tués en plus sur les routes. L'annonce de l'entrée en vigueur de cet assouplissement a-t-elle pu faire naître dans l'esprit de certains conducteurs un soudain sentiment d'impunité qui aurait annihilé les réflexes de prudence et la peur du gendarme ? Le phénomène s'est cependant tassé par la suite puisque, finalement, l'année 2011 fut une bonne année. Cela a presque fait oublier le difficile début d'année.
On pourra également évoquer les problèmes posés par la généralisation, sous peine d'amende, de deux éthylotests par voiture. Outre le fait que les éthylotests chimiques ne sont pas fiables et peuvent donner de faux négatifs, ils ne résistent pas à une exposition prolongée à des températures supérieures à 40 degrés ou à des températures très basses, ce qui peut poser problème en été et en hiver.
En outre, la protection de l'environnement n'a pas été prise en compte : aucune mesure n'a été prise pour éviter que ne fussent jetés dans l'environnement des dizaines de millions d'éthylotests utilisés ou déclassés, alors que ceux-ci contiennent environ un gramme de chrome VI, substance classée cancérogène, mutagène et reprotoxique.
Je me félicite quand même que nos collègues de l'opposition, après ces sorties de route, reviennent dans le droit chemin de la sécurité routière en proposant une loi dont l'intention est louable, celle de former aux cinq gestes qui sauvent.

Comme l'a rappelé notre rapporteur, les premiers instants après l'accident sont les plus importants pour les victimes, et il convient de former le plus grand nombre aux réflexes qui permettent de sauver des vies.
Toutefois, l'article 16 de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière comporte déjà une telle mesure. Notre collègue Pierre Morel-A-L'Huissier, sensible à la multiplication et la superposition des normes juridiques, préférera, j'en suis certain, que l'on applique une disposition déjà existante plutôt que l'on adopte un texte empiétant sur le domaine règlementaire. Est-il bien nécessaire de recourir à une loi pour régler ce problème ?
Comme vous l'aurez noté, chers collègues, les différentes composantes des épreuves du permis de conduire relèvent de la partie règlementaire du code de la route. Nous laissons donc le soin au pouvoir exécutif de prendre les mesures qu'il jugera nécessaire afin de renforcer la formation aux cinq gestes qui sauvent. Nous regrettons toutefois qu'une telle proposition de loi n'adosse cette formation qu'à l'étape du passage du permis de conduire. Ce choix pose le problème de l'organisation d'une possible troisième épreuve – le permis est déjà assez compliqué – et surtout de son coût. Je le rappelle : pour un certain nombre de nos concitoyens, le permis est particulièrement onéreux. Certains s'endettent pour le passer et les missions locales pour l'emploi donnent des fonds à certains de nos concitoyens pour pouvoir le passer et aller au travail. C'est donc une question importante.

Enfin, la formation à ces gestes de secours peut se faire de manière progressive tout au long de la scolarité. Il suffirait de renforcer l'attestation scolaire de sécurité routière, passée au collège en cinquième et en troisième, qui est nécessaire pour se présenter au brevet de sécurité routière et au permis de conduire. Cette première approche pourrait être complétée au lycée ; c'est d'ailleurs le cas dans la formation de certains établissements professionnels. Votre humble serviteur a d'ailleurs dans sa prime jeunesse, qui n'était pas folle, je vous rassure (Sourires), bénéficié de ce genre de formation. La formation au secourisme lors de la journée défense et citoyenneté pourrait également être renforcée.
Je suis sensible à votre argument lorsque que vous évoquez les limites d'une formation en collège. Les élèves l'auront oubliée en partie lorsqu'ils passeront le permis de conduire. Cela dit, pour ma part, je l'ai suivie au lycée et juste avant le permis de conduire, et je serais aujourd'hui dans l'incapacité totale d'effectuer les gestes en question.

Instaurer une telle formation au moment du permis de conduire n'est donc pas une bonne chose, car ce n'est pas suffisant. C'est bien la formation tout au long de la vie qu'il faut renforcer. Les situations auxquelles seront confrontés les automobilistes d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans cinquante ans, notamment à cause de l'évolution des technologies, alors qu'ils seront, dans cinquante ans, toujours en possession de leur permis de conduire. Comment croire que les personnes formées aujourd'hui pourront encore maîtriser les gestes en questions dans vingt ans sans quelques piqûres de rappel ?
Des pistes sont donc à envisager afin de renforcer la formation et la sensibilisation, avec une réactualisation continue par le biais de formations périodiques obligatoires dans le cadre, par exemple, de la médecine du travail, ou, tout simplement, dans les entreprises. C'est d'ailleurs en partie fait : les conseillers hygiène et sécurité sont chargés de ce genre de choses dans bon nombre d'entreprises.
Peut-être conviendrait-il de donner un peu plus de cohérence à tout cela et de généraliser les initiatives déjà prises. Nous aurions donc été sensibles à une initiative ambitieuse en termes de formation aux gestes qui sauvent, qui aurait porté sur l'ensemble des situations auxquelles les individus peuvent être confrontés dans leur quotidien et touché un large public.
Telles sont les raisons pour lesquelles mon groupe exprime un avis réservé sur une proposition de loi dont les buts sont, certes, louables mais dont l'ambition est trop restreinte et qui vient empiéter sur le domaine réglementaire. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi vise légitimement à relever le défi de la mortalité routière par la mise en oeuvre plus systématique de politiques de formation aux rudiments du secourisme. Elle a pour objet une mesure simple et précise : l'inclusion, dans les épreuves du permis de conduire, d'une formation aux cinq gestes qui sauvent, ce qui permettrait de favoriser la formation d'un public particulièrement large. Comme le souligne l'auteur et rapporteur du texte, les connaissances acquises à l'occasion de la préparation au permis de conduire pourront ensuite être réutilisées dans de nombreuses circonstances de la vie quotidienne.
Le texte prévoit que cette formation de quatre heures serait dispensées et validée par les associations de secourisme agréées, ce qui offrirait, à l'évidence, une garantie de qualité.
Cette proposition de loi reprend un projet vieux de quarante-cinq ans, issu d'une pétition lancée en 1967 par Didier Burggraeve, alors à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Las, en dépit de nombreuses initiatives, l'idée d'une formation aux gestes qui sauvent face à un accident de la route lors de la préparation au permis de conduire n'a pas abouti jusqu'à présent.
Pourtant, les professionnels de la santé publique s'accordent – c'est important – sur l'insuffisance du niveau de formation des Français aux gestes qui sauvent. Selon des études réalisées par la Croix-Rouge française en 2009, environ 40 % de la population serait formée aux premiers secours, 29 % des Français auraient reçu une formation diplômante, environ 11 % ont eu une initiation d'une durée de moins de trois heures.
Dans un rapport intitulé Secourisme en France : panorama et perspectives, publié le 29 juin 2010, l'Académie nationale de médecine dresse un bilan du secourisme en France et formule quelques propositions. Selon elle, 250 à 350 personnes pourraient être sauvées sur les routes par l'apprentissage de ces gestes, sans compter celles qui le seraient lors des accidents de la vie courante. Elle rappelle aussi que certains pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et le Danemark lient l'obtention du permis de conduire à celle d'un diplôme de secouriste et regrette qu'en France la proposition ait été faite à plusieurs reprises sans succès.
D'une manière générale, et je crois que c'est un point extrêmement important de notre débat, de nombreuses études attestent que la rapidité de l'intervention du premier témoin après un accident et son efficacité sont déterminantes pour l'efficience des professionnels qui interviennent ensuite.
Comme le dit clairement la fédération française de cardiologie, et comme le souligne notre rapporteur, sans prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques sont fatals. Chaque minute qui passe avant l'arrivée des secours correspond à 10 % de chances de survie en moins pour la victime. À l'inverse, quatre personnes sur cinq qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de gestes de premiers secours pratiqués par un témoin. Pour toutes ces raisons, notre groupe partage pleinement l'objectif fixé par les auteurs de la proposition de loi, de faire du secourisme le premier maillon de la chaîne de secours.
Certes, nous avons noté les réserves exprimées lors de l'examen de la proposition de loi en commission. Premièrement, la charge financière nouvelle pour le candidat au permis de conduire peut poser problème. Cela étant, le coût du permis est déjà exorbitant : il ne faudrait pas, à l'évidence, que la formation aux cinq gestes qui sauvent s'accompagne d'une charge supplémentaire pour le candidat.
Toutefois, cette charge est estimée entre 25 et 50 euros, alors que le coût total du permis se situe aujourd'hui, en moyenne, entre 1000 et 1200 euros : tout le monde conviendra donc que le coût supplémentaire reste minime.

Deuxièmement, il est vrai que cette proposition de loi ne permet pas de remédier à la faiblesse de la formation française en matière de secourisme. À cet égard, nous considérons pour notre part que l'idéal serait de généraliser la formation aux gestes de premier secours dispensée au collège, puis de l'étendre au lycée, et de la prolonger par une formation tout au long de la vie.
On peut, cela dit, s'interroger sur le caractère réglementaire du texte. Il n'en demeure pas moins que nous en discutons ici cet après-midi et qu'il propose un dispositif simple et précis. Ce dispositif répond à une demande de longue date des professionnels du secourisme et de la santé publique ; il existe déjà depuis de nombreuses années dans plusieurs pays européens. Plus d'une dizaine d'entre eux ont ainsi intégré les gestes de premiers secours à la formation en vue de l'acquisition du permis de conduire.
Au total, nous pensons que ce dispositif est opportun. Il contribuera certainement à lutter contre la mortalité routière ainsi qu'à diminuer le nombre de blessés graves par les accidents de la route. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, le groupe GDR votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je tiens à saluer le travail du rapporteur et l'esprit qui a présidé aux travaux en commission. Les échanges furent de qualité, la tonalité toujours constructive. La courtoisie républicaine de M. Gérard a été appréciée de chacun. Je me permets donc, en votre nom à tous, de le remercier chaleureusement. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Les questions liées à la sécurité routière sont parmi les plus sensibles, les plus douloureuses, les plus médiatiques. Aussi chacun est-il parfaitement convaincu de la nécessité de diminuer sans cesse les risques de mortalité. L'exercice de nos responsabilités n'y est pas étranger : nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre à des situations dramatiques dans nos différentes circonscriptions. Face à la peine de celles et ceux que nous avons croisés, il est peu de mots qui réconfortent. Chacun pourrait donc trouver ici un motif d'agir.
Je vous invite à prendre le temps de la réflexion pour apporter la réponse la plus efficace possible au problème dont nous débattons : trouver les meilleurs moyens pour que celles et ceux qui portent les premiers secours soient bien formés et qu'ils disposent des meilleurs réflexes afin de ne pas aggraver la situation à laquelle ils sont confrontés.
À l'issue de tous nos échanges, de tous nos débats, je maintiens mes réserves.
La première est de principe : elle n'est pas secondaire. Comme vous l'a fait remarquer M. le ministre, la disposition que nous examinons est très certainement de nature réglementaire et non législative. Tout indique, mes chers collègues, que les modalités de passage de l'examen du permis de conduire ne relèvent pas de notre compétence. À l'appui de mon propos, je m'en tiendrai à deux arguments juridiques. D'abord, aux termes de l'article R. 221-3 du code de la route, les examens du permis de conduire « comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports ». Ensuite, l'état actuel du droit montre bien que cette matière relève du domaine réglementaire. C'est ainsi par arrêté du 6 novembre 2009 que les trois gestes à pratiquer en cas d'arrêt cardiaque ont été définis. C'est encore un arrêté ministériel qui a défini le contenu des matières relatives à l'enseignement de la sécurité routière, à la formation et au perfectionnement des conducteurs.
Je vous demande de ne pas écarter d'un revers de main le problème posé par le caractère réglementaire de ces dispositions, car agir en dehors du champ de nos compétences diminue les chances de mener à terme toute initiative parlementaire, aussi bien intentionnée soit elle.
La seconde réserve tient au fait qu'en matière de formation aux premiers secours, nous ne sommes pas en terrain vierge. Notre pays a, depuis quelques années maintenant, pris conscience de son retard. Nous pouvons distinguer au moins trois temps de formation. Le premier est inscrit dans le cursus scolaire : un temps de formation est programmé pour les élèves de troisième. Le second a lieu au cours de la journée défense et citoyenneté. Le troisième, enfin, concerne l'examen même du permis de conduire, puisque la loi du 12 juin 2003 contre les violences routières prévoit déjà une telle mesure. Je cite son article 16 : « Les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de premiers secours. » On notera par ailleurs que l'acquisition de ces notions est déjà prévue par le corpus législatif et réglementaire puisque l'examinateur est en droit d'en vérifier l'assimilation, comme le prévoit l'arrêté du 23 janvier 1989 relatif au programme national de formation à la conduite.
À mon sens, le travail le plus urgent est d'évaluer ces dispositifs, d'en faire le bilan, pour les compléter et les améliorer si besoin. Il importe en effet de voir qui en bénéficie et si les effets positifs ou négatifs peuvent être identifiés. Il est également important d'examiner la complémentarité de ces formations et de voir les points d'amélioration afin de les rendre les plus efficaces possibles.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je suis convaincue que nous prenons le risque d'agir à rebours de nos intentions en mettant en place un nouveau dispositif alors que ceux qui existent déjà attendent encore d'être évalués.
Je m'interroge sur un troisième point, à mes yeux incontournable : le financement de cette mesure. Cette préoccupation rejoint celle, plus générale, du financement du permis de conduire. Je vous rappelle, mes chers collègues, que beaucoup de jeunes et de parents s'endettent pour le passer. Je vous rappelle également que le permis de conduire est très – trop – onéreux alors qu'il est souvent un sésame pour accéder à un travail. Ne risquons-nous pas d'ajouter l'injustice à l'injustice ? Je m'interroge.
Chacun sait ici qu'une formation digne de ce nom a un coût de plusieurs dizaines d'euros. Nous ne pouvons d'un côté dénoncer telle ou telle augmentation des prix, par exemple de l'énergie, et dans le même temps rajouter des charges indirectes qui sont loin d'être indolores, quelle que soit la noblesse du but poursuivi. Soyons en prise avec la réalité de nos concitoyens qui terminent le mois à quelques dizaines d'euros près, et pour qui une charge supplémentaire de 30 ou 40 euros sera une difficulté de plus, réelle ou perçue comme telle. La sécurité n'a peut-être pas de prix, mais elle a un coût que nul ne peut ignorer. Je n'apprendrai à aucun d'entre vous que tous les postes budgétaires enflent et que sur ces sujets, les épidermes sont sensibles car nombre de nos concitoyens souffrent.
À ce surcoût financier, rajoutons que les délais d'examen sont déjà longs et que l'engorgement des candidatures est de notoriété publique : il n'est pas opportun de compliquer une situation déjà très tendue. Je voterai donc contre cette proposition de loi, aussi généreuse soit-elle.
M. le ministre s'est d'ailleurs engagé à dépoussiérer un décret aujourd'hui obsolète et à étudier toutes les formes réglementaires susceptibles d'apporter une vraie réponse à ce qui est un vrai problème. Pour ma part, je vous propose deux axes de réflexion complémentaires.
Le premier, de long terme, a trait à la nécessité de repenser les différentes étapes de formation aux premiers secours. Proposer par tranche d'âge, par niveau scolaire, par étape de vie, une formation cohérente, progressive et coordonnée aux premiers secours me semble être la meilleure garantie d'une formation de qualité, afin que les citoyens aient les réflexes de circonstance et connaissent les gestes adéquats pour faire face à des situations d'urgence.
Le second, plus immédiat, est de faire évoluer le permis de conduire en lui-même sur deux points. Il convient d'abord d'insister, lors des modules de formation, sur la formation aux premiers secours. Il faudrait ensuite rendre obligatoires, parmi les questions de l'examen du code de la route, une ou plusieurs questions portant sur les comportements appropriés pour secourir des personnes en cas d'accident.
Chers collègues, je vous remercie pour votre attention. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous discutons est à la fois simple dans sa forme et positive et incontestable dans sa finalité. Qui ne serait d'accord pour instituer une formation à cinq gestes de base qui doivent sauver ou du moins prévenir une perte de chances de survie en cas d'accident de la circulation ? Personne !
Cette unique disposition pose néanmoins plus de questions qu'elle ne garantit d'effets concrets et durables. Le diable est toujours dans les détails de la mise en oeuvre. Il me semble que trois points affaiblissent les intentions louables de cette proposition de loi.
Tout d'abord, le fait d'instituer une obligation faisant partie de l'examen du permis de conduire ne sera pas sans conséquences sur l'obtention de celui-ci. Un autre choix aurait pu être fait : la formation à la conduite pourrait comporter une initiation au secourisme sans que celle-ci ne participe à l'examen ni ne contribue à l'obtention du permis de conduire. L'important est de partager la connaissance de ces gestes, et de les répandre. L'institution d'une nouvelle obligation pourrait avoir des retentissements pratiques non évalués, notamment sur les délais d'attente de passage de l'examen qui atteignent aujourd'hui près de trois mois pour un nouveau candidat.
D'autre part, sa mise en oeuvre suppose des moyens dont l'ampleur n'est ni objectivée, ni même estimée en ordre de grandeur. Je ne parle pas seulement du coût pour les candidats, mais aussi de l'organisation, des délais et des effets attendus. Plus de 700 000 candidats au permis de conduire seraient en effet concernés chaque année par cette nouvelle épreuve. Vous me répondrez que ces problèmes d'organisation et de moyens sont peu de chose au regard des vies que ce dispositif permettrait, potentiellement, de sauver.
Vous indiquez dans l'exposé des motifs de la proposition de loi que : « La formation aux cinq gestes qui sauvent, spécifique aux accidents de la route, permettra d'acquérir des connaissances réutilisables dans la vie quotidienne en cas d'urgence. »
Vous indiquez que cette mesure est à l'étude depuis bientôt quarante ans… On peut donc se poser la question de savoir pourquoi une mesure aussi juste n'a jamais été mise en place !

Si les gouvernements n'y sont pas arrivés, malgré la justesse de l'analyse, peut-être faut-il prendre le problème par l'autre bout. Ne conviendrait-il pas de faire en sorte que les gestes de secours soient appris au plus grand nombre, pour tous les cas d'urgence de la vie courante, rendant ainsi ces gestes utilisables pour les cas d'accidents de la route, par les conducteurs aussi bien que par les non-conducteurs ? Ces gestes doivent en effet faire partie de l'éducation tout court !
L'enseignement de ces principes simples de secourisme pourrait être décliné, de manière opérationnelle, tout au long de la scolarité des élèves et de la carrière des enseignants. Il semble donc impératif d'enseigner aux futurs citoyens les gestes appropriés pour faire face aux divers risques de la vie courante. Je rappelle que, chaque année, 20 000 personnes décèdent des suites d'un accident de la vie courante, ce qui équivaut malheureusement à quatre fois le nombre des tués sur la route. Il s'agit de développer des conduites autonomes et adaptées, qu'elles soient prévoyantes ou réactives.
Il est tout aussi impératif de faire en sorte que ce qui est déjà prévu par les programmes scolaires soit effectivement mis en oeuvre. Aujourd'hui cette formation donne lieu à la délivrance d'une attestation aux élèves de troisième ayant suivi la formation aux premiers secours. Il est souhaitable que le ministre de l'éducation communique à la représentation nationale une évaluation des progrès, des conditions et des difficultés rencontrées dans cet apprentissage. En axant ainsi nos efforts sur l'éducation, nous pourrons garantir non seulement l'apprentissage de gestes qui préviennent et sauvent, mais aussi leur appropriation concrète et pérenne, leur adaptation dans le temps et leur pertinence par rapport à tous les risques.
Comme cela a bien été rappelé précédemment par notre collègue Marie-Anne Chapdelaine, cette proposition de loi manque vraiment de réflexion et d'approfondissement.

Si elle est intéressante dans son objectif, elle oublie ce qui existe et devrait être amplifié pour tous ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, mesdames, messieurs, le secourisme revêt, en France, comme dans d'autres pays, une véritable dimension sociétale. C'est, sans conteste, une démarche de civisme actif que nous devons soutenir. La formation aux premiers secours encourage les comportements altruistes et favorise la diffusion de valeurs morales fortes. Toutefois, puisque l'objet de notre discussion est l'introduction d'un apprentissage obligatoire des notions élémentaires de premiers secours, dites des cinq gestes qui sauvent, apprentissage qui devrait être sanctionné dans le cadre d'une épreuve spécifique du permis de conduire, j'insisterai, en premier lieu, sur le fait que cet enseignement est déjà très présent dans notre société. Outre que les grands principes des premiers secours – protéger, alerter, secourir – sont déjà enseignés et sanctionnés dans le cadre de l'épreuve de code, obligatoire avant tout apprentissage effectif de la conduite, les ministères de l'éducation nationale, de la défense et de la santé organisent, chacun, un enseignement particulier aux premiers secours.
Le ministère de l'éducation nationale s'est donné pour objectif de développer chez les élèves un comportement civique et solidaire, et ce dès le plus jeune âge. Les lois des 9 et 13 août 2004 sur la santé publique et la sécurité civile ont marqué la volonté de former les élèves pour qu'ils puissent prévenir les situations de danger, se protéger et porter secours. La connaissance des gestes de premiers secours et dès règles de sécurité est, ainsi, inscrite dans le socle commun des connaissances et des compétences que tous les élèves doivent acquérir au cours de leur scolarité obligatoire. Un décret interministériel de 2006 a, d'ailleurs, posé les bases de ce nouveau programme. Il prévoit l'initiation aux premiers secours dès l'école maternelle ; la sensibilisation des élèves du primaire, puis, au collège et au lycée, la formation aux premiers secours, qui peut être sanctionnée par un premier brevet de prévention et de secours : le PSC 1.
Le ministère de la défense, vous l'avez souligné, mes chers collègues, organise l'apprentissage des gestes de premiers secours durant la journée de la défense et de la citoyenneté. Ainsi, 760 000 jeunes sont formés chaque année.
Le ministère de la santé a, quant à lui, lancé une campagne sur les thèmes : alerter, masser, défibriller, campagne souvent relayée par les élus territoriaux qui organisent des actions de sensibilisation.
On constate, donc, que la loi prévoit la sensibilisation et la formation des personnes dès leur plus jeune âge. En dehors des programmes des ministères, des formations aux gestes qui sauvent sont proposées dans les entreprises et les administrations. Si l'article 16 de la loi de 2003 prévoit cette formation dans le cadre du permis de conduire, la détermination de son contenu, comme c'est le cas pour les programmes de l'éducation nationale, relève du domaine réglementaire.
Je ne comprends donc pas que vous ayez déposé cette proposition de loi. Ce n'est, en effet, pas en empilant les textes que nous trouverons une solution à ce problème. La preuve : la loi existe, vous l'avez votée. Vous avez donc eu l'occasion de publier ce décret depuis 2003. Pour ma part, je suis favorable à l'encouragement de la prévention. Nous devons faire en sorte que chaque citoyen soit capable d'intervenir de façon pertinente et de faire les gestes qui sauvent. La formation et la prévention aux premiers secours devraient être l'objet d'une réflexion plus globale. Dans notre pays, une formation ponctuelle n'est évidemment pas suffisante. Nous devrions être en mesure de proposer une politique de formation tout au long de la vie. Les gestes qui sauvent sont organisés par de nombreux ministères. Une meilleure coordination entre eux serait sans doute nécessaire et peut-être devrions-nous y réfléchir.
Pour terminer, je tiens à rappeler, mes chers collègues, que votre candidat, Nicolas Sarkozy, annonçait en avril 2012 une vaste réforme du permis de conduire. Il le jugeait trop long, trop onéreux, et proposait d'associer l'éducation nationale à la formation théorique et de réserver aux écoles de conduite l'apprentissage pratique de la route !
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, je vous demande, mes chers collègues, de ne pas voter ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Je relaterai, en quelques mots, les travaux de la commission des lois, qui n'a pas accepté, comme l'a précisé le rapporteur ce matin, la proposition de loi qui nous est soumise. Je dois dire qu'elle l'a fait avec regret. En effet, comme le ministre l'a souligné et comme l'ont répété les parlementaires qui sont intervenus, ce sujet fait consensus. Nous ne nous interrogeons pas, pour notre part, sur l'objet, mais nous doutons, ce qui nous a amenés à refuser ce texte, de l'outil utilisé pour faire progresser la réglementation.
La commission pense, en effet, que le sujet traité ici ne relève pas du domaine législatif, je vous le rappelle comme je l'ai rappelé aux associations qui m'ont contacté depuis que la commission a rejeté la proposition de loi de notre collègue.
Je tenterai, en donnant trois arguments, d'expliquer notre position, pour que chacun puisse être amplement éclairé, évitant ainsi que ne soit dressé, demain, aucun procès d'intention. Personne ici, au contraire, ne considère que ce sujet ne présente pas de difficulté.
Premier élément : notre collègue nous propose d'insérer les dispositions dans le code de la route. Nous pouvons penser que la chose est légitime dans la mesure où il suffit d'ajouter une modalité à l'examen. Toutefois, les dispositions visées, lesquelles figurent, effectivement, dans la partie législative du code de la route, et qui pourraient justifier un ajustement, sont très spécifiques. Elles concernent en effet les infractions, à savoir : l'interdiction de conduire un véhicule sans permis ou les règles de validité de permis liées, par exemple, au nombre de points ou aux modalités de retrait. Or, ces dispositions relèvent de l'article 34 de la Constitution, qui définit le domaine de la loi, précise les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et détermine les délits et les peines. Il en va différemment des autres aspects du code de la route, figurant dans sa partie réglementaire, et qui définissent les différentes catégories de permis de conduire, l'organisation du contrôle médical à l'aptitude à conduire ou encore les modalités d'enregistrement par le ministère de l'intérieur des informations relatives au permis.
Le dispositif qui nous est proposé vise, en fait, à élever au niveau législatif un article de nature réglementaire. La commission et son président, qui a le privilège de s'exprimer devant vous cet après-midi, ne peuvent pas trouver de justification juridique à cette proposition. La nécessité de ce changement de nature juridique ne nous a pas convaincus.

Nous persistons à penser que les modalités du passage de l'examen du permis de conduire ne relèvent pas du domaine législatif tel qu'il est défini à l'article 34 de la Constitution.
Deuxième élément, on nous cite, pour justifier cette évolution, la loi du 12 juin 2003. Je suis au regret de dire que cet argument ne nous paraît pas plus convaincant. Cette loi visant à renforcer la lutte contre la violence routière prévoit des sensibilisations à des notions élémentaires de premiers secours dans le cadre de la formation des candidats au permis de conduire. Mais – et il y a, évidement, un mais, sinon je n'aurais pas avancé cet argument – cet article est issu d'un amendement parlementaire et n'est pas codifié, contrairement à la plupart des dispositions de la loi. Nous estimons que cette absence de codification est un indice suffisamment lourd de la difficulté juridique qu'aurait soulevé l'examen de codification. En effet, codifier implique d'identifier expressément la nature législative du dispositif. Qui plus est, il est hasardeux d'invoquer, comme l'a fait le rapporteur, une sorte d'effet de cliquet. Ce n'est pas parce que le législateur aurait indûment adopté une mesure de nature réglementaire que celle-ci acquerrait une dimension législative. C'est au demeurant le sens de la procédure de délégalisation prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, auquel je vous renvoie, qui donne compétence au Conseil constitutionnel pour déclarer qu'une disposition législative a, en réalité, valeur réglementaire et qu'elle peut donc être modifiée par décret.
Je vous prie, avant de conclure mon propos, de m'excuser d'avoir été un peu long, mais je souhaitais dissiper l'ensemble des ambiguïtés qui sont apparues depuis que la commission a rejeté le texte.
Je donnerai, en conclusion, un troisième argument : l'état du droit positif, qui démontre, ainsi que d'autres collègues l'ont précisé avant moi, la nature proprement réglementaire des propositions qui nous sont ainsi soumises. Je citerai plusieurs exemples. C'est l'arrêté du 6 novembre 2009, relatif à l'initiation des personnes non médecins à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes, qui prévoit les trois gestes à pratiquer en cas d'arrêt cardiaque, et son article 4 détaille la conduite à tenir devant un arrêt cardiaque : appeler, masser, défibriller.

C'est, peu ou prou, la même démarche qui nous est proposée ici. C'est en effet par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1989 relatif au programme national de formation à la conduite, définissant le contenu des matières relatives à l'enseignement de la sécurité routière, à la formation et au perfectionnement des conducteurs, que la norme a été publiée.
Je pourrais encore signaler que, chaque fois que des formations sont mentionnées, elles le sont dans des textes de nature réglementaire. C'est par un arrêté que sont fixées les modalités de la dispense de formation de base PSC 1 : prévention et secours civique 1. C'est par un décret qu'ont été précisées les modalités d'organisation de la formation aux premiers secours mise en oeuvre dans les établissements scolaires. Inversement, les seuls dispositifs qui figurent dans la loi et qui concernent le secourisme ne sont que des déclarations d'intention, de principe. Je pense à l'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure, qui se contente de prévoir la disposition suivante, peu normative ainsi que chacun en conviendra : « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile et veille à prévenir les services de secours. »
Le ministre a apporté certains éléments permettant de répondre aux aspirations exprimées, mais, quelle que soit l'appréciation que l'on porte sur les intentions des auteurs de la proposition de loi quant au fond, on ne peut que conclure, avec tristesse, au caractère réglementaire du dispositif proposé et, donc, au rejet de la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. Bernard Gérard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Madame la présidente, mesdames, messieurs, je remercie les uns et les autres, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent, pour la qualité de nos débats. Chacun a apporté, dans un respect mutuel, des arguments extrêmement intéressants. Je remercie également Guy Geoffroy et mon collègue du groupe UDI de leur soutien.
Nous ne sommes pas ici pour arbitrer entre procédure réglementaire et procédure législative. Nous sommes là pour apporter une solution que nous attendons depuis trente ans ! Je répondrai aux orateurs, qui ont dit à cette tribune qu'il convenait de se donner le temps de la réflexion, que l'on se le donne depuis trente ans ! Il arrive un moment où nous devons prendre une décision. J'ai beaucoup apprécié les propos de notre collègue Marc Dolez, lequel a rappelé le travail accompli par M. Didier Burggraeve qui sensibilise chacun aux dispositions qu'il convient de prendre depuis les années 1970 ! À M. le président de la commission des lois qui s'interrogeait sur le fait de savoir si cette proposition était d'ordre réglementaire ou législatif et qui a cité l'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure, je répondrai que le législateur a, à de multiples reprises, fait le choix de dépasser le débat strictement juridique pour prendre position et adresser un signal symbolique et très fort sur un sujet majeur pour notre société.
Je reviendrai plus précisément, en présentant mes amendements sur ce qui a été dit, entre autres, sur le prix… Tout cela est réglé. Nous avons procédé à d'innombrables auditions auxquelles Mme Chapdelaine a participé ; elle a pu constater la qualité des interlocuteurs. Ainsi, un ancien président de l'Académie de médecine, encore membre de ladite Académie, nous a expliqué qu'il fallait absolument agir.
Je tiens, pour conclure, à vous lire l'extrait d'une lettre que j'ai reçue le 25 septembre 2012.
De nombreux gouvernements, dit l'auteur de cette lettre, suivant les directives de l'Union européenne, ont déjà mis en pratique un tel prérequis au permis de conduire, et nous pensons depuis plus de quinze ans que la France aurait dû être un précurseur en la matière. Il me confirme ensuite son soutien à cette proposition de loi. Cette lettre est signée par le professeur Jean-François Mattei, ancien ministre, président de la Croix-Rouge française.
Je n'ai eu que des interventions de cette nature. Agissons, de manière réglementaire ou législative, mais de sorte que la question soit une bonne fois réglée ! Nous sommes tous d'accord sur les cinq gestes qui sauvent. Il y a peut-être des ajustements à faire, mais on peut préciser les choses par décret. Trêve d'arguties : il est question de vies humaines. Occupons-nous, non pas de procédure, mais des intérêts des gens. Pardonnez-moi de vous le dire, on doit s'intéresser ici aux problèmes de la population. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Madame la présidente, mesdames, messieurs, je vous prie tout d'abord d'excuser mon absence lors de la discussion générale. J'étais retenu au Sénat et je remercie Mme Fourneyron d'avoir assuré la présence du Gouvernement.
Vous avez tous insisté sur le nombre, toujours trop élevé, de morts sur la route. C'est une préoccupation que nous partageons, qui ne souffre pas de discussions entre nous. À l'instar de l'engagement très fort initié par Jacques Chirac, poursuivi par Nicolas Sarkozy, le Président de la République, François Hollande, souhaite que nous ne relâchions pas les efforts en matière de sécurité routière. J'ai eu l'occasion de le souligner tout à l'heure, nous ne pouvons pas baisser la garde. Cela passe évidemment par la prévention et par l'éducation, ainsi que par une nécessaire répression, mais tel n'est pas l'objet du débat.
Comme l'a souligné le président de la commission des lois, ce texte est d'ordre réglementaire. C'est un débat que nous avons souvent eu ici, que nous avons à contre-courant désormais – c'est la vie – mais tous les législateurs souhaitent que l'on ne confonde pas ce qui est de l'ordre de la loi et ce qui est de l'ordre du règlement. C'est pourquoi j'ai proposé dans mon intervention liminaire des axes d'action pratiques, pragmatiques, sur lesquels nous pouvons nous retrouver.
M. Geoffroy et M. Zumkeller ont soutenu l'initiative de M. Gérard. L'objectif est évidemment louable, et c'est sur le vecteur à utiliser que nous divergeons. M. Dolez reconnaît lui-même qu'il y a une difficulté, même s'il soutient la proposition. Je suis évidemment sensible aux arguments avancés par Mme Chapdelaine, Mme Guittet, Mme Karamanli et M. Molac, qui ont beaucoup insisté sur la formation tout au long de la vie et sur le rôle de l'école. Soyons par ailleurs attentifs au fait que les associations n'ont pas forcément la formation nécessaire pour mener une telle action, ni la capacité d'aller jusqu'au bout de ce que cela requiert. Vous avez eu raison aussi d'insister sur le coût du permis de conduire et sur les délais.
Sur tous ces sujets, j'insiste sur la nécessité de mener des concertations et des consultations. J'ai indiqué ce matin que je vous proposais de renforcer ces thématiques au sein des outils de formation et de sensibilisation qui existent déjà à l'attention des formateurs et des élèves. Cela sera donc développé dans le programme national de formation à la conduite qui doit être prochainement revu et refondu, ainsi que dans les différentes banques de questions utilisées dans les examens, notamment, bien sûr, à l'occasion de l'épreuve théorique de code. Une telle initiative doit être menée en concertation avec les représentants des écoles de conduite et des inspecteurs du permis de conduire, ainsi qu'avec les associations et les usagers.
Sans faire un parallèle direct avec un événement récent, j'ai dû différer la mise en oeuvre de la disposition sanctionnant l'absence d'éthylotest parce qu'il me semble que l'on n'en a pas suffisamment appréhendé l'impact, à la fois sur le plan industriel et du point de vue de la concertation avec les associations qui connaissent bien ces questions. Nous l'avons différée au 1er mars, mais j'ai souhaité une évaluation de la décision et de son impact.
Pour les mesures que vous proposez, monsieur le rapporteur, mieux vaut donc privilégier la concertation et la voie réglementaire plutôt que de nous enfermer dans une logique législative qui ne me semble pas appropriée. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

J'appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement, puisque la commission n'a pas adopté le texte.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 1 à l'article 1er.

Cet amendement prévoit l'insertion du nouveau dispositif de formation dans la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.
La question des différentes composantes des examens du permis de conduire relève de l'article R. 221-3 du code de la route, disposition de nature réglementaire, mais le traitement d'un sujet de sécurité routière a plus sa place dans la loi du 12 juin 2003.
Le dispositif que je vous propose viendra se substituer à l'actuel article 16 de la loi, qui prévoit une simple sensibilisation aux notions élémentaires de premier secours, mesure dont le décret n'a jamais été publié.
On me répond que c'est du domaine réglementaire, mais il y a de très nombreuses dispositions législatives sur la formation aux premiers secours dans notre droit, l'article 16 de la loi du 12 juin 2003, l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation, qui ne prévoit qu'une simple sensibilisation, l'article L. 312-16 du code de l'éducation, qui prévoit un cours d'apprentissage, ou encore l'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure.
Cet amendement permet de régler la question de savoir si c'est du domaine réglementaire ou du domaine législatif.
Défavorable, car cet amendement ne règle pas la question du caractère réglementaire des dispositions proposées instaurant une troisième épreuve du permis de conduire. Les deux épreuves actuelles, code et conduite, sont prévues par des dispositions du code de la route.

Monsieur le rapporteur, vous avez confirmé par le dépôt de cet amendement la pertinence de l'ensemble des arguments avancés par le ministre, le président de la commission des lois et mes collègues de la majorité, qui consacrent l'idée que l'on ne peut introduire dans le dispositif législatif un élément concernant la réglementation de la délivrance du permis de conduire et sanctionnant éventuellement le refus de le délivrer.
Vous avez raison de souligner que la responsabilité de l'Assemblée, c'est d'être moteur, mais la première de nos responsabilités, c'est de faire la loi ; or une loi mal faite, mauvaise, est une loi plus dangereuse, nous le savons.
La loi de juin 2003 tend à lutter contre la violence routière. Ce texte ne peut pas contenir d'éléments susceptibles de conditionner la délivrance du permis de conduire ou même l'accès au permis de conduire à la présentation d'une attestation justifiant d'avoir suivi une telle formation.
Le texte qui nous est proposé ne peut donc pas nous aider à régler le problème de fond soulevé : apprendre à tous les citoyens les gestes de premier secours susceptibles de faire diminuer le nombre des victimes.
Nous avions déposé un texte sur l'initiation des collégiens aux premiers secours, et c'est vous qui aviez rejeté le dispositif. Cette bonne intention, vous la partagez aujourd'hui. Souhaitons que le Gouvernement s'intéresse à ces questions comme il s'y est engagé. La majorité rejettera cet amendement.

Nous avons apprécié le docte exposé du président de la commission, mais je me situerai sur un plan pratique.
Je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais suivi une formation au lycée. En mars dernier, quelqu'un a eu un accident juste devant moi. J'ai téléphoné aux pompiers. Je peux vous affirmer que je ne me souvenais absolument pas de ce que j'avais appris.
Ce que vous proposez ne réglera en rien le problème et rendra simplement le permis encore plus cher. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement.

Je n'ai pas le temps de vous faire, de façon non violente, la réponse que mériterait votre exposé, monsieur le président de la commission des lois, mais, la fragilité de votre argumentaire vous ayant poussé à trop vous appuyer sur le caractère non législatif de la disposition, vous avez dit l'inverse de ce que vous auriez dû dire pour que votre argument soit valable.
Vous vous trompez de cible en parlant des modalités car il s'agit d'un principe : pour être admis au permis de conduire, il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir suivi au préalable une formation aux cinq gestes qui sauvent. Nous sommes donc en plein dans le champ de la loi, qui fixe des conditions pour pouvoir bénéficier d'un droit, en l'occurrence le droit de conduire une automobile après avoir obtenu le permis de conduire.
L'argument selon lequel notre proposition de loi n'est pas de nature législative est d'une telle fragilité que j'insiste, monsieur le ministre, pour que vous mettiez en oeuvre ces dispositions par tous les moyens qui sont en votre pouvoir.

Monsieur Geoffroy, ne nous battons pas quand le sujet ne le mérite pas. Nous sommes d'accord sur la finalité. Le sujet a été évoqué dans cet hémicycle, il y a quelque temps, et vous nous aviez expliqué que c'était de nature réglementaire.

Nous n'étions pas d'accord. Nous avons réfléchi et nous pensons aujourd'hui que vous aviez raison. (Rires. – Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
(L'amendement n° 1 n'est pas adopté.)

Par respect du formalisme, je rappelle que l'amendement que je présente a été rejeté par la commission des lois et que je le présente donc à titre personnel.
Nous demandons que la formation aux notions élémentaires de premier secours et sa validation soient assurées par les associations de secourisme agréées. Nous ne faisons pas appel aux moniteurs d'auto-école ni aux inspecteurs chargés de faire passer le permis de conduire.
Au cours des auditions que nous avons conduites, les organisations de secourisme nous ont précisé que 35 000 moniteurs de premier secours étaient prêts à assurer cette formation, que cela ne posait aucun problème. Le coût se situe entre 20 et 25 euros ; c'est le chiffre que, de manière unanime, on nous a fourni. Cet amendement répond aux questions qui pouvaient se poser quant au coût supplémentaire engendré par cette formation.

M. le rapporteur a précisé que l'avis de la commission était défavorable.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Défavorable également. La validation des connaissances acquises à l'issue d'une formation dispensée par une association de secourisme agréée suscite, je l'ai déjà dit, un certain nombre de réserves. Ces associations ont-elles la capacité de former le million de candidats annuel ? Sans mettre en cause leur travail exceptionnel, j'en doute. Cette solution n'écarte pas non plus le risque important d'allongement des délais d'obtention du permis de conduire. Enfin, l'attestation prise en charge par les candidats renchérira nécessairement le permis. Pour ces raisons et pour celles que j'ai déjà exposées, le Gouvernement est opposé à cet amendement.
(L'amendement n° 2 n'est pas adopté.)
(L'article 1er n'est pas adopté.)

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3 , tendant à supprimer l'article 2.

Il s'agit d'un amendement de conséquence. Compte tenu du rôle des associations de secourisme agréées dans la dispense de la formation, la loi que je propose n'engendre pas de charges nouvelles pour l'État. La commission des finances l'a d'ailleurs reconnu.

Dans un souci d'ouverture, nous sommes prêts à voter cet amendement. (Rires.)

Je propose néanmoins à notre rapporteur de le retirer, s'il veut que la proposition conserve sa pertinence…

M. Le Bouillonnec a bien compris qu'en votant contre cet amendement la majorité dirait une chose et son contraire, et que ce serait très ennuyeux, mais ce n'est pas une raison pour retirer cet excellent amendement.

Non, madame la présidente.
(L'amendement n° 3 est adopté et l'article 2 est ainsi supprimé.)

Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles de la proposition de loi.
L'Assemblée ayant rejeté tous les articles de la proposition, il n'y aura pas lieu de procéder au vote solennel décidé par la conférence des présidents.
Article 2

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures vingt-cinq.)


Madame la présidente, monsieur le ministre délégué – que nous serons très heureux d'entendre –, monsieur le président de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, la proposition de loi que j'ai l'honneur de défendre devant vous, et de rapporter, la commission ayant bien voulu me désigner comme rapporteur, traite de la localisation des centres d'appel.
Au-delà de ce sujet, la vraie préoccupation de nos concitoyens, c'est le risque de délocalisation de l'emploi, du départ des emplois vers l'étranger. Ce risque, ils le voient, ils le vivent, et les médias relatent de multiples difficultés liées au monde de l'industrie. Il n'empêche que le monde des services est également concerné, de manière souvent plus insidieuse, moins spectaculaire mais tout aussi massive. C'est pourquoi il faut que nous réagissions. De ce point de vue, les centres d'appel sont emblématiques.
Ma solution, ma proposition est très modeste et en même temps relativement ambitieuse : créer dans le monde des services un made in France, que nous pourrons étendre à toutes sortes de secteurs, en particulier le transport de marchandises. Aujourd'hui, par le cabotage, n'importe quel camionneur issu de pays d'Europe orientale peut circuler dans notre pays. Il n'existe pas l'équivalent d'un made in France. Imaginons ce label dans le domaine des services ; c'est le but de la présente proposition de loi.
Elle concerne les centres d'appel. Ce domaine, c'est d'abord du monde : 275 000 salariés dans notre pays, dont 200 000 font partie des entreprises, et sont donc peut-être un peu moins concernés par le sujet, et 75 000 sont externalisés en France : les donneurs d'ordre font appel à des entreprises spécialisées, et réparties sur l'ensemble du territoire.
Comparons ces chiffres avec ceux d'autres pays européens. En Allemagne, le nombre de personnes travaillant dans des centres d'appel est de 600 000, en Grande-Bretagne d'un million. La différence apparaît aussi au niveau des coûts, des salaires, et des charges, puisque l'essentiel du coût dans ces métiers est un coût de main-d'oeuvre. En France, on parle de 28 euros de l'heure pour les centres d'appel externalisés, en Allemagne de 24 euros et en Grande-Bretagne de 22 euros. On aborde un sujet bien français, celui du coût du travail. J'ai noté, monsieur le ministre délégué, que ce sujet, censuré encore il y a peu par le Gouvernement, était désormais admis dans le débat, et je m'en réjouis.
Ces emplois sont certes modestes, je veux bien en convenir, et offrent peu de perspectives de développement, ce que l'on peut regretter.
Mais ce sont de vrais emplois, généralement en CDI, qui bénéficient à des jeunes et qui se sont multipliés ces dernières années dans l'ensemble de nos régions, et si nous avons de telles perspectives d'emplois chez nous, nous nous en réjouissons et sommes les premiers, tous autant que nous sommes, à aller rechercher les donneurs d'ordre des entreprises susceptibles de les créer.
Le problème, c'est que se sont développés récemment, à côté des emplois en France, des emplois à l'étranger, essentiellement au Maroc, en Tunisie, à l'île Maurice et en Roumanie, mais aussi, dans une certaine mesure, en Espagne, voire en Inde. On peut les évaluer à 60 000 postes. Il s'agit de locuteurs utilisant la langue française, qui téléphonent principalement à des clients établis en France. Eux-mêmes sont salariés d'entreprises françaises, mais qui se sont développées à l'étranger au détriment d'un développement en France. Il y a là une véritable difficulté dont nos concitoyens sont parfaitement conscients.
Avec le concours de l'administrateur qui m'a été affecté et que je salue et remercie, nous avons auditionné les donneurs d'ordre, les entreprises concernées, les syndicats, et je peux vous dire une chose très simple : avant ses auditions, j'étais inquiet… Depuis, je suis objectivement terrorisé !

Rien ne retient et rien ne retiendra, demain, ces emplois en France. Dans le domaine des biens, monsieur le président de la commission, il y a un coût et un délai de transport, ainsi qu'une incertitude, alors que, dans celui des services, rien n'arrête les délocalisations. Le rapport entre le coût du travail en France et le coût du travail dans ces pays – où d'ailleurs l'on arrive à trouver une main-d'oeuvre de qualité, plutôt bien formée en termes universitaires – est au mieux du simple au double, et le plus souvent du simple au triple.
C'est dire que nous assistons à un vrai risque : celui d'un départ massif. J'appelle les uns et les autres à prendre leurs responsabilités. Je pense en particulier à l'entreprise Téléperformance, qui est, peu de gens le savent, le leader mondial dans ce domaine. Elle salarie plus de 100 000 personnes sur tous les continents, mais désormais moins de 4 500 en France ! C'est dire que l'activité nationale de ce leader mondial est aujourd'hui marginale, déficitaire comme ils nous l'ont expliqué et, à terme, vraisemblablement condamnée. Sommes-nous voués à avoir des leaders mondiaux pour lesquels l'activité sur notre territoire serait secondaire, marginale, et dont le devenir serait plus qu'incertain ?
Voilà les questions que je pose dans mon rapport.
Quelles sont les réponses qui nous ont été faites ?
Voilà la question !

Je salue la venue de M. le ministre chargé des relations avec notre parlement.
Quelles sont, demandais-je, les réponses qui ont été proposées ?
Il y a eu des réponses professionnelles, avec des efforts en termes de chartes de qualité.
Et puis il y a une réponse qui s'esquisse, consistant à réserver à la France la niche de la clientèle la plus exigeante, à lui offrir un service franco-français, et tant pis pour le reste. Je suis toujours un peu réservé devant ce genre d'attitude, qui voudrait dire que nous justifions le départ de l'essentiel des centres d'appels pour conserver, momentanément sans doute, la clientèle la plus exigeante.
Quant à la réponse européenne qu'on aurait pu attendre, elle n'est pas encore venue à ce jour. Je n'ai connaissance ni de démarches, ni de volonté manifestée par l'Europe, ni de la moindre réflexion de sa part sur ces vraies questions et sur ce vrai risque.
Par ailleurs, les pouvoirs publics ont apporté différentes réponses qu'il convient de saluer : dès 2004, le problème a été posé ; lors de la dernière législature, nous avons beaucoup évoqué les questions liées à PACITEL, mais c'est un autre sujet puisqu'il s'agissait surtout de lutter contre ce que bon nombre de nos compatriotes perçoivent comme une agression téléphonique, à savoir le fait d'être rappelé trop fréquemment.
La solution que je propose est très simple, monsieur le ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Je rappelle qu'il existe un made in France dans le domaine des biens : on sait, lorsqu'on achète une voiture made in France, qu'au moins ses pièces ont été assemblées dans notre pays ; ce made in France peut certes poser des problèmes, mais au moins il existe. Imaginons une disposition analogue dans le domaine des services. Je forme le voeu que ce nouveau made in France aboutira à une forme de patriotisme économique, et au moins le consommateur s'interrogera-t-il. Bien souvent, il se croit gagnant en faisant appel à des services bon marché réalisés à l'étranger et il l'est peut-être momentanément, mais ce gain est illusoire car on sait bien qu'il est conditionné par la perte d'emplois en France. Créons clairement un made in France.
Et puis, derrière la question des centres d'appels, il y a celle des services publics. Je reviens à un sujet qui a fait l'actualité cet été : le STIF. C'est un établissement public, dont le président relève de la région Île-de-France, qui rend un certain nombre de services sociaux destinés à une clientèle en difficulté face au monde des transports. Naguère, le STIF faisait travailler des centres d'appel situés en Vendée et en Moselle – quatre-vingts salariés –, et du jour au lendemain, du fait d'un appel d'offres, il a décidé de supprimer ces emplois et de délocaliser l'essentiel de l'activité au Maroc. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe SRC.)

C'est le vrai sujet. Cela vous gêne, mais c'est la réalité, auditionnez les personnes concernées. Premier temps : une émotion bien compréhensible. Deuxième temps : le 31 juillet, dans cette enceinte, M. Montebourg disait qu'il allait en parler au président Huchon et remonter jusqu'au Président de la République. C'était le temps des gesticulations. (Mêmes mouvements.)

Troisième temps : inaction ! Rien ne s'est passé, ni sur le contrat ni en termes de réponse législative ou réglementaire, strictement rien. Émotion, gesticulations, inaction : cette valse en trois temps, les Français ne la supportent plus !

Réécriture de l'histoire ! Ce n'est pas le STIF qui délocalise, mais les entreprises !

À notre niveau, quelles sont les réponses que l'on peut apporter en la matière ? Il faut que nous soyons plus exigeants parce que, vous l'avez bien compris, le STIF a fait sauter une barrière : c'est le premier service public qui délocalise ses centres d'appels à l'étranger, et des réflexions analogues peuvent demain aboutir au même résultat pour l'URSSAF, pour Pôle Emploi, etc. Il y a des centaines, voire des milliers d'emplois en jeu ! Le Gouvernement, avec quelques raisons, va être de plus en plus exigeant en termes financiers à l'égard de ses services publics, et je crains qu'une telle exigence se traduise par le même arbitrage, d'autant que les entreprises spécialisées le lui proposeront : réduire un coût en transférant un certain nombre d'emplois à l'étranger.
C'est pourquoi je propose un dispositif très simple : afin que le consommateur, l'usager, le client, sache à qui il a affaire, il faut que, lorsqu'il appelle, il entende très clairement un message lui indiquant le lieu où aboutit son appel.

C'est quelque chose de très simple qui aboutirait, je l'espère, à une prise de conscience.
Derrière cette affaire des centres d'appels, qui apparaît peut-être d'une ampleur limitée à certains, il y a un vrai problème de maintien de l'emploi et des services dans notre pays. Si nous n'avons pas ce type de réponses, nous échouerons, monsieur le ministre. Celle que je propose est pleine d'humilité, je n'ai pas le sentiment d'avoir la réponse majuscule, mais il est indispensable que nous prenions conscience de la difficulté qui se pose et que nous sachions au moins informer les uns et les autres en termes de traçabilité pour que les usagers sachent qu'elles sont les conséquences de leurs choix et qu'ainsi ils soient responsabilisés ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

…mais il est logique que j'en dise deux mots.
Notre rapporteur a beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, mais nous sommes là dans le syndrome du pompier pyromane.

Premier temps : libéralisation en créant une quatrième licence dans un secteur où le marché est contraint, et en mettant donc la pression sur l'ensemble des opérateurs. Deuxième temps : dérégulation – je rappelle que rien, dans la loi de modernisation de l'économie, n'est venu aménager le code des marchés publics, alors que nous avions fait à l'époque des propositions qui n'ont jamais été entendues. Troisième temps : pognon, car l'on a demandé à l'opérateur entrant de payer le maximum, afin d'apporter à l'État quelques subsides dont il avait légitimement besoin – mais pognon sans conditions. Pardonnez-moi d'être un peu trivial, monsieur le rapporteur,…

…mais vous et votre majorité de l'époque avez récolté ce que vous avez semé. Vous êtes face à une tempête, et vous ne savez comment vous en exonérez puisque vous êtes à l'origine de tout. Vous tous de l'UMP, vous avez mis en place un système qui a généré des comportements anti-emploi. Il faut donc tout reprendre à zéro. Vous avez mis la France dans un état tel, dans un état qui encourage toutes les délocalisations, que vous essayez de vous faire pardonner, de chercher une porte de sortie en disant : « C'est la faute des autres. » Non, monsieur le rapporteur : je rappelle que la dérégulation, c'est chez vous, la libéralisation, c'est chez vous, et la demande de pognon extravagante, c'est aussi chez vous. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Aujourd'hui, vous nous proposez une solution inacceptable, anecdotique, et qui ne règle pas durablement le problème. C'est la raison pour laquelle la commission n'a pas adopté ce rapport. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

La parole est à M. le ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, je vais essayer de répondre de la manière la plus complète possible sur ce qu'est la stratégie et la politique du Gouvernement en matière de lutte contre les délocalisations, y compris s'agissant de celle des centres d'appels, qui suscite une émotion sincère chez nombre de nos concitoyens, et sur la façon dont on peut construire une stratégie globale dans ce domaine.
Mais, au préalable, je veux rappeler que la lutte contre les délocalisations ne date pas d'aujourd'hui et que plusieurs solutions auraient pu être utilement évoquées dans le débat public et dans le débat européen, d'autant que, nous le savons, il y a peu d'instruments très efficaces.
Dans l'Union européenne, dès lors qu'il y a des délocalisations, on sait que le principal instrument, c'est l'harmonisation fiscale. Le sujet n'a pas été à l'ordre du jour du Conseil depuis très longtemps, mais, sans une telle harmonisation, il continuera d'y avoir des tentatives de dumping fiscal qui favoriseront les délocalisations. On ne peut pas dire, mesdames et messieurs les députés, que le précédent quinquennat se soit illustré par un grand volontarisme en matière d'harmonisation fiscale. Monsieur Le Fur, mieux vaudrait, pour vous et vos collègues, assumer les positions qui étaient les vôtres : vous n'y étiez pas favorables. C'est parfaitement respectable, mais vous avez laissé faire les délocalisations en très grand nombre.
La deuxième solution porte sur les délocalisations hors de l'Union européenne : il s'agit de savoir quels sont les instruments que l'on peut mobiliser aux frontières de l'Union pour lutter contre. Le premier, découvert par Nicolas Sarkozy sur le tard, pendant la campagne présidentielle, quand nos industries le réclamaient depuis longtemps, c'est la mise en oeuvre de la réciprocité commerciale, du principe selon lequel, dans les accords de l'OMC, on s'engage à appliquer ici les règles que l'on accepte ailleurs ; sinon nos entreprises perdent des contrats à l'étranger et également ici. Vous avez évoqué l'Île-de-France, monsieur Le Fur : regardez quelle a été la situation d'Alstom face à Bombardier au regard d'une concurrence déloyale liée à l'absence de réciprocité entre le Canada d'une part, la France et l'Union européenne d'autre part. Vous verrez que c'est un sujet important. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec le principe de réciprocité, puisque l'ex-président de la République s'y était lui-même converti.
Dernier point en matière de lutte globale contre les délocalisations : nous promouvons le principe du juste échange. Aux frontières de l'Union européenne, grâce aux tarifs extérieurs communs – par le biais de ce qui pourrait être une fiscalité écologique par exemple –, on pourrait agir à l'égard des importations de produits qui ne respectent pas les normes les plus élémentaires en matière sociale et environnementale. Encore une solution que nous avons mise en débat et qu'il aurait été bien inspiré, de la part de la majorité de l'époque, d'évoquer plus tôt. Mais si vous voulez vous convertir à des thèses que vous avez combattues, bienvenu sur ces lignes politiques-là.
L'actualité récente, les perspectives de suppressions d'emplois par certains opérateurs de télécoms, que vous avez eu raison d'évoquer, monsieur Le Fur, et la possibilité de faire figurer dans des marchés publics des dispositions sur le lieu de production de la prestation, ont a mis sur le devant de la scène la problématique des centres d'appels. Cela ne concerne d'ailleurs pas seulement le secteur des télécoms, mais aussi la vente à distance et le suivi clientèle, quel que soit le champ d'intervention.
Vous avez rappelé à juste titre, et chacun ici le reconnaîtra, que, s'agissant des centres d'appels, la situation est la suivante : la France compte environ 3 500 centres de relation client employant près de 275 000 salariés ; 60 000 d'entre eux sont basés à l'étranger, hors des frontières de l'Union européenne.
Pour expliquer cette situation, plusieurs facteurs ont pu jouer. Dans les télécoms notamment, l'arrivée d'un quatrième opérateur a certes pu déstabiliser le modèle, mais elle a également, il faut le reconnaître, créé de l'emploi et permis une baisse importante des prix dans un contexte délicat de pouvoir d'achat. Du point de vue du consommateur, le jeu de la concurrence a eu du bon puisqu'il a permis une réduction de ces dépenses incompressibles que sont celles de la téléphonie.
La situation n'est pas aussi univoque que certaines thèses semblent l'affirmer. Ce marché, comme tous les autres, évolue en fonction de ses dynamiques propres liées aux coûts de production, aux innovations, aux investissements des opérateurs et aux attentes des consommateurs.
Face à cette complexité, vous avez choisi de répondre par une forme de simplisme et par des faux-semblants. Je comprends la motivation et je ne mets pas en doute la sincérité de vos intentions. À cet égard, j'espère que je pourrai compter sur votre soutien lorsque, l'année prochaine, nous évoquerons l'extension des indications géographiques aux produits manufacturés, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la consommation que je porterai.
Le Gouvernement propose cette extension géographique afin de protéger nos produits manufacturés, ceux que nous fabriquons sur nos territoires, et de répondre au problème d'une ville comme Laguiole, par exemple, qui se retrouve dans la situation que l'on connaît. C'est la volonté du Gouvernement et je serai heureux de solliciter vos avis sur ce sujet.
Pourquoi dis-je que votre texte manifeste une forme de simplisme ? Cette proposition de loi, qui vise à ce que la localisation d'un centre de service client d'une entreprise installée sur le territoire français soit identifiable pour tout appel reçu ou émis avant tout contact avec un téléconseiller, stigmatise en fait ceux qui travaillent à l'étranger.
De ce point de vue, l'exposé des motifs a au moins le mérite d'être clair. La phrase suivante a particulièrement retenu mon attention : « Beaucoup de nos concitoyens ont fait l'expérience de ces centres d'appels délocalisés où tenter de résoudre un problème ou d'obtenir une réponse relève de l'exploit face à un interlocuteur manifestement peu usager de la langue française. »
Je ne crois pas que ce moyen permettra de rapatrier un seul emploi en France et encore moins d'améliorer la situation des télécoms dans notre pays.
Venons-en aux faux-semblants.
Cette mesure n'est pas conforme au droit communautaire,…
…et vous le savez bien car ce sont vos amis politiques, hier au pouvoir, qui l'ont fait expertiser. Dois-je vous rappeler qu'en 2004, Nicolas Sarkozy, alors ministre, avait voulu la mettre en oeuvre et que Jacques Chirac le lui avait interdit ?
Dois-je vous rappeler que M. Novelli, en 2010, avait voulu mettre en oeuvre la même proposition avant d'y renoncer, parce qu'elle contrevenait à nos engagements internationaux et au droit communautaire ? Mesdames et messieurs de l'opposition, 2010, ce n'est pas très vieux. Je suis surpris que vous ne sollicitiez pas celles et ceux qui, gouvernant en votre nom, avaient renoncé à mettre en oeuvre une telle réforme sur les conseils de leurs propres services, qui la jugeaient contraire au droit communautaire.
Cette mesure est une entrave à la libre prestation de service et à la liberté d'établissement. C'est aussi et surtout une atteinte au principe de non-discrimination selon la nationalité ou la résidence, prévu par le droit communautaire. Cette proposition de loi pose également le problème de l'application de la législation de notre pays à une entreprise installée à l'étranger.
Je pense que vous saviez tout cela. Votre proposition de loi répond à la question de la délocalisation par la stigmatisation des travailleurs à l'étranger.
C'est une mauvaise réponse.
Pour sa part, le Gouvernement entend agir dans la durée, avec des solutions pérennes et de la méthode – excusez-nous d'en faire preuve.
Le Gouvernement entend développer un plan interministériel donnant une impulsion nouvelle à l'emploi et à l'investissement dans les télécoms. Il a été annoncé avant-hier par Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin, et j'y prendrai ma part pour toutes les dimensions liées à la protection des consommateurs.
Ces mesures visent à ce que le secteur renoue avec l'investissement et la création d'emplois en France. Elles portent sur l'incitation de chacun à investir dans les réseaux mobiles, sur l'accélération du déploiement du très haut débit mobile dit 4G, sur le niveau d'emplois en France dans le secteur de la relation client – ce qui est votre préoccupation, monsieur le député –, et enfin sur les modes de commercialisation des terminaux mobiles.
Première priorité : l'investissement.
Le Gouvernement a décidé de rendre le processus de déploiement des opérateurs plus transparent par la mise en place d'un observatoire des investissements et des déploiements dans les réseaux mobiles. Cet observatoire s'appuiera sur l'expertise conjointe de l'Agence nationale des fréquences et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
La première publication, d'ici à la fin du mois d'octobre, portera sur le déploiement des réseaux des opérateurs en 3G à la fin du troisième trimestre 2012. Cet observatoire intégrera ensuite, progressivement, d'une part, les déploiements en très haut débit mobile 4G et, d'autre part, les montants d'investissements des quatre opérateurs mobiles sur la base d'une nomenclature commune.
Deuxième priorité : maîtriser le recours à l'itinérance et à la mutualisation.
Le déploiement des réseaux doit trouver un équilibre entre l'investissement de tous et la mutualisation des réseaux pour la couverture des territoires les moins rentables, que cette mutualisation se fasse sous la forme d'accords d'itinérance ou de partage d'infrastructures.
Le Gouvernement considère qu'en dehors des zones les moins denses du territoire, le déploiement par chaque opérateur de son propre réseau doit être la règle, y compris pour le dernier entrant. En particulier, le recours à l'itinérance ne saurait servir de modèle économique et ne peut donc se concevoir que de manière transitoire, en tout cas dans les zones denses.
Le Gouvernement publiera, dès 2013, les lignes directrices sur les conditions de mutualisation et d'itinérance permettant d'assurer au secteur un environnement réellement incitatif à l'investissement et à même de répondre aux enjeux de couverture des territoires les moins denses dans des délais adaptés et avec un haut niveau de service. Ces lignes directrices s'appuieront sur les recommandations de l'Autorité de la concurrence, que le Gouvernement saisit pour avis.
Troisième priorité : accélérer au bénéfice de l'emploi le déploiement de la 4G.
Le Gouvernement est mobilisé pour accélérer le déploiement du très haut débit mobile. Ces investissements, comme la grande majorité de ceux qui sont réalisés dans le secteur des télécoms, sont créateurs d'emplois non délocalisables.
Trois chantiers mobilisent le Gouvernement.
Sur les fréquences 2,6 gigaherz attribuées en septembre 2011, une première étape a été franchie avec l'accélération du calendrier de libération de ces fréquences par la direction générale de l'aviation civile. Dans ces conditions, les opérateurs sont en mesure d'anticiper sur les déploiements 4G initialement prévus et d'envisager une ouverture commerciale dans les prochains mois, ce qui est une bonne nouvelle.
Sur les fréquences 800 mégahertz, fréquences « en or » issues du premier dividende numérique attribuées en décembre dernier, la table ronde de juillet dernier a été l'occasion de mobiliser Orange, SFR et Bouygues Télécom pour traiter les éventuels cas de brouillage qui pourraient apparaître eu égard à la proximité avec les fréquences audiovisuelles. Les opérateurs se sont ainsi rapidement organisés pour mener une expérimentation à Saint-Étienne. Le Gouvernement entend désormais donner mandat à l'Agence nationale des fréquences pour proposer puis mettre en place une structure s'appuyant sur la contribution des trois opérateurs et permettant de traiter les cas de brouillages éventuels, ouvrant ainsi la voie à un déploiement à une échelle industrielle dans la bande 800 mégahertz.
Sur les fréquences 1 800 mégahertz et les conditions de leur ouverture à la 4G, le Gouvernement et l'ARCEP étudient conjointement dans quelle mesure une ouverture prochaine pourrait, le cas échéant, être compatible avec le bon fonctionnement du secteur. Ces travaux déboucheront en début d'année prochaine sur l'établissement d'un calendrier et la fixation d'un niveau de redevances.
Le Gouvernement, dont je me fais aujourd'hui le porte-parole, n'entend pas opposer professionnels et consommateurs. Nous marcherons sur nos deux jambes. C'est le sens de ma présence ici pour porter la parole du Gouvernement sur le sujet et compléter les annonces faites par Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin il y a quelques jours.
Quatrième priorité : mobiliser l'ensemble des leviers disponibles – c'est votre préoccupation, je crois, monsieur Le Fur – pour le maintien et la création d'emplois dans la relation client en France.
Les chantiers suivants seront ouverts.
Celui de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, par le biais d'un label garantissant que l'opérateur respecte un niveau minimal d'emplois localisés en France dans la relation client au sein de son entreprise et de ses sous-traitants.
Celui de l'accroissement de la qualité de service dans la relation client, qui serait susceptible de générer de l'emploi dans ce secteur, par exemple au travers d'offres premium. Ayant compris que vous considériez que c'était insuffisant, j'insiste sur un point : il n'est absolument pas question de remettre en cause l'accès gratuit à l'assistance technique pour les hot lines, mais si certains opérateurs veulent créer une offre premium qui garantisse les créations d'emplois en France et qui soit payante, nous les invitons évidemment à le faire. Cela peut être une excellente initiative.
Enfin, celui de l'utilisation du critère d'emploi dans les critères d'attribution des fréquences ou dans les redevances d'occupation du domaine public hertzien, au travers des engagements volontaires que pourraient être amenés à prendre les opérateurs, par exemple en termes de nombre de créations d'emplois et de part des emplois localisés en France dans le segment de la relation client.
Ce dernier point pourrait, le cas échéant, être mis à profit dans le cadre de l'utilisation des fréquences 1 800 mégahertz pour la 4G. Le comité stratégique de filière du numérique, issu de la conférence nationale de l'industrie, sera saisi pour faire des propositions en ce sens d'ici la fin de l'année.
Pour ma part, j'ai saisi aujourd'hui même le Conseil national de la consommation de la question de l'accroissement de la qualité de service dans la relation client, qui devra conforter les consommateurs dans leurs droits à un service client gratuit et de qualité. À l'occasion de l'examen de cette proposition de loi, je répète qu'il n'est pas question de dégrader les acquis des consommateurs dans le domaine des télécoms. Ces acquis sont largement défendus par les associations de consommateurs, et à juste titre.
Cinquième et dernière priorité : accompagner la réflexion sur le modèle économique du secteur.
Le Gouvernement entend accompagner la politique commerciale des opérateurs en matière de terminaux. Une instruction est en cours pour définir d'ici à janvier 2013, en concertation avec les acteurs de la filière et les associations de consommateurs, d'éventuelles évolutions réglementaires qui permettraient à la fois la sécurisation juridique du modèle de subventionnement des terminaux et une possible modération du rythme de renouvellement des terminaux.
L'objectif est de permettre un réajustement du partage de la valeur entre les opérateurs français et les fournisseurs de terminaux, dans le plein respect de l'intérêt des consommateurs. Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies associera donc les associations de consommateurs à ses réflexions, car le Gouvernement a entendu leurs préoccupations en la matière.
Le Gouvernement envisage d'autres types d'action qui dépassent le seul secteur des télécoms.
Vous avez rappelé et mis à votre crédit la réflexion sur le « produire en France ». Nous la partageons, et nous allons essayer de faire en sorte de lui donner un contenu véritable. À la suite du rapport remis par Louis Gallois, début novembre, le Gouvernement annoncera des mesures pour renforcer la compétitivité de notre économie. Vous aurez, mesdames et messieurs les députés, l'occasion d'évoquer cette question.
Par ailleurs, ainsi que je l'ai annoncé la semaine passée, je proposerai une réflexion et l'inscription de l'extension des indications géographiques…
…aux produits manufacturés, dans un travail mené avec Mme Pinel et M. Montebourg. Il s'agit de créer un vrai made in France.
Parce que les consommateurs sont attachés aux repères de qualité que constitue un marquage d'origine de nos productions, je souhaite que nous puissions aller au bout de cette réflexion à l'occasion de l'examen du projet de loi sur la consommation, et que nous instaurions ce qui pourrait être un label France pour beaucoup de nos produits manufacturés.
Afin de préciser l'information que les consommateurs sont en droit d'attendre, je propose, comme l'a souhaité la majorité socialiste du Sénat, d'étendre cette indication géographique, au-delà des seuls produits naturels, à une série de produits manufacturés qu'il conviendra de déterminer ici.
Il conviendra aussi de déterminer les process et les critères de territorialisation, pour faire de cette indication géographique un vrai avantage pour nos productions locales, un moyen de les maintenir voire de les relocaliser. Ce sera un vecteur de développement économique, mais aussi d'aménagement du territoire. J'imagine que, sur ces bancs, personne n'est opposé à un tel objectif.
Il reviendra à l'État d'homologuer les cahiers des charges pour les protéger. Au préalable, il aura fallu que les producteurs qui ont souhaité définir une indication géographique parviennent à un consensus sur sa définition.
Telle est, monsieur Le Fur, la position du Gouvernement. Il faut faire attention aux conséquences d'une proposition de loi comme la vôtre qui labelliserait négativement certains opérateurs au motif que leurs centres d'appels seraient à l'étranger.
Je vous invite à regarder le travail remarquable qui est fait par ma collègue Nicole Bricq sur la co-localisation : un développement conjoint d'activités en France et dans un pays partenaire en jouant sur les complémentarités de gammes, de services, de compétences. C'est permettre à notre économie de se développer en mettant en avant ses forces et en la protégeant de ses faiblesses. C'est bien cela que le Gouvernement compte faire et non – comme vous le proposez – prendre une mesure qui n'aura aucun impact sur la relocalisation d'emplois et qui risque de stigmatiser ceux qui travaillent à l'étranger. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau.

Monsieur le ministre, j'ai bien entendu tout ce que vous allez demander aux opérateurs, que nous connaissons bien, de produire. C'est dommage que M. Montebourg et Mme Pellerin n'aient pas pu empêcher la fermeture de l'usine Technicolor d'Angers, où 350 salariés possèdent un véritable savoir-faire. Avec tout ce que vous avez prévu de mettre en production en France, nous aurions pu partager les ateliers de cette usine.
La proposition de loi présentée par notre collègue Marc Le Fur portant obligation d'informer de la localisation des centres d'appels vise à renforcer l'information des consommateurs sur les risques de délocalisation des emplois qui leur sont liés. Ce n'est ni plus ni moins, monsieur le ministre, que de la traçabilité, comme celle que vous comptez mettre en place d'ici un an sur les produits importés.
Il s'agit d'une mesure très simple et concrète qui répond à des préoccupations immédiates en termes d'emplois. C'est pourquoi le groupe UMP a tenu à inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de sa première journée d'initiative parlementaire.
Un peu de redite ne fait pas de mal…

En France, les centres d'appels emploient 275 000 salariés et ce sont environ 60 000 autres emplois qui sont délocalisés. En outre, 75 % de ces centres d'appels sont internes aux entreprises ou aux administrations, les 25 % restants sont externalisés en France. On constate cependant que le recours à la délocalisation est en constante augmentation. Pourquoi ? Parce que le coût moyen horaire d'un téléconseiller est aujourd'hui de 28 € en France contre 24 € en Allemagne, 22 € au Royaume-Uni, 15 € au Maghreb et 2,80 € en Inde, soit dix fois moins qu'en France.
La flexibilité du droit du travail, non moins importante que le coût du travail, permet à nos voisins une amplitude horaire sur la journée bien plus grande et du travail en fin de semaine. Chez eux, ce n'est pas un rêve, ni même un rêve réenchanté, c'est la réalité.
Je ne reviendrai pas sur la société Téléperformance, évoquée par Marc Le Fur. Le seul endroit où elle perd de l'argent, c'est en France, avec ses 4 500 emplois. On ne peut non plus discuter de cette proposition de loi sans rappeler ce qui s'est passé en juillet dernier en Île de France. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France présidé par le président socialiste de la région, Jean-Paul Huchon, avait alors décidé d'attribuer un marché public pour la plateforme téléphonique du dispositif solidarité transport à une société dont le centre d'appels est installé au Maroc.

Cette prestation était auparavant assurée par une société employant 80 personnes en France, réparties dans deux centres d'appel, en Moselle et en Vendée. Alors qu'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, a exigé que le STIF annule ce marché pour permettre de sauver les emplois localisés en France, le Président de la République a soutenu Jean-Paul Huchon, considérant que les règles relatives aux marchés publics avaient été respectées. D'après l'AFP, le Président de la République a également déclaré : « Ensuite, c'est à chaque responsable public, en fonction des règles qui existent, des règles de la concurrence, à faire autant qu'il est possible prévaloir le travail en France. » Quand on peut, donc.

« Je ne suis pas favorable à ce que nous entrions dans une surenchère protectionniste », a souligné le Président Hollande. « Je demande à tous les responsables publics, où qu'ils se situent, même s'ils ne sont pas dans la sphère étatique, et donc les collectivités locales, d'être très attentifs. »
Ce n'est plus du redressement productif : j'appelle cela du redressement de bretelles !

Mais ce que je demanderais au Président de la République, c'est de faire en sorte que l'administration accompagne les entreprises plutôt que se contenter de les contrôler.
Il appartenait pourtant au STIF d'indiquer les critères retenus pour l'attribution de ce marché, car c'est bien cela, la logique du mieux-disant. Si le code des marchés publics interdit de retenir des critères de préférence géographique, il permet néanmoins la prise en compte des objectifs de développement durable et d'exigences sociales, telles que l'insertion professionnelle des publics en difficulté. D'autres critères auraient également pu être identifiés dans ce marché, comme la sécurité des installations téléphoniques, la capacité d'intervention rapide sur site ou la compatibilité avec les règles posées par la CNIL en matière de transfert et de protection des données personnelles.
On constate bien là une incohérence du Gouvernement dans sa politique d'emploi. On ne peut à la fois soutenir une politique prétendument viable, créatrice d'emplois, et favoriser les délocalisations par la voix même du Président de la République ! À moins que ce ne soit une reconnaissance implicite de notre déficit de compétitivité par rapport aux pays émergents et du caractère trop élevé du coût du travail en France. Cela laisserait présager, à l'instar du mouvement des Pigeons – ou des « Geonpis », comme on dirait sur Twitter –, une libération des énergies et une facilitation de toutes les actions qui génèrent du travail. Faut-il rappeler que la France a besoin aujourd'hui de tous les entrepreneurs et de toutes les entreprises pour créer de l'activité, du travail et donc de l'emploi ? Car qu'est-ce qui crée de l'emploi, sinon le travail ?
En France, oui, le coût du travail est trop important. Comme il y est difficile de travailler normalement, de monter son entreprise normalement et d'être aux normes normalement ! En France, on est tellement protégé que l'on doit être un des seuls pays au monde où l'on vous empêche de travailler.

C'est trop facile de dire ça ! Le problème de la surprotection de l'emploi, qui a fini par tuer le travail, c'est depuis plus de dix ans qu'il se pose. En France, on est capable de vous dire : « Ah non, monsieur, si vous travaillez, vous allez perdre vos aides ! » Parce qu'on n'a pas su organiser les transferts progressifs. Vous dites avoir l'intention de faire plein de choses, mais malheureusement, ce ne sont pas les projets de loi de finances qui vont nous être présentés qui favoriseront les créations de travail, donc d'emplois.
Il ne s'agit pas de rapatrier tous les emplois, mais d'empêcher qu'ils se créent à l'étranger. Nous devrions, par exemple, considérer que les accords d'entreprise adaptés à la spécificité d'une entreprise doivent primer sur les accords de branche et sur le code du travail, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la sécurité ni à la santé du personnel, pour des séquences occasionnelles ou saisonnières. Vous aurez alors plus de plateformes intégrées aux entreprises, notamment lors de pointes saisonnières, monsieur le ministre.

Ce n'est pas seulement depuis dix ans que notre surprotection de l'emploi agit contre notre travail, mais depuis 1936.

Si vous parvenez à l'harmonisation fiscale en Europe, à la réciprocité et à la protection à l'entrée de l'Europe, monsieur le ministre, je voterai pour ! Mais je vous souhaite bien du plaisir.
Nous n'aurons pas de mal à faire mieux que vous, car au cours des cinq dernières années, vous n'avez rien voté…

…sauf un petit amendement tout à l'heure.
Pour résumer, notre surprotection de l'emploi agit contre notre travail, de même que nos délais administratifs, et cela depuis longtemps, bien que nous ayons essayé de changer les choses au cours des cinq dernières années. Nos normes administratives et environnementales agissent également contre notre travail. Vous le reconnaissez d'ailleurs implicitement, puisque vous projetez de mettre en place une fiscalité environnementale à l'entrée de l'Europe pour les pays qui ne respectent pas les normes environnementales qui sont les nôtres.
Il faut, en France, accompagner les entreprises. Aujourd'hui, la DREAL dit aux chefs d'entreprise : « Monsieur, nous ne sommes pas là pour vous aider, nous sommes là pour vous contrôler. » Qu'elle leur dise plutôt : « Nous sommes là pour vous accompagner au moment où vous débutez une activité qui va être créatrice d'emplois. Dans cinq ans, vous serez aux normes, parce que vous aurez un référent à la DREAL, qui va vous accompagner ». Faites cela, monsieur le ministre : je voterai des deux mains, comme tous mes collègues de l'UMP.

Mais je vous souhaite beaucoup de plaisir, car il n'y a pas que les députés qui décident, en France, il y a aussi les syndicats, avec lesquels il vous faudra discuter.

Nous ne pourrons pas tout révolutionner aujourd'hui. Le président Brottes, fort de sa longue expérience, disait qu'il allait falloir tout reprendre à zéro. Cela va être compliqué ! Commençons donc plutôt par la sensibilisation du consommateur en adoptant cette proposition de loi, afin que, pour tout centre d'appels d'une entreprise, avant toute mise en relation, il puisse identifier clairement le pays dans lequel il est implanté. Souhaitons qu'alors le citoyen consommateur devienne un consommateur citoyen (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) !

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j'ai beau chercher, je ne vois vraiment pas ce qui peut conduire le Gouvernement et la majorité parlementaire à rejeter cette proposition de loi.
Notre collègue Marc Le Fur vient pourtant de défendre son texte avec une franchise et une humilité qui l'honorent. Cette proposition n'a pas la prétention de bouleverser le droit existant. Elle vise simplement à ouvrir un droit nouveau pour le consommateur, qui est le droit à l'information.
Pourquoi ce que vous défendez en matière de traçabilité sur les produits alimentaires ou les produits manufacturés, c'est-à-dire des obligations liées à l'étiquetage, que d'ailleurs personne ne songe à remettre en cause aujourd'hui, ne trouverait aucun écho dans les services et le secteur tertiaire ?
J'ai retrouvé une de vos déclarations, monsieur le ministre, qui est récente, puisqu'elle date du 5 octobre dernier : « En se rapportant à une indication de provenance géographique, disiez-vous, les consommateurs attendent d'un produit qu'il possède certains caractères liés au lieu de production. Les marques sont pour le consommateur la garantie d'une certaine constance et d'une qualité des produits. Elles peuvent aussi participer du choix du consommateur d'encourager la production locale. »
Alors, pourquoi est-il donc si important d'informer le consommateur de la provenance des produits manufacturés et si dérisoire de lui offrir les mêmes droits dans le secteur des services ?
Pourtant, l'industrie a malheureusement perdu le monopole des délocalisations. L'univers des services, en croissance constante depuis plus d'un demi-siècle, a longtemps été considéré comme un secteur d'activité non délocalisable, sur lequel la quasi-totalité de nos économies occidentales devait théoriquement se spécialiser pour en tirer des avantages comparatifs. La réalité n'est plus la même aujourd'hui. À travers le prisme des centres d'appels, la proposition de loi met donc le doigt sur une tendance structurelle qui, si nous ne faisons rien, risque de devenir la règle. En ce sens, le groupe UDI tient à saluer la pertinence et la réactivité de la démarche de notre collègue Marc Le Fur.
Les chiffres qui émaillent son rapport sont éloquents. À mon sens, on peut en tirer trois enseignements, qui devraient à eux seuls conduire à l'adoption de cette proposition de loi la semaine prochaine.
D'abord, avec 273 000 salariés qui travaillent au quotidien dans les centres d'appel, soit une augmentation de près de 25 % des effectifs ces six dernières années, ce secteur d'activité constitue un important vivier d'emplois sur le territoire national, qui est en croissance de plus de 4 % par an.
Ensuite, environ 60 000 emplois d'entreprises françaises gestionnaires de centres d'appels ont été délocalisés ces dernières années. Le rapporteur a démontré que nous étions là face à une tendance hémorragique, qu'il convient de contenir rapidement.
Enfin, les comparaisons avec nos voisins européens doivent également nous amener à élaborer des pistes de réflexion viables et efficaces pour conserver l'emploi sur notre territoire. On compte 600 000 agents en Allemagne et plus d'un million au Royaume-Uni, où une croissance annuelle de 10 % des effectifs est prévue dans les centres d'appels.
Ce triple constat nous appelle, en tant que législateur, à agir vite pour endiguer le risque de destruction exponentielle d'emplois dans ce secteur qui bénéficie d'un potentiel de croissance rare dans la période de crise que nous traversons. Pour les députés du groupe UDI, trois leviers principaux pourraient être déployés.
Le premier, c'est évidemment la baisse des charges qui pèsent sur le travail. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet largement commenté ces derniers mois et je vous renvoie aux différences de coût du travail avec nos concurrents directs, excellemment décrites dans le rapport de Marc Le Fur. Je me contenterai simplement de lancer un nouvel appel solennel au Gouvernement afin qu'il agisse puissamment sur cette question vitale pour les forces productrices de notre économie.
Le second levier, ce sont les propositions issues du rapport de notre collègue. Il ne serait en effet pas complètement incohérent de demander un effort aux consommateurs en contrepartie de la garantie d'un service de qualité. Le concept de numéro illico garantissant une réponse en moins de 60 secondes par des agents localisés en France, pour un coût supérieur mais supportable, et avec l'engagement pris par les entreprises de consacrer 60 % des revenus engendrés par ces appels aux rémunérations des agents, nous semble constituer une piste qu'il conviendrait d'explorer, en concertation avec les opérateurs du secteur.
Le troisième levier consiste à renforcer l'information du consommateur, tout en responsabilisant les entreprises qui font ou pourraient faire le choix de délocaliser leur activité en privilégiant les centres offshore. C'est justement l'approche qui est privilégiée par ce texte. Au-delà de la seule situation des centres d'appels, c'est la question plus globale du « produire en France » – transposée au secteur tertiaire – qui nous est directement posée. Il s'agit là d'une réflexion particulièrement intéressante, que l'on pourrait élargir à d'autres activités.
La rédaction de la proposition de loi ne stigmatise pas, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure, les employés des pays qui accueillent les centres d'appels. Nous ne souhaitons pas non plus, à travers ce texte, stigmatiser les entreprises qui font parfois le choix de sacrifier quelques dizaines d'emplois pour en sauver des centaines.
En revanche, monsieur le ministre, nous sommes en droit de leur demander de la transparence, et c'est tout ce dont il est question aujourd'hui.
Je ne comprends donc pas la position de nos collègues de la majorité sur un texte qui vise à améliorer la transparence et l'information du consommateur. L'opinion publique doit savoir quelles sont les entreprises qui délocalisent et dans quelles conditions elles le font.

Est-ce une sorte de réflexe protecteur lié à l'affaire du STIF qui a conduit le président socialiste de la région Île-de-France à revoir sa copie à la suite de la délocalisation programmée de quatre-vingts emplois vers un prestataire disposant d'une plate-forme téléphonique au Maroc ?

Je ne remets pas ici en cause la bonne foi de Jean-Paul Huchon, mais peut-être faudrait-il songer à une réforme du code des marchés publics pour éviter ce genre de mésaventures ?

Sans sombrer dans un protectionnisme qui aurait plus d'effets pervers que d'avantages, il serait intéressant de hiérarchiser les critères prioritaires pour l'attribution d'un marché public. On pourrait notamment privilégier la qualité de la prestation fournie à l'usager plutôt que le prix, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un service d'intérêt général.
Alors, monsieur le ministre, j'en reviens aux questions que j'ai posées au début de mon intervention. Pourquoi repousser ce texte dont l'objectif est de limiter les délocalisations grâce à une simple information du consommateur ? La transparence vous fait-t-elle peur ? La traçabilité vous effraie-t-elle ? La responsabilisation des entreprises qui font le choix de supprimer des emplois sur le territoire vous pose-t-elle un problème éthique ?

On vous a pourtant connu bien plus véhément lorsque vous étiez dans l'opposition, ou du moins plus ambitieux.
Mes chers collègues, à force de me poser ces questions sans parvenir à y répondre, je pense avoir enfin compris : en réalité, vous vous opposez à ce texte pour la seule raison qu'il n'émane pas de vos bancs.

Regrettant de ne pas avoir eu l'idée plus tôt, et d'être aujourd'hui contraints de devoir vous associer à un texte issu de la première journée d'initiative parlementaire réservée à un groupe de l'opposition depuis le début de la XIVe législature, vous préférez vous raccrocher à des arguments spécieux pour en justifier le rejet.
Aussi, je souhaite prendre date avec vous : je suis convaincu que ce débat n'est pas clos et que nous traiterons à nouveau ce sujet dans l'hémicycle au sein d'un projet de loi sur le droit des consommateurs que vous vous empresserez d'adopter.

Le sujet reviendra sur de bonnes bases, celles posées par le Gouvernement !

En ce qui nous concerne, nous considérons que ce texte à la portée limitée ouvre la voie à une réflexion pertinente sur la notion du « produire en France » dans les services, en alliant deux notions qui nous sont chères : la transparence et la sincérité légitimement dues aux consommateurs, ainsi que la responsabilisation des entreprises qui font le choix de délocaliser. C'est pourquoi le groupe UDI le soutiendra. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, déposée par les députés UMP, cette proposition de loi portant obligation d'informer de la localisation des centres d'appel soulève de nombreux débats chez les députés de tous bords politiques.
Elle propose que l'utilisateur puisse identifier le pays d'implantation des centres d'appels rattachés aux entreprises installées sur le territoire français. Vous la présentez, monsieur le rapporteur, comme une réponse à la délocalisation des centres d'appels et comme un remède à une prétendue mauvaise qualité de ces services. Je dois vous avouer que je ne suis pas tout à fait convaincue.
Cependant, la question de la relocalisation des technologies de la communication m'interpelle. Je considère, en effet, qu'une relation étroite entre un client et son fournisseur est primordiale. La distance peut nuire à ces bonnes relations et cela est d'autant plus vrai si ces relations sont ponctuelles. La confiance et le respect sont renforcés par la proximité géographique, même dans le cas d'utilisation de moyens de télécommunication. Ces derniers ne sont pas une fin en soi, mais un support à des relations interpersonnelles. Ce qui me fait dire que les technologies de communication ont aussi droit et intérêt à la proximité.
Le phénomène de la délocalisation des centres d'appels est regrettable au moment où l'on souhaiterait une relocalisation de l'économie, des services et des biens de proximité, et une relation sociale soutenue entre les partenaires commerciaux, deux orientations dont, vous le savez, les écologistes sont les fervents défenseurs.
Cependant, l'économie de libre marché, l'économie financiarisée à outrance et dépendante des actionnaires, conduit les entreprises à faire des choix qui sont préjudiciables pour elles, pour leurs clients et pour toute l'économie d'un pays. Et l'on sait d'où cette politique provient. Cela est remarquable dans la téléphonie mobile, où les secousses vécues par le secteur et la dégradation de certains services sont attribuées à l'ouverture à une concurrence féroce, voire sauvage. La lutte contre cette concurrence sauvage devrait être notre premier combat pour regagner un potentiel productif fort.
Si cette proposition de loi n'a pas la prétention de régler le problème de la relocalisation de tous les services, mais pour autant, le début de réponse qu'elle apporte n'est pas concluant.
Elle voudrait que les consommateurs informés se détournent du service proposé si le pays d'installation du centre ne leur convient pas et que leur nombre soit suffisant pour que l'entreprise concernée traduise ce signal en orientation opérationnelle de rapatriement de ses centres d'appels. Soyons sérieux, ce n'est pas crédible !
L'idée d'une identification de la provenance de nos services, tout comme l'identification de nos produits alimentaires, est intéressante, mais elle relève davantage de la transparence à l'égard des consommateurs que d'une réelle politique de relocalisation de l'emploi. Cette politique de relocalisation devrait s'appuyer sur une remise à plat de nos règles commerciales internationales, sur une régulation de certains secteurs d'activités d'intérêt général, sur une réorientation vers l'économie de marché, sur la marginalisation de l'économie financière, et enfin sur une valorisation, notamment à travers le code des marchés publics, des entreprises présentant une forte compétitivité sociale et environnementale. La sortie par le haut se fera par l'écologie et non par la course à l'économie !
Vous alléguez que cette proposition de loi corrige les défauts de qualité des services en question ; je pense que nous nous trompons de débat. Le lien entre la disposition proposée et cet objectif est ténu, voire inexistant. J'y vois même une certaine stigmatisation des étrangers, qui m'interpelle très fortement quant aux véritables objectifs de votre texte. À la lecture de votre proposition de loi, l'amalgame « mauvaise qualité égale étranger ; bonne qualité égale français » est inévitable. C'est tout à fait regrettable.
En effet, la qualité du service fourni n'est pas fonction du pays d'origine de l'appel ; elle dépend du niveau de formation et de qualification des télé-opérateurs.
Par ailleurs, ce métier compte parmi les plus précaires et propose de très mauvaises conditions de travail en termes de bruit, de cadences, et de stress. L'insatisfaction supposée des clients ou des usagers n'a donc aucun lien avec la nationalité des opérateurs ; elle soulève la question de leurs conditions de travail et, en corollaire, celle de la précarité et la souffrance.
La responsabilité de l'entreprise ou de l'administration en matière de formation et de conditions de travail est donc en jeu, et non la position géographique du télé-opérateur. Cela vaut aussi bien en France, où les taux élevés de turnover et d'absentéisme sont révélateurs du mal-être des salariés de ce secteur, qu'à l'étranger.
Je vous remercie d'avoir mis en avant l'enjeu de la relocalisation des services en France. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos prochains débats, notamment lors de la réforme bancaire ou encore lors de la loi-cadre sur l'économie sociale et solidaire, mais à l'heure actuelle, je ne suis pas convaincue par le bien-fondé du texte proposé. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, chers collègues, en écoutant les propos des différents orateurs, et notamment les vôtres, monsieur le rapporteur, je m'étonne que l'opposition ne s'interroge pas sur la responsabilité de la majorité qu'elle fut hier dans la situation que nous connaissons aujourd'hui.
Le sujet qui nous occupe est une préoccupation du Gouvernement depuis sa prise de fonction. Les annonces, en plein été, de plans de départ volontaires chez SFR et Bouygues Telecom concrétisaient malheureusement les craintes que nous avions exprimées dès 2009 avec mon collègue François Brottes, aujourd'hui président de la commission des affaires économiques, quant aux conditions d'octroi de la quatrième licence de téléphonie mobile. À l'époque, nous avions très fortement alerté le gouvernement sur ce sujet.

Il faut en effet rappeler que les opérateurs télécoms demeurent les principaux donneurs d'ordre de la relation client : 60 % du chiffre d'affaires réalisé par le secteur provient de la téléphonie et de l'internet ; 75 % du chiffre d'affaires offshore est généré par ce même secteur.
Les rencontres avec les opérateurs, organisées durant l'été par Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin, auxquelles Benoît Hamon a également été associé, ont ainsi constitué une rupture par rapport aux choix du gouvernement précédent, qui a constamment privilégié le court terme sans se soucier des conditions de l'emploi sur le long terme.
C'est la raison pour laquelle il me semble important de considérer les évolutions des télécoms, mais aussi de la filière numérique dans son ensemble.
La présente proposition de loi présentée par M. Marc Le Fur ne met donc pas en lumière un phénomène économique jusque-là ignoré : celui-ci est clairement et depuis longtemps identifié. Tout au plus isole-t-elle un des aspects de la problématique de l'emploi dans la filière numérique en étant consacrée uniquement aux centres d'appels, qui ne sont qu'une facette de la relation client. De nombreux autres secteurs de la filière sont également touchés par ces évolutions. Ainsi, cette proposition de loi apparaît bien insuffisante au regard des enjeux.
D'un point de vue législatif, il semble également bien peu judicieux de s'intéresser à la problématique de la transparence en matière de production de services en ne ciblant qu'un secteur particulier. Cela signifierait-il, monsieur Le Fur, que nous serons conduits à légiférer sur chaque type de service, sur chaque type de transparence ?
Nous sommes tous préoccupés par la création et le maintien d'emplois en France, affichés comme un des objectifs de ce texte. Cependant, nous devons juger ce texte non sur cet objectif, mais bien évidemment sur les moyens proposés pour l'atteindre.
M. le rapporteur a reconnu en commission que son texte avait une « ambition limitée ». C'est un accès de franchise.

M. le rapporteur semble lui-même ne pas vraiment croire au dispositif qu'il nous soumet aujourd'hui. Selon ses propres mots, ce texte « pose la question de la menace de délocalisation ». Or la menace est bien réelle, puisque le mouvement de délocalisation est malheureusement initié depuis plusieurs années.
Quel est donc l'intérêt de proposer un texte sur un sujet si important, si aucune mesure propre à infléchir le phénomène dénoncé n'est proposée, de l'aveu même du rapporteur ?
La réponse semble se trouver dans la phrase de l'exposé des motifs que M. le ministre a lue tout à l'heure. Elle nous a tous surpris et se révèle terriblement gênante tant elle véhicule des idées reçues sur le niveau culturel des travailleurs étrangers, dont certains sont des citoyens de pays où la langue française reste très utilisée, notamment tout au long des études.
Ce mépris trouve également un prolongement dans les dispositions techniques proposées. Si la proposition de loi de M. Le Fur était adoptée, elle risquerait in fine d'avoir pour conséquence d'exposer les télé-opérateurs à des remarques déplacées alors que, je vous le rappelle, ils ne sont en rien responsables d'une situation qui relève du choix des donneurs d'ordres.
Il nous faut ici soulever le paradoxe de cette proposition de loi : censée favoriser la création d'emplois, elle adopte pourtant essentiellement le point de vue du consommateur. Or, si cet élément a son importance, il semble bien inadapté à l'ampleur de l'enjeu que représentent le maintien et la création d'emplois dans notre pays.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous souhaitez transposer le made in France au secteur des services. À ce propos, il faut rappeler que, dans le cas des centres d'appels, l'usager n'a pas d'autre choix que d'utiliser le service tel qu'il lui est proposé, contrairement à ce qui peut se passer, par exemple, pour des produits manufacturés. Il est en effet peu probable qu'il raccroche si l'annonce ne le satisfait pas, puisqu'il a un besoin urgent d'être en contact avec son interlocuteur. En outre, ce dispositif pourrait être facilement contourné, un premier interlocuteur, basé en France, pouvant basculer l'appel vers un centre offshore. Le dispositif proposé suscite donc également de fortes interrogations quant à son efficacité.
Au-delà de ces considérations, que nous ne pouvons négliger en tant que législateur, je veux insister, monsieur le rapporteur, sur votre insuffisante prise en compte de l'écosystème dont dépendent principalement ces centres d'appels ; vous étudiez le problème – pardonnez-moi l'expression – par le petit bout de la lorgnette. Comme je l'ai indiqué, le secteur des télécoms est le principal client des centres externalisés de relation client. Il paraît donc difficile d'agir sur l'emploi dans les centres d'appels sans avoir à l'esprit les problématiques propres à ce secteur. Or, si la filière numérique est aujourd'hui un levier formidable pour stimuler la croissance et la création d'emplois à long terme, les technologies numériques constituant un outil puissant pour l'attractivité de nos territoires, cette ambition nécessite de s'appuyer sur une filière forte, dynamique et innovante. Ainsi, le Gouvernement vient d'annoncer, ce mardi, cinq mesures pour la filière télécoms, dont le soutien relève évidemment des missions de l'État.
Le secteur des télécommunications a connu de nombreux bouleversements ces dernières années, dont le dernier en date est la modification des modèles économiques consécutive à l'octroi par l'État d'une quatrième licence de téléphonie mobile, que l'opposition actuelle avait ardemment soutenu, sans aucunement réfléchir aux modèles économiques en jeu ni anticiper l'impact potentiel de cette mesure sur l'emploi. Le raisonnement qui a présidé à cette décision était le suivant : l'augmentation de l'intensité concurrentielle dans le secteur de la téléphonie mobile contribuera à une baisse des prix favorable au consommateur. Cette logique a effectivement été appliquée, sans anticipation ni étude d'impact. Le nouvel opérateur est arrivé sur le marché avec une stratégie, qu'il avait d'ailleurs annoncée, agressive sur les prix, stratégie permise par l'adoption d'un modèle low cost qui a obligé les concurrents à s'aligner. Le résultat a été mécanique : les marges des opérateurs de télécommunications ont été fortement impactées et, pour amortir cette baisse, ils se sont évidemment engagés dans des réductions de coûts qui ont des répercussions, non seulement en interne, mais aussi et surtout sur l'ensemble de leurs partenaires, qu'il s'agisse des équipementiers ou des entreprises auprès desquelles ils sous-traitent leur relation client.
Ce mouvement ascendant, auquel nous sommes confrontés depuis quelques années, revêt une acuité particulière depuis le début de l'année, les prestataires de services étant soumis aux exigences croissantes de leurs donneurs d'ordres en matière de baisse des coûts. Or, vous oubliez ce principe économique et la responsabilité qui est la vôtre dans les décisions qui sont prises actuellement. Le secteur de la relation client n'a pas été le seul de la filière numérique à subir les effets de cette politique ; c'est également le cas, je l'ai dit, des équipementiers télécoms, et nous sommes, hélas ! dans l'attente d'un certain nombre de plans sociaux qui devraient être annoncés prochainement dans ce secteur. J'aurais aimé que vous soyez à nos côtés, à l'époque, lorsque nous avons alerté le Gouvernement sur ce sujet. L'incidence sur l'emploi est malheureusement immédiate, nous risquons d'en avoir la triste illustration dans les prochains jours. Ces décisions politiques impactent la filière au moment même où les besoins d'investissement pour les déploiements des réseaux de nouvelle génération, très haut débit et haut débit mobile, sont considérables.
Mais revenons-en à l'emploi. Une étude, que je vous conseille de lire, a été menée par Bruno Deffains, économiste enseignant à Paris II, qui évalue l'impact extrêmement inquiétant de cette guerre des prix sur la filière, notamment dans le secteur de la relation client.
Je note cependant avec satisfaction qu'entre l'examen du texte en commission et la rédaction de votre rapport, vous semblez, monsieur le rapporteur, avoir découvert que la filière connaissait un certain nombre de difficultés. Vous jouez les modestes, mais cela ne suffira pas à nous convaincre. Le problème que vous soulevez est, certes, réel, mais il nécessite une réflexion plus aboutie, plus globale et implique des mesures autrement plus efficaces.

Nous nous opposons donc à ce texte, qui n'est ni à la hauteur des enjeux ni satisfaisant sur le plan technique et économique. Néanmoins, comme cela a été dit tout à l'heure, nous explorons actuellement un certain nombre de pistes de travail dans ce domaine, que je vais vous préciser.

J'ajoute, monsieur le rapporteur, que vous avez pu vous apercevoir ce matin, lors de la réunion de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les coûts de production, que le problème n'était pas aussi simple que vous sembliez le croire.
L'État doit tout d'abord réaffirmer sa volonté de soutenir la filière numérique,…

…et j'aurais aimé, monsieur le rapporteur, que vous réfléchissiez, comme nous l'avions demandé à l'époque, à la prise en compte d'un critère « emploi » dans l'attribution des licences 3G et 4G. Vous ne l'avez pas fait.

Ainsi que l'a indiqué M. le ministre, c'est une des pistes sur lesquelles nous travaillons, notamment pour le 1 800 Ghz : il est possible d'intégrer un tel critère dans le cahier des charges.
En matière de transparence, nous pouvons demander la publication par chaque opérateur de la localisation des emplois dans leur secteur de la relation client, sans pour autant exposer, comme vous le proposez, le téléopérateur à des remarques déplacées. Des travaux doivent être également menés sur l'évolution de la relation client. On peut ainsi réfléchir à l'évolution des offres, notamment à une différenciation des forfaits par la qualité de service et l'innovation, tout en imposant une qualité suffisante et transparente pour les services classiques. L'autre levier est, bien entendu, l'innovation, qui permet d'améliorer la compétitivité de l'industrie. En effet, la baisse du coût du travail, brandie à tort et à travers, n'est pas l'unique élément de la compétitivité. À cet égard, la relation client devient un axe majeur de différenciation. Comme je l'ai évoqué, les réseaux à très haut débit vont offrir de nouvelles possibilités. Par ailleurs, la gestion des données informatiques doit être intégrée à cette réflexion, puisque la délocalisation des centres d'appels suppose un accès à distance aux données des clients et usagers.
Enfin, je veux aborder une question que vous avez évoquée tout à l'heure de manière extrêmement simpliste, en rappelant la fameuse affaire du STIF. En l'espèce, la procédure a été clairement respectée.

Dans ce domaine, vous le savez très bien, nous devons envisager une évolution du code des marchés publics, et nous sommes en train d'y travailler.

Si le STIF avait voulu éviter ce problème, il aurait pu le faire dès le début et vous le savez très bien ! Il suffisait de retenir d'autres critères d'attribution !

La procédure, je le répète, a été parfaitement respectée. En la matière, je le répète, il nous faut faire évoluer le code des marchés publics.
Bien évidemment, nous allons mener l'ensemble des réflexions nécessaires et proposer un certain nombre de dispositions.

C'était à vous de le faire avant, mon cher collègue.
En conclusion, ce texte n'apporte aucun élément nouveau quant au phénomène du low cost et du low price, que vous semblez ne pas connaître etqui ont pourtant un impact lourd sur l'emploi. D'une portée limitée, il n'intègre aucunement les évolutions possibles de la relation client, qu'elles soient technologiques, réglementaires ou relatives à la régulation. Cette proposition de loi ne remet nullement en cause les initiatives prises par le gouvernement précédent, que vous souteniez. Enfin, nous ne pouvons souscrire à un texte qui présente, dans son exposé des motifs, des arguments fondés sur des considérations plus que douteuses, visant plus à alimenter des préjugés qu'à décrire la réalité d'une situation économique complexe. Non seulement il n'est pas acceptable – et c'est un point extrêmement important – que les salariés, téléopérateurs ou téléconseillers, soient exposés à des remarques désagréables, mais votre proposition ne règle pas le problème de fond, qui est lié à l'équilibre économique de la filière. Nous comptons, quant à nous prendre des mesures précises dans ce domaine.
Pour toutes ces raisons, nous nous prononcerons contre ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, monsieur le ministre délégué, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, la proposition de loi que nous sommes amenés à discuter aujourd'hui met en lumière un phénomène bien réel, mais encore trop souvent méconnu, celui de la délocalisation des services. En effet, si nous sommes malheureusement bien familiers de la délocalisation qui touche notre secteur industriel, nous le sommes moins de celle qui concerne le secteur tertiaire. Certes, cette délocalisation ne saurait concerner tous les services – on comprend aisément pourquoi –, mais elle constitue une nouvelle source de déperdition d'emplois, que nous ne pouvons pas négliger.
Ainsi, comme d'autres prestations, les centres d'appels sont touchés par ce phénomène. Rappelons – les chiffres ont déjà été évoqués, mais je crois utile de les rappeler – que les centres d'appels emploient aujourd'hui 273 000 salariés en France. Un quart de ces centres est externalisé et représente 70 000 personnes. Le nombre d'emplois délocalisés est, quant à lui, évalué à 60 000. Ces centres d'appel sont installés principalement au Maroc, en Tunisie, en Roumanie et, plus récemment, au Portugal et en Espagne. Cette pratique s'explique aisément par la souplesse de la réglementation relative au temps de travail en vigueur dans ces pays, qui permet à ces centres d'appels de fonctionner la nuit et le week-end. Mais elle s'explique aussi et surtout par le coût de la main-d'oeuvre dans ces pays, deux à trois fois moins élevé qu'en France. À ce propos, je me permets de poser la question suivante : combien de temps encore allons-nous faire l'économie d'un vrai débat sur la compétitivité et l'attractivité de notre pays ?

Pour en revenir au sujet précis qui nous occupe aujourd'hui, je rappelle que le coût moyen horaire d'un téléconseiller est de 28 euros en France, contre 24 euros en Allemagne, 22 euros au Royaume-Uni et 15 euros au Maghreb. Dès lors, j'ai bien peur que le nombre de ces centres dits « offshore » ou « low cost » ne cesse de croître, d'autant plus que se développent toujours plus rapidement les technologies de l'information et de la communication et que prévaut, en France, la logique de la gratuité et du service compris, qui conduit nos entreprises à pratiquer des coûts de plus en plus bas.
C'est pourquoi nous devons prendre des mesures de protection. Celles-ci sont d'autant plus nécessaires qu'au-delà des entreprises, le secteur public est également concerné par cette question de réduction des coûts. À cet égard, je ne peux m'empêcher de rappeler le triste précédent du STIF, rappelé par plusieurs des orateurs précédents.

Certes, le code des marchés publics a été respecté, mais, en développant un tel argument, on minimise la responsabilité de nos élus locaux.

Ces services d'appels ont été délocalisés au détriment de salariés basés en Moselle et en Vendée et confiés à une entreprise installée au Maroc.

C'est la vérité, mes chers collègues et je constate avec beaucoup de tristesse qu'elle vous dérange. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

Mais revenons au texte dont nous discutons. Celui-ci met en oeuvre des mesures simples de précaution et de protection. Ainsi l'article 1er donne la possibilité au consommateur de connaître la localisation du centre d'appels dans le message délivré par le répondeur téléphonique et l'article 2 prévoit que la documentation jointe à un produit ou à un service précise, là encore, la localisation du centre d'appels dédié aux clients. Ce texte a donc le grand mérite de mettre le consommateur au coeur du dispositif, puisqu'il est question de la qualité du service client. Ces centres d'appels délocalisés présentent, disons-le, un véritable problème, de ce point de vue ; chacun a pu en faire l'expérience.
La proposition de loi promeut également la transparence, et c'est un point très important, car il me semble normal que celui qui consomme sache qui délocalise et où il le fait. Cette notion de traçabilité, fondamentale, fait de ce texte un texte pédagogique, qui permet au consommateur de s'interroger et de prendre conscience des menaces de délocalisation qui pèsent sur certains services, et c'est une très bonne chose.
Ce texte constitue donc un premier pas. À ce titre, il ne s'inscrit pas dans une logique de sanction, d'interdiction, mais, comme nous l'avons dit, d'information.
Enfin et surtout, il a le grand avantage de mettre vraiment et concrètement en avant la notion de « produire français », ou made in France, tant évoquée durant cette campagne et scandée à l'envi par ce gouvernement.
Alors, certes, d'aucuns pourraient trouver ce texte modeste, mais nous préférons de loin les mesures simples et concrètes comme celle-ci aux longs discours incantatoires qui ne sont souvent que des coquilles vides.
Pour toutes ces raisons, je salue l'initiative de mon collègue Marc Le Fur et soutiens fermement cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Monsieur le rapporteur, j'ai le regret de vous dire que cette proposition de loi nous laisse très sceptiques quant à ses objectifs réels.
Bien sûr, nous pouvons partager votre objectif de favoriser la création d'emplois et d'éviter les délocalisations. Mais le problème, c'est qu'un texte de loi ne peut pas se résumer à quelques lignes d'intention, surtout en matière d'emploi. Le vôtre laisse de côté trop de sujets qui méritent une réflexion plus approfondie et des propositions concrètes. Et je vais vous donner quelques exemples.
Où se trouvent, dans ce texte, des mesures incitatives sur le plan économique et fiscal ? Des mesures pour la régulation du secteur concerné ? Des mesures pour l'amélioration de la qualité du service ?

Où se trouve, enfin, la question du problème du recrutement et de la dévalorisation des emplois dans les centres d'appels ? Tout cela est oublié par et dans votre texte.

Monsieur le rapporteur, le sujet est peut-être consensuel, mais la manière dont vous l'avez abordé ne l'est absolument pas. Informer le consommateur du lieu d'implantation du centre d'appels n'est pas la solution entière et viable aux problèmes de ce secteur, ni pour les entreprises, ni pour les consommateurs, ni pour les salariés.

Vous me rétorquerez certainement que si ce texte peut paraître sommaire, il a le mérite d'ouvrir une piste de travail. Sauf que votre entrée en matière est déjà très ambiguë lorsque vous pointez la mauvaise maîtrise de la langue française par certains salariés. D'emblée, vous choisissez de stigmatiser des salariés, sans chercher à comprendre les difficultés de ce secteur et sans proposer de solutions pérennes.
Autre constat : vous vous placez uniquement sous l'angle des consommateurs et vous oubliez l'emploi. Même en vous focalisant sur les consommateurs, votre proposition ne prend pas en compte l'évolution du secteur de la relation client.
Vous prétendez avec ce texte empêcher les délocalisations, mais là encore, rien de concret ! Pensez-vous, très sincèrement, que le simple fait d'informer le consommateur du lieu d'implantation du centre d'appels empêchera les délocalisations ?
C'est bien ça que nous pointons du doigt depuis nos travaux en commission : l'absence de réel dispositif et le peu de réflexion accordée à des problématiques complexes que vous ne traiterez pas avec ces deux articles et ces trois amendements.
Vous expliquez que votre proposition de loi va dans le bon sens. Certes, mais ne nous demandez pas de voter un texte dont l'efficacité sera extrêmement réduite, voire nulle.
La délocalisation des centres d'appels est un sujet à traiter à l'échelle de la filière. Or, votre texte est bien trop maigre pour atteindre l'objectif affiché.
Plutôt que d'entretenir la stigmatisation des travailleurs étrangers, je pense qu'il serait plus intelligent de promouvoir la réciprocité des échanges commerciaux et d'établir des partenariats constructifs et durables. Opposer emplois en France et emplois à l'étranger serait, pour certaines filières, une erreur. C'est bien ce que comprend le Gouvernement lorsqu'il soutient la compétitivité partagée et la co-localisation des entreprises, c'est-à-dire le partage intelligent de la valeur ajoutée entre les pays. Le ministre l'a dit, sa collègue Nicole Bricq travaille en sens et Mme Ehrel a fait des propositions.
En conclusion, monsieur le rapporteur, nous avons conscience, autant que vous, de l'urgence à agir dans ce domaine, mais pas en nous proposant une mesurette. Votre initiative, dès lors, devient maladroite et relève, en l'état, davantage de la joute politicienne. Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, nous ne la soutiendrons pas. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous prie d'excuser mon collègue Pouria Amirshahi, qui est allé accueillir le Président de la République en visite à Dakar. Je le remplace au pied levé.
Monsieur le rapporteur, votre proposition de loi vise avant tout à ouvrir un débat sur la délocalisation des services. Vous me pardonnerez donc de ne pas m'arrêter aux seuls centres d'appels, mais de replacer ce débat dans une vision un peu plus globale.
Il est entendu que nous ne parlons pas aujourd'hui d'implantations d'unités nouvelles de nos entreprises à l'étranger qui se font sans transfert d'activité, mais bien des délocalisations, c'est-à-dire d'emplois perdus en France et recréés dans d'autres pays.
Parmi ces délocalisations auxquelles nous sommes confrontés, je distinguerai trois zones ou trois catégories.
D'abord, nos débats européens le montrent, la France est confrontée à des délocalisations au sein même de l'Union européenne : des entreprises quittent notre territoire pour aller en Écosse ou en Pologne, car, au sein même de l'Union, les États membres, qui avaient pourtant décidé d'unir leurs destins économiques, pratiquent entre eux une concurrence sociale et fiscale destructrice. Face à cette dérive, nous devons réussir le pari d'une Europe solidaire, pour laquelle la France plaide à nouveau depuis le mois de mai dernier.
Deuxièmement, certaines entreprises installent leurs sites de production dans les pays émergents d'Amérique latine ou d'Asie, tentées par leur potentiel de consommateurs autant que par un prix du travail moins cher, souvent dû au dumping social. Dans ce domaine, c'est à nous de montrer que nous pouvons, à l'échelle européenne encore, déployer une stratégie de relocalisation et dire que, par des écluses tarifaires ciblées, l'Europe peut se protéger et protéger ses salariés. J'ajoute que de nombreux exemples montrent les limites des stratégies de délocalisations pures : limites en termes de qualité de production et de sécurité au travail ; limite aussi du fait du coût important des frais de transport de marchandises produites ailleurs, mais réimportées chez nous. C'est donc aussi un enjeu écologique et social.
Enfin, il y a l'enjeu méditerranéen, dont Pouria Amirshahi aurait parlé mieux que moi, avec sa connaissance et son implantation. Vous estimez vous-même à 60 000 le nombre d'emplois délocalisés, principalement au Maghreb. Il y a d'autres secteurs concernés, je pense en particulier au secteur automobile. Cette concurrence est d'autant plus nuisible qu'elle génère des rancoeurs des deux côtés de la Méditerranée et, tandis que l'Europe se crispe du fait de sa crise, le Maghreb se tourne vers d'autres partenaires, vivant au fond très mal qu'on lui fasse le procès de s'industrialiser et de se développer économiquement. Or, nos amis et partenaires du Maghreb en ont le droit et nous devons même les aider dans cette stratégie, car il en va aussi de notre intérêt. Je m'en explique. Si d'un côté le Maghreb éprouve un réel besoin de développer son appareil productif, les Français sont, eux, soucieux de préserver les emplois industriels et de services de l'Hexagone. Nous avons, dès lors, deux solutions : nous tourner le dos, ou nous tendre la main.
Je veux plaider ici pour une stratégie concertée de multi-localisation des emplois sur le pourtour méditerranéen et de développement partagé. Opposer emplois en France et emplois au Maghreb me paraît une erreur. Il faut rappeler qu'au lendemain de la chute du Mur de Berlin, la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne et la République tchèque avaient réussi à créer une dynamique partagée d'intégration économique, comme nous, au lendemain des printemps arabes, nous devons nous allier avec nos amis du Sud.
La rive sud de la Méditerranée a besoin d'investissements et en même temps elle représente un débouché avec un fort potentiel pour nos entreprises. Il faut arriver à un partenariat intelligent, comme vient de le rappeler Pascale Got, permettant de partager les bénéfices au profit de nos deux économies. Cela est parfaitement possible et doit même constituer un axe central du projet méditerranéen.
Lors d'un récent déplacement au Maroc et en Algérie, la ministre Nicole Bricq et Pouria Amirshahi avaient d'ailleurs plaidé en faveur de la co-localisation avec nos partenaires méditerranéens, en disant qu'il faut impulser un nouvel élan permettant à nos entreprises de réussir là-bas et aux entreprises du Sud de réussir en France.
J'en reviens aux centres d'appels. Ils représentent un peu plus de 270 000 emplois avec, c'est vrai, un réel risque de délocalisation. C'est justement pourquoi il est nécessaire d'entrer dans une concertation sérieuse avec la rive sud de la Méditerranée. Nous pouvons envisager, comme l'a proposé le ministre du redressement productif, l'implantation de centres d'appel en France, en particulier dans des bassins d'emplois durement touchés par le chômage. Mais nous devons en même temps proposer un vrai partenariat industriel et économique aux pays d'Afrique, en particulier dans l'espace francophone.
Peut-on envisager de construire ensemble les industries modernes des énergies renouvelables ? La réponse est oui. Peut-on construire ensemble des filières industrielles et de services communs ? La réponse est encore oui. Peut-on créer des dispositifs de formation professionnelle et technologique communs ? La réponse est toujours oui, mais elle passe par l'instauration d'un dialogue permanent avec nos partenaires du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne sur les sujets commerciaux : le gouvernement de Jean-Marc Ayrault l'a d'ailleurs déjà engagée.
Vous comprendrez, monsieur le rapporteur, que nous jugions votre proposition de loi insatisfaisante. Nous la rejetterons, non parce qu'elle ouvrirait un faux débat ni parce qu'elle émane de l'opposition, mais parce qu'elle nous paraît à courte vue et qu'un certain nombre de considérations figurant dans son exposé des motifs nous semblent relever d'une mauvaise inspiration.
Mon collègue l'aurait dit mieux que moi, la Méditerranée, c'est aussi notre avenir ; le partenariat avec le Sud, c'est aussi notre avenir et nous devons enfin lui donner une véritable concrétisation. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Je veux remercier les différents orateurs qui se sont exprimés sur ce texte, qui a au moins le mérite d'ouvrir un débat. Je remercie mes collègues Taugourdeau, Favennec et Marcangeli qui soutiennent cette proposition, laquelle revendique son humilité : nous n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes, mais d'avancer, ce qui me semble une bonne chose. Nous préférons une proposition à effet immédiat qu'un grand débat, qu'un grand colloque, que de bonnes idées qui donnent lieu à des rapports… C'est une conception intellectuelle souvent partagée à droite. Mais c'est également qu'il y a urgence : le temps nous est compté. Madame Allain, vous disiez : « Il s'agit de rapatrier des emplois. » Nous n'en sommes plus là : il s'agit de conserver ceux que l'on a, et qui peuvent partir très vite ! L'enjeu, c'est 60 000, 70 000, 100 000 emplois dans les mois ou les années à venir. Donc agissons : humilité, mais réaction rapide.
Monsieur le président de la commission, je vous sais très compétent sur ce sujet, mais pourquoi me parlez-vous de mes amis politiques ? Que je sache, M. Jean-Paul Huchon ne fait pas partie de mes amis politiques : c'est pourtant lui qui prend une décision qui s'est traduite par la suppression de quatre-vingts emplois dans la province française. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Que je sache, M. Niel n'est pas un de mes amis politiques : c'est plutôt l'un des vôtres, d'ailleurs.

Monsieur le ministre, merci de vos précisions, merci également de ces ouvertures sur le texte qui sera le vôtre dans quelques semaines ou dans quelques mois. Merci de votre volontarisme sur la 4G. Nous espérons qu'il aura chez nous des effets concrets et nous y serons attentifs.
Vous nous dites que cette proposition de loi est contraire au droit communautaire. Cela ne vous ressemble pas, monsieur le ministre. Je vous croyais autrement plus volontariste.. Si le made in France est contraire au droit communautaire, mieux vaut tout arrêter, mieux vaut fermer cette maison et se dire que tout se passe ailleurs ! Je crois qu'on peut agir, pas à la marge, concrètement, et je crois que la principale évolution qui dépend de nous, c'est d'informer nos concitoyens, parce que je les crois responsables. Comme on l'a dit avant moi, être homme c'est être responsable : par l'information, comprendre qu'on n'est pas seulement consommateur, mais aussi producteur. Ce qui est en jeu, ce sont nos emplois et ceux de nos enfants.
J'espère que l'agressivité de Mme Erhel n'est pas liée à notre proximité géographique. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Ma chère collègue, je n'ose pas l'imaginer. Plusieurs orateurs ont joué la petite musique de la stigmatisation : mon texte stigmatiserait !
La politique, ce sont des alternatives. Le vrai sujet pour nous, c'est de permettre aux jeunes issus de l'immigration qui habitent dans les quartiers nord d'Amiens d'avoir demain un travail : c'est cela, le vrai sujet. L'alternative, c'est l'emploi à Amiens nord ou de l'autre côté de la Méditerranée. Il faut que nous choisissions. Nous sommes des députés de la nation, qu'on le veuille ou non, ce qui signifie imaginer et créer certaines lignes de défense.
Madame Got, pardonnez-moi, mais je n'hésite pas à le dire : il nous faut développer ce type d'emplois qui demain bénéficiera à Mouloud qui habite Amiens, à Kevin ou à Christelle qui habitent Rennes ou Tours. Pour autant, nous ne stigmatisons personne, pas plus qu'un ministre ne stigmatise les Coréens quand il dit qu'il ne faut pas acheter de voitures coréennes.
Nous sommes dans une logique de défense de nos emplois – ceux de nos circonscriptions et, plus largement, ceux de la France.
Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais je m'étonne que vous n'ayez pas dit un mot sur les services publics. Or, le vrai sujet est bien celui-ci : la fuite des services publics, que l'on peut craindre pour demain si nous n'agissons pas. Agissons ! En ce qui concerne le STIF, je crois que le président Huchon aurait pu éviter la décision qui a été prise, s'il l'avait vraiment voulu. Si des mesures doivent être prises en matière de réglementation des marchés publics, prenons-les, nous sommes là pour ça !
Madame Allain, je suis, tout comme vous, partisan du circuit court, et je ne propose d'ailleurs rien d'autre. Même si votre position n'est pas tout à fait identique à la nôtre, elle la rejoint sur le fond. J'ai la conviction que nous devons raisonner en termes simples : ce qui peut être fait chez nous doit être fait chez nous – et quand des dizaines de milliers d'emplois sont en cause, cela vaut la peine d'y réfléchir. Cette proposition de loi est un petit pas, modeste mais concret, dans la bonne direction : appliquons le made in France au domaine des services. Comme l'a très bien dit M. Dussopt, le sujet n'est pas seulement celui des centres d'appel, il concerne bien d'autres secteurs. Pour ma part, j'ai reçu de très nombreux mails au sujet des services internet, qui sont aujourd'hui délocalisés sans qu'on le sache. Le phénomène risque de prendre encore plus d'ampleur, aussi nous ne devons pas rester indifférents, mais agir ! (« C'est vrai ! » sur les bancs du groupe UMP.)
Ce genre de problèmes ne devrait pas nous diviser, mais au contraire nous rassembler. Nous avons bien compris que ce n'était pas la journée des textes UMP…

…mais si nous ne parvenons pas à les faire voter, cela ne nous empêche pas de les défendre, l'essentiel étant que nous parvenions à faire passer certaines idées. Rien ne vous empêche de faire votre propre texte, mes chers collègues de la majorité, je n'ai, en ce qui me concerne, aucune paternité à faire valoir sur les idées que je défends ici ! Bref, faites en sorte, en mettant en oeuvre un principe qui nous rassemble, de sauver des emplois en France ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Je commencerai en répondant à M. le rapporteur au sujet du droit communautaire. Il y a une différence entre vouloir changer les choses et être en infraction avec le droit communautaire. En ce qui me concerne, si je souhaite modifier les règles du jeu en Europe, je ne veux pas être en infraction avec le droit communautaire. Or, ce serait le cas si nous adoptions cette proposition de loi, contraire au principe de la non-discrimination en raison du lieu de résidence – et le législateur que vous êtes ne saurait en faire abstraction.
Monsieur Taugourdeau, quand vous avez commencé à parler de 1936 et des syndicats, j'ai cru que vous alliez encore évoquer les 35 heures, mais pour une fois cela n'a pas été le cas.
Je vous rappelle que 450 000 emplois industriels ont été détruits lors des cinq dernières années, et 750 000 lors des dix dernières années !
Nous ne sommes pas plongés dans cette crise depuis dix ans, monsieur le député ! Je suis heureux que vous découvriez enfin le problème des délocalisations, mais quand Renault a commencé à installer ses chaînes de production en Roumanie et ailleurs, on ne vous a pas entendus ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
La réalité à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est qu'une partie de l'outil de production industrielle a été délocalisée hors de France et même hors de l'Union européenne – ce dont nous tirons les conséquences en essayant de mettre en oeuvre une stratégie de relocalisation des emplois. Une chose est sûre, cela n'a pas grand-chose à voir avec 1936…
…et le coût du travail – même si cette dernière question est centrale et devra être prise en compte si nous voulons améliorer la compétitivité de notre économie. Pardon de vous rappeler que vous avez un bilan et que, de ce point de vue, les membres de l'ancienne majorité vont avoir un peu de mal à se faire passer pour des oies blanches !
M. Favennec a fait des remarques tout à fait intéressantes, notamment en posant ces questions : pourquoi n'étend-on pas au secteur des services le principe de l'indication géographique ? Pourquoi n'étend-on pas aux produits manufacturés l'indication géographique contrôlée figurant actuellement sur les produits alimentaires ?
Récemment, le village de Laguiole, où l'on fabrique les couteaux de cette marque, s'est malheureusement vu déposséder de son nom – comme cela a été le cas autrefois pour la crème Chantilly ou l'eau de Cologne –, ce qui a provoqué une vive émotion dans la commune. J'ai moi-même appelé son maire pour lui annoncer que, dans le cadre du projet de loi sur la consommation, nous allions réfléchir à une disposition permettant aux produits manufacturés de disposer d'une indication géographique.
À partir du moment où l'on connaît les matériaux permettant la fabrication d'un produit manufacturé, où l'on identifie un process lié à un territoire, il est possible de concevoir le principe d'une indication géographique. Mais qu'en est-il pour les services ? Indiquer à un appelant que la personne qui lui répond le fait de l'étranger est constitutif d'une discrimination évidente, donc d'une infraction au droit communautaire. Au demeurant, cela ne donne aucune indication quant aux conditions de production. C'est pourquoi, si nous sommes favorables à une indication géographique en matière de produits alimentaires et de produits manufacturés, nous ne sommes pas favorables à ce que vous proposez ici, concernant les centres d'appel.
Je le répète, une telle disposition constituerait une infraction au droit communautaire. Je vous accorde le bénéfice du doute, monsieur le rapporteur : sans doute n'étiez-vous animé que de bonnes intentions. Cependant, j'estime que vous poursuivez un mauvais objectif en proposant une mesure qui n'aura pour effet que de stigmatiser – il suffit de voir comment cette mesure peut être interprétée. Moi qui suis élu de Trappes, je peux vous dire que les jeunes de ma commune n'ont pas pour unique vocation de travailler dans les centres d'appel : à Trappes, il y a aussi de jeunes diplômés capables de faire autre chose que de répondre au téléphone dans un centre d'appel – et cela vaut pour les quartiers nord d'Amiens, comme pour bien d'autres quartiers, bien d'autres communes. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Attention au réflexe consistant à stigmatiser de manière systématique ! Nous traversons une période où il est plus judicieux de chercher à réconcilier les Français, à retisser le fil de la toile entre tous nos concitoyens. J'aimerais que la question cruciale de la lutte contre les délocalisations ne soit pas une nouvelle occasion de stigmatiser l'étranger. C'est la raison pour laquelle je demanderai le rejet de cette proposition de loi.

J'appelle maintenant les articles de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement, puisque la commission n'a pas adopté le texte.

Nous souhaitons, avec l'amendement n° 2 , rappeler que sont concernés non seulement les services privés, notamment ceux liés au téléphone, mais aussi les services publics, qui ont fait la une de l'actualité au mois de juillet. Il n'est pas exclu que, demain, les services publics se mettent à délocaliser une partie de leur activité, ce qui serait redoutable pour l'emploi en France.

Je ne demande pas l'avis de la commission, puisque j'ai compris que celle-ci a rejeté l'amendement.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

L'amendement n° 3 vise à préciser que les informations relatives à l'implantation géographique des centres d'appels doivent figurer sur tous les documents commerciaux ou contractuels y afférents, y compris en matière de services publics.
J'en profite pour insister sur un point : les emplois en centres d'appel ne sont peut-être pas valorisants, mais ils ont le mérite d'exister ! Dans ma circonscription dominée par le secteur agro-alimentaire, les jeunes femmes qui partent au travail à quatre heures du matin, dans le froid, pour un salaire dépassant rarement le SMIC, seraient souvent bien contentes de trouver un tel emploi. Demain, on va peut-être les en priver si on n'autorise pas l'identification géographique, pour permettre aux consommateurs de faire des choix. Réfléchissez-y, mes chers collègues.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 4 portant article additionnel après l'article 2.

Je n'imagine pas que l'amendement n° 4 puisse être repoussé par nos collègues socialistes, car il est de nature à nous rassembler tous.
Afin de permettre aux personnes sourdes et malentendantes d'accéder aux services clients des centres d'appel, il faut concevoir des dispositifs – sur la base d'envois de SMS ou de mails, par exemple – leur faisant parvenir les mêmes informations que celles dont disposent les autres utilisateurs. C'est du bon sens, et un certain nombre d'entreprises ne nous ont d'ailleurs pas attendus, en mettant d'ores et déjà en place de tels dispositifs.
Notre amendement a pour objet d'inciter le maximum d'entreprises à en faire de même, à l'image des principes affirmés par la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. S'il n'y a qu'un élément à retenir dans cette loi, vous n'avez qu'à rayer tout le reste, monsieur le président de la commission des affaires économiques, mais retenez au moins cette proposition ! C'est là un élément attendu par les associations et qui ne pose pas de difficulté particulière – je ne vois pas, en l'occurrence, comment vous pourriez nous reprocher ici de stigmatiser qui que ce soit.

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 4 pose une vraie question et apporte une vraie réponse. Mais quand vous nous suggérez de garder cette proposition et de « rayer tout le reste », monsieur le rapporteur, je ne vois pas comment nous pourrions le faire. Car si nous rayions tout le reste, comme vous dites, il ne restera plus rien à quoi l'accrocher ! Rien que du point de vue juridique, il est impossible que votre proposition de loi puisse se réduire à ce seul amendement – qui n'a, au demeurant, pas grand-chose à voir avec le reste.
Certes, cette suggestion recueille l'approbation de la plupart d'entre nous, et il nous revient de mener un travail de réflexion afin de pouvoir apporter rapidement des éléments de réponse aux personnes concernées. Cependant, vous reconnaissez vous-même que la mesure proposée n'a pas un rapport très étroit avec le reste de votre proposition de loi, d'où votre invitation à « rayer tout le reste ». Mais si on raye tout le reste, l'amendement n'est plus accroché à rien, donc il n'existe plus, et le souhait que vous exprimez se met à ressembler à de l'inconséquence, monsieur le rapporteur.

Je veux revenir sur l'accusation selon laquelle nous stigmatiserions les travailleurs étrangers. Elle me choque profondément. Quand nous demandons une plus grande traçabilité, c'est dans l'objectif d'enrayer les délocalisations et même, si possible, de favoriser la création de nouveaux centres d'appel en France. De la même façon qu'un produit fabriqué en France crée du travail en France, un service élaboré en France crée du travail en France ! Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais de favoriser l'emploi en France.

Pour louable qu'il soit dans son intention, cet amendement illustre à nouveau le caractère incomplet de la proposition de loi qui nous est soumise. Il n'est fourni aucune précision sur le type de dispositif à mettre en place, et on sait très bien que quand le législateur ne pose aucune règle précise, aucune sanction, les règles qu'il pose ne sont pas suivies d'effet – en l'occurrence, une telle disposition ne serait d'aucun effet sur l'amélioration de l'accessibilité des services.

Par ailleurs, au risque de vous paraître un peu désagréable, je dirai que ce n'est pas en rafistolant votre proposition avec ce type d'amendement que vous nous ferez changer d'avis sur sa qualité, monsieur le rapporteur. On se demande même si cet amendement n'a pas été déposé uniquement pour la forme, pour venir au secours d'un texte très pauvre dans son contenu. C'est là faire peu de cas d'un sujet aussi important que celui de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Je rappelle que cette proposition de loi est censée aider à la relocalisation des emplois de services dans le secteur des centres d'appel. Si l'intention manifestée par l'amendement n° 4 est louable et peut parfaitement être reprise par le Gouvernement dans le cadre d'autres textes, elle n'a pas vraiment sa place au sein de ce texte. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Je regrette cet avis défavorable. L'amendement n° 4 permettait d'adresser un signal simple, clair, peu coûteux et susceptible de rassembler tout le monde, et je regrette que nous ne puissions pas envoyer ce signal.
Je me rappelle d'ailleurs, mes chers collègues de la majorité, que vous n'aviez pas voté la loi de 2005, même si vous vous en réclamez aujourd'hui. Or il s'agit d'une grande loi pour le monde du handicap.
Mais comme je suis un esprit positif, je retiens le propos du ministre selon lequel cette idée, et peut-être même le texte de cet amendement, pourrait trouver une transcription dans un avenir proche.
(L'amendement n° 4 n'est pas adopté.)

Nous avons achevé l'examen des articles de la proposition de loi.
L'Assemblée ayant rejeté tous les articles de la proposition, il n'y aura pas lieu de procéder au vote solennel décidé par la Conférence des présidents.

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier portant création des principes d'adaptabilité et de subsidiarité en vue d'une mise en oeuvre différenciée des normes en milieu rural (nos 142 rectifié, 206).
La parole est à M. Pierre Morel-A-L'Huissier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Madame la présidente, madame la ministre déléguée chargée de la décentralisation, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, avant de vous exposer très précisément le sens et la portée de ma proposition de loi, à laquelle j'associe bien volontiers mes collègues Étienne Blanc, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec et tous les députés de l'UMP, en remerciant tout particulièrement le président du groupe, Christian Jacob, d'avoir accepté d'inscrire cette proposition au tout début de notre session parlementaire, je voudrais vous rappeler la genèse de cette initiative.
Je suis député de la Lozère, l'unique député d'un département ô combien rural, et président du collectif parlementaire sur la ruralité. Je n'ai cessé, depuis 2002, de prôner la défense de la ruralité et de ses particularismes.
Après dix ans de mandat, je peux affirmer que l'on ne connaît pas, à Paris, la ruralité – les ruralités – de notre pays.

Vous aurez l'occasion de constater, madame la ministre déléguée, qu'il y a en la matière une véritable inculture de nos pouvoirs publics et de nos administrations centrales. L'Aveyron est une chose, Paris en est une autre !
Pourtant, la ruralité, c'est 80 % du territoire français et 11 millions d'habitants ; 50 % des communes en France ont moins de 426 habitants. Les problèmes y sont multiples : ingénierie publique, organisation de l'État, ATESAT – l'assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire –, péréquation, haut et très haut débit, agriculture, forêts, artisanat, commerce, tourisme, attractivité économique, zonage européen, désertification médicale, accès aux soins, urbanisme, ou encore monde associatif, cher à Yannick Favennec.
Face à ce constat, la réponse institutionnelle est affligeante : la DATAR, véritable « machin » inefficace et totalement inadapté, ne sert qu'à produire des documents de prospective qu'aucun citoyen ne lit.

À cela s'ajoute la complexité des politiques publiques interministérielles, qu'aucun gouvernement n'a su réellement prendre en considération ces vingt dernières années.
Pour tout vous dire, je suis très inquiet quant à notre capacité aujourd'hui, à droite comme à gauche, à porter une volonté politique forte en faveur des territoires ruraux.

On bavarde beaucoup dans les colloques, dans les associations d'élus, voire dans les états généraux de la démocratie locale. Je crains d'ailleurs que cette dernière montagne n'accouche que d'une très, très petite souris dans les semaines à venir.
Ce que je dis aujourd'hui, je le disais déjà hier ; c'est pourquoi j'avais demandé au précédent Président de la République de me confier une mission d'expertise sur la ruralité, ce qu'il fit en octobre 2011. J'ai ainsi scruté et analysé les problématiques de nos territoires.
Le rapport, le voici : il ne compte pas moins de 300 pages et 200 mesures et propose une architecture innovante en matière d'aménagement du territoire.
Ce travail, remis à l'ancien Président de la République au mois de mai, a également été porté à la connaissance du nouveau, François Hollande, qui m'a fait, le 21 juin 2012, la réponse suivante : « Les propositions contenues dans votre rapport constituent une contribution utile au travail gouvernemental qui s'engage et je serai attentif aux suites qui pourront leur être données ».

Je tenais à faire ces observations liminaires pour bien faire sentir à la représentation parlementaire qu'il s'agit pour moi, non pas d'un coup politique, mais bien d'une conviction enracinée au plus profond de moi-même.
Pour avoir vécu les débats artificiels et creux sur le bouclier rural, qui ne comportait aucune mesure et qui, de l'aveu même de l'un de nos collègues socialistes, Michel Vergnier, était un simple « clin d'oeil » à la ruralité,…

…je ne pouvais pas aujourd'hui vous proposer un texte mal préparé et relevant de l'artifice.
Comme je l'ai fait dans le cadre du « plan Marshall » que j'ai porté lors de la précédente législature, je vous propose aujourd'hui, après avoir rencontré un certain nombre de juristes et m'être rendu au Conseil d'État, ainsi qu'au Conseil constitutionnel, la création de deux grands principes du droit – la proportionnalité et la subsidiarité –, dans le strict respect de l'article 72 de la Constitution. Ces deux grands principes viendraient en complément du principe d'égalité et du principe de précaution. Je sais que nous ferons ainsi oeuvre utile, car tous les acteurs de nos territoires se plaignent de la complexité et de l'inflation normatives.
Les états généraux de la démocratie territoriale, que vient d'organiser le Sénat, ont été l'occasion pour les élus locaux de faire connaître quels étaient leurs préoccupations, leurs difficultés et leurs espoirs dans l'exercice des responsabilités locales.
Un constat majeur a fait l'objet d'un consensus : les élus ploient sous la charge grandissante, irritante et exorbitante des normes qu'on leur demande de respecter ou de mettre en application.
Le Président de la République l'a reconnu la semaine dernière, en estimant que « nous ne pouvons plus accepter cette situation en termes de coût pour les collectivités, en termes de délai pour les procédures. » Il a également souhaité que le droit des collectivités à expérimenter et adapter les normes qui leur sont applicables soit étendu.
Alors que la commission des lois du Sénat a examiné hier la proposition de M. Doligé, le président du Sénat, M. Jean-Pierre Bel, a demandé hier à cette même commission et à la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales de proposer un texte visant à la simplification des normes. Ce texte existe d'ores et déjà ; il est devant vous !
La proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui traduit ces déclarations politiques en principes juridiques. Elle reste perfectible, mais elle est une première avancée. Il y a en effet aujourd'hui urgence à agir : il est temps de passer du constat à l'action. Même si la commission des lois a, hélas ! repoussé ce texte, la discussion publique devrait permettre d'améliorer son dispositif et, je l'espère, de faire évoluer les esprits à son encontre.

Le sujet des normes est récurrent depuis une vingtaine d'années. Le diagnostic posé par le Conseil d'État dans son rapport public de 1991 en mettait en évidence les conséquences, tant en termes d'intelligibilité, de crédibilité du droit et de sécurité juridique, que de coût pour les administrés chargés de l'appliquer. Sa conclusion est restée fameuse : « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite ». Pourtant, quinze ans après, la même institution n'a pu que constater que le phénomène s'était encore développé.
Nous autres, parlementaires, sommes bien placés pour être tantôt témoins, tantôt contributeurs de ce phénomène. Ainsi, pour prendre comme seul exemple la loi relative aux territoires ruraux de 2005, le texte comptait 74 articles à sa sortie du Conseil des ministres et 240 après la discussion parlementaire. Il prévoyait en outre 85 décrets d'application, dont je ne suis pas sûr qu'ils aient été tous publiés à ce jour.
Trois rapports ont récemment mis en évidence le poids de cette inflation normative pour les collectivités territoriales : celui de M. Belot, celui de M. Doligé et le mien, que j'ai présenté avec trois de mes collègues ici présents. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'à travers 8 000 lois apparaissent 400 000 normes. Ce sont 2,3 milliards d'euros qui étaient engagés fin 2011 par les collectivités pour la simple mise aux normes imposée entre 2009 et 2011. Or les prescripteurs de normes sont toujours plus nombreux ; parmi eux, il faut citer l'Union européenne et l'Association française de normalisation, l'AFNOR. Tout cela forme un magma dans lequel on n'arrive plus à se retrouver.
Plusieurs facteurs tendent à aggraver cette tendance. Nous sommes victimes d'un véritable zèle normatif, lié à la croyance inconditionnelle dans les vertus de la norme et dans sa capacité à servir l'intérêt général. Cette dérive touche aussi bien les responsables politiques que les représentants d'intérêts particuliers exerçant leur lobbying pour obtenir une loi emblématique, ou encore les médias, qui mettent sous pression les responsables politiques pour les amener à légiférer dans l'urgence. La norme devient ainsi une tentative de légitimation de sa propre existence : « Je réglemente, donc je suis ».
Face à ce constat, trois solutions ont été proposées ces dernières années : la création de la commission consultative d'évaluation des normes, le moratoire instauré en 2011 et la nomination d'un commissaire à la simplification.
La commission consultative d'évaluation des normes, présidée par Alain Lambert, a fait du bon travail ; elle a examiné 287 projets de texte en 2011, contre 176 en 2010. Il lui faudrait environ 2 000 ans pour analyser notre socle de 8 000 lois et 400 000 textes normatifs. D'où la portée très relative de cette commission. Il en va d'ailleurs de même pour le moratoire de 2010 et pour le travail, certes honorable, du commissaire à la simplification, nommé en novembre 2010.
Mes chers collègues, on voit très clairement que les solutions fondées sur l'autorégulation ont des limites intrinsèques. C'est pourquoi la présente proposition de loi fait confiance à l'intelligence des territoires, de leurs élus et de leurs acteurs, en vue de substituer aux normes réglementaires d'application des mesures adaptées à la réalité et à la diversité des situations locales. Elle tend à introduire dans le droit français un double principe de proportionnalité et de subsidiarité. Pour ce faire, elle s'appuie sur les principes inscrits dans l'article 72 de la Constitution.
Le principe de subsidiarité, d'abord, résulte de l'alinéa qui dispose : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon ». Le pouvoir réglementaire autonome ou délégué, ensuite, est prévu par notre Constitution depuis 2003.
Ce texte permet de faire confiance à l'échelon local pour appliquer les lois tout en tenant compte des réalités du terrain. Il instaure deux régimes distincts de dérogation aux normes réglementaires prises par les administrations centrales pour l'application d'une loi, tout en s'appuyant sur des critères similaires : en application de leurs prérogatives constitutionnelles et dans le cadre de l'exercice de leur compétence propre, les collectivités territoriales, mais aussi les autres personnes publiques, pourront décider d'arrêter des mesures adaptées, alors que les personnes privées pourront solliciter une dérogation auprès du préfet, après avis d'une commission multipartite de médiation.
Dans les deux cas, la faculté de s'affranchir des dispositions réglementaires est strictement encadrée. Le critère permettant d'invoquer le nouveau régime de dérogation est celui de l'inadaptation, pour les personnes publiques, ou de la disproportion, pour les personnes privées, entre les moyens – matériels, techniques ou financiers, notamment lorsqu'il s'agit de petites collectivités – nécessaires à la mise en oeuvre d'une réglementation et les objectifs déterminés par la loi, eu égard à la configuration particulière et aux besoins constatés localement.
C'est donc uniquement lorsque la norme réglementaire édictée par les administrations centrales – encore elles ! – aboutirait à des résultats absurdes, contrevenant à l'esprit de la loi et à la volonté du législateur, qu'elle pourrait faire l'objet d'adaptations. Seuls les actes réglementaires pris pour l'application d'une loi seraient concernés. Les textes se bornant à transposer une directive européenne ou un autre engagement de la France seraient exclus de ce régime.
Ce texte reste cependant perfectible. C'est pourquoi j'ai déposé dix-huit amendements qui visent à faire en sorte de s'assurer qu'il respecte tout à la fois le texte constitutionnel et le principe d'égalité.
Comme le rappelle le Conseil constitutionnel, l'égalité ne peut s'exercer qu'entre des personnes placées dans une situation similaire. Comment parler d'égalité, madame la ministre – vous connaissez ces problèmes – entre les moyens d'une métropole et ceux d'une commune rurale ?

C'est pourquoi un amendement visera à permettre au Gouvernement de préciser, norme par norme, les critères permettant d'y déroger.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, que j'ai rencontrés dans le cadre de ma mission, me l'ont confirmé : il est possible de mettre en place des normes différenciées, prenant en compte les spécificités de certaines collectivités, mais dans un cadre légal précis et encadré, comme celui que je vous propose.
Je vous demande, mes chers collègues, d'oublier un peu la politique et les idéologies. La ruralité et les territoires, cela va au-delà des clivages. Faisons un bout de chemin ensemble ; c'est l'objectif de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la décentralisation.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, le sujet de cette proposition de loi se trouve au coeur des préoccupations de nos concitoyens, et, pour cette raison, ne saurait être éludé.
Vous avez parfaitement démontré, monsieur le rapporteur, la place que tiennent les normes dans notre quotidien. Qui d'entre nous ne peut citer l'exemple d'une norme qui, dans sa vie d'élu, est venue poser problème pour des raisons très pragmatiques, compliquées souvent d'enjeux financiers ?
L'inflation normative que vous avez relevée a créé des situations que le Père Ubu aurait pu inventer, lui qui imaginait, pour transporter son armée contrainte de marcher à côté de ses chevaux pour ne pas les fatiguer, des voitures à vent, dans un pays sans vent !
Selon une étude conduite par l'association des maires de France, plus de 400 000 normes techniques s'imposeraient aux collectivités territoriales, chiffre impressionnant qui ne manque pas de nous interroger, nous tous qui sommes ici. Cette inflation est en effet la conséquence d'une législation dont nous portons chacun, dans notre rôle de législateur, une part de responsabilité.
Je ne peux donc que me féliciter avec vous de cette prise de conscience de la nécessité de revenir à des règles de bon sens et équilibrées, dans les contraintes qu'elles imposent.
C'est le sens d'ailleurs des démarches engagées à l'occasion des réflexions conduites par le sénateur Claude Belot et transcrites en février 2011 dans son rapport sur « la maladie de la norme » et par son collègue Éric Doligé, qui remettait en juin 2011 un rapport sur « la simplification des normes applicables aux collectivités locales ».
C'est aussi le sens de cette proposition de loi. Je me rappelle fort bien avoir été parmi les personnes entendues à l'occasion de la mission que vous conduisiez, monsieur le rapporteur, avec vos collègues Étienne Blanc, Daniel Fasquelle et Yannick Favennec lors de votre déplacement dans le département de l'Aveyron, afin de mesurer les conséquences des normes sur le développement des territoires ruraux.
Dans une belle unanimité, nous avions souligné l'absolue nécessité de tordre le cou à ce que j'ai entendu appeler l'« incontinence normative », et de faire confiance à ce que vous désignez des beaux mots de « l'intelligence des territoires ».
Intelligence des territoires portée par des collectivités territoriales qui disent de plus en plus haut et de plus en plus fort qu'elles manquent de moyens humains, techniques et financiers pour faire face aux contraintes normatives qui s'imposent à elles, et cela à un moment où, moins qu'avant, elles peuvent compter sur les services techniques de l'État, qui leur apportaient expertise et appui technique.
Le sentiment partagé d'une inflation normative supportée par les collectivités territoriales et des difficultés particulières rencontrées par les plus petites d'entre elles pour mettre en oeuvre ces normes, nous impose de nous saisir de ce problème et d'y apporter des réponses.
Je veux voir dans la convergence des réflexions actuelles le signe de l'obligation qui nous est faite. Ainsi en est-il des réponses apportées par les élus dans le questionnaire qui leur avait été adressé pour préparer les États généraux de la démocratie territoriale : le sujet des normes est revenu de façon récurrente.
Lorsque, à l'occasion de ces mêmes États généraux, je me suis déplacée dans un certain nombre de départements qui m'avaient invitée à entendre les conclusions des élus, tous sans exception ont dit leur inquiétude, voire leur exaspération. Ces inquiétudes, encore, étaient audibles lors des journées de clôture organisées par le Sénat les 4 et 5 octobre.
Le Président de la République a bien entendu votre message, celui des élus, quel que soit leur territoire. Dans le discours qu'il a prononcé lors des États généraux, il a proposé d'une part qu'aucune nouvelle norme ne soit décidée sans l'avis favorable de la Commission consultative d'évaluation des normes, d'autre part que toute norme réglementaire qui n'aura pas été confirmée de manière expresse à une date fixée par la loi devienne immédiatement caduque, et qu'enfin toute nouvelle norme soit accompagnée de la suppression d'une norme existante. De telles préconisations sont de nature autant à réduire le stock des normes existantes qu'à limiter le flux des nouvelles normes.
Il existe une convergence de vues sur les objectifs à atteindre, objectifs qui sont au coeur de cette proposition de loi. Les moyens pour y parvenir peuvent prendre des voies différentes, mais ils doivent, dans tous les cas, s'inscrire dans notre cadre constitutionnel et le respecter.
Je voudrais rappeler ici trois principes intangibles. Le premier, posé par l'article 72 de la Constitution, est que les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Le deuxième, prévu à l'article 21 de la Constitution, fonde l'articulation de ce pouvoir réglementaire avec le pouvoir réglementaire général confié au Premier ministre. Enfin, le principe d'égalité des citoyens devant la loi n'autorise les différences de traitement que si elles sont justifiées par un intérêt général suffisant, en rapport avec la nature et l'objet des dispositions en cause.
Au regard de ces trois principes se pose la question de l'adaptation des normes réglementaires d'application d'une loi en fonction de certaines circonstances locales. Le législateur peut-il, sans méconnaître l'article 21 et le principe d'égalité, renvoyer directement au pouvoir réglementaire des collectivités territoriales le soin d'édicter des mesures d'application d'une loi ?
C'est un point sur lequel nous souhaitons connaître l'expertise du Conseil d'État, que le Gouvernement vient de saisir en ce sens. Sa réponse sera déterminante, vous n'en doutez pas, pour l'appréciation de notre doctrine.
Vous comprendrez, dès lors, mesdames et messieurs les députés, que ce texte peut avoir suscité des interrogations. Comme la commission des lois, je m'interroge sur l'article premier, qui permet aux collectivités locales de mettre en place des mesures de substitution aux normes réglementaires dès lors qu'elles considèrent leur mise en oeuvre disproportionnée au regard des circonstances locales, et sur l'article 2, qui donne la possibilité à l'autorité publique concernée ou au préfet de département d'accéder à la demande de personnes qui proposeraient des mesures de substitution répondant aux objectifs fixés par la loi. J'ajoute que ces dispositions, en tant que telles, ne s'appliqueraient qu'en milieu rural. La question principale est donc celle de leur constitutionnalité.
S'il est possible à la loi de prévoir des critères de dérogation individuelle aux mesures générales qu'elle fixe, c'est à la condition que le législateur ait défini avec une précision suffisante, directement ou par renvoi encadré au décret d'application, les conditions auxquelles ces dérogations doivent répondre, notamment la nature et l'objet des mesures de substitution qui peuvent être prises.
Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 2011 qui, s'agissant d'un problème d'accessibilité des personnes handicapées à des locaux, considère « qu'en adoptant de telles dispositions qui ne répondent pas à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le législateur n'a pas précisément défini l'objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour assurer l'accessibilité aux bâtiments ; que le législateur a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que par suite, l'article 19 de la loi est contraire à la Constitution. »
Le texte que nous examinons et qui propose de conférer aux collectivités territoriales ou aux préfets de département le pouvoir d'adapter les mesures réglementaires d'application de la loi, risquerait, outre de méconnaître cette jurisprudence ainsi que l'article 21 de la Constitution, de se heurter aux exigences du principe d'égalité devant la loi.
Si ce principe ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que des différences de situations puissent justifier des différences de traitement, c'est à la condition que les distinctions opérées reposent sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec l'objet de la loi qui les établit.
C'est pourquoi, afin de poursuivre l'objectif consistant à remédier aux contraintes entraînées dans certaines circonstances, notamment pour certaines collectivités, par l'application de certaines mesures réglementaires, il appartient au législateur, dans des différents domaines d'intervention, de donner au pouvoir réglementaire un cadre juridique suffisamment précis pour lui permettre, lorsque cela est possible au regard des principes constitutionnels applicables, de prévoir les adaptations tenant compte notamment de la situation des collectivités territoriales de faible capacité financière, ou des dérogations individuelles pour des catégories objectivement déterminées de collectivités territoriales.
Les normes qui peuvent être en cause sont en effet très diverses et elles appellent chacune, de la part du législateur, une appréciation au cas d'espèce de son caractère plus ou moins contraignant, selon la nature des intérêts qu'elle entend protéger et des critères des mesures d'adaptation souhaitées. Une disposition législative qui entendrait énoncer, de manière générale, ce que le législateur peut prévoir en matière d'adaptation, selon quels procédés et sans quelles limites, risquerait d'être réductrice et serait soit inconstitutionnelle soit non normative.
Aux objections que je viens d'apporter en droit sur le fond de cette proposition et qui rejoignent celles formulées par les membres de la commission des lois, je voudrais ajouter une objection de forme.
En effet, l'intelligibilité du texte est quelque peu brouillée par le fait que le périmètre des dispositions de l'article premier, applicables aux collectivités territoriales, et de l'article 2, applicables à toute autre « personne », apparaît très imprécis.
L'article premier ouvre la possibilité d'aménager les normes réglementaires nécessaires à la disposition législative sans que la nature du vecteur ou celle de son auteur soit précisée. À l'article 2, la notion de « personne » ne permet pas de bien circonscrire les bénéficiaires de la mesure. C'est un peu comme si le mot « personne » était ici utilisé dans son sens étymologique, persona signifiant « masque ». L'identification des personnes physiques ou des personnes morales susceptibles d'être concernées est impossible.
Sans aller plus loin dans l'analyse de ce texte, sans avoir à développer d'autres éléments, le Gouvernement a pris toute la mesure du problème que voudrait régler cette proposition de loi.
Cependant, ce texte n'est pas à la hauteur des enjeux relevés très régulièrement par la Commission consultative d'évaluation des normes que préside Alain Lambert. Celle-ci a souligné, dans son rapport d'activité de 2011, la progression des dépenses consécutives à l'application des normes réglementaires : 2 milliards d'euros par an. À cela s'ajoutent, chacun l'a souligné, la lourdeur, la complexité, l'encombrement des procédures liées à leur application.
Face à cette inflation normative, le Gouvernement, comme les parlementaires, veut trouver des solutions. Outre M. Morel-À-L'Huissier, les députés Michel Vergnier et Daniel Boisserie et le sénateur Eric Doligé ont déposé des propositions de loi. Le président du Sénat Jean-Pierre Bel, au lendemain des états généraux de la démocratie territoriale, a demandé à la délégation aux collectivités territoriales, présidée par Jacqueline Gourault, et à la commission des lois, présidée par Jean-Pierre Sueur, de faire des propositions pour donner corps aux propos tenus par le Président de la République sur les normes.
Tout laisse donc à penser que la conjonction de vos réflexions, monsieur le rapporteur et de celles de vos collègues parlementaires, saura trouver la voie juste d'un processus dans lequel les normes – ces instruments qui permettent de mettre d'« équerre », au sens premier du mot latin norma – ne seront plus pour les collectivités territoriales que les outils raisonnés de la protection du citoyen. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste ainsi que sur plusieurs bancs du groupe UMP.)

La parole est à M. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le président de la commission des lois que j'ai l'honneur d'être n'a pas de chance avec les deux propositions de loi qui lui sont proposées par le groupe UMP.
Alors que son objet – les gestes qui sauvent – nous convenait, nous avons été contraints de rejeter la première puisque nous estimions qu'elle relevait du domaine réglementaire ; la seconde poursuit un objectif que nous partageons, mais nous considérons que, compte tenu, de son écriture, vous rendriez un très mauvais service à la cause que vous voulez défendre en nous offrant la possibilité de l'adopter. Donc, pour votre bien, monsieur le rapporteur, et pour celui des collectivités que vous voulez défendre, nous allons être contraints de la refuser, comme nous l'avons fait en commission. (« Dommage ! » sur les bancs du groupe UMP.)
Vous avez défendu tout à l'heure les raisons pour lesquelles vous présentiez ce texte ; je vais, pour ma part, me permettre de revenir sur les raisons pour lesquelles la commission des lois de l'Assemblée nationale n'a pas jugé bon de vous suivre.
Cette proposition de loi ne manque pas de mérites. Le premier d'entre eux est de s'atteler à un problème qui, depuis trop longtemps, contrarie les élus locaux en général et les maires en particulier, dans l'exercice de leurs missions.
Vous avez à juste titre, madame la ministre, évoqué l'incontinence normative, expression imagée qui rend bien compte de l'ampleur d'une dérive que nul ne semble plus capable de juguler. C'est comme une machine qui, après avoir échappé au contrôle de ses créateurs, serait devenue folle, portée par sa propre dynamique.
On connaît les chiffres, ils donnent volontiers le vertige. L'adaptation à cet univers mouvant, en constante évolution, réclame de la part des administrations locales une énergie considérable et, au-delà, se révèle extrêmement onéreuse, puisqu'en 2009 et 2010 l'incidence budgétaire des 339 « projets de norme » émanant de l'État a été évaluée à plus d'un milliard d'euros de dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales.
Le mal, au demeurant, est diagnostiqué de longue date. En 1991 déjà, le Conseil d'État avait eu à se pencher sur la prolifération des normes et sur les difficultés qu'elle provoquait, notamment pour les communes. Le phénomène n'a pourtant fait que s'aggraver depuis, et dans des proportions considérables.
Certes, des initiatives ont été prises ces dernières années – vous les avez rappelées –, mais ni la commission consultative d'évaluation des normes instituée en 2007, ni le moratoire instauré en juillet 2010, ni le commissaire à la simplification désigné en novembre 2010 n'ont permis de canaliser ce flux normatif, de l'enrayer ou, mieux, de le ralentir.
Le texte que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, prend acte de cette impasse, que personne ne conteste. Vous nous proposez des solutions ; nous les trouvons aventureuses et, avant de relâcher l'étau normatif qui enserre l'action publique locale, nous voudrions être certains de disposer d'un outil vraiment efficace.
Vous préconisez deux régimes distincts de dérogation aux normes réglementaires, dispositifs dont la mise en oeuvre pourrait permettre à l'échelon local d'adapter une loi en fonction des réalités du terrain. On ne peut balayer une telle proposition d'un simple revers de main, et c'est la raison pour laquelle vous apprécierez sans doute que la commission des lois et la majorité de notre assemblée aient souhaité que ce débat ait lieu, contrairement à l'époque où des propositions de loi déposées par l'opposition étaient écartées, les votes renvoyés. Nous souhaitons, nous, aller au fond du sujet, car nous respectons l'opposition, les combats qu'elle porte et les solutions qu'elle propose, quand bien même nous n'en mesurons pas forcément l'intérêt.
Votre proposition est donc intéressante, d'abord parce que, sur le plan formel, il s'agit d'un texte qui évite l'écueil des considérations fourre-tout. Il est concis – quelques articles – et centré sur un enjeu clairement identifié.
Sur le fond ensuite, il s'inspire de principes généraux, dont notre culture politique, volontiers centralisatrice, peine trop souvent à reconnaître le bien-fondé : la vérité d'un territoire n'est pas forcément celle de son voisin ; l'égalité n'est pas l'uniformité.
Pour autant, votre texte a l'inconvénient d'être trop imprécis dans sa formulation. Certes, vous pourriez me répondre que c'est le travail de la commission que de corriger les imprécisions…

Mais la tâche était précisément si vaste que nous nous serions perdus et nous avons préféré aller directement à l'essentiel.
Certaines des questions que vous posez sont en suspens, et vous préconisez des mécanismes qui échapperaient difficilement – la ministre l'a rappelé – à une censure du Conseil constitutionnel.

Je reviens sur deux éléments que vous évoquez pour justifier nos réserves. D'abord la notion de « moyens inadaptés » ou de « moyens disproportionnés » invoqués pour justifier le recours par les collectivités aux dispositifs de dérogation nous paraît beaucoup trop vague, trop inconsistante et susceptible dès lors d'alimenter des contentieux sans fin qu'il incomberait fatalement à la justice administrative de trancher.
Nous comprenons mal, par ailleurs, qui au bout du compte est censé bénéficier de cette loi : son intitulé fait référence au « milieu rural », tandis qu'il n'en est nullement question dans le corps du texte. Il s'agit au demeurant d'un concept plus sociologique ou économique que juridique, mais pourquoi alors présenter la proposition de loi comme étant de nature à profiter aux seuls maires ruraux, alors qu'elle concerne en réalité l'ensemble des collectivités locales, urbaines comprises ? Il y a là, à notre sens, une ambiguïté certaine dont le droit, par principe, s'accommode mal.
D'autre part, est-il réellement concevable d'octroyer, comme vous proposez de le faire, une faculté d'adaptation de la norme commune à l'ensemble des collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public ? N'en résulterait-il pas, de manière mécanique, une dilution et un éclatement du pouvoir réglementaire proprement ingérables ? À ma connaissance – mais elle est peut-être lacunaire – aucun pays européen n'a emprunté cette voie. Le pouvoir normatif, généralement, est concédé à un seul échelon décentralisé, le plus souvent l'échelon régional.
Il faut également parler du risque d'inconstitutionnalité, et je regrette, comme je vous l'ai dit en commission, monsieur le rapporteur, que vous n'ayez pas pu ou pas voulu soumettre votre proposition de loi à l'examen du Conseil d'État, les délais ne le permettant sans doute pas. Cela étant, le Conseil d'État s'était déjà prononcé sur le texte du sénateur Doligé, qui défendait peu ou prou les mêmes orientations, et je n'ai donc guère besoin d'y revenir.
Je vois donc mal comment le Conseil constitutionnel pourrait se satisfaire de la remise en cause de l'application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire, en fonction des pressions locales dont le préfet pourrait faire l'objet ou des affinités qu'il pourrait tisser.
Si le diagnostic posé par cette proposition de loi est juste, le remède qu'elle entend imposer au malade n'a donc pas fait, loin s'en faut, la preuve de son efficacité curative, et l'autorisation de mise sur le marché semble très compromise…
Il ne s'agit évidemment pas pour autant de reporter le traitement d'un problème dont nous sommes tous conscients de la gravité. Le Gouvernement va travailler en ce sens. Dans le cadre des états généraux, le Président de la République a fait des annonces, que vous avez rappelées, madame la ministre. Sera bientôt lancé, sans doute au premier trimestre 2013, un chantier de la révision générale des normes. Il s'agira d'un chantier d'envergure, piloté par le Parlement ; d'abord par le Sénat puisque cela relève de ses prérogatives – nous pouvons parfois le regretter tout en acceptant un bicamérisme dans lequel nous avons le dernier mot –, puis l'Assemblée nationale et la commission des lois.
Bref, monsieur le rapporteur, vous posez un juste diagnostic mais esquissez des réponses qui ne nous agréent pas. Nous en appelons donc à votre patience. Nous connaissons votre constance : vous saurez tenir l'objectif, garder le cap et nous interroger au moment voulu, quand le Gouvernement vous proposera un texte s'efforçant de répondre aux questions que vous nous posez. Souffrez donc que, d'ici là, nous vous demandions d'accepter le fait que la commission a refusé votre texte. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis par notre collègue Pierre Morel-A-L'Huissier recueillera évidemment l'accord de l'UMP, tant il répond à un besoin que notre formation politique a clairement identifié – mais vous nous dites, madame la ministre, et je le comprends, que c'est un sujet qui dépasse les clivages classiques qui séparent nos assemblées.
La France n'est pas le seul pays du monde à connaître cette situation. Pour avoir rapporté quelques lois de simplification qui portaient sur des domaines aussi divers que le droit des sociétés, le droit social ou le droit des collectivités territoriales, j'ai cherché dans d'autres pays d'Europe les voies et les moyens utilisés par certains membres de l'Union européenne pour apporter réponse à cette épineuse question de la prolifération des normes. Les situations sont bien différentes entre les pays centralisés, jacobins, et les pays d'essence fédérale ou confédérale, qui ont délégué aux cantons ou aux länder le pouvoir réglementaire.
La situation que nous connaissons est aujourd'hui insupportable, à la fois pour les particuliers, pour les entreprises et pour les collectivités locales : 8 000 lois, d'importance très inégale, 400 000 décrets, auxquels s'ajoutent les 6 000 textes qui traduisent les engagements internationaux de la France et aggravent la complexité, laquelle complexité a été parfaitement dépeinte par notre collègue sénateur, Éric Doligé.
Un journaliste, a écrit, il y a quelques années, un ouvrage remarquable intitulé, choix judicieux, Ubu loi. Mais la question n'est pas nouvelle. J'avais trouvé, en travaillant sur un texte, une disposition de 1871 : nous sommes encore sous l'emprise de la Commune de Paris dont certains de nos collègues cherchent parfois à nous dire que ses politiques sont encore d'actualité…

On avait donc en 1871 ajouté à un texte d'ordre pénal un article qui prévoyait « l'exception d'ignorance ». Cela concernait le domaine contraventionnel, dans lequel un certain nombre de nos concitoyens, dans le monde rural par exemple, n'avaient pas connaissance des nouveaux textes mis en oeuvre, notamment pour ce qui concerne le droit de la chasse. On avait donc permis au juge d'admettre une « exception d'ignorance » pour les cas où, de bonne foi, un texte était méconnu. Dans le maquis que nous connaissons aujourd'hui, l'exception d'ignorance devrait être la règle, et la connaissance du droit l'exception.
Le texte qui nous est soumis par notre collègue Pierre Morel-A-L'Huissier est, à notre avis, particulièrement adapté. En premier lieu il série parfaitement les cas justifiant une dérogation. Quels sont ces cas ? Nous constatons que le caractère uniforme et unique de la loi ou du règlement, s'imposant de la même manière sur l'ensemble du territoire crée des incohérences. Quelle incohérence en effet d'appliquer de la même manière dans le centre de Paris ou une commune de moindre importance, voire une commune rurale, un texte touchant à la sécurité, à l'accessibilité pour les handicapés ou aux normes sanitaires !
Le résultat est que nous imposons aux collectivités rurales des procédures lourdes, que non seulement elles peinent à mettre en oeuvre mais qui ont surtout des incidences financières gigantesques.
Ce que dit ce texte, c'est que l'on pourrait atteindre exactement le même objectif, louable, en utilisant des moyens différents, alors que la réglementation actuelle nous contraint à user de moyens totalement inadaptés, coûteux et parfois impossibles à mettre en oeuvre pour des moyens techniques. C'est parfois la complexité même qu'ils génèrent qui rend impossible l'aboutissement du projet d'origine.

Cette proposition de loi surmonte cette difficulté grâce à la notion d'équivalence : nous parviendrons au même objectif mais nous utiliserons des moyens différents.
En second lieu, je m'arrêterai sur la procédure. J'ai bien entendu Mme la ministre, selon qui l'idéal serait que la loi prévoie les conditions de la dérogation et que l'on renvoie au règlement la mise en oeuvre de ces dérogations. Mais cela ne ferait qu'accroître la complexité de la procédure. En procédant de la sorte, nous ne ferions qu'alourdir la norme, puisqu'il faudrait, dans chaque texte, rajouter un ou deux articles précisant les dérogations. Cela rendrait plus illisibles encore une législation et une réglementation qui le sont déjà.
La solution proposée par notre collègue est la bonne : un préfet avec, à ses côtés, une commission chargée d'examiner si les conditions d'une dérogation sont réunies, puis d'évaluer l'équivalence dans le résultat par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur.
Je crois que la solution est la bonne. Toute autre solution serait à nos yeux centralisatrice, contraignante et rentrerait dans l'excès.
Madame la ministre, vous avez été rejointe en cela par M. le président de la commission des lois qui, avec un esprit un peu moqueur…

…nous a dit que, finalement, ce texte était excellent sur le fond et sur la forme, rendant ainsi hommage à l'illustre Pierre Morel-A-L'Huissier, lequel connaît parfaitement bien le sujet. En tout cas, chez nous, à l'UMP, c'est un orfèvre. Vous avez dit trois choses.
D'abord, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel n'accepteront jamais ce dispositif tant ce serait remettre en cause les principes – qui datent de 1789 et plus encore de l'Empire – de l'unicité, de l'uniformité et du caractère jacobin de notre droit.
Dans le cadre de la mission que nous avons menée avec nos collègues, nous avons rencontré l'ensemble des conseillers d'État. Nous nous sommes même rendus au Conseil constitutionnel pour essayer de comprendre et être éclairés sur la perception de ce problème majeur, de cette complexité par les plus hautes instances administratives de notre pays.
J'ai été surpris, car on nous a prêté une oreille favorable. Je ne sais pas si nous avons été entendus, mais nous avons été très largement écoutés. Et, à travers les encouragements qui nous ont été donnés, nous avons vu qu'il existait aujourd'hui quelques voies et moyens pour sortir de ce problème particulièrement compliqué.
Autre sujet : notre Constitution nous permettrait-elle d'adopter ce texte ? J'ai repris les dispositions de l'article 72 tel qu'il résulte de la réforme constitutionnelle. Son alinéa 4 ouvre une porte à l'expérimentation, à ce que j'appelle une véritable décentralisation de la capacité normative. Le texte tel qu'il a été rédigé par notre collègue, au titre de l'alinéa 4 de l'article 72, nous permet aujourd'hui d'ouvrir la porte à la possibilité de déroger.
Dernier problème, enfin : le principe d'égalité. Lorsqu'il a eu à examiner les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a posé un principe qui me semble pouvoir éclairer nos débats. Selon le Conseil, le principe d'égalité interdit simplement de traiter de façon différente des situations semblables, mais il n'interdit pas pour autant de traiter de manière différente des situations différentes.
C'est précisément le problème qui nous est aujourd'hui soumis : nous sommes face à des situations différentes du fait de la géographie et de l'importance des collectivités territoriales. À nos yeux, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme ne s'oppose pas à ce que nous les traitions différemment en raison de ces caractères particuliers, à condition, bien sûr, et sous le contrôle du juge administratif, que les critères et les différences soient expliqués. Mais de grâce, que l'on ne nous impose pas, à nous législateur, de les écrire à l'avance. Je le répète, cela générerait de la complexité
Ma dernière observation sera peut-être un peu plus politique.
J'ai lu la déclaration, hier, de M. le président du Sénat, M. Bel. Je pense qu'à l'occasion des assises territoriales, on a beaucoup parlé de cela, en tout cas dans nos départements. Vous le savez mieux que nous, madame la ministre, on ne parle que de cela quand on rencontre des élus territoriaux, quand on organise des réunions d'échanges sur le fonctionnement de nos collectivités, notamment dans le monde rural ; on ne nous parle que de la complexité et du caractère insupportable des contraintes qui, du fait de normes excessives, pèsent sur les collectivités territoriales les plus petites. Le président Bel dit que c'est un vrai sujet auquel il faut maintenant apporter une réponse.
Quant à M. le Président de la République, il faut reconnaître qu'il a parfaitement compris ce que pense le pays au plus profond de lui-même et il propose aujourd'hui que nous allions plus loin.
Madame la ministre, les conditions politiques semblent réunies, ainsi que les conditions juridiques. Ce texte, en l'état, peut être adopté. Il le sera si la majorité actuelle le souhaite, pour le plus grand bénéfice de nos collectivités territoriales. Cela donnera aussi une très belle image du droit français qui, je le rappelle, a rayonné sur le monde à une certaine époque. Car je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en raison de son caractère compliqué et illisible, il ait encore la même vocation universelle. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et UDI.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais rappeler ici, dans cet hémicycle, combien les territoires sont une richesse pour notre pays, un atout pour le redéploiement économique et social de la France, qu'il convient de préserver et de valoriser. Ils sont également le ciment de l'unité et de la cohésion de notre République.
Or l'inflation, l'hystérie, je dirais même l'incontinence législative et normative qui s'est emparée de nos assemblées ces dernières années, l'alourdissement des procédures qui pèsent chaque jour davantage sur le quotidien tant de nos concitoyens que des élus locaux s'est révélé un véritable frein au développement des territoires, notamment des territoires ruraux.
Le recours croissant à la règle de droit pour réguler toutes les facettes du réel est devenu une constante dans nos sociétés contemporaines, la norme devenant ainsi l'unique moyen de résoudre les problèmes, le bon sens laissant place à l'absurdité, à des situations qui n'ont plus le moindre lien direct avec la réalité du terrain.
Peu à peu, la nécessité de restaurer, au nom des principes d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, la qualité et la lisibilité de la norme juridique s'est imposée à nous. Sous la précédente législature, notre assemblée a entrepris un important travail de simplification du droit, et nous débattions encore, il y a quelques mois de cela, de mesures de simplification du droit des entreprises.
La proposition de loi aujourd'hui soumise à notre examen nous donne l'opportunité de poursuivre ce travail de simplification. Notre collègue Pierre Morel-A-L'Huissier part d'un constat et d'une analyse très simple, que nous partageons tous au regard du débat qui a eu lieu en commission : la prolifération des normes et l'inadaptation à la réalité de terrain de décisions provenant d'administrations centralisées parisiennes constituent un frein au développement des territoires, en particulier des territoires ruraux.
À ce jour, ce sont 400 000 normes, selon l'Association des maires de France, qui doivent être respectées par les acteurs de ces territoires. Au-delà des conséquences qu'elle peut avoir en termes d'intelligibilité, de crédibilité du droit et de sécurité juridique, la prolifération des normes représente un coût pour les administrés et une charge considérable pour les collectivités territoriales : la commission consultative d'évaluation des normes parle d'un coût de l'ordre de 2,34 milliards d'euros entre les années 2008 et 2012.
Cette situation se traduit également par le découragement et la démotivation des acteurs de terrain, qu'ils soient élus ou qu'ils soient entrepreneurs, industriels, artisans, commerçants, agriculteurs ou encore responsables associatifs. Tous ressentent, au plus près du terrain, l'absurdité de certaines normes. À titre d'exemple, les états généraux de la démocratie territoriale du Sénat, dans un sondage sur la perception de la décentralisation par les élus locaux, révèlent que 68 % des élus attendent un allégement de certaines contraintes législatives et réglementaires, en particulier en matière d'urbanisme et de marchés publics.
Comment, en effet, ne pas se sentir désemparé lorsque l'on se voit obligé d'appliquer des normes toujours plus nombreuses, toujours plus complexes et inadaptées aux situations locales ? Ce malaise, nous sommes, en tant qu'élus, bien placés pour le constater. Dans mon département de la Mayenne, je mesure au quotidien ce désarroi, notamment celui des maires des petites communes. La problématique ne peut être la même entre la plus petite commune de ma circonscription, Rennes-en-Grenouille, et une ville comme Laval, Nantes ou Paris ! Les moyens financiers et humains ne sont évidemment pas les mêmes. Pourtant, les normes doivent s'y appliquer de la même façon !
J'ai pu en avoir la confirmation au cours des nombreux déplacements effectués dans le cadre de la mission sur la « simplification des normes au service du développement des territoires ruraux » que nous avait confiée le Président de la République, Nicolas Sarkozy, et dont la présente proposition de loi n'est rien d'autre que l'aboutissement.
À ce constat simple, une solution simple et efficace nous est proposée. Loin de remettre en cause notre ordre juridique, loin de mettre à mal notre hiérarchie des normes, le présent texte instaure un dispositif juridiquement solide, qui s'exerce dans un cadre juridiquement restreint et s'appuie sur les principes de subsidiarité et d'adaptabilité inscrits à l'article 72 de notre Constitution.
En outre, ce texte devrait être juridiquement applicable et recevable, car il limite de manière très étroite le champ et les possibilités de dérogation : les substitutions ne peuvent être mises en oeuvre que dans les cas où les textes adoptés par voie réglementaire pour l'application d'une loi imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en oeuvre de moyens disproportionnés au regard des objectifs recherchés et des personnes qui y sont assujetties.
Pour envisager de déroger, il faut dresser le constat qu'il est impossible d'appliquer la norme, que son éventuelle application déboucherait sur une véritable absurdité ou que le rapport entre l'objectif poursuivi et les coûts de mise en oeuvre est manifestement disproportionné.

Quelle est la réponse de la majorité face à ce constat qui semble pourtant faire consensus de part et d'autre de cet hémicycle ?
Nos collègues socialistes se sont contentés de proposer dans le passé un bouclier rural, une proposition virtuelle, un clin d'oeil au monde rural – comme le rappelait tout à l'heure Pierre Morel-A-L'Huissier – qui ne répond en rien aux attentes des habitants des territoires ruraux. Au dogmatisme, je préfère le pragmatisme de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui.
À nos collègues de la majorité qui soutiennent que ce ne serait pas le bon moment, qu'il vaudrait mieux attendre un « acte III de la décentralisation », je réponds qu'au contraire, il est grand temps d'agir pour mettre fin à la situation d'asphyxie et d'exaspération à laquelle les acteurs de terrain, et notamment les élus locaux, sont soumis.
Il est grand temps de reconnaître que l'échelon local est précisément le mieux à même de déterminer la façon dont les objectifs de la loi peuvent être mis en oeuvre dans la réalité des communes, des départements, des régions et des groupements de collectivités à fiscalité propre.
Il est grand temps, madame la ministre, de faire confiance à l'intelligence des territoires, au bon sens de leurs habitants et de leurs responsables.
Mes chers collègues, en adoptant cette proposition de loi, nous pourrions apporter une solution efficace et rapide au problème bien réel de l'inadaptation des normes en milieu rural.
Enfin, ce texte répond à l'un des besoins les plus urgents des territoires ruraux, mais nous pouvons encore agir sur d'autres thèmes : la mission sur la ruralité dont j'ai été membre a préconisé plusieurs orientations, comme l'instauration d'une nouvelle gouvernance, la réaffirmation du service au public et du service public en milieu rural.
Espérons, madame la ministre, que ces sujets pourront être abordés au cours de cette législature, dans une vision moderne et non passéiste de l'avenir de la ruralité en France, parce que, mes chers collègues, l'avenir de notre pays passe aussi par une ruralité moderne, dynamique et attractive.
Pour toutes ces raisons, le groupe UDI soutiendra sans réserve cette excellente initiative en faveur du développement de nos territoires en général et de notre ruralité en particulier. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, mes chères collègues – il me semble bien que vous êtes majoritaires ce soir, cela vaut la peine de le souligner ! –, mes chers collègues.
Disons-le, la proposition de loi présentée par notre collègue Pierre Morel-A-L'Huissier entend résoudre un vrai problème : celui de l'inflation, de la multiplication, de 1'enchevêtrement de normes et de règlements qui amènent nos élus locaux à une certaine exaspération parfois réelle, parfois feinte.
Durant la dernière législature, le Gouvernement s'était engagé à supprimer des textes législatifs considérés comme inutiles ou obsolètes et à opérer les simplifications nécessaires dans la législation. Il semble bien que cette bonne intention n'ait guère tenu dans le temps législatif et médiatique. La lutte contre la prolifération des normes, 9 000 lois et 400 000 normes réglementaires applicables sur l'ensemble du territoire, pourrait être une cause nationale. Certains la réclament, car nous sommes atteints dans notre pays d'une sorte de maladie – je ne parlerai pas d'incontinence législative –, la « généso-législative » compulsive, qui consiste à faire des lois. Nous en aurions trois fois plus que l'Allemagne ! Mais comparaison n'est pas raison…
Avec cette proposition de loi, notre collègue présente un arrangement pour supporter cette frénésie textuelle.
La proposition de loi souhaite instaurer dans notre droit un principe d'adaptabilité des normes qui serait inscrit dans le code général des collectivités territoriales : lorsque les conditions locales rendraient disproportionnée la mise en application d'une norme réglementaire, les collectivités pourraient trouver des mesures adaptées pour que le nécessaire respect de la loi ne débouche pas sur des situations absurdes.
Nous avons tous à l'esprit des exemples d'opérations abandonnées parce que l'étude d'impact coûterait dix fois plus cher que les travaux en eux-mêmes… Il faut noter qu'autrefois, les services de la DDE pouvaient se charger de l'étude et de la réalisation pour des sommes modiques alors que les cabinets d'étude actuels rendent des études très chères et un service pas toujours optimum…

C'est une idée…
Ce texte vise à donner, pour chaque loi, la possibilité de proposer des mesures d'adaptation spécifiques aux territoires ruraux. Les collectivités locales et autres personnes publiques auraient la possibilité d'y déroger, ou de proposer une dérogation au préfet assisté d'une commission locale de médiation. Le but ne serait pas de s'exonérer de la loi mais de la satisfaire de manière différente.
Les spécificités du monde rural pourraient justifier de consacrer un chapitre aux dispositions ou aménagements nécessaires. Mais cette proposition de loi est-elle en mesure de régler la surenchère législative et réglementaire ? Si l'exposé des motifs et la visée générale du texte ne posent pas problème, sa rédaction souffre de plusieurs faiblesses.
Il y a d'abord une crainte d'inconstitutionnalité. L'article 21 de la Constitution confie le pouvoir réglementaire au Premier ministre. L'on ne peut y déroger que de manière extrêmement précise et dans des cas particuliers. En principe, le pouvoir réglementaire ne se partage pas. Cependant, le Conseil constitutionnel admet que la loi elle-même prévoie, de manière très encadrée, ses propres critères de dérogation.
Ensuite, aucun critère n'est prévu dans le texte pour définir le caractère inadapté ou disproportionné d'une norme. Il en résulte un risque de contentieux et d'insécurité juridique : seul le juge administratif pourra vérifier que les mesures de substitution ont été prises pour un motif légitime et qu'elles satisfont à la loi. Les recours de particuliers ou d'associations se multiplieront et l'on fustigera l'incompétence du législateur qui n'arrive qu'à encombrer les tribunaux.
En outre, les petites collectivités risquent d'avoir du mal avec cette disposition. Dans certaines communes, le seul employé est un secrétaire. Comment imaginer qu'il ait à formuler des propositions d'adaptation de la norme ?
Par ailleurs, outre les collectivités territoriales, il semble que les syndicats par exemple et toute personne de droit public puisse se voir ouvrir ce pouvoir réglementaire. Cela pose le problème de la lisibilité de l'ordonnancement juridique. À notre sens, cette faculté d'adaptation des lois doit être réservée aux seules collectivités locales de plein exercice, en premier lieu les régions. Dans les pays fédéraux, le pouvoir d'adaptation n'est d'ailleurs donné qu'à une seule collectivité.
Enfin, conférer aux préfets un pouvoir d'appréciation de l'adaptation des normes me semble être une approche hasardeuse. Ne s'agit-il pas d'un pouvoir d'appréciation et d'opportunité manifestement excessif ? Ce pouvoir risquerait aussi de le soumettre aux pressions des élus locaux, ce qui ne peut être que préjudiciable.
Je souligne que la possibilité d'adaptation des normes existe par ailleurs déjà dans l'article 72 de la Constitution, à titre expérimental. Il est vrai que ces expérimentations sont peu fréquentes en France. À titre d'exemple, le conseil régional de Bretagne, qui a demandé la compétence dans le domaine de la culture, de l'eau et des fonds européens, ne l'a jamais obtenue…

Le champ des expérimentations n'a donc pas été poussé à un niveau intéressant.
Pour notre groupe et pour les régionalistes que je représente, le principe d'adaptabilité des normes doit être repris dans le cadre de l'acte III de la décentralisation. Les futures lois de décentralisation devront être l'occasion de s'interroger sur l'échelle d'intervention et sur le meilleur niveau où déployer, dans de bonnes conditions, l'expertise nécessaire aux adaptations des normes.
Pour nous, elles devront aller plus loin en donnant aux régions de réels pouvoirs d'expérimentation et d'adaptation locale de la norme commune, ainsi que cela se fait dans tous les pays qui nous entourent. Le dernier à s'y convertir a été le Royaume-Uni, en 1999. L'Écosse et le Pays de Galles ont aujourd'hui des pouvoirs réglementaires, ainsi qu'un budget, 20 milliards pour le Pays de Galles et 27 pour l'Écosse, qui peut faire rêver nos régions, dont le budget dépasse tout juste un milliard… Je vous fais grâce des autres pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne – la Suisse restant un cas très particulier.
Nous sommes heureux que le Président de la République ait repris son propos de Dijon lors de son allocution au Sénat à l'occasion des états généraux de la démocratie territoriale. Ainsi qu'il l'a dit, « La confiance, c'est aussi le droit à l'expérimentation. La République est une, mais elle n'est pas uniforme. Il existe, aujourd'hui, déjà un droit à l'expérimentation (…) Il sera donc élargi et assoupli afin que les collectivités locales puissent mettre en oeuvre des politiques nouvelles, des pratiques différentes ou même adaptent, comme il leur paraîtra souhaitable, des dispositifs existants ».
Et le président de la République d'insister : « La confiance ce peut être – dans des limites qui devront être bien précises – d'envisager un pouvoir d'adaptation locale de la loi et des règlements, lorsque l'intérêt général le justifie ». Et enfin : « Je ne parle pas ici simplement de l'outre-mer, qui connaît déjà cette évolution, je parle de nos régions... ».
Il nous semble en définitive que ce que propose Pierre Morel-A-L'Huissier doit être mieux défini et prendre sa place dans un projet plus vaste, plus ambitieux : celui de l'acte III de la décentralisation. Cela augure bien de nos futurs travaux.
Mon groupe parlementaire votera donc contre cette proposition de loi. À titre personnel, s'il n'était pas question de ce troisième acte, je pense que j'aurais voté pour – sans imaginer qu'elle pourrait passer sous les fourches caudines du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, mais pour bien pointer du doigt le problème. En l'occurrence, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour régler le problème, en tout cas en partie, dans la tradition bonapartiste qui est la nôtre. J'espère que nous irons assez loin – assez loin pour nous engager vers une France peut-être un jour fédérale.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur, la question des normes est un sujet récurrent depuis de nombreuses années. Exponentiel, instable, difficilement accessible, l'édifice normatif est devenu au fil des ans un véritable piège pour les collectivités territoriales.
Autant le préciser tout de suite, il n'y a pas entre nous de clivage idéologique sur ce sujet. Tous ceux qui, sur ces bancs, ont exercé ou exercent des responsabilités locales, tous ceux qui connaissent simplement le terrain, savent la complexité de situations auxquelles nous pouvons être confrontés. Nous partageons ce constat qu'il faut aider les collectivités locales à résoudre leurs difficultés, notamment pour ce qui est des travaux de mise en conformité.
Dès 1991 le Conseil d'État, dans son rapport public, pointait du doigt la « surproduction normative » et ses conséquences, en termes tant de sécurité juridique, d'intelligibilité et de crédibilité du droit que de coût pour les administrés et les collectivités.
Par la suite, plusieurs rapports ont porté sur la question, comme le rapport Belot ou le rapport Doligé, pour déboucher sur le même constat. C'est aussi dans cette logique que s'inscrit le travail de notre rapporteur à la suite de la mission que lui avait confiée le précédent Président de la République.
Selon l'Association des maires de France, 400 000 normes techniques s'imposent aux élus locaux. Elles représentent un défi technique pour un grand nombre de collectivités territoriales, mais aussi un poids financier croissant.
La lecture du rapport d'activité de la Commission consultative d'évaluation des normes est un excellent moyen de mesurer l'ampleur du problème. La Commission, qui est obligatoirement saisie de tous les textes réglementaires ayant une incidence sur les collectivités territoriales, écrit par exemple qu'entre septembre 2008 et décembre 2011, 692 textes lui ont été soumis, avec un impact pour les collectivités locales qui pourrait atteindre 2,34 milliards.
Nous partageons donc le constat et l'objectif, l'exposé des motifs et la visée générale du texte. Toutefois, il nous semble présenter des fragilités, notamment concernant sa recevabilité.
Une première série de remarques concerne le sens des mots. Le titre de cette proposition évoque une « mise en oeuvre différenciée des normes en milieu rural ». Or, le texte, tout en étant fait pour la ruralité, ne définit à aucun moment le milieu rural. En outre, aucun des trois articles ne fait véritablement référence à la ruralité. L'article 1er vise « les collectivités territoriales et toute personne morale de droit public » quand l'article 2 parle des « personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ».
Ces deux dernières notions posent aussi question. Pour le texte, c'est l'obligation de mettre en oeuvre des moyens inadaptés ou disproportionnés qui justifie que la collectivité puisse élaborer des mesures de substitution plus adaptées à sa situation. Or, ces notions ne sont pas définies par le texte et restent vagues et subjectives.
Ce qui pousse à se rappeler la sévérité du Conseil d'État dans son avis sur la proposition de loi Doligé, notamment son article 1er : aucune possibilité d'adaptation ne semble possible au Conseil si elle n'est pas préalablement définie et encadrée, dans une loi spécifique, à un domaine de l'intervention publique.
Mais au-delà se posent des questions de fond, à commencer par le pouvoir de substitution dévolu au préfet. Selon l'article 2 du texte, lorsque les normes nécessitent la mise en oeuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés, les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé peuvent proposer à l'autorité publique concernée des mesures de substitution adaptées. L'autorisation de déroger est alors donnée par le préfet du département. Cela revient à confier au préfet un pouvoir d'appréciation et d'opportunité manifestement excessif qui va à l'encontre des principes mêmes des différents actes de décentralisation que la France a connus depuis 1982.

A fortiori, un tel pouvoir risquerait aussi de le soumettre à des pressions locales préjudiciables.
La seconde interrogation porte sur la notion d'adaptabilité des normes. L'article 73 de la Constitution prévoit bien que les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités d'outre-mer. En revanche, elle ne prévoit aucune sorte d'adaptabilité pour les collectivités territoriales rurales, qu'elle ne définit ni ne distingue d'ailleurs des autres collectivités territoriales.
Ainsi, le pouvoir réglementaire local, garanti par l'article 72, alinéa 3 de la Constitution, ne peut en l'état du droit servir de justification aux collectivités pour adapter les normes juridiques. Ce pouvoir est très encadré : il est soumis au pouvoir de règlement général du Premier ministre, garanti par l'article 21, et s'exerce uniquement dans les conditions prévues par la loi et pour l'exercice des compétences des collectivités territoriales.
Cette prudence se justifie par le fait que le pouvoir réglementaire propre au Premier Ministre ne saurait être trop fragmenté. La proposition de loi, en donnant une possibilité de substitution à toutes les collectivités locales, voire à leurs groupements, et en évoquant l'éventualité d'en doter certaines personnes de droit privé, accroît ce risque de fragmentation.
Le principe d'expérimentation ne peut pas non plus servir de justification aux collectivités pour adapter les normes juridiques. En effet, l'article correspondant se borne à prévoir des dérogations à titre expérimental et pour un objet et une durée limités aux dispositions législatives ou réglementaires qui définissent les compétences des collectivités.
La troisième faiblesse sur le fond me semble être que ce texte porte en lui un risque d'atteinte au principe d'égalité devant la loi et d'égalité d'accès aux services publics, qui est un de nos principes fondateurs.
Le Conseil constitutionnel l'avait assoupli, en ne s'opposant ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit – ledit objet ne devant être ni contraire à la Constitution, ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le Conseil peut néanmoins considérer que les critères de dérogation envisagés par la loi ne sont pas assez précis et que la violation du principe d'égalité est donc manifeste. On peut se rappeler sa décision du 28 juillet 2011 à propos de la proposition de loi visant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, dont l'article 19 n'était pas sans rapport avec le présent texte.
Cet article disposait : « Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l'article L. 111-7 lorsque le maître d'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilité technique de les remplir pleinement du fait de l'implantation du bâtiment, de l'activité qui y est exercée ou de sa destination. Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ».
Le Conseil constitutionnel avait estimé que cet article était contraire à la Constitution. Nul doute alors que la proposition de loi de ce jour ne subisse le même sort, si, par aventure, elle était adoptée.
Je crois que nous ne pouvons pas prendre le risque d'ajouter l'incertitude et l'instabilité juridique à la difficulté que rencontrent aujourd'hui les collectivités locales pour l'application des normes.
Enfin, je veux dire en quelques mots que la simple adaptation des normes par les collectivités territoriales ne constitue pas une solution miracle. L'élaboration des normes requiert une forme d'expertise et repose sur des considérations techniques et scientifiques, particulièrement lorsque l'objectif est d'assurer la sécurité environnementale, médicale ou alimentaire. Par conséquent, les adapter nécessiterait la mobilisation au niveau local d'un niveau d'expertise non seulement juridique mais aussi technique que toutes les collectivités n'ont pas. En outre, si le texte prévoit l'adaptabilité des normes, il ne prévoit pas d'en stopper la production ou d'en diminuer le nombre. Il prévoit donc simplement de moduler leur application au niveau local sans s'attaquer vraiment à leur stock, alors que leur nombre est évalué à 400 000.
Nos interrogations sur cette proposition de loi sont donc nombreuses et nous amènent par conséquent à ne pas la soutenir. Trop de failles juridiques, trop de fragilités en font un texte qui nous semble relever de l'intention plus que de l'action.
Nous ne disons pas que la question de l'application des normes ne se pose pas pour un certain nombre de collectivités et de territoires. Elle se pose même cruellement, et leur multiplication au cours de ces dernières années, dans un contexte budgétaire contraint doublé d'une perte d'autonomie fiscale, a largement contribué à inquiéter les élus locaux.
La question et les problématiques de la ruralité doivent être prises en compte, mais sans opposer les villes aux campagnes. La complémentarité et la diversité des territoires de la République doivent rester une richesse qu'il convient de renforcer en tenant compte des spécificités de chacun.
Le Président de la République François Hollande, lors de son intervention devant les états généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat le 5 octobre dernier, a d'ailleurs lancé à ce sujet quelques pistes de réflexion. Faisant le constat qu'il faut un allégement des normes, le Président de la République envisage de doter les collectivités territoriales d'un pouvoir d'adaptation local de la loi et du règlement quand l'intérêt général lié aux circonstances locales le justifie. Il souhaite aussi qu'aucune norme ne puisse être édictée sans l'avis favorable de la Commission consultative d'évaluation des normes, dont la composition pourrait évoluer. Il envisage aussi la possibilité que toute nouvelle norme soit accompagnée de la suppression d'une autre. Enfin, il a émis l'hypothèse de rendre caduque toute norme réglementaire qui n'aura pas été confirmée de manière expresse à une date fixée par la loi.
Vous le voyez, la simplification de l'édifice normatif est donc une préoccupation partagée par tous. Il faut apporter des réponses concrètes et efficaces, mais cette simplification doit se faire dans un cadre juridique clair, adapté, en accord avec nos principes constitutionnels. C'est tout le sens du travail qui s'annonce devant nous, auquel le Sénat a déjà commencé à réfléchir comme l'a annoncé Jean-Pierre Bel la semaine dernière et comme il l'a demandé, pas plus tard qu'hier, à la commission des lois et à la délégation des collectivités territoriales de la Haute assemblée.
Il faut apporter une solution tant à l'inflation qu'à l'impossibilité, pour nombre de collectivités locales, d'appliquer les normes. Cela mérite un texte plus approfondi, plus sécurisé et dont l'application ne soit pas susceptible de recours et encore moins d'inconstitutionnalité.
Enfin, un mot pour le rapporteur. J'ai apprécié, monsieur le rapporteur, le climat constructif et même courtois de nos échanges. Le travail que vous avez fourni, avec l'élaboration de cette proposition de loi, ne restera pas lettre morte. Il ne sera pas inutile, nonobstant le fait que notre assemblée va très certainement repousser la proposition de loi. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit dans le cadre de ces travaux préparatoires sera utile au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que nous arrivions ensemble à résoudre cette question des normes. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et écologiste.)

Madame la présidente, madame la ministre déléguée, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Pierre Morel-A-l'Huissier est attendue et utile.
Elle est attendue, car le constat est depuis trop longtemps partagé : il y a trop de lois en France, la loi est trop bavarde et, en définitive, nous le savons tous, trop de lois tuent la loi. Le Conseil d'État, dans son rapport de l'année 1992, relevait déjà « trop de logorrhée législative et parlementaire ».
Elle est utile car, à côté des textes, se trouve le contexte. Les élus ruraux que nous sommes les connaissent et les élus locaux que nous sommes nombreux à représenter dans cet hémicycle nous alertent constamment sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur le parcours du combattant qu'ils doivent accomplir au quotidien.
Si vous le voulez bien, je vous raconterai ce soir le quotidien de nos élus ruraux, le quotidien de ce maire d'une petite commune qui n'emploie qu'un agent au service technique. Savez-vous que ce maire, avant de l'envoyer changer une ampoule de la salle de conseil municipal, devra s'être assuré qu'il a bien suivi la formation pour obtenir le niveau d'habilitation électrique qui autorise à changer une lampe ? S'il lui vient ensuite l'idée de faire nettoyer les gouttières de la salle des fêtes, il aura bien sûr préalablement loué une nacelle, car l'échelle n'est plus un poste de travail, il aura donc a fortiori permis à son agent de suivre la formation pour obtenir l'autorisation de conduite adéquate, à savoir le CACES, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité.

Pour tondre la pelouse du terrain de football, notre maire aura encore invité son employé à suivre la formation qui correspond au matériel de tonte et lui aura délivré l'autorisation nécessaire. Quant au désherbage et au traitement des allées du cimetière, il va de soi que notre agent communal aura suivi la formation pour pouvoir utiliser des produits phytosanitaires.

Pour faire face à tant de risques, notre élu n'aura pas manqué de rédiger le document unique avec son employé, document obligatoire dans toute collectivité, qui retrace justement toutes les expositions aux risques et les mesures de prévention.
Allez, finissons la journée en beauté avec le marché hebdomadaire et la tournée des commerçants pour encaisser les droits de place. Vous vous en doutez, encore une fois, inutile d'envoyer votre agent accomplir cette tâche sans la formation nécessaire pour pouvoir détenir une caisse avec du numéraire, encore appelée régie. Vous n'aurez pas non plus omis de verser à votre agent la prime prévue pour cette haute responsabilité.
J'ai bien sûr gardé le meilleur pour la fin. Notre maire n'oubliera pas de solliciter chaque matin son employé, pour qu'il lui produise son permis de conduire. En effet, sa responsabilité ne manquerait pas d'être engagée si son employé s'était vu retirer son permis et avait omis de lui signaler…
Ce rapide exposé de la vie quotidienne de notre élu rural, qui ne dispose pas des services et des moyens d'une grande collectivité,…

…doit, s'il en était besoin, vous montrer toute la légitimité de cette proposition de loi.
Rapide exposé, dis-je, car les exemples sont légion dans tous les secteurs de la vie de nos communes, tels ces extincteurs dont une norme impose la vérification par un atelier agréé tous les dix ans alors qu'en pratique il revient moins cher de les remplacer et qu'il existe par ailleurs une obligation de contrôle de ces mêmes appareils tous les ans.
Que dire encore des moyens d'assurer la défense incendie qui est régie par une circulaire de 1951 et qui impose encore aujourd'hui de disposer des mêmes moyens en zone urbaine et dans nos hameaux ? Cela oblige nos élus à installer des usines à gaz ruineuses, voire à interdire, faute de moyens, tout aménagement des constructions existantes.
Rédiger un document d'urbanisme revient dorénavant à jouer au loto tant la législation en la matière est complexe et les documents de rang supérieur nombreux, ce qui rend ipso facto les recours d'autant plus aisés. Rappelons encore les obligations et coûts excessifs en matière de fouilles archéologiques, ou les contraintes liées à la présence d'un bâtiment protégé au sens du patrimoine architectural.
Face à cet empilement de normes nationales, de normes européennes, de multiples décrets, arrêtés, contraintes et lourdes procédures, de nombreux maires ruraux sont dépassés et désemparés.
La norme est utile, nul ne le conteste, mais le stock de normes explose. Bien qu'un commissaire à la simplification ait été nommé et qu'une commission pour évaluer l'impact des normes pour les collectivités ait le mérite d'exister, cette situation ubuesque perdure.
Par conséquent, si chacun dresse le même constat, le remède passe par cette proposition de loi. Elle repose en effet, d'une part, sur le principe de proportionnalité, afin d'adapter les normes aux territoires, et ainsi pouvoir tenir compte des spécificités du monde rural, d'autre part, sur le principe de la subsidiarité, car le niveau local est tout à fait en mesure de se voir confier des prérogatives en matière d'adaptation des lois.
Le dispositif est encadré. Le préfet aura ainsi un rôle pivot car c'est lui qui validera l'éventuelle dérogation.
Mes chers collègues, il faut écouter les préoccupations légitimes des élus du monde rural. Cette proposition de loi va dans le bon sens ; c'est pourquoi il paraît nécessaire de l'adopter. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre déléguée, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, la proposition qui nous est soumise aujourd'hui s'inscrit dans une série de tentatives qui se font jour depuis quelques années – on a plus particulièrement cité la proposition Doligé, puisqu'elle est en cours d'examen –, qui tendent à s'attaquer à la complexité du droit applicable tout particulièrement, mais pas seulement, aux collectivités locales. C'est un sujet qui mérite attention, même si sa dramatisation ne sert finalement personne.
Malheureusement, l'enfer est pavé de bonnes intentions et cette proposition de loi qui consiste, ni plus ni moins, en une dévolution aux communes, et dans une moindre mesure au préfet, du pouvoir réglementaire d'application des lois souffre d'au moins trois motifs d'inconstitutionnalité. Ces motifs sont tels que l'on s'étonne quelque peu de ce choix maximaliste, comme si se faire entendre était une raison plus forte qu'arriver à un dispositif vraiment praticable, c'est-à-dire vraiment utile aux communes, ce qui est normalement l'objectif recherché.
Premier motif d'inconstitutionnalité, cette loi méconnaît l'article 21 de la Constitution, qui donne au Premier ministre et à lui seul – c'est clair – le pouvoir d'appliquer les lois. Encore le Premier ministre lui-même ne peut-il déroger à la loi que dans les cas et selon les critères que celle-ci a prévus.
Le Conseil constitutionnel exerce en la matière, on le sait, une vigilance particulière. Mme la ministre déléguée et d'autres orateurs ont rappelé sa décision du 28 juillet 2011, qu'il est d'ailleurs permis de trouver extrêmement sévère ; du moins est-ce mon appréciation.
Deuxième motif d'inconstitutionnalité, cette proposition de loi – M. Dussopt l'a très opportunément rappelé – méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'il résulterait de son application que les usagers du service public seraient traités différemment à Aurillac et à Romorantin. Non seulement les petites communes rurales prendraient des mesures dérogatoires par rapport aux normes d'ensemble mais ces normes elles-mêmes pourraient varier d'une commune à l'autre, voire à l'intérieur d'une même commune, et la fragmentation se poursuivre quasiment sans frein. Cela intéresserait peut-être les physiciens nucléaires, mais, tout de même, derrière cela, quelle vision, quelle vision désastreuse du service public et des besoins de l'usager ! Il fallait que cela fût quand même rappelé une fois.
Troisième et dernier motif d'inconstitutionnalité, ce texte souffre – cela aussi a été rappelé – d'un défaut de clarté et d'intelligibilité. Or ces principes ont valeur constitutionnelle. D'une part, les catégories de communes en cause ne sont pas définies. D'autre part, les cas dans lesquels il serait possible de déroger à la loi ne sont pas non plus encadrés avec une précision suffisante, les obstacles techniques et l'impossibilité financière étant laissés à l'appréciation de chaque commune, mais nous atteignons là à un deuxième degré d'inconstitutionnalité.
On le voit, s'il n'est certes pas faux de dire qu'aujourd'hui le poids des normes de toute nature a quelque chose d'accablant – ce qui vient d'être rappelé avec esprit –, singulièrement pour les petites communes, le remède proposé risque d'être pire que le mal. Je ne veux pas sous-estimer ce dernier. Il n'est pas nécessaire de cumuler un mandat local et un mandat national, l'élu national se rend compte du poids des normes auxquelles sont soumises les petites communes.
Alors, quelles pistes envisager ? On peut mettre quelque espoir dans le fait, d'abord, que tous les pouvoirs de ce pays – Sénat, Assemblée nationale, Gouvernement et, tout récemment encore, le Président de la République – se sont montrés sensibles au poids des normes qui est aussi un aspect de la bonne application des lois.
Il me semble que ce sera donc à la loi, à l'avenir, de se soucier tout particulièrement de l'applicabilité des normes qu'elle définit ; à la loi, c'est-à-dire à nous-même, législateur, qui nous faisons ici une leçon que nous pourrions tirer pour l'avenir.
Cela est vrai pour le flux, mais il reste le stock, et le nombre des normes aujourd'hui applicables est considérable. Il serait sans doute bon qu'un groupe ad hoc constitué d'élus se penchât sur une évaluation raisonnable des règles applicables avec l'appui de la Commission consultative d'évaluation des normes. Y voyant plus clair, le législateur pourrait alors revenir sur ses excès précédents. Soulignons d'ailleurs qu'il ne pourrait le faire que dans le champ non communautaire. Or de très nombreuses normes européennes s'appliquent aujourd'hui, et font partie du fardeau ; la part qu'elles y prennent mériterait d'ailleurs une évaluation. À la suite des travaux de ce groupe, une loi de portée générale, transversale, qui désignerait les principaux domaines dans lesquels il y aurait lieu d'alléger les normes et de donner des dérogations serait tout à fait imaginable, elle pourrait, le cas échéant, être inscrite au code général des collectivités territoriales.
Le législateur n'en a donc pas fini avec les normes, c'est-à-dire qu'il n'en a pas fini avec lui-même, et c'est finalement heureux. Il ne doit cependant pas se tromper sur les moyens à employer, faute de quoi il n'aboutirait qu'à repousser la solution du problème. C'est malheureusement ce que fait le présent texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la tradition juridique française se caractérise par une application uniforme et sans exception des normes, dès leur adoption, sur l'ensemble du territoire national.
Pourtant notre pays s'illustre par un activisme normatif que l'on pourrait, pour le coup, aisément qualifier de hors norme. Il en résulte des chiffres astronomiques : 8 000 lois, 400 000 normes sont présentes dans l'ordre juridique français ! Si les normes sont nécessaires, leur application, voire leur applicabilité sur le terrain ne sont pas toujours assurées.
Il y a là un paradoxe inhérent à la norme : utile, indispensable, elle est bien souvent réclamée, mais pose également de grandes difficultés de mise en oeuvre. Comme cela nous a été rappelé, les exemples sont légion, notamment dans les territoires ruraux que nous sommes nombreux à représenter dans cet hémicycle. L'accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite est une exigence incontestable, mais elle inquiète nombre d'élus locaux, qui nous le disent. Les retards sont tels que les délais prévus ne pourront pas être respectés. Le rapport publié hier, le 10 octobre, par l'Observatoire interministériel de l'accessibilité le montre. Il souligne que l'absence d'une politique coordonnée en matière d'accessibilité des établissements publics aux personnes handicapées a conduit à d'importantes inégalités sur l'ensemble du territoire. Une plus grande adaptabilité des normes aurait probablement apporté des solutions et des réponses aux difficultés et aux inégalités soulevées.
Les normes d'urbanisme sont souvent perçues par les élus comme des contraintes car elles posent beaucoup de difficultés d'application. Les normes concernant les espèces d'animaux nuisibles ne tiennent pas compte des spécificités de chaque territoire. En outre, la production normative a une incidence considérable sur les finances publiques. Cela a été rappelé notamment par Mme la ministre.
Il est donc plus que temps de se pencher sur le problème du stock normatif et d'apporter des réponses et des solutions concrètes à cette inflation normative qui est désormais contre-productive. Un moratoire sur les normes réglementaires relatives aux collectivités locales a bien été décidé en 2010, mais il n'a pas atteint l'objectif escompté.
La proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui tend à répondre concrètement à cette situation. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un certain consensus : puisque nul ne saurait remettre en cause l'utilité des normes, il convient de rechercher une meilleure articulation entre celles-ci et leur application locale.
Sans remettre en cause le principe d'égalité, qui reste tout à fait intangible, il peut paraître utile – voire nécessaire – d'instaurer une application conforme aux réalités locales, car lorsque l'égalité se mue finalement en source d'inégalités, la situation change considérablement.

Je pense notamment aux nombreux maires de ma circonscription de l'Orne, qui sont parfois complètement démunis face aux subtilités des normes en matière d'urbanisme, et qui m'ont souvent relaté la difficulté d'appliquer tel ou tel dispositif.
Instaurer des principes d'adaptabilité et de subsidiarité en faveur des territoires ruraux me paraît de bon augure. Certaines normes, en effet, ne peuvent être appliquées de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. La souplesse normative est de loin préférable à une rigidité normative contre-productive. Certaines normes tiennent, certes, déjà compte des spécificités des territoires, comme en matière de plans d'occupations des sols, par exemple. Chaque commune, dans ce domaine, adopte son propre plan.
L'application d'une même norme à Paris et dans une collectivité rurale de quelques centaines – voire quelques dizaines – d'habitants n'a manifestement pas les mêmes incidences. Les grandes collectivités disposent de services juridiques qui n'existent pas dans les communes rurales, où parfois le maire doit gérer lui-même son secrétariat ! Cet exemple peut paraître quelque peu caricatural, mais mon propos n'est pas de refaire ici l'analyse de Paris et du désert français. La carte de la France n'en reste pas moins marquée par des disproportions qui composent une mosaïque de situations différentes : d'une part, de multiples petites communes et, à l'autre extrémité du spectre, de grandes métropoles.
J'ai entendu un précédent orateur proposer une réflexion sur l'évolution des normes dans le cadre de la région. Les territoires sont également très divers au niveau régional.
C'est pourquoi le dispositif prévu par la proposition de loi me paraît totalement équilibré et ne vise aucunement à diminuer la portée des normes. Un mécanisme de veille est prévu : les préfets surveilleront cette adaptabilité.
En outre, adapter une norme ne signifie aucunement la vider de sa substance. Le long et patient travail orchestré notamment par le rapporteur, Pierre Morel-A-l'-Huissier, est un signe positif qui ne peut, mes chers collègues, que nous inciter à voter en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le constat de l'inflation normative et de ses effets néfastes est à l'évidence partagé sur tous les bancs de cet hémicycle, mais aussi bien au-delà de notre assemblée.
La consultation récemment lancée par nos collègues sénateurs à l'occasion des états généraux de la démocratie territoriale a montré, s'il en était besoin, que les élus locaux considèrent la prolifération des normes, parfois qualifiée de harcèlement textuel, comme un élément majeur de complexité dans l'exercice des responsabilités locales. Le stock des quelque 400 000 normes applicables aux interventions des collectivités fait peser à l'évidence un risque juridique sur la tête des élus locaux comme, d'ailleurs, des fonctionnaires territoriaux.
À la quantité des normes s'ajoute leur instabilité. En dix ans, 80 % des articles législatifs et 55 % des articles réglementaires du code général des collectivités territoriales ont été modifiés.
Le stock et le flux de textes réglementaires ont enfin des conséquences directes sur les budgets locaux. Plus de 500 millions d'euros de dépenses supplémentaires par an sont directement induits par les modifications de l'édifice normatif, selon les estimations manifestement basses du président du Sénat. Il y a là une forme de contournement de la décentralisation et, à tout le moins une entorse à la libre administration des collectivités locales.
Pour être objectif, ce constat n'en a pas moins des causes. Nos collègues nous ont fait tout à l'heure le récit des parcours du combattant que certains maires connaissent. Pour autant, n'ignorons pas notre responsabilité de législateur. Je m'adresse en particulier à nos collègues de l'opposition : vous êtes responsables de la multiplication, au cours des dix dernières années, de certaines lois-prétextes ou lois-parapluies visant à répondre à l'émotion souvent légitime suscitée par un fait divers.

Limiter les normes, c'est aussi favoriser la rationalité de notre travail législatif. Cette proposition de loi apporte, selon nous, une réponse inadaptée à une question juste que le rapporteur a eu raison de soulever. Je le salue.
En premier lieu, comme cela a déjà été dit, le champ d'application du texte pose problème. Les articles de la proposition de loi ne visent pas une catégorie particulière de collectivités, mais l'exposé des motifs et surtout le titre lui-même limitent les principes édictés par ce texte au milieu rural, sans jamais d'ailleurs le définir. Sans méconnaître les difficultés particulières du monde rural, je voudrais que nous ne versions pas pour autant dans les simplifications. Deux idées potentiellement erronées sous-tendent cette proposition de loi.
Premièrement, les petites communes ne sont pas forcément rurales. Le manque d'expertise, qui limite leur capacité à connaître et appliquer les normes, se rencontre aussi en milieu péri-urbain. Je qualifierai une deuxième idée de fausse : les petites collectivités n'ont pas forcément un potentiel financier réduit et, a contrario, les grandes collectivités n'ont pas toujours un potentiel financier élevé. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.) J'en veux pour preuve la situation particulière des communes dont l'essentiel du territoire est classé en zone urbaine sensible. Elles doivent faire face à des charges accrues pour des recettes minorées, et sont de ce fait particulièrement victimes de l'inflation normative.
Comme l'écrit régulièrement le Conseil national des villes dans ses avis, les villes dites pauvres, quels que soient leur nombre d'habitants et leur situation géographique, sont confrontées à un double défi : d'une part conforter l'environnement urbain économique, social, éducatif et culturel de l'ensemble de la population, mais aussi corriger les inégalités de tous ordres qui frappent les habitants les plus démunis, qui sont souvent cantonnés dans les territoires les plus sensibles.
La simplification des normes concerne donc bien toutes les collectivités. Elle n'est pas détachable d'une réflexion globale sur l'égalité des territoires et ses corollaires que sont l'organisation territoriale et l'exercice des compétences d'une part, mais aussi la péréquation financière d'autre part.
Plutôt que d'adopter une proposition de loi manifestement entachée d'inconstitutionnalité, notamment parce qu'elle contrevient de manière manifeste au principe d'égalité, plutôt que de répondre par un texte au problème de la prolifération des textes, adoptons une autre démarche, comme vous nous y avez invités, madame la ministre !
Le Président de la République nous y a également invités dans son discours prononcé le 5 octobre à l'occasion des états généraux de la démocratie territoriale, qui a été abondamment – et à juste titre – cité ce soir. La feuille de route claire qu'il a donnée intègre la question des normes comme un élément du pacte de confiance entre l'État et des collectivités locales qui, il est vrai, ont été particulièrement malmenées, méprisées et rendues coupables de tous les maux ces dix dernières années.
Retrouver les chemins d'une décentralisation apaisée, comme nous y invitera le projet de loi sur l'acte III de la décentralisation qui nous sera soumis début 2013, c'est admettre qu'en matière de normes, l'égalité n'est pas l'uniformité, que la France est riche de la diversité de ses territoires, et que les chemins de la croissance et du redressement passent aussi par une mise en synergie des acteurs locaux dans une République des territoires modernisée.
En votant contre cette proposition de loi, que nous jugeons juridiquement inaboutie et inadaptée, notre groupe entend poursuivre une réflexion qui devra avancer rapidement et s'inscrire dans un mouvement global. Sans renvoyer formellement à l'acte III de la décentralisation, il va de soi que la question de la simplification des normes et de leur adaptation est indissociable de l'évolution de notre organisation territoriale. La réponse aux difficultés des collectivités les plus défavorisées, indépendamment de leur taille, passe aussi par le développement des coopérations intercommunales et des processus de mutualisation. La question des ressources et de la consolidation des outils de péréquation est aussi liée à cette démarche. Le changement, attendu par les élus locaux, doit s'écrire globalement en se fondant sur la confiance et la stabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, nous souscrivons à la nécessité de stopper l'inflation de la production normative, les 400 000 normes existantes étant indubitablement un frein à l'action des collectivités territoriales. Il nous apparaît crucial de faciliter le travail des élus de nos collectivités territoriales au quotidien. Nous n'en restons pas moins très réservés, voire plutôt opposés, aux solutions avancées par cette proposition pour y remédier.
Nombre de sujétions, c'est certain, sont insupportables, allant à l'encontre de l'efficacité de l'action locale et étant contraire à une bonne utilisation des deniers publics. On peut accorder aux auteurs de cette proposition de loi une bonne intention pour tenter de répondre à un besoin réel ! Mais cela ne suffit pas.
De prime abord, il a été rappelé lors des débats en commission ainsi qu'aujourd'hui que cette proposition présente un risque d'inconstitutionnalité, notamment parce qu'elle introduit une possibilité de déroger de manière bien trop évasive à la loi, autorisant ainsi la violation, de manière bien trop manifeste, du principe d'égalité d'accès au service public.
J'ai bien entendu l'opposition affirmer sa volonté de pragmatisme. On peut admettre la nécessité de simplification que cette proposition de loi entend traduire, mais on ne peut risquer de voter une nouvelle fois un texte fragile sur le plan juridique, comme l'a souligné M. le président de la commission des lois.
Ensuite, et c'est là où l'esprit de ce texte semble revêtir un caractère de division inutile, il introduit une distinction entre territoire rural et territoire urbain, alors qu'il faudrait plutôt renforcer leur complémentarité. C'est à vrai dire presque implicite : le texte initial ne contient pas les mots rural et ruralité. Le titre de la proposition de loi amorce cette différenciation, puis un amendement introduit explicitement l'idée, enfin le rapport la développe.
L'application des normes a un coût. C'est donc aussi un sujet financier : à cet égard, les collectivités diffèrent moins par leur caractère urbain ou rural que par les moyens dont elles disposent. On ne peut sous-entendre, comme le fait le rapport de la commission, que la loi est faite par et pour les villes au détriment du monde rural.
Enfin, cette proposition de loi s'en prend trop directement au législateur, présenté comme forcément déconnecté de la réalité locale, et toujours enclin à produire – je cite l'exposé des motifs – des normes manifestement disproportionnées. Aussi témoigne-t-elle d'une tentation grandissante dans notre République, celle de dénier aux normes leur légitimité. Cette tendance est dangereuse, et il est de notre responsabilité de la freiner.
En renforçant le rôle de la Commission consultative d'évaluation des normes, déjà pourrions-nous éviter la prolifération des normes et l'écueil de porter atteinte au travail du législateur, législateur qui devra s'investir dans le travail de révision des normes qu'il doit opérer dans le cadre de son pouvoir d'évaluation. Une mission à développer !
Par l'édiction de normes, l'État a continué d'intervenir régulièrement dans l'exercice des responsabilités locales. Forme de tutelle déguisée ? Décentralisation contournée ?
C'est en rétablissant la confiance entre l'État et les collectivités territoriales, dont en insufflant un changement de comportement et de relations, en faisant confiance à l'intelligence des territoires et de ses élus, en clarifiant les responsabilités de chacun, en donnant de la cohérence aux politiques menées par les collectivités, souhaits exprimés par le Président de la République, lors des États généraux de la démocratie territoriale, que l'on construira une gouvernance appropriée aux réalités des territoires quels qu'ils soient. L'allégement des normes peut découler, aussi, d'une confiance mutuelle.
Il ne s'agit pas, ici, de nier qu'il n'existe pas de particularité locale, de spécificités qui nécessitent des traitements différents. L'égalité n'est pas l'uniformité, cela a été répété à plusieurs reprises. Le Président de la République avait, lui-même, pendant la campagne présidentielle, parlé de bouclier rural.
Il nous faut donc engranger toute cette réflexion sur l'édiction des normes et leur mise en oeuvre, se mettre à la tâche et préparer un texte sécurisé qui nous permette de prendre le bon cap. Ce sera ce texte utile qu'attendent les élus des territoires.
Par ailleurs, l'acte III de la décentralisation construit avec les collectivités permettra aux territoires de maîtriser leur devenir, d'impliquer chacun dans la démocratie locale et d'offrir un service public au plus près des citoyens. Tel est l'enjeu de la décentralisation. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Je voudrais d'abord saluer l'esprit dans lequel vous avez abordé la discussion parlementaire sur ce texte, madame la ministre. J'ai noté la convergence sur la volonté d'agir. Je vous remercie d'avoir rappelé que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à Rodez, lors d'un déjeuner de travail qui nous a permis d'aborder la réalité de la ruralité. Certes, le Conseil d'État n'a pas accepté, faute de savoir comment y parvenir, la notion de « ruralité et exception ».
Nous avons souhaité, avec Yannick Favennec, Étienne Blanc et Daniel Fasquelle, apporter, avec ce texte, un début de réponse à une vraie problématique que tout le monde a, ici, soulignée.
Vous avez parlé d'imprécision, du coût des normes, de la longueur des procédures et de la complexité. Je ne serai pas cruel. Toutefois, un de vos collègues socialiste que j'apprécie, Michel Vergnier, député de la Creuse, lui aussi député d'un département rural, a déposé une proposition de loi similaire,…

…identique, à la virgule près. Je copréside avec lui la commission affaires rurales de l'Association des Maires de France. Nous partageons les mêmes orientations et essayons de faire fi du débat idéologique.
Monsieur le président de la commission des lois, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous, je vous l'ai déjà dit. Je retiendrai le terme « incontinence », lequel restera très important. Certains ont parlé de « harcèlement textuel », on pourrait également parler de logorrhée permanente du législateur et de l'aspect décrétal. J'ai fait un rêve : celui que la commission des lois puisse parfaire ce texte. Il me semblait que c'était son rôle d'analyser, article par article, comme nous l'avons fait avec Étienne Blanc et Yannick Favennec, pour tenter, avec l'ensemble de la représentation parlementaire, de compléter éventuellement ce texte. Ce rêve est un peu déçu, monsieur le président, même si je ne peux que saluer votre volonté d'agir et votre ouverture d'esprit dont vous avez largement fait preuve dès que j'ai voulu accomplir un travail au sein de cette commission.
Étienne Blanc, vous avez rappelé tous les aspects juridiques et particulièrement l'alinéa 4 de l'article 72 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme. Vous êtes l'auteur de nombreuses lois de simplification. Vous savez le travail colossal que cela représente. Vous avez rappelé que ce texte s'inscrivait dans un cadre constitutionnel et juridique.
Yannick Favennec a rappelé la démotivation totale des acteurs des territoires ruraux ainsi que l'intelligence des territoires.
Je saluerai les propos tenus en commission des lois et ici même, ce soir, par Paul Molac, originaire du Morbihan. Il a ainsi parlé de frénésie textuelle et de surenchère permanente de la norme. Je le rejoins totalement en cela. Je comprends qu'il ait soulevé des problèmes inhérents à l'inconstitutionnalité, à la proportionnalité et au rôle du préfet. Je salue toutefois sa volonté d'agir en faveur d'une respiration des territoires.
Olivier Dussopt, vous avez parlé d'objectifs communs et avez ajouté qu'il n'y avait pas de clivage idéologique. Vous êtes allé au-delà de ce que je souhaitais, ce dont je vous remercie du fond du coeur. J'ai toujours, dans mon action politique, essayé de faire fi d'un certain nombre de clivages politiques. J'ai agi ainsi à l'occasion de loi, aujourd'hui reconnue par tout le monde, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. J'ai essayé, dans cette proposition de loi relative aux normes rurales de faire oeuvre utile. J'ai précisé qu'il n'y avait pas de coup politique, puisqu'elle résulte d'un travail d'un an et demi. Vous avez souligné que la discussion s'était déroulée dans un esprit d'ouverture et de sympathie. Je vous en remercie, même si vous avez noté l'imprécision, voire les difficultés d'applicabilité, la non-définition de la ruralité, le rôle du préfet et l'atteinte au principe d'égalité.
Nous sommes dans une République décentralisée. Je suis donc assez étonné que, dans cette Assemblée nationale, certains souhaitent revenir à la centralisation et veuillent que cette République soit normée. Lâchons-nous un peu ! Je ne dis pas cela en référence à l'incontinence. (Sourires.) Je vous voyais venir, monsieur le président Urvoas… (Nouveaux sourires.)
J'ai souhaité, pour ma part, que, grâce à ce débat, l'on offre aux territoires quelque peu d'oxygène et de respiration. Je sens bien le blocage. J'espérais qu'en commission et dans l'hémicycle, on puisse faire un bout de chemin. Le Sénat aurait, ensuite, peut-être corrigé telle ou telle évolution un peu trop importante votée par l'Assemblée nationale.
Marianne Dubois, vous avez à juste titre rappelé l'utilité de cette proposition de loi et vous avez fort bien décrit, de manière imagée, le quotidien des élus locaux.
Mme Marie-Françoise Bechtel, votre plaidoyer sur l'inconstitutionnalité a été très dur. En fait, vous avez « dézingué » mon texte à l'aide de nombreux arguments juridiques. Je tiens à vous préciser que nous avons rencontré au Conseil d'État M. Sauvé et des présidents de sections administratives. Ils nous ont répondu qu'il était difficile de soulever une exception de ruralité considérant le principe d'égalité. Ils nous ont alors renvoyés devant le Conseil constitutionnel. Ce dernier nous a alors été précisé que l'émergence d'un principe juridique nouveau ne portait absolument pas atteinte au principe d'égalité à partir du moment où il était bien encadré et où les critères étaient définis précisément. Si j'en crois ce qui m'a été expliqué, le Conseil constitutionnel n'y voyait aucun inconvénient. On nous a même parlé du stock et du flux. Ainsi, chaque fois que nous serons amenés à voter une loi, on nous a conseillé, d'une part, d'agir comme pour les DOM-TOM ou pour la Corse et de prévoir diverses mesures en faveur des territoires ruraux – c'est le flux –, d'autre part, d'envisager un principe nouveau d'assouplissement, de dérogation – c'est le stock. C'est sur cet aspect que je me bats et que je continuerai à me battre.
Madame Véronique Louwagie, vous avez une vision très objective de cette problématique et je tenais à vous en remercier.
Madame Nathalie Appéré, je vous rejoins sur la simplification des normes et l'égalité des territoires. Quant au fait que cette proposition de loi serait inaboutie, je vous répondrai qu'elle est une proposition et que j'espérais que le débat parlementaire aboutirait sur des aspects très circonstanciés et que l'on pourrait accomplir un travail utile.
Madame François Descamps-Crosnier, vous avez parlé d'inconstitutionnalité. Le législateur a pour rôle, à un moment donné et en fonction de l'évolution de la société, d'envisager certaines améliorations. Il me semble que nous aurions pu, dans cette enceinte, faire oeuvre utile et progresser en matière de dérogations dont pourraient bénéficier les territoires ruraux, notamment.
J'ai beaucoup apprécié le vocabulaire : frénésie textuelle, harcèlement textuel, logorrhée, incontinence… Le mot « exaspération » est bien souvent revenu au cours du débat, ce qui montre effectivement quel est le poids de ces normes et combien il nous faut nous battre ensemble contre cette profusion. Je me réjouis que nous soyons tous d'accord sur ce point et également tous d'accord pour reconnaître que notre République, si elle est bien décentralisée, est une et multiple. Il nous faut donc trouver les modalités de lier les principes d'unicité et de multiplicité, et ce toujours dans le respect de la Constitution.
Je ferai de très brèves observations.
Je salue la proposition de Mme Bechtel de prévoir une évaluation. Il serait effectivement essentiel à un moment donné, d'évaluer ce stock et de voir comment aller au-delà.
Monsieur Blanc, j'ai beaucoup apprécié vos propos, notamment en ce qui concerne l'expérimentation. Permettez-moi simplement de préciser le cadre tel qu'il a été défini, aujourd'hui, dans le code général des collectivités territoriales. L'expérimentation ne peut excéder une période de cinq ans. Elle doit répondre à la nature juridique et aux caractéristiques des collectivités locales autorisées à y participer. La prolongation de l'expérimentation peut intervenir pour une période de trois ans au terme de laquelle elle sera soit généralisée, soit abandonnée. Je tenais à apporter cette précision parce que l'on parle aujourd'hui beaucoup d'expérimentation, sans toutefois la mesurer totalement, dans le cadre de la réflexion sur l'acte III de la décentralisation.
Pour conclure, et avant de prolonger notre débat, je dirai qu'à défaut de ne pouvoir instaurer ou réinstaurer – j'ai beaucoup aussi apprécié l'exception d'ignorance ! – il nous faut, aujourd'hui, veiller à ne pas ajouter une incertitude juridique, que vous avez tous soulignée, aux difficultés importantes que rencontrent, c'est vrai, nos collectivités territoriales. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Vous venez de parler, madame la ministre, de prolonger nos débats. Ce terme est utilisé, oserai-je le dire, à point nommé. Nous allons devoir examiner une vingtaine d'amendements. Deux options s'offrent à nous : soit lever notre séance pour la reprendre à vingt et une heures trente, soit la poursuivre et examiner ces amendements dès maintenant. J'ose imaginer que chacun d'entre vous pourra, s'il le souhaite, aller se sustenter, si tant est qu'il en ait besoin ! Je pense, pour ma part, qu'il serait bien que nous discutions dès maintenant de ces vingt amendements, ce qui nous éviterait de siéger à vingt et une heures trente. Puis-je considérer que j'ai l'accord du Gouvernement et de la commission ?
Tout à fait !

J'appelle, maintenant, les articles de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été saisie initialement, puisque la commission n'a pas adopté le texte.

Cet amendement est rédactionnel.
Je tiens à préciser, madame la présidente, que la commission a rejeté tous les amendements. Je n'y reviendrai donc pas.
Avis défavorable puisqu'il n'ajoute rien au texte.

Je tiens à souligner que nous avons voté, en commission, contre la proposition de lois donc contre les trois articles et les vingt amendements.
En écho à ce qu'a précisé tout à l'heure M. le rapporteur, s'agissant d'une proposition de loi quasi-identique déposée par certains de nos collègues, je voulais le rassurer en lui indiquant qu'ils l'ont retirée parce qu'ils font confiance aux initiatives du président du Sénat et du Président de la République. Mais vous serez associé à ce travail, mon cher collègue !
Toutefois, même si nous nous sommes prononcés en commission contre les amendements, nous en reconnaissons la valeur et l'utilité, puisque nombre d'entre eux – je pense notamment aux amendements n°s 3 , 7 et 8 – sont de nature à améliorer le texte et à remédier à un certain nombre de défauts que nous avons pointés, même s'ils ne répondent pas à la question de la constitutionnalité.
Nous voterons contre l'ensemble de ces amendements.
(L'amendement n° 1 n'est pas adopté.)






Nous avons achevé l'examen des articles de la proposition de loi.
Je vous rappelle que les explications de vote et le vote, par scrutin public auront lieu le mardi 16 octobre, après les questions au gouvernement.

Prochaine séance, lundi 15 octobre, à seize heures, salle Lamartine :
Débat sur la prise en compte des orientations budgétaires européennes par le projet de loi de finances dans le cadre du semestre européen.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures vingt.)
Le Directeur du service du compte rendu de la séance de l'Assemblée nationale,
Nicolas Véron